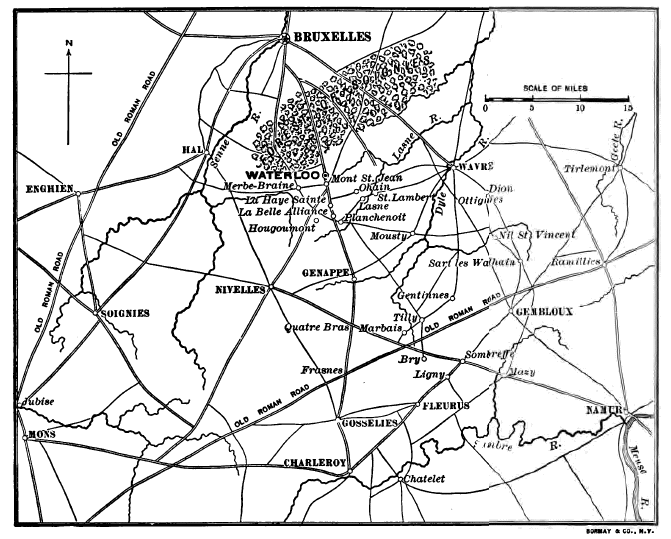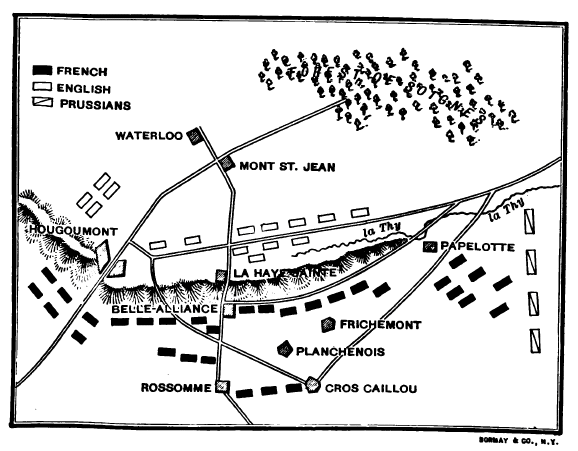LA CAMPAGNE DE WATERLOO
ADOLPHE THIERS
SILVER, BURDETT AND
COMPANY
NEW YORK - BOSTON - CHICAGO
|
Les troupes se succédaient dans l'ordre suivant : la cavalerie légère de Subervic, les cuirassiers de Milhaud avec quelques batteries d'artillerie à cheval, l'infanterie d'Erlon (1er corps), celle de Lobau (6e corps), les cuirassiers de Kellermann, la garde, et enfin le corps de Reille (2e), qui, fortement engagé aux Quatre-Bras, avait employé la matinée à se remettre du rude combat de la veille. Napoléon marchait avec l'avant-garde qu'il dirigeait en personne. On avait à traverser le gros bourg de Genappe, où l'on franchit la Dyle. Les Anglais avaient mis leur cavalerie à l'arrière-garde, pour ralentir notre marche par des charges exécutées avec à-propos et vigueur, toutes les fois que le terrain le permettrait. En approchant de Genappe le sol s'abaissait, et une fois la Dyle passée se relevait, de manière que nous avions en face de nous l'arrière-garde anglaise, vivement pressée par notre avant-garde. Napoléon ordonnant lui-même tous les mouvements sous une pluie torrentueuse, avait fait amener vingt-quatre bouches à feu, qui tiraient à outrance sur les colonnes en retraite. Les Anglais ayant hâte de s'éloigner ne prenaient pas le temps de riposter, et recevaient sans les rendre des boulets qui faisaient dans leurs masses vivantes des trouées profondes. Au sortir de Genappe les hussards anglais chargèrent notre cavalerie, mais ils furent presque aussitôt culbutés par nos lanciers. A son tour lord Uxbridge, à la tête des gardes à cheval, chargea nos lanciers et les ramena. Mais nos cuirassiers fondant sur les gardes à cheval les forcèrent de se replier. En quelques minutes la route fut couverte de blessés et de morts, la plupart ennemis. Notre canon surtout avait jonché la terre de débris humains qui étaient hideux à voir. Dans ces diverses rencontres le colonel Sourd, le modèle des braves, se couvrit de gloire. Avec un bras haché de coups de sabre et à moitié séparé du corps, il s'obstina à rester à cheval. Il n'en descendit que pour subir une amputation qui ne diminua ni son ardeur ni son courage, car à peine amputé il se remit en selle, et commanda son régiment jusque sous les murs de Paris. Napoléon, au milieu de ces charges de cavalerie, ne cessa pas un instant de diriger lui-même l'avant-garde. La marche fut lente néanmoins, car Anglais et Français pliaient sous la violence de l'orage. Quelques heures n'avaient pas suffi pour décharger le ciel des masses d'eau qu'il contenait, et nos troupes étaient tombées dans un état déplorable. La chaussée pavée ne pouvant plus les porter toutes, il avait fallu que l'infanterie cédât le pas à l'artillerie et à la cavalerie ; elle s'était donc jetée à droite et à gauche de la route, et elle enfonçait jusqu'à mi-jambe dans les terres grasses de la Belgique. Bientôt il lui devint impossible de conserver ses rangs ; chacun marcha comme il voulut et comme il put, suivant de loin la colonne de cavalerie et d'artillerie qu'on apercevait sur la chaussée pavée. Vers la fin du jour la souffrance s'accrut avec la durée de la pluie et avec la nuit. Les cœurs se serrèrent, comme si on avait vu dans ces rigueurs du ciel un signe avant-coureur d'un désastre. On se serait consolé, si au terme de cette pénible marche on avait espéré joindre les Anglais, et terminer sur un terrain propre à combattre les longues inimitiés des deux nations. Mais on ne savait s'ils n'allaient pas disparaître dans les profondeurs de la forêt de Soignes, et se réunir aux Prussiens derrière l'épais rideau de cette forêt. Parmi les blessés ennemis on avait recueilli un officier, appartenant à la famille de lord Elphinston, et on l'avait amené à Napoléon, qui l'avait accueilli avec beaucoup d'égards, et interrogé avec adresse dans l'espoir de lui arracher le secret du duc de Wellington, qu'il était en position de connaître. Cet officier répondant à Napoléon avec autant de noblesse que de convenance, lui déclara que tombé au pouvoir des Français, il ne trahirait point son pays pour se ménager de meilleurs traitements. Napoléon respectant ce sentiment, chargea M. de Flahault de lui prodiguer tous les soins qu'on aurait donnés à un Français objet de la plus grande faveur. Mais il n'avait rien appris, ou presque rien, des projets de l'armée britannique. A la chute du jour, en suivant la chaussée de Bruxelles à travers une plaine fortement ondulée, on arriva sur une éminence d'où l'on découvrait tout le pays d'alentour. On était au pied de la célèbre position de Mont-Saint-Jean, et au delà on apercevait la sombre verdure de la forêt de Soignes. Les Anglais, qui s'étaient mis en marche de bonne heure, avaient eu le temps de se bien asseoir derrière cette position, où l'élévation du sol les préservait d'une partie des souffrances que nous endurions, et où leur service des vivres, chèrement payé, leur avait préparé d'abondantes ressources. Établis sur le revers du coteau de Mont-Saint-Jean, on les entrevoyait à peine. D'ailleurs une brume épaisse succédant à la pluie, enveloppait la campagne, et avait ainsi hâté de deux heures l'obscurité de la nuit. On ne pouvait donc rien discerner, et Napoléon restait dans un doute pénible ; car si les Anglais s'étaient engagés dans la forêt de Soignes pour la traverser pendant la nuit, il était à présumer qu'ils iraient rejoindre les Prussiens derrière Bruxelles, et que le plan de les rencontrer séparément, si heureusement réalisé jusqu'ici, finirait par échouer. Il était difficile en effet de se porter au delà de Bruxelles pour combattre deux cent mille ennemis braves et passionnés, avec cent mille soldats, héroïques mais réduits à la proportion d'un contre deux, en songeant surtout qu'à cent cinquante lieues sur notre droite avançait la grande colonne des Autrichiens et des Russes. Dévoré de l'inquiétude que cette situation faisait naître, Napoléon, pour la dissiper, ordonna aux cuirassiers de Milhaud de se déployer en faisant feu de toute leur artillerie. Cette manœuvre s'étant immédiatement exécutée, les Anglais démasquèrent une cinquantaine de bouches à feu, et couvrirent ainsi de boulets le bassin qui les séparait de nous. Napoléon descendit alors de cheval, et suivi de deux ou trois officiers seulement se mit à étudier lui-même la position dont l'armée britannique semblait avoir fait choix. Il entendait à chaque instant les boulets s'enfoncer lourdement dans une boue épaisse qu'ils faisaient jaillir de tous côtés. Il fut soulagé par ce spectacle d'une partie de ses inquiétudes, car il conclut de cette canonnade si prompte et si étendue, qu'il n'avait pas devant lui une simple arrière-garde s'arrêtant au détour d'un chemin pour ralentir la poursuite de l'ennemi, mais une armée entière en position, se couvrant de tous ses feux. Il ne doutait donc presque plus de la bataille, et sur son cœur si chargé de soucis il ne restait désormais que les incertitudes de la bataille elle-même. C'était bien assez pour le cœur le plus ferme. ! Au surplus, il avait un tel sentiment de son savoir-faire et de l'énergie de ses soldats, qu'il ne demandait à la Providence que la bataille, se chargeant comme autrefois d'en faire une victoire ! Cette preuve de la présence des Anglais obtenue, il ordonna au général Milhaud de replier ses cuirassiers, afin de leur procurer le repos dont ils avaient grand besoin pour la formidable journée du lendemain. Quant à lui, ayant laissé son état-major en arrière, il se mit à longer le pied de la hauteur qu'occupaient les Anglais. Accompagné du grand maréchal Bertrand et de son premier page Gudin, il se promena longtemps, cherchant à se rendre compte de la position qui devait être bientôt arrosée de tant de sang. A chaque pas il enfonçait profondément dans la boue, et pour en sortir s'appuyait tantôt sur le bras du grand maréchal, tantôt sur celui du jeune Gudin, puis dirigeait sur l'ennemi la petite lunette qu'il avait dans sa poche. Ne prêtant guère attention aux boulets qui tombaient autour de lui, il fut cependant tiré un moment de ses préoccupations en voyant à ses côtés l'enfant de dix-sept ans qui remplissait auprès de lui l'office de page, et dont le père qui lui était cher, avait succombé à Valoutina. — Mon ami, lui dit-il, tu n'avais jamais assisté à pareille fête. Ton début est rude, mais ton éducation se fera plus vite. — L'enfant, digne fils de son père, était, comme le grand maréchal Bertrand, exclusivement occupé du maître qu'il servait, mais personne n'aurait osé devant Napoléon exprimer une crainte, même pour lui, et cette reconnaissance, exécutée les pieds dans une boue profonde, la tête sous les boulets, dura jusque vers dix heures du soir. Napoléon, qui ne faisait rien d'inutile, ne l'avait prolongée que pour voir de ses propres yeux les Anglais établir leurs bivouacs. Bientôt l'horizon s'illumina de mille feux, entretenus avec le bois de la forêt de Soignes. Les Anglais, aussi mouillés que nous, employèrent la soirée à sécher leurs habits et à cuire leurs aliments. L'horizon, comme Napoléon l'a écrit si grandement, parut un vaste incendie, et ces flammes, qui en ce moment ne lui présageaient que la victoire, le remplirent d'une satisfaction, malheureusement bien trompeuse ! Remontant à cheval, Napoléon revint à la ferme dite du Caillou, où l'on avait établi son quartier général. Il annonça pour le lendemain une bataille décisive, qui devait, disait-il, sauver ou perdre la France. Il ordonna à ses généraux de s'y préparer. De tous les ordres, le plus pressant était celui que Napoléon devait adresser à Grouchy ; car il ne fallait pas le laisser errer à l'aventure dans une circonstance pareille, et comme le maréchal se trouvait à quatre ou cinq lieues, il importait de lui expédier ses instructions immédiatement, pour qu'il pût les recevoir en temps utile. A dix heures environ Napoléon lui adressa les instructions que comportait la situation envisagée sous toutes ses faces. Grouchy avait été chargé de suivre les Prussiens pour compléter leur défaite, surveiller leurs entreprises, et se tenir toujours, quelque parti qu'ils prissent, entre eux et les Anglais, comme un mur impossible à franchir. Quelles éventualités y avait-il à prévoir dans une situation pareille ? Les Prussiens avaient pu, ainsi qu'on l'avait supposé un instant d'après les canons et les fuyards recueillis sur la route de Namur, gagner Liège pour rejoindre sur le Rhin les autres armées alliées, ou bien encore gagner par Gembloux et Wavre la route qui traverse l'extrémité orientale de la forêt de Soignes, et qui les aurait réunis aux Anglais au delà de Bruxelles. Ils avaient pu enfin s'arrêter à Wavre même, le long de la Dyle, avant de s'enfoncer dans la forêt de Soignes, dans l'intention de se joindre aux Anglais en avant de la forêt. De toutes ces suppositions aucune n'était alarmante, même la dernière, si le maréchal Grouchy ne perdait point la tête, qu'il n'avait jamais perdue jusqu'ici. Les instructions pour ces divers cas ressortaient de la nature des choses, et Napoléon, qui ne les puisait jamais ailleurs, les traça avec une extrême précision. Si les Prussiens, dit-il dans la dépêche destinée au maréchal Grouchy, si les Prussiens ont pris la route du Rhin, il n'y a plus à vous en occuper, et il suffira de laisser mille chevaux à leur suite pour vous assurer qu'ils ne reviendront pas sur nous. Si par la route de Wavre ils se sont portés sur Bruxelles, il suffit encore d'envoyer après eux un millier de chevaux, et dans ce second cas, comme dans le premier, il faut vous replier tout entier sur nous, pour concourir à la ruine de l'année anglaise. Si enfin les Prussiens se sont arrêtés en avant de la forêt de Soignes, à Wavre ou ailleurs, il faut vous placer entre eux et nous, les occuper, les contenir, et détacher une division de sept mille hommes afin de prendre à revers l'aile gauche des Anglais. — Ces instructions ne pouvaient être différentes, quand même le génie militaire de Napoléon n'eût été ni aussi grand, ni aussi sûr qu'il l'était. Laisser quelques éclaireurs sur la trace des Prussiens soit qu'ils eussent regagné le Rhin ou qu'ils se fussent enfoncés sur Bruxelles, et dans ces deux cas rejoindre Napoléon avec la totalité de l'aile droite, ou bien, s'ils s'étaient arrêtés à Wavre, les occuper, les tenir éloignés du terrible duel qui allait s'engager entre l'armée française et l'armée britannique, et enfin dans ce dernier cas détacher sept mille hommes pour prendre à dos l'aile gauche anglaise, étaient les instructions que comportait ce qu'on savait de la situation. Qu'elles pussent arriver et être exécutées à temps, ce n'était pas chose plus douteuse que le reste. Il était environ dix heures du soir : en admettant que l'officier qui les porterait ne partît qu'à onze, il devait être rendu au plus tard à deux heures du matin à Gembloux, où l'on devait présumer que se trouverait le maréchal Grouchy. En effet, de la ferme du Caillou à Gembloux, en suivant toujours la chaussée pavée de Namur, et en la quittant à Sombreffe pour prendre celle de Wavre, il n'y avait qu'environ sept ou huit lieues métriques de distance, tandis qu'en ligne droite il y en avait à peine cinq. Un homme à cheval devait certainement franchir cet espace en moins de trois heures. Recevant ses instructions à deux heures du matin, le maréchal Grouchy pouvait partir à quatre de Gembloux, et devait être bien près de Napoléon lorsque commencerait la bataille ; car soit qu'il négligeât les Prussiens en route vers le Rhin ou vers Bruxelles, soit qu'il eût à les suivre sur Wavre, et à faire un détachement vers Mont-Saint-Jean, il n'avait pas plus de cinq à six lieues à parcourir avec son corps d'armée. Ces ordres expédiés, Napoléon prit quelques instants de repos au milieu de la nuit, comme il en avait l'habitude quand il était engagé dans de grandes opérations. Il dormit profondément à la veille de la journée la plus terrible de sa vie, et l'une des plus funestes qui aient jamais lui sur la France. Les résolutions des généraux ennemis étaient du reste à peu près telles que Napoléon les souhaitait, sans se douter de ce qu'il désirait en demandant à la Providence de lui accorder encore une bataille. Lord Wellington, la veille au soir, après le combat des Quatre-Bras, s'était arrêté à Genappe, où il avait établi son quartier général. N'ayant rien reçu du maréchal Blücher, soit que celui-ci fût mécontent de n'avoir pas été plus activement secouru, soit que son affreuse chute de cheval l'eût empêché de vaquer à ses devoirs, le général britannique avait supposé que les Prussiens étaient vaincus, surtout en voyant de toute part les vedettes françaises tant aux Quatre-Bras que sur la chaussée de Namur. Les Français, en effet, auraient dû se retirer s'ils n'avaient pas remporté une victoire qui leur permit d'occuper une position aussi avancée. Le duc de Wellington avait donc pris le parti de se replier sur Mont-Saint-Jean, à la lisière de la forêt de Soignes, bien résolu à se battre dans cette position, qu'il avait longuement étudiée dans la prévision d'une bataille défensive, livrée sous les murs de Bruxelles pour la conservation du royaume des Pays-Bas. Toutefois il ne voulait livrer cette bataille défensive, quelque bonne que lui parût la position, qu'à la condition d'être soutenu par les Prussiens. En conséquence il avait dépêché un officier au maréchal Blücher pour savoir s'il pouvait compter sur son secours. Tandis que les choses se passaient ainsi du côté des Anglais, le vieil et inflexible Blücher, quoique fort maltraité à Ligny, ne se tenait pas pour vaincu, et entendait renouveler la lutte le lendemain ou le surlendemain, dès qu'il rencontrerait un poste favorable à ses desseins. Loin de songer à s'éloigner du théâtre des hostilités en regagnant le Rhin, il voulait s'y tenir au contraire, et ne pas aller plus loin que la forêt de Soignes, pour y livrer, avec ou sans les Anglais, une nouvelle bataille, non pas en arrière mais en avant de Bruxelles. En conséquence il s'était replié en deux colonnes sur Wavre, en attirant à lui le corps de Bülow (4e corps prussien), lequel était en marche pendant la bataille de Ligny. Ziethen et Pirch Ier, qui avaient combattu entre Ligny et Saint-Amand, et s'étaient trouvés les plus avancés sur la chaussée de Na- mur aux Quatre-Bras, s'étaient retirés par Tilly et Mont-Saint-Guibert, en suivant la rive droite de la Dyle, pendant la nuit du 16 au 17. Thielmann, qui n'avait pas dépassé Sombreffe, avait rétrogradé par la route de Gembloux, et donné la main à Bülow arrivant de Liège. Ils avaient tous pris position autour de Wavre à la fin de cette journée du 17, les uns plus tôt, les autres plus tard, les uns au delà, les autres en deçà de la Dyle. Blücher avait employé le reste du jour à leur ménager un peu de repos, à leur procurer des vivres, à remplacer les munitions consommées, et à rallier une multitude de fuyards que sa cavalerie tâchait de recueillir, et que la nôtre aurait pu ramasser par milliers, si elle avait été mieux dirigée. Averti des intentions du duc de Wellington, il lui avait répondu qu'il serait le 18 à Mont-Saint-Jean, espérant bien que, si les Français n'attaquaient pas le 18, on les attaquerait le 19 : noble et patriotique énergie dans un vieillard de soixante-treize ans ! Les deux généraux ennemis étaient donc décidés à livrer bataille dans la journée du i8, en avant de la forêt de Soignes, après s'être réunis par un mouvement de flanc, que Blücher devait exécuter le long de la forêt, si toutefois les Français lui en laissaient le temps et les moyens. C'était au maréchal Grouchy qu'appartenaient naturellement la mission et la faculté de s'y opposer. Si on jette en effet les yeux sur la carte du pays, on verra que rien n'était plus facile que son rôle, bien qu'il eût à manœuvrer devant 88 mille Prussiens avec environ 34 mille Français. Napoléon s'étant emparé brusquement de la grande chaussée de Namur aux Quatre-Bras, par laquelle les Anglais et les Prussiens auraient pu se rejoindre, les uns et les autres avaient été contraints de se reporter en arrière, les premiers par la route de Mont-Saint-Jean, les seconds par celle de Wavre. Ces deux routes traversent la vaste forêt de Soignes qui enveloppe Bruxelles, du sud-ouest au nord-est, et se réunissent à Bruxelles même. Napoléon, poursuivant le duc de Wellington sur Mont-Saint-Jean, Grouchy devant poursuivre Blücher sur Wavre, marchaient à environ quatre lieues l'un de l'autre, mesurées à vol d'oiseau. Grouchy n'avait guère plus de chemin à faire pour rejoindre Napoléon, que Blücher pour rejoindre Wellington. De plus, partant d'auprès de Napoléon, ayant mission de communiquer toujours avec lui, Grouchy, s'il ne perdait pas la piste des Prussiens, devait obtenir l'un des deux résultats que voici : ou de s'interposer entre eux et Napoléon, et de retarder assez leur arrivée pour qu'on eût le temps de battre les Anglais, ou s'il n'avait pas pu leur barrer le chemin, de les prendre en flanc pendant qu'ils chercheraient à se réunir à l'armée britannique. Mais ne pas les rencontrer, ne pas même les voir dans un espace aussi étroit, était un miracle, un miracle de malheur, qui n'était guère à supposer Pour remplir sa mission la plus indiquée, celle de s'interposer entre les Prussiens et les Anglais, Grouchy avait en sa faveur une circonstance locale des plus heureuses. La Dyle, petite rivière de peu d'importance sans doute, mais dont les abords sont très faciles à défendre, coulant de Genappe vers Wavre, séparait Napoléon de Grouchy, comme Wellington de Blücher. En suivant à la lettre ses instructions qui lui proscrivaient de communiquer toujours par sa gauche avec le quartier général, Grouchy pouvait se porter sur la Dyle, la franchir, la mettre ainsi entre lui et les Prussiens, et leur en disputer le passage afin d'empêcher leur arrivée à Mont-Saint-Jean, ou s'ils l'avaient franchie avant lui, les surprendre dans leur marche de flanc, et les arrêter net avant qu'ils eussent rejoint le duc de Wellington. L'ascendant de la victoire remportée à Ligny, la surprise de flanc, suffisaient pour compenser l'inégalité du nombre, et donner à Grouchy sinon le moyen de vaincre, du moins celui d'occuper les Prussiens, et de les faire arriver trop tard au rendez-vous commun de Waterloo. A la vérité, pour ne point perdre de temps, pour bien suivre les mouvements des Prussiens, il aurait fallu connaître, ou soupçonner du moins leur direction, de manière à ne pas courir trop tard après eux. Mais les suppositions à faire en cette circonstance étaient si peu nombreuses, si faciles à vérifier avec les treize régiments de cavalerie dont Grouchy disposait, et les espaces à parcourir si peu considérables, qu'il était facile de regagner le temps qu'on aurait perdu en fausses recherches. Si les Prussiens vaincus à Ligny se retiraient par Liège sur le Rhin, il n'y avait qu'un détachement de cavalerie à laisser sur leurs traces, et à ne plus s'en inquiéter ensuite ; s'ils marchaient sur Wavre pour combattre en avant ou en arrière de la forêt de Soignes, ils avaient deux routes à prendre, l'une par Tilly et Mont-Saint-Guibert, l'autre par Sombreffe et Gembloux, toutes deux aboutissant à Wavre. Trois reconnaissances de cavalerie, une sur Namur, deux sur Wavre, devaient en quelques heures constater ce qui en était, et Grouchy, que Napoléon avait quitté à onze heures du matin, aurait dû à trois ou quatre heures de l'après-midi savoir la vérité, et de quatre à neuf être bien près de Wavre, s'il prenait le parti de s'y rendre, ou se trouver sur la gauche de la Dyle, si, ce qui valait mieux, il traversait cette rivière pour se mettre en communication plus étroite avec Napoléon. De tout cela le maréchal Grouchy n'avait rien fait dans la journée. Ayant du coup d'œil et de la vigueur sur lé terrain, il n'avait aucun discernement dans la direction générale des opérations, et surtout rien de la sagacité d'un officier d'avant-garde chargé d'éclairer une armée. Ainsi il n'avait envoyé aucune reconnaissance sur sa gauche, de Tilly à Mont-Saint-Guibert, route qu'avaient prise Ziethen et Pirch Ier : il n'en avait pas même envoyé une par sa droite sur Gembloux, et en se séparant de Napoléon à Sombreffe, il avait couru comme une tête légère sur Namur, où on lui avait dit que Pajol avait ramassé des fuyards et du canon. Tandis qu'il galopait fort inconsidérément dans cette direction, il avait appris que sa cavalerie battant l'estrade pendant la matinée, avait aperçu les Prussiens en grand nombre du côté de Gembloux, lesquels semblaient marcher sur Wavre. En même temps la dépêche que Napoléon lui avait adressée de Marbais par la main du grand maréchal, lui avait donné la même information, et alors il s'était mis à courir sur Gembloux, en ordonnant à son infanterie de l'y suivre. Cette infanterie, composée des corps de Vandamme et de Gérard, n'avait été mise en mouvement que vers trois ou quatre heures de l'après-midi. Sans doute elle avait gagné à ce retard de se reposer un peu des fatigues de la veille, mais il eût mieux valu l'acheminer dès midi sur Gembloux, où elle se serait trouvée convenablement placée pour toutes les hypothèses, car à Gembloux elle eût été à la fois sur la route directe de Wavre, et en communication avec Liège par la vieille chaussée romaine. Elle aurait eu de la sorte l'avantage d'arriver à Gembloux avant l'orage qui vers deux heures de l'après-midi s'étendit sur toutes les plaines de la Belgique, et en mesure encore, après y avoir pris un repos de trois ou quatre heures, de s'approcher de Wavre, si de nouveaux indices signalaient cette direction comme définitivement préférable. A Gembloux les rapports des gens du pays indiquèrent Wavre comme le véritable point de retraite de l'armée prussienne, et il y avait dans leurs dires un ensemble qui aurait certainement décidé un esprit moins flottant que celui du maréchal Grouchy. Mais comme Bülow arrivait par la route de Liège, comme il y avait dès lors du matériel sur cette route, les perplexités du maréchal Grouchy s'augmentèrent, et il ne sut plus à quelle supposition s'arrêter. Les indices à la guerre, de même que dans la politique, troublent l'esprit par leur multiplicité même, si par une raison à la fois sagace et ferme on ne sait pas les rapprocher et les concilier. Ce qu'il y avait de plus supposable, c'est que les Prussiens allaient se réunir aux Anglais pour combattre avec eux, en avant ou en arrière de la forêt de Soignes ; ce qui l'était moins, c'est qu'ils retournassent vers le Rhin ; ce qui ne l'était pas du tout, c'est qu'ils se partageassent entre ces deux directions. Ce fut pourtant à cette dernière supposition que le maréchal Grouchy s'arrêta, influencé qu'il était par les doubles traces observées sur la route de Wavre et sur celle de Liège, doubles traces qui s'expliquaient facilement, puisque les Prussiens ayant leur tête vers Wavre, leur queue vers Liège d'où ils venaient, devaient sur ces deux points laisser des signes de leur Présence. Une autre et puissante raison aurait dû décider le maréchal dans son choix. Si on se trompait en se dirigeant sur Wavre, le mal n'était pas grand, car on laissait les Prussiens gagner le Rhin sans les poursuivre, mais on apportait à Napoléon un renfort accablant contre les Anglais. Si au contraire on se trompait en marchant vers Liège, il y avait le danger mortel de laisser les Prussiens gagner tranquillement Wavre, s'y placer dans le voisinage immédiat des Anglais, et se mettre ainsi en mesure d'accabler Napoléon avec leurs forces réunies. Cette pensée, chez un esprit clairvoyant, n'aurait pas dû permettre un moment d'hésitation à l'égard de la conduite à tenir. Malheureusement il n'en fut rien, et le maréchal Grouchy sembla complètement oublier que sa mission essentielle était de suivre les Prussiens, et de les empêcher de revenir sur nous pendant que nous aurions affaire aux Anglais, ce qui résultait des instructions verbales de Napoléon et de l'évidente nature des choses. Vers la chute du jour les indices étant devenus plus nombreux et plus concordants, la direction de Wavre se présenta définitivement comme celle que les Prussiens avaient dû suivre. En conséquence, le maréchal Grouchy se contenta, comme dernière précaution contre une éventualité dont la crainte n'avait pas entièrement disparu de son esprit, de laisser quelque cavalerie sur la route de Liège, mais il eut soin d'en placer la plus grande partie sur celle de Wavre, en avant de Sauvenière. Il laissa toute son infanterie se reposer à Gembloux, où elle était arrivée tard par suite du mauvais temps, afin de lui procurer une bonne fin de journée, et de pouvoir la mettre en marche le lendemain de très bonne heure. Il était bien fâcheux sans doute, lorsqu'on avait les Prussiens à poursuivre vivement, de n'avoir fait que deux lieues et demie dans la journée, mais en partant à quatre heures le lendemain 18, tout était réparable, car on n'avait qu'un trajet de quatre lieues à exécuter pour être rendu à Wavre, qu'un de six pour se trouver à côté de Napoléon, lieues métriques qu'un homme à pied parcourt en trois quarts d'heure. Il était donc possible de faire à temps, et très à propos, tout ce qu'on n'avait pas fait dans cette journée du 17. A dix heures du soir, moment même où Napoléon venait d'écrire au maréchal Grouchy pour le rappeler à lui, le maréchal écrivait à Napoléon pour l'informer du parti qu'il avait pris, lequel, disait-il, lui laissait encore le choix entre Wavre et Liège, et pour lui annoncer la résolution de marcher tout entier sur Wavre, dès le matin, si cette direction paraissait définitivement la véritable, afin, ajoutait-il, de séparer les Prussiens du duc de Wellington. — Ces dernières expressions avaient cela de rassurant qu'en ce moment le maréchal semblait comprendre enfin le fond de sa mission, et elles prouvent aussi que Napoléon, en lui donnant le matin ses instructions verbales, s'était fort clairement expliqué. Telle était la manière dont chacun avait achevé la journée du 17 sur ce théâtre de guerre, large tout au plus de cinq à six lieues dans les divers sens, et sur lequel trois cent mille hommes se cherchaient pour terminer en s'égorgeant vingt-deux ans de luttes acharnées. Pendant que tout dormait dans le camp des quatre armées, Napoléon, après un court repos, se leva vers deux heures après minuit, ayant toujours la crainte de voir les Anglais se soustraire à son approche, pour se réunir aux Prussiens derrière Bruxelles. En effet, le danger des grandes batailles contre lui était tellement reconnu des généraux européens, ce danger était si évident pour les Anglais qui avaient une immense forêt à dos, à travers laquelle la retraite serait des plus difficiles, et au contraire la réunion avec les Prussiens derrière la forêt de Soignes présentait un jeu si sûr, qu'il ne comprenait pas comment les Anglais pouvaient être tentés de l'attendre. Il raisonnait sans tenir compte de deux passions violentes, la haine chez le général prussien, l'ambition chez le général britannique. Le premier, effectivement, était prêt à payer de sa vie la ruine de la France ; le second aspirait à terminer lui-même la querelle de l'Europe contre nous, et à en avoir le principal honneur. Napoléon néanmoins doutait toujours, et malgré la pluie qui tombait de nouveau, il recommença avec deux ou trois officiers la reconnaissance qu'il avait déjà tant prolongée quelques heures auparavant. La terre était encore plus détrempée, la boue plus profonde que dans la soirée. Malgré cette fâcheuse circonstance, qui pouvait rendre bien difficile l'attaque d'une armée en position, il éprouva une véritable joie en apercevant les feux des bivouacs britanniques. Ces feux resplendissant d'un bout à l'autre de ce champ de bataille, attestaient la présence persévérante de l'armée anglaise. Un moment Napoléon fut troublé par un bruit de voiture sur sa gauche, dans la direction de Mont-Saint-Jean, mais bientôt ce bruit cessa, et des espions revenant du camp ennemi ne laissèrent plus d'incertitude sur la résolution du duc de Wellington de livrer bataille. Napoléon en fut à la fois surpris et content, et ne put d'ailleurs en douter lorsque le jour commença à poindre ; car le général anglais, s'il avait voulu battre en retraite, n'aurait pas attendu qu'il fit jour pour s'enfoncer, en ayant son terrible adversaire sur ses traces, dans le long et dangereux défilé de la forêt de Soignes. Tandis qu'il opérait cette reconnaissance, Napoléon reçut la dépêche que Grouchy venait de lui expédier de Gembloux à dix heures du soir, et dans laquelle il lui annonçait la position qu'il avait prise entre les deux directions de Liège et de Wavre, avec penchant cependant à préférer celle de Wavre, afin de tenir les Prussiens séparés des Anglais. Quoiqu'il trouvât bien médiocre la conduite du maréchal, bien mal employée une journée de poursuite dans laquelle on n'avait fait que deux lieues et demie, Napoléon se consola pourtant en voyant que Grouchy tendait vers Wavre, et qu'il semblait comprendre la portion essentielle de son rôle, celle qui consistait à tenir les Prussiens séparés des Anglais. Il se rassura en songeant que Grouchy, pourvu qu'il se mît en marche à quatre ou cinq heures du matin, pourrait le rejoindre vers dix heures, et exécuter ainsi les instructions expédiées le soir du quartier général, lesquelles lui enjoignaient de suivre les Prussiens sur Wavre et de détacher vers lui une division de sept mille hommes. L'état du sol, sur lequel avaient coulé les eaux du ciel pendant douze heures consécutives, ne rendant pas possible une bataille avant dix heures du matin, il suffisait qu'à ce moment, et même plus tard, Grouchy parût en entier ou en partie sur la gauche des Anglais, pour obtenir les plus grands résultats. Napoléon, pour plus de sûreté, lui fit adresser à l'instant même, c'est-à-dire à trois heures du matin, un duplicata de l'ordre de dix heures du soir. Berthier avait l'habitude d'expédier plusieurs copies du même ordre par des officiers différents, afin que sur trois ou quatre il en parvînt au moins une : le maréchal Soult, tout nouveau à ce service, n'avait pas pris cette précaution. Mais deux expéditions, parties l'une à dix heures du soir, l'autre à trois heures du matin, pouvaient paraître suffisantes, sur une route d'ailleurs praticable, puisque l'officier porteur d'un rapport daté de dix heures du soir était arrivé à deux heures du matin. Rassuré, sans être très satisfait, Napoléon ne formait plus qu'un vœu, c'est que le temps se remît, et rendît possibles les manœuvres de l'artillerie. Il passa le reste de la nuit en reconnaissances, revenant de temps en temps à la ferme du Caillou, pour se sécher auprès d'un grand feu. Vers quatre heures il faisait jour, et le ciel commençait à s'éclaircir. Bientôt un rayon de soleil perçant une bande épaisse de nuages illumina tout l'horizon, et l'espérance, la trompeuse espérance, pénétra au cœur agité de Napoléon ! Il se flatta qu'avec le retour du soleil les nuages se dissiperaient, et que la pluie cessant, le sol en quelques heures deviendrait praticable à l'artillerie. Drouot, les officiers de l'arme consultés, déclara que dans cinq ou six heures, et grâce à la saison, le sol serait non pas tout à fait consolidé, mais assez raffermi pour mettre en position des pièces de tout calibre. Le ciel effectivement devint plus clair, et Napoléon prit patience, ne se doutant point que ce n'était pas seulement au soleil, mais aux Prussiens qu'il donnait ainsi le temps d'arriver ! Vers huit heures, la pluie ne semblant plus à craindre, il appela ses généraux, les fit asseoir à sa table où était servi son frugal repas du matin, et discuta avec eux le plan de la bataille qu'on allait livrer à l'armée britannique. Du sommet d'un tertre élevé, il avait parfaitement discerné la forme du terrain, ainsi que la distribution des forces ennemies, et avait arrêté déjà dans son esprit la manière de l'attaquer, au point qu'il paraissait très confiant dans le résultat de ses combinaisons. Le général Reille, très habitué à la guerre contre les Anglais, et ayant conservé de leur solidité une impression qui avait beaucoup nui aux opérations des Quatre-Bras, eut en cette occasion le mérite de faire entendre à Napoléon des vérités utiles. Il lui dit que les Anglais, médiocres dans l'offensive, étaient dans la défensive supérieurs à presque toutes les armées de l'Europe, et qu'il fallait chercher à 23 les vaincre par des manœuvres plutôt que par des attaques directes. — Je sais, répondit Napoléon, que les Anglais sont difficiles à battre en position, aussi vais-je manœuvrer. — Il songeait en effet à joindre les manœuvres à la vigueur des attaques, et ne croyait pas que les Anglais pussent résister à la manière dont il les aborderait. — Nous avons, ajouta-t-il, quatre-vingt-dix chances sur cent, et il achevait à peine ces paroles, que Ney entrant subitement lui dit qu'il pourrait avoir raison si les Anglais consentaient à l'attendre, mais qu'en ce moment ils battaient en retraite. Napoléon n'attacha pas la moindre créance à cette nouvelle, car, répliqua-t-il, les Anglais, s'ils avaient voulu se retirer, n'auraient pas différé jusqu'au jour. — Cet argument était sans réplique. Napoléon néanmoins monta à cheval pour voir ce qui en était, et après avoir reconnu que l'armée anglaise demeurait en position, dicta son plan d'attaque, qui fut immédiatement transcrit par des officiers pour être communiqué à tous les chefs de corps. Le moment est venu de décrire ce champ de bataille, triste théâtre de l'une des actions les plus sanglantes du siècle, et de la plus désastreuse de notre histoire, quoique la plus héroïque ! Les Anglais s'étaient arrêtés sur le plateau de Mont-Saint-Jean, lequel s'étendant sur deux lieues environ de droite à gauche, et s'abaissant vers nous par une pente assez douce, donnait ainsi naissance à un petit vallon qui séparait les deux armées. Derrière ce plateau et sur un espace de plusieurs lieues la forêt de Soignes étalait sa sombre verdure. Les Anglais, pour être à l'abri de notre artillerie, se tenaient sur le revers du plateau, et n'avaient sur le bord même que quelques batteries bien attelées et bien gardées. Le long du plateau et pour ainsi dire à mi-côte, un chemin de traverse, allant du village d'Ohain à notre droite, vers celui de Merbe-Braine à notre gauche, bordé de haies vives en quelques endroits, fort encaissé en quelques autres, présentait une espèce de fossé qui couvrait entièrement la position des Anglais, et qu'on aurait pu croire exécuté pour cette occasion. Le vallon qui courait entre les deux armées, passant successivement au-dessous des fermes de Papelotte et de la Haye, puis au pied du village d'Ohain, devenait en s'abaissant le lit d'un ruisseau, affluent de la Dyle, et s'ouvrait vers la petite ville de Wavre, qu'avec des lunettes on pouvait apercevoir à environ trois lieues et demie sur notre droite. A notre gauche, ce même vallon descendant en sens contraire, et tournant autour de la position de l'ennemi, déversait les eaux environnantes dans la petite rivière de Senne. Le partage des eaux entre la Senne et la Dyle se faisait ainsi devant nous par une sorte de remblai, qui allant de nous aux Anglais, portait la grande chaussée de Charleroy à Bruxelles. Cette chaussée, après avoir franchi le plateau de Mont-Saint-Jean, se confondait à Mont-Saint-Jean même avec la route de Nivelles, qu'on apercevait sur notre gauche bordée de grands arbres, de manière que Mont-Saint-Jean était le point de réunion des deux principales chaussées pavées. C'est par ces deux chaussées en effet que les diverses parties de l'armée britannique, celles qui avaient eu le temps d'accourir aux Quatre-Bras, et celles qui n'avaient pas eu le temps de dépasser Nivelles, s'étaient rejointes pour former sous le duc de Wellington la masse chargée de nous disputer Bruxelles. Un peu au delà de Mont-Saint-Jean, et à l'en- trée de la forêt de Soignes, se trouvait le village de Waterloo, qui a donné son nom à la bataille, parce que c'est de là que le général anglais écrivait et datait ses dépêches. Les Anglais étaient établis au revers du plateau, sur les deux côtés de la chaussée de Bruxelles. Le duc de Wellington, entré en campagne avec environ 90 mille hommes, en avait perdu près de six mille dans les diverses rencontres des jours précédents. Il avait envoyé à Hal un gros détachement qui n'était pas de moins de quinze mille hommes, dans la crainte d'être tourné par sa droite, c'est- à-dire vers la mer, crainte qui n'avait pas cessé de préoccuper son esprit, et qui dans le moment n'était pas digne de son discernement militaire. Il avait donc à Mont-Saint-Jean, en défalquant quelques autres détachements, 75 mille soldats, Anglais, Belges, Hollandais, Hanovriens, Nassauviens, Brunswickois. Il avait placé à sa droite, en avant de Merbe-Braine, entre les deux chaussées de Nivelles et de Charleroy, les gardes anglaises, plus la division Alten, formée d'Anglais et d'Allemands. En arrière et comme appui se trouvait la division Clinton, disposée en colonne serrée et profonde. La brigade anglaise Mitchell, détachée de la division Colville, occupait l'extrême droite. Cette aile avait donc été fortement composée à cause des chaussées de Nivelles et de Charleroy dont elle gardait le point d'intersection, et elle avait en outre en seconde ligne le corps de Brunswick avec une grande partie de la cavalerie alliée. Pour dernière et bien inutile précaution, le duc de Wellington avait posté à trois quarts de lieue, au bourg de Braine-l'Alleud, la division anglo-hollandaise Chassé, toujours afin de parer au danger chimérique d'être tourné par sa droite. A son centre, c'est-à-dire sur la grande chaussée de Charleroy à Bruxelles, il avait pratiqué un abatis à l'endroit où elle débouchait sur le plateau. Sur la chaussée même il avait mis peu de monde, les troupes accumulées à droite et à gauche devant suffire à la défendre. Seulement, un peu en arrière, vers Mont-Saint-Jean, il avait laissé en réserve la brigade anglaise Lambert. A sa gauche, vis-à-vis de notre droite, il avait établi la division Picton, composée des brigades anglaises Kempt et Pack, des brigades hanovriennes Best et Vincke, partie embusquée dans le chemin de traverse d'Ohain, partie rangée en masse en arrière. Enfin la division Perponcher formait son extrême gauche, et communiquait par les troupes de Nassau avec le village d'Ohain. Cette aile gauche avait été laissée la plus faible, parce que le duc de Wellington comptait que l'armée prussienne viendrait la renforcer. Les masses de la cavalerie étaient répandues sur le revers du plateau, presque hors de nôtre vue. Le duc de Wellington avait en outre occupé quelques postes détachés en avant de sa position. A sa droite et en face de notre gauche, là où le plateau de Mont-Saint-Jean commence à former un contour en arrière, se trouvait le château de Goumont, composé de divers bâtiments, d'un verger, et d'un bois qui descendait presque jusqu'au fond du ravin. Le duc de Wellington y avait mis une garnison de 1.800 hommes de ses meilleures troupes. Au centre, sur la chaussée de Bruxelles, et également à mi-côte, se voyait la ferme de la Haye-Sainte, consistant en un gros bâtiment et un verger. Le duc de Wellington en avait confié la garde à un millier d'hommes. A sa gauche enfin, et vers le bas du plateau, il avait placé quelques détachements de la brigade de Nassau dans les fermes de la Haye et de Papelotte. Ainsi, en avant trois ouvrages détachés et fortement occupés, au-dessus, dans le petit chemin longeant le plateau à mi-côte, de nombreux bataillons en embuscade, et enfin sur les revers du plateau, à droite et à gauche de la route de Bruxelles, des masses d'infanterie et de cavalerie, partie déployées, partie en colonnes serrées, telles étaient la position et la distribution de l'armée anglaise. Comme on le voit, par le site qu'elle avait choisi, par le nombre et la qualité des combattants, elle présentait à l'audace des Français un obstacle formidable. Après avoir examiné la position, Napoléon avait arrêté sur-le-champ la manière de l'attaquer. Il avait résolu de déployer son armée au pied du plateau, d'enlever d'abord les trois ouvrages avancés, le château de Goumont à sa gauche, la ferme de la Haye-Sainte à son centre, les fermes de la Haye et de Papelotte à sa droite, puis de porter son aile droite, renforcée de toutes ses réserves, sur l'aile gauche des Anglais qui était la moins forte par le site et le nombre de ses soldats, de la culbuter sur leur centre qui occupait la grande chaussée de Bruxelles, de s'emparer de cette chaussée, seule issue praticable à travers la forêt de Soignes, et de pousser ainsi l'armée britannique sur cette forêt mal percée alors, et devant sinon empêcher absolument, du moins gêner beaucoup la retraite d'un ennemi en déroute. En opérant par sa droite contre la gauche des Anglais, Napoléon avait l'avantage de diriger son plus grand effort contre le côté le moins solide de l'ennemi, de la priver de son principal débouché à travers la forêt de Soignes, et de la séparer des Prussiens dont la présence à Wavre, sans être certaine, était du moins infiniment présumable. Ce plan, où éclataient une dernière fois toute la promptitude et la sûreté du coup d'œil de Napoléon, était incontestablement le meilleur, le plus efficace d'après la forme des lieux et la répartition des forces ennemies. Une fois fixé sur ce qu'il avait à faire, Napoléon donna des ordres pour que ses troupes vinssent se placer conformément au rôle qu'elles devaient remplir dans la journée. La pluie ayant cessé depuis plusieurs heures, et le sol commençant à se raffermir, elles se déployèrent avec une célérité et un ensemble admirables. A notre gauche, entre les chaussées de Nivelles et de Charleroy, vis-à-vis du château de Goumont, le corps du général Reille se déploya sur le bord du vallon qui nous séparait de l'ennemi, chaque division formée sur deux lignes, la cavalerie légère de Piré jetée à l'extrême gauche, afin de porter ses reconnaissances jusqu'à l'extrême droite des Anglais. A l'aile droite, c'est-à-dire de l'autre côté de la chaussée de Bruxelles, le corps du comte d'Erlon, qui n'avait pas encore combattu et qui comptait 19 mille fantassins, vint s'établir en face de la gauche des Anglais, ses quatre divisions placées l'une à la suite de l'autre, et chacune d'elles rangée sur deux lignes. Le général Jacquinot avec sa cavalerie légère, était en vedette à notre extrême droite, poussant ses reconnaissances dans la direction de Wavre. Avec l'artillerie de ces divers corps on avait composé sur leur front une vaste batterie de quatre-vingts bouches à feu. Derrière cette première ligne, le corps du comte de Lobau, distribué également sur chaque côté de la chaussée de Bruxelles, formait réserve au centre. A sa gauche, par conséquent derrière le général Reille, se déployaient les magnifiques cuirassiers de Kellermann, à droite, derrière le général d'Erlon, les cuirassiers non moins imposants de Milhaud. Telle était notre seconde ligne, un peu moins étendue que la première, mais plus profonde, et resplendissante des cuirasses de notre grosse cavalerie. Enfin la garde, dont la superbe infanterie était rangée en masse sur les deux côtés de la chaussée de Bruxelles, ayant à gauche les grenadiers à cheval de Guyot, à droite les chasseurs et les lanciers de Lefebvre-Desnoëttes, la garde formait notre troisième et dernière ligne, plus profonde encore et moins étendue que la seconde, de manière que notre armée présentait un vaste éventail, étincelant des feux du soleil reflétés sur nos baïonnettes, nos sabres et nos cuirasses. En moins d'une heure ces belles troupes eurent pris leur position, et leur déploiement produisit un effet des plus saisissants. Napoléon en éprouva un mouvement d'orgueil et de confiance, qui se manifesta sur son visage et dans ses paroles. Voulant dans cette journée exciter encore davantage, s'il était possible, l'enthousiasme de ses soldats, il parcourut de nouveau le champ de bataille, passant de la gauche à la droite devant le front des troupes. A son aspect, les fantassins mettaient leurs shakos au bout de leurs baïonnettes, les cavaliers leurs casques au bout de leurs sabres, et poussaient des cris violents de Vive l'Empereur ! qui se prolongeaient longtemps après qu'il s'était éloigné. Il vit ainsi l'armée tout entière, qu'il laissa ivre de joie et d'espérance, malgré une affreuse nuit passée dans la boue, sans feu, presque sans vivres, tandis que l'armée anglaise, arrivée à ses bivouacs plusieurs heures avant nous, et y ayant trouvé des aliments abondants, avait très peu souffert. Nos soldats toutefois avaient eu la matinée pour préparer leur soupe, et ils étaient d'ailleurs dans un état d'exaltation qui les élevait au-dessus des souffrances comme des dangers. Napoléon, d'après l'avis de Drouot, ayant pris le parti de laisser sécher le sol, n'avait plus aucun motif de hâter la bataille, surtout depuis qu'il voyait les Anglais résolus à ne pas l'éviter. Il avait à différer deux avantages, celui de laisser le sol se raffermir, ce qui devait être -uniquement au profit de l'attaque, et de donner à Grouchy le temps d'arriver. Tout en effet devait lui faire espérer la prochaine apparition du lieutenant auquel il avait confié son aile droite. A dix heures du soir, comme on l'a vu, Grouchy avait mandé qu'il était à Gembloux, prêt à se porter sur Liège ou sur Wavre, mais plus disposé à marcher vers Wavre, et commençant à comprendre qu'il avait pour mission principale de séparer les Prussiens des Anglais. A deux heures de la nuit il avait écrit pour annoncer que définitivement il marcherait sur Wavre dès la pointe du jour. Dès lors, après l'ordre de dix heures du soir, réitéré à trois heures du matin, Napoléon pensait que, si Grouchy n'arrivait pas avec la totalité de son corps d'armée, il enverrait au moins un détachement de sept mille hommes, ce qui lui en laisserait 26 mille, avec lesquels il pourrait contenir les Prussiens, ou bien se replier en combattant sur la droite de Mont-Saint-Jean. Napoléon comptait donc ou sur un détachement de son aile droite, ou sur son aile droite tout entière. Néanmoins malgré les ordres expédiés le soir, et répétés pendant la nuit, il voulut envoyer un nouvel officier à Grouchy pour lui faire bien connaître la situation, et lui expliquer encore une fois quel était le concours qu'on attendait de sa part. Il zo manda auprès de lui l'officier polonais Zenowicz, destiné à porter ce nouveau message, le conduisit sur un mamelon d'où l'on embrassait tout l'horizon, puis se tournant vers la droite, J'attends Grouchy de ce côté, lui dit-il, je l'attends impatiemment... allez le joindre, amenez-le, et ne le quittez que lorsque son corps d'armée débouchera sur notre ligne de bataille. — Napoléon recommanda à cet officier de marcher le plus vite possible, et de se faire remettre par le maréchal Soult une dépêche écrite, qui devait préciser mieux encore les ordres qu'il venait de lui donner verbalement. Cela fait, Napoléon, qui avait passé la nuit à exécuter des reconnaissances dans la boue, et qui depuis qu'il avait quitté Ligny, c'est-à-dire depuis la veille à cinq heures du matin, n'avait pris que trois heures de repos, se jeta sur son lit de champ. Il avait en ce moment son frère Jérôme à ses côtés. — Il est dix heures, lui dit-il, je vais dormir jusqu'à onze ; je me réveillerai certainement, mais en tout cas tu me réveilleras toi-même, car, ajouta-t-il, en montrant les officiers qui l'entouraient, ils n'oseraient interrompre mon sommeil. — Après avoir prononcé ces paroles, il posa sa tête sur son mince oreiller, et quelques minutes après il était profondément endormi. Pendant ce temps, tout était en mouvement autour de lui, et chacun prenait de son mieux la position qui lui était assignée. Les Anglais bien reposés, bien nourris, n'étaient occupés qu'à se placer méthodiquement sur le terrain où ils devaient déployer leur opiniâtreté accoutumée. Les Français achevaient en hâte un faible repas, et à peine reposés, à peine nourris, attendaient impatiemment le signal du combat, qu'ils étaient habitués à rece, voir des batteries de la garde. Certaines divisions venaient seulement d'arriver en ligne, et celle du général Durutte notamment, mise tardivement en marche par la faute de l'état-major général, se hâtait d'accourir à son poste, n'ayant presque pas eu le temps de manger la soupe. Mais l'ardeur dont nos soldats étaient animés leur faisait considérer toutes les souffrances comme indifférentes, qu'elles fussent dues aux circonstances ou à la faute de leurs chefs. Au loin, le mouvement des diverses armées avait également pour but l'action décisive qui allait s'engager sur le plateau de Mont-Saint-Jean. Blücher, après avoir dès la veille réuni ses quatre corps à Wavre, et rallié un certain nombre de ses fuyards, que notre cavalerie mal dirigée n'avait point ramassés, s'apprêtait à tenir la parole donnée au duc de Wellington, et à lui amener tout ou partie de ses forces. Il lui restait environ 88 mille hommes, fort éprouvés par la journée du 16, mais grâce à ses patriotiques exemples, prêts à combattre de nouveau avec le dernier dévouement. Le 4e corps, celui de Bülow, n'avait pas encore tiré un coup de fusil, et il le destinait à marcher le premier vers Mont-Saint-Jean. En conséquence il lui avait prescrit de franchir la Dyle dès la pointe du jour, mais ce corps, ralenti par un incendie dans son passage à travers la ville de Wavre, n'avait pu être en marche vers Mont-Saint-Jean qu'après sept heures du matin. Il avait ordre de se diriger vers la chapelle Saint-Lambert, située sur le flanc de la position où allait se livrer la bataille entre les Anglais et les Français. Il pouvait y être vers une heure de l'après-midi. Le projet de Blücher était de faire appuyer Bülow par Pirch Ier (2e corps), et de diriger Ziethen (1er corps) le long de la forêt de Soignes, par le petit chemin d'Ohain, de manière qu'il pût déboucher plus près encore de la gauche des Anglais. Ces deux corps de Pirch Ier et de Ziethen, ré- duits à environ 15 mille hommes chacun, et joints à Bülow qui était entier, portaient à 60 mille combattants le secours que les Prussiens allaient fournir au duc de Wellington. Enfin Blücher avait résolu de laisser en arrière-garde Thielmann (3e corps), qui avait peu souffert à Ligny, et lui avait prescrit de retenir Grouchy devant Wavre, en lui disputant le passage de la Dyle. Certainement l'apparition possible de 60 mille Prussiens sur son flanc droit était pour Napoléon une chose extrêmement grave. Mais il restait 34 mille Français, victorieux l'avant-veille à Ligny, pleins de confiance en eux-mêmes et de dévouement à leur drapeau, et leur position était telle, qu'ils pouvaient faire retomber sur la tête des Prussiens le coup suspendu en ce moment sur la nôtre. Arrivés à Mont-Saint-Jean avant Blücher, ils devaient rendre Napoléon invulnérable pendant une journée au moins : arrivés après, ils plaçaient Blücher entre deux feux, et devaient l'accabler. Toute la question était de savoir s'ils arriveraient, et en vérité il était difficile d'en douter. On a vu en effet comment le maréchal Grouchy, après avoir perdu la moitié de la journée précédente en vaines recherches, avait fini par découvrir la marche des Prussiens vers Wavre, et par se porter à Gembloux. Il y était parvenu tard, mais ses troupes n'ayant fait que deux lieues et demie dans la journée, auraient pu en partant le lendemain 18 à quatre heures du matin, être rendues au milieu de la matinée sur les points les plus éloignés de ce théâtre d'opération. Malheureusement, bien qu'à la fin du jour Grouchy ne conservât plus de doute sur la direction suivie par les Prussiens, il n'avait donné les ordres de départ à Vandamme qu'à six heures du matin, à Gérard qu'à sept, et comme le temps nécessaire pour les distributions de vivres n'avait pas été prévu, les troupes, de Vandamme n'avaient pu être en route avant huit heures, celles de Gérard avant neuf. Néanmoins, malgré ces lenteurs, rien n'était perdu, rien même n'était compromis, car on était à quatre lieues les uns des autres à vol d'oiseau, à cinq au plus par les chemins de traverse. Le canon, qui allait bientôt remplir la contrée de ses éclats, devait être de tous les ordres le plus clair, et en supposant qu'il fallût cinq heures pour rejoindre Napoléon — ce qui est exagéré, comme on le verra —, il restait assez de temps pour apporter un poids décisif dans la balance de nos destinées. Ainsi donc si Blücher marchait vers Mont-Saint-Jean, Grouchy, d'après toutes les probabilités, devait y marcher aussi, et à onze heures du matin, soit qu'on ignorât, soit qu'on connût les détails que nous venons de rapporter, il y avait autant d'espérances que de craintes à concevoir pour le sort de la France. Que disons-nous, autant d'espérances que de craintes ! il n'y avait que des espérances à concevoir, si le canon qui atteindrait les oreilles de ces 34 mille Français, ouvrait en même temps leur esprit Hélas, il allait leur ouvrir l'esprit à tous, le remplir même de lumière, un seul excepté, celui qui les commandait ! L'officier polonais Zenowicz, que Napoléon avait chargé de porter une dernière instruction au maréchal Grouchy, avait perdu une heure auprès du maréchal Soult, pour obtenir la dépêche écrite qu'il devait prendre des mains de ce maréchal. Cette dépêche, tout à fait ambiguë, ne valait pas le temps qu'elle avait coûté. Elle disait qu'une grande bataille allait se livrer contre les Anglais, qu'il fallait par conséquent se hâter de marcher vers Wavre, pour se tenir en communication étroite avec l'armée et se mettre en rapport d'opérations avec elle. — Cependant quelque vague que fût ce langage, rapproché des ordres de la veille, interprété par la situation elle-même, il disait suffisamment qu'il fallait se hâter, soit pour s'interposer entre les Anglais et les Prussiens, soit pour assaillir ceux-ci, les assaillir n'importe comment, pourvu qu'on les IS occupât, et qu'on les empêchât d'apporter la victoire aux Anglais. Onze heures venaient de sonner : Napoléon, sans laisser à son frère le soin de l'arracher au sommeil, était déjà debout. Il avait quitté la ferme du Caillou, et s'était établi à la ferme de la Belle-Alliance, d'où il dominait tout entier le bassin où il allait livrer sa dernière bataille. Il avait pris place sur un petit tertre, ayant ses cartes étalées sur une table, ses officiers autour de lui, ses chevaux sellés au pied du tertre. Les deux armées attendaient immobiles le signal du combat. Les Anglais étaient tranquilles, confiants dans leur courage, dans leur position, dans leur général, dans le concours empressé des Prussiens. Les Français — nous parlons des soldats et des officiers inférieurs —, exaltés au plus haut point, ne songeaient ni aux Prussiens ni à Grouchy, mais aux Anglais qu'ils avaient devant eux, ne demandaient qu'à les aborder, et attendaient la victoire d'eux-mêmes et du génie fécond qui les commandait, et qui toujours avait su trouver à propos des combinaisons irrésistibles. A onze heures et demie, Napoléon donna le signal, et de notre côté cent vingt bouches à feu y répondirent. D'après le plan qu'il avait conçu de rabattre la gauche des Anglais sur leur centre, afin de leur enlever la chaussée de Bruxelles, la principale attaque devait s'exécuter par notre droite, et Napoléon y avait accumulé une grande quantité d'artillerie. Il avait amené là non seulement les batteries de 12 du comte d'Erlon, chargé de cette opération, mais celles du général Reille, chargé de l'attaque de gauche, celles du comte de Lobau, laissé en réserve, et un certain nombre de pièces de la garde. Il avait formé ainsi une batterie de quatre-vingts bouches à feu, qui, tirant par-dessus le petit vallon situé entre les deux armées, envoyait ses boulets jusque sur le revers du plateau. La gauche des Anglais obliquant un peu en arrière pour obéir à la configuration du terrain, notre droite la suivait dans ce mouvement, et formait un angle avec la ligne de bataille, de manière que beaucoup de nos boulets prenant d'écharpe la grande chaussée de Bruxelles, tombaient au centre de l'armée britannique. A notre gauche, le général Reille avait réuni les batteries de ses divisions, celles de la cavalerie de Piré, et tirait sur le bois et le château de Goumont. Napoléon, pour soutenir le feu de cette aile, avait ordonné d'y joindre l'artillerie attelée de Kellermann, lequel était placé derrière le corps de Reille, et de ce côté quarante bouches à feu au moins couvraient de leurs projectiles la droite du duc de Wellington. Beaucoup de boulets étaient perdus, mais d'autres portaient la mort au plus épais des masses ennemies, et y produisaient des trouées profondes, malgré le soin qu'on avait eu de les tenir sur le revers du plateau. Après une demi-heure de cette violente canonnade, Napoléon ordonna l'attaque du bois et du château de Goumont. Il avait deux raisons pour commencer l'action par notre gauche, l'une que le poste de Goumont étant le plus avancé se présentait le premier, l'autre qu'en attirant l'attention de l'ennemi sur la droite, on la détournait un peu de sa gauche, où devait s'opérer notre principal effort. Le 2e corps, composé des divisions Foy, Jérôme, Bachelu, descendit dans le vallon, et, se ployant autour du bois de Goumont, l'embrassa dans une espèce de demi-cercle. La division Foy formant notre extrême gauche et flanquée par la cavalerie de Piré, dut se porter un peu plus en avant, afin de joindre cette partie de la ligne anglaise qui décrivait un contour en arrière. Mais ce n'était pas elle qui devait s'engager la première. La division Jérôme, rencontrant le bois de Goumont allongé vers nous, s'y jeta vivement, tandis qu'à sa droite la division Bachelu remplissait l'espace compris entre Goumont et la chaussée de Bruxelles. Nos tirailleurs repoussèrent les tirailleurs de l'ennemi, puis la brigade Bauduin, composée du ier léger et du 3e de ligne, s'élança sur le bois qui consistait dans une haute futaie très claire, et dans un taillis épais placé au-dessous de la futaie. Il était occupé par un bataillon de Nassau et par plusieurs compagnies hanovriennes. Quatre compagnies des gardes anglaises gardaient les bâtiments situés au delà du bois, et complétaient une garnison qui était, avons-nous dit, de 1.800 hommes. La brigade Bauduin essuya un feu meurtrier parti du taillis qui remplissait les intervalles de la futaie. Il était difficile de répondre à coups de fusil à un ennemi qu'on ne voyait point. Aussi nos soldats se hâtèrent-ils de pénétrer dans le fourré, tuant à coups de baïonnette les adversaires qui les avaient fusillés à bout portant. Le brave général Bauduin reçut la mort dans cette attaque. Les gens de Nassau favorisés par la nature du lieu, se défendirent opiniâtrement ; mais le prince Jérôme, amenant la brigade Soye, et tournant le bois par la droite, les força de se retirer. A peine avions-nous conquis le bois, que nous arrivâmes devant un obstacle plus difficile encore à vaincre. Au sortir du bois se trouvait un verger enceint d'une haie vive, et cette haie formée d'arbres très gros et fortement entrelacés, présentait une espèce de mur impénétrable, d'où partait une grêle de balles. Les premiers soldats qui voulurent déboucher du bois tombèrent sous le feu. Mais l'audace de nos fantassins ne s'arrêta point devant le péril. Ils se précipitèrent sur cette haie si épaisse, s'y frayèrent un passage la hache à la main, tuèrent à coups de baïonnette tout ce qui n'avait pas eu le temps de fuir. Ce deuxième obstacle surmonté, ils en rencontrèrent un troisième. Au delà de la haie s'élevaient les bâtiments du château, consistant vers notre droite en un gros mur crénelé, et vers notre gauche en un corps de ferme d'une remarquable solidité. Six cents hommes des gardes anglaises les occupaient. Ce n'était pas la peine assurément de perdre des centaines et surtout des milliers d'hommes pour enlever un tel obstacle, car là n'était pas le véritable point d'attaque, et il suffisait d'avoir conquis le bois pour s'assurer un appui contre les entreprises de l'ennemi sur notre gauche, sans sacrifier à un objet tout à fait secondaire la belle infanterie du 2e corps, qui comprenait un tiers de l'infanterie de l'armée. Le général Reille qui pensait ainsi, donna l'ordre de ne pas s'entêter à prendre ces bâtiments, mais il n'alla pas veiller d'assez près à l'exécution de cet ordre, et nos généraux de brigade et de division, entraînés par leur ardeur et celle des troupes, s'obstinèrent à conquérir la ferme et le château. De son côté, le duc de Wellington, voyant l'acharnement que nous y mettions, y envoya aussitôt un bataillon de Brunswick, et de nouveaux détachements des gardes anglaises. La lutte de ce côté devint ainsi des plus violentes. Tandis que notre aile gauche s'engageait de la sorte, Napoléon, obligé de s'en fier à ses lieutenants du détail des attaques, suivait attentivement l'ensemble de la bataille, et préparait l'opération principale contre le centre et la gauche de l'ennemi. Ney devait exécuter sous ses yeux cette opération, qui avait pour but, comme nous l'avons dit, d'enlever aux Anglais la chaussée de Bruxelles, seule issue praticable à travers la forêt de Soignes. Les troupes du 1er corps, désolées d'être restées inutiles le 16, attendaient avec impatience le signal du combat. Napoléon, la lunette à la main, cherchait à discerner si l'ennemi avait fait quelques dispositions nouvelles par suite de l'attaque commencée contre le château de Goumont. Tout ce qu'on pouvait apercevoir, c'est que de Braine-l'Alleud s'avançaient quelques troupes. C'était la division Chassé, très inutilement laissée par le duc de Wellington à son extrême droite, pour le lier aux troupes laissées encore plus inutilement à Hal. Tandis que le général anglais faisait avancer cette division pour renforcer sa droite, il paraissait inactif vers son centre et sa gauche, se bornant de ce côté à serrer les rangs éclaircis par nos boulets. Tout à coup cependant, Napoléon, toujours attentif à son extrême droite par où devait venir Grouchy, aperçut dans la direction de la chapelle Saint-Lambert comme une ombre à l'horizon, dont il n'était pas facile de saisir le vrai caractère. Si on a présente la description que nous avons donnée de ce champ de bataille, on doit se souvenir que le vallon qui séparait les deux armées, s'allongeant vers Wavre, passait successivement au pied des fermes, de Papelotte et de la Haye, traversait ensuite des bois épais, se réunissait près de la chapelle Saint-Lambert au vallon que servait de lit au ruisseau de Lasne, et allait enfin beaucoup plus loin se confondre avec la vallée de la Dyle. C'est sur ces hauteurs lointaines de la chapelle Saint-Lambert que se montrait l'espèce d'ombre que Napoléon avait remarquée à l'extrémité de l'horizon. L'ombre semblait s'avancer, ce qui pouvait faire supposer que c'étaient des troupes. Napoléon prêta sa lunette au maréchal Soult, celui-ci à divers généraux de l'état-major, et chacun exprima son avis. Les uns croyaient y voir la cime de quelques bois, d'autres un objet mobile qui paraissait se déplacer. Dans le doute, Napoléon suspendit ses ordres d'attaque pour s'assurer de ce que pouvait être cette apparition inquiétante. Bientôt avec son tact exercé il y reconnut des troupes en marche, et ne conserva plus à cet égard aucun doute. Était-ce le détachement demandé à Grouchy, ou bien Grouchy lui-même ? Étaient-ce les Prussiens ? A cette distance il était impossible de distinguer l'habit français de l'habit prussien, l'un et l'autre étant de couleur bleue. Napoléon appela auprès de lui le général Domon, commandant une division de cavalerie légère, le fit monter sur le tertre où il avait pris place, lui montra les troupes qu'on apercevait à l'horizon, et le chargea d'aller les reconnaître, avec ordre de les rallier si elles étaient françaises, de les contenir si elles étaient ennemies, et de mander immédiatement ce qu'il aurait appris. Il lui donna pour le seconder dans l'accomplissement de sa mission, la division légère de Subervic, forte de 1.200 à 1.300 chevaux. Les deux en comprenaient environ 2.400, et étaient en mesure non seulement d'observer mais de ralentir la marche du corps qui s'avançait, si par hasard il était ennemi. Cet incident n'inquiéta pas encore Napoléon. Si Grouchy en effet avait laissé échapper quelques colonnes latérales de l'armée prussienne, il ne pouvait manquer d'être à leur poursuite, et paraissant bientôt après elles, l'accident loin d'être malheureux deviendrait heureux, car ces colonnes prises entre deux feux seraient inévitablement détruites. Le mystère pourtant ne tarda point à s'éclaircir. On amena un prisonnier, sous-officier de hussards, enlevé par notre cavalerie légère. Il portait une lettre du général Bülow au duc de Wellington, lui annonçant son approche, et lui demandant des instructions. Ce sous-officier était fort intelligent. Il déclara que les troupes qu'on apercevait étaient le corps de Bülow, fort de mille hommes, et envoyé pour se joindre à la gauche de l'armée anglaise. Cette révélation était sérieuse, sans être cependant alarmante. Si Bülow, qui venait de Liège par Gembloux, et qui avait dû défiler sous les yeux de Grouchy, était si près, Grouchy, qui aurait dû fermer les yeux pour ne point le voir, ne pouvait être bien loin. Ou son corps tout entier, ou le détachement qu'on lui avait demandé, allait arriver en même temps que Bülow, et il était même possible de tirer un grand parti de cet accident. En plaçant en effet sur notre droite qu'on replierait en potence, un fort détachement pour arrêter Bülow, ce dernier serait mis entre deux feux par les sept mille hommes demandés à Grouchy, ou par les trente-quatre mille que Grouchy amènerait lui-même. Napoléon fit appeler le comte de Lobau, et lui ordonna d'aller choisir sur le penchant des hauteurs tournées vers la Dyle un terrain où il pût se défendre longtemps avec ses deux divisions d'infanterie, et les deux divisions de cavalerie de Domon et de Subervic. Le tout devait former une masse de dix mille hommes, qui dans les mains du comte de Lobau vaudrait beaucoup plus que son nombre, et qui pourrait bien attendre les sept mille hommes que dans la pire hypothèse on devait espérer de Grouchy, s'il n'accourait pas avec la totalité de ses forces. On aurait ainsi 17 mille combattants à opposer aux 30 mille de Bülow, et distribués de manière à le prendre en queue, tandis qu'on l'arrêterait en tête. Il n'y avait donc pas de quoi s'alarmer. Toutefois c'étaient dix mille hommes de moins à jeter sur la gauche des Anglais pour la culbuter sur leur centre et pour les déposséder de la chaussée de Bruxelles. Mais la garde, qu'on ne ménageait plus dans ces guerres à outrance, serait tout entière engagée comme réserve, et s'il devait en coûter davantage, le triomphe n'en serait pas moins décisif. Napoléon n'éprouva par conséquent aucun trouble. Seulement au lieu de 75 mille hommes, il allait en avoir los mille à combattre avec 68 mille : les chances étaient moindres, mais grandes encore. Il aurait pu à la vérité se replier, et renoncer à combattre : mais se replier au milieu d'une bataille commencée, devant les Anglais et devant les Prussiens, était une résolution des plus graves. C'était perdre l'ascendant de la victoire de Ligny, c'était repasser en vaincu la frontière que deux jours auparavant on avait passée en vainqueur, avec la certitude d'avoir quinze jours après deux cent cinquante mille ennemis de plus sur les bras, par l'arrivée en ligne des Autrichiens, des Russes et des Bavarois. Mieux valait continuer une bataille qui, si elle était gagnée, maintenait définitivement les choses dans la situation où nous avions espéré les mettre, que de reculer pour voir les deux colonnes envahissantes du Nord et de l'Est se réunir, et nous accabler par leur réunion. Dans la position où l'on se trouvait, il fallait vaincre ou mourir. Napoléon le savait, et il n'apprenait rien en voyant combien la journée devenait sérieuse. D'ailleurs pour imaginer que les Prussiens viendraient sans Grouchy, il fallait tout mettre au pire, et supposer la fortune tellement rigoureuse qu'en vingt ans de guerre elle ne l'avait jamais été à ce point. Il se borna donc à prendre de nouvelles précautions afin de faire arriver Grouchy en ligne. Il prescrivit au maréchal Soult d'expédier un officier avec une dépêche datée d'une heure, annonçant l'apparition des troupes prussiennes sur notre droite, et portant l'ordre formel de marcher à nous pour les écraser. Un officier au galop courant au-devant de Grouchy devait le rencontrer dans moins de deux heures, et l'amener dans moins de trois à portée des deux armées. Ainsi Grouchy devait se faire sentir avant six heures, et certes la bataille serait loin d'être décidée à ce moment de la journée. Lobau tiendrait bien jusque-là sur notre flanc droit, aidé par la forme des lieux et par son énergie. Pourtant c'était une raison de hâter l'attaque contre la gauche des Anglais ; car outre l'avantage de pouvoir reporter nos forces du côté de Bülow, si on en avait fini avec eux, il y avait celui de les séparer des Prussiens, et d'empêcher tout secours de leur parvenir. Napoléon donna donc au maréchal Ney le signal de l'attaque. Cette importante opération devait commencer par un coup de vigueur au centre, contre la ferme de la Haye-Sainte située sur la grande chaussée de Bruxelles. Notre aile droite déployée devait ensuite gravir le plateau, se rendre maîtresse du petit chemin d'Ohain qui courait à mi-côte, se jeter sur la gauche des Anglais, et tâcher de la culbuter sur leur centre, pour leur enlever Mont-Saint-Jean au point d'intersection des routes de Nivelles et de Bruxelles. La brigade Quiot de la division Alix (première de d'Erlon), disposée en colonne d'attaque sur la grande route, et appuyée par une brigade des cuirassiers de Milhaud, avait ordre d'emporter la ferme de la Haye-Sainte. La brigade Bourgeois (seconde d'Alix), placée sur la droite de la grande route, devait former le premier échelon de l'attaque du plateau ; la division Donzelot devait former le second, la division Marcognet le troisième, la division Durutte le quatrième. Ney et d'Erlon avaient adopté pour cette journée, sans doute afin de donner plus de consistance à leur infanterie, une disposition singulière, et dont les inconvénients se firent bientôt sentir. Il était d'usage dans notre armée que les colonnes d'attaque se présentassent à l'ennemi un bataillon déployé sur leur front, pour fournir des feux, et sur chaque flanc un bataillon en colonne serrée pour tenir tête aux charges de la cavalerie. Cette fois, au contraire, Ney et d'Erlon avaient déployé les huit bataillons de chaque division, en les rangeant les uns derrière les autres à distance de cinq pas, de manière qu'entre chaque bataillon déployé il y avait à peine place pour les officiers, et qu'il leur était impossible de se former en carré sur leurs flancs pour résister à la cavalerie. Ces quatre divisions formant ainsi quatre colonnes épaisses et profondes, s'avançaient à la même hauteur, laissant de l'une à l'autre un intervalle de trois cents pas. D'Erlon était à cheval à la tête de ses quatre échelons ; Ney dirigeait lui-même la brigade Quiot, qui allait aborder la Haye-Sainte. Le général Picton commandait la gauche des Anglais. Il avait en première ligne le 95e bataillon de la brigade anglaise Kempt, embusqué le long du chemin d'Ohain, et sur le prolongement du 95e, toujours dans ce même chemin, la brigade Bylandt de la division Perponcher. Il avait en seconde ligne, sur le bord du plateau, le reste de la brigade Kempt, la brigade écossaise Pack, les brigades hanovriennes Vincke et Best. La brigade de Saxe-Weimar (division Perponcher) occupait les fermes de Papelotte et de la Haye. La cavalerie légère anglaise Vivian et Vandeleur flanquait l'extrême gauche en attendant les Prussiens. Vingt bouches à feu couvraient le front de cette partie de l'armée ennemie. Vers une heure et demie, Ney lance la brigade Quiot sur la Haye-Sainte, et d'Erlon descend avec ses quatre divisions dans le vallon qui nous sépare des Anglais. Ce qu'il y aurait eu de plus simple, c'eût été de démolir la Haye-Sainte à coups de canon, et là comme au château de Goumont on eût épargné bien du sang. Mais l'ardeur est telle, qu'on ne compte plus avec les obstacles. Les soldats de Quiot, conduits par Ney, se jettent d'abord sur le verger, qui précède les bâtiments de ferme, et qui est entouré d'une haie vive. Ils y pénètrent sous une grêle de balles, et en expulsent les soldats de la légion allemande. Le verger conquis, ils veulent s'emparer des bâtiments, mais des murs crénelés part un feu meurtrier qui les décime. Un brave officier, tué depuis sous les murs de Constantine, le commandant du génie Vieux, s'avance une hache à la main pour abattre la porte de la ferme, reçoit un coup de feu, s'obstine, et ne cède que lorsque atteint de plusieurs blessures il ne peut plus se tenir debout. La porte résiste, et du haut des murs les balles continuent à pleuvoir. A la vue de cette attaque, le prince d'Orange sentant le danger du bataillon allemand qui défend la Haye-Sainte, envoie à son secours le bataillon hanovrien de Lunebourg. Ney laisse approcher les Hanovriens, et lance sur eux l'un des deux régiments de cuirassiers qu'il avait sous la main. Les cuirassiers fondent sur le bataillon de Lunebourg, le renversent, le foulent aux pieds, lui enlèvent son drapeau, et après avoir sabré une partie de ses hommes, poursuivent les autres jusqu'au bord du plateau. A leur tour les gardes à cheval de Somerset chargent les cuirassiers, qui, surpris en désordre, sont obligés de revenir. Mais Ney, opposant un bataillon de Quiot aux gardes à cheval, les arrête par une vive fusillade. Tandis que le combat se prolonge autour de la Haye-Sainte, dont le verger seul est conquis, d'Erlon s'avance avec ses quatre divisions sous la protection de notre grande batterie de quatre-vingts bouches à feu, parcourt le fond du vallon, puis en remonte le bord opposé. Cheminant dans des terres grasses et détrempées, son infanterie franchit lentement l'espace qui la sépare de l'ennemi. Bientôt nos canons ne pouvant plus tirer par dessus sa tête, elle continue sa marche sans protection, et gravit le plateau avec une fermeté remarquable. En approchant du sommet, un feu terrible de mousqueterie partant du chemin d'Ohain, dans lequel était embusqué le 95e, accueille notre premier échelon de gauche, formé par la seconde brigade de la division Alix. — On vient de voir que la première brigade attaquait la Haye-Sainte. — Pour se soustraire à ce feu, la division Alix appuie à droite, et raccourcit ainsi la distance qui la sépare du second échelon (division Donzelot). Toutes deux marchent au chemin d'Ohain, le traversent malgré quelques portions de haie vive, et après avoir essuyé des décharges meurtrières, se précipitent sur le 95e, et sur les bataillons déployés de la brigade Bylandt. Elles tuent un grand nombre des soldats du 95e et culbutent à la baïonnette les bataillons de Kempt et de Bylandt. A leur droite notre troisième échelon (division Marcognet), après avoir gravi la hauteur sous la mitraille, franchit à son tour le chemin d'Ohain, renverse les Hanovriens, et prend pied sur le plateau, à quelque distance des deux divisions Alix et Donzelot. Déjà la victoire se prononce pour nous, et la position semble emportée, lorsqu'à un signal du général Picton, les Écossais de Pack cachés dans les blés se lèvent à l'improviste, et tirent à bout portant sur nos deux premières colonnes. Surprises par ce feu au moment même où elles débouchaient sur le plateau, elles s'arrêtent. Le général Picton les fait alors charger à la baïonnette par les bataillons de Pack et de Kempt ralliés. Il tombe mort atteint d'une balle au front, mais la charge continue, et nos deux colonnes vivement abordées cèdent du terrain. Elles résistent cependant, se reportent en avant, et se mêlent avec l'infanterie anglaise, lorsque tout à coup un orage imprévu vient fondre sur elles. Le duc de Wellington accouru sur les lieux, avait lancé sur notre infanterie les douze cents dragons écossais de Ponsonby, appelés les Écossais gris, parce qu'ils montaient des chevaux de couleur grise. Ces dragons formés en deux colonnes, et chargeant avec toute la vigueur des chevaux anglais, pénètrent entre la division Alix et la division Donzelot d'un côté, entre la division Donzelot et la division Marcognet de l'autre. Abordant par le flanc les masses profondes de notre infanterie qui ne peuvent se déployer pour se former en carré, ils s'y enfoncent sans les rompre, ni les traverser à cause de leur épaisseur, mais y produisent une sorte de confusion. Ployant sous le choc des chevaux, et poussées sur la déclivité du terrain, nos colonnes descendent pêle-mêle avec les dragons jusqu'au fond du vallon qu'elles avaient franchi. Les Écossais gris enlèvent d'un côté le drapeau du 105e (division Alix), et de l'autre celui du 45e (division Marcognet). Ils ne bornent pas là leurs exploits. Deux batteries qui faisaient partie de la grande batterie de quatre-vingts bouches à feu s'étaient mises en mouvement pour appuyer notre infanterie. Les dragons dispersent les canonniers, égorgent le brave colonel Chandon, culbutent les canons dans la fange, et ne pouvant les emmener tuent les chevaux. Heureusement ils touchent au terme de leur triomphe. Napoléon du haut du tertre où il était placé, avait aperçu ce désordre. Se jetant sur un cheval, il traverse le champ de bataille au galop, court à la grosse cavalerie de Milhaud, et lance sur les dragons écossais la brigade Travers composée des 7e et 12e de cuirassiers. L'un de ces régiments les aborde de front, tandis que l'autre les prend en flanc, et que le général Jacquinot dirige sur leur flanc opposé le 4e de lanciers. Les dragons écossais, surpris dans le désordre d'une poursuite à toute bride, et assaillis dans tous les sens, sont à l'instant mis en pièces. Nos cuirassiers brûlant de venger notre infanterie, les percent avec leurs grands sabres, et en font un horrible carnage. Le 4e de lanciers, conduit par le colonel Bro, ne les traite pas mieux avec ses lances. Un maréchal des logis des lanciers, nommé Urban, se précipitant dans la mêlée, fait prisonnier le chef des dragons, le brave Ponsonby. Les Écossais s'efforçant de délivrer leur général, Urban le renverse mort à ses pieds, puis menacé par plusieurs dragons, il va droit à l'un d'eux qui tenait le drapeau du 45e, le démonte d'un coup de lance, le tue d'un second coup, lui enlève le drapeau, se débarrasse en le tuant encore d'un autre Écossais que le serrait de près, et revient tout couvert de sang porter à son colonel le trophée qu'il avait si glorieusement reconquis. Les Écossais cruellement maltraités regagnent les lignes de l'infanterie de Kempt et de Pack, laissant sept à huit cents morts ou blessés dans nos mains, sur douze cents dont leur brigade était composée. A l'extrême droite de d'Erlon la division Durutte, qui formait le quatrième échelon, avait eu à peu près le sort des trois autres. Elle s'était avancée dans l'ordre prescrit aux quatre divisions, c'est-à-dire ses bataillons déployés et rangés les uns derrière les autres à distance de cinq pas. Cependant comme elle avait aperçu la cavalerie Vandeleur prêté à charger, elle avait laissé en arrière le 8e en carré pour lui servir d'appui. Assaillie par les dragons légers de Vandeleur, elle n'avait pas été enfoncée, mais sa première ligne avait ployé un moment sous le poids de la cavalerie. Bientôt elle s'était dégagée à coups de fusil, et secourue par le 3e de chasseurs, elle s'était repliée en bon ordre sur le carré du 85e demeuré inébranlable. Tel avait été le sort de cette attaque sur la gauche des Anglais, de laquelle Napoléon attendait de si grands résultats. Une faute de tactique imputable à Ney et à d'Erlon avait laissé nos quatre colonnes d'infanterie en prise à la cavalerie ennemie, et leur avait coûté environ trois mille hommes, en morts, blessés ou prisonniers. Les Anglais avaient à regretter leurs dragons, une partie de l'infanterie de Kempt et de Pack, les généraux Picton et Ponsonby, et en total un nombre d'hommes à peu près égal à celui que nous avions perdu. Mais ils avaient conservé leur position, et c'était une opération à recommencer, avec le désavantage d'une première tentative manquée. Toutefois il nous restait une partie de la ferme de la Haye-Sainte, et nos soldats, dont l'ardeur n'était pas refroidie, se ralliaient déjà sur le bord du vallon qui nous séparait des Anglais. Napoléon s'y était porté, et se promenait lentement devant leurs rangs, au milieu des boulets ricochant d'une ligne à l'autre, et des obus remplissant l'air de leurs éclats. Le brave général Desvaux, commandant l'artillerie de la garde, venait d'être tué à ses côtés. Quoique fort contrarié de cet incident, Napoléon montrait à ses soldats un visage calme et confiant, et leur faisait dire qu'on allait s'y prendre autrement, et qu'on n'en viendrait pas moins à bout de la ténacité ennemie. Mais un autre objet attirait en cet instant son attention. Le général Domon, envoyé à la rencontre des troupes qu'on avait cru apercevoir sur les hauteurs de la chapelle Saint-Lambert mandait que ces troupes étaient prussiennes, qu'il était aux prises avec elles, qu'il avait fourni plusieurs charges contre leur avant-garde, et qu'il fallait de l'infanterie pour les arrêter. Des [...] lancés par elles venaient mourir en arrière [...] droit, sur la chaussée de Charleroy. Enfin, un officier du maréchal Grouchy, ayant réussi à réduire l'espace qui nous séparait de lui, annonçait qu'il devait partir de Gembloux à quatre heures du matin [...] parti à neuf, et qu'il se dirigeait sur Wavre. Si le maréchal eût marché en ligne droite sur Mont-Saint-Jean, il aurait pu rejoindre l'armée dans le moment même, c'est-à-dire vers trois heures. Mais Napoléon voyait clairement que Grouchy n'avait compris ni les lieux ni sa mission, et commençait à ne plus compter sur son arrivée. Il allait donc avoir deux armées sur les bras. Il était trop tard pour battre en retraite, car on aurait été assailli en queue et en flanc par cent trente mille hommes autorisés à se croire victorieux, auxquels on ne pouvait en opposer que 68 mille, réduits à 60 mille par la bataille engagée, et qui se seraient crus vaincus, si on leur avait commandé un mouvement rétrograde. Napoléon résolut donc de tenir tête à l'orage, et ne désespéra pas de faire face à toutes les difficultés avec les braves soldats qui lui restaient, et dont l'exaltation semblait croître avec le péril. Le comte de Lobau était allé sur la droite reconnaître un terrain propre à la défensive. Napoléon lui ordonna de s'y transporter avec son corps réduit à deux divisions depuis le départ de la division Teste, et comptant 7.500 baïonnettes. Il lui adjoignit quelques batteries de sa garde pour remplacer sa batterie de 12, qui était l'une de celles que les dragons écossais avaient culbutées. Le comte de Lobau partit immédiatement, et son corps quittant le centre, traversa le champ de bataille au pas avec une lenteur imposante. Il alla s'établir en potence sur notre droite, parallèlement à la chaussée de Charleroy, et formant un angle droit avec notre ligne de bataille. Le terrain que le comte de Lobau avait résolu d'occuper était des mieux choisis pour résister avec peu de monde à des forces supérieures. Ainsi que nous l'avons dit, le petit vallon placé entre les deux armées devenait en se prolongeant le lit du ruisseau de Smohain, et plus loin faisait sa jonction avec le ruisseau de Lasne. Entre les. deux s'élevait une espèce de promontoire dont les pentes étaient boisées. Le comte de Lobau s'établit en travers de ce promontoire, la droite â la ferme d'Hanotelet, la gauche au château de Frichermont, se liant avec la division Durutte vers la ferme de Papelotte, barrant ainsi tout l'espace compris entre l'un et l'autre ruisseau, et ayant sur son front une batterie de trente bouches à feu, qui attendait l'ennemi la mèche à la main. Le corps de Bülow était descendu de la chapelle Saint-Lambert dans le lit du ruisseau de Lasne par un chemin des plus difficiles, marchant tantôt dans un sable mouvant, tantôt dans une argile glissante, et ayant la plus grande peine à se faire suivre de son artillerie. Après avoir franchi ces mauvais terrains, il avait eu à traverser des bois épais, où quelques troupes bien postées auraient pu arrêter une armée. Malheureusement, dans la confiance où l'on était qu'il ne pouvait arriver de ce côté que Grouchy lui-même, aucune précaution n'avait été prise, et à cette vue Blücher, qui venait de rejoindre Bülow, tressaillit de joie. A trois heures à peu près, les deux premières divisions de Bülow approchaient de la position de Lobau, la division de Losthin vers le ruisseau de Smohain, celle de Hiller vers le ruisseau de Lasne, l'une et l'autre précédées par de la cavalerie. Les escadrons de Domon et de Subervic faisaient avec elles le coup de sabre, et retardaient autant que possible leur approche. Lobau en bataille sur le bord du coteau les attendait, prêt à les couvrir de mitraille. Napoléon, sans être encore alarmée de ce qui allait survenir de ce côté, avait néanmoins modifié son plan. Ayant pris l'offensive contre les Anglais, il dépendait de lui de suspendre l'action vis-à-vis d'eux, et de ne la reprendre pour la rendre décisive que lorsqu'il aurait pu apprécier toute l'importance de l'attaque des Prussiens. Son projet était donc d'accueillir ces derniers d'une manière si vigoureuse, qu'ils fussent arrêtés pour une heure ou deux au moins, puis de revenir aux Anglais, de se porter par la chaussée de Bruxelles sur le plateau de Mont-Saint-Jean avec le corps de d'Erlon rallié, avec la garde, avec la grosse cavalerie, et se jetant ainsi avec toutes ses forces sur le centre du duc de Wellington, d'en finir par un coup de désespoir. Mais pour agir avec sûreté il fallait au centre être en possession de la Haye-Sainte, afin de contenir les Anglais pendant qu'on temporiserait avec eux, et de pouvoir ensuite déboucher sur le plateau quand on voudrait frapper ce dernier coup. Il fallait sur la gauche avoir du château de Goumont tout ou partie, ce qui serait nécessaire en un mot pour s'y soutenir. Il recommanda donc à Ney d'enlever la Haye-Sainte coûte que coûte, de s'y établir, puis d'attendre le signal qu'il lui donnerait pour une tentative générale et définitive contre l'armée britannique. En même temps le général Reille ayant manqué de grosse artillerie dans l'attaque du château de Goumont, parce que sa batterie de 12 avait été portée à la grande batterie de droite, Napoléon lui envoya quelques obusiers afin d'incendier la ferme et le château. Pendant ce temps le combat ne s'était ralenti ni à gauche ni au centre. La division Jérôme s'était acharnée contre le verger et les bâtiments du château de Goumont, et avait perdu presque autant d'hommes qu'elle en avait tué à l'ennemi. Elle avait fini par traverser la haie épaisse qui se présentait au sortir du bois ; puis, ne pouvant forcer les murs crénelés du jardin, elle avait appuyé à gauche pour s'emparer des bâtiments de ferme, tandis que la division Foy la remplaçant dans le bois se fusillait avec les Anglais le long du verger. Le colonel Cubières, commandant le 1er léger, qui s'était déjà signalé deux jours auparavant dans l'attaque du bois de Bossu, avait tourné les bâtiments sous un feu épouvantable parti du plateau. Apercevant par derrière une porte qui donnait dans la cour du château, il avait résolu de l'enfoncer. Un vaillant homme, le sous-lieutenant Legros, ancien sous-officier du génie, et surnommé par ses camarades l'enfonceur, se saisissant d'une hache avait abattu la porte, et, à la tête d'une poignée de braves gens, avait pénétré dans la cour. Déjà le poste était à nous, et nous allions en rester les maîtres, lorsque le lieutenant-colonel Macdonell, accourant à la tête des gardes anglaises, était parvenu à repousser nos soldats, à refermer la porte, et à sauver ainsi le château de Goumont. Le brave Legros était resté mort sur le terrain. Le colonel Cubières, blessé l'avant-veille aux Quatre-Bras, atteint en ce moment de plusieurs coups de feu, renversé sous son cheval, allait être égorgé, lorsque les Anglais, touchés de sa bravoure et de son âge, l'avaient épargné, et l'avaient emporté tout sanglant. Il avait donc fallu revenir à la lisière du bois sans avoir conquis ce fatal amas de bâtiments. Pourtant la batterie d'obusiers étant arrivée, on l'avait établie sur le bord du vallon, et on avait fait pleuvoir sur la ferme et le château une grêle d'obus qui bientôt y avaient mis le feu. Au milieu de cet incendie, les Anglais, sans cesse renforcés, s'obstinaient à tenir dans une position qu'ils regardaient comme de la plus grande importance pour la défense du plateau. Déjà ce combat avait coûté trois mille hommes aux Français, et deux mille aux Anglais, sans autre résultat pour nous que d'avoir conquis le bois de Goumont. Les divisions Jérôme et Foy s'étaient accumulées autour de ce bois, où elles trouvaient une sorte d'abri, et la division Bachelu, réduite à trois mille hommes par l'affaire des Quatre-Bras, s'en était rapprochée également pour se dérober aux coups de l'artillerie britannique, en attendant qu'on employât plus utilement son courage. L'espace entre le château de Goumont et la chaussée de Bruxelles, où Ney attaquait la Haye-Sainte, était ainsi demeuré presque inoccupé. A la Haye-Sainte, Ney avait redoublé d'efforts pour enlever un poste dont Napoléon voulait se servir pour tenter plus tard une attaque décisive contre le centre des Anglais. La brigade Quiot était restée dans le verger, et de là continuait à tirer sur les bâtiments de ferme. Les divisions de d'Erlon s'étaient reformées sur le bord du vallon, et Ney les avait rapprochées de lui, afin de les jeter sur le plateau par la chaussée de Bruxelles, lorsque le moment serait venu. Cet illustre maréchal n'avait certes pas besoin d'être stimulé, car sa bravoure sans pareille semblait dans cette journée portée au delà des forces ordinaires de l'humanité. Sachant que Napoléon voulait avoir la Haye-Sainte à tout prix, il se saisit de deux bataillons de la division Donzelot qui s'était ralliée la première, et marchant droit sur la Haye-Sainte, il s'y précipita avec impétuosité. Entraînés par lui les soldats enfoncèrent la porte de la ferme, y pénétrèrent sous un feu épouvantable, et massacrèrent le bataillon léger de la légion allemande qui la défendait. Sur près de cinq cents hommes, quarante seulement avec cinq officiers réussirent à s'enfuir, poursuivis à coups de sabre par nos cuirassiers, dont une brigade n'avait pas cessé de prendre part à ce combat. La légion allemande, placée le long du chemin d'Ohain, en voyant revenir ces malheureux débris de l'un de ses bataillons, voulut se porter à leur secours. Deux bataillons détachés par elle descendirent jusqu'à la Haye-Sainte pour essayer de reprendre la ferme. Aussitôt qu'il les vit, Ney lança sur eux la brigade des cuirassiers. Les deux bataillons allemands se formèrent immédiatement en carré, mais nos cuirassiers fondant sur eux avec impétuosité, rompirent l'un des deux, le sabrèrent et prirent son drapeau. L'autre, ayant eu le temps de se former, résista à deux charges consécutives, et allait être enfoncé à son tour quand il fut dégagé par les gardes à cheval de Somerset. Nos cuirassiers se replièrent, obligés de laisser échapper l'un des deux bataillons, mais ayant eu la cruelle satisfaction d'égorger l'autre presque en entier. Ney, maître de la Haye-Sainte, se croyait en mesure de déboucher victorieusement sur le plateau par la chaussée de Bruxelles, et il en demandait les moyens, pensant que le moment était venu de livrer à l'armée anglaise un as- saut décisif. Ayant déjà rapproché les divisions de d'Erlon de la Haye-Sainte, il les porta en avant, et parvint à occuper sur sa droite la partie la plus voisine du chemin d'Ohain, que les troupes de Kempt et de Pack, à moitié détruites, ne pouvaient plus lui disputer. Il aurait voulu se joindre par sa gauche avec les troupes de Reille, dont les trois divisions pelotonnées autour du bois de Goumont, avaient laissé un vide entre ce bois et la Haye-Sainte. Il fit plusieurs fois demander à Napoléon des forces pour remplir ce vide, et le visage rayonnant d'une ardeur héroïque, il dit à diverses reprises au général Drouot que, si on mettait quelques troupes à sa disposition, il allait remporter un triomphe éclatant et en finir avec l'armée britannique. Il était quatre heures et demie, et en ce moment, sur notre extrême droite repliée en potence, l'attaque de Bülow était fortement prononcée. Les troupes prussiennes, sortant des fonds boisés entre le ruisseau de Smohain et celui de Lasne, avaient gravi la pente du terrain, la division de Losthin à leur droite, celle de Hiller à leur gauche. Le brave Lobau, les attendant avec un sang-froid imperturbable, les avait d'abord criblées de ses boulets, sans parvenir toutefois à les arrêter. Elles avaient en effet riposté de leur mieux, et leurs projectiles tombant derrière nous, au milieu de nos bagages, répandaient déjà un certain trouble sur la chaussée de Charleroy. Lobau voyant bien avec son coup d'œil exercé qu'elles n'étaient pas soutenues, avait saisi l'à-propos, et détaché sa première ligne qui les abordant à la baïonnette les avait refoulées vers les fonds boisés d'où elles étaient sorties. Pourtant ce succès dû à la vigueur, à la présence d'esprit du chef du 6e corps, n'était que du temps gagné, car on commençait à découvrir de nouvelles colonnes prussiennes qui venaient soutenir les premières, et quelques-unes même qui, faisant un détour plus grand sur notre flanc droit, s'apprêtaient à nous envelopper. Napoléon, qui avait à sa disposition les vingt-quatre bataillons de la garde, ne craignait guère une semblable entreprise, mais il voulut y parer tout de suite, et en avoir raison avant de frapper sur l'armée anglaise le coup par lequel il se flattait de terminer la bataille. Il ordonna donc au général Duhesme de se porter à la droite du 6e corps avec les huit bataillons de jeune garde qu'il commandait, et lui donna vingt-quatre bouches à feu pour cribler les Prussiens de mitraille. Napoléon resta au centre avec quinze bataillons de la moyenne et vieille garde, comptant avec ces quinze bataillons, avec la cavalerie de la garde et toute la réserve de grosse cavalerie, fondre sur les Anglais comme la foudre, lorsqu'il aurait vu le terme de l'attaque des Prussiens. D'ailleurs Grouchy, après s'être tant fait attendre, pouvait enfin paraître. Il était près de cinq heures, et en ne précipitant rien, en tenant ferme, on lui donnerait le temps d'arriver, et de contribuer à un triomphe qui ne pouvait manquer d'être éclatant, s'il prenait les Prussiens à revers, tandis qu'on les combattrait en tête. Napoléon, d'après ces vues, fit dire à Ney qu'il lui était impossible de lui donner de l'infanterie, mais qu'il lui envoyait provisoirement les cuirassiers de Milhaud pour remplir l'intervalle entre la Haye-Sainte et le bois de Goumont, et lui recommanda en outre d'attendre ses ordres pour l'attaque qui devait décider du sort de la journée. D'après la volonté de Napoléon, les cuirassiers de Milhaud qui étaient derrière d'Erlon, s'ébranlèrent au trot, parcoururent le champ de bataille de droite à gauche, traversèrent la chaussée de Bruxelles, et allèrent se placer derrière leur première brigade, que Ney avait déjà plusieurs fois employée contre l'ennemi. Ils prirent position entre la Haye-Sainte et le bois de Goumont, pour remplir l'espace laissé vacant par les divisions de Reille, qui s'étaient, avons-nous dit, accumulées autour du bois. Le mouvement de ces formidables cavaliers, comprenant huit régiments et quatre brigades, causa une vive sensation. Tout le monde crut qu'ils allaient charger et que dès lors le moment suprême approchait. On les salua du cri de Vive l'Empereur ! auquel ils répondirent par les mêmes acclamations. Le général Milhaud, en passant devant Lefebvre-Desnoëttes, qui commandait la cavalerie légère de la garde, lui dit en lui serrant la main : Je vais attaquer, soutiens-moi. — Lefebvre-Desnoëttes, dont l'ardeur n'avait pas besoin de nouveaux stimulants, crut que c'était par ordre de l'Empereur qu'on lui disait de soutenir les cuirassiers, et, suivant leur mouvement, il vint prendre rang derrière eux. On avait eu à déplorer à Wagram, à Fuentes-d'Orioro, l'institution des commandants en chef de la garde impériale, qui l'avait paralysée si mal à propos dans ces journées fameuses, on eut ici à déplorer la défaillance de l'institution (due à la maladie de Mortier), car il n'y avait personne pour arrêter des entraînements intempestifs, et, par surcroît de malheur, Napoléon, obligé de quitter la position qu'il occupait au centre, s'était porté à droite pour diriger le combat contre les Prussiens, de manière que ceux-ci nous enlevaient à la fois nos réserves et la personne même de Napoléon. Lorsque Ney vit tant de belle cavalerie à sa disposition, il redoubla de confiance et d'audace, et il en devint d'autant plus impatient de justifier ce qu'il avait dit à Drouot, que, si on le laissait faire, il en finirait à lui seul avec l'armée anglaise. En ce moment, le duc de Wellington avait apporté quelques changements à son ordre de bataille, provoqués par les changements survenus dans le nôtre. La division Alten, placée à son centre et à sa droite, avait cruellement souffert. Il l'avait renforcée en faisant avancer le corps de Brunswick, ainsi que les brigades Mitchell et Lambert. Il avait prescrit au général Chassé, établi d'abord à Braine-l'Alleud, de venir appuyer l'extrémité de son aile droite. Il avait rapproché aussi la division Clinton, laissée jusque-là sur les derrières de l'armée britannique, et avait rappelé de sa gauche, qui lui semblait hors de danger depuis la tentative infructueuse de d'Erlon et l'apparition des Prussiens, la brigade hanovrienne Vincke. Déjà fort maltraité par notre artillerie, exposé à l'être davantage depuis que nous avions occupé la Haye-Sainte, il avait eu soin en concentrant ses troupes vers sa droite, de les ramener un peu en arrière, et se tenant à cheval au milieu d'elles, il les préparait à un rude assaut, facile à pressentir en voyant briller les casques de nos cuirassiers et les lances de la cavalerie légère de la garde. L'artillerie des Anglais était restée seule sur le bord du plateau, par suite du mouvement rétrograde que leur infanterie avait opéré, et par suite aussi d'une tactique qui leur était habituelle. Ils avaient en effet la coutume, lorsque leur artillerie était menacée par des troupes à cheval, de retirer dans les carrés les canonniers et les attelages, de laisser sans défense les canons que l'ennemi ne pouvait emmener sans chevaux, et, quand l'orage était passé, de revenir pour s'en servir de nouveau contre la cavalerie en retraite. Soixante pièces de canon étaient donc en avant de la ligne anglaise, peu appuyées, et offrant à un ennemi audacieux un objet de vive tentation. Tout bouillant encore du combat de la Haye-Sainte, confiant dans les cinq mille cavaliers qui venaient de lui arriver, et qui formaient quatre belles lignes de cavalerie, Ney n'était pas homme à se tenir tranquille sous les décharges de l'artillerie anglaise. S'étant aperçu que cette artillerie était sans appui, et que l'infanterie anglaise elle-même avait exécuté un mouvement rétrograde, il résolut d'enlever la rangée de canons qu'il avait devant lui, et se mettant à la tête de la division Delort composée de quatre régiments de cuirassiers, ordonnant à la division Wathier de le soutenir, il partit au trot malgré le mauvais état du sol. Ne pouvant déboucher par la chaussée de Bruxelles qui était obstruée, gêné par l'encaissement du chemin d'Ohain, très profond en cet endroit, il prit un peu à gauche, franchit le bord du plateau avec ses quatre régiments, et fondit comme l'éclair sur l'artillerie qui était peu défendue. Après avoir dépassé la ligne des canons, voyant l'infanterie de la division Alten qui semblait rétrograder, il jeta sur elle ses cuirassiers. Ces braves cavaliers, malgré la grêle de balles qui pleuvait sur eux, tombèrent à bride abattue sur les carrés de la division Alten, et en renversèrent plusieurs qu'ils se mirent à sabrer avec fureur. Cependant quelques-uns de ces carrés, enfoncés d'abord par le poids des hommes et des chevaux, mais se refermant en toute hâte sur nos cavaliers démontés, eurent bientôt réparé leurs brèches. D'autres, restés intacts, continuèrent à faire un feu meurtrier. Ney, en voyant cette résistance, lance sa seconde division, celle de Wathier, et sous cet effort violent de quatre nouveaux régiments de cuirassiers, la division Alten est culbutée sur la seconde ligne de l'infanterie anglaise. Plusieurs bataillons des légions allemande et hanovrienne sont enfoncés, foulés aux pieds, sabrés, privés de leurs drapeaux. Nos cuirassiers, qui étaient les plus vieux soldats de l'armée, assouvissent leur rage en tuant des Anglais sans miséricorde. Inébranlable au plus fort de cette tempête, le duc de Wellington fait passer à travers les intervalles de son infanterie la brigade des gardes à cheval de Somerset, les carabiniers hollandais de Trip, et les dragons de Dörnberg. Ces escadrons anglais et allemands, profitant du désordre inévitable de nos cavaliers, ont d'abord sur eux l'avantage, et parviennent à les repousser. Mais Ney, courant à Lefebvre-Desnoëttes, lui fait signe d'arriver, et le jette sur la cavalerie anglaise et allemande du duc de Wellington. Nos braves lanciers se précipitent sur les gardes à cheval, et, se servant avec adresse de leurs lances, les culbutent à leur tour. Ayant eu le temps de se reformer pendant cette charge, nos cuirassiers reviennent, et joints à nos chasseurs, à nos lanciers, fondent de nouveau sur la cavalerie anglaise. On se mêle, et mille duels, le sabre ou la lance à la main, s'engagent entre les cavaliers des deux nations. Bientôt les nôtres l'emportent, et une partie de la cavalerie anglaise reste sur le carreau. Ses débris se réfugient derrière les carrés de l'infanterie anglaise, et nos cavaliers se voient arrêtés encore une fois, avec grand dommage pour la cavalerie légère de la garde, qui n'étant pas revêtue de cuirasses, perd par le feu beau- coup d'hommes et de chevaux. Ney, au milieu de cet effroyable débordement de fureurs humaines, a déjà eu deux chevaux tués sous lui. Son habit, son chapeau sont criblés de balles ; mais toujours invulnérable, le brave des braves a juré d'enfoncer l'armée anglaise. Il s'en flatte à l'aspect de ce qu'il a déjà fait, et en voyant immobiles sur le revers du plateau trois mille cuirassiers et deux mille grenadiers à cheval de la garde, qui n'ont pas encore donné, il demande qu'on les lui confie pour achever la victoire. Il rallie ceux qui viennent de combattre, les range au bord du plateau pour leur laisser le temps de respirer, et galope vers les autres pour les amener au combat. Toute l'armée avait aperçu de loin cette mêlée formidable, et au mouvement des casques, des lances, qui allaient, venaient sans abandonner la position, avait bien auguré du résultat. L'instinct du dernier soldat était qu'il fallait continuer une telle œuvre une fois commencée, et les soldats avaient raison ; car si c'était une faute de l'avoir entreprise, t'eût été une plus grande faute de l'interrompre. Napoléon, dont l'attention avait été rappelée de ce côté par cet affreux tumulte de cavalerie, avait aperçu l'œuvre tentée par l'impatience de Ney. Tout autour de lui on y avait applaudi. Mais ce capitaine consommé qui avait déjà livré plus de cinquante batailles rangées, s'était écrié : C'est trop tôt d'une heure... — Cet homme, avait ajouté le maréchal Soult en parlant de Ney, est toujours le même ! il va tout compromettre comme à Iéna, comme à Eylau !... — Napoléon néanmoins pensa qu'il fallait soutenir ce qui était fait, et il envoya l'ordre à Kellermann d'appuyer les cuirassiers de Milhaud. — Les trois mille cuirassiers de Kellermann avaient derrière eux la grosse cavalerie de la garde, forte de deux mille grenadiers à cheval et dragons, et les uns comme les autres brûlant d'impatience d'en venir aux mains ; car la cavalerie était au moins aussi ardente que l'infanterie dans cette funeste journée. Kellermann, qui venait d'éprouver aux Quatre-Bras ce qu'il appelait la folle ardeur de Ney, blâmait l'emploi désespéré qu'on faisait en ce moment de la cavalerie. Se défiant du résultat, il retint une de ses brigades, celle des carabiniers, pour s'en servir comme dernière ressource, et livra le reste au maréchal Ney avec un profond chagrin. Celui-ci, accouru à la rencontre des cuirassiers de Kellermann, les enflamme par sa présence et ses gestes, et gravit avec eux le plateau, au bord duquel la cavalerie précédemment engagée reprenait haleine. Lu duc de Wellington attendait de sang-froid ce nouvel assaut. Derrière la division Alten, presque détruite, il avait rangé le corps de Brunswick, les gardes de Maitland, la division Mitchell, et en troisième ligne, les divisions Chassé et Clinton. Abattre ces trois murailles était bien difficile, car on pouvait en renverser une, même deux, mais il n'était guère à espérer qu'on vint à bout de la troisième. Néanmoins l'audacieux Ney débouche sur le plateau avec ses escadrons couverts de fer, et à son signal ces braves cavaliers partent au galop en agitant leurs sabres, en criant Vive l'Empereur ! Jamais, ont dit les témoins de cette scène épouvantable, on ne vit rien de pareil dans les annales de la guerre. Ces vingt escadrons, officiers et généraux en tête, se précipitent de toute la force de leurs chevaux, et malgré une pluie de feux, abordent, rompent la première ligne anglaise. L'infortunée division Alten, déjà si maltraitée, est culbutée cette fois, et le 69e anglais est haché en entier. Les débris de cette division se réfugient en désordre sur la chaussée de Bruxelles. Ney, ralliant ses escadrons, les lance sur la seconde ligne. Ils l'abordent avec la même ardeur, mais ils trouvent ici une résistance invincible. Plusieurs carrés sont rompus, toutefois le plus grand nombre se maintient, et quelques-uns de nos cavaliers perçant jusqu'à la troisième ligne, expirent devant ses baïonnettes, ou se dérobent au galop pour se reformer en arrière, et renouveler la charge. Le duc de Wellington se décide alors à sacrifier les restes de sa cavalerie. Il la jette dans cette mêlée où bientôt elle succombe, car si l'infanterie anglaise peut arrêter nos cuirassiers par ses baïonnettes, aucune cavalerie ne peut supporter leur formidable choc. Dans cette extrémité il veut faire emploi de mille hussards de Cumberland qui sont encore intacts. Mais à la vue de cette arène sanglante ces hussards se replient en désordre, entraînant sur la route de Bruxelles les équipages, les blessés, les fuyards, qui déjà s'y précipitent en foule. Ney, malgré la résistance qu'il rencontre, ne désespère pas d'en finir le sabre au poing avec l'armée anglaise. Un nouveau renfort imprévu lui arrive. Tandis qu'il livre ce combat de géants, la grosse cavalerie de la garde accourt sans qu'on sache pourquoi. Elle était demeurée un peu en arrière dans un pli du terrain, lorsque quelques officiers s'étant portés en avant pour assister au combat prodigieux de Ney avaient cru à son triomphe, et avaient crié victoire en agitant leurs sabres. A ce cri d'autres officiers s'étaient avancés, et les escadrons les plus voisins, se figurant qu'on leur donnait le signal de la charge, s'étaient ébranlés au trot. La masse avait suivi, et par un entraînement involontaire les deux mille dragons et grenadiers à cheval avaient gravi le plateau, au milieu d'une terre boueuse et détrempée. Pendant ce temps, Bertrand envoyé par Napoléon pour les retenir, avait couru en vain après eux sans pouvoir les rejoindre. Ney s'empare de ce renfort inattendu, et le jette sur la muraille d'airain qu'il veut abattre. La grosse cavalerie de la garde fait à son tour des prodiges, enfonce des carrés, mais, faute de cuirasses, perd un grand nombre d'hommes sous les coups de la mousqueterie. Ney, que rien ne saurait décourager, lance de nouveau les cuirassiers de Milhaud, qui venaient de se reposer quelques instants, et opère ainsi une sorte de charge continue, au moyen de nos escadrons qui après avoir chargé, vont au galop se reformer en arrière pour charger encore. Quelques-uns même tournent le bois de Goumont, pour venir se remettre en rang et recommencer le combat. Au milieu de cet acharnement, Ney apercevant la brigade des carabiniers que Kellermann avait tenue en réserve, court à elle, lui demande ce qu'elle fait, et malgré Kellermann s'en saisit, et la conduit à l'ennemi. Elle ouvre de nouvelles brèches dans la seconde ligne de l'infanterie britannique, renverse plusieurs carrés, les sabre sous le feu de la troisième ligne, mais ruine aux trois quarts le second mur sans atteindre ni entamer le troisième. Ney s'obstine, et ramène jusqu'à onze fois ses dix mille cavaliers au combat, tuant toujours, sans pouvoir w venir à bout de la constance d'une infanterie qui, renversée un moment, se relève, se reforme, et tire encore. Ney tout écumant, ayant perdu son quatrième cheval, sans chapeau, son habit percé de balles, ayant une quantité de contusions et heureusement pas une blessure pénétrante, dit au colonel Heymès que si on lui donne l'infanterie de la garde, il achèvera cette infanterie anglaise épuisée et arrivée au dernier terme des forces humaines. Il lui ordonne d'aller la demander à Napoléon. Dans cette espérance, voyant bien que ce n'est pas avec les troupes à cheval qu'il terminera le combat, et qu'il faut de l'infanterie pour en finir avec la baïonnette, il rallie ses cavaliers sur le bord du plateau, et les y maintient par sa ferme contenance. Il parcourt leurs rangs, les exhorte, leur dit qu'il faut rester là malgré le feu de l'artillerie, et que bientôt, si on a le courage de conserver le plateau, on sera débarrassé pour jamais de l'armée anglaise. C'est ici, mes amis, leur dit-il, que va se décider le sort de notre pays, c'est ici qu'il faut vaincre pour assurer notre indépendance. — Quittant un moment la cavalerie, et courant à droite auprès de d'Erlon dont l'infanterie avait réussi à s'emparer du chemin d'Ohain, et continuait à faire le coup de fusil avec les bataillons presque détruits de Pack et de Kempt, Tiens bien, mon ami, lui dit-il, car toi et moi, si nous ne mourons pas ici sous les balles des Anglais, il ne nous reste qu'à tomber misérablement sous les balles des émigrés ! — Triste et douloureuse prophétie ! Ce héros sans pareil, allant ainsi de ses fantassins à ses cavaliers, les maintient sous le feu, et y demeure lui-même, miracle vivant d'invulnérabilité, car il semble que les balles de l'ennemi ne puissent l'atteindre. Quatre mille de ses cavaliers jonchent le sol, mais en revanche dix mille Anglais, fantassins ou cavaliers, ont payé de leur vie leur opiniâtre résistance. Presque tous les généraux anglais sont frappés plus ou moins gravement. Une multitude de fuyards, sous prétexte d'emporter les blessés, ont couru avec les valets, les cantiniers, les conducteurs de bagages, sur la route de Bruxelles, criant que tout est fini, que la bataille est perdue. Au contraire, les soldats qui n'ont pas quitté le rang, se tiennent immobiles à leur place. Le duc de Wellington montant sa fermeté au niveau de l'héroïsme de Ney, leur dit que les Prussiens approchent, que dans peu d'instants ils vont paraître, qu'en tout cas il faut mourir en les attendant. Il regarde sa montre, invoque la nuit ou Blücher comme son salut ! Mais il lui reste trente-six mille hommes sur ce plateau contre lequel Ney s'acharne, et il ne désespère pas encore. Ney ne désespère pas plus que lui, et ces deux grands cœurs balancent les destinées des deux nations ! Un étrange phénomène de lassitude se produit alors. Pendant près d'une heure les combattants épuisés cessent de s'attaquer. Les Anglais tirent à peine quelques coups de canon avec les débris de leur artillerie, et de leur côté nos cavaliers, ayant derrière eux soixante pièces conquises et six drapeaux, demeurent inébranlables, ayant des milliers de cadavres sous leurs pieds. Pendant ce combat sans exemple, digne et terrible fin de siècle sanglant, le colonel Heymès était accouru auprès de Napoléon pour lui demander de l'infanterie au nom de son maréchal. — De l'infanterie ! répondit Napoléon avec une irritation qu'il ne pouvait plus contenir, où veut-il que j'en prenne ? veut-il que j'en fasse faire ?... — Voyez ce que j'ai sur les bras, et voyez ce qui me reste... — En effet, la situation vers la droite était devenue des plus graves. Au corps de Bülow, fort de trente mille hommes, que Napoléon essayait d'arrêter avec les dix mille soldats de Lobau, venaient se joindre d'épaisses colonnes qu'on apercevait dans les fonds boisés d'où sortait l'armée prussienne. Il était évident qu'on allait avoir affaire à toutes les forces de Blücher, c'est-à-dire à 80 mille hommes, auxquels on n'aurait à opposer que l'infanterie de la garde, c'est-à-dire 13 mille combattants, car la cavalerie de cette garde et toute la réserve, dragons, cuirassiers, venaient d'être employés et usés par le maréchal Ney dans une tentative prématurée ! Quant à l'arrivée de Grouchy, Napoléon avait cessé de l'espérer, car on n'avait aucune nouvelle de ce commandant de notre aile droite, et en promenant sur tout l'horizon l'œil le plus exercé, l'oreille la plus fine, il était impossible de saisir une ombre, un bruit qui accusât sa présence, même son voisinage. L'infanterie de la garde qu'on demandait à Napoléon était donc sa seule ressource contre une effroyable catastrophe. Sans doute s'il avait pu voir de ses propres yeux ce que Ney lui mandait de l'état de l'armée britannique, si le péril ne s'étant pas aggravé à droite il avait pu contenir Bülow avec Lobau seul, il aurait dû se jeter avec l'infanterie de la garde sur les Anglais, achever de les écraser, et revenir ensuite sur les Prussiens pour leur opposer des débris il est vrai, mais des débris victorieux ! Il serait sorti de cette mêlée comme un vaillant homme, qui ayant deux ennemis à combattre, parvient à triompher de l'un et de l'autre, en tombant à demi mort sur le cadavre du dernier. Mais il doutait du jugement de Ney, il ne lui pardonnait pas sa précipitation, et il voyait l'armée prussienne sortir tout entière de cet abîme béant qui vomissait sans cesse de nouveaux ennemis. Il voulut donc arrêter les Prussiens par un engagement à fond avec eux, avant d'aller essayer de gagner au centre une bataille douteuse, tandis qu'à sa droite il en laisserait une qui serait probablement perdue et mortelle. Toutefois après un moment d'irritation, reprenant son empire sur lui-même, il envoya à Ney une réponse moins dure et moins désolante que celle qu'il avait d'abord faite au colonel Heymès. Il chargea ce dernier de dire au maréchal que, si la situation était difficile sur le plateau de Mont-Saint-Jean, elle ne l'était pas moins« sur les bords du ruisseau de Lasne ; qu'il avait sur les bras la totalité de l'armée prussienne, que lorsqu'il serait parvenu à la repousser, ou du moins à la contenir, il irait avec la garde achever, par un effort désespéré, la victoire à demi remportée sur les Anglais ; que jusque-là il fallait rester à tout prix sur ce plateau, puisque Ney s'était tant pressé d'y monter, et que pourvu qu'il s'y maintînt une heure, il serait prochainement et vigoureusement secouru. En effet, pendant que le colonel Heymès allait porter à Ney cette réponse si différente de celle que le maréchal attendait, le combat avec les Prussiens était devenu aussi terrible qu'avec les Anglais. Blücher rendu de sa personne sur les lieux, c'est-à-dire sur les hauteurs qui bordent le ruisseau de Lasne, voyait distinctement ce qui se passait sur le plateau de Mont-Saint-Jean, et bien qu'il ne fût pas fâché de laisser les Anglais dans les angoisses, de les punir ainsi du secours, tardif selon lui, qu'il en avait reçu à Ligny, il ne voulait pas compromettre la cause commune par de mesquins ressentiments. En apercevant de loin les assauts formidables de nos cuirassiers, il avait ordonné à Bülow d'enfoncer la droite des Français, il avait prescrit à Pirch, qui amenait quinze mille hommes, de seconder Bülow de tous ses moyens, à Ziethen, qui en amenait à peu près autant, d'aller soutenir la gauche des Anglais par le chemin d'Ohain, et aux uns comme aux autres, de hâter le pas et de se comporter de manière à terminer la guerre dans cette journée mémorable. L'ardeur de Blücher avait pénétré toutes les âmes, et les Prussiens, excités par le patriotisme et par la haine, faisaient des efforts inouïs pour s'établir sur cette espèce de promontoire qui s'avance entre le ruisseau de Smohain et le ruisseau de Lasne. Tandis que la division de Losthin tâchait d'emporter le château de Frichermont, et celle de Hiller la ferme de Hanotelet, elles avaient laissé entre elles un intervalle que Bülow avait rempli avec la cavalerie du prince Guillaume. Le brave comte de Lobau à cheval au milieu de ses soldats, dont il dominait les rangs de sa haute stature, montrait tin imperturbable sang-froid, se retirait lentement comme sur un champ de manœuvre, tantôt lançant la cavalerie de Subervic et de Domon sur les escadrons du prince Guillaume, tantôt arrêtant par des charges à la baïonnette l'infanterie de Losthin à sa gauche, celle de Hiller à sa droite. Il était six heures, et sur 7.500 baïonnettes il en avait perdu environ 2.500, ce qui le réduisait à cinq mille fantassins en présence de trente mille hommes. Son danger le plus grand était d'être débordé par sa droite, les Prussiens faisant d'immenses efforts pour nous tourner. En effet, en remontant le ruisseau de Lasne jusqu'à sa naissance, on arrivait au village de Planchenois, situé en arrière de la Belle-Alliance, c'est-à-dire sur notre droite et nos derrières. Si donc l'ennemi en suivant le ravin pénétrait dans ce village bâti ad fond même du ravin, nous étions tournés définitivement, et la chaussée de Charleroy, notre seule ligne de retraite, était perdue. Aussi Bülow faisant appuyer la division Hiller par la division Ryssel, les avait-il poussées dans le ravin de Lasne jusqu'à Planchenois, tandis que vers Frichermont il faisait appuyer la division Losthin par la division Haaken. C'est en vue de ce grave danger que Napoléon, qui s'était personnellement transporté vers cet endroit, avait envoyé au comte de Lobau tous les secours dont il avait pu disposer. A gauche, il avait détaché la division Durutte du corps de d'Erlon, et l'avait portée vers les fermes de la Haye et de Papelotte pour établir un pivot solide au sommet de l'angle formé par notre ligne de bataille. A droite, il avait envoyé à Planchenois le général Duhesme avec la jeune garde, et 24 bouches à feu de la réserve, pour y défendre un poste qu'on pouvait appeler justement les Thermopyles de la France. En ce moment le général Duhesme, officier consommé, disposant de huit bataillons de jeune garde, forts d'à peu près quatre mille hommes, avait rempli de défenseurs les deux côtés du ravin à l'extrémité duquel était construit le village de Planchenois. Tandis qu'il faisait pleuvoir les boulets et la mitraille sur les Prussiens, ses jeunes fantassins, les uns établis dans les arbres et les buissons, les autres logés dans les maisons du village, se défendaient par un feu meurtrier de mousqueterie, et ne paraissaient pas près de se laisser arracher leur position, quoique assaillis par plus de vingt mille hommes. Vers six heures et demi, Blücher ayant donné l'ordre d'enlever Planchenois, Hiller forme six bataillons en colonne, et après avoir criblé le village de boulets et d'obus, essaye d'y pénétrer baïonnette baissée. Nos soldats postés aux fenêtres des maisons font d'abord un feu terrible, puis Duhesme lançant lui-même un de ses bataillons, refoule les Prussiens à la baïonnette, et les rejette dans le ravin, où notre artillerie les couvre de mitraille. Ils se replient en désordre horriblement maltraités à la suite de cette inu- tile tentative. Blücher alors réitère à ses lieutenants l'ordre absolu d'enlever Planchenois, et Hiller, sous les yeux mêmes de son chef, rallie ses bataillons après les avoir laissés respirer un instant, leur en adjoint huit autres, et avec quatorze revient à la charge, bien résolu d'emporter cette fois le poste si violemment disputé. Ces quatorze bataillons s'enfoncent dans le ravin bordé de chaque côté par nos soldats, et s'avancent au milieu d'un véritable gouffre de feux. Quoique tombant par centaines, ils serrent leurs rangs en marchant sur les cadavres de leurs compagnons, se poussent les uns les autres, et finissent par pénétrer dans ce malheureux village de Planchenois, par s'élever même jusqu'à la naissance du ravin. Ils n'ont plus qu'un pas à faire pour déboucher sur la chaussée de Charleroy. Nos jeunes soldats de la garde se replient, tout émus d'avoir subi cette espèce de violence. Mais Napoléon est auprès d'eux ! c'est à la vieille garde à tout réparer. Cette troupe invincible ne peut se laisser arracher notre ligne de retraite, salut de l'armée. Napoléon appelle le général Morand, lui donne un bataillon du 2e de grenadiers, un du 2e de chasseurs, et lui prescrit de repousser cette tentative si alarmante pour nos derrières. Il passe à cheval devant ces bataillons. — Mes amis, leur dit-il, nos voici arrivés au moment suprême : il ne s'agit pas de tirer, il faut joindre l'ennemi corps à corps, et avec la pointe de vos baïonnettes le précipiter dans ce ravin d'où il est sorti, et d'où il menace l'armée, l'Empire et la France ! — Vive l'Empereur ! est la seule réponse de cette troupe héroïque. Les deux bataillons désignés rompent le carré, se forment en colonnes, et l'un à gauche, l'autre à droite, se portent au bord du ravin d'où les Prussiens débouchaient déjà en grand nombre. Ils abordent les assaillants d'un pas si ferme, d'un bras si vigoureux, que tout cède à leur approche. Furieux contre l'ennemi qui voulait nous tourner, ils renversent ou égorgent tout ce qui résiste et convertissent en un torrent de fuyards les bataillons de Hiller qui venaient de vaincre la jeune garde. Tantôt se servant de la baïonnette, tantôt de la crosse de leurs fusils, ils percent ou frappent, et telle est l'ardeur qui règne parmi eux, que le tambour-major de l'un des bataillons assomme avec la pomme de sa canne les fuyards qu'il peut joindre. Entraînés eux-mêmes par le torrent qu'ils ont produit, les deux bataillons de vieille garde se précipitent dans le fond du ravin, et remontent à la suite des Prussiens la berge opposée, jusqu'auprès du village de Maransart, situé en face de Planchenois. Là cependant on les arrête avec la mitraille, et ils sont obligés de se replier. Mais ils restent maîtres de Planchenois et de la chaussée de Charleroy, et pour cette vengeance de la jeune garde par la vieille, deux bataillons avaient suffi ! On pouvait évaluer à deux mille les victimes qu'ils avaient faites dans cette charge épouvantable. En ce moment la redoutable attaque de flanc tentée par les Prussiens semblait repoussée, à en juger du moins par les apparences. Si un incident nouveau survenait, ce ne pouvait être d'après toutes les probabilités que l'apparition de Grouchy, laquelle si longtemps attendue devait se réaliser enfin, et dans ce cas amener pour les Prussiens un vrai désastre, car ils se trouveraient entre deux feux. On entendait en effet du côté de Wavre une canonnade qui attestait la présence sur ce point de notre aile droite, mais le détachement qu'on avait formellement demandé à Grouchy devait être en route, et sa seule arrivée sur les derrières de Bülow suffisait pour produire d'importantes conséquences. A l'angle de notre ligne de bataille, à Papelotte, Durutte se soutenait ; au centre, à la gauche, le plateau de Mont-Saint-Jean restait couvert de notre cavalerie ; on venait d'apporter aux pieds de Napoléon les six drapeaux conquis par nos cavaliers sur l'infanterie anglaise. L'aspect d'abord sombre de la journée semblait s'éclaircir. Le cœur de Napoléon, un instant oppressé, respirait, et il pouvait compter sur une nouvelle victoire en portant sa vielle garde, désormais libre, derrière sa cavalerie pour achever la défaite des Anglais. Jusqu'ici soixante-huit mille Français avaient tenu tête à environ cent quarante mille Anglais, Prussiens, Hollandais, Allemands, et leur avaient arraché la plus grande partie du champ de bataille. Saisissant avec promptitude le moment décisif, celui de l'attaque repoussée des Prussiens, pour jeter sa réserve sur les Anglais, Napoléon ordonne de réunir la vieille garde, de la porter au centre de sa ligne, c'est-à-dire sur le plateau de Mont-Saint-Jean, et de la jeter à travers les rangs de nos cuirassiers, sur l'infanterie britannique épuisée. Quoique épuisée, elle aussi, notre cavalerie en voyant la vieille garde engagée, ne peut manquer de retrouver son élan, de charger une dernière fois, et de terminer cette lutte horrible. Il est vrai qu'il n'y aura plus aucune réserve pour parer à un accident imprévu, mais le grand joueur en est arrivé à cette extrémité suprême où la prudence c'est le désespoir ! Il restait à Napoléon sur vingt-quatre bataillons de la garde, réduits à vingt-trois après Ligny, treize qui n'avaient pas donné. Huit de la jeune garde s'étaient épuisés à Planchenois, et y étaient encore indispensables, deux de la vieille garde avaient décidé la défaite des Prussiens, et ne devaient pas non plus quitter la place. Des treize restants, un était établi en carré à l'embranchement du chemin de Planchenois avec la chaussée de Charleroy, et ce n'était pas trop assurément pour garder notre ligne de communication. Même en usant de ses dernières ressources, on ne pouvait se dispenser de laisser deux bataillons au quartier général pour parer à un accident, tel par exemple qu'un nouvel effort des Prussiens sur Planchenois. Napoléon laisse donc les deux bataillons du ler de grenadiers à Rossomme, un peu en arrière de la ferme de la Belle-Alliance, et porte lui-même en avant les dix autres, qui présentaient une masse d'environ six mille fantassins. Ils comprenaient les bataillons de la moyenne et de la vieille garde, soldats plus ou moins anciens, mais tous éprouvés, résolus à vaincre ou à mourir, et suffisants pour enfoncer quelque ligne d'infanterie que ce fût. Napoléon était occupé à les ranger en colonnes d'attaque sur le bord du vallon qui nous séparait des Anglais, lorsqu'il entend quelques coups de fusil vers Papelotte, c'est-à-dire à l'angle de sa ligne de bataille. Une sorte de frémissement saisit son cœur. Ce peut être l'arrivée de Grouchy ; ce peut être aussi un nouveau débordement de Prussiens, et dans le doute il aimerait mieux que ce ne fût rien. Mais ses inquiétudes augmentent en voyant quelques troupes de Durutte abandonner la ferme de Papelotte, au cri de sauve qui peut, proféré par la trahison, ou par ceux qui la craignent. Napoléon pousse son cheval p vers les fuyards, leur parle, les ramène à leur poste, et revient à la Haye-Sainte, lorsqu'en levant les yeux vers le plateau, il remarque un certain ébranlement dans sa cavalerie jusque-là immobile. Un sinistre pressentiment traverse son âme, et il commence à croire que de ce poste élevé nos cavaliers ont dû apercevoir de nouvelles troupes prussiennes. Sur-le-champ, ne donnant rien au chagrin, tout à l'action, il envoie La Bédoyère au galop parcourir de droite à gauche les rangs des soldats, et dire que les coups de fusil qu'on entend sont tirés par Grouchy, qu'un grand résultat se prépare, pourvu qu'on tienne encore quelques instants. Après avoir chargé La Bédoyère de répandre cet utile mensonge, il se décide à lancer sur le plateau de Mont-Saint-Jean les dix bataillons de la garde qu'il avait amenés. Il en confie quatre au brave Friant pour exécuter une attaque furieuse, de concert avec Reille qui doit rallier pour cette dernière tentative ce qui lui reste de son corps, puis il dispose les six autres diagonalement, de la Haye-Sainte à Planchenois, de manière à lier son centre avec sa droite, et, à pourvoir aux nouveaux événements qu'il redoute. Son intention, si ces événements n'ont pas la gravité qu'il suppose, est de mener lui-même ces six bataillons à la suite des quatre premiers, pour enfoncer à tout prix la ligne anglaise, et terminer ainsi la journée. Conduisant par la chaussée de Bruxelles les quatre bataillons destinés à la première attaque, il rencontre en chemin Ney presque hors de lui, s'écriant que la cavalerie va lâcher pied, si un puissant secours d'infanterie n'arrive à l'instant même. Napoléon lui donne les quatre bataillons qu'il vient d'amener, lui en promet six autres, sans ajouter, ce qui malheureusement est trop inutile à dire, que le salut de la France dépend de la charge qui va s'exécuter. Ney prend les quatre bataillons, et gravit avec eux le plateau au moment même où les restes du corps de Reille se disposent à déboucher du bois de Goumont. Tandis que Ney et Friant s'apprêtent à charger avec leur infanterie, le duc de Wellington, à la vue des bonnets à poil de la garde, sent bien que l'heure suprême a sonné, et que la grandeur de sa patrie, la sienne, vont être le prix d'un dernier effort. Il a vu de loin s'approcher de nouvelles colonnes prussiennes, et, dans l'espérance d'être secouru, il est résolu à tenir jusqu'à la dernière extrémité, bien que derrière lui des masses de fuyards couvrent déjà la route de Bruxelles. Il tâche de communiquer à ses compagnons d'armes la force de son âme. Kempt, qui a remplacé dans le commandement de l'aile gauche Picton tué tout à l'heure, lui fait demander des renforts, car il n'a plus que deux à trois milliers d'hommes. — Qu'ils meurent tous, répond-il, je n'ai pas de renforts à leur envoyer. — Le général Hill, commandant en second de l'armée, lui dit : Vous pouvez être tué ici, quels ordres me laissez-vous ? — Celui de mourir jusqu'au dernier, s'il le faut, pour donner aux Prussiens le temps de venir. — Ces nobles paroles prononcées, le duc de Wellington serre la ligne, la courbe légèrement comme un arc, de manière à placer les nouveaux assaillants au milieu de feux concentriques, puis fait coucher à terre les gardes de Maitland, et attend immobile l'apparition de la garde impériale. Ney et Friant en effet portent leurs quatre bataillons en avant, et les font déboucher sur le plateau en échelons, celui de gauche le premier, les autres successivement, chacun d'eux un peu à droite et en arrière du précédent. Dès que le premier paraît, ferme et aligné, la mitraille l'accueille, et perce ses rangs en cent endroits. La ligne des bonnets à poil flotte sans reculer, et elle avance avec une héroïque fermeté. Les autres bataillons débouchent à leur tour, essuyant le même feu sans se montrer plus émus. Ils s'arrêtent pour tirer, et par un feu terrible rendent le mal qu'on leur a fait. A ce même instant, les divisions Foy et Bachelu du corps de Reille débouchant sur la gauche, attirent à elles une partie des coups de l'ennemi. Après avoir déchargé leurs armes, les bataillons de la garde se disposent à croiser la baïonnette pour engager un duel à mort avec l'infanterie britannique, lorsque tout à coup, à un signe du duc de Wellington, les gardes de Maitland couchés à terre se lèvent, et exécutent presque à bout portant une affreuse décharge. Devant cette cruelle surprise nos soldats ne reculent pas, et serrent leurs rangs pour marcher en avant. Le vieux Friant, le modèle de la vieille armée, gravement blessé, descend tout sanglant pour annoncer que la victoire est certaine, si de nouveaux bataillons viennent appuyer les premiers. Il rencontre Napoléon qui, après avoir placé à mi-côte un bataillon de la garde en carré, afin de contenir la cavalerie ennemie, s'avance pour conduire lui-même à l'assaut de la ligne anglaise les cinq bataillons qui lui restent. Tandis qu'il écoute les paroles de Friant, l'œil toujours dirigé vers sa droite, il aperçoit soudainement, dans la direction de Papelotte, environ trois mille cavaliers qui se précipitent sur la déclivité du terrain. Ce sont les escadrons de Vandeleur et de Vivian qui, voyant arriver le corps prussien de Ziethen par le chemin d'Ohain, et se sentant dès lors appuyés, se hâtent de charger. En effet, pendant que le corps de Pirch était allé soutenir Bülow, celui de Ziethen était venu, en longeant la forêt de Soignes, soutenir la gauche de Wellington. Il était huit heures, et sa présence allait tout décider. En un clin d'œil la cavalerie de Vandeleur et de Vivian inonde le milieu du champ de bataille. Napoléon qui avait laissé en carré, à mi-côte du vallon, l'un de ses bataillons, court aux autres pour les former également en carrés, et empêcher que sa ligne ne soit percée entre la Haye-Sainte et Planchenois. Si la cavalerie de la garde était intacte, il se débarrasserait aisément des escadrons de Vivian et de Vandeleur, et le terrain nettoyé, il pourrait ramener à lui sa gauche et son centre engagés sur le plateau de Mont-Saint-Jean, se retirer en bon ordre vers sa droite, et recueillant ainsi ce qui lui reste, coucher sur le champ de bataille. Mais de toute la cavalerie de la garde, il conserve quatre cents chasseurs au plus pour les opposer à trois mille. Il les lance néanmoins, et ces quatre cents braves gens se précipitant sur les escadrons de Vivian et de Vandeleur, repoussent d'abord les plus rapprochés, mais sont bientôt refoulés par le flot toujours croissant de la cavalerie ennemie. Une vraie multitude à cheval à l'uniforme anglais et prussien remplit en un instant le champ de bataille. Formés en citadelles inébranlables, les bataillons de la garde la couvrent de feu, mais ne peuvent l'empêcher de se répandre en tout sens. Pour comble de malheur l'infanterie de Ziethen, arrivée à la suite de la cavalerie prussienne, se jette sur la division Durutte à moitié détruite, lui enlève les fermes de la Haye et de Papelotte, et nous arrache ainsi le pivot sur lequel s'appuyait l'angle de notre ligne de bataille, repliée en potence depuis qu'il avait fallu faire face à deux ennemis à la fois. Tout devient dès lors trouble et confusion. Notre grosse cavalerie retenue sur le plateau de Mont-Saint-Jean par l'indomptable fermeté de Ney, se voyant enveloppée, se retire pour n'être pas coupée du centre de l'armée. Ce mouvement rétrograde sur un terrain en pente se change bientôt en un torrent impétueux d'hommes et de chevaux. Les débris de d'Erlon se débandent à la suite de notre cavalerie. Ivre de joie, le général anglais, qui jusque-là s'était borné à se défendre, prend alors l'offensive, et porte sa ligne en avant contre nos bataillons de la garde réduits de plus de la moitié. De la gauche à la droite, les armées anglaise et prussienne marchent sut nous, précédées de leur artillerie qui vomit des feux destructeurs. Napoléon, ne se dissimulant plus le désastre, tâche néanmoins de rallier les s fuyards sur les bataillons de la garde demeurés en carré. Le désespoir dans l'âme, le calme sur le front, il reste sous une pluie de feux pour maintenir son infanterie, et opposer une digue au débordement des deux armées victorieuses. En ce moment il montait un cheval gris mal dressé, s'agitant sous les boulets et les obus : il en demande un autre à son page Gudin, prêt à recevoir comme un bienfait le coup qui le délivrera de la vie ! Les infanteries anglaise et prussienne continuant de s'approcher, les carrés de la garde, qui d'abord ont tenu tête à la cavalerie, sont obligés de rétrograder, poussés par l'ennemi et par le torrent des fuyards. Notre armée, après avoir déployé dans cette journée un courage surhumain, tombe tout à coup dans l'abattement qui suit les violentes émotions. Se défiant de ses chefs, ne se fiant qu'en Napoléon, et par comble d'infortune ne le voyant plus depuis que les ténèbres enveloppent le champ de bataille, elle le demande, le cherche, ne le trouve pas, le croit mort, et se livre à un vrai désespoir. — Il est blessé, disent les uns, il est tué, disent les autres, et à cette nouvelle qu'elle a faite, notre malheureuse armée fuit en tout sens, prétendant qu'on l'a trahie, que Napoléon mort elle n'a plus rien à faire en ce monde. Si un corps entier restait en arrière, qui put la rallier, l'éclairer, lui montrer Napoléon vivant, elle s'arrêterait, prête encore à combattre y et à mourir. Mais jusqu'au dernier homme tout a donné, et quatre ou cinq carrés de la garde, au milieu de cent cinquante mille hommes victorieux, sont comme trois ou quatre cimes de rochers que l'Océan furieux couvre de son écume. L'armée n'aperçoit pas même ces carrés, noyés au milieu des flots de l'ennemi, et elle fuit en désordre sur la route de Charleroy. Là elle trouve les équipages de l'artillerie qui, ayant épuisé leurs munitions, ramenaient leurs caissons vides. La confusion s'en accroît, et cette chaussée de Charleroy devient bientôt un vrai chaos où règnent le tumulte et la terreur. L'histoire n'a plus que quelques désespoirs sublimes à raconter, et elle doit les retracer pour l'éternel honneur des martyrs de notre gloire, pour la punition de ceux qui prodiguent sans raison le sang des hommes ! Les débris des bataillons de la garde, poussés pêle-mêle dans le vallon, se battent toujours sans vouloir se rendre. A ce moment on entend ce mot qui traversera les siècles, proféré selon les uns par le général Cambronne, selon les autres par le colonel Michel : La garde meurt et ne se rend pas. — Cambronne, blessé presque mortellement, reste étendu sur le terrain, ne voulant pas que ses soldats quittent leurs rangs pour l'emporter. Le deuxième bataillon du 3e de grenadiers, demeuré dans le vallon, réduit de 500 à 300 hommes, ayant sous ses pieds ses propres camarades, devant lui des centaines de cavaliers abattus, refuse de mettre bas les armes, et s'obstine à combattre. Serrant toujours ses rangs à mesure qu'ils s'éclaircissent, il attend une dernière attaque, et assailli sur ses quatre faces à la fois, fait une décharge terrible qui renverse des centaines de cavaliers. Furieux, l'ennemi amène de l'artillerie, et tire à outrance sur les quatre angles du carré. Les angles de cette forteresse vivante abattus, le carré se resserre, ne présentant plus qu'une forme irrégulière mais persistante. Il dédouble ses rangs pour occuper plus d'espace, et protéger ainsi les blessés qui ont cherché asile dans son sein. Chargé encore une fois il demeure debout, abattant par son feu de nouveaux ennemis. Trop peu nombreux pour rester en carré, il profite d'un répit afin de prendre une forme nouvelle, et se réduit alors à un triangle tourné vers l'ennemi, de manière à sauver en rétrogradant tout ce qui s'est réfugié derrière ses baïonnettes. Il est bientôt assailli de nouveau. — Ne nous rendons pas ! s'écrient ces braves gens, qui ne sont plus que cent cinquante. — Tous alors, après avoir tiré une dernière fois, se précipitent sur la cavalerie acharnée à les poursuivre, et avec leurs baïonnettes tuent des hommes et des chevaux, jusqu'à ce qu'enfin ils succombent dans ce sublime et dernier effort. Dévouement admirable, et que rien ne surpasse dans l'histoire des siècles ! Ney, terminant dignement cette journée où Dieu lui accorda pour expier ses fautes l'occasion de déployer le plus grand héroïsme connu, Ney, descendu le dernier du plateau de Mont-Saint-Jean, rencontre les débris de la division Durutte qui battait en retraite. Quelques centaines d'hommes, noble débris de cette division, et comprenant une partie du 95e commandé par le chef de bataillon Rullière, se retiraient avec leurs armes. Le général Durutte s'était porté à quelques pas en avant pour chercher un chemin, lorsque Ney, sans chapeau, son épée brisée à la main, ses habits déchirés, et trouvant encore une poignée d'hommes armés, court à eux pour les ramener à l'ennemi. — Venez, mes amis, leur dit-il, venez voir comment meurt un maréchal de France ! — Ces braves gens, entraînés par sa présence, font volte-face, et se précipitent en désespérés sur une colonne prussienne qui les suivait. Ils font d'abord un grand carnage, mais sont bientôt accablés, et deux cents à peine parviennent à échapper à la mort. Le chef de bataillon Rullière brise la lance qui porte l'aigle du régiment, cache l'aigle sous sa redingote, et suit Ney, démonté pour la cinquième fois, et toujours resté sans blessure. L'illustre maréchal se retire à pied jusqu'à ce qu'un sous-officier de cavalerie lui donne son cheval, et qu'il puisse rejoindre le gros de l'armée, sauvé par la nuit qui couvre enfin comme un voile funèbre ce champ de bataille où gisent soixante mille hommes, morts ou blessés, les uns Français, les autres Anglais et Prussiens. Au milieu de cette scène horrible, nos soldats fuyant en désordre, et cherchant l'homme qu'ils ne cessaient d'idolâtrer quoiqu'il fût le principal auteur de leurs infortunes, continuaient à demander Napoléon, et le croyant mort s'en allaient plus vite. C'était miracle en effet qu'il n'eût pas succombé, mais pour lui comme pour Ney, la Providence semblait préparer une fin plus féconde en enseignement I Après avoir bravé mille morts, il s'était laissé enfermer dans le carré du premier régiment de grenadiers, que commandait le chef de bataillon Martenot. Il marchait ainsi pêle-mêle avec une masse de blessés, au milieu de ses vieux grenadiers, fiers du dépôt précieux confié à leur dévouement, bien résolus à ne pas le laisser arracher de leurs mains, et dans cette journée de désespoir ne désespérant pas des destinées de la patrie, tant que leur ancien général vivait ! Quant à lui, il n'espérait plus rien. Il se retirait à cheval au centre du carré, le visage sombre mais impassible, sondant l'avenir de son regard perçant, et dans l'événement du jour découvrant bien autre chose qu'une bataille perdue ! Il ne sortait de cet abîme de réflexions que pour demander des nouvelles de ses lieutenants, dont quelques-uns d'ailleurs étaient auprès de lui, parmi les blessés que ce carré de la garde emmenait dans ses rangs. On ignorait ce qu'était devenu Ney. On savait Friant, Cambronne, Lobau, Duhesme, Durutte, blessés, et on était inquiet pour leur sort. Les Anglais (il faut leur rendre cette justice), sans conserver dans cette guerre acharnée toute l'humanité que se doivent entre elles des nations civilisées, étaient les seuls qui respectassent les blessés. Ils avaient notamment relevé et respecté Cambronne, atteint des blessures les plus graves. Du reste, dans ce carré qui contenait Napoléon, il régnait une telle stupeur, qu'on marchait presque sans s'interroger. Napoléon seul adressait quelques paroles tantôt au major général ; tantôt à son frère Jérôme qui ne l'avaient pas quitté. Quelquefois quand les escadrons prussiens étaient trop pressants, on faisait halte pour les écarter par le feu de la face attaquée, puis on reprenait cette marche triste et silencieuse, IS battus de temps en temps par le flot des fuyards ou par celui de la cavalerie ennemie. On arriva ainsi à Genappe vers onze heures du soir. Les voitures de l'artillerie s'étant accumulées sur le pont de cette petite ville, l'encombrement devint tel, que personne ne pouvait passer. Heureusement la Dyle qui coule à Genappe était facile à franchir, et chacun se jeta dedans pour atteindre la rive opposée. Ce fut même une protection pour nos fuyards, traversant un à un ce petit cours d'eau, qui pour eux n'était pas un obstacle, tandis qu'il en était un pour l'ennemi marchant en corps d'armée. A Genappe Napoléon quitta le carré de la garde dans lequel il avait trouvé asile. Les autres carrés, encombrés par les blessés et les fuyards, avaient fini par se dissoudre. A partir de Genappe, chacun se retira comme il put. Les soldats de l'artillerie, ne pouvant conserver leurs pièces, qui du reste importaient moins que les chevaux, coupèrent les traits et sauvèrent les attelages. On laissa ainsi dans les mains de l'ennemi près de 200 bouches à feu, dont aucune ne nous avait été enlevée en bataille. Chose remarquable, nous n'avions perdu qu'un drapeau, car le sous-officier de lanciers Urban avait reconquis celui du 45e, l'un des deux pris au corps de d'Erlon. L'ennemi ne nous avait fait d'autres prisonniers que les blessés. Cette fatale journée nous coûtait vingt et quelques mille hommes, y compris les cinq à six mille blessés demeurés au pouvoir des Anglais. Environ vingt généraux avaient été frappés plus ou moins gravement. Les pertes des Anglais égalaient à peu près les nôtres. Celles des Prussiens étaient de huit à dix mille hommes. La journée avait donc coûté plus de trente mille hommes aux alliés, mais ne leur avait pas, comme à nous, coûté la victoire. Le duc de Wellington et le maréchal Blücher se rencontrèrent entre la Belle-Alliance et Planchenois, et s'embrassèrent en se félicitant de l'immense succès qu'ils venaient d'obtenir. Ils en avaient le droit, car l'un par sa fermeté indomptable, l'autre par son ardeur à recommencer la lutte, avaient assuré le triomphe de l'Europe sur la France, et grandement réparé la faute de livrer bataille en avant de la forêt de Soignes. Après les épanchements d'une joie bien naturelle, Blücher, dont l'armée n'avait pas autant souffert que l'armée anglaise, dont la cavalerie d'ailleurs était intacte, se chargea de la poursuite, qui convenait fort à la fureur des Prussiens contre nous. Heureusement si la cavalerie prussienne n'avait pas été exposée à l'épuisement moral de la bataille, elle l'avait été à la fatigue physique de la marche, et elle s'arrêta sur la Dyle. Nos soldats purent donc regagner la Sambre, et la passer soit à Châtelet, soit à Charleroy, soit à Marchiennes-au-Pont. Partout les Belges accueillirent nos blessés et nos fuyards avec l'empressement d'anciens compatriotes. L'année 1814 leur avait inspiré une forte haine contre les Prussiens, et avait réveillé chez eux les sentiments français. Ils partagèrent la douleur de notre défaite, et donnèrent asile à tous ceux de nos soldats qui cherchèrent refuge auprès d'eux. A Charleroy l'encombrement fut immense, quoique moindre cependant qu'à Genappe ; mais la division Girard, commandée par le colonel Matis, et laissée en arrière, protégea le passage. Napoléon s'arrêta quelques instants à Charleroy avec le major général et son frère Jérôme, pour expédier des ordres. Il dépêcha un officier au maréchal Grouchy pour lui rapporter de vive voix les tristes détails de la bataille du 18, et lui prescrire de se retirer sur Namur. Il confia au prince Jérôme le commandement de l'armée, lui laissa le maréchal Soult pour major général, et leur recommanda à tous deux de rallier nos débris le plus tôt qu'ils pourraient, afin de les conduire à Laon. Il partit lui-même pour les y précéder, et y attirer toutes les ressources qu'il serait possible de réunir après une telle catastrophe. Il se dirigea ensuite vers Philippeville, accompagné d'une vingtaine de cavaliers appartenant aux divers corps de l'armée. Tels avaient été les événements dans cette funeste journée du 18 juin 18, que les Anglais ont appelée bataille de Waterloo, parce que le bulletin fut daté de ce village, que les Prussiens ont appelée bataille de la Belle-Alliance, parce que c'est là qu'ils combattirent, que Napoléon enfin a appelée bataille de Mont-Saint-Jean, parce que c'est sur ce plateau que l'armée française fit des prodiges, et que nous qualifions, nous, de bataille de Waterloo, parce que l'usage, souverain en fait d'appellations, l'a ainsi établi. Les fautes et les mérites dans cette funeste journée sont faciles à apprécier pour quiconque, en se dégageant de toute prévention, veut appliquer à les juger les simples lumières du bon sens. Si on considère en effet cette campagne de quatre jours sous des rapports plus élevés, on y verra, non pas les fautes actuelles du capitaine, qui n'avait jamais été ni plus profond, ni plus actif, ni plus fécond en ressources, mais celles du chef d'État, qui s'était créé à lui-même et à la France une situation forcée, où rien ne se passait naturellement, et où le génie le plus puissant devait échouer devant des impossibilités morales insurmontables. Certes rien n'était plus beau, plus habile que la combinaison qui en quelques jours réunissait sur la frontière 124 mille hommes à l'insu de l'ennemi, qui en quelques heures donnait Charleroy à Napoléon, le plaçait entre les Prussiens .et les Anglais, le mettait en position de les combattre séparément, et les Prussiens, les Anglais vaincus, lui laissait le temps encore d'aller faire face aux Russes, aux Autrichiens, avec les forces qui achèveraient de s'organiser pendant qu'il combattrait ! Mais les hésitations de Ney et de Reille le 15, renouvelées encore le 16, lesquelles rendaient incomplet un succès qui aurait dû être décisif, on peut les faire remonter jusqu'à Napoléon ; car c'est lui qui avait gravé dans leur mémoire les souvenirs qui les ébranlaient si fortement ! C'est lui qui dans la mémoire de Reille avait inscrit Salamanque et Vittoria, dans celle de Ney, Dennewitz, Leipzig, Laon, et enfin Kulm dans celle de Vandamme ! Si le lendemain de la bataille de Ligny on avait perdu la journée du 17, ce qui du reste n'était pas très regrettable, la faute en était encore aux hésitations de Ney pour une moitié du jour, à un orage pour l'autre moitié. Cet orage n'était, certes, le fait de personne, ni de Napoléon, ni de ses lieutenants, mais ce qui était son fait, c'était de s'être placé dans une situation où le moindre accident physique devenait un grave danger, dans une situation où, pour ne pas périr, il fallait que toutes les circonstances fussent favorables, toutes sans exception, ce que la nature n'accorde jamais à aucun capitaine. La perte de la matinée du 18 n'était encore la faute de personne, car il fallait absolument laisser le sol se raffermir sous les pieds des chevaux, sous la roue des canons, et après tout on ne pouvait croire que le temps qu'on donnerait au sol pour se consolider, serait tout simplement donné aux Prussiens pour arriver. Mais si Reille était découragé devant Goumont, si Ney, d'Erlon, après avoir eu la fièvre de l'hésitation le 16, avaient celle de l'emportement le 18, et dépensaient nos forces les plus précieuses avant le moment opportun, nous le répéterons ici, on peut faire remonter à Napoléon qui les avait placés tous dans des positions si étranges, la cause de leur état moral, la cause de cet héroïsme, prodigieux mais aveugle. Enfin, si l'attention de Napoléon attirée à droite avec sa personne et sa réserve, manquait au centre pour y prévenir de graves fautes, le tort en était à l'arrivée des Prussiens, et le tort de l'arrivée des Prussiens était, non pas à la combinaison de détacher sa droite pour les occuper, car il ne pouvait les laisser sans surveillance, sans obstacle opposé à leur retour, mais à Grouchy, à Grouchy seul quoi qu'on en dise ! mais le tort d'avoir Grouchy, ah ! ce tort si grand était à Napoléon, qui, pour récompenser un service politique, avait choisi un homme brave et loyal sans doute, mais incapable de mener une armée en de telles circonstances. Enfin avec vingt, trente mille soldats de plus, Napoléon aurait pourvu à tous ces accidents, mais ces vingt, ces trente mille soldats étaient en Vendée, et cette Vendée faisait partie de la situation extraordinaire dont il était l'unique auteur. C'était en effet une extrême témérité que de se battre avec 120 mille hommes contre 220 mille, formés en partie des premiers soldats de l'Europe, commandés par des généraux exaspérés, résolus à vaincre ou à mourir, et cette témérité si grande était presque de la sagesse dans la situation où Napoléon se trouvait, car ce n'était qu'à cette condition qu'il pouvait gagner cette prodigieuse gageure de vaincre l'Europe exaspérée avec les forces détruites de la France, forces qu'il n'avait eu que deux mois pour refaire. Et pour ne rien omettre enfin, cet état fébrile de l'armée, qui, après avoir été sublime d'héroïsme, tombait dans un abattement inouï, était comme tout le reste l'ouvrage du chef d'État qui, dans un règne de quinze ans, avait abusé de tout, de la France, de son armée, de son génie, de tout ce que Dieu avait mis dans ses prodigues mains ! Chercher dans l'incapacité militaire de Napoléon les causes d'un revers qui sont toutes dans une situation qu'il avait mis quinze ans à créer, c'est substituer non seulement le faux au vrai, mais le petit au grand. Il y eut à Waterloo bien autre chose qu'un capitaine qui avait perdu son activité, sa présence d'esprit, qui avait vieilli en un mot, il y avait un homme extraordinaire, un guerrier incomparable, que tout son génie ne put sauver des conséquences de ses fautes politiques, il y eut un géant qui, voulant lutter contre la force des choses, la violenter, l'outrager, était emporté, vaincu comme le plus faible, le plus incapable des hommes. Le génie impuissant devant la raison méconnue, ou trop tard reconnue, est un spectacle non seulement plus vrai, mais bien autrement moral qu'un capitaine qui a vieilli, et qui commet une faute de métier ! Au lieu d'une leçon digne du genre humain qui la reçoit, de Dieu qui la donne, ce serait un thème bon à discuter devant quelques élèves d'une école militaire.
Plan de la bataille de WaterlooFIN DE L'OUVRAGE |