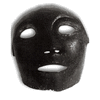L'HOMME AU MASQUE DE FER
MÉMOIRE HISTORIQUE, OÙ L'ON RÉFUTE LES DIFFÉRENTES OPINIONS RELATIVES À CE PERSONNAGE MYSTÉRIEUX, ET OÙ L'ON DÉMONTRE QUE CE PRISONNIER FUT UNE VICTIME DES JÉSUITES
DEUXIÈME PARTIE.
|
Avant que d'employer l'autorité d'une pièce authentique, il faut commencer par s'assurer qu'elle n'est ni fausse ni falsifiée. Traité des différentes sortes de preuves qui servent à établir la vérité de l'histoire, par le père Griffet, p. 214, édition de 1770. J'allai à Versailles le 1er de juillet 1783. Le hasard m'avait déjà appris qu'on avait fait, par ordre de M. de Vergennes, des recherches aux archives des affaires étrangères relativement au patriarche, et qu'on avait reconnu dans les dates des contradictions qui ne pouvaient se concilier avec mon opinion. Cela ne m'effraya pas. Les rapports qui m'avaient frappé dans les deux personnages étaient en si grand nombre, ils m'avaient paru en prouver si bien l'identité, qu'il ne nie restait aucun doute sur ma découverte. Ce qu'on m'avait rapporté ne laissait pas cependant de m'occuper par intervalles, et quoique je me fusse proposé de ne voir que M. de Vergennes, il me vint dans la pensée de faire d'abord une visite à M. Simonin, chef du dépôt des affaires étrangères. Il pouvait être bon que je fusse instruit à l'avance des objections qu'on avait à me faire, et je crus qu'il ne serait pas impossible de tirer de lui quelque éclaircissement. Je n'eus aucun besoin d'adresse pour me procurer ce que je désirais. Il prévint de lui-même mon impatience. Au premier mot qui fut prononcé sur le masque de fer, il s'écria : Vous vous êtes trompé ou tout au tout ; vous vous êtes fourvoyé entièrement ; il est prouvé, il est démontré de la manière la plus évidente, la plus authentique, que l'homme masqué n'est point le patriarche, et ne saurait être lui. — Comment, répartis-je aussitôt, mais pourtant avec la surprise que devait produire en moi le ton d'assurance de M. Simonin, et avec la crainte que ce ton commençait déjà à m'inspirer, comment me prouverez-vous que je me suis trompé ? il serait bien honteux à moi qui, par caractère, crois si difficilement, d'avoir été si facile à croire dans cette occasion, et d'avoir donné aussi légèrement pour une réalité ce qui ne serait qu'un fantôme ? Ne doutez pas de ce que je vous dis, répliqua M. Simonin, vous douteriez en vain. Il me demanda alors dans quelle année le masque de fer avait été transféré à la Bastille ? Je lui répondis, conformément h ce que j'avais établi dans mon mémoire, que c'était en l'année 1698, et qu'il y était mort en 1703 : que ces dates étaient certaines, puisqu'elles étaient tirées de la pièce la plus authentique, du journal de M. Dujonca, lieutenant de roi à la Bastille, et que le temps de sa mort était de nouveau prouvé de la manière la plus incontestable par les registres mortuaires de la paroisse de Saint-Paul, où il avait été enterré. Il ne m'en faut pas davantage, reprit M. Simonin : ces dates sont votre condamnation ; vous venez vous-même de la prononcer ; il est prouvé par une foule de dépêches du temps que le patriarche était à Constantinople à l'époque où le masque de fer se trouvait à la Bastille. Il est prouvé qu'il y était en 1698, en 1699, en 1700 ; qu'il y était enfin en 1705, c'est-à-dire trois ans encore après que le masque de fer eût été enterré. Ce sont des preuves matérielles auxquelles rien ne peut résister, et qui détruisent invinciblement toutes les vôtres. Je l'avoue, continua-t-il, sans la contradiction des dates qui rend la chose impossible, il aurait été difficile de combattre, je ne dirai pas vos preuves, mais vos raisons, et il y avait le plus grand air de vérité dans votre découverte. Les titres qu'on m'opposait étaient incontestables. Je ne songeai même pas à y chercher une réponse. Je me voyais trop justement condamné d'après mon propre aveu. J'étais absorbé dans mes réflexions, et ne pouvais concevoir comment et par quelle étrange illusion j'avais été conduit à une erreur aussi manifeste. La force avec laquelle je l'avais adoptée dans mon âme, me faisait presque trembler dans ce moment pour ma raison. J'étais étonné, confondu. Mais M. Simonin, prenant l'air que nie donnaient ces divers sentiments pour l'air d'un homme qui doutait encore, et qui s'efforçait de résister à l'évidence, il est inutile de douter, reprit- il, il est inutile de disputer : ce que je vous dis est clair comme le jour, et pour prévenir tout vain raisonnement, je vais vous faire voir les dépêches qui furent écrites sur ce sujet par M. de Fériol, et par M. de Torcy, au nom du roi. Alors il fit appeler M. Poisson et lui demanda l'extrait qui avait été fait de cette correspondance pour M. de Vergennes. M. Poisson revint et lui présenta un cahier que M. Simonin se mit aussitôt en devoir de me lire. Je ne dissimulerai pas que dans la confusion de voir ainsi détruire une opinion que j'avais osé donner affirmativement pour démontrée à M. de Vergennes, non moins occupé de mes propres pensées, ou pour mieux dire de ma honte, que des faits dont M. Simonin me faisait la lecture, il dut m'échapper bien des détails qui ajouteraient à l'intérêt de ce récit : ce qu'il y avait de plus essentiel me frappa cependant assez pour être assuré que, dans ce que j'en rapporterai, il n'y aura rien que de vrai, dit moins quant au fond des choses, si les expressions sont différentes. La première lettre de M. de Fériol, de l'ambassadeur du roi, sur cet événement, est, je crois, du mois de juin 1706. On y voit que le patriarche, après avoir été dépouillé de sa dignité, après avoir été renversé du trône patriarcal, se trouvait enfermé, comme le dernier des malheureux, au bagne de Constantinople. C'est la prison où la barbarie ottomane entasse pêle-mêle les esclaves, les scélérats et les forçats. Mais Arwedick, loin d'être abattu par son infortune, conservait encore un air menaçant dans les horreurs de son cachot. Il faisait trembler ses ennemis, et il était à craindre qu'ils ne répandissent tôt ou tard des larmes amères sur leur triomphe. Les Arméniens catholiques sentirent combien il était important pour eux d'éloigner d'abord de Constantinople un ennemi aussi dangereux ; c'est à quoi ils s'attachèrent : ils répandirent l'argent à la manière orientale, et Arwedick fut exilé[1]. Une autre lettre de M. de Fériol annonce à M. de Torcy l'enlèvement du patriarche. Cette lettre est de 1706 comme la première. Les mesures avaient été si bien concertées, que cet infortuné avait été subitement enlevé dans son passage par mer de Constantinople à Chio. On ne fit que le jeter du bâtiment qui le portait dans un autre qui prit aussitôt la route de Marseille. M. de Fériol se félicite du succès de cette entreprise. Il n'était pourtant pas sans quelque crainte sur l'avenir. M. de Torcy[2] dans sa réponse à cette lettre et à quelques autres cherche à le rassurer. Il lui dit que les ordres les plus précis ont été envoyés à M. de Montmort, commandant à Marseille, pour que le patriarche soit débarqué à son arrivée avec le plus grand secret et pour qu'il soit mis d'abord dans un lieu de sûreté. Il ajoute qu'il ne doit lui rester aucune inquiétude sur cela ; que jamais on n'aura de preuves que le patriarche ait paru en France, ou qu'il y ait abordé, et qu'enfin on n'entendra plus parler de lui. Ce que M. de Fériol avait prévu, ce qu'il avait craint ne manqua pas d'arriver. Les partisans d'Arwedick ne tardèrent pas à être informés que le patriarche n'avait point paru à Chio, lieu de sou exil ; et il perça probablement quelque chose sur son enlèvement dans le public. Les Arméniens schismatiques ne manquèrent pas de profiter de cette circonstance pour intriguer auprès de la Porte. Leur argent fut alors prodigué à Constantinople comme celui des catholiques l'avait été auparavant, et il le fut avec le même succès, puisqu'il leur donna à leur tour la prépondérance auprès du gouvernement. La Porte, comme on a vu dans la première partie que je
l'avais conjecturé, prit la chose avec autant de hauteur que de violence. Le
grand vizir manda l'ambassadeur du roi pour réclamer le patriarche de la part
du grand seigneur ; il lui dit : Qu'on savait,
à n'en pas douter, qu'Arwedick avait été envoyé en France : que c'était à lui
à le faire revenir : que sa personne en répondait, et que sa hautesse était déterminée
à déclarer la guerre au roi, plutôt que d'abandonner un de ses sujets aussi
indignement enlevé, et de ne pas avoir une satisfaction éclatante d'un
attentat commis avec tant d'audace dans son empire. Ce ton, quoique la Porte y eût déjà accoutumé les ministres de Louis XIV, les étonna. La France soutenait alors une guerre pénible et malheureuse contre toute l'Europe. Une suite d'échecs humiliants et désastreux l'avait plongée dans le plus triste état, et la perspective de l'avenir ne lui annonçait que de nouvelles infortunes. Le ministère ottoman qui, par orgueil autant que par principe, est toujours porté à abuser de la faiblesse d'autrui et de sa propre force, devenait d'autant plus à craindre pour elle, qu'il pouvait tout oser impunément dans des circonstances aussi malheureuses. Le roi se trouva en effet très-embarrassé. Il y a des circonstances, a dit le père Griffet qui ne prévoyait pas l'application qu'on ferait de cette maxime, il y a des circonstances qui lient, en quelque sorte, les hommes à des situations dont ils connaissent les périls et les inconvénients, sans leur laisser aucun moyen praticable de les éviter[3]. Telle était la situation où Louis XIV se trouvait réduit par la suite de cet atroce attentat des jésuites. Il ne se présentait que deux partis à prendre ; celui d'avouer qu'Arwedick était en France, et celui de le nier. Mais l'un et l'autre avaient de grands inconvénients. On finit par s'arrêter an parti le moins juste, mais le plus sage, du moins par l'événement[4]. Il fut résolu qu'on persisterait à soutenir que la France n'avait eu aucune part à l'enlèvement d'Arwedick et qu'on ignorait absolument sa destinée. On répéta, à peu près, ce que nous avions jugé que le vice-consul de Chio avait répondu dans son interrogatoire ; et on s'étendit sur le regret qu'avait le roi d'être dans l'impuissance de ne donner sur cela aucune satisfaction au grand seigneur. Cette réponse ne satisfit pas la Porte. Elle s'obstina plus que jamais à réclamer Arwedick et à prétendre que c'était à la France de le trouver et de le rendre. Les injures, les menaces, les procédés les plus insolents et les plus odieux, tels que les ministres du grand seigneur se les permettent contre les puissances dont ils croient n'avoir rien à craindre, rendirent cette négociation extrêmement pénible pour M. de Fériol. Ce fut en vain qu'il adressa plus de vingt lettres ou mémoires au grand vizir pour tâcher de l'adoucir, on de le faire revenir sur ce sujet : c'est ce qu'il mande en propres termes à M. de Torcy. Il ne pouvait exprimer d'une manière plus forte la chaleur avec laquelle se suivait cette affaire, puisque les négociations les plus importantes produisent rarement chez cette nation autant d'écritures. La Porte voulait enfin une réponse précise et satisfaisante : elle l'exigeait, et menaçait de se porter aux dernières extrémités, si on la différait davantage. Le roi fit alors une démarche singulière à laquelle on est bien loin de s'attendre, et dont il est pourtant facile de deviner le motif et le but. M. de Torcy écrivit par son ordre à M. de Fériol que sa majesté, dans la seule vue de complaire à sa hautesse, avait fait chercher le patriarche dans toute l'Europe, et qu'à force de soins on était parvenu à découvrir qu'il était enfermé dans la citadelle de Messine. Comme l'Espagne était alors maîtresse de la Sicile, et que les Espagnols étaient toujours censés avoir la guerre avec le grand seigneur, l'intention du roi était de faire entendre que c'étaient eux qui avaient enlevé le patriarche, et qu'il était leur prisonnier. Ce détour peu honorable, auquel Louis XIV se crut forcé, fait voir qu'absolument dépendant des circonstances, ce prince n'était pas encore entièrement décidé à un parti, et que, selon le plus ou le moins de violence que la Porte continuerait à mettre dans ses réclamations, il se réservait le moyen de retenir le patriarche ou de le renvoyer à Constantinople, en se faisant un mérite d'avoir obtenu du roi d'Espagne sa liberté. Il était bien sûr d'avoir de son petit- fils tous les aveux et toutes les déclarations qu'il jugerait à propos de lui demander. Mais ce triste expédient n'eut pas le succès que le roi s'en était promis. Le grand vizir, espérant tout du demi-aveu qu'il venait d'arracher, ne s'en montra que plus ferme à réclamer Arwedick. Il déclara à M. de Fériol, avec toute la hauteur d'un premier ministre de l'empire ottoman, que le grand seigneur ne se départirait jamais de la résolution où il était d'avoir son sujet, et que c'était au roi à trouver les moyens de satisfaire sa hautesse à cet égard. Les instances du grand vizir et celles de M. de Fériol lui-même, qui, dans la crainte du dénouement de cette aventure, n'était pas à se repentir d'avoir cherché aussi mal à propos à s'en faire honneur, devenant de plus en plus embarrassantes, le roi, quoi qu'il pût arriver, se décida à brusquer la négociation. Le marquis de Torcy écrivit, au nom de sa majesté, à M. de Fériol, que Dieu, en appelant à lui le patriarche, venait de mettre un obstacle invincible aux bonnes intentions du roi, que la nouvelle de sa mort était parvenue à sa majesté, au moment même où elle faisait usage de tous les moyens qui étaient en son pouvoir pour lui procurer la liberté ; que, la puissance des hommes ne pouvant rien contre les décrets éternels, il ne leur restait que le mérite de s'y soumettre avec résignation, et d'adorer en tout la Providence. On fit dans cette conjoncture ce que les anciens faisaient dans les malheurs extrêmes et sans ressource ; ils s'enveloppaient la tête et s'abandonnaient à la fortune. Les dépêches, qui me furent communiquées, ne
m'instruisirent point de quelle manière la nouvelle de la mort du patriarche
avait été reçue à Constantinople. Mais il y avait déjà plusieurs mois que le
marquis de Torcy l'avait mandée à M. de Fériol au nom du roi, lorsque la cour
de Rome jugea à propos de se mettre sur la scène ; l'enlèvement d'Arwedick ne
lui était pas inconnu. Rome regardait un ecclésiastique, surtout de la
qualité du patriarche, comme lui appartenant, et, sans égard pour aucune des
considérations qui auraient dû lui défendre une pareille démarche, elle osa
le réclamer. Le cardinal ministre écrivit au nom du pape, pour demander que
le patriarche fût livré au Saint-Siège, comme on lui livra autrefois le
fameux Zizim, frère de Bajazet. On
rejeta, sans aucun ménagement, une demande aussi indiscrète qu'opposée aux
intentions du roi, puisque l'effet infaillible de la moindre condescendance
aurait été de donner la plus grande publicité à cette aventure. La lettre qui
fut adressée à la cour de Rome — je le répète, parce qu'il est très-essentiel
de le remarquer — cette lettre du marquis de Torcy, écrite au nom de sa
majesté, est de 1708 ou de 1709, et postérieure de plusieurs mois à la
dépêche par laquelle le même marquis de Torcy avait annoncé la mort du
patriarche à l'ambassadeur. Elle porte expressément Que
le patriarche est vivant encore, qu'il est dans un lieu de sûreté ; que ce
lieu demeurera à jamais inconnu ; que jamais on n'entendra parler de lui ;
qu'on lui permet d'aller à la messe de temps en temps, avec des précautions
qui empêchent qu'il ne soit vu de personne ; qu'on ne le laisse manquer de
rien, et qu'un homme, un seul homme, chargé de le soigner, attaché à sa seule
personne, est réduit à s'entretenir avec lui par signes, lorsqu'il
s'agit de pourvoir à ses besoins, et de savoir ce qu'il peut désirer. Les réflexions se présentent ici d'elles-mêmes, et elles sont si naturelles, que cc serait faire injure au lecteur que d'entreprendre de les lui inspirer. C'est à lui de prononcer. Ce tableau serait imparfait si, quoiqu'il m'en coûte, je ne faisais mention, d'après les dépêches de la cour, de divers Arméniens qui partagèrent le triste sort de leur patriarche, ou qui peut-être furent encore plus malheureux. Envoyés en France par les amis d'Arwedick, pour l'y chercher, ils disparurent ou périrent dans cette entreprise. tin autre Arménien, personnellement attaché au patriarche, rendu soupçonneux par le long silence de ceux qui avaient été envoyés les premiers, s'embarqua directement pour l'Italie, dans l'espérance de dérober sa marche à ses ennemis, et de se rendre ensuite en France avec plus de sûreté. Mais cette précaution lui fut encore inutile. De faux frères, qui assistaient à toutes les délibérations des Arméniens à Constantinople, eu rendaient compte aux jésuites, et les jésuites en faisaient part aussitôt à l'ambassadeur du roi. Le marquis de Torcy ne tarda pas à être informé de toutes les particularités de cette nouvelle mission, et il prit les mesures nécessaires pour en empêcher le succès. Il écrivit à M. de Fériol qu'on ne perdrait pas de vue l'homme dont il avait envoyé le signalement, et que, dès le moment qu'il mettrait les pieds sur les terres de France, il serait arrêté et enfermé. Il y a apparence qu'il n'échappa pas à son malheur, et qu'il subit le sort de ceux qui l'avaient précédé. Quand M. Simonin eut fini sa lecture, je lui demandai si l'on avait quelque connaissance de ce que le patriarche était devenu, de la prison dans laquelle il avait été enfermé, du lieu où il était mort. Il me répondit que, depuis les ordres qui avaient été envoyés à Marseille, pour le faire débarquer dans le plus grand secret, on l'avait entièrement perdu de vue ; que dès-lors sa marche devenait absolument inconnue, qu'il n'en restait aucune trace, et qu'on ignorait tout à cet égard. Instruit par M. de Bonnac de la marche du patriarche et de sa réclusion à l'île Ste-Marguerite, il m'était aisé de représenter à M. Simonin que le fil de cet événement, qu'on regardait comme perdu, parce qu'il avait échappé à tous les yeux, on le retrouvait tout entier, si, dès le moment que le patriarche aborde en France et disparaît, on ramène ses regards sur un inconnu, dont on n'a jamais pu découvrir ni l'état ni le nom, qu'on sait pourtant être sorti de l'île Ste-Marguerite, sans qu'on sache comment il y était entré, et avait été conduit ensuite à la Bastille..... Mais je jugeai que ce serait en vain que je raisonnerais avec lui. La prévention était trop forte pour me flatter de parvenir à lui faire adopter d'autres idées : je crus même apercevoir qu'il se plaisait à la conserver ; c'est à dire, que par cet esprit d'envie qui agite et tourmente l'âme de tout ce qui habite Versailles, il n'était pas fâché que je ne pusse pas me vanter d'avoir fait cette découverte. Je pris donc le parti de le laisser se reposer tranquillement sur cette façon de penser : et comme la bureaucratie aujourd'hui donne le ton à tout, influe sur tout, j'imaginai que la prévention devait s'être étendue de bureau en bureau et de là à M. de Vergennes : une entrevue avec lui me devenait inutile. Je quittai donc Versailles sans le voir, sans me présenter, quoique ce ministre eût été le seul objet de mon voyage[5]. D'ailleurs, il faut être vrai, il faut être juste. L'erreur de M. Simonin, s'il était réellement dans l'erreur, est très-excusable. Les dates qu'il m'avait objectées, et dont il s'appuyait, rie m'avaient-elles pas d'abord confondu ? n'en avais-je pas été atterré ? n'avais-je pas cru, dans ma première surprise, n'avoir enfanté honteusement qu'une chimère ? était-ce donc à lui de voir plus foin que moi, dans une chose où il n'avait aucun intérêt, et qui, par conséquent, lui était tout au moins indifférente ? les bureaux devaient-ils voir ou chercher à voir plus loin que lui ? les dates, ces dates fulminantes, évidemment destructives de mon opinion, ne lui interdisaient-elles pas tout raisonnement, toute réflexion, et ne paraissaient-elles pas me condamner de la manière la plus irrévocable ? était-il possible qu'un homme, mort en 1703 à la Bastille, vécût en 1706 à Constantinople ? et que cet homme se fût trouvé en même temps en deux lieux si différents, si éloignés, mort dans l'un et vivant dans l'autre ? n'étais-je pas convenu que, non-seulement le masque de fer avait été conduit à la Bastille en 1698, mais qu'il y était mort en 1703, le 19 novembre, et qu'il avait été enterré le lendemain, c'est-à-dire le 20 novembre, au cimetière de S.-Paul, paroisse de la Bastille ? et n'étais-je pas forcé de convenir dans ce moment que le patriarche vivait encore en 17o6 à Constantinople ? J'avais eu beau ne voir qu'une seule personne dans ces deux hommes, la contradiction des dates rendait nécessairement l'identité impossible. Je m'étais donc très-certainement trompé, si, malgré ce dont j'étais convenu, il n'y avait pas un défaut de vérité dans ces dates de 1698 et de 1703. La date de 1706 étant certaine, ne pouvant en aucune manière être révoquée en doute, puisqu'elle est prouvée par une foule de dépêches du temps, qui sont incontestables, il s'ensuit que, si le masque de fer et le patriarche sont réellement la même personne, c'est dans les dates de 1698 et de 1703 qu'il faut chercher la falsification ou la supposition. Voyons donc s'il me sera possible de l'y découvrir. Quoi qu'il arrive, je suis du moins bien assuré que je ne porterai que de la bonne foi, de la franchise et de l'amour de la vérité dans cet examen. Commençons par confesser franchement que, dans la première partie de mon mémoire, j'ai donné pour vraie une date que je suis obligé de reconnaître pour fausse ; c'est celle de l'enlèvement du patriarche. Voici mes raisons et ma justification. Le marquis de Bonnac, qui ne parle qu'une seule fois du patriarche, et qui ne dit absolument sur son sujet que ce que nous en avons rapporté, se contente de nous apprendre, comme on l'a vu, que son enlèvement eut lieu sous l'ambassade de M. de Fériol ; il n'en fixe aucunement la date précise ; il donne pour unique époque cette ambassade. D'un autre côté, je croyais avoir un guide sûr dans le journal de Dujonca. Ce journal avait été donné au public pour une pièce authentique, incontestable ; et comme M. Dujonca fixe la translation du masque de fer à la Bastille en l'année 1698, et que M. de Fériol était de cette même année seulement ambassadeur à Constantinople, j'en tirai d'autant plus hardiment la conséquence que le patriarche devait avoir été enlevé en 1698, que tous les rapports que je voyais entre le patriarche et le masque de fer m'avaient d'avance intimement persuadé que ces deux hommes n'étaient et ne pouvaient être que la même personne. Je ne pouvais placer l'enlèvement ni plutôt ni plus tard. Plutôt, il aurait devancé l'ambassade de M. de Fériol qui n'arriva à Constantinople qu'en 1698. Plus tard, il aurait été en contradiction avec le journal de Dujonca. C'est ainsi que j'avais agi, que j'avais raisonné dans toute la sincérité de mon cœur. Je suis obligé présentement de renverser cette marche. J'avais d'abord pris les époques telles qu'elles nous étaient données par le journal de Dujonca pour règle infaillible, et comme devant me donner les époques du patriarche, qui m'étaient inconnues : mais, comme ces époques étaient fausses, ainsi que je prétends le prouver, elles donnèrent quelques résultats faux par de justes conséquences. Aujourd'hui, les époques du patriarche, que je connais très-certainement, seront ma règle pour connaître celles du masque de fer qu'on m'avait artificieusement cachées ; et en raisonnant conséquemment, ces époques me donneront des résultats vrais parce qu'elles sont elles-mêmes véritables. On verra que les unes et les autres s'identifient parfaitement, et que tout ne s'accorde que mieux avec le souvenir que l'on conserve de cette aventure. Venons à notre objet. Je m'étais contenté dans mon premier mémoire de citer quelques paroles des pièces d'où les dates de 1698 et 1703 avaient été tirées : ces pièces, données pour vraies, pour certaines, me paraissaient porter leur preuve avec elles. Tout change aujourd'hui. Je suis obligé de les transcrire en entier pour eu discuter ensuite la vérité. Journal de M. Dujonca, lieutenant du roi à la Bastille. Du jeudi 18 septembre 1698, à trois heures après-midi, M. de Saint-Mars, gouverneur de la Bastille, est arrivé, pour sa première entrée, venant de son gouvernement des îles Ste-Marguerite et S.-Honorat, ayant amené avec lui dans sa litière un ancien prisonnier, qu'il avait à Pignerol, dont le nom ne se dit pas ; lequel on fait tenir toujours masqué ; et qui fut mis d'abord dans la tour de la Basinière ; en attendant la nuit, et que je conduisis ensuite moi-même, sur les neuf heures du soir, dans la troisième chambre de la tour de la Bertaulière, laquelle chambre j'avais, eu soin de faire meubler de toutes choses avant son arrivée en ayant reçu l'ordre de M. de Saint-Mars : en le conduisant dans la dite chambre, j'étais accompagné du sieur de Rosarges, que M. de Saint-Mars avait amené avec lui, et qui était chargé de servir et de soigner le dit prisonnier, lequel était nourri par le gouverneur. Voilà son arrivée à la Bastille ; voici, suivant le même journal, l'époque de sa mort. Du lundi 19 novembre 1703, le prisonnier inconnu, toujours masqué d'un masque de velours noir, que M. de Saint-Mars a amené avec lui, venant des îles Ste-Marguerite, qu'il gardait depuis longtemps, lequel, s'étant trouvé hier un peu plus mal, en sortant de la messe, est mort ce jourd'hui, sur les dix heures du soir, sans avoir eu une grande maladie, il ne se peut pas moins. M. Giraud, notre aumônier, le confessa hier. Surpris de la mort, il n'a pu recevoir ses sacrements, et notre aumônier l'a exhorté un moment avant que de mourir. Il fut enterré le mardi 20 novembre, à quatre heures après-midi, dans le cimetière de S.-Paul notre paroisse : son enterrement coûta quarante livres. A l'appui de ce journal vient l'extrait des registres de sépulture de l'église royale et paroissiale de S.-Paul à Paris, le voici. L'an 1703, le 19 novembre, Marchialy, âgé de 45 ans ou environ, est décédé dans la Bastille, duquel le corps a été inhumé dans le cimetière de S.-Paul, sa paroisse, le 20 du présent, en présence de M. Rosarges, major, et de M. Reilhe, chirurgien-major de la Bastille, qui ont signé. Ce dernier extrait est très-fidèle : j'en ai fait moi-même la vérification à S.-Paul : mais il est inutile d'en parler dans ce moment. Il faut nous arrêter auparavant aux deux articles du journal de Dujonca. On doit ces deux articles au père Griffet, jésuite. Il les plaça dans sa dissertation sur le masque de fer. M. de Saint-Foix cita après lui : c'est après eux que j'en ai parlé avec la plus grande confiance, avec une entière sécurité : mais, toute la terre en eût-elle parlé de même, ces deux articles n'en acquerraient pas pour cela une plus grande autorité. C'est toujours le père Griffet et le père Griffet seul qu'il faut y considérer, puisque c'est lui qui les a cités pour la première fois, et qu'il n'a été que copié par tous les autres. Ce jésuite n'a rien omis pour attirer la confiance à ces deux pièces. Il a grand soin de nous prévenir que, de tout ce qui a été dit ou écrit sur cet homme au masque, rien ne peut être comparé pour la certitude à l'autorité de ce journal. C'est, ajoute-t-il, une pièce authentique : c'est un homme en place, un témoin oculaire, qui rapporte ce qu'il a vu, dans un journal écrit tout entier de sa main, où il marquait chaque jour ce qui se passait sous ses yeux. Mais il me sera permis de profiter d'un conseil, que le père Griffet lui-même nous donne dans le même ouvrage, où se trouve sa dissertation : Avant que d'employer l'autorité d'une pièce authentique, nous dit-il, il faut commencer par s'assurer qu'elle n'est ni fausse ni falsifiée[6]. Voilà sans doute par où j'aurais dû commencer, sans même en être averti par lui : mais je n'avais alors aucune raison de me défier d'une autorité dont il se rendait le garant : et comment aurais-je soupçonné des pièges aussi artistement tendus, et dans lesquels ont été pris, ainsi que moi, tous ceux, sans exception, qui se sont occupés de la même recherche ? Comment aurait-il été possible de marcher d'un pas toujours sûr dans un labyrinthe ténébreux, dont le seul sentier qui conduisait à la sortie avait été fermé, comblé, effacé avec le plus grand artifice ? Éclairé aujourd'hui, si cela se peut dire, par les ténèbres mêmes dont on avait couvert la vérité, je l'aperçois dans le lointain, et je vais tâcher de parcourir l'espace qui m'en sépare. Plût à Dieu que le père Griffet vécût encore pour être témoin de la destruction de son imposture, et pour voir s'évanouir d'elles-mêmes la foule des difficultés qu'il avait créées avec l'astuce la plus profonde, dans l'intention d'égarer le siècle présent et la postérité ! Je m'inscris en faux, comme on l'a déjà prévu, contre le journal de Dujonca. J'ose assurer d'avance que, si ce journal n'est pas entièrement supposé, il a été du moins altéré par les plus graves falsifications ; les raisons qui déterminent en cela mon opinion sont si fortes, qu'il est, ce me semble, impossible qu'aucun homme sensé refuse de s'y rendre. La persuasion qu'elles ont produite en moi, après y avoir longtemps réfléchi, après avoir tout combiné, m'assure de la même persuasion chez les autres. Mais je sais qu'il ne suffit pas de raisonner, et que, pour détruire des préventions aussi anciennes, aussi enracinées, il est encore nécessaire de prouver. Je prouverai donc ; mais les preuves ne viendront qu'après avoir persuadé par la force et la multitude de mes raisons. Le père Griffet avait été confesseur de la Bastille, et, en cette qualité, il avait fait partie de l'état-major. Officier, par conséquent, de la maison, soumis aux mêmes formalités, aux mêmes lois que les autres officiers, il avait fait serment de ne jamais rien révéler, de ne jamais parler de ce qui pouvait se passer à la Bastille. Ils auront des yeux, et ils ne verront pas ; ils auront des oreilles, et ils n'entendront pas. C'est, peut-être, de toutes les maisons qui soient sur la terre, celle à laquelle peuvent s'appliquer avec le plus de justesse ces paroles de l'Écriture. Qui croira donc, qui pourra croire que le père Griffet, un des plus sages, comme un des plus habiles membres de la société, ait travaillé de bonne foi, après avoir été confesseur de la Bastille, à découvrir à l'univers un mystère de la Bastille, qui, par les précautions extraordinaires qu'on avait prises pour le cacher, paraissait devoir importer si fort ail gouvernement ?... Cela est impossible. Était-ce la coutume des jésuites, était-il dans leur régime, dans leurs constitutions, dans leur politique, d'offenser ainsi les puissances et de les braver, surtout lorsque ces puissances pesaient sur eux par tous les points, et qu'ils avaient, par conséquent,' les plus fortes raisons de les ménager ? Qui pourra croire que le père Griffet, obligé par un serment solennel, de cacher, d'oublier même tout ce qui pouvait avoir le moindre rapport à la Bastille, que le père Griffet, qui n'avait été admis dans ce sanctuaire redoutable que sous ce serment, ait affecté d'en violer publiquement les dépôts sacrés, et de se déshonorer par un parjure aux yeux de tout l'univers ?..... Cela est impossible. Est-ce le temps où la société était persécutée, où ses ennemis n'étaient occupés qu'à lui chercher des crimes, où elle était accusée de la morale la plus relâchée et la plus corrompue : est-ce ce temps que le père Griffet aurait choisi de préférence pour donner maladroitement une preuve éclatante de la vérité de cette accusation et pour faire voir au monde que, si les jésuites avaient aspiré à la confiance des princes, c'était pour abuser du pouvoir de la trahir ?..... Cela est encore impossible. Le père Griffet ne se serait-il pas rendu également coupable, si, ne sachant pas la vérité, il eût cherché sérieusement, par son travail et par une violation manifeste des archives de la Bastille, à mettre les autres sur les voies de la découvrir ?..... Cela est encore impossible. Mais ce mystère, voilé aux hommes avec des précautions
aussi extraordinaires, n'en était pas un, et n'en pouvait être un pour le
père Griffet. Le père Riquelet, jésuite, était confesseur de la Bastille, dans
le temps que le masque de fer y était détenu. Il eut pour successeur un
jésuite, et les confesseurs de la Bastille furent tous des jésuites jusqu'à l'entière
suppression de la société en France. Le père Griffet lui-même remplit cette
place, depuis 1745 jusqu'en l'année 1763. On est fondé à assurer qu'il ne
peut y avoir rien de caché à la Bastille pour celui qui en est le confesseur,
et les jésuites ne manquaient pas sans doute de s'en transmettre les uns aux
autres tous les secrets. Personne n'ignore qu'une des choses le plus
fortement recommandées par les constitutions, était la connaissance qu'ils
devaient donner de toutes les affaires à la société. C'est en exécution de
cet article de l'institut que le général entretenait des relations
périodiques, qui le mettaient au fait de ce qui se passait, non-seulement
dans son ordre, mais encore dans tout l'univers. Il fallait qu'il fût
instruit de tout ce que les jésuites projetaient,
opéraient, craignaient et désiraient, en corps et en particulier ;
de tout ce qu'ils faisaient chez les grands,
de tout ce qu'ils apprenaient, de tout
ce qu'ils savaient, de tout ce qu'ils soupçonnaient ; en un mot de tout ce qui regardait directement ou indirectement la société,
et même de ce qui ne la regardait pas. C'est ainsi que le général fut
instruit de l'aventure du patriarche, et que la connaissance, comme on l'a
vu, en parvint à la cour de Rome. On ne peut pas douter que l'histoire de cet
événement ne se trouvât dans les archives de la société ; et — pour ne pas
confondre le patriarche avec le masque de fer, si on persistait encore à
vouloir en faire deux personnages différents — l'aventure du masque de fer y
fut certainement consignée avec toutes ses circonstances, de même que celle
du premier. Ces archives devaient être ouvertes au père Griffet, un des
principaux membres de l'ordre, comme profès, comme savant, comme historien ;
et ce ne sont pas sans doute les secrets de la Bastille, en particulier, que
les jésuites auraient affecté de soustraire aux regards de celui de leurs
confrères qui en était le confesseur. Donc, on peut assurer que l'histoire de
l'homme au masque de fer lui était parfaitement connue. Par une suite de ce que nous venons d'établir, on est en droit d'avancer que, si le père Griffet n'a pas été vrai dans la totalité de sa dissertation, il ne l'a pas été davantage dans les articles qu'il a cités, comme tirés du journal de Dujonca. Sa mauvaise foi nous oblige de citer ici un mot du célèbre Fra-Paolo, qu'on n'accusera pas de n'avoir pas bien connu le régime des jésuites. Une règle générale et infaillible, nous dit-il, pour toutes les difficultés qu'on rencontre dans ses études, c'est de consulter les jésuites, et de résoudre toutes choses directement au contraire de ce qu'ils auront décidé. La justesse de ce mot se vérifie pleinement dans cette occasion. Si nous portons présentement nos regards, d'une manière plus particulière, sur le journal même, et que nous en examinions les phrases et la contexture, on y apercevra comme des pièces de rapport qui, de la façon dont elles sont contournées, forment des espèces de disparates : la plus légère attention suffit pour s'en convaincre, malgré la simplicité, malgré.la naïveté avec lesquelles ce journal paraît écrit. Mais c'est en cela même qu'éclatent davantage l'adresse et l'intention du fabricateur de l'imposture. Enfin, dès qu'il est comme prouvé que l'intention du père Griffet n'était pas et ne pouvait être de dire la vérité, il est évident qu'il n'a dû dire que le contraire de la vérité. Il a altéré les faits, et il en a supposé. Il a avancé une foule de faussetés, ou comme des choses certaines, ou comme des conjectures ; il s'est surtout attaché à devancer les temps par des changements de dates. En feignant de vouloir nous éclairer sur une chose obscure, il nous a plongés dans de plus profondes obscurités, et nous a détournés artificieusement de la véritable voie : il n'a travaillé qu'à nous égarer. Jetons un coup d'œil sur le journal du jeudi, 18 septembre 1698. A trois heures après midi, M. de Saint-Mars, gouverneur de la Bastille, est arrivé, pour sa première entrée, venant de son gouvernement des îles Sainte-Marguerite, ayant amené avec lui, dans sa litière, un ancien prisonnier qu'il avait à Pignerol, etc. Tout l'article est écrit dans le même goût. On y sent, on y voit une affectation singulièrement marquée à appuyer sur certaines circonstances, dans la vue d'y fixer l'attention, et d'assurer la croyance à cc qu'on rapporte. Tout y fait soupçonner que ce journal, que M. Dujonca est censé ne faire que pour lui-même, n'a été fait que pour les autres. Ce mot ancien, si bien trouvé avec celui de Pignerol, ne nous avait pas trompés dans la première partie 'de notre mémoire, et nous en discernons encore mieux la fausseté présentement. Comment M. de Saint-Mars, malgré le voile sous lequel il cherche à cacher son prisonnier, malgré le masque dont il l'affuble, malgré le mystère qu'il paraît faire au lieutenant de roi lui-même du nom et de l'état de cet inconnu, malgré un plan bien formé de garder, sur ce qui le con- cerne, le plus grand secret, se serait-il si fort pressé d'indiquer à ce lieutenant la marche de. son prisonnier et l'ancienneté de sa prison ? Il aurait donc voulu, en le mettant ainsi sur la voie lui faciliter les moyens de découvrir un secret qu'on avait tant de soin de cacher ? Et dans quel temps M. de Saint-Mars lui aurait-il fait cette confidence ?... Quand aurait-il commis une si étrange indiscrétion ? c'est le propre jour de son arrivée, et de son arrivée pour sa première entrée : c'est dans le moment même qu'il remit son prisonnier entre les mains de M. Dujonca. Et M. de Saint-Mars n'aurait ainsi débuté que pour s'en tenir là strictement ? C'est sa première et sa dernière indiscrétion. Il n'en parle plus à M. Dujonca. Ils meurent l'un et l'autre sans que M. Dujonca paraisse en savoir davantage. On jugera du moins que cette unique confidence était plus qu'inutile. Ce n'est point là tout-à-fait la manière d'un gouverneur de la Bastille. Mais il fallait encore ajouter au journal, si cependant il est vrai qu'il y ait jamais eu un journal de Dujonca, il fallait y ajouter de quoi embrouiller un fait que la société était intéressée à empêcher qu'on ne pût jamais éclaircir ; il fallait l'antidater ; il fallait y mettre une date précise, et surtout une date antérieure à l'événement qu'on voulait cacher ; il fallait parler à tort et à travers de Pignerol, pour renvoyer les curieux à une chose qui n'était pas, à un être de raison. Le masque de fer été enfermé à Pignerol ? Le duc de Nivernois est le premier qui ait fait mention de l'homme au masque de fer, dans les Mémoires secrets pour servir à l'histoire de Perse, c'est-à-dire à l'histoire de France. Si, cependant, comme le disent les Mémoires de Bachaumont, il est réellement l'auteur de cet ouvrage, il n'est pas étonnant que cc seigneur, admis par son rang dans la familiarité de ce que la cour avait de plus grand, fï,t parvenu à pénétrer quelque particularité de cet étrange-événement, dans des temps qui n'en étaient pas fort éloignés. Mais il paraît que des gens ou mal instruits, ou intéressés à le tromper, mêlèrent le mensonge à quelques vérités qui leur échappèrent, puisqu'on fixa son opinion, touchant cet inconnu, sur la personne. du comte de Vermandois, mort en 1683. Le duc de Nivernois fait d'abord conduire le masque de fer à l'île Sainte-Marguerite ; de-là il le fait transférer à la Bastille. Il n'a garde de parler de Pignerol. Il ne pouvait en parler, puisque jamais il n'en avait été question. Ce ne fut que longtemps après, lorsque de nouvelles circonstances parurent l'exiger, que le père Griffet s'avisa de supposer que le masque de fer avait été enfermé à Pignerol, et que, pour mieux accréditer cette supposition, il l'ajusta comme il put dans le journal de Dujonca. M. de Voltaire, qui parle du même fait dans ses anecdotes du siècle de Louis XIV, et qui entre dans de grands détails, fondé sur des rapports que lui avaient faits des gens ou contemporains, ou à peu près contemporains, fut trompé en beaucoup de choses, comme le duc de Nivernois l'avait été ; mais il ne parle, ainsi que lui, que de l'île Sainte-Marguerite et de la Bastille, en mentionnant les prisons où le masque de fer avait été détenu. Il ne prononce pas seulement le nom de Pignerol, parce que ce nom n'avait pas encore été prononcé à cette occasion. M. de Palteau, petit-neveu de M. de Saint-Mars, qui a écrit sur le même événement, ne parle pas plus de Pignerol que le duc de Nivernois et M. de Voltaire. Il s'était néanmoins entretenu souvent du masque de fer avec le sieur de Blainvilliers qui, à ce que rapporte M. de Palteau lui-même, joignait à l'avantage d'avoir eu un grand accès chez M. de Saint-Mars, celui d'avoir vu le masque de fer, dont il était contemporain. Il y a plus, le père de M. de Palteau avait été constamment employé à la suite de M. de Saint-Mars, dont il était le propre neveu. Il avait servi sous lui à l'île Sainte-Marguerite et à la Bastille. Il ne quitta la Bastille qu'après la mort de M. de Saint-Mars, qui lui laissa sa terre de Palteau. Il s'y maria vers l'année 1712, et quoique son fils, dont il est question ici, ait vécu avec lui nombre d'années, jamais il ne fut question entr'eux de la prison de Pignerol, puisqu'en écrivant sur cc sujet, il ne parle lui-même que de Sainte-Marguerite et de la Bastille. Si le prisonnier eût été d'abord enfermé à Pignerol, il est à présumer que le sieur de Blainvilliers ne l'aurait pas ignoré, et qu'il en aurait parlé à M. de Palteau, comme il lui parla de l'île Sainte-Marguerite et de la Bastille. Enfin, sur vingt auteurs qui, suivant Voltaire, s'égarèrent en conjectures sur ce fait avéré, dont il n'est aucun exemple dans l'histoire du monde, aucun n'a fait mention de Pignerol. Reilhe, chirurgien major de la Bastille, qui avait signé sur les registres de sépulture de Saint-Paul, quand Marchialy y fut enterré, et Ru, un des porte-clefs, s'entretenant avec Renneville, en 1705 ou 1706, du prisonnier inconnu, qui était alors sous leurs yeux, ne lui dirent rien de Pignerol, quoiqu'ils lui parlassent de Sainte-Marguerite ; et ils lui eu parlèrent même, comme ayant été sa première prison. Ils ne pouvaient savoir ce qui n'était pas, puisque le père Griffet n'avait pas inventé cette nouvelle supposition. Ce n'est que vers l'année 1770 que ce jésuite la glissa adroitement dans le journal de Dujonca, si toutefois le journal en entier n'est pas lui-même une supposition. On vient de voir avec quelle bonne foi le père Griffet fait parler le journal de Dujonca, à l'occasion de la translation de l'homme masqué à la Bastille : on va voir qu'il y soutient parfaitement le même caractère, en nous y annonçant sa mort. Du lundi, 19 novembre 1703. Le prisonnier inconnu, toujours masqué d'un masque de velours noir, que M. de Saint-Mars avait amené avec lui, venant des îles Sainte-Marguerite, qu'il gardait depuis longtemps. Qui ne remarquera pas la manière singulière dont les mots,
qu'il gardait depuis longtemps, se
trouvent là heureusement enchâssés ? On ne nomme pas, il est vrai, Pignerol ;
on n'en parle plus ; mais ces quatre mots valent bien le nom de Pignerol, et
le père Griffet croit en tirer tout l'avantage qu'il s'en était promis. Ils
remplissent son objet, qui est de nous bien inculquer dans l'esprit que M. de
Saint-Mars avait eu anciennement le
masque de fer à Pignerol, et qu'il le gardait
depuis longtemps. Mais il est aussi très-singulier que M. Dujonca,
qui doit avoir souvent parlé pendant cinq ans, dans son journal, de cet
étrange prisonnier, croie avoir besoin, pour se le rappeler, de se dire de
nouveau à lui-même, qu'il lui est encore inconnu, qu'il est toujours masqué
d'un masque de velours noir, que M. de Saint-Mars l'avait amené avec lui des
iles Sainte-Marguerite, et qu'il le gardait depuis longtemps. Cette manière
de nous présenter ces faits, dans un journal qui n'est que pour soi-même,
serait inconcevable, si' elle ne servait à nous dévoiler l'intérêt et la
grande envie qu'a le père Griffet de nous les persuader. Le prisonnier, continue le journal, se trouva hier un peu plus mal en sortant de la messe, et il est mort ce jourd'hui, sans avoir eu une grande maladie ; il ne se peut pas moins. M. Giraut, notre aumônier, le confessa hier. Surpris de la mort, il n'a pu recevoir ses sacrements, et notre aumônier l'a exhorté un moment avant que de mourir. L'affectation de citer ici deux fois dans deux lignes l'aumônier M. Giraut, doit beaucoup étonner, surtout quand on sait qu'à l'exception de la messe, que les aumôniers étaient chargés de dire, ils étaient absolument étrangers au régime de la Bastille ; mais on est bien plus étonné que ce soit cet aumônier qui confesse un prisonnier de cette importance, avant que de mourir. Où était donc le père Riquelet, jésuite, le confesseur en titre et en exercice de la Bastille ? Serait-ce que l'usage des jésuites, en ce temps-là, aurait été de céder à d'autres leurs fonctions, dans les plus brillantes occasions ? ou le gouverneur de la Bastille aurait-il pris sur lui de les attribuer à cet aumônier, au préjudice d'un jésuite à qui elles appartenaient ? Aurait-il osé faire cette injure à un membre de la société, de cette société alors toute-puissante en France, et qui, offensée dans un de ses membres, n'aurait pas manqué de faire usage de la faveur sans bornes dont elle jouissait auprès du roi, pour se venger ? N'aurait-ce pas été attenter aux droits que cet emploi donnait au père Riquelet, sur les secrets de la Bastille, et par lui, à la société ? M. de Saint-Mars aurait-il osé, dans un temps où tout tremblait au moindre signe de cette société, où toute la France était à ses pieds, lui faire ce passe-droit, et s'exposer aux suites d'une pareille injustice ? En supposant, comme on doit le supposer, que l'homme masqué, quel qu'il fût, n'était pas inconnu au père Riquelet, au confesseur de la Bastille, était-il sage, était-il prudent de multiplier les dépositaires de ce secret, pour multiplier les dangers qu'il ne fût découvert ? Le gouverneur, qui n'eut pas le temps de prendre les ordres de la cour, aurait-il voulu se charger ainsi des événements ? Mais c'est encore là bien évidemment une suite des falsifications du journal de Dujonca, et tout s'explique naturellement par un plan combiné d'impostures. Ou y voit distinctement l'application raisonnée du père Griffet, à ne nommer aucun jésuite dans toute cette affaire, à éloigner toute idée des jésuites, et, afin d'empêcher qu'on ne songe à eux, à donner les fonctions de confesseur à un aumônier, quoiqu'il soit hors de toute vraisemblance que le père Riquelet ait cédé ce rôle à un autre, dans le moment le plus intéressant, c'est-à-dire au dernier acte de la tragédie. Mais, quoi que dise le journal, il est plus que probable que chacun remplit ses fonctions dans cette circonstance, que le père Riquelet fit les siennes selon l'usage, et que le père Griffet, pour être fidèle son système de ne faire paraître aucun jésuite sur la scène, devait éviter avec soin, comme il l'a fait, de parler de lui. Le journal de Dujonca, du 19 novembre, finit par les paroles suivantes : Il fut enterré le mardi, 20 novembre, à quatre heures après midi, dans le cimetière de Saint-Paul, notre paroisse. Son enterrement coûta 40 livres. Dans l'ordre naturel et commun des choses, on raconte ordinairement le 20 ce qui s'est passé le 19 ; mais ici, par une singularité très-remarquable, on raconte le 19 ce qui arriva le 20, c'est-à-dire ce qui n'était pas encore. Ce n'est pas tout, on y voit que le journaliste, que le lieutenant de roi, qui savait ce qu'il ne pouvait savoir, ignorait ce qu'il n'aurait pas dû ignorer, c'est-à-dire ce qui était parfaitement connu de Rosarges, major, et même du chirurgien. Il ignorait que l'homme enterré s'appelait Marchialy, quoique Rosarges et le chirurgien le sussent, puisqu'ils avaient signé sur le registre de sépulture. Le lieutenant de roi l'ignorait, quoiqu'il fût d'autant plus à portée de le savoir, qu'il savait déjà le 19 que l'enterrement fait le 20 avait coûté 4o livres. Tout cela paraît former une brouillerie inexplicable ; mais c'est ainsi qu'on a le malheur de se déceler. On a beau méditer et combiner une fourberie, il nous échappe presque toujours quelque trait qui aide à la faire découvrir. Ce sont les roseaux de la fable qui crient : Midas a des oreilles d'âne. RÉFLEXIONS SUR LES REGISTRES MORTUAIRES DE SAINT-PAUL.Je préviendrai ici une objection qu'on ne manquera pas de me faire. Les registres de Saint-Paul, dira-t-on, ont donc été falsifiés aussi, puisqu'ils sont d'accord avec le journal de Dujonca ?... Non, ces registres sont vrais, sont fidèles ; ils n'ont essuyé ni altération, ni falsification ; tout a été exactement vérifié à Saint-Paul..... Mais que disent en effet ces registres ?.... ils attestent que Marchialy, âgé de quarante-cinq ans ou environ, décédé le 19 novembre à la Bastille, a été enterré le 20 dans le cimetière de Saint-Paul, en présence de Rosarges, major, et de Reilhe, chirurgien major de la Bastille qui ont signé. Les registres n'en disent pas davantage ; ils attestent simplement ce qui a été fait, et il ne fut fait pour Marchialy, mort à la Bastille, que ce qu'on faisait pour tous les autres prisonniers qui mouraient dans ce château. Deux hommes de la Bastille, deux témoins, accompagnaient le corps, le faisaient enterrer, et attestaient l'enterrement par leur signature. Mais rien, dans tout cela, ne nous fait voir que Marchialy soit le masque de fer, malgré la concordance des dates avec le journal de Dujonca. Il n'avait pas été plus question du nom de Marchialy pour le masque de fer, que de Pignerol pour sa prison. Il serait bien étonnant, si Marchialy eût été réellement l'homme masqué, que ce nom, qui n'aurait rien appris au monde, eût échappé au duc de Nivernois, à Voltaire, M. de Palteau, neveu de Saint-Mars, au sieur de Blainvilliers, son parent, à M. Dujonca, lieutenant de roi, à Reilhe, chirurgien major de la Bastille, à Ru, qui en était un des porte-clefs, à une foule d'auteurs, qui, à force de recherches, étaient venus à bout de découvrir bien d'autres singularités, à tous les contemporains, dont plusieurs avaient écrit sur le masque de fer, et qu'enfin on ne l'eût appris que, par le père Griffet, qui nous fait savoir avec bonté que le nom de Marchialy avait été inscrit secrètement, à la vue d'une foule de témoins, dans des registres publics de sépulture. Mais le nommé Marchialy mourut certainement en 1703 ; et, malgré le journal de Dujonca, je suis en état de faire voir que le masque de fer, le vrai masque de fer, le prisonnier inconnu, qui passait pour avoir été conduit par M. de Saint-Mars à la Bastille, vivait encore plusieurs années après 1703. Je le prouverai même dans un moment, de manière que la preuve ne laissera rien à désirer. Mais tout est artifice et n'est qu'artifice dans les détails et dans l'ensemble de cet échafaudage d'impostures. Et qui pourrait en être étonné, après avoir vu que ces moyens bas et honteux avaient été employés sans aucune pudeur par le plus honnête des ministres, par M. de Torcy, dans le temps même qu'il parlait au nom du roi ? Jamais le patriarche ne fut enfermé à Messine, quoi qu'ait écrit le marquis de Torcy, ni le prisonnier inconnu à Pignerol, quoi qu'ait fait dire le père Griffet au journal de Dujonca. Le masque de fer ne fut jamais à Pignerol, ni peu de temps, ni beaucoup de temps, ni nouvellement, ni anciennement. Jamais encore on ne l'appela Marchialy ; et si, longues années après sa mort, on cru qu'il avait effectivement porté ce nom, ce n'a été que depuis 1768, quand le père Griffet lui eut appliqué faussement celui d'un nommé Marchialy, mort réellement à la Bastille, et enterré en 1703 à Saint-Paul. Jamais enfin ce prisonnier, quoi qu'on ait écrit, quoi que j'aie d'abord cru moi-même, fondé sur le journal imposteur de Dujonca, jamais le masque de fer ne fut conduit à la Bastille par M. de Saint-Mars. Avant d'aller plus loin, je dois faire voir quelle fut l'origine de cette opinion, que le prisonnier masqué avait été conduit à la Bastille par M. de Saint-Mars, en 1698, et comment elle avait tellement saisi tous les esprits, que jamais il ne vint dans la pensée de personne qu'on dit avoir le moindre doute, le moindre soupçon sur ce sujet. DE QUELLE MANIÈRE LE MASQUE DE FER FUT CONDUIT ET ENFERMÉ À LA BASTILLE.Le patriarche fut enlevé en pleine mer, vers l'année 1706. Le bâtiment dans lequel il fut jeté étant arrivé près de Marseille, au lieu destiné pour la quarantaine des vaisseaux qui viennent du Levant, ou le débarqua secrètement, et, pour le mettre à couvert des regards des curieux, on l'envoya au château de l'île Sainte-Marguerite. Pendant qu'il y faisait sa quarantaine, conformément à une loi dont le salut de l'état ne permet de dispenser personne, M. de Saint-Mars, alors gouverneur de la Bastille, fut prévenu par le ministre qu'il lui arriverait bientôt un prisonnier, dont la détention exigeait le plus grand secret, et pour lequel l'intention du roi était qu'on eût les plus grands égards. En conséquence, M. Dujonca, lieutenant de roi, eut ordre de M. de Saint-Mars de faire meubler de toutes choses la troisième chambre de la tour de la Bertaudière[7]. La quarantaine finie, on fit prendre au patriarche la route de la Bastille. La prudence, qui, non moins que l'audace, formait le caractère distinctif de la société, peut même faire présumer qu'il fut accompagné, pendant le voyage, par des jésuites. Quoiqu'il soit sans exemple qu'un gouverneur de la Bastille ait été le conducteur d'aucun prisonnier, il y aurait quelque raison de croire que M. de Saint-Mars fut au devant de lui. L'affectation de faire dire au journal de Dujonca que M. de Saint-Mars y arrivait pour sa première entrée, autorise du moins à le soupçonner. On usa, dans l'intérieur de la Bastille, de toutes les précautions dont on put s'aviser, pour que son arrivée y frit absolument inconnue : Il ne sortit de la litière que pour être déposé dans la tour de la Basinière, en attendant la nuit. Vers les neuf heures du soir, c'est-à-dire lorsqu'un profond silence et la plus entière solitude régnaient à la Bastille, lorsque les ténèbres y couvraient les démarches de ceux qui y commandaient, M. Dujonca y fut prendre le prisonnier, et lui-même le conduisit à la tour de la Bertaudière, accompagné du sieur Rosarges, qui seul était chargé de le servir et de le soigner. C'est de cette manière, c'est avec ces précautions qu'on réussit à faire que le patriarche fût pendant quelque temps à la Bastille, sans que personne, à l'exception de ceux qui durent en être nécessairement instruits, pût soupçonner qu'il s'y trouvait un prisonnier inconnu. Lorsque ce secret vint à y percer confusément, sans pourtant qu'il fût possible de savoir le temps précis auquel le prisonnier y avait été conduit, chacun, selon sa manière de voir et de juger, s'abandonna aux conjectures. Comme ces premiers bruits suivirent d'assez près son arrivée, et que les conjectures touchaient, pour ainsi dire, au temps où il avait été enlevé, on craignait d'autant plus qu'on ne vînt à penser au patriarche, que la Porte irritée le réclamait déjà fortement. Les jésuites alarmés redoublèrent alors de précautions, et, pour mieux tromper le public, ils songèrent à donner le change aux habitants mêmes de la Bastille. Ils imaginèrent pour cela le meilleur des expédients, et cet expédient se trouva être en même temps le plus simple. Il consistait à établir à la Bastille la croyance que ce prisonnier, qui paraissait y être tombé du ciel, tant on ignorait qui il était et depuis quel temps il s'y trouvait, y avait été conduit par M. de Saint-Mars lui-même, en 1698, c'est-à-dire à l'époque où il était venu prendre possession de son gouvernement. M. de Saint-Mars, M. Dujonca et M. de Rosarges étant probablement les seuls instruits du temps et des circonstances de son arrivée, il leur fut facile, après avoir tout concerté, de répandre l'opinion qu'ils avaient ordre d'établir. On ne doit pas craindre de se tromper, en soupçonnant qu'ils furent très-bien aidés en cela par les jésuites. Ce plan des officiers de la Bastille leur réussit parfaitement ; car, par une faiblesse commune à tous les hommes, on ne se défie pas des confidences qui flattent, et l'inférieur est surtout flatté de celles que lui fout les dépositaires de l'autorité. C'est ainsi que les subalternes de la Bastille, après avoir été trompés par les principaux officiers de ce château et par les jésuites, trompèrent à leur tour, de bonne foi, le publie, en voulant se faire honneur de savoir qu'un prisonnier inconnu, qu'on avait gardé avec les précautions les plus extraordinaires, avait été d'abord enfermé aux îles Sainte-Marguerite, d'où il avait été conduit par M. de Saint-Mars à la Bastille, en 1698. Il est à croire que les officiers que nous avons nommés étaient les seuls qui connussent parfaitement le personnage confié à leurs soins et à leur vigilance. Les jésuites n'étaient pas gens à révéler, sans une extrême nécessité, un secret aussi important ; et le patriarche, ne parlant qu'une langue qui n'a absolument aucun rapport avec les langues de l'Europe, était privé de tout moyen de le découvrir. Mais les jésuites ne lui étaient que trop connus, et il n'ignorait pas que c'étaient eux qui l'avaient fait enlever. Il était notoire dans le temps, à la Bastille, que le prisonnier inconnu que M. de Saint-Mars passait pour y avoir amené, en venant de Ille Sainte-Marguerite, avait été condamné à une prison perpétuelle, par le crédit des jésuites. Le malheureux patriarche, qui, dans ses plaintes et ses lamentations, devait souvent prononcer leur nom, avait fait connaître sans doute aux gens qui l'entendaient que les jésuites étaient les auteurs de son infortune. Il est encore fort probable qu'ils avaient donné heu eux-mêmes à ce soupçon par l'inspection qu'ils avaient dû conserver sur lui dans sa prison. Telle est la conduite que l'on tint dans les commencements de la détention du patriarche ou du masque de fer à la Bastille. Ceux qui avaient un si grand intérêt à dérober aux hommes la connaissance de cette aventure n'avaient pas besoin, pour l'objet qu'ils se proposaient, d'en dire ou d'en faire croire davantage. On ne parla de la mort du prisonnier à la Bastille ni en 1703, parce qu'il n'y était pas encore, quoi qu'ait dit le journal de Dujonca ; ni même nombre d'années après 1703, parce que, quand une fois il y eut été enfermé, son existence y fut si notoire, que de fausses suppositions sur cela devenaient impossibles. Les inventions sur sa mort sont d'une date beaucoup plus moderne. Ceci exige d'autres éclaircissements qui, quoique séparés par un long intervalle de ceux qu'on vient de lire, y sont néanmoins si intimement liés, que les premiers sans les seconds laisseraient beaucoup de choses à désirer. Tant de longueurs, je le sens, doivent fatiguer le lecteur ; mais je ne saurais lui en faire grâce. Une prévention aussi ancienne demande d'être attaquée par tous les points. Des détails nécessaires forment le fil qui, par des détours innombrables, doit nous conduire' à la sortie du labyrinthe dans lequel le public s'était cru égaré et perdu sans ressources. MOYENS EMPLOYÉS PAR LE PÈRE GRIFFET POUR DONNER LE CHANGE SUR CE PRISONNIER.Dans la chaleur des disputes, dont l'homme masqué fut l'occasion, il s'était élevé le plus violent des orages contre les jésuites. Accusés et poursuivis, non-seulement au pied des tribunaux, mais par les tribunaux mêmes, ils avaient été déjà supprimés en France, et ils étaient menacés, à la suite de cet exemple, de leur destruction entière dans le reste du monde. Dans cet état de détresse, divers d'entr'eux entreprirent la défense de la société. Le père Griffet un de ses membres les plus illustres, employa pour elle sa plume et ses talents. Mais il ne se borna pas à des apologies, à des justifications sur les choses dont elle était accusée ; il porta sa prévoyance jusqu'à un fait qui, quoiqu'ancien, était de nature à lui être reproché par tous les amis de l'humanité et de la justice. Craignant que parmi les auteurs qui, dans ce temps-là, cherchaient à découvrit- ce que c'était que ce célèbre et malheureux inconnu, dont tout le monde parlait et auquel s'intéressait toute l'Europe, le hasard n'en favorisât assez quelqu'un pour lui dévoiler le mystère de cet événement, il feignit de travailler à la même découverte, tandis qu'il ne travailla eu effet qu'à égarer les autres dans leurs recherches. Il avait trop lu, il était trop instruit, pour ne pas savoir qu'on trouvait dans une histoire imprimée, qu'il existait vers l'année 1706, à la Bastille, un prisonnier inconnu, dont le signalement, donné par un témoin oculaire, indiquait l'homme masqué de la manière la plus évidente, et dont on assurait, outre cela, que la captivité était l'ouvrage des jésuites. La force d'un pareil témoignage ne servit qu'à rendre le père Griffet plus attentif à ne pas citer cette histoire, à n'en faire aucune mention, à ne pas combattre l'accusation qu'elle contenait, et surtout à ne pas parler des jésuites. C'était une de ces occasions où les avantages que peut donner l'adresse la plus l'affilée ne valent pas ceux qu'on trouve dans un sage silence[8]. Il sentit que de la discussion d'un fait vrai, pouvait jaillir quelqu'étincelle qui fit soulever le voile dont ou avait cherché à couvrir la vérité. Mais, instruit par les archives de la Bastille, et par celles de la société, des moyens qu'on avait employés autrefois pour éloigner toute preuve, tout soupçon que l'inconnu, que l'homme masqué fût le patriarche, il jugea qu'il parviendrait au même but en employant ces mêmes moyens, et en les étayant par de nouvelles suppositions. On a vu que dès-lors on avait imaginé d'établir à la Bastille l'opinion que ce prisonnier, bardé, servi, soigné par un seul homme, y avait été conduit par M. de Saint-Mars en 1698 ; d'où il résultait nécessairement que ce ne pouvait être le patriarche qui était encore vers 1706 à Constantinople. C'est avec cette circonstance essentielle et sans cesse répétée de la conduite du prisonnier par M. de Saint-Mars en 1698, que les bruits relatifs à sa détention avaient été insinués, répandus, établis. Un changement de date avait suffi dans le temps pour tromper les habitans mêmes de la Bastille, et ce même changement semblait devoir encore suffire pour maintenir l'erreur dans le public. Mais le père Griffet, semblable à un criminel qui voit toujours les yeux de la justice fixés sur lui, et qui ne trouve jamais assez sûres les précautions qu'il prend pour leur échapper, jugea nécessaire d'ajouter encore à cette tromperie. Il usa pour cela d'une ruse, d'une tricherie assez familière aux jésuites, et dont on pourrait citer une foule d'exemples[9]. Il falsifia le journal de Dujonca, si même il ne le fabriqua pas entièrement, et il l'antidata pour en faire cadrer les dates avec les bruits que les jésuites étaient parvenus à accréditer par leurs artifices. Il fait dire à ce prétendu journal, en 1698, que M. de Saint-Mars vient d'amener avec lui, de l'île Ste-Marguerite, un prisonnier masqué et inconnu ; et, afin d'éloigner encore plus de la véritable date, il ajoute ; un ancien prisonnier qu'il avait à Pignerol. Mais cela ne lui suffit pas encore. Il faut, qu'après avoir ainsi fixé l'époque de l'arrivée du prisonnier, il fixe et assure avec la même fidélité, avec la même exactitude, l'époque de sa mort. Son plan fait, il parcourt la liste des prisonniers morts à la Bastille et enterrés à St-Paul. Il y trouve un certain Marchialy mort en 1703. Le nom et la date lui conviennent. Le nom, parce que ce nom de Marchialy était inconnu ; et la date, parce qu'il était impossible qu'un homme, mort en 1703, fût un homme qui vivait vers 1706 à Constantinople. Il se hâte aussitôt de se saisir et du nom et de la date, et il les applique au masque de fer, au prisonnier inconnu. Rien n'était plus facile après cela que de fabriquer un journal qui fût conforme à cet arrangement. Ce journal faisant mourir, le 19 novembre 1703, l'homme masqué, et le faisant enterrer le 20 novembre à St-Paul, il faut nécessairement que cet homme masqué soit Marchialy, puisqu'il est constaté par les registres de la paroisse, que Marchialy est mort à la Bastille le 19 novembre 1703, et qu'il a été enterré le 20 à St-Paul. De cette manière, on voit que des insinuations artificieuses, de fausses confidences, et les bruits vagues qui en avaient résulté avaient d'abord disposé la croyance publique ; que le journal de Dujonca, donné comme une pièce authentique, vient prouver la vérité de ces bruits, et qu'ensuite les registres de St-Paul, dont la fidélité ne peut être contestée, étant conformes à ces bruits et au journal, il est impossible qu'il reste à personne le moindre doute sur ce sujet. Qu'on cherche tant que l'on voudra, on ne trouvera point de fait, quelque constaté, quelqu'authentique qu'il puisse être, qui réunisse plus de caractères appareils de vérité que cette fourberie. On m'arrêtera ici pour me demander ce que devient donc le témoignage de M. de Palteau ? de M. de Palteau, le parent, le neveu, l'héritier de M. de Saint- ?fars ? le possesseur après lui de la terre de Palteau ? de cette même terre, de ce même château M. de Saint-Mars passa en 1698, et où il garda, pendant quelques jours, le masque de fer avec lui ? Peut-on soupçonner sa véracité ? invente-t-on des circonstances, des détails tels que ceux dui sont contenus dans la lettre qu'il écrivit à M. Fréron, le 19 juin 1768 ? ne prit-il pas sur les lieux, dans Palteau même, les renseignemens dont sa lettre est remplie ? ne lui furent-ils pas attestés, confirmés par ses paysans, par ses vassaux qui avaient été les paysans, les vassaux de M. de Saint-Mars, et qui, ayant tout vu de leurs propres yeux, avaient toutes les qualités nécessaires pour rendre légalement un témoignage irrécusable ? suffira-t-il de nier les faits les mieux constatés, les plus authentiques, pour être en droit de croire qu'on les a réfutés ? enfin les détails en général fussent-ils faux, n'est-il pas au moins prouvé par cette lettre, n'est-il pas démontré que M. de Saint-Mars séjourna, en 1698, à Palteau avec le masque de fer ? Il n'est point de moyens, dira-t-on, pour attaquer une pareille preuve ; il n'est point d'objection qui ne disparaisse, qui ne s'anéantisse devant elle. La lettre de M. de Palteau, il faut l'avouer, doit paraître, au premier coup d'œil, très-embarrassante. Comment concevoir en effet qu'un homme dans la position de M. de Palteau, qu'un homme de bon sens, qu'un honnête homme ait pu donner avec tant d'assurance de pures rêveries pour des vérités constantes ? M. de Palteau pouvait-il ignorer si le masque de fer avait passé, ou n'avait pas passé à Palteau en 1698 ? Un prisonnier aussi singulier, gardé avec des précautions aussi extraordinaires, devait avoir fait trop de sensation à Palteau et dans les environs, pour que le souvenir pût en être ainsi effacé[10]. Je pourrais répliquer qu'il suffit d'être homme pour savoir jusqu'à quel point d'autres hommes peuvent être imposteurs ou dupes, et qu'il est en eux des choses qui étonneraient étrangement, si une certaine connaissance de l'esprit humain laissait encore quelque place au sentiment de la surprise. Mais ce ne serait pas répondre. Je vais donc expliquer ces obscurités, ces contradictions. La première fois que je jetai les yeux sur la lettre de M. de Palteau, avant même d'avoir la moindre raison de m'en méfier, je fus vivement frappé des absurdités et des inconséquences qu'elle contenait. Mais, par égard pour un honnête homme qui paraissait n'avoir écouté que sa bonne foi, je laissai totalement de côté ces absurdités, ces inconséquences, pour ne m'attacher qu'à l'article essentiel du séjour du prisonnier à Palteau ; persuadé d'avance, par le journal de Dujonca, que M. de Saint-Mars avait conduit lui-même le prisonnier masqué en 1698, je n'eus aucune peine à croire, d'après la lettre, que le prisonnier avait été mené réellement à Palteau, puisqu'elle attestait que M. de Saint-Mars y avait fait quelque séjour. La lettre me sembla prouver la vérité du journal, et le journal la vérité de la lettre. Attaché donc à ce seul fait que je regardais comme doublement constaté, je me bornai à observer que, si jamais M. de Saint-Mars s'était permis de séjourner à Palteau avec un prisonnier d'état, dont il était important de cacher l'existence, et qu'il lui était ordonné, de la manière la plus expresse, de soustraire à tous les regards, il ne pouvait se l'être permis qu'avec un homme tel que le patriarche, avec un étranger qui, ne parlant qu'une langue inintelligible, ne pouvait guère abuser de sa liberté. Mais ce que, d'après ces raisons, je croyais alors qu'il fût absolument possible qu'on eût fait avec le patriarche, je me crois en droit d'assurer aujourd'hui qu'on ne se le permit pas même avec lui. Tout me fait voir au contraire que le masque de fer ne passa point à Palteau ; tout nie dit qu'on n'envoie point de tels prisonniers d'état faire un tour à la campagne avec leur conducteur ; tout m'assure que M. de Saint-Mars n'était chargé ni de ce prisonnier, ni probablement d'aucun autre, lorsqu'il s'arrêta, et lit quelque séjour à sa terre de Palteau, en allant prendre possession de son gouvernement de la Bastille, en 1698. La lettre de M. de Palteau avait fait sur M. de Saint-Foix, qui n'eut jamais la clef de cet événement, la même impression qu'elle fit depuis sur moi, dans un temps où je n'avais pas plus cette clef que lui. En dédaignant de relever les absurdités dont elle était remplie, il se contenta d'imprimer qu'il y avait quelquefois des choses vraies qui n'étaient pas vraisemblables. Mais j'ai lieu de penser qu'il ne fut pas aussi modéré, en écrivant à M. de Palteau lui-même, qu'il l'avait été dans un écrit destiné à être public. M. de Palteau, que je vis chez lui, en 1783, paraissait conserver encore un souvenir douloureux de sa lettre, et, sans qu'il me dît précisément ce qu'elle contenait, il me fut aisé de reconnaître que M. de Saint-Foix ne l'y avait pas beaucoup ménagé. Il est essentiel de connaître la lettre de M. de Palteau ; je la transcrirai donc ici, ou j'en donnerai la substance. Les prétendues notions qu'elle renferme sont tirées de deux sources différentes : 1° Des paysans qui allèrent au-devant de leur seigneur, c'est-à-dire au-devant de M. de Saint-Mars, lorsqu'il conduisit à Palteau le masque de fer ; 2° Du sieur de Blainvilliers, officier d'infanterie, qui avait accès chez M. de Saint-Mars. Je distinguerai et séparerai les deux rapports. On n'en sera que plus en état de peser les circonstances particulières qui s'y font remarquer et d'en bien juger. Ce que M. de Palteau nous y apprend, on ce qu'il croit nous y apprendre, est absolument tout ce qu'il savait de cette aventure. Il le déclare formellement dans sa lettre, et il le confirma de bouche à l'auteur de cette dissertation. Lorsque je fus le voir à Palteau, dans l'espérance d'en tirer quelqu'autre éclaircissement, je reconnus sans peine qu'il ne savait véritablement rien. Semblable à un témoin qui, ayant des reproches à se faire sur une première déposition, se montre très-inquiet au moment d'en faire une seconde, par la crainte de s'écarter de la ligne sur laquelle il avait marché la première fois, il ne répondait qu'en chancelant, qu'en bégayant à mes demandes. Les railleries de M. de Saint-Foix lui avaient fait sentir combien il est délicat de se compromettre avec le public. RAPPORT DES PAYSANS À M. DE PALTEAU.M. de Saint-Mars séjourna avec le masque de fer à Palteau en 1698. Le prisonnier arriva dans une litière. Les paysans allèrent au-devant de leur seigneur. M. de Saint-Mars mangea avec son prisonnier qui avait le dos opposé aux croisées de la salle à manger, qui donnent sur la cour. Les paysans que j'ai interrogés n'ont pu voir s'il mangeait avec son masque ; mais ils observèrent très-bien que M. de Saint-Mars, qui était à table vis-à-vis de lui, avait deux pistolets à côté de son assiette. Ils n'avaient pour les servir qu'un seul valet-de- chambre, qui allait chercher les plats qu'on lui apportait dans l'antichambre. Lorsque le prisonnier traversait la cour, il avait toujours son masque noir sur le visage. Les paysans remarquèrent qu'on lui voyait les dents et les lèvres, qu'il était grand, et avait les cheveux blancs. M. de Saint-Mars coucha dans un lit qu'on lui avait dressé auprès de celui de l'homme au masque. Tel est le rapport des paysans à M. de Palteau. Il est évident qu'un pareil témoignage n'a pu que confirmer dans leur opinion ceux qui étaient déjà persuadés que le masque de fer avait été conduit par M. de Saint-Mars en 1698. Ils n'ont rien examiné ; ils ont cru aveuglément, sans songer qu'il faut toujours se défier de ce qui répugne si manifestement au bon sens et à la raison. La circonstance absurde des paysans qui courent au-devant du masque de fer, ou, ce qui est la même chose, au-devant de leur seigneur qui menait le masque de fer, aurait dû suffire seule pour ôter toute créance à la lettre de M. de Palteau, quand même chacune de toutes les autres circonstances qu'elle renferme n'aurait pas en soi ses absurdités particulières. Un fait certain contre lequel personne n'a élevé le moindre doute, et qui est également prouvé par les faussetés et par les vérités qui sont parvenues confusément jusqu'à nous, c'est qu'on employa les plus grands soins, les précautions les plus extraordinaires pour cacher au public l'existence de cet inconnu, et que tous ceux à qui la garde eu fut confiée eurent les ordres les plus précis de faire en sorte qu'il ne fût vu de personne. Comment peut-on croire, après cela, que la cour ait permis à M. de Saint-Mars d'aller faire quelque séjour à Palteau, en ), menant le prisonnier avec lui ? Ou, s'il était possible, contre toutes les lumières de la raison, qu'il eût demandé et obtenu cette permission, comment croire qu'il n'eût pas pris les mesures les plus sûres pour y arriver de nuit ou dans le plus grand secret, au lieu de s'y faire recevoir en pompe et avec éclat par tous les habitants, et qu'il n'eût pas fait de son château une prison plus impénétrable encore que la Bastille ? Et qu'on n'aille pas dire que les mesures qu'avait prises M. de Saint-Mars furent probablement dérangées par quelqu'événement imprévu. Cette raison, la seule qu'on pourrait hasarder, tombe d'elle-même, lorsqu'on voit ce même M. de Saint-Mars, le sévère, le défiant, l'ombrageux de Saint-Mars, par une continuité soutenue d'indiscrétion et d'imprudence, permettre à cette foule de paysans de se tenir extérieurement contre les croisées de la salle où il mangeait tête à tête avec son prisonnier, pour qu'ils pussent le considérer de toute leur attention dans ses mouvements, dans tous ses gestes, et entendre ce qu'il aurait pu dire, si, comme on attrait toujours dû le craindre, le masque de fer, qu'on dépeint fort et vigoureux, se fût abandonné à quelque violence, ou eût cherché à se faire connaître dans quelque accès de désespoir ? Il est vrai que les deux pistolets, tristement dirigés sur lui, et que M. de Saint-Mars n'avait sans doute à côté de son assiette que pour le tuer dans le besoin, étaient les garants de sa sagesse et de son silence. Mais enfin, n'était-il pas possible que le prisonnier se jetât sur ces pistolets, qu'il les saisît, et qu'il s'en servit contre M. de Saint-Mars même, vieillard faible, cacochyme et âgé de plus de soixante -douze ans ? D'ailleurs, pourquoi mettre sans cesse la mort sous les yeux de cet infortuné ? Où était la nécessité de placer en faction ces vilains pistolets, pendant le repas, si cette faction cessait sans inconvénient, lorsque M. de Saint-Mars et le prisonnier étaient seuls couchés, chacun dans leur lit, à côté fun de l'autre ? Mais tant de puérilités aussi mal conçues que mal présentées, sont trop dégoûtantes ; et si, parmi les gens du monde, même les plus sensés, il n'en était pas beaucoup qui croient tout, plutôt que de se donner la peine de réfléchir et de rien examiner, on rougirait de s'y être arrêté. Mais comment M. de Palteau s'est-il laissé aller jusqu'à nous faire sérieusement des contes d'enfant aussi méprisables ? Je vais le dire. M. de Palteau était un bon et honnête homme ; mais il avait sa portion de petite vanité, et c'est cette petite vanité qui fit tout dans cette occasion. Lorsqu'il eut succédé à son père qui avait hérité de M. de Saint-Mars la terre de Palteau, il s'occupa principalement des papiers de la succession. Les différents brevets de M. de Saint-Mars, ses provisions, ses patentes, tous ses titres d'honneur attirèrent surtout son attention. Des baux et d'autres actes que M. de Saint-Mars avait passés, en se rendant de l'île Sainte-Marguerite à son gouvernement de la Bastille, lui attestèrent qu'il avait fait quelque séjour à Palteau, en 1698. Ayant vu depuis, dans les divers écrits qui parurent sur le masque de fer de 1753 à 1768, que ce prisonnier avait été conduit par M. de Saint-Mars lui-même, il en conclut qu'il avait séjourné à Palteau avec son conducteur, puisqu'il était établi dans ces écrits que le conducteur ne s'était jamais séparé de son prisonnier. Mais il n'avait sur cet événement aucune notion particulière. Jamais il n'en avait entendu parler à Palteau. Ou ne savait rien, on ne se souvenait de rien ni à Palteau ni dans tous les environs. Son père même, qui avait toujours accompagné M. de Saint-Mars, avait gardé un profond silence à cet égard. M. de Palteau recourut donc à ses papiers ; il n'y trouva pas plus d'éclaircissements. Alors il appela, il interrogea les plus vieux paysans de Palteau. Persuadé que le masque de fer y avait séjourné avec M. de Saint-Mars, il voulut absolument que, malgré la contradiction des temps, ils en sussent quelque chose. Ces pauvres gens l'assurèrent d'abord qu'ils ne savaient ce qu'il voulait dire ; mais, obstiné à vouloir qu'ils fussent instruits, il joua le rôle de ce personnage de comédie, qui, voulant que son valet sache une chose qu'il ignore, commence par la lui apprendre, et à chaque circonstance dont il l'instruit, et que le valet répète, il dit à celui-ci : Tu vois bien que tu le savais. Le valet, qui ne s'en doutait pas, en convient, et se rit intérieurement de la faiblesse de son maître. Comme il en est parmi les paysans qui ont aussi leur part de la malice humaine, quelques-uns d'entre eux se firent un amusement d'ajouter aux questions de M. de Palteau et de se jouer malignement de leur seigneur. Voilà l'origine des cheveux blancs et des pistolets. L'est ainsi que M. de Palteau parvint à se faire dire par les paysans une partie de ce qu'il désirait en apprendre, et, qu'après les avoir induits à convenir qu'ils le savaient, il s'étaya de leur prétendu témoignage dans sa lettre. L'histoire absurde et ridicule qu'il rapporte, comme venant d'eux, il la fabriqua lui-même sans s'en apercevoir, et la leur suggéra ; il métamorphosa en faits certains ses propres questions. On potinait même dire qu'on entrevoit, à la manière hachée dont il présente les faits, que ce ne sont que des aveux arrachés. J'ai dit qu'une petite vanité avait tout fait, lorsque M. de Palteau écrivit sa lettre. Il fut flatté de joindre son nom aux noms de Voltaire, de Saint-Foix et des autres écrivains qui s'étaient occupés du masque de fer. Il fut flatté de paraître avoir été à portée d'en savoir plus qu'eux sur un événement qu'on croyait de la plus grande importance. Il le fut d'apprendre au public qu'il était le neveu de M. de Saint-Mars, d'un gouverneur de la Bastille, d'un maréchal de camp, et qu'il possédait la terre de Palteau qui devait devenir célèbre par le séjour que de Saint-Mars serait censé y avoir fait avec le fameux prisonnier. Il crut enfin qu'il pourrait rejaillir de tout cela quelque honneur sur sa maison. RAPPORT DU SIEUR DE BLAINVILLIERS.Contre ce que je m'étais d'abord proposé, je m'étendrai peu sur le rapport du sieur de Blainvilliers. Il suffit de lui appliquer ce que je viens de dire sur le rapport des paysans, parce qu'il peut être considéré sous le même point de vue. Je serais néanmoins assez porté à croire que tout n'est pas absolument faux dans son récit. Blainvilliers avait été employé à l'ile Sainte-Marguerite ; il pouvait y avoir vu le masque de fer, quand même il ne l'y aurait pas vu de la manière dont il le raconte. La couleur brune qu'il donne à ses habits était celle des habits du patriarche. L'observation de la jambe trop fournie par le bas est une chose qu'un menteur même ne s'avise guère d'inventer, ou de dire, s'il n'en est averti par la vérité. Cette forme est aussi celle des Arméniens et de tous les peuples du Levant. A l'exception de ces deux particularités, presque tout ce que prétend nous apprendre Blainvilliers, il l'a pris dans M. de Voltaire, jusqu'à l'erreur de la date de 1704, qui est toujours une erreur, puisqu'il voulait parler de la mort de Marchialy en 1703. On ne sait du reste qui l'on doit considérer le plus dans ces faux détails, ou M. de Blainvilliers, ou M. de Palteau, quoique celui-ci les donne tous comme les tenant du premier. Il est d'autant plus naturel de les attribuer à M. de Palteau, qu'en homme piqué, il lance un trait contre M. de Saint-Foix ; car c'est lui qu'il attaque en disant que Blainvilliers n'avait point entendu dire que le masque de fer eût aucun accent étranger. Cet accent étranger était une des raisons sur lesquelles Saint-Foix s'était fondé pour soutenir que le masque de fer était le duc de Monmouth. Ce que Blainvilliers dit de l'enterrement secret et des drogues qu'on mit dans le cercueil pour consumer le corps, n'est qu'une fable puérile à ajouter à tontes les autres. Il n'y eut rien de secret, rien d'extraordinaire dans la manière d'enterrer Marchialy. Il le fut avec si peu de mystère que les pareils de tout homme qui aurait été enterré après lin dans la même paroisse, auraient vu, en signant sur les registres de sépulture, que Marchialy, mort le 19 novembre à la Bastille, venait aussi d'être enterré. Peut-être se trouvera-t-il encore des lecteurs qui, livrés à leurs premières impressions, toujours possédés de leurs anciens préjugés, reviendront malgré eux au journal de Dujonca et aux registres mortuaires de Saint-Paul, qui se représenteront à leur esprit comme des difficultés insurmontables ; mais je ne me lasserai pas de leur répéter : Laissez de côté ces faux titres ; oubliez-les, ou, les envisageant dans leur véritable sens, servez-vous-en comme d'un flambeau, non pour courir après de vains fantômes, mais pour découvrir la vérité qu'on s'est efforcé de vous cacher. Sentez enfin, reconnaissez que le journal de Dujonca n'est qu'une insigne fausseté ; et l'article de Marchialy, tout vrai, tout incontestable qu'il est dans les registres de Saint-Paul, ne devient lui-même, par l'abus qu'en a fait artificieusement le père Griffet, qu'une double supercherie. Son intention une fois connue ou seulement soupçonnée, chaque ligne, chaque mot de son discours le décèle. On y voit avec la plus grande évidence que le jésuite n'a eu d'autre but que de tromper le public : mais, en travaillant à lui dérober la connaissance d'un forfait de sa société, il n'aura réussi, sans la sauver de cette honte, qu'à élever à sa propre mémoire un monument d'infamie. Ses amis tenteront peut-être de le justifier, en disant que son ouvrage n'est qu'un jeu d'esprit ; mais tout honnête homme jugera sans doute qu'un jeu est de beaucoup trop fort, lorsque du ton le plus sérieux on joint sans aucune pudeur l'imposture à la plaisanterie. Tout ce que nous venons de dire sera prouvé ; mais il est temps de considérer un peu à fond son examen. DE LA DISSERTATION DU PÈRE GRIFFET SUR LE MASQUE DE FER, OU SON EXAMEN DE CETTE ANECDOTE MIS DANS SON VÉRITABLE JOUR.Ce ne fut pas sans dessein que le père Griffet inséra sa dissertation dans son traité des différentes preuves qui servent à établir la vérité de l'histoire : il se flatta que ce titre aiderait à l'illusion, et que jamais personne ne soupçonnerait qu'il eût mis une pièce aussi mensongère dans un ouvrage qu'il donnait comme uniquement consacré à la vérité. Aussi le succès répondit-il parfaitement à ses vues. On s'attacha, comme il le désirait, aux actes authentiques qui servent de base à son examen ; et tous ceux qui, après lui, travaillèrent à la découverte de ce mystérieux événement, prirent constamment ces prétendus actes pour base de leurs recherches. Mais jamais écrit, on ose le dire, ne fut composé avec plus de mauvaise foi d'astuce et d'artifice. Les gens d'esprit comme les sots, les savants comme les ignorants, Voltaire enfin, Saint-Foix et une multitude d'autres écrivains donnèrent aveuglément dans les pièges qu'il leur avait tendus, et ils y furent tous pris de la manière la plus étrange, sans qu'aucun deux se doutât le moins du monde de la supercherie. Si dès-lors les mots persiflage et mystification n'eussent pas été introduits assez ridiculement dans la langue française, jamais ils n'auraient pu être plus justement inventés que dans cette occasion. La morale relâchée des jésuites est connue : on sait
qu'aucune considération ne les arrêtait, lorsqu'ils trouvaient l'occasion de
faire du mal à leurs ennemis, ou de défendre la société[11]. Un trait des
jésuites de Douai, rapporté par Bayle dans une de ses lettres, est bien
propre à confirmer l'opinion qui se trouve généralement établie à cet égard. Ces imposteurs, dit Bayle, ont
écrit, sous le nom de l'évêque d'Arras, pendant plusieurs mois, à des
jansénistes de Douai, et entre autres à un professeur de philosophie, pour
l'engager, sous de belles promesses, à se défaire de son établissement, et à
s'en aller en Languedoc prendre possession d'un meilleur ; et il y est allé,
le simple qu'il a été, et n'a trouvé personne à l'adresse qu'on lui a donnée.
Vous admirerez le fourbe, ajoute Bayle, et
vous représenterez bien des éclats de rire en ceux qui l'ont fait si bien
réussir. Nous dirons, en nous servant des propres expressions de Bayle, qu'il ne s'est trouvé personne aux adresses que le père Griffet a données à ses lecteurs, dans sa dissertation ; et si les jésuites de Douai se réjouissent si fort d'avoir dupé un janséniste, qu'on se figure les éclats de rire auxquels le père Griffet s'abandonna, dans la joie d'avoir si bien réussi à duper toute l'Europe. Mais venons à notre objet. Nous nous sommes d'abord trouvés un peu embarrassés sur la manière de combattre l'examen. En effet, comment attaquer sérieusement un ouvrage qui n'a pas été fait sérieusement ? Ce serait se battre contre le vent. Évitons le ridicule où tomba M. de Saint-Foix, en ne répondant qu'au sens dans lequel il avait pris l'examen, et nullement au sens dans lequel avait été composé cet ouvrage. Faire voir que tous les raisonnements du père Griffet ne sont que des faussetés dérisoires et des plaisanteries, nous a semblé devoir être la meilleure réfutation. Il commence son examen par transcrire l'histoire du masque
de fer, telle qu'elle nous a été donnée, dit-il, dans
un livre très-connu, et très-bien écrit — dans le Siècle de Louis
XIV —. On ne parla beaucoup, selon lui, de ce
prisonnier, que depuis que Voltaire eut fait part au public de cette aventure
? Il passe ensuite aux deux articles du journal de Dujonca, dont le premier nous apprend l'arrivée du prisonnier inconnu à la Bastille, et le deuxième nous rend compte de sa mort. A ces deux articles, il en joint un troisième qui est l'extrait des registres mortuaires de l'église de Saint-Paul, où le nommé Marchialy, mort à la Bastille, avait été enterré, et dont la date s'accorde avec celle de la mort du prisonnier inconnu à la Bastille, selon le journal de Dujonca ; d'où l'on a conclu que Marchialy était le masque de fer. Telles sont les bases sur lesquelles porte la dissertation. Après avoir tracé un cercle autour de ces trois articles, le père Griffet y renferme ses lecteurs eu leur adressant les paroles suivantes : La vérité, leur dit-il, est dans ce cercle ; elle n'est que là, et ne peut être que là : hors de ce cercle vous ne trouverez qu'erreurs et faussetés : prenez donc bien garde de ne pas en franchir la circonférence. Vous perdriez le fil que je veux bien vous donner, pour vous conduire en sûreté dans le labyrinthe, et après vous être en vain débattus dans vos recherches, vous en seriez pour la honte de vous être ridiculement égarés. Voilà ce que le père Griffet nous dit en d'autres termes, et ce qu'il a réussi à persuader à tout le monde ; tandis qu'on devait être persuadé au contraire que ce n'était qu'en sortant de ce cercle qu'on pouvait arriver à la vérité. Pour attirer une confiance entière au journal de Dujonca, pour en faire, en quelque sorte, un article de foi, le jésuite ajoute : De tout ce qui a été dit ou écrit
sur cet homme au masque, rien ne peut être comparé, pour la certitude,
à l'autorité de ce journal : c'est une pièce authentique, c'est un homme en
place, un témoin oculaire, qui rapporte ce qu'il a vu, dans un journal écrit tout
entier de sa main, où il marquait chaque jour ce qui se passait sous ses yeux. Mais le père Griffet ne nous a-t-il pas averti lui-même d'être en garde contre cette pièce authentique, lorsqu'il nous a dit dans tin autre chapitre de l'excellent ouvrage qui contient son examen : Qu'avant d'employer l'autorité d'une pièce authentique, il fallait commencer par s'assurer qu'elle n'était ni fausse, ni falsifiée. C'est donc par là qu'il aurait été sage de commencer. Le père Griffet a cité le premier le journal de Dujonca comme véritablement authentique, et nous n'avons d'autre titre, d'autre preuve pour y croire que sa parole... Quoi qu'il en soit, nous croyons ne rien hasarder en assurant d'avarice, ou que le journal ne paraîtra jamais, ou que, si par événement il vient à être connu, on y verra des preuves convaincantes de sa fausseté ou de sa falsification. Le père Griffet s'est bien gardé de toucher au récit de M. de Voltaire ; il s'est borné à le mettre sous les yeux de ses lecteurs, sans y joindre aucune réflexion. Cependant il n'aimait pas cet écrivain : il s'était toujours fait un plaisir de relever ses méprises. On devrait donc être étonné des Ménagements qu'il montre pour lui dans cette circonstance. Avec la plus belle occasion d'attaquer avantageusement, sur une multitude de faits, un adversaire auquel il n'avait jamais rien pardonné, il se hâte de lui abandonner le champ de bataille. Il lui fait même grâce sur une contradiction non moins frappante que ridicule. Voltaire, à la manière des romanciers, pour rendre le masque de fer plus intéressant, lui avait donné la figure la plus belle et la plus noble ; et cela au moment même où il venait d'avancer que personne n'avait jamais vu son visage, pas même un vieux médecin qui l'avait souvent traité dans ses maladies. Le père Griffet porte la complaisance jusqu'à se défendre de rire de cette contradiction ; mais sa générosité envers M. de Voltaire n'était qu'une perfidie à l'égard du public. L'opinion de Voltaire est connue[12], quoiqu'il ne l'ait pas manifestée ouvertement. Il n'a fait que l'insinuer à ses lecteurs, sans la leur dire. En fixant la translation du prisonnier inconnu il la Bastille, à l'année 1661, quelques mois après la mort du cardinal Mazarin, il en avait fait une espèce d'infamie qu'il concentrait dans la famille royale. Rien n'était plus facile que d'anéantir cette absurde opinion ; mais il était de l'intérêt du père Griffet de la laisser tout entière aux lecteurs de M. de Voltaire. Aussi s'est-il bien gardé de la combattre, et même de s'y arrêter. Son plan le lui défendait ; il connaissait toute la force qu'ont sur les hommes les premières impressions ; il savait que le vulgaire et même les gens qui se croient fort au-dessus du vulgaire, entraînés par le nom de ce célèbre écrivain, tourneraient toujours les yeux sur son récit, qu'ils s'y attacheraient, qu'ils se confirmeraient de plus en plus dans les préjugés qu'ils y avaient puisés, et il n'avait garde de se rien permettre qui pût les affaiblir. Plus les hommes tiendraient à ces préjugés, moins ils seraient capables, je ne dirai pas de découvrir la vérité, mais d'en approcher. Pour être en état de saisir le père Griffet dans tous ses détours, il est nécessaire de se faire une idée exacte de la méthode qu'il suit dans son examen. Elle consiste : 1° à fuir et à écarter tout ce qu'il sait être vrai, ou en le niant, ou en se prescrivant sur cela mi silence absolu. 2° A appuyer et à raisonner longuement sur ce qu'il sait n'être pas, sur ce qu'il sait être faux, et à persuader aux autres que cela est vrai, en s'en montrant lui-même persuadé. Nous ajouterons même, sans craindre de rien hasarder, que, toutes les fois qu'il avance simplement un fait, il en impose ; et que, s'il l'affirme, s'il v joint le mot certainement, c'est pour en imposer encore davantage. Son ouvrage enfin n'est qu'un composé de faussetés, de réticences et de plaisanteries. S'il ne parle jamais de Ce qui est vrai, il ne saurait tenir sur ce qui est faux. Telle est sa marche constante. Pignerol nous en fournit un exemple qui nous tiendra lieu de tous les autres. Le père Griffet savait très bien que le prisonnier inconnu n'avait jamais été enfermé à Pignerol ; mais, pour le succès de son plan, il devait mettre toute son application à bien persuader que Pignerol avait été sa première prison. Il ne pouvait cacher qu'il avait été renfermé à Sainte-Marguerite et à la Bastille : la chose était trop connue ; aussi se décida-t-il à en convenir : mais il eut la précaution d'accoler artificieusement Pignerol aux prisons de Sainte-Marguerite et de la Bastille ; car, disant la vérité sur Sainte-Marguerite et la Bastille, on devait en conclure qu'il la disait également sur Pignerol ; rien n'est plus naturel que cette conséquence. Il débute donc par assurer que le prisonnier inconnu avait
été d'abord enfermé à Pignerol, de là transféré à Sainte-Marguerite, et
ensuite à la Bastille. Il appelle, à l'appui de cette assertion, le premier
article du journal de Dujonca, auquel il fait dire que
le 18 septembre 1698, M. de Saint-Mars est arrivé, pour sa première entrée,
venant de son gouvernement des îles Sainte-Marguerite, ayant mené avec lui un
ancien prisonnier qu'il avait à Pignerol. Cette assertion une fois
jetée en avant, il ne se lasse pas d'y revenir et de remettre sans cesse
Pignerol sur la scène : il veut que ses lecteurs aient toujours Pignerol sous
les yeux, et qu'ils ne puissent raisonner que sur ce premier fondement. Ici,
il redit que le masque de fer fut d'abord envoyé à Pignerol sous la garde de
Saint-Mars qui en avait le commandement ; là, il établit que ce qui manque
pour décider entre les différentes opinions, c'est de savoir au juste en
quelle année le prisonnier fut conduit à Pignerol qui fut certainement sa première prison. Partout il
place Pignerol devant lui, et, à la faveur de cette supposition établie comme
une vérité incontestable, il croit pouvoir, sans aucun risque, hasarder toute
sorte de plaisanteries. Ailleurs, il nous dit que si l'on était sûr que ce prisonnier avait été conduit à Pignerol en 1669, on
serait fondé à croire que c'était le duc de Beaufort ; que, si l'on était sûr
qu'il n'avait été mis à Pignerol qu'en 1683, on pourrait croire que c'était
le comte de Vermandois ; que, si l'on était sûr qu'il ne fut conduit à Pignerol
qu'en 1685, on aurait raison de dire que c'était le duc de Monmouth. Le
bon jésuite désirerait seulement, afin d'asseoir avec confiance une décision
à cet 'égard une de ces dates que l'on appelle fulminantes, parce qu'il en
résulte une preuve qui ne souffre point de réplique. C'est
faute de pouvoir vérifier une seule date, ajoute-t-il malignement, que nous nous trouvons dans des ténèbres et dans une
incertitude d'où il nous est impossible de sortir : car il s'en faut beaucoup,
dit-il encore, que l'on puisse s'assurer du temps où
l'emprisonnement du masque de fer a commencé à Pignerol[13]. Si, continue-t-il avec la même malignité, on le trouvait marqué dans quelque registre semblable à
celui de Dujonca, on le saurait arec certitude ; mais il avoue, en se riant
intérieurement de ses lecteurs et du journal de Dujonca, que, pour vérifier
une époque d'une aussi grande conséquence, il nous manque une preuve de
cette force et de cette authenticité. Il finit par dire qu'on attendra,
pour former une décision, qu'on nous ait donné une date aussi sûre de
l'arrivée de ce fameux prisonnier à Pignerol, que celle que l'on a de son
arrivée et de sa mort à la Bastille par le
journal de Dujonca. Mais, en attendant une preuve de cette force et de cette authenticité que le
père Griffet feint de nous souhaiter charitablement, nous ne craindrons pas
d'assurer que Pignerol, comme prison du masque de fer, est une fausseté ; que
les dates que nous a données le journal de Dujonca de son arrivée et de sa
mort à la Bastille, sont des faussetés ; que le journal de Dujonca est
lui-même une fausseté d'où dérivent toutes les autres : et, si l'indignation
que tout cela inspire pouvait laisser place à d'autres sentiments, nous nous
amuserions beaucoup, avec le père Griffet, des vains efforts des curieux pour
trouver dans les souterrains de Pignerol un prisonnier qui n'y entra jamais,
et nous ririons comme lui de ses faussetés et de ses plaisanteries. Nous avons fait plus haut l'analyse d'une lettre que M. de Palteau avait écrite à M. Fréron en i 768. Nous étions déjà persuadés alors, malgré cette lettre, que le masque de fer n'avait jamais séjourné à Palteau, et qu'il n'y avait que fausseté dans tout ce qui avait rapport à ce séjour. Nous remarquâmes surtout qu'il n'était nullement vraisemblable que Saint-Mars, cet homme si ombrageux, si précautionné, eût assemblé ses vassaux et une foule d'autres gens, pour leur donner en spectacle un prisonnier que l'on cachait avec les soins les plus extraordinaires. Le père Griffet, qui se moque intérieurement de cette lettre, devait, d'après sa méthode, faire semblant d'y ajouter foi : il commence par dire, non pas qu'elle est dictée, mais qu'elle paraît dictée par la vérité même ; et ii fonde plusieurs raisonnements, tous dignes de la lettre, sur les détails qu'elle contient. M. de Palteau, dit-il en propres termes, y raconte tout ce qu'il avait appris de ceux qui vivaient ENCORE lorsque le masque de fer passa à Palteau. On lit avec si peu d'attention, que la singularité de cette phrase a échappé à tous ses lecteurs. On a passé rapidement par-dessus la plaisanterie que ces expressions renferment, et la malignité du jésuite a eu un succès complet : du même trait lancé contre M. de Palteau dont il se joue, il a percé tous ceux qui n'ont pas été frappés de l'invraisemblance, et même de l'impossibilité qu'il y avait, à ce que les mêmes gens qui vivaient encore, c'est-à-dire, qui étaient déjà vieux en 1698, pussent être interrogés par M. de Palteau en 1768. Le père Griffer vient ensuite à une lettre que la Grange-Chancel avait écrite à M. Fréron, plusieurs années après que le Siècle de Louis XIV eut paru, et il est assez plaisant de considérer l'importance qu'il affecte de mettre aux choses les plus futiles et les plus ridicules. Tout le monde sait que la Grange-Chancel fut enfermé aux îles Sainte-Marguerite vers l'année 1718. Cet écrivain prétend s'être entretenu alors du masque de fer avec M. de Lamothe-Guérin qui y commandait, et avec le sieur de Formanoir — Blainvilliers —, neveu de Saint-Mars, et lieutenant de la compagnie franche préposée à la garde des prisonniers. A l'en croire, il apprit des particularités très-intéressantes ; mais la plus curieuse et la plus intéressante fut que l'homme au masque de fer pouvait liter son masque dans sa chambre, puisque lorsqu'il était seul il avait la liberté de s'amuser à s'arracher le poil de la barbe, avec des pincettes d'acier très-luisantes et très-polies. Le père Griffet, qui se rit des pincettes et de la Grange-Chancel, fait semblant de vouloir rechercher à son tour, si le prisonnier demeurait effectivement masqué dans sa chambre : Il n'y a nulle apparence, dit-il, qu'il fût obligé de garder son masque quand il mangeait seul dans sa chambre, en présence de Rosarges et du gouverneur qui le connaissaient parfaitement. Il n'était donc obligé de le prendre que lorsqu'il traversait la cour de la Bastille pour aller à la messe, afin qu'il ne fût pas reconnu par les sentinelles, ou quand on était obligé de laisser entrer dans sa chambre quelqu'homme de service qui n'était pas dans le secret. Le jésuite met ainsi en fait tout ce qui a besoin d'être prouvé, tout ce qu'il sait lui-même être faux, et il en conclut que le prisonnier pouvait ôter son masque. Mais la principale preuve en est, selon lui, dans les pincettes d'acier très-polies et très-luisantes, avec lesquelles il pouvait s'amuser à s'arracher le poil de la barbe. Le lecteur en conclura avec beaucoup plus de raison que le père Griffet se riait de toutes ces vaines preuves dans le fond de sou cœur. Que chacun juge si un trait de cette espèce, aussi incertain d'ailleurs que frivole, trait qui ne tient à rien, qui ne nous apprend rien, était de nature à arrêter sérieusement un homme aussi difficile en preuves, que l'auteur du Traité des différentes preuves qui servent à établir la vérité de l'histoire ? Qui ne sentira pas, au contraire, que tant de puérilités, tant de misérables raisonnements ne peuvent-être que des plaisanteries ? Dès que le père Griffet affecte de s'occuper gravement dans
sa dissertation des choses les plus frivoles, il devait y faire jouer un rôle
aux cheveux du masque de fer ; aussi n'y a-t-il pas manqué. Les traditions contenues dans les écrits sur le masque de
fer, nous dit-il, ne sont pas toutes également
vraies ; elles ne sont pas également fausses : mais toutes ces traditions
s'accordent assez sur un point, qui est que l'homme au masque avait les
cheveux blancs, et dans le temps qu'il était à Sainte-Marguerite, et depuis,
lorsqu'il passa par le château de Palteau[14]. En effet il n'y
attrait rien d'extraordinaire à ce qu'il dit eu les cheveux blancs à Palteau,
s'il les avait déjà eus blancs à Sainte-Marguerite ; mais on se contentera de
demander si ces curieuses traditions peuvent cire autre chose que des
plaisanteries. D'après la méthode de beaucoup appuyer sur ce qui est faux, le père Griffet ne se lasse pas de revenir au masque du prisonnier, comme il est souvent revenu à la prison de Pignerol. M. de Palteau, rapportant ce que lui avaient raconté les paysans qui, par la croisée de la salle à manger assistaient en foule au repas de M. de Saint-Mars et du masque de fer, disait dans sa lettre : Que M. de Saint- Mars mangeait avec son prisonnier qui avait le dos opposé aux croisées de la salle à manger, qui donnaient sur la cour. Que les paysans qui l'avaient vu, et qu'il a interrogés, ne purent voir s'il mangeait avec son masque ; mais ils observèrent très-bien que M. de Saint-Mars, qui était à table vis-à-vis de lui, avait deux pistolets à côté de son assiette ; ils n'avaient pour les servir qu'un seul valet de chambre qui allait chercher les plats qu'on lui portait dans l'antichambre, fermant soigneusement sur lui la porte de la salle à manger. La fable de ces pistolets factionnaires est si absurde, que le père Griffet a craint de trop offenser M. de Palteau en s'y arrêtant : mais, comme s'il eût voulu faire mieux sentir encore les traits qu'il avait déjà lancés contre lui, an sujet du rapport qu'il prétendait lui avoir été fait par ces paysans si vivaces, il écrit en gros caractères : Les paysans qui l'avaient vu, et qu'il a interrogés. Il ajoute ensuite du ton le plus sérieux : Voilà des circonstances qui prouvent que le prisonnier avait la liberté d'ôter son masque, d'abord à l'île Sainte-Marguerite quand il voulait s'arracher avec des pincettes le poil de la barbe ; ensuite à Palteau, lorsqu'il mangeait avec M. de Saint-Mars ; car, s'il avait eu son masque, pourquoi aurait-en pris toutes ces précautions ? Pourquoi aurait-on voulu qu'il
tournât le dos aux fenêtres de la salle à manger ? Pourquoi le valet de chambre qui les servait aurait-il été prendre les plats dans l'antichambre ? Pourquoi fermait-il soigneusement la porte de la salle à manger, quand il y était entré ? C'est au lecteur à juger si toutes ces preuves et tous ces pourquoi si comiques ne sont pas de véritables plaisanteries. Le père Griffet, comme on l'a vu, ayant eu ses raisons pour laisser intact le récit de M. de Voltaire, réduit à trois opinions les différents systèmes qu'on a imaginés sur le masque de fer. La Grange y avait vu le duc de Beaufort ; Saint-Foix, le duc de Mont-Mouth ; l'auteur des Mémoires secrets, le comte de Vermandois, fils de Louis XIV. Le jésuite, en feignant de préférer le dernier système à tous les autres, s'en moque réellement comme il s'est moqué des deux premiers ; car rien n'est plus dérisoire que les raisons sur lesquelles il fonde cette préférence ; les voici : première raison. Il est constaté, dit-il, que le masque de fer avait la liberté de s'amuser à s'arracher le poil de la barbe, avec des pincettes d'acier très-polies et très-luisantes ; or, il est évident que cette occupation convenait bien mieux au jeune comte de Vermandois qu'au duc de Beaufort qui aurait eu plus de cinquante-huit ans. Deuxième raison, Quoique le comte de Vermandois fût encore très-jeune, il serait inutile, selon le père Griffet, d'incidenter sur ce que M. Dujonca dit dans son journal, que l'homme au masque de fer était un ancien prisonnier, que M. de Saint-Mars avait à Pignerol. Si c'était le comte de Vermandois, ajoute le jésuite, il y aurait eu quinze ans, en 1698, qu'il aurait été envoyé à Pignerol. Or, quinze ans de prison donnent certainement à une personne un titre d'antiquité que beaucoup d'autres n'ont pas, et sont ravis de ne pas avoir. — Ce titre d'antiquité peut-il être autre chose qu'une plaisanterie ? Troisième raison. Les précautions
étonnantes que l'on prit pour cacher le nom du prisonnier pendant sa vie et
après sa mort, continue le père Griffet, s'expliquent
bien plus naturellement dans l'opinion de l'auteur des Mémoires secrets,
que dans toutes les autres. Et aussitôt il nous les explique lui-même
par des exclamations ironiques, au lieu de nous les expliquer par des
raisons. Il s'écrie donc : Quel grand éclat
n'aurait-on pas donné à un affront fait au dauphin par une punition publique
? quel abîme d'affliction pour la mère et la sœur de ce jeune prince ! quelle
nouvelle à leur annoncer que la détention éternelle d'un fils et d'un frère
enfermé pour le reste de ses jours ! Quelles précautions à prendre pour que ce
terrible châtiment ne parvînt jamais à leur connaissance ! Ces mêmes raisons,
continue-t-il, subsistaient après sa mort. Comment
annoncer une fin si triste et si déplorable à sa mère et à sa sœur qui lui
ont survécu ? Nous ne nous permettrons sur tout cela aucune réflexion. Nous dirons seulement que les exclamations et les pourquoi du père Griffet, débités gravement sur le théâtre par un bon valet de comédie et surtout avec l'air de malignité qu'aurait pu y mettre le fameux Préville, feraient rire aux éclats tous les spectateurs, et attireraient à l'acteur de grands applaudissements. Le père Griffet devient toujours plus hardi à mesure qu'il avance dans sa dissertation. Il ose nous dire, après tant d'absurdes raisonnements, Qu'il ne faut pas s'imaginer que l'auteur des Mémoires secrets soit le premier qui ait imputé au comte de Vermandois l'attentat dont il s'agit ; qu'on en avait parlé longtemps auparavant sur une de ces traditions, qui ont à la vérité besoin d'être prouvées, et que le souvenir de celle-ci s'était toujours conservé, quoiqu'on n'en fit pas beaucoup de bruit, du temps du feu roi — Louis XIV —, par la crainte de lui déplaire. C'est de quoi, ajoute-il, beaucoup de gens qui ont vécu sous son règne pourraient rendre témoignage. Ce passage de l'examen est plus qu'une plaisanterie. Il n'y a pas une seule ligne à laquelle on ne fit en droit d'appliquer le mot si fameux des Lettres provinciales, mentiris impudentissimè. Oui, quoi qu'assure le père Griffet, l'auteur des Mémoires secrets est le premier qui ait parlé du prétendu attentat du comte de Vermandois. Jamais aucune tradition n'en avait fait mention avant lui. Celles qui ont ti la vérité besoin d'être prouvées ont, ainsi que les vraies traditions, gardé un silence absolu sur ce sujet : si l'on peut dire que le souvenir de celle-ci s'est toujours conservé, c'est uniquement depuis 1745 ; car c'est en 1745 que parurent les Mémoires secrets ; et ce qui pourrait donner lieu à des soupçons assez singuliers, c'est cette même année 1745 que le père Griffet fut nommé confesseur de la Bastille. Il joint donc très-certainement le mensonge à la plaisanterie, lorsqu'il écrit que c'est de quoi beaucoup de gens qui ont vécu sons le règne de Louis XIV pourraient rendre témoignage. Beaucoup de gens pourraient rendre témoignage, en 1770, d'un fait arrivé en 1683 ! ! Ce trait est le pendant de celui qu'il avait déjà lancé contre le témoignage de ces paysans qui vivaient encore, c'est-à-dire, qui, déjà vieux en X698, lorsque le masque de fer séjourna à Palteau, rendirent un compte détaillé de ce séjour à M. de Palteau, en 1768. Mais le père Griffet lui-même ne croyait pas plus à l'outrage prétendu fait au dauphin que celui qui a écrit que cette opinion était un soufflet donné au sens commun. C'est ici que la plaisanterie va jaillir avec plus de force encore qu'elle n'a fait dans tous les raisonnements qui précèdent. On ne prétend pas assurer comme
un fait certain, dit le jésuite, l'espèce de
crime que l'on voulait punir dans la personne du comte de Vermandois ; mais
quand même celui qu'on lui impute serait démontré faux, il ne s'ensuivrait
pas qu'en se trompant sur la nature du crime on se trompât également sur la personne.
Le comte de Vermandois ne reparut à la cour que sur la fin d'octobre, pour y
prendre congé avant que de partir pour sa première campagne ; et le temps
pour prendre congé, ajoute-t-il plaisamment, et plus qu'il ne faut
pour faire à la cour de grandes fautes. C'est après cette singulière réflexion
qu'il s'écrie : Combien d'autres fautes un jeune homme vif et emporté ne
pouvait-il pas commettre, qui eussent mérité et même exigé une semblable
punition ! Un enfant de quatorze à quinze ans, un fils de Louis XIV, toujours accompagné de son gouverneur, entouré de ses gentilshommes, pendant le peu de temps qu'il faut pour prendre congé du roi et de la famille royale, pouvait commettre une multitude de fautes qui auraient mérité et même exigé d'être punies par le plus long, et le plus cruel des supplices ! et ici ce ne sont plus des crimes, mais des fautes qui seraient punies avec Cette barbarie ! Il n'est personne qui ne sente d'abord qu'il est impossible qu'un homme aussi judicieux que le père Griffet ait écrit sérieusement d'aussi étranges absurdités, et que tout cela ne peut être qu'une plaisanterie. Après les différents traits que nous venons de rapporter et auxquels il serait facile d'en ajouter une infinité d'autres, quel est l'homme à qui il pourrait rester quelque doute sur la nature et l'objet de la dissertation que nous venons de combattre ? qui ne sera convaincu qu'il n'y a que faussetés et plaisanteries dans cet ouvrage ? Mais ce qui n'est pas une plaisanterie, et la seule chose vraie qui soit peut-être dans l'examen, c'est la sortie violente du père Griffet contre son confrère le P. Tournemine. Sa colère est un problème moral que nous présenterons à nos lecteurs, et dont nous leur donnerons en même temps la solution ; mais, avant que d'en venir là, nous croyons devoir faire mention d'un écrit qui parut immédiatement après l'examen et dont il fait nécessairement partie ; quoiqu'il ait été donné au public sous le titre de Lettre d'un ami du père Griffet, tout fait voir que cette lettre est du père Griffet même et qu'elle ne peut être que de lui. C'est son style, sa manière propre, son genre d'ironie : ce sont enfin les mêmes faussetés, le même persifflage, le même ton de plaisanterie. Le succès de sa dissertation avait été probablement
au-delà de ses espérances. On serait même fondé à soupçonner qu'il fut piqué
qu'on l'eût cru capable de toutes les absurdités dont l'examen était rempli.
Il voulut s'en venger, et il le fit en se jouant plus ouvertement encore
qu'il ne l'avait fait et de M. de Saint-Foix et du public. Voulant faire
sentir le ridicule d'un outrage dont il connaissait toute la fausseté, il
prit, pour le démentir, un détour digne de lui : il le démentit par une autre
fausseté. L'ignorance que cette fausseté pourrait faire supposer ne saurait
être du père Griffet un des hommes de l'Europe le mieux instruit des détails
les plus minutieux de l'histoire. On a vu qu'il avait établi dans son examen
que c'était à la cour que le dauphin avait reçu le plus grand des outrages,
pendant le peu de moments que le comte de Vermandois y avait passés pour
prendre congé de la famille royale. Dans sa lettre, ait contraire, il assure
que cet outrage imaginaire fut fait au dauphin devant Courtrai. Cette
contradiction dérisoire était trop frappante pour qu'il pût donner la lettre
sous son nom, et c'est probablement ce qui le détermina à la mettre sous le
nom d'un ami : L'auteur des mémoires,
dit-il, a mal placé le lieu de la scène, et cette
faute a ôté presque toute vraisemblance au reste de son récit. Ce fut au camp
devant Courtrai, que M. le comte de Vermandois eut une querelle avec
M. le dauphin. Il ne faut pas être fort habile en histoire pour savoir que le dauphin ne s'éloigna pas un moment de la cour pendant le siège de cette place. On en trouve la preuve dans toutes les feuilles, dans tous les journaux, dans toutes les gazettes. Qu'on se figure donc les éclats de rire du père Griffet, lorsqu'il vit Saint-Foix se démener de toutes les manières pour trouver des preuves que le dauphin n'avait pas fait la campagne de Courtrai. C'est l'action d'un homme qui, quand le soleil est en plein midi, se fatiguerait à vouloir nous prouver qu'il est au-dessus de notre horizon. Le père Griffet ne cesse de se moquer de Saint-Foix en le flattant, en le caressant, en lui applaudissant : il pousse enfin le persifflage jusqu'à le louer d'avoir su démontrer, au sujet du dauphin et du comte de Vermandois, que deux hommes ne sont pas exactement du même tige, quand l'un n'a que quinze ans, et que l'autre en a vingt-deux. Enfin le père Griffet en vient jusqu'à convenir que le masque de fer passait en Provence pour un prince turc. Cet aveu, que l'aveuglement dont il voyait qu'il avait frappé tous les esprits par son examen lui fit hasarder dans sa lettre, est bien précieux ; mais comme il pouvait être dangereux par ses conséquences qui tenaient de près à la vérité, il se hâte de détourner du véritable objet les regards du lecteur, et de les lui faire porter sur un objet étranger, en ajoutant aussitôt : Je ne désespère pas de voir soutenir un jour que ce célèbre inconnu est le sultan Mahomet IV, détrôné en 1687 : sa taille, son accent étranger, et quelques autres circonstances paraissent d'autant plus propres à confirmer cette conjecture qu'on sait que le sort de ce prince après sa déposition est assez incertain. La taille de Mahomet IV se trouve là singulièrement bien placée ; mais le père Griffet, en parlant de l'accent étranger du masque de fer, et de quelques autres circonstances, en disait sûrement plus qu'il ne croyait en dire. Laissons pourtant de côté, dans ce moment, ce qui résulte de cet accent et de ces circonstances, et contentons-nous de remarquer que l'incertitude qu'il suppose n'est réellement qu'une fausseté. Le sort de Mahomet IV est très-connu. Détrôné en 1687, il fut enfermé dans le sérail, selon l'usage ordinaire des Turcs lorsqu'ils ne font pas mourir leur souverain, et on sait d'une manière, certaine qu'il y vécut encore cinq ans. Tout ce que l'on ignore, c'est s'il y mourut de mort naturelle, ou s'il finit par être empoisonné. Le père Griffet termine malignement sa lettre par les paroles suivantes : Nous aurions lieu de nous applaudir de nos remarques, si elles engageaient M. de Saint-Foix à communiquer au public des recherches et des réflexions nouvelles. C'est encore là bien certainement une plaisanterie ; mais rien n'est plus plaisant que l'ardeur avec laquelle Saint-Foix se livre, par de nouvelles recherches, à cette ironique invitation. Il s'était néanmoins aperçu que l'auteur de la lettre avait altéré des faits, qu'il en avait falsifié, qu'il en supposait ; il lui reproche amèrement d'avoir écrit le contraire de ce qu'il voyait et de ce qu'il pensait. Quel nom, s'écrie-t-il, donne-t-on à un pareil procédé ? Mais telle fut sa prévention, que quoiqu'homme de beaucoup d'esprit, il eut toujours la bonne foi de croire que le père Griffet était sérieusement de mauvaise foi dans ce qui n'était de sa part qu'une suite continuelle de plaisanteries. On connaît le caractère sensible et violent de ce célèbre écrivain. Si la seule mauvaise foi du jésuite excitait sa colère, quelle n'aurait pas été sa fureur, s'il eût reconnu que cette mauvaise foi ne tendait qu'à se moquer de lui ? Venons au problème que nous avons promis. COLÈRE DU PÈRE GRIFFET CONTRE LE PÈRE TOURNEMINE.PROBLÈME MORAL.Saint-Foix, toujours prompt à saisir tout ce qui paraissait lui présenter le moindre jour en faveur de son système, rapporte un fait, duquel il croyait pouvoir inférer que le duc de Monmouth quoique décapité en plein jour, à la vue de toute l'Angleterre, n'était pas réellement mort, et que, par conséquent, ce prince pouvait être le masque de fer. Voici ce fait, rendu fidèlement dans les propres termes de Saint-Foix. D'autres et moi, écrit-il, avons entendu raconter au père Tournemine, qu'étant allé faire visite à la duchesse de Portsmouth avec le confesseur du roi Jacques, le père Sanders, elle leur dit dans une suite de conversation, qu'elle reprocherait toujours à la mémoire de ce prince l'exécution du duc de Monmouth, après que Charles II, à l'heure de la mort, et prêt à communier, lui avait fait promettre devant l'hostie, que, quelque révolte que tentât le duc de Monmouth, il ne le ferait jamais punir de mort. Aussi ne l'a-t-il pas fait, répondit avec vivacité le père Sanders. Il n'y avait certainement rien dans tout cela que le père
Tournemine, en se jugeant même avec la plus grande sévérité, eût la moindre
raison de se reprocher. Qui sait même si, en rendant ce propos à M. de
Saint-Foix, il ne s'était pas moqué de lui ? Le père Griffet qui, dans son
examen, s'était déjà ri malignement de son opinion, pouvait se borner à en
rire de même dans cette occasion, et on ne lui en aurait pas demandé
davantage ; mais, par l'effet d'un sentiment dont la cause était restée
inconnue, il entre tout-à-coup en fureur contre le père Tournemine, il écrit
que le témoignage de cent pères Tournemine ne
suffirait pas pour vérifier un fait de cette nature ; que ce père était d'une
imagination vive et enflammée, à peu près comme celle de Maimbourg ; qu'il
aimait à raconter des choses extraordinaires, sans trop s'embarrasser si elles
étaient vraies, ce qui faisait dire, quand on rencontrait des gens du même
caractère, Il
ressemble à Tournemine, Qui croit tout ce qu'il imagine. et il a la dureté d'ajouter qu'on sait d'ailleurs qu'en cet endroit l'auteur des vers n'a point outré la satire. Ce procédé entièrement opposé à la douceur et à la politesse qui distinguaient le père Griffet, dut d'autant plus étonner qu'il était une violation manifeste des constitutions des jésuites. Toutes s'accordaient à recommander l'union entre les membres de la société. Elles leur ordonnaient de s'aimer, non comme hommes, mais comme jésuites. Elles leur faisaient une loi des égards réciproques. Elles en commandaient de particuliers pour ceux d'entr'eux qui étaient distingués par les talents et surtout par la naissance. Elles défendaient expressément d'attaquer leur gloire et leur réputation, parce que la gloire des individus faisait la gloire de la société. Quelle est donc la raison qui a pu engager le père Griffet à violer aussi ouvertement une loi recommandée par toutes les constitutions ? pourquoi, au mépris de toutes les bienséances, s'est-il porté à insulter à la mémoire d'un confrère qui joignait aux avantages d'une naissance distinguée la science et les talents ? d'un confrère aimé, estimé, considéré à la cour et à la ville, célèbre dans toute l'Europe, dont le nom était compté parmi les noms les plus illustres, et qui à tant de titres réunissait, en qualité de profès, toute la plénitude du jésuitisme ? SOLUTION DU PROBLÈME.Pour la solution de ce problème, il est nécessaire de savoir que si les constitutions recommandaient fortement les égards réciproques aux membres de la société, elles commandaient bien plus impérieusement encore de tout sacrifier, sans exception, à la société elle-même : ses propres membres étaient compris dans cette sorte d'anathème, parce que les individus n'étaient rien lorsqu'il s'agissait de l'intérêt et de la gloire de la société. Cette loi, comme on le sent, était la première en rang : toutes les autres lui étaient subordonnées. On a vu que le père Griffet avait évité soigneusement dans son examen de jamais parler des jésuites. Il avait passé par-dessus le fait que Renneville rapporte dans son histoire ; les jésuites y étaient trop fortement compromis. Il avait sauté une seconde fois par-dessus cette même anecdote, lorsqu'il avait discuté le mémoire de Saint-Foix qui s'étend assez sur ce sujet. Il était dans son plan, comme dans l'intérêt de sa cause, d'écarter toute idée qui eût le moindre rapport aux jésuites, surtout en parlant du masque de fer. Quand donc M. de Saint-Foix, en citant le propos du père Tournemine, vient à l'improviste mettre les jésuites sur la scène, ce propos, quelqu'innocent qu'il soit, devient aux yeux du père Griffet un crime de lèse-société qu'il ne saurait lui pardonner. Il ne voit qu'en frémissant les jésuites nommés à côté d'un forfait dont les seuls jésuites étaient les auteurs, et dont il avait travaillé lui-même avec autant de soin que d'artifice à dérober la connais-sauce à tous les hommes. La crainte que ces pensées lui inspirent le rend furieux et lui ôte subitement l'usage de sa raison. Il s'emporte avec violence contre le père Tournemine. Il le déprime, il l'outrage, il cherche à l'avilir. Il voudrait pouvoir l'anéantir dans sa colère. Brutus sacrifia des enfants chéris au salut de la patrie : le père Griffet croit immoler de même un' confrère respectable au salut de la société. La solution de ce problème est prise dans la nature du cœur humain : nous la croyons vraie, et sa vérité se fera mieux sentir encore par un exemple. Nous avons parlé d'un plan, que le duc d'Aiguillon avait fait faire sous ses yeux, de l'action de saint Cast, et on se rappellera qu'au mépris des lois de la reconnaissance, il avait évité d'y mettre le moulin qui, pendant cette action, lui avait rendu un service signalé. Un artiste fameux imagine de faire un nouveau plan de la même action pour s'en faire un mérite auprès de Ce plan était beau, nettement dessiné, et rien n'y avait été négligé pour l'exactitude et les ornements. L'artiste, fier de son ouvrage, vole chez le duc d'Aiguillon et le lui présente. Ce ministre, alors tout puissant, le reçoit avec une bonté qui donne à l'auteur les plus grandes espérances. Il admire son travail, il le loue ; il se disait dans le fond de son cœur que ce plan allait multiplier les titres de sa gloire. L'artiste, non moins content, s'imaginait déjà marcher à grands pas dans la carrière de la fortune. Tout-à-coup, le duc d'Aiguillon aperçoit le moulin qu'il avait rendu célèbre en s'y couvrant d'autre chose que de gloire. Il frissonne à cette vue ; son front se ride, son ton s'aigrit, et le mécontentement le plus marqué succède à sa première satisfaction. Le malheureux artiste, qui ne conçoit rien à ce bizarre changement, s'effraie, balbutie en tremblant quelques mots, fait plusieurs révérences à reculons, franchit la porte et disparaît. Jamais le duc d'Aiguillon ne lui pardonna. Nous ne nous permettrons aucune réflexion Sur ce qu'on vient de lire. Nous demanderons seulement si l'examen du père Griffet, sa lettre sous le nom d'un ami, et sa colère contre le P. Tournemine ne sont pas, pour tout homme qui pense, des preuves non équivoques de la vérité de notre découverte. RAISONS DE SOUPÇONNER QUE LE MASQUE DE FEU À EXISTÉ LONGTEMPS ENCORE APRÈS 1703, DATE DE LA MORT DE MARCHIALY.Au commencement de 1788, un de mes amis me communiqua une note qui lui avait été donnée par le premier commis des archives de la Bastille. Cette note, qui contenait tout ce qui se trouvait dans les papiers de ce château sur le masque de fer, n'était exactement que la répétition de ce que le père Griffet en avait dit dans son examen. Il y avait seulement ajouté, pour mieux tromper, que cela avait été raconté par M. de Launay, qui a été longtemps gouverneur de la Bastille, et qui l'avait entendu dire à ceux qui avaient vu le prisonnier avec son masque, lorsqu'il passait dans la cour du château pour aller à la messe. Nous ne dirons pas que des ouï-dire, fondés sur des ouï-dire, forment une plaisante autorité, dont un critique aussi judicieux que le père Griffet aurait eu honte de faire usage, s'il eût parlé sérieusement ; mais son intention et sa marche m'étant connues, lorsque cette note me fut remise, je ne fus pas étonné de son entière conformité avec ce qu'il en avait déjà dit lui-même au public. Tout me persuada que la note de la Bastille et le récit du jésuite étaient sortis de la même source, quoiqu'il eût voulu faire croire que c'était par M. de Launay qu'on l'avait appris. Je réfléchis néanmoins sur cette conformité, et voici le résultat de mes réflexions. Je pensai, après avoir suivi pas à pas la marche artificieuse du père Griffet, qu'ayant choisi la date de la mort de Marchialy, en 1703, pour l'appliquer à la mort du masque de fer, il était très-vraisemblable qu'il aurait agi de même à l'égard de son entrée à la Bastille, en appliquant à l'entrée du masque de fer la date de l'entrée de Marchialy, c'est-à-dire la date du 18 septembre 1698. Mais, imaginant en même temps que le père Griffet aurait prévu qu'on pourrait recourir aux registres de la Bastille pour y vérifier les faits, et qu'alors on trouverait Marchialy assez bien signalé à son entrée, pour qu'on vît clairement qu'il ne pouvait pas être le masque de fer, je conjecturai qu'il n'aurait pas manqué de faire raturer ou effacer dans les registres cet article de 1698, comme l'unique moyen d'assurer le succès de sa supercherie. J'écrivis, en conséquence, à l'ami qui m'avait procuré la note de l'archiviste de la Bastille ; mais je n'obtins aucun éclaircissement. La fortune y a suppléé, et le temps, qui dévoile tout, malgré le père Griffet, a pleinement justifié mes raisonnements et ma conjecture. La prise de la Bastille en a mis au grand jour tous les papiers. Il est vrai qu'on n'a pas trouvé que l'article dont j'ai parlé eût été ni raturé, ni effacé dans le grand registre, comme je l'avais pensé ; mais, ce qui n'était pas moins sûr, on a trouvé que la feuille qui le contenait en avait été enlevée. On lit, en propres termes, dans la Bastille dévoilée, dont les auteurs avaient le grand registre sous les yeux, que le folio 121 y suit immédiatement le folio 119, et que par conséquent le folio 120, qui contenait l'année 1698, manque. Ces auteurs ajoutent que ce folio n'a pas été déchiré, et qu'il semble au contraire qu'il a été enlevé avec beaucoup de soin et de précaution. Cette conjecture, que le temps a si bien justifiée, aurait
dû nous conduire alors à une seconde, qui était une suite toute naturelle de
la première. Mais on s'avise rarement de tout à la fois. Nous aurions dû
penser que, si le père Griffet avait eu la précaution et l'adresse de faire
supprimer, dans les papiers de la Bastille, les notions qui s'y trouvaient,
touchant l'entrée de Marchialy, il aurait eu la même précaution pour en faire
disparaître les notions qui s'y trouvaient touchant le patriarche. Cette
dernière mesure n'était pas moins nécessaire : aussi ne fut-elle pas
négligée. Les auteurs de la Bastille dévoilée nous apprennent encore que depuis 1705, jusqu'au 24 avril 1730 inclusivement,
leur registre se trouvait déchiré et mutilé à un tel point, qu'il leur était
impossible d'en faire une analyse suivie. C'est tout ce qu'ils en
disent : mais nous remarquerons qu'au milieu de ce vide du registre déchiré,
on trouve, comme jetés au hasard, les deux mots.... arménien patriarche, sans autre chose. Il est
assez probable que ce registre ne fut ainsi déchiré, depuis 1705 jusqu'à
1730, que pour effacer tonte trace du patriarche, depuis son arrestation
jusqu'à sa mort. Car de ce qu'on vient de voir, en le joignant à ce qu'on va
lire dans un moment, on pourrait présumer que le masque de fer ne mourut
effectivement qu'en 1730. Il y a des preuves, comme on le verra bientôt, que le masque de fer était à la Bastille en 1721 et même en 1723. Il ne serait donc pas étonnant qu'il eût encore vécu jusqu'en 1730 ; et on peut le soupçonner, puisque le temps de 1705 à 1730 est le temps renfermé dans ce qu'on a déchiré et mutilé dans le grand registre de la Bastille. NOTE SINGULIÈRE TROUVÉE À LA BASTILLE, LORSQUE LE PEUPLE DE PARIS S'EN EMPARA ; ELLE POURRAIT DONNER QUELQUE POIDS À CETTE DERNIÈRE CONJECTURE.Extrait du Patriote français, par Brissot, du mardi 11 août 1789, N° XIII. On vient de publier, dit Brissot, un petit, mais très-petit pamphlet, où l'on prétend prouver que l'homme au masque de fer n'était autre que Fouquet. On s'appuie sur une carte trouvée à la Bastille, qui contient la note suivante..... Fouquet, arrivant des iles Sainte-Marguerite avec un masque de fer. On lisait ensuite trois xxx, et au-dessous Kersadiou. C'est tout ce que Brissot nous dit de ce pamphlet qui m'est tout-à-fait inconnu, et sur lequel il est fort inutile d'en savoir davantage ; mais je m'arrêterai un instant au mot Kersadiou et aux trois xxx qu'on lisait sur la carte trouvée à la Bastille. Ne serait-il pas possible que quelque homme parfaitement instruit de l'aventure du patriarche, un jésuite, par exemple, eût cherché, comme le barbier de Midas, à se soulager d'un secret qui lui pesait, en le consignant d'une manière obscure et singulière sur cette carte ? Le marquis de Bonnac, en le nommant, écrit Awedix, c'est-à-dire Aouedix, parce que le double w se prononce ou dans les langues de l'Orient, comme dans celles du Nord. M. de Feriol écrit Awediks ou Aouediks, en mettant k et s, au lieu d'x. Quelques missionnaires jésuites l'écrivent comme M. de Fériol. D'autres mémoires, sans adoucir les noms étrangers, comme cela est très-ordinaire dans la langue française, y ajoutent un r, en écrivant Arcvediks ou Arouediks, ainsi que les Arméniens le prononcent. Dans ce dernier cas, Kersadiou serait exactement lettre pour lettre, l'anagramme d'Arouediks, c'est-à-dire du nom du patriarche. Quant aux trois xxx, ce sont des chiffres romains qui signifient trente, et on aurait pu avoir en vue d'indiquer ainsi par abréviation l'année de sa mort : Obiit anno XXX. La chose aurait été trop claire si l'on en eût dit davantage. Cela s'accorde parfaitement à l'année 1730, qui a été déchirée à dessein dans le grand livre de la Bastille. D'après ces réflexions, il serait assez naturel de croire que l'auteur de la carte se serait fait un plaisir d'y consigner deux choses vraies, le nom du patriarche, et l'époque de sa mort. Le nom de Fouquet, jeté au travers de ces deux vérités, serait la terre, dont le barbier de Midas avait bouché le trou dans lequel il avait déposé son secret. PREUVES QUE L'EXISTENCE DU MASQUE DE FER EST DE BEAUCOUP POSTÉRIEURE À LA MORT DE MARCHIALY, ENTERRÉ EN 1703 ; D'OÙ RÉSULTE UNE PREUVE DE LA FAUSSETÉ DU JOURNAL DE DUJONCA.M. de Voltaire assure avoir
appris du deuxième maréchal de La Feuillade, gendre de M. de Chamillard, qu'à la mort de ce ministre, il le conjura de
lui apprendre ce que c'était que cet inconnu, qu'on ne connut jamais que sous
le nom de l'homme au masque de fer ; et que Chamillard lui répondit que
c'était le secret de l'état, et qu'il avait fait serment de ne le point
révéler. M. de Chamillard mourut en 1721 : c'est donc en 1721 que
M. de la Feuillade cherchait à savoir qui était cet inconnu. Jamais, quoi
qu'ait écrit le père Griffet, il ne fut parlé d'un prisonnier masqué, ni sous
Louis XIV, ni même longues années après Louis XIV. Il perça peut-être un
moment à la cour qu'il y avait à la Bastille un prisonnier qu'on gardait avec
des précautions extraordinaires, et c'est ce qui excita la curiosité de M. de
La Feuillade. Mais si ce prisonnier inconnu à tout le monde, et qui n'avait
avec personne aucun de ces rapports qui auraient pu intéresser à lui, eût été
enfermé en 1698, et qu'il fût mort en 1703, quelqu'un en France se serait-il
souvenu de lui en 1721, dans un temps surtout oie les imaginations n'avaient
pas encore été exaltées par la multitude des écrits qui parurent depuis sur
cette aventure ? est-il dans la nature du cœur humain qu'on conserve ainsi la
mémoire des gens que l'on a le plus aimés ? On peut donc conclure de la
prière faite en 1721 à M. de Chamillard, par le maréchal de La Feuillade, que le masque de fer vivait encore
en 1721. Les Mémoires secrets, etc., qu'on attribue au duc de Nivernois, assurent que fe duc d'Orléans, régent, peu de temps avant sa mort, alla voir le masque de fer à la Bastille : Saint-Foix, persuadé, comme tout le monde, par le journal de Dujonca, que le prisonnier masqué était mort en 1703, se rit de cette visite, en disant que l'auteur des Mémoires secrets, après avoir ressuscité le prisonnier, le présente vivant en 1723. Voltaire, dans sa défense du siècle de Louis XIV, parle plus sérieusement de cette vérité : il affirme, en propres termes, que tout Paris sait qu'il est faux que le duc d'Orléans ait jamais fait une visite à la Bastille. Cette assertion de Voltaire, quoiqu'avancée sans doute avec trop de hardiesse, est en quelque sorte excusable, puisqu'il est très-vrai que les princes du sang n'entraient jamais dans l'intérieur de ce château. Mais cette visite du régent de la France, quoique contraire aux usages, et dans tous les sens fort extraordinaire, n'en est pas moins certaine. Elle est attestée par un acte de la Bastille, moins suspect que l'examen du père Griffet, et plus vrai, et plus authentique que son journal de Dujonca. On trouve, dans un mémoire manuscrit fait par le major d'alors, pour l'instruction d'un nouveau ministre qui avait la Bastille dans son département, les paroles suivantes : Du temps de la régence, j'ai vu entrer dans la cour de l'intérieur du château M. le duc de Lorraine et M. le duc d'Orléans, accompagnés d'un seigneur de la cour dont il ne me souvient pas du nom[15]. On aurait pu douter de ce fait, s'il ne se fût trouvé que dans les mémoires de Perse : on ne peut plus en douter quand on le voit attesté par un titre authentique de la Bastille. Donc Marchialy mort et enterré en 1703 n'est pas et ne peut être le masque de fer, qui a été vu à la Bastille en 1723. Donc tout est faux dans l'examen du père Griffet, et tout est également faux dans le journal de Dujonca, que ce jésuite n'a fabriqué que pour en faire la base de sa dissertation. Il résulte bien clairement de tout ce qui précède, que quand on a enlevé le folio 120 du grand livre de la Bastille, c'est-à-dire l'année 1698, et qu'on y a mutilé et déchiré les années de 1705 à 1730, de manière à les rendre indéchiffrables, on a eu en vue d'y anéantir et les notices touchant Marchialy et les notices touchant le patriarche. On y supprima tout ce qui concernait Marchialy, pour qu'on ne vît pas qu'il n'était pas le masque de fer et qu'il n'avait aucun rapport avec lui. On y supprima tout ce qui concernait le patriarche, pour qu'on ne pût jamais connaître que ce patriarche, était le prisonnier inconnu, dont on a fait tant de bruit sous le nom de l'homme au masque de fer. PROBABILITÉS QUI FORTIFIENT LES PREUVES.On vient de voir que le prisonnier inconnu, que le masque de fer ne peut être Marchialy-, mort très-certainement en 1703. Mais, comme il est des probabilités qui sont propres à donner un nouveau jour aux preuves mêmes, nous croyons devoir en ajouter quelques-unes à celles que nous n'avons déjà répandues qu'avec trop de profusion, peut-être, dans le cours de ce mémoire. PREMIÈRE PROBABILITÉ.On a vu dans la première partie de cet ouvrage que Nélaton, chirurgien anglais, près de la porte St-Antoine, avait été conduit à la Bastille, pour y saigner un prisonnier, c'est-à-dire le masque de fer. M. de Saint-Foix qui atteste ce fait, le tenait de Nélaton lui-même, qui le lui avait raconté plusieurs fois. On pense bien que Saint-Foix ne manqua pas de s'informer du temps précis où cette visite avait eu lieu : mais, l'époque que lui donna Nélaton ne s'accordant pas avec les préjugés qu'il avait puisés dans le journal de Dujonca et se trouvant postérieure à l'année 1703, qu'on croyait être celle de la mort du prisonnier, il fut persuadé que Nélaton se trompait à cet égard : il n'a fait aucune mention de sa réponse, et n'a pris de son récit que ce qu'il a cru favorable à son opinion touchant le duc de Monmouth. C'est ainsi qu'en ont usé tous les auteurs qui ont écrit sur ce sujet : ils ont rejeté toutes les époques qui se trouvaient en contradiction avec celles du journal de Dujonca, et qui seules auraient pu les conduire à la vérité. DEUXIÈME PROBABILITÉ.Voltaire a agi comme tous les autres ; il raconte dans sa défense du siècle de Louis XIV, que M. Riousse, ancien commissaire des guerres à Cannes, avait vu ce prisonnier dans sa jeunesse, quand on le transféra de l'île Ste-Marguerite à Paris. M. Riousse, ajoute-t-il, était encore en vie l'année passée (1754) et peut-être vit-il encore (1755) : mais, s'il était vrai, comme on doit le croire, qu'il eût réellement vu le prisonnier lorsqu'on le transférait à la Bastille, Voltaire suppose tacitement que c'était en 1698, et il se borne à écrire vaguement qu'il l'avait vu dans sa jeunesse. Il se garde bien de fixer l'époque où M. Riousse l'avait vu : cette époque ne s'accordait pas avec le journal de Dujonca. Si les gens qui ont été cités comme témoins oculaires par les différents auteurs eussent prétendu avoir vu le prisonnier en 1698, on ne pourrait les comparer qu'à ces paysans, dont le père Griffet dit assez plaisamment qu'ayant tout raconté à M. de Palteau en 1768, ils méritaient d'autant plus de foi, qu'ils avaient tout vu de leurs propres yeux, puisqu'ils vivaient encore en 1698. TROISIÈME PROBABILITÉ.Le prince Henri de Prusse se trouvait à Paris vers l'année 1785. Il alla à la Bastille et il y parla beaucoup du masque de fer avec le gouverneur et les officiers de l'état-major ; à travers les conjectures, les contradictions et les faits confondus pêle-mêle, au hasard, dans leurs discours, il démêla différents traits qui lui firent conclure que l'existence de l'homme au masque de fer tenait à un temps beaucoup moins éloigné que les époques auxquelles s'étaient fixés tous les auteurs qui avaient travaillé à cette découverte. Il en parla au comte de Grimoard de qui je tiens cette anecdote, et il se crut fondé à lui assurer que ce ne serait qu'en rapprochant les recherches de notre temps, qu'on pourrait parvenir à découvrir la vérité. Ce prince, que le grand Frédéric, son frère, estimait assez pour en être jaloux, jugea cet événement, comme dans ses campagnes il avait jugé la conduite des généraux ennemis, dont il n'aurait pas mieux connu les desseins, quand même il aurait assisté à leurs conseils. Il vit dans les discours des officiers de la Bastille, ce qu'eux-mêmes n'y voyaient pas, parce qu'il y porta ce coup d'œil sûr et perçant, qui, dans la multitude des combats qu'il avait livrés, lui avait toujours assuré la victoire. BLAINVILLIERS.Quoique nous ayons déjà parlé plusieurs fois de Blainvilliers, nous sommes obligés d'y revenir : ce qu'on a dit de lui exige quelqu'éclaircissement. M. de Palteau, en disant que Blainvilliers, officier d'infanterie, avait accès chez M. de Saint-Mars, a voulu faire entendre que, malgré cet accès, il n'avait pas été plus privilégié que les autres, et qu'il avait été obligé d'user de stratagème pour voir le masque de fer à File Ste-Marguerite. Oui, sans cloute, Blainvilliers avait accès chez M. de Saint-Mars : il est même prouvé qu'il avait toute sa confiance ; mais cette confiance n'avait pas passé au successeur de Saint-Mars, et c'est sous ce successeur que le prisonnier inconnu fut déposé à Ille Ste-Marguerite. M. de Palteau ne prit dans le récit de Blainvilliers que ce qui lui convenait. L'époque que lui donna cet officier, plus rapprochée de notre temps, ne s'accordait point avec les époques qu'il avait vues dans les écrits qui avaient paru sur ce sujet, puisqu'elle était postérieure de plusieurs années aux années 1698 et 1703. Il n'en fit aucune mention dans sa lettre à M. Fréron en, 1768. M. de Palteau en usa avec Blainvilliers comme Voltaire en avait usé avec le commissaire Riousse, et Saint-Foix avec Nélaton. Ils ne parlèrent, ni les uns ni les autres, des époques qu'on leur avait données, parce qu'elles étaient opposées à leurs préjugés. Tant il est vrai, comme l'a dit Fontenelle, que, du moment que l'erreur est en possession des esprits-, c'est une merveille si elle ne s'y maintient toujours. Blainvilliers était fils naturel d'un Formanoir, de la même famille que M. de Palteau. Ce fut à ce titre qu'il obtint la lieutenance d'une compagnie franche, qui appartenait à Saint-Mars, et qui suivit ce gouverneur à Pignerol, à Exilles et à Ste-Marguerite. Blainvilliers vieillit lieutenant dans cette même compagnie qui demeura attachée à l'île Ste-Marguerite pour la garde des prisonniers, après le départ de Saint-Mars pour la Bastille. Il prit alors le nom de Formanoir qu'il ne lui avait pas été permis de porter sous les yeux de Saint-Mars ; et c'est sous ce nom que Lagrange-Chancel le connut à l'île Ste-Marguerite vers l'année 1718. C'est entre les mains de ce lieutenant qu'il écrit avoir vu une de ces pincettes d'acier très-luisantes et très-polies, avec lesquelles il était permis au prisonnier inconnu de s'amuser à s'arracher le poil de la barbe. C'est encore sur ces mêmes pincettes d'acier que le père Griffet s'est diverti à plaisanter, du ton le plus sérieux, dans son examen. Mais comment ce Blainvilliers, qui n'était jamais sorti de l'ile Ste-Marguerite, pouvait-il avoir dit à M. de Palteau que l'on avait enterré secrètement le masque de fer à S'-Paul et qu'on avait mis des drogues dans le cercueil pour consumer le corps ? C'est que M. de Palteau mêla et confondit ensemble le récit de Blainvilliers, les bruits populaires, et ce qu'en avait écrit Voltaire dans sa première édition du siècle de Louis XIV. Il est si vrai que M. de Palteau n'avait fait, en quelque sorte, que copier Voltaire, qu'il avait pris dans son récit les années 1699 et 1704, qui ne se trouvaient que dans la première édition du siècle de Louis XIV, au lieu des années 1698 et 1703 du journal de Dujonca. C'est cependant d'après cette lettre de M. de Palteau et d'après toutes les absurdités qu'elle contient que le père Griffet ose nous dire, non pas qu'elle est dictée, mais qu'elle paraît dictée par la vérité même[16]. DU JOURNAL DE DUJONCA, LIEUTENANT DE ROI À LA BASTILLE.Dans tous les ouvrages, qui, depuis 1770, ont paru sur le masque de fer, c'est-à-dire depuis l'examen du père Griffet, les auteurs de ces ouvrages, quel qu'ait été leur système, se sont tous appuyés sur le journal de Dujonca, qui ne fut connu pour la première fois du public, que par cet examen. Ce journal fut pour eux un dogme de foi, auquel ils ramenèrent toujours leur pensée, et d'après lequel ils se crurent obligés de rejeter tous les faits et tous les raisonnements qui se trouvaient en contradiction avec lui. Nous y fûmes longtemps trompés nous-mêmes, ainsi qu'on l'a vu dans la première partie de ce mémoire ; cependant, malgré ce journal, nous avons toujours soutenu que le prisonnier inconnu n'avait jamais été à Pignerol, et depuis nous l'avons prouvé. Quant au journal, lorsque nous fûmes un peu plus instruits, nous nous bornâmes à assurer que les articles concernant le patriarche auraient été infailliblement raturés ou effacés, si cependant le journal lui-même n'était pas en tout une supposition. Nous n'avions guère que des raisons à donner sur cette supposition, et quelque fortes qu'elles fussent ce n'était enfin que des raisons. Le temps, qui dévoile tout, nous a enfin donné une preuve matérielle, telle que nous pouvions la désirer. En 1800, me trouvant à Paris, j'allai à la bibliothèque de l'arsenal, et je demandai à voir le journal de Dujonca. Un bénédictin, employé alors à cette bibliothèque, et qui avait été auparavant bibliothécaire de celle de l'abbaye St-Germain me demanda si je connaissais l'écriture de M. Dujonca ; sur ma réponse, il ajouta que beaucoup de gens pensaient que ce journal avait été fabriqué à dessein, et qu'il n'était pas de M. Dujonca... Je vais rendre compte de mes observations. Le journal consiste en deux volumes assez peu considérables, ou, pour mieux dire, en deux cahiers, puisqu'ils ne sont pas reliés : l'un contient l'entrée, l'autre la sortie des prisonniers de la Bastille. Le 1er cahier est sous le titre suivant : L'état des prisonniers qui sont envoyés par l'ordre du Roi à la Bastille, à commencer du mécrédi hensieme du mois d'octobre, que je suis entré en possession de la charge de lieutenant de Roi, en l'année 1690. Les pages ne sont numérotées qu'au recto de chaque feuillet : au verso du feuillet 37, se trouve l'entrée du masque de fer, telle que nous allons la transcrire, après l'avoir copiée sur l'original : Du jeudi 18e de septembre, à
trois heures après midi, M. de Saint-Mars, gouverneur du château de la
Bastille, est arrivé, pour sa première entrée, venant de son gouvernement des
îles Sainte-Marguerite Honorat, ayant amené avec lui dans sa litière un
ancien prisonnier qu'il avait à Pignerol, lequel il fait tenir toujours
masqué, dont le nom ne se dit pas ; et l'ayant fait mettre, en descendant de
la litière, dans la première chambre de la tour de la Basinière, en attendant
la nuit, pour le mettre et mener moi-même, à 9 heures du soir, avec M. de
Rosarges, un des sergents que Monsieur le gouverneur a menés, dans la
troisième chambre, seul, de la tour de la Bretaudière, que j'avais fait
meubler de toutes choses, quelques jours avant son arrivée, en ayant reçu l'ordre de M. de Saint-Mars, lequel prisonnier
sera servi et sounié par M. de Rosarges, que M. le gouverneur norira. PREUVE SANS RÉPLIQUE DE LA FAUSSETÉ DU JOURNAL DE DUJONCA.Le recto du feuillet 38, qui se trouve à côté du verso dont nous venons de parler, commence par l'indication de l'année 1699, et contient l'article suivant : il est absolument étranger au masque de fer ; mais on va voir que ce n'est pas sans raison qu'on le rapporte. Du jeudi, 1er jour du mois de janvier de l'année 1699. Du dimanche, après midi, 4me du mois de janvier, M. Monie, aide-major de la marine, et commandant pour le Roi dans File de Terre-Neuve et du fort Louis-de-Plaisance, est venu de lui-même se rendre prisonnier, ayant apporté y son ordre du Roi, expédié par M. de Pontchartrain et M. le conte de Morpas. Le second cahier commence par le titre suivant : Etat des prisonniers qui sortent de la Bastille, à commencer du houzièrne du mois d'octobre, que je suis entré en possession en l'année 1690. Jusqu'au 25 juillet 1705, par M. Dujonca lieutenant de Roi. Ces deux dernières lignes sont d'une autre écriture. Au verso du 80me feuillet de ce second cahier, se trouve l'article de la mort et de l'enterrement du prisonnier masqué. Le voici tel qu'il est avec sa note marginale : on s'est attaché à le copier exactement : Du même jour, lundi 19me de
novembre 1703, le prisonnier inconnu, toujours masqué d'un masque de velours
noir, que M. de Saint-Mars gouverneur avait mené avec lui, en venant des îles
Sainte-Marguerite, qu'il gardait depuis longtemps, lequel s'étant trouvé hier
un peu malade, en sortant de la messe, il est mort se jourd'hui, sur les 10
heures du soir, sans avoir eu une grande maladie, il no se peut pas moins. M.
Giraut, notre homonier, le confessa hier ; surpris de sa mort, il n'a point
reçu ses sacrements, et notre homonier l'a exhorté un moment avant que de
mourir, et le prisonnier inconnu, gardé depuis si longtemps, a été enterré le
mardi, à 4 heures de l'après-midi, 20me novembre, dans le semetière
Saint-Paul, notre paroisse, sur le registre mortuel. On a donné un nom aussi
inconnu[17]
que M. de Rosarges major et M. Reil sieurgien qui
hont signé sur le registre. Qui ne verra pas une véritable caricature dans les deux articles qui concernent le masque de-fer, et surtout dans le second ? Le fabricateur du journal, sachant que M. Dujonca écrivait mal et n'orthographiait pas mieux, y charge le tableau. à toute outrance, pour mieux persuader que le journal est réellement de lui. M. Dujonca homme de condition, avait été bien élevé, et avait fréquenté constamment la bonne compagnie. Si une bonne éducation n'empêche pas quelquefois qu'on ait une très-mauvaise orthographe, elle garantit du moins, pour l'ordinaire, d'une diction telle que celle qui se fait remarquer dans le journal qu'on a mis sous son nom. Mais nous ne nous arrêterons pas à la diction du prétendu M. Dujonca. Nous observerons seulement que, quand il affecte de dire dans le second article.... le prisonnier inconnu que M. de Saint-Mars gardait depuis si longtemps, l'intention du faussaire n'est que d'imprimer fortement dans l'esprit de ses lecteurs, conformément à ce qui est établi dans le premier article, ainsi que dans l'examen du père Griffet, que le prisonnier avait été longtemps à Pignerol avant d'avoir été conduit à Sainte-Marguerite et à la Bastille. On observera encore que si, dans le même article, il nomme deux fois avec la même affectation l'aumônier Giraut, qui confessa le prisonnier, et qui ensuite l'exhorta un moment avant que de mourir, c'est par la crainte de faire penser aux jésuites, en nommant le père Riquelet, jésuite, alors confesseur de la Bastille. Nous ne dirons rien de la tour de la Bretaudière, que M. Dujonca aurait dû avoir appris, pendant huit ans, s'appeler la Bertaudière, ni du mot norira, au lieu de nourrira ; de sounié, au lieu de soigné ; de Reil, sieurgien, au lieu de Reilhe, chirurgien ; d'homonier, au lieu d'aumônier ; d'anteremant, au lieu d'enterrement ; de mortuel, au lieu de mortuaire, ni même de conte de Morpas, quoique le lieutenant de roi, en écrivant ce nom, soit censé avoir eu sous les yeux l'ordre du-roi, signé par le comte de Maurepas. La note qu'on lit à la marge de ce même, article 2 est surtout digne de remarque, puisque le lieutenant de roi affecte de faire entendre qu'il ignorait des faits qui étaient connus des derniers valets de la Bastille : tille : il savait à la vérité, le lundi 19 novembre, que l'inconnu avait été enterré à Saint-Paul, le mardi 20, ce qui n'est pas tout-à-fait dans l'ordre des choses ; mais il ignorait encore sous quel nom. Ce ne fut que du depuis, selon son expression, qu'il apprit qu'on l'avait nome M. de Marchiel, etc., et qu'on avait payé 40 fr. d'anteremant. Tant de réflexions sont bien fastidieuses, je le sens ; mais elles m'ont paru nécessaires, pour mieux préparer à la preuve matérielle que j'ai promise. La voici : Conte de Morpas. Quand un officier, soit de terre, soit de mer, était mis à la Bastille, un usage, fondé sur les égards que les ministres avaient les uns pour les autres, voulait que la lettre de cachet fia signée par le ministre de qui cet officier dépendait, comme par celui qui avait la Bastille dans son département. On voit, dans l'article que nous venons de transcrire, que M. Monie, aide-major de la marine, fut envoyé à la Bastille en 1699, et que l'ordre avait été expédié par M. de Pontchartrain et par M. le comte de Maurepas conjointement. M. de Maurepas, par une faveur sans exemple, eut le ministère de la marine, presqu'au sortir de l'enfance, et il est à présumer qu'il l'occupait encore dans le temps où l'on fabriquait le journal de Dujonca[18]. Notre faussaire, qui se montre très- instruit, connaissait parfaitement les usages de la Bastille, et il sentit qu'il lui fallait un ministre de la marine pour signer la lettre de cachet de M. Monie, officiel de marine. Il ne songea, malheureusement pour lui, qu'à M. de Maurepas, qu'il savait avoir eu très-jeune ce département : il supputa mal les temps, ou il ne songea pas à les supputer ; car il fit signer la lettre de cachet par ce ministre, non-seulement avant qu'il fût ministre, mais même avant qu'il fût né, puisque M. de Maurepas ne vint au monde qu'en 1700, et que la lettre de cachet, signée le comte de Maurepas, est de 1699. C'est ainsi qu'un fourbe, avec quelqu'adresse qu'il ourdisse une imposture, laisse presque toujours échapper quelque trait qui sert à la dévoiler. Après une pareille preuve, se trouvera-t-il quelqu'un dans le monde qui puisse révoquer en doute la supposition du journal de Dujonca ? Le père Griffet, dans son examen, fonde toutes ses assertions et tous ses raisonnements sur ce journal, dont la fausseté lui était bien certainement connue ; et peut-être avait-il coopéré lui-même à sa fabrication. Nous avons déjà fait voir, avec la plus grande évidence, dans quel esprit il avait composé ce prétendu examen ; et vu la méthode qu'il a suivie bien fidèlement, il est aisé de sentir que tout ce qu'il assure être faux doit être vrai, et que tout ce qu'il assure être vrai doit être faux. Une chose encore à remarquer, c'est qu'il a inséré ce chef-d'œuvre de fausseté dans un très-bon ouvrage, où il ne devait avoir pour but que la vérité. Il n'inventa le séjour du prisonnier à Pignerol, la date de son entrée à la Bastille en 1698, et celle de sa mort eu 1703, que parce que ce séjour et ces dates devaient naturellement rendre la découverte de ce mystère impossible. Sa colère contre le père Tournemine, sans cause apparente, et à propos de rien ; cette colère, dont la violence présente un problème moral dont nous avons donné la solution, n'eut pour principe qu'un intérêt de corps, qui, pour des religieux, et surtout pour un jésuite, était le plus grand des intérêts. Sa passion le porte à faire un crime au père Tournemine d'un propos très-indifférent- en lui-même, mais qui, -contre son vœu et contre son plan, venait à l'improviste montrer les jésuites sur la scène, Qu'on me permette encore ici une observation, dont il serait facile de tirer quelque connaissance. Le deuxième volume du journal de Dujonca porte, dans son titre, que ce journal ne va que jusqu'à l'année 1705, c'est-à-dire jusqu'au temps à peu près où le patriarche fut réellement enfermé à la. Bastille. C'est encore depuis cette année 1705 jusqu'en 1730, qu'à été mutilé et déchiré le grand livre ou le grand registre de la Bastille. C'est enfin cette même année 1705, qu'un témoin oculaire atteste avoir vu le prisonnier inconnu à la Bastille. Si cette rencontre de l'année 1705, qu'on trouve trois fois, dans trois occasions, qui toutes se rapportent au masque de fer, était de pur hasard et ne signifiait rien, il faudrait du moins convenir qu'elle serait fort singulière. Mais le dernier témoignage dont nous venons de parler, nous ramène à une preuve, dont tout ce qui précède confirme la vérité, et qui elle-même confirme tout ce qui précède. Nous l'avons déjà touchée plusieurs fois ; mais nous n'avons fait, pour ainsi dire, que l'indiquer. Elle exige d'être traitée d'une manière plus claire et plus décisive, afin de ne laisser ni doute, ni incertitude à cet égard. C'est par elle que nous terminerons cet ouvrage. DE CONSTANTIN DE RENNEVILLE ET PREUVE TIRÉE DE SON HISTOIRE, EN FAVEUR DE NOTRE DÉCOUVERTE.Constantin de Renneville fut mis à la Bastille le 16 du
mois de mai 1702. Sorti de sa prison en 1713, après la paix d'Utrecht, et
banni de France à perpétuité, il passa en Hollande et en Angleterre. Pour se
venger de sa longue détention, il se mit d'abord à travailler à l'histoire de
la Bastille, sous le titre de l'Inquisition française[19]. Le 1er volume,
le seul supportable de tous ceux qu'il a donnés, parut en 1716, imprimé à Amsterdam.
M. de Saint-Foix parle de cet ouvrage avec le plus grand Mépris, et ce n'est
pas sans quelque raison : L'auteur, dit-il, y a entassé le vrai et le faux avec l'impudence la plus
outrée, et dans le style le plus grossier. Mais, quoique l'auteur
mérite, à beaucoup d'égards, la manière dont le traite M. de Saint-Foix, il
est des faits, sur lesquels il nous semble qu'il est juste de le croire,
comme s'il disait toujours la vérité. Il prévient lui-même le public qu'il rapporte les faits qu'il a vus, comme les ayant vus,
et que c'est de ceux-là seuls qu'il est garant : mais qu'il n'est pas
responsable de ceux dont on lui a fait le rapport. — Encore une fois, ajoute-t-il, quand j'ai dit j'ai vu, l'on me peut croire, puisque
j'aimerais mieux mourir que d'écrire une fausseté... Et si parmi les faits que je rapporte, comme les ayant
vus, il s'en trouve un seul faux, je consens de passer pour calomniateur, et
comme tel, d'être banni à jamais de la société de tout le genre humain.
C'est à chacun de voir, si c'est d'après cette déclaration que Renneville
doit être jugé. Il raconte, dans la préface de son histoire, qu'en 1705 il vit à la Bastille un prisonnier, dont il ne put jamais parvenir à savoir le nom. Qu'un jour ayant été introduit, par hasard et par méprise, dans une salle où ce prisonnier se trouvait avec les officiers de la Bastille, ils lui firent promptement tourner le dos, ce qui l'empêcha de le voir au visage. Que cet homme était de moyenne taille, portant ses cheveux d'un crêpé noir et fort épais, dont pas un n'était encore mêlé[20]. Renneville ajoute ensuite que ce
prisonnier dont Reilhe, le chirurgien-major, et Ru, le porte-clefs, lui avaient
conté quelque tems après toute l'histoire, avait été d'abord enfermé à l'île Sainte-Marguerite,
d'où M. de Saint-Mars l'avait amené à la Bastille avec des précautions
extraordinaires, pour que personne ne le vît dans la route : et — ce
qui est surtout à remarquer — que le roi l'avait
condamné à une prison perpétuelle à la sollicitation des jésuites. Nous laissons de côté diverses particularités puériles et ridicules, dont ces deux habitants de la Bastille avaient accompagné leur récit. Nous ne nous arrêterons pas davantage aux conjectures non moins absurdes que fait Renneville à cette occasion. Le fait essentiel est qu'il vit, par hasard, à la Bastille, en 1705, le prisonnier inconnu, et que ce prisonnier, d'abord enfermé à l'île Sainte-Marguerite, avait été conduit par M. de Saint-Mars à la Bastille, et qu'il avait été condamné à une prison perpétuelle, à la sollicitation des jésuites. Si Reilhe et Ru lui dirent, quelque temps après, que ce prisonnier avait été mis en liberté, c'est qu'ils étaient assurés qu'à l'avenir on prendrait d'assez bonnes précautions pour que l'accident qui l'avait exposé à être vu n'arrivât pas davantage. D'après la tradition, qui est certainement fausse à quelques égards, il est généralement reçu et établi dans le public, comme une vérité incontestable, que le masque de fer avait été da-bord enfermé à l'île Sainte-Marguerite, que de là on l'avait transféré à la Bastille, et qu'il v avait été conduit par M. de Saint-Mars. D'un autre côté, on est assuré que le patriarche fut d'abord déposé et enfermé à l'île Sainte-Marguerite, que delà il fut transféré à la Bastille, et qu'ayant été enlevé par les jésuites, il fut condamné, par leur crédit, à y passer le reste de ses jours. On demandera donc si l'homme vu par Renneville, et dont il n'a jamais pu savoir le nom, cet homme, qui avait été enfermé d'abord à Sainte-Marguerite, transféré ensuite à la Bastille et qui passait pour y avoir été conduit par M. de Saint-Mars ; qui d'ailleurs avait été condamné à une prison perpétuelle, à la sollicitation des jésuites, ne peut être autre que le patriarche, que le prisonnier inconnu, que le masque de fer. Mais il faut prévenir une objection qu'on ne manquera pas de faire. Le prisonnier inconnu, cura-t-on, fut vu à la Bastille en 1705, et il est prouvé par les dépêches de M. de Fériol, qu'il ne fut enlevé qu'en 1706. Je répondrai à cela deux choses. 1° Que Renneville, à qui les ennuis et les anxiétés de la plus triste captivité durent faire paraître-extrêmement long le temps qui s'était écoulé depuis 1702 jusqu'à 1713, époque de sa liberté, n'ayant parlé du prisonnier en 1716 que de mémoire, par réminiscence et même dans sa préface, il est très-possible qu'il se soit trompé sur le temps précis où il l'avait vu ; et si l'on réfléchit à la nature du cœur humain, on ne devrait pas être étonné s'il eût commis une erreur bien plus forte encore, qu'en mettant 1705 au lieu de 1706. 2° Que le marquis de Bonnac, avec toute la correspondance de M. de Fériol sous les yeux, n'ayant jamais pu savoir au vrai si cet ambassadeur avait eu connaissance de l'enlèvement, et paraissant persuadé, au contraire, qu'il n'en avait été instruit qu'après que l'entreprise eût entièrement réussi, il serait très-possible que M. de Fériol n'en eût écrit à la cour qu'en i7o6 quoique le patriarche eût été enlevé en 1705. D'ailleurs l'identité des deux personnages du patriarche et du masque de fer étant assez démontrée, qu'importe d'où vienne l'erreur ? Tout est possible et rien ne doit surprendre, en songeant à tous les artifices dont les jésuites étaient capables de faire usage dans une affaire qui pouvait décider de leur salut ou de leur destruction dans tonte l'étendue des états du grand seigneur. Que pourrais-je répondre à ceux qui douteraient encore ? Sinon que tout parle à des yeux attentifs ; que tout est indice pour ceux qui savent voir : mais que rien n'est sensible ; que rien n'est clair pour le vulgaire, et même pour le vulgaire prétendu philosophe qu'aveugle le préjugé. J'ai tâché de rendre la vérité de plus en plus palpable ; j'ai augmenté le nombre des probabilités ; j'ai rendu la vraisemblance plus grande : j'ai ajouté lumières sur lumières, en réunissant les faits, en accumulant les preuves. Après cela, je me laisse juger sans inquiétude et sans appel. Mais à quoi servirait la découverte d'une vérité, qu'on a crue de la plus grande importance, et qui dans le fond est très-indifférente, si je n'en tirais pas quelque moralité qui puisse être utile aux rois et à tous les hommes ? Les réflexions du père Griffet m'en fourniront une ; mais ce sera en prenant le contre-pied de sa conduite. PREMIÈRE MORALITÉ.Il fallait que ce jésuite, toujours fidèle au plan qu'il s'était fait de dire en tout le contraire de ce qui était et de ce qu'il pensait, finît comme il avait commencé. Après nous avoir répété que monsieur d'Argenson avait assuré qu'on ne saurait jamais cela, il s'écrie en disant avec sa perfidie ordinaire : tant il est vrai que les secrets des souverains[21] ne sont pas faciles à découvrir quand ils savent et qu'ils veulent user de tout leur pouvoir pour les ensevelir dans un éternel oubli. Jamais il ne se fût permis cette réflexion tournée en forme de sentence, si elle n'eût été une conséquence de la fausseté de sa dissertation, réflexion fausse et détestable, j'ose le dire, puisqu'elle tend à encourager au crime les méchants rois en les délivrant, par l'assurance du secret, de l'unique frein qui peut les contenir. Combien plus vraie, plus juste, plus morale est la maxime contraire, surtout appuyée de notre découverte ! Tremblez, crie-t-elle à tous les rois, tremblez d'être inj estes, tremblez d'être méchants en voyant que vos actions les plus secrètes, lors même que vous avez usé de tout votre pouvoir pour les ensevelir dans un éternel oubli, ne laissent pas de parvenir à la postérité qui s'empresse de flétrir votre mémoire pour venger les malheureuses victimes de vos injustices. DEUXIÈME MORALITÉ.De notre découverte découle naturellement une seconde moralité. Elle nous fait voir, d'après les faux raisonnements de plusieurs hommes, d'ailleurs très-estimables, sur ce problème historique, qu'il n'y a que sottise et extravagance à attendre de la part même des gens les plus sages, lorsque, dans la recherche des causes, ils sont réduits pour tout appui à leur raison et à leurs conjectures. EXTRAIT DE QUELQUES LETTRES MINISTÉRIELLES CONCERNANT LE PATRIARCHE ARWEDICK.Arwedick, ce patriarche hérétique qui nous avait fait tant de mal, est enfin tombé entre mes mains. On doit le porter à Marseille. Je supplie humblement votre majesté d'ordonner qu'il soit emprisonné jusqu'à ce que j'aie rendu compte à votre majesté de toutes ses perfidies et de tous ses crimes. (Lettre de M. de Fériol, ambassadeur de France à Constantinople, du 6 mai 1706 au roi.) Arwedick, le tyran des latins, celui qui trafiquait notre religion avec les Turcs, et qui prêchait dans ses églises qu'il valait mieux se faire turc que romain, ce patriarche arménien qui était abandonné à toute sorte de crimes et d'abominations, après avoir été déposé et envoyé en exil, est enfin tombé entre mes mains. Je l'ai fait passer en France pour y recevoir la punition de ses fautes. Je donnai mes ordres pour ce sujet au sieur Bonnac, vice-consul à Chio, qui les exécuta avec toute la diligence et l'habileté possibles. Il fallut corrompre le chiaoux, qui était chargé de la conduite d'Arwedick, et faire plusieurs autres intrigues qui ont réussi, et Arwedick sera bientôt à Marseille, si le capitaine qui le porte n'est pas pris par les corsaires. Il est important qu'il soit resserré de si près qu'il ne puisse pas écrire en Turquie ; car les Turcs, qui me l'ont déjà demandé, ne manqueraient pas de m'en faire une affaire. J'ai cru ne pouvoir faire une œuvre plus agréable à Dieu, ni rendre un plus grand service à la religion dont il était le persécuteur, qu'en l'éloignant de ce pays. Ses impiétés méritent une bonne pénitence.. Je l'ai adressé à M. de Montmor. (Autre lettre au roi du 1er, juin 1706.) L'affaire d'Arwedick m'a donné beaucoup de peine. Le grand seigneur voulait me rendre responsable de sa personne. J'ai écrit plus de vingt lettres au grand-vizir à ce sujet. Je suis enfin convenu avec lui que je supplierais sa majesté d'écrire au roi d'Espagne de le faire sortir de sa prison de Messine et de lui permettre de retourner à Constantinople. J'ignore si Arwedick est encore à Messine, s'il a été mis dans les prisons du Saint-Office, ou porté en France. Il est très-important pour le repos et le salut des catholiques Arméniens qu'il ne paraisse jamais dans cet empire avec tous les crimes dont il est chargé et qui font horreur. Il a été le persécuteur constant et inexorable de la catholicité, et il a dit plusieurs fois qu'il portait sa corde dans son sein, et qu'il ne craignait pas la mort, s'il pouvait perdre auparavant tous les catholiques. (Lettre de M. de Fériol à M. de Torcy, du septembre 1706.) Le grand-vizir m'a dit qu'il
comptait sur la parole que je lui ai donnée que je supplierais sa majesté de
demander Arwedick au roi d'Espagne et de le renvoyer à Constantinople. J'ai répondu
que j'écrirais par le premier vaisseau, et que je ne doutais pas que le dit Arwedick
ne fût envoyé, si dans l'intervalle le roi d'Espagne était encore maitre des
royaumes de Naples et de Sicile. Il me dit en riant qu'il n'en fallait pas.
douter et que je ne devais pas me servir de cette défaite pour le retour d'Arwedick,
que le grand seigneur désirait..... mais il
est très-important qu'Arwedick ne revienne plus à Constantinople, pour le
repos de la religion. (Autre à M. de
Torcy, du 16 septembre 1706.) Il vous est impossible, comme vous le savez d'ailleurs, de satisfaire aux demandes du grand vizir au sujet d'Arwedick. Il n'est plus en état qu'on puisse l'envoyer vivant à Constantinople, ainsi c'est une affaire finie. (Lettre de M. de Torcy à M. Fériol, du 15 février 1707.) J'ai reçu votre lettre du 18 de
ce mois avec l'extrait de celle de M. le cardinal de la Trémouille, sur les
instances qui lui ont été faites par les congrégations du Saint-Office et de
la Propagande, et en ai rendu compte au roi..... Sa majesté m'a commandé de vous expliquer qu'il était
difficile de le garder avec plus de soin. Il n'est vu que par celui qui lui
sert à manger ; ils ne s'entendent que par signes, et on le met dans un
endroit séparé lorsqu'il entend la messe les fêtes et dimanches ; mais je
crois que vous jugerez à propos, en répondant à M. le cardinal de la
Trémouille, de lui marquer qu'il ne doit pas dire qu'il soit en France.
Quoiqu'on le présume à Constantinople, l'on n'en est pas certain. Si on
l'était, l'ambassadeur du roi pour lequel le grand vizir n'a pas conservé
beaucoup d'égards pourrait en souffrir..... Il
est venu des Arméniens à Malte, à Messine et même à Marseille, qui
n'ont pu en avoir des nouvelles, et actuellement on m'écrit que son valet[22] est parti de Ligourne pour le chercher, et qu'il doit
passer à Marseille. Le roi a donné ordre à M. de Montmor de le faire arrêter
aussitôt son arrivée, et mettre dans un cachot où il ne puisse être vu ni
communiquer avec personne. (Lettre de
M. de Pontchartrain à M. de Torcy, du 31 août 1708.) On reprocha à M. de Fériol les embarras dans lesquels il avait jeté le gouvernement par l'enlèvement d'Arwedick ; la lettre suivante contient pour toute excuse une longue énumération des crimes et des vices de cet infortuné. Arwedick, dit-il[23], était reconnu pour magicien, pour sodomite, etc., etc. Il avait fait donner au grand seigneur des kattcherifs contre nos missions ; d'ailleurs c'était un homme ne tenant à rien, sorti de la lie du peuple, comme tous ceux qui parviennent à ces sortes de places, et si méprisé par les Turcs eux-mêmes qu'il l'est pas un des derniers valets de l'ambassade qui n'eût dédaigné de se comparer avec lui. Je n'aurais donc jamais cru qu'on eût pu donner tant d'importance à cette affaire. (Lettre de M. de Fériol à M. de Torcy, du 6 janvier 1709.) Le grand vizir dit, il y a dix jours, à l'interprète, sans répondre à la demande que faisait M. de Fériol d'une audience, que M. de Fériol eût à faire revenir le nommé Arwedick, arménien ; qu'il avait appris qu'il était dans sa maison, et qu'il le voulait absolument[24]. Le vizir m'en fit aussi parler : je répondis que je n'avais aucune connaissance de cette affaire. La Porte ne peut, à ce qu'il me paraît, oublier cet enlèvement. (Lettre de M. Desaleurs ambassadeur de France à Constantinople, à M. de Torcy, 16 juin 1710.) On a voulu réveiller cette affaire et envoyer en France pour le redemander. J'ai entièrement assoupi ce dessein par le moyen du patriarche arménien avec lequel je me suis joint contre l'ancien patriarche, qui veut toujours remuer cette affaire, quoiqu'il soit exilé sur la mer Noire. J'espère qu'on n'entendra plus parler de lui ni d'Arwedick. (Lettre de M. Desaleurs à M. de Torcy, du 1er août 1713.) FIN DE L'OUVRAGE |