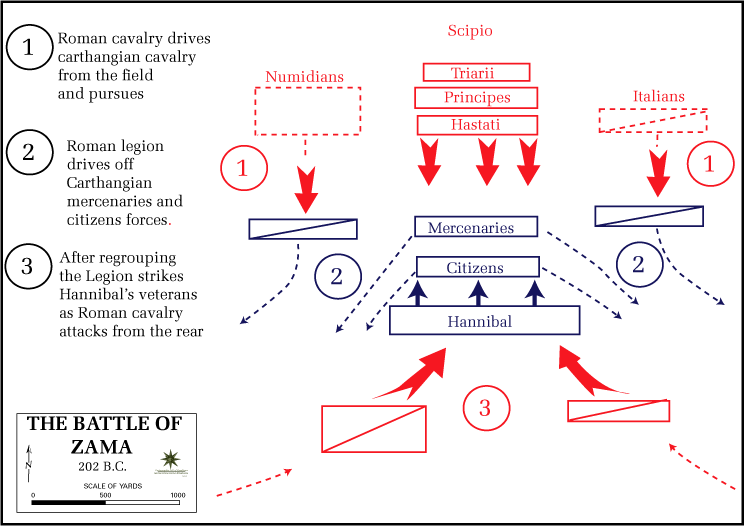HISTOIRE DE CARTHAGE
CHAPITRE QUATRIÈME
|
SECONDE GUERRE PUNIQUE Dans la première guerre punique Rome et Carthage s’étaient étudiées réciproquement ; elles avaient essayé leurs forces. Dans la seconde, elles se connaissaient parfaitement et se détestaient davantage. La jalousie causa la première, et la haine la seconde. On avait d’abord pris les armes pour se disputer la palme de la gloire la liberté, des mers et quelques possessions ; on se battit ensuite pour se détruire. Les vainqueurs ignorent toujours la nécessité de la modération ; ils oublient que toute paix humiliante est un affront dont on veut se venger, une trêve trompeuse qu’on cherche à rompre, et que le désespoir d’un ennemi opprimé, prépare souvent les plus grands périls à celui qui l’a injustement abaissé. Carthage regrettait
Ce grand capitaine, formant son fils par ses leçons et par ses exemples, conquit en peu de temps par la force des armes toute la partie de l’Espagne, située entre la mer et l’Èbre, et la soumit totalement à son pays par la douceur de son administration. Après, de longs succès, il trouva une mort digne de sa vie, et périt glorieusement dans une bataille qui le couronna pour la dernière fois des palmes de la victoire. Asdrubal, son gendre, lui succéda ; et, pour assurer ses conquêtes, il bâtit sur la côte méridionale la nouvelle Carthage, appelée aujourd’hui Carthagène, qui devint, par sa position et par son commerce, une des plus importantes villes de l’Europe. Rome voyait ces progrès d’un œil jaloux : elle aurait pris les armes pour enlever la péninsule à sa rivale ; mais la crainte des Gaulois qui la menaçaient l’arrêta. Elle négocia au lieu de combattre, se contenta de limiter des conquêtes qu’elle n’osait ravir, et conclut avec Asdrubal un traité qui défendait aux Carthaginois de s’avancer au-delà de l’Èbre. Asdrubal poursuivant ses succès, subjugua tous les peuples qui se trouvaient entre la mer et le fleuve. Après huit ans de victoires, il périt assassiné par un Gaulois[1]. Trois ans avant sa mort, il avait demandé qu’on lui envoyât son beau-frère Annibal, alors âgé de vingt-deux ans. Dans ce temps, l’oligarchie dominait à Carthage ; les familles d’Hannon, d’Imilcon, de Magon, de Bomilcar, d’Adherbal, d’Amilcar, d’Asdrubal, y jouissaient du plus grand crédit. Cette oligarchie se divisait en deux factions ; celle d’Amilcar et d’Annibal se nommait la faction Barcine ; l’autre avait pour chef Hannon. La première était ambitieuse, la seconde pacifique. Les exploits d’Amilcar et d’Asdrubal donnaient beaucoup d’éclat à leur parti qui projeta sans cesse de nouvelles conquêtes. Celui d’Hannon voulait consolider la puissance de Carthage par la paix et l’étendre par le commerce, et il s’opposa au départ d’Annibal pour l’Espagne : Hannon représenta vivement au sénat le danger de confier l’armée à un jeune homme impétueux comme Pyrrhus, impérieux comme son père, et qui avait juré, au sein de la paix, une guerre éternelle à Rome. Il regardait ce génie bouillant comme une étincelle ardente, qui devait bientôt causer un vaste incendie. Malgré ces remontrances, la faction Barcine l’emporta, Annibal partit pour l’Espagne. Les soldats, charmés, crurent revoir le grand Amilcar ; ils retrouvèrent en lui les mêmes traits, la même vigueur, la même intrépidité, la même présence d’esprit un génie plus vaste, un talent fécond et souple, énergique et artificieux, propre à triompher également par l’audace et par la ruse. Il fit avec distinction trois campagnes sous Asdrubal ; après la mort de ce général, le peuple et l’armée, malgré l’opposition de ses rivaux, lui déférèrent le commandement[2]. (Cornélius Nepos assure même que, sans considérer sa jeunesse, on le nomma suffète ou roi.) Parvenu à ce poste, l’Italie fut constamment le but de ses pensées secrètes. Il conquit plusieurs villes en Espagne ; son ambition excita la crainte de tous les peuples de cette contrée. Ils se liguèrent contre lui, et opposèrent à sa valeur une armée de cent mille hommes. Malgré l’infériorité du nombre de osés troupes, il défit les ennemis en bataille rangée, et mit tous ses soins, après la victoire, à se concilier, par les faveurs et de grandes largesses, les citoyens, les alliés et les peuples conquis, voulant assurer, par cette sage politique, l’exécution tranquille de ses grands desseins. Le traité conclu avec Rome ne pouvait arrêter ce génie ambitieux, qui ne cherchait que l’occasion de le rompre. Il forma audacieusement le siége de Sagonte, place située au-delà de l’Èbre. Les Sagontins invoquèrent la protection de Rome. Elle envoya sur-le-champ des députés pour s’opposer à cette infraction de la paix. Annibal refusa de les entendre ; ils ne furent pas mieux accueillis à Carthage, malgré les remontrances d’Hannon qui s’efforça vainement de faire sentir l’injustice, et le danger d’une pareille agression. Sagonte, redite à l’extrémité, capitula : mais Annibal proposa des conditions si humiliantes que les sénateurs préférèrent la mort à la honte de les accepter. Ne consultant que leur désespoir, ils dressèrent un bûcher sur la place publique, y jetèrent leurs richesses, le trésor de l’état, et se précipitèrent dans les flammes qui se communiquèrent rapidement à toute la ville. Au même instant, une tour battue par les béliers d’Annibal, s’écroule, les Carthaginois entrent par la brèche, s’emparent de la ville, égorgent tous ceux qui portaient les armes, et dérobent à l’incendie un immense butin. Annibal ne s’en réserva rien ; mais il s’en servit habilement pour animer l’ardeur du soldat, et pour augmenter la force de sa faction dans Carthage. La nouvelle de ce désastre, répandit la consternation à Rome. L’indignation d’une attaque si audacieuse, au mépris des traités, la honte d’avoir laissé périr sans secours des alliés fidèles, la crainte du génie et des projets d’Annibal, réveillent, avec fureur, l’antique haine. Le peuple s’émeut, accourt sur la place, le sénat s’assemble ; les harangues les plus violentes se font entendre, et l’on décide unanimement le prompt départ d’ambassadeurs, chargés de demander formellement à Carthage si la ruine de Sagonte a été ordonnée par elle, et d’exiger pour réparation, qu’on livrât Annibal aux Romains. Le sénat de Carthage, voulant, suivant sa coutume, prendre des délais, répondre vaguement à des plaintes positives, et opposer la ruse punique à la fierté romaine. Fabius, ambassadeur de Rome montrant alors un pan de sa robe qu’il tenait plié dans ses mains : Je porte ici, dit-il, la paix ou la guerre, choisissez. — Choisissez vous même, lui répondit-on. — Je vous déclare donc la guerre, reprit-il en secouant sa toge, et elle sera terrible. — Nous l’acceptons de bon cœur, et la ferons de même, s’écrièrent tous les sénateurs. C’est ainsi que fut rompue la paix, l’an du monde 3787, avant Jésus-Christ, 217, l’an de Rome 531 et de Carthage 629. Elle avait duré vingt-quatre ans ; Annibal avait alors vingt-six ans. Avant de suivre le vaste projet dont ce grand capitaine méditait le plan depuis sa plus tendre jeunesse, il fit passer en Afrique les soldats espagnols qui se trouvaient dans son armée, et appela en Espagne ceux d’Afrique, espérant que loin de leur patrie, ils seraient plus soumis. Par ses ordres, quarante mille hommes gardèrent l’Afrique ; quinze mille, les provinces d’Espagne ; soixante vaisseaux protégèrent les côtes. Il offrit à Cadix un sacrifice à Hercule, et ensuite marcha pour mettre fin à l’entreprise la plus audacieuse qu’un mortel eût jamais conçue, celle de traverser l’Espagne, les Gaules et de franchir les Alpes pour envahir l’Italie.
Les trois possibilités du passage des Alpes par Annibal Il partit de Carthagène éloignée de l’Èbre de cent dix lieues. Son armée se composait de cent mille hommes d’infanterie, de douze mille de cavalerie et de quarante éléphants. Il battit tous les peuples et conquit tous les pays au-delà de l’Èbre jusqu’à Emporium, petite ville maritime près des Pyrénées, qui sépare l’Espagne des Gaules, et se trouve distante de l’Èbre de quatre-vingts lieues. Il laissa Hannon avec onze mille hommes dans cette partie de l’Espagne qu’il venait de soumettre. Franchissant ensuite les Pyrénées, il s’avança sur lé Rhône avec cinquante mille hommes de pied, neuf mille chevaux et seize éléphants. Les Gaulois, postés sur l’autre rive du fleuve, lui en disputaient le passage. Annibal, informé de leurs desseins, avait envoyé, deux jours avant, Hannon, fils de Bomilcar, avec un corps de troupes chargé de traverser le Rhône un peu plus haut et dans un endroit moins gardé. Son ordre fut exécuté. Alors il se présenta sur la rive du fleuve. Les uns le passaient sur des barques, les autres à la nage, l’infanterie sur des radeaux, ou dans quelques troncs d’arbres creusés ; plusieurs grands bateaux, rangés et liés, rompaient le courant. Les Gaulois, placés sur l’autre rive, poussaient des cris, frappaient leurs boucliers, lançaient de grands traits, et s’animaient mutuellement au combat. Mais, tout à coup, ils aperçoivent sur le haut des montagnes un corps ennemi, celui d’Hannon, qui brûle leur camp et marche sur eux. Attaqués en tête et en queue, ils se troublent, se découragent et prennent la fuite. Délivrée de tout obstacle, l’armée d’Annibal passe tranquillement le fleuve ; les éléphants le traversent ensuite sur de grands radeaux qu’on avait couverts de terre, pour que ces’ animaux ne s’aperçussent pas qu’ils quittaient le rivage. Pendant ce temps, les deux consuls Scipion et Sempronius
étaient partis avec deux armées, destinées l’une pour l’Espagne et l’autre pour
Annibal détacha cinq cents Numides au-devant d’eux : ces deux troupes, se livrèrent un combat opiniâtre et sanglant. Les Romains perdirent la moitié des leurs, mais forcèrent les Numides à fuir. Cette action, regardée comme un présage de l’issue de la guerre, annonçait, suivant les augures, qu’elle serait favorable aux Romains, après avoir coûté beaucoup de sang. Sur ces entrefaites, Annibal reçut une ambassade des
Gaulois établis sur la rive du Pô. Ils lui promettaient des vivres et des
secours, contre les Romains. Ce grand capitaine, voulant suivre sans obstacle
ses desseins, s’éleva un peu vers le nord, et, s’éloignant de la mer afin d’éviter
la rencontre de Scipion, traversa Scipion n’arriva sur le Rhône que trois jours après le passage des Carthaginois. Désespérant, alors d’atteindre l’ennemi, il retourna à Marseille, envoya son frère avec la plus grande partie de ses troupes en Espagne, et partit lui-même pour Gènes dans le dessein d’opposer l’armée romaine, qui se trouvait sur les rives du Pô, à celle d’Annibal lorsqu’elle descendrait les Alpes. Celui-ci traversa le pays des Allobroges, où l’on voit aujourd’hui Genève, Vienne et Grenoble, il y trouva les peuples divisés, les pacifia, leur donna des vivres pour s’assurer leur amitié, et s’avança au pied des Alpes. Là son génie eut à triompher de nouveaux obstacles. Ces monts escarpés ne lui offraient aucune route. Forcé de suivre des sentiers étroits et glissants, bordés de précipices, il voyait sans cesse des abîmes sous ses pieds, et sur les hauteurs, de belliqueux montagnards qui s’opposaient à son passage. L’intrépide Annibal dompte à la fois la nature et l’ennemi ; et, après avoir perdu un grand nombre d’hommes et de chevaux, écrasés par les rochers qu’on roulait sur eux, ou tombés dans les précipices, il s’empare d’une forteresse, et y trouve des provisions qui rendent le courage et l’espoir à ses troupes exténuées de fatigue. Continuant sa marche, et trompé par la perfidie de ses guides, il se voit attaqué dans un défilé étroit, et se tire de ce nouveau péril par des prodiges de valeur. Enfin, après neuf jours d’efforts surnaturels et de combats sans cesse renouvelés, il atteint le sommet des Alpes, et s’y repose deux jours. Une neige abondante, tombant alors sur les montagnes, porte dans l’esprit des soldats le découragement et l’effroi : Annibal les ranime en montrant à leurs yeux les plaines de la riche Italie, et en flattant leur avidité par l’espoir du pillage de Rome. Le soldat rassuré reprend ses armes ; la soif de l’or lui fait oublier tous les périls ; mais la glace rendait les sentiers presque impraticables, la neige, couvrant les précipices, engloutissait sous sa surface trompeuse les hommes et les animaux : d’immenses éboulements de terre écrasaient des cohortes entières. Annibal, que rien ne pouvait décourager, creuse avec le fer et le feu des chemins dans le rocher. Quelques historiens ajoutent fabuleusement qu’après avoir fait rougir le roc, il y jetait du vinaigre pour le fondre. Les actions de ce grand homme n’avaient pas besoin d’exagération pour être regardées comme des prodiges. L’armée descendit enfin dans une plaine fertile, qui consola bientôt le soldat de ses travaux et de ses dangers. Malgré ses premiers succès, Annibal dut prévoir alors toutes les difficultés, que présentait une invasion, dont son ambition ne lui avait montré d’abord que la gloire. Sorti de l’Espagne avec près de soixante mille combattants, il ne lui restait plus que douze mille Africains, huit mille Espagnols et six mille chevaux (ainsi qu’il l’inscrivit lui-même sur une colonne) et cependant il n’avait pas encore combattu les Romains. Tel est le danger de toute guerre portée dans des pays lointains ; plus on avance, plus on s’affaiblit, et chaque succès n’est souvent qu’un pas de plus vers une ruine totale. La marche des Carthaginois durait depuis six mois ; ils
avaient employé quinze jours à franchir les Alpes ; le mois de septembre
était arrivé. Annibal croyait trouver des alliés à Turin ; ces peuples
refusèrent de s’associer à ses projets. Pour les punir de ce refus, il s’empara
de leur ville, passa les habitants au fil de l’épée, et s’avança sur le
Tésin. La rapidité de sa marche étonna Rome, vaincue pour la première fois en
audace et en ambition. Sempronius
reçut l’ordre de quitter Cependant Scipion passe le Tésin ; Annibal, à la tête de son armée, offre un sacrifice Jupiter, fend la tête à un agneau avec une pierre tranchante et se` voue au même sort s’il ne parvient pas à faire jouir ses soldats des biens qu’il leur a promis, le signal est donné ; les deux armées, animées par une vieille haine, fondent avec furie l’une sur l’autre. L’infanterie romaine résiste d’abord avec succès aux archers et à la cavalerie pesante de Carthage ; mais les Numides, ayant enfoncé la cavalerie ennemie, tombent sur les légions qui, se trouvant attaquées de tous côtés, se retirent au-delà du Tésin, passent le Pô, et rompent les ponts. Le consul Scipion, blessé dans le combat et entouré, fut délivré par la vaillance de son fils, âgé, alors de dix-sept ans, et qui mérita, dans la suite en terminant glorieusement cette guerre, le surnom d’Africain. La victoire donne toujours des alliés. Tous les Gaulois établis
en Italie embrassèrent la cause d’Annibal. Sempronius revenu de Sicile avec ses
troupes, marcha vers Scipion voulait qu’on évitât le combat, afin d’exercer les nouvelles levées et de fatiguer l’inconstance des Gaulois ; mais Sempronius, plus présomptueux qu’habile, accusa cette prudence de timidité, et voulut en venir aux mains : c’était ce que désirait Annibal ; il disait souvent que dans les entreprises extraordinaires et les guerres d’invasion, il faut toujours soutenir le courage des troupes et l’espoir des alliés par de nouveau exploits. Après avoir placé Magon et deux mille hommes en embuscade
dans une prairie couverte d’arbres, sur les bords d’un petit ruisseau, il fit
passer L’année suivante, la fortune devint plus favorable aux Romains. Leurs armes furent victorieuses en Espagne ; Scipion y battit Hannon, le fit prisonnier, et conquit tout le pays, jusqu’à l’Èbre. Annibal prit la route de L’année d’après, Flaminius et Servilius, nouveaux consuls, rassemblèrent leurs armées à Arétium en Toscane. Annibal marcha contre eux, et, pour les joindre plus promptement, il traversa un pays marécageux, dont l’air infect fit périr beaucoup de soldats il y perdit lui-même un œil. Rome, dans sa haine et peu scrupuleuse sur les moyens de vengeance, envoya plus d’une fois dans le camp carthaginois des émissaires chargés de trancher les jours de leur redoutable adversaire. Loin de sa patrie et entouré d’ennemis et d’assassins, il s’était fait faire de faux cheveux, des costumes de tout âge et de toute profession, et changeait si fréquemment de déguisement, que ses amis mêmes pouvaient à peine le reconnaître. Ainsi ce capitaine ambitieux, qui voulait remplir l’univers de son nom, se voyait forcé, par la crainte de la mort, à se cacher dans son propre camp ; tant les hommes se trompent sur le bonheur qu’ils croient attaché à la puissance et à la gloire. Arrivé près d’Arétium, il étudia le caractère de Flaminius avant de se mesurer avec lui. Ayant bientôt reconnu qu’il était téméraire et avide de succès, il pilla le plat pays afin de lui faire quitter une forte position qu’il occupait. Ses premières tentatives ne réussissant point, il feignit de s’avancer vers Rome, avant Crotone à sa gauche et le lac Trasimène à sa droite. Bientôt on lui apprit que le consul le suivait[3] : alors, après avoir traversé un vallon étroit, et posté des embuscades à l’entrée et sur les côtés de ce défilé, il se campa lui-même à l’autre extrémité sur une haute colline. L’ardent Flaminius entra témérairement dans ce vallon sans envoyer d’éclaireurs pour le fouiller. Les Africains fondent de tous côtés sur les Romains ; Flaminius s’efforce en vain de rétablir l’ordre. Son intrépidité se communique à ses soldats ; ils combattent avec courage, mais en confusion. Malgré leur désavantage, ils résistèrent longtemps ; enfin, Flaminius tombant sous les coups d’un Gaulois, les Romains prennent la fuite, et trouvent la sortie du défilé gardée par l’ennemi. Dix mille hommes, renversant cet obstacle, se sauvèrent à Rome, six mille furent pris et quinze mille tués. Dans cette victoire, qu’Annibal dut à son habileté, il ne perdit que quinze cents soldats. Carthage triompha de cette journée, et Rome tomba dans la consternation, lorsque le préteur, du haut de la tribune, prononça tristement ces mots : Citoyens, nous venons de perdre une grande bataille. Le sénat eut alors recours au moyen extrême que la république prenait dans les grandes calamités : il nomma Fabius dictateur, et Minutius général de la cavalerie. Annibal ne crut pas qu’il fût encore temps de s’approcher
de Rome. Il ravagea les campagnes de l’Ombrie, et jusqu’à Fabius éclairé par les fautes de ses prédécesseurs, et plus habile qu’eux, suivait les mouvements de l’ennemi sans se compromettre, et le harcelait continuellement, sans risquer de combat décisif. Lorsque Annibal, tourmenté par ses manœuvres, voulait l’attaquer, il trouvait toujours, Fabius retranché dans une forte position, et le provoquait en vain. Ce sage Romain savait, que dans les guerres d’invasion, le pays attaqué gagne tout quand il peut gagner du temps. Annibal se moquait hautement de sa pusillanimité : mais il admirait en secret cette habile temporisation, et sentait qu’il avait trouvé un rival, digne de lui. Fabius, prévoyant qu’Annibal, à son retour de Campanie, passerait par le vallon de Casilin, qui, séparait le territoire de Falerne de celui de Capoue, embusqua quatre mille hommes qui gardaient le seul défilé par où l’ennemi pouvait sortir. Il se porta ensuite avec l’armée, suivant son usage, sur les hauteurs. Annibal tomba dans le piège et se trouva enveloppé de toutes parts. Privé de vivres, environné d’ennemis inattaquables,
n’apercevant aucun moyen de retraite, sa ruine semblait inévitable ; un
artifice le sauva. Il rassembla de mille bœufs, attacha à leurs cornes des
faisceaux de sarment, y mit le feu, et les poussa à grands coups, pendant la
nuit, vers le sommet des montagnes. Ces animaux furieux, se dispersant des
tous côtés, et répandant partout la flamme, firent croire aux quatre mille
hommes qui gardaient le défilé que l’armée romaine était attaquée sur les
hauteurs. Ils quittèrent leur poste, et volèrent au secours des légions. Annibal
alors, trouvant le passage libre, hâta sa marche, et sortit sans perte de
cette position qui devait être son tombeau. Il reprit ensuite le chemin de Peu de temps après, Fabius rappelé à Rome par le sénat, recommanda, à Minutius de ne point hasarder de combat pendant son absence. Celui-ci n’obéit pas : ayant appris que la cavalerie carthaginoise se trouvait dispersée pour rassembler des vivres et des fourrages, il l’attaqua vivement, la battit et, fit beaucoup de prisonniers. Cet avantage enfla son orgueil et lui valut la faveur du peuple romain, avide d’évènements, affamé de combats et fatigué des lenteurs de Fabius. Quand le dictateur revint à l’armée, Minutius, fort du vœu du peuple, exigea avec hauteur que le commandement fût partagé entre eux et par jour. Fabius aima mieux partager les troupes et lui en confia la moitié. Annibal, informé du peu de concorde qui existait entre les généraux et du partage de leurs forces, tendit un piège à la témérité de Minutius ; il l’attira par ses manœuvres près d’une colline derrière laquelle il avait placé une forte infanterie. Lorsqu’il le vit assez engagé, il l’attaqua en tête et en flanc, et se vit au moment de l’exterminer ; mais Fabius, apercevant les premiers fuyards, dit à sa légion. Sauvons l’imprudent Minutius, arrachons à l’ennemi la victoire et à Rome l’aveu de sa faute. Il fondit sur Annibal, et le força de se retirer. Celui-ci dit alors : Je savais bien que cette sombre nuée qui se tenait depuis si longtemps sur les montagnes crèverait enfin et nous amènerait un grand orage. Cette même année, Cnéius Scipion défit la flotte d’Amilcar et lui prit vingt-cinq vaisseaux. Il se joignit ensuite à son frère en Espagne, passa l’Èbre, se rendit maître de Sagonte par trahison, et en tira les enfants des familles les plus distinguées d’Espagne ; qu’Annibal y faisait garder en otages pour s’assurer la soumission des peuples de cette contrée. L’année suivante, Roméo élut pour consuls Térentius Varron et Paul Émile. Jamais on n’avait levé que quatre légions ; dans ce danger extrême, les Romains en formèrent huit, de cinq mille hommes chacune ; ce qui, joint avec les alliés, composa la plus forte armée qu’eût encore mise sur pied la république. Varron, fier de ses forces et rempli de présomption, avait déclaré hautement que la guerre ne finirait pas tant qu’on placerait des hommes timides comme Fabius à la tête des armées, mais que pour lui il combattrait sans hésiter l’ennemi, dès qu’il le verrait. Cette ardeur plaisait au peuple et lui attira sa faveur. Son début sembla réaliser ses promesses ; dans un premier combat, il tua quinze cents Carthaginois. Annibal, qui manquait alors de vivres, avait besoin d’une victoire, les Espagnols parlaient déjà de l’abandonner, tout délai lui aurait été funeste. Il regarda comme un gain la perte qu’il venait d’éprouver, prévoyant qu’il redoublerait l’aveugle confiance du consul et le déciderait à lui livrer promptement bataille. Les deux armées se trouvèrent bientôt en présence près de Cannes, sur les bords du fleuve Aufide[4]. Annibal occupait une plaine vaste et propre au déploiement de sa nombreuse cavalerie. Émilius voulait attirer l’ennemi dans un terrain plus favorable à l’infanterie Varron, présomptueux comme tous les malhabiles, n’adopta point son avis, et, dès que le jour où il devait commander fut arrivé, il donna le signal du combat. Annibal harangua ses troupes. Enfin, dit-il, j’ai réduit les Romains à combattre ; compagnons, souvenez-vous de vos exploits. Trois victoires vous ont soumis les plaines d’Italie ; celle-ci va vous rendre maîtres de ses villes, de ses trésors, des richesses et de la puissance de Rome. C’est assez parlé, il faut agir. Les dieux annoncent que toutes mes promesses vont être accomplies. L’armée romaine comptait quatre-vingt-six mille combattants, et les Carthaginois cinquante mille. Émilius commandait la droite, Varron la gauche, Servilius le centre. Annibal s’était placé de manière que le vent soufflait contre les Romains et les aveuglait de poussière. La rivière appuyait son aile gauche, l’infanterie espagnole et gauloise formait son centre ; les cohortes africaines se partageaient sur les ailes et soutenaient la cavalerie qui s’y trouvait. Annibal commença l’attaque avec les Espagnols et les Gaulois, s’étendant en avant ses ailes et tenant en arrière ses Africains, de sorte que son armée formait un demi cercle. Les légions romaines, voyant leur centre attaqué se resserrèrent pour opposer une masse à l’ennemi. Annibal, cédant peu à peu, se retira et fut vivement poursuivi par les légions. Lorsqu’il vit l’armée romaine suffisamment engagée, il la fit attaquer en flanc par ses deux ailes et par ses Africains. Les Romains, obligés de faire face de tous côtés, ne purent reprendre leur ordre de bataille. Chargés de toutes parts et enfoncés, ils furent taillés en pièces. Émilius, couvert de blessures, périt dans la mêlée ; deux questeurs, vingt et un tribuns militaires, Servilius, Minutius, et quatre-vingt sénateurs, furent Tués ; plus de soixante-dix mille hommes restèrent sur le champ de bataille ; enfin Annibal, rassasié de ce carnage, cria d’épargner les vaincus. Dix mille hommes, qui occupaient le camp romain, se rendirent prisonniers. Le consul Varron se sauva à Vénouze avec soixante-dix cavaliers. Quatre mille Romains échappèrent seuls à la mort par la fuite. La perte d’Annibal ne monta pas à plus de six mille hommes. Maherbal, l’un de ses généraux, voulait qu’il, marchât droit à Rome, et, ne pouvant l’y déterminer, il lui dit : Annibal, vous savez vaincre, mais vous ne savez pas profiter de la victoire. Tous les historiens, excepté Polybe, lui reprochent cette faute. C’est juger légèrement un grand homme, et le silence de l’historien grec à cet égard paraît plus sage. Il ne restait pas à Annibal trente mille combattants ; Rogne était furie et peuplée de héros, et pendant un long siéger les légions d’Espagne pouvaient revenir et accabler les assiégeants, Annibal devait attendre et espérer des renforts de Carthage. Cependant, à l’époque de ses revers, il regretta lui-même de n’avoir pas suivi le conseil hasardeux de Maherbal, estimant, peut-être alors qu’il eût été plus glorieux pour lui de périr devant les remparts de Rome que d’être vaincu sous les murs de Carthage. Après sa victoire, il envoya en Afrique frère Magon qui répandit au milieu du sénat un boisseau d’anneaux d’or, enlevés aux chevaliers tués à Cannes, Aucune phrase éloquente n’aurait pu donner une idée aussi grande et aussi complète de son triomphe. Imilcon, partisan zélé de la faction Barcine, profita de ce grand succès pour se permettre des railleries amères contre Hannon et ses amis qui s’étaient constamment opposés à la guerre. Hannon, sans se déconcerter, répondit : Je préfèrerai toujours une paix solide à une gloire ruineuse. Annibal se vante d’avoir taillé les Romains en pièces, et pourtant nous devons lever une nouvelle armée pour les combattre. Il livre au pillage les villes d’Italie, et nous demande des blés et de l’argent : que ferait-il donc s’il était vaincu ? Il conclut par refuser tout secours. Malgré lui, on ordonna la levée de trente mille hommes. Les intrigues de sa faction firent différer l’exécution de ce décret. Dès lors on dût prévoir la ruine de Carthage. Avant de commencer la guerre, les sages peuvent s’y opposer ; mais, dès qu’elle est déclarée, soit qu’on la trouve juste ou injuste, il ne doit plus exister qu’une volonté. Chaque citoyen se doit tout entier à sa patrie. C’est ainsi qu’on pensait à Rome : elle fut sauvée, et la désunion perdit Carthage. Les peuples de Au reste, la cause la plus évidente de la chute d’Annibal fut le manque de tout secours de sa patrie ; et le sort, comme il arrive souvent, se joua de sa prévoyance et de son habileté. Carthage, malgré les progrès des Romains en Espagne, donna l’ordre à Asdrubal de joindre en Italie, avec une armée, son frère Annibal. Mais les deux Scipion le poursuivirent dans sa marche, le forcèrent à combattre, le défirent et le mirent hors d’état d’exécuter son projet. Les armes africaines n’eurent pas plus de succès eu Sicile ; et la victoire demeura, dans cette contrée, fidèle aux aigles romaines. Annibal, dont les forces diminuaient chaque jour, ne pouvait plus faire aucune action d’éclat. En vain son génie actif cherchait une occasion favorable pour ranimer la confiance des siens par de nouveaux exploits. Le consul Marcellus, adoptant le sage système de Fabius surnommé le Temporiseur, observait et harcelait constamment l’ennemi sans hasarder de bataille. L’armée romaine renforcée de nouvelles levées, forma le siège de Capoue, et fortifia si bien son camp, qu’Annibal ne put jamais la contraindre ni à combattre ni à lever le siège. Alors ce grand homme, tentant un dernier moyen pour tirer l’ennemi de cette position et pour dégager Capoue, marche brusquement vers Rome. A son approche, tous les citoyens courent aux armes et sortent des murs. Annibal et les consuls en présence se virent plusieurs fois au moment de décider cette lutte sanglante par un dernier combat : mais dès qu’on en donnait le signal, une tempête horrible éclairait et empêchait les deux partis d’en venir aux mains. Annibal crut voir dans ce phénomène répété un arrêt des dieux ; et ce qui le déconcerta le plus, ce fut la confiance des Romains. En sa présence, ils firent sortir des recrues pour l’armée d’Espagne, on vendit à l’encan le champ sur lequel il campait ; et ce champ ne perdit rien de sa valeur. Annibal découragé se retira, et Capoue se rendit aux Romains. Cependant la face des affaires changeait en Espagne[5]. Carthage y envoya trois armées sous la conduite de Magon, d’Asdrubal, fils de Giscon, et d’un autre Asdrubal, fils de Giscar. Les deux Scipion commirent alors une grande faute, ils divisèrent leurs forces. Publius Scipion attaqué le premier, fut battu et tué. Massinissa, qui venait d’enlever le trône de Numidie à Syphax, eut la plus grande part à cette défaite[6]. Les trois armées victorieuses tombèrent sur Cneius Scipion, qui, à leur arrivée, pressentit le malheur et la mort de son frère. Il éprouva le même sort, vit son armée en déroute, et périt dans le combat. Mais quelques temps après, le jeune Scipion, réservé par le ciel à de plus heureuses destinées, arriva en Espagne avec de nouvelles troupes, vengea son père et son oncle ; et rétablit l’autorité romaine dans la péninsule. Claudius Néron étant consul avec Marcus Livius, Carthage
se décida tardivement à secourir Annibal[7].
Une armée partit sous le commandement de son frère, Asdrubal, avec l’ordre de
suivre la même route que ce grand homme avait parcourue. Tout parut d’abord favoriser
ce dessein. Il trouva tous les peuples
disposés en sa faveur, traversa l’Espagne, les Gaules et franchit les Alpes
sans obstacle. Descendu en Italie, il expédia un courrier à son frère pour le
prévenir qu’il le joindrait dans l’Ombrie. Néron intercepta ses lettres ; et
quoique Il marcha jour et nuit, et se joignit à Livius qu’il pressa de ne point différer l’attaque. Asdrubal, craignant de compromettre, par une action le sort de cette grande lutte entre les deux peuples, voulut prudemment éviter le combat et se retira. Ses guides l’abandonnèrent, il s’égara. Les Romains l’atteignirent sur les bords du fleuve Métaure. Asdrubal prit un poste avantageux, disposa bien ses troupes, et soutint sa gloire passée par un courage intrépide ; mais voyant que la victoire se déclarait pour les Romains, il se jeta au milieu d’une cohorte ennemie et y trouva une mort digne du frère d’Annibal. C’est ainsi que Livius et Néron décidèrent par leur habileté du sort de cette guerre, et méritèrent une gloire que le hasard et l’histoire attribuèrent depuis au seul Scipion, parce qu’il sut habilement, dans la suite, profiter de leurs succès. Carthage perdit dans cette affaire cinquante-cinq mille hommes ; six mille furent tués. On avertit Livius qu’on découvrait encore une troupe ennemie facile à détruire : Laissez-en vivre quelques-uns, dit-il, pour qu’ils portent à Carthage la nouvelle de leur défaite. Néron courut en Ombrie retrouver son armée, et jeta dans le camp carthaginois la tête d’Asdrubal. Annibal, en la voyant, s’écria : C’en est fait, Carthage ne recevra plus de moi de glorieux trophées. En perdant Asdrubal, je perds ma fortune et mon espoir. Il se retira dans le pays des Brutiens, et s’y soutint avec peine, privé de tout secours de sa patrie. Cependant le jeune Scipion, unissant à l’ardeur son âge, la prudence des plus vieux capitaines, conquit l’Espagne ; et la soumit tout entière aux Romains[8]. Pour comble de fortune, Massinissa, puissant en Afrique par l’étendue de ses possessions et par le nombre de ses sujets, embrassa la cause de Rome, tandis que Syphax, à la tête d’une faible faction, passait dit côté de Carthage. Scipion revint à Rome ; le peuple, comptant ses exploits,
et non ses années, le nomma consul[9].
Son habileté dans les conseils, sa valeur dans les combats, la prise
brillante de Carthagène, son mérite personnel et les faveurs de la fortune,
lui attiraient la confiance générale. On lui assigna Cette grande entreprise était l’objet de tous ses vœux. Carthage ne lui opposa point d’obstacle ; aucune armée navale n’arrêta sa marche. Débarqué sur le continent, il défit les armées de Syphax et d’un autre Asdrubal, brûla leur camp, et fit Syphax prisonnier. Carthage, consternée de ses revers, demanda la paix. Trente sénateurs, prosternés aux pieds de Scipion, rejetèrent les torts de la guerre et les malheurs de l’Italie sur l’ambition d’Annibal, et promirent, au nom de leur république, une obéissance entière au peuple romain. Scipion leur répondit : Je suis venu pour vaincre, et non pour signer la paix : cependant je l’accorderai, si vous voulez rendre tous les prisonniers, évacuer l’Italie, les Gaules, l’Espagne, les îles, livrer tous vos vaisseaux, excepté vingt et payer un tribut de quinze millions et huit cent mille boisseaux de grains. A ces conditions, vous pourrez envoyer une ambassade à Rome. Ils s’y soumirent ; les députés partirent ; la trêve fut conclue, et Annibal reçût l’ordre de retourner en Afrique[10]. En lisant cet arrêt fatal, il frémit de douleur et d’indignation, accusa les hommes et les dieux, et se reprocha de n’avoir pas cherché la victoire ou la mort sous les murs de Rome, après là bataille de Cannes. Cependant il céda au destin et obéit. Le sénat romain, fier et irrité, ne trouva pas d’abord les conditions de la paix assez dures pour Carthage, assez avantageuses pour Rome, et pourtant il renvoya le tout à la décision de Scipion. Sur ces entrefaites, Octavius, conduisant en Afrique deux cents vaisseaux de charge, vit sa flotte dispersée par une tempête près de Carthage. Le peuple, impétueux et avide, voulut se saisir de cette riche proie. Le sénat au mépris de la trêve, eût la faiblesse d’y consentir : par ses ordres Asdrubal s’empara de tous ces bâtiments. Scipion envoya des officiers pour se plaindre vivement de cette agression. Le peuple insulta ses députes ; le sénat refusa de les entendre. L’approche d’Annibal et de son armée réveillait la haine, les espérances et la fierté des Carthaginois. Les ambassadeurs de Carthage revenaient alors de Rome ; Scipion, plus généreux que ses ennemis, les reçut avec honneur, et les laissa passer tranquillement mais il leur déclara que la trêve était rompue.
Tout le peuple à Carthage ne respirait que la guerre ; Annibal seul conseillait la paix, dont il sentait la triste nécessité. Il demanda une entrevue à Scipion, qui la lui accorda. Ces deux grands hommes, en s’approchant, saisis d’admiration l’un pour l’autre, gardèrent quelque temps un profond silence[11]. Annibal le rompit le premier. Après avoir loué adroitement
son rival sur ses exploits, il lui représenta tous les malheurs qu’entraîne
la guerre, l’incertitude des événements, et se cita lui-même comme un exemple
frappant des vicissitudes de la fortune : Vous
êtes, lui dit-il, à présent ce que je
fus à Trasimène et à Cannés. Profitez mieux que moi de votre prospérité ;
faites la paix au moment où vous pouvez en régler les conditions. Nous
consentons à vous céder Scipion répondit par des reproches sur la perfidie de Carthage et sur l’infraction de la trêve. Il témoigna sa haute estime pour Annibal, le remercia de ses conseils ; mais l’avertit en même temps de se préparer au combat s’il ne voulait pas consentir au désarmement des vaisseaux, au tribut demandé et à quelques indemnités pour la rupture de la trêve. Annibal ne put se résoudre à signer un traité si honteux pour lui, et si contraire aux vœux de ses concitoyens et à l’intérêt de son pays. De part et d’autre on courut aux armes. Les deux généraux haranguèrent leurs soldats, leur rappelèrent une longue suite de triomphes, et leur présentèrent, pour les animer au combat, les motifs les plus puissants sur le cœur des hommes ; car, dans ce jour fatal, la destinée des deux peuples dépendait d’un succès ou d’un revers.
On déploya de chaque coté la même habileté dans la disposition des troupes, la même présence d’esprit dans l’action ; mais le courage des Romains triompha de tous les obstacles que leur opposait le génie d’Annibal. Les Carthaginois prirent la fuite, laissant vingt mille des leurs sur le champ de bataille, et vingt mille prisonniers. Annibal, rentré dans Carthage, déclara qu’il n’existait plus d’espoir, que toute résistance devenait impossible, et qu’on devait se soumettre aux conditions du vainqueur. Scipion, profitant de sa victoire, s’approcha de Carthage avec sa flotte et son aimée. Comme il s’avançait, il vit arrivée à sa rencontre un vaisseau couvert de branches d’olivier et portant des ambassadeurs qui venaient implorer sa clémence. Il leur dit d’aller l’attendre à Tunis. Là, il se vit pressé par tous les officiers qui voulaient prendre et raser Carthage ; mais soit que son caractère humain et généreux, lui fit repousser l’idée de détruire une si antique et si florissante cité, soit qu’il craignit la force que donne souvent le désespoir, soit enfin que son ambition ne voulût pas laisser à un successeur l’honneur de faire ce siége difficile et de terminer la guerre, il accorda la paix, en ajoutant aux conditions déjà proposées, de ne garder que dix vaisseaux, de livrer les éléphants, de restituer à Massinissa ce qu’on lui avait pris, de ne point entreprendre de guerre même en Afrique, sans la permission de Rome, et de solder l’armée romaine jusqu’à la ratification du traité. Lorsque Annibal lut ces articles devant le sénat de Carthage, Giscon déclama violemment contre cette humiliante convention. Annibal, indigné d’une opposition si intempestive, le saisit au corps et le jeta en bas de son siége ; comme une telle violence excitait de grands murmures dans le sénat, il dit avec fermeté : Sorti de vos murs à neuf ans, j’ai pendant trente-six années appris la guerre et oublié vos coutumes ; ce que je connais parfaitement, c’est votre position. Elle est sans ressource, vos alliés vous ont trahis ; vos provinces sont sous la puissance de l’ennemi ; votre flotte est détruite ; vos armées sont vaincues et exterminées ; votre trésor est vidé : il ne vous reste à opposer aux Romains que des vieillards, des enfants, des femmes et des blessés. Au lieu de vous plaindre des conditions de la paix, remerciez les dieux qui vous l’accordent, et, signez votre salut en l’acceptant. On le crut et on signa. Les ambassadeurs envoyés à Rome étaient tous choisis dans le parti d’Hannon. Ils éclatèrent devant le sénat en reproches sur l’ambition d’Annibal, qui, disaient-ils, avait seul conseillé et prolongé la guerre. Ils flattèrent l’orgueil du vainqueur par de basses soumissions, et prodiguèrent les plus grands éloges à la générosité du peuple romain, si accoutumé à vaincre qu’il trouvait plus de gloire à augmenter son empire par la clémence que par la victoire. Le sénat et le peuple ratifièrent la paix ; ordonnèrent à Scipion de ramener l’armée romaine. Avant de partir à la vue de Carthage, il brûla cinq cents vaisseaux et fit pendre les transfuges romains qu’on lui avait rendus. Le sénat de Carthage éprouvait de grandes difficultés pour lever les taxes et payer le tribut convenu. Annibal, les voyant dans ces embarras, sourit amèrement. On lui reprochait d’insulter ainsi à la douleur publique. Vous lisez mal dans mon cœur, répondit-il, ce rire qui vous offense est un rire d’indignation et de pitié. Vous ne sentez le malheur général que lorsqu’il vous frappe personnellement : c’était lorsqu’on nous enlevait nos armes ; quand on brûlait nos vaisseaux ; et lorsqu’en nous défendant la guerre, on nous isolait sans défense au milieu de l’Afrique, que vous déviez pleurer, et non pas au moment où l’on vous demande quelques millions. Pleurez votre indépendance, pleurez votre patrie, et supportez courageusement la perte de votre fortune Je vous le prédis, ce qui cause aujourd’hui vos larmes vous paraîtra dans peu le plus léger de vos malheurs. Tandis que Carthage, consternée gémissait ainsi d’une ruine et d’une humiliation que rendait plus sensible le souvenir de sa grandeur passée, Rome, dans la joie, recevait avec les plus grands honneurs Scipion, chargé des dépouilles de sa rivale. On lui décerna le triomphe, et il reçut du peuple le glorieux surnom d’Africain pour avoir terminé cette seconde guerre punique qui durait depuis dix-sept ans. |
 Amilcar-Barca, après avoir apaisé les troubles en d’Afrique
et soumis les Numides révoltés, conduisit une armée en Espagne, et combattit
avec succès. Cet homme, fameux en Afrique par ses exploits, ferme dans le
commandement, doué d’un grand courage et d’une prudence consommée, terrible
dans les combats, doux après la victoire, conciliant dans les conseils,
adroit en politique, réunissait toutes les qualités d’un grand général et d’un
homme d’état habile. Implacable ennemi des Romains, il obligea son fils Annibal,
âgé de neuf ans, de jurer aux pieds des autels une haine éternelle à Rome ;
et jamais homme ne tint mieux, son serment.
Amilcar-Barca, après avoir apaisé les troubles en d’Afrique
et soumis les Numides révoltés, conduisit une armée en Espagne, et combattit
avec succès. Cet homme, fameux en Afrique par ses exploits, ferme dans le
commandement, doué d’un grand courage et d’une prudence consommée, terrible
dans les combats, doux après la victoire, conciliant dans les conseils,
adroit en politique, réunissait toutes les qualités d’un grand général et d’un
homme d’état habile. Implacable ennemi des Romains, il obligea son fils Annibal,
âgé de neuf ans, de jurer aux pieds des autels une haine éternelle à Rome ;
et jamais homme ne tint mieux, son serment.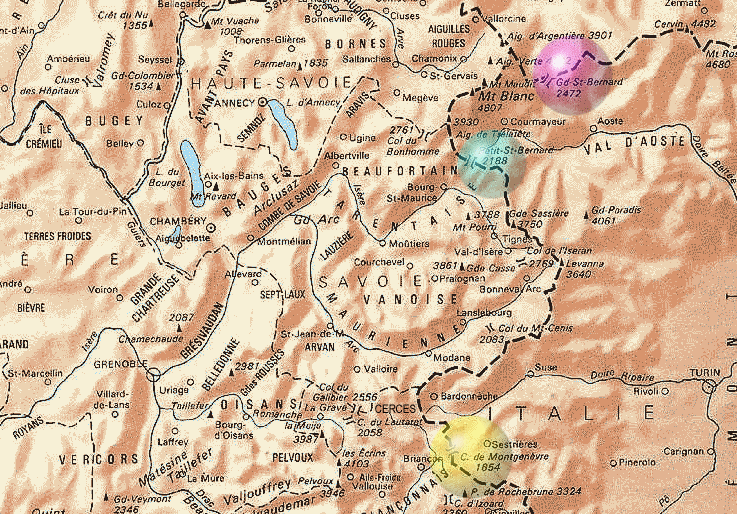
 Annibal, débarqué en Afrique, fit camper son armée près de
Zama, à cinq lieues de Carthage. Il envoya des espions pour reconnaître le camp
romain ; Scipion les découvrit, et, au lieu de les punir, il leur fit voir en
détail la force et le bel ordre de son armée.
Annibal, débarqué en Afrique, fit camper son armée près de
Zama, à cinq lieues de Carthage. Il envoya des espions pour reconnaître le camp
romain ; Scipion les découvrit, et, au lieu de les punir, il leur fit voir en
détail la force et le bel ordre de son armée.