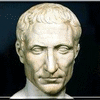JULES CÉSAR
CHAPITRE IV. — GUERRE CIVILE. - LE RUBICON.
|
Avant d'entamer le drame de Pharsale, un mot sur l'armée de César qui va y jouer son rôle. En comblant sans cesse les vides que la guerre y laissait, César en a fait peu à peu, comme Annibal, un pêle-mêle de toutes les nations qu'il a vaincues et attelées à son char. Belges, Celtes, Ibères, les trois grandes races qui se partagent la Gaule, puis des Bretons, des Germains, des Helvètes, des Suèves, toutes les branches en un mot de la vaste famille barbare y sont représentées, et s'y mêlent à l'élément italique qui en fait le fond. L'armée de César est l'image anticipée de la cité romaine, telle qu'il la veut faire, si la Mort lui en laisse le temps. Ce camp cosmopolite est devenu pour tous les peuples une cité de refuge, une patrie armée. L'unité dans la guerre prépare ainsi l'unité dans la paix. Comme Sertorius aussi, le conquérant de la Gaule a des dévoués espagnols, prêts à donner leur vie pour lui, même sans nécessité, pour le seul plaisir de mourir sous ses yeux, avec le sombre fanatisme de cette race étrange qui a toujours fait bon marché de sa vie. Avec une pareille armée, César peut tout entreprendre. Jusqu'ici un voile de feinte modération à couvert ses profonds desseins. Il a offert de poser les armes si Pompée en faisait autant de son côté, et si on lui laissait pour province la Gaule Cisalpine et l'Illyrie, avec deux légions seulement, jusqu'à ce qu'il fût consul. Mais ces offres ne sont sincères, ni d'une part, ni de l'autre. Pompée n'a pas plus envie que son rival de licencier l'armée qui fait sa force. Au fond, tous deux veulent la guerre, et sentent que l'épée seule peut trancher la question. Si César était de bonne foi, il n'aurait qu'une chose à faire, ce serait de renoncer à son gouvernement, et de venir à Borne briguer le consulat ; mais il n'y songe pas, et veut mener de front ses deux conquêtes à la fois. Pour suivre de plus près ces feintes négociations, il passe les Alpes, laissant en Gaule le gros de son armée, et ne prend avec lui que 5,000 fantassins et 300 chevaux ; son nom fera le reste ! L'heure est venue, il s'en aperçoit aux adhésions qui lui arrivent de tous côtés. Pompée s'est vanté, en frappant la terre du pied, d'en faire sortir des légions ; mais César n'a qu'à se montrer pour trouver partout des soldats. Sa province comprenait les deux Gaules, et sa frontière était le Rubicon. Au nord de ce petit ruisseau, devenu si grand dans l'histoire, se trouvait la légalité, au sud la révolte : il fallait choisir ! Devant cette limite fatale, César hésita longtemps. Arrêté sur le rivage, il pesa mûrement, dans un profond silence, cette redoutable alternative qui s'offrait à son esprit. Ce qui le retient, ce n'est pas la peur du danger, c'est l'audace et la grandeur de l'entreprise, l'incertitude du résultat, les maux sans nombre qu'il va déchaîner sur son pays. Aussi, sous la fiction du poète y a-t-il ici une vivante réalité ; Lucain a lu dans l'âme de César quand il nous montre le fantôme de la vieille Rome se dressant devant ce fils rebelle pour lui dire : Tu ne passeras pas sans fouler aux pieds ta mère ! Un instant, on n'en peut pas douter, il songea à renoncer à son entreprise, et se tournant vers ses amis, demeurés quelque peu en arrière, nous pouvons encore, leur dit-il, revenir sur nos pas ; mais si nous franchissons ce pont, il faudra marcher en avant, l'épée à la main ! Devant une pareille perspective, même le plus audacieux des mortels, même César pouvait hésiter ! Mais l'ambition l'emporte à la fin : Alea jacta est ! — le sort en est jeté ! — s'écrie-t-il, refrain des ambitieux qui voudraient se persuader qu'une force irrésistible les pousse en avant. Et pourtant, au fond du cœur, ils se sentent libres, et cherchent à rejeter sur une aveugle fatalité cette responsabilité qui leur pèse. Le sort en est jeté ! César franchit les limites de sa province, et entre par des chemins détournés, seul avec quelques amis, sur le terrain de la révolte, comme un malfaiteur qui se met lui-même hors la loi. Avec cette rapidité qui est chez lui un calcul pour étonner ses ennemis, il est déjà maître d'Ariminium avant qu'on y ait soupçonné son arrivée. La guerre civile a mis le pied avec lui sur le territoire romain. Le lendemain sa petite armée le rejoint à Rimini ; mais, malgré tout le prestige qui entoure son invincible chef, elle hésite à le suivre dans cette voie désespérée. Là, s'il t'ami en croire Suétone, César trouva dans ses vieux compagnons d'armes, plus dociles d'ordinaire, une résistance sur laquelle il n'avait pas compté. Il lui fallut descendre aux plus humbles prières, et supplier au lieu de commander. A bout d'arguments, il pleure devant eux, il déchire ses habits, et le conquérant de la Gaule se traîne aux pieds de ceux qui l'ont aidé à vaincre. Rome est vengée, et l'abaissement de César est le premier châtiment de sa faute. Je sais que, dans les Commentaires sur la guerre civile, inspirés, mais pou écrits par lui, il n'est pas question de cette scène humiliante ; mais on n'y parle pas non plus de la scène du Rubicon, et ce prudent silence n'a pas effacé le Rubicon de l'histoire. César est à peine à Rimini, et la grande nouvelle court
déjà l'Italie. Jamais coup de foudre, éclatant dans un ciel serein, ne
produisit un pareil effet. La prise d'Ariminium,
suivant l'expression de Plutarque, ouvrait toutes
les portes de la guerre, et sur terre et sur mer. Les villes mêmes semblaient
s'arracher de leurs fondements pour fuir devant cette invasion sacrilège, et
Rome se trouva comme inondée d'un déluge de gens qui s'y réfugiaient.
Ce qui dominait dans toutes les âmes, ce n'était ni l'indignation, ni la
douleur, ni le respect des lois violées, c'était la peur. On prenait César
pour un Sylla, et l'on redoutait sa vengeance. Mais c'était lui faire injure,
et il l'allait prouver bientôt. Ses soldats, entraînés, ont cédé à la fin, mais seulement quand il leur a fait voir Antoine et Cassius encore déguisés en esclaves, et la sainteté du tribunat violée en leur personne ; ils ont promis de le suivre partout où il voudrait les mener. Il approche, et chacun croit déjà le voir aux portes de la ville, traînant après lui avec ses légions la barbarie toute entière. Il approche et tout fuit, même Pompée, pliant sous le poids de ses fautes et sous les reproches que chacun lui adresse. Frappe du pied, il en est temps, Pompée ! ose lui dire Favonius en plein sénat. Il a une armée, une flotte, des ressources inépuisables, et il fuit, avec les consuls et le sénat, entraîné dans le courant de la peur universelle. Caton, qui depuis longtemps n'a plus d'illusion sur personne, persuade pourtant au sénat de remettre toute l'autorité aux mains de Pompée. Le premier usage qu'en fait celui-ci, c'est de déclarer César ennemi public, d'ordonner au sénat et à tous les magistrats de quitter Rome, sous peine d'être regardés comme rebelles. On dirait que Pompée, en fuyant, emporte avec lui la patrie, et que Rome est mise hors la loi avec César, car chacun s'empresse de la quitter. Des césariens même s'enfuient, comme Pison son beau-père, sans savoir pourquoi, et pour faire comme tout le monde. Labienus, l'un de ses familiers, qui ne l'a pas quitté pendant toute la guerre des Gaules, passe à Pompée ; César s'en venge en lui renvoyant son argent et ses équipages. Rome, abandonnée à elle-même, flotte au hasard, comme un vaisseau sans pilote, et César, par un reste de pudeur, s'abstient quelque temps d'y entrer. Pompée, avec son cortège de sénateurs et de magistrats,
s'était dirigé vers la Pouille. Le gros de ses forces était en Espagne, où
Afranius et Petreius, ses lieutenants, se trouvaient avec cinq légions.
L'Orient, sa réserve, n'était rien moins que préparé à la guerre. Pompée,
dans son imprévoyance, a déchainé César sur lui et sur l'Italie, et il n'est
pas prêt à lui tenir tête. Mais la position de son adversaire, plus forte au
point de vue matériel, est bien inférieure au point de vue moral. Tout ce qui
reste dans la république de nobles cœurs et de noms honorés s'est rallié
autour de Pompée ; il a pour lui, comme dit un ancien, toute la dignité de
l'État, et César n'en a que là force. Sénèque, en quelques lignes fermes et
précises, a résumé la situation : Si vous voulez,
dit-il, vous faire de ces tristes temps nue image
fidèle, vous verrez du côté de César la plèbe et tous les hommes perdus que
la ruine de leur fortune rend avides de changement ; de l'autre, le sénat,
l'ordre équestre, tout, ce qu'il y a de noble et de grand dans la ville ; au
milieu, Caton et la république, seuls et abandonnés de tous. Mais, à défaut d'appui moral, César a la force, et il en
usera. Pendant qu'il amuse par un semblant de négociations Pompée qui a voulu
traiter avec lui, pendant que le reste de ses légions accourt à marches
forcées du fond de la Gaule, il marche avec ses cinq mille hommes à la
conquête de l'Italie et du monde. Pompée a mis hors la loi tous ceux qui se
joindront à son ennemi ; César fait proclamer partout qu'il regardera comme étant pour lui tous ceux qui ne se déclareront
pas contre lui. Domitius, au lieu de se réunir à Pompée, s'est jeté
dans Corfinium avec trente cohortes ; César vient assiéger avec deux légions
une ville dont la garnison est plus forte que toute son armée ; mais les
habitants et la garnison sont bientôt d'accord pour la lui livrer. On
s'attendait à le voir sévir contre les partisans de Pompée ; mais César,
mieux inspiré que Sylla, s'est fait de la clémence une arme à laquelle rien
ne résiste, ni les villes, ni les cœurs. Il pardonne à tout le monde, même à
ceux qui refusent de se joindre à son parti ; il protège leurs propriétés et
leur vie contre les insultes de ses soldats ; et quand, plus tard, les plus
compromis vont rejoindre Pompée, ce n'est pas une
raison pour moi, écrit-il à Cicéron, de me
repentir de ma générosité. Je suis charmé qu'ils se montrent dignes
d'eux-mêmes, comme il me convient à moi de ne pas me démentir. Voilà ce qu'on peut appeler le côté officiel et extérieur de la clémence de César ; mais creusons un peu plus avant, et voyons ce que dit de lui Dion Cassius : César, nous dit-il, était naturellement doux, et ne se mettait pas aisément en colère. Cicéron l'avait insulté plus d'une fois, et il avait dédaigné ses attaques, en laissant Cicéron l'outrager et se louer sans mesure. Quand César se décidait à punir, il ne le faisait jamais sur- le-champ. Il épiait le moment propice et frappait à l'improviste, cherchant moins à se venger qu'à diriger toutes choses dans le sens de son intérêt... Aussi a-t-il pardonné bien des offenses ; mais quand il punissait, c'était avec plus de rigueur que n'en comportait la justice, afin de se mettre, disait-il, à l'abri de tout danger pour l'avenir. Enfin, après ce précieux témoignage de Dion, le dernier
des écrivains grecs qui mérite le nom d'historien, nous avons celui de César
lui-même. Une de ses lettres intimes nous donne le secret et comme la clef de
sa clémence. Je me réjouis, écrit-il à Balbus
et à Oppius, que vous approuviez ma conduite à
Corfinium : Tentons de regagner par cette voie tous les esprits. Les autres,
en se montrant cruels, n'ont pu éviter la haine publique, ni jouir longtemps
de leur victoire, excepté Sylla, que je suis très résolu à ne pas imiter.
Donnons l'exemple d'une nouvelle façon de vaincre, et assurons notre
fortune (nos muniamus) par la clémence
et par l'humanité. Ici, nous avons e tout entier, peint de sa main, pour ses
intimes seulement, et non pour la postérité, qu'il ne croyait pas mettre dans
sa confidence. Maintenant, faut-il croire avec Curion que César n'était point porté à la clémence par caractère,
mais par politique, pour se gagner la faveur du peuple, et que, s'il s'en
était vu franchement détesté, il serait devenu cruel ? Non, Curion,
âme vindicative, jugeait son maitre d'après lui-même. Ce n'est pas lui qu'il
faut en croire, mais César, grand de toute la grandeur qui peut exister dans
une âme dont la vertu est absente ; César qui, toujours fidèle à son
programme de pardon, résista jusqu'à la fin aux obsessions de ses amis qui le pressaient de verser le sang. Dans
cette clémence insidieuse, comme
l'appelle Cicéron, mais qui répond à un secret instinct de ce cœur magnanime,
deux choses dominent : la haine de Sylla et le parti pris de ne pas marcher
dans les mômes voies que lui, puis le désir d'assurer
sa fortune, et de jouir longtemps des
fruits de sa victoire. L'humanité, chez lui, est donc nature et calcul à la
fois, et dans ce pardon sans limites comme sans précédents, qui pourrait dire
où finit la générosité, et où commence le calcul ? Le siège de Corfinium n'avait duré que sept jours ; c'était trop encore pour César, plus avare de son temps que de sa vie. Il lui tardait de se remettre sur la piste de Pompée, qu'il craignait, non sans raison, de voir lui échapper. Parti de Rimini avec cinq mille hommes, il avait maintenant six légions, dont deux de recrues qui, au bruit de sa fortune, accouraient à lui de tous côtés. Pompée, au contraire, avec l'élite de ses troupes en Espagne, n'en avait en Italie que le rebut, et en était réduit à armer des pâtres et des esclaves. Son seul refuge, c'était Brindes, à portée de la mer, qui lui appartenait. Au bout de quelques jours, César vient l'y retrouver. Il a appelé tout le inonde à lui, et tout le monde vient ! En deux mois, il a conquis l'Italie, sans une goutte de sang versé, par le double prestige de la gloire et de la clémence. Sans perdre un instant, César met le siège devant Brindes, se flattant d'y enfermer son ennemi. Mais autant il se fie à sa fortune, autant Pompée a peur de la sienne. Sa feinte résistance n'a pour but que de faciliter sa fuite. Pour se défendre à la fois contre les habitants et contre l'ennemi, il fait murer les portes et les rues de la ville qui donnent sur le port. Il fait embarquer ses troupes la nuit, en grand secret, et s'éloigne en fugitif de ce port qui le vit, peu d'années auparavant, revenir vainqueur de Mithridate, traînant après lui, avec une gloire qui semblait plus qu'humaine, le faste et les dépouilles de l'Asie. Un des torts du grand Pompée, et non le moindre, c'est de s'être surtout appuyé sur l'Orient, tandis que César, mieux inspiré, ne se fie qu'à l'Occident, car il sait que là est l'avenir, pour le monde et pour lui. Les vaisseaux lui manquent pour poursuivre son ennemi, et il le laisse fuir en Orient, jugeant la province digne du général. D'ailleurs, après cette fuite honteuse, il sait que, pour quelque temps, il n'a rien à redouter de lui, et il craint, en abandonnant l'Italie, de la livrer aux légions d'Espagne, dont il a plus peur que de Pompée. On sent percer dans tout ce drame confus qui va se dénouer à Pharsale l'immense mépris de César pour son adversaire, et ce mépris, qui ne le partage ? Ajournant donc la poursuite de Pompée, qu'il saura bien retrouver, le vainqueur des Gaules se permet enfin de revenir à Rome, en passant par Formies, où il voit Cicéron. Mais ici, il faut s'arrêter un instant, pour fouiller un des replis les plus secrets de l'âme de César. Le châtiment de ces maîtres du monde qui sont arrivés au faîte des choses humaines en foulant aux pieds la morale et les lois, c'est de voir tout ce qui est perdu venir à eux, et tout ce qui est honnête s'en éloigner. Ajoutez la secrète morsure de leur conscience à cette solennelle réprobation de la conscience publique, et vous verrez que la morale est vengée, et que la justice humaine a réservé ses droits, en attendant la justice divine. Cette mise au ban de tous les cœurs honnêtes pesait sur César, qui se débattait contre elle, sans pouvoir lui échapper. Il eût payé bien cher l'adhésion de quelques-unes de ces dupes sublimes dont il avait ri si souvent, comme Brutus, comme Caton... Mais tous deux, fidèles aux convictions de toute leur vie, avaient suivi, non pas Pompée, mais la patrie et les lois qui s'exilaient avec lui. Restait Cicéron, honnête aussi, courageux même, mais à ses heures, et quand cela ne dérangeait pas trop sa vie si bien ordonnée et ses studieux loisirs. Cicéron, comme toutes les Ames faibles, avait cru pouvoir, à force de concessions, se maintenir bien avec les deux partis. Entraîné vers Pompée par son cœur et vers César par son esprit, avec toute sa perspicacité, il n'avait pas su voir que, l'alliance des deux rivaux ne reposant que sur un intérêt passager, du moment où César cesserait d'avoir besoin de Pompée, il Cesserait de le ménager, et qu'alors il lui faudrait opter entre les deux. Ce moment était venu enfin ; Mais Cicéron, mis en demeure
de choisir, avait l'âme trop droite pour hésiter : J'aime
mieux, écrit-il à son ami Atticus, confident de ses éternelles
irrésolutions, être vaincu avec Pompée que vaincre
avec César. Du reste, il est désabusé de tout, même de Pompée, et ne
croit plus à son ancienne idole, à la veille de se sacrifier à elle. Je savais bien, écrit-il encore, qu'il n'entendait rien au gouvernement ; mais hélas ! il
ne s'entend pas mieux à la guerre. Et ailleurs : César avec une mauvaise cause est applaudi ; Pompée, avec
la meilleure de toutes, se fait détester ; l'un pardonne même à ses ennemis,
l'autre abandonne ses amis... La victoire
nous donnera sûrement un tyran, car aucun des deux ne veut notre bien ; tous deux
n'aspirent qu'à régner. Combattons donc, et pourquoi ?... Pour être proscrits, si nous sommes vaincus, esclaves, si
nous sommes victorieux ! Pompée ne s'en cache point, il a toujours souhaité
recommencer Sylla. Sans cesse il répète : Ce que Sylla a pu, pourquoi ne le
pourrais-je pas ? son cœur ne respire que Sylla et que proscriptions. (Sullaturit animus ejus
proscripturit.) Mais s'il traite ainsi Pompée, qu'il aime encore au fond
du cœur, ce n'est pas, on va le voir, pour ménager César ! Ô bandit perdu de crimes (perditum latronem) ! ô homme insensé et misérable, qui n'a pas même l'idée
du beau moral (τοΰ
καλοΰ) ! Il prétend
venger ainsi son honneur ; mais l'honneur peut-il être où la vertu n'est pas
? L'honneur consiste-t-il à asservir sa patrie, et à ne reculer devant aucun
forfait, tout cela pour arriver à la tyrannie, la grande divinité des ambitieux
? Je ne lui envie pas sa fortune, j'aime mieux mille fois mourir que de
faire comme lui ! Et il conclut en ces termes : Je vois bien qui je dois fuir, mais je ne sais à qui
m'attacher. Cicéron n'avait pas voulu suivre Pompée dans son exil ;
mais quand il le sait assiégé dans Brindes, puis fugitif et errant sur les
mers, le remords le prend, et ce remords touche presque au désespoir : La turpitude de sa fuite (deformitas), écrit-il, avait tué mon affection pour lui ; mais depuis
qu'il est parti, mon amour' se réveille, je ne puis supporter de me voir loin
de lui. Ni les livres, ni la philosophie n'y peuvent rien. Je tourne jour et
nuit les yeux vers la mer, comme l'oiseau qui veut prendre l'essor et
s'envoler. C'est dans ces dispositions que César trouva Cicéron
lorsque, après bien des tentatives inutiles, il voulut tenter d'emporter par
lui-même ce que ses entremetteurs n'avaient pu gagner. Il y allait de son
honneur de réussir, et cette difficile conquête manquait à sa gloire. Avant
de rentrer dans Rome, soumise et dépeuplée, il voulait y ramener Cicéron, et
décorer de ce beau nom le fantôme de république qu'il allait y dresser. On
peut juger si César fut aimable, surtout au début de l'entrevue, lorsque la
séduction marchait encore avant la menace. Nous avons par bonheur, dans les
lettres de Cicéron à Atticus (IX, 18),
un résumé trop court de ce mémorable entretien. Et d'abord, César le pressa
vivement de venir reprendre son siège au sénat, qu'il fallait repeupler, et
où manquaient tous les grands noms de la république, ces noms qu'on ne peut
pas créer, même en créant des sénateurs. Le futur dictateur avait bien
recueilli çà et là, dans la débâcle de Pompée, quelques anciens consuls, puis
des préteurs, des tribuns et autres magistrats secondaires ; mais il lui
manquait Cicéron, il lui fallait Cicéron pour rehausser ces faciles
conquêtes, et parer son triomphe un peu solitaire. Aussi n'épargna-t-il rien
pour le gagner, et entraîner à la curie l'illustre réfractaire. Il ne lui
demanda pas même de combattre Pompée, pas même de se rallier ouvertement,
rien que de ne pas se prononcer contre lui. Votre
absence me condamne, lui dit-il ; tout le
monde sera plus lent à venir à moi, si vous refusez de donner l'exemple ! Cicéron fut inflexible : il allégua ses liaisons avec
Pompée ; avec les sénateurs qui l'avaient suivi. Mais César ne veut pas se
tenir pour battu : Eh bien, dit-il, venez au sénat pour y parler de paix. — Me sera-t-il permis, dit Cicéron, d'y dire vraiment ce que je pense ? — En doutez-vous, et pourrais-je songer à vous dicter ce que
vous avez à dire ? — Eh bien, je dirai que le
sénat n'approuve point qu'on aille attaquer l'Espagne, ni que l'on transporte
des troupes en Grèce, et je déplorerai le triste sort de Pompée. Ici
César l'interrompt : Je ne veux pas, dit le
conquérant, qu'on tienne dans le sénat un pareil
langage. — Je m'en doutais, reprit
Cicéron, et c'est pour cela que je ne veux pas y
mettre le pied ; car il faut que j'en sois absent ou que j'y dise ces
choses-là, et bien d'autres encore que je ne peux pas taire. César,
poussé à bout, s'emporte, ou en fait le semblant : Puisque
ceux qui pourraient me donner conseil ne le veulent pas, dit-il, je ne reculerai devant aucune extrémité !... Cependant,
il s'apaise bientôt, et, pour se ménager une issue honnête, il déclare à
Cicéron qu'il n'accepte pas son refus, et le prie d'y réfléchir mûrement. Je ne pouvais pas lui dire non, ajoute Cicéron, et c'est ainsi que nous nous séparâmes. Je crois que cet
homme ne m'aime pas ; mais moi, j'ai été content de moi-même, habitude que
j'avais perdue depuis longtemps. Et César s'en va, triste plutôt
qu'irrité, et forcé de s'avouer qu'il a perdu la première bataille livrée par
lui sur le terrain de l'honnête. Du reste, le parti de Cicéron était pris, et c'est par pure politesse qu'il avait promis de réfléchir. La vue de l'entourage de César, de son cortège de bandits, perdus de dettes et de crimes, aurait suffi pour le décider. Et cependant, parmi ses amis même, les conseillers ne manquaient pas pour le presser de se donner à César. Ainsi Cœlius, un de ses intimes, qui recrute des défections pour légitimer la sienne, lui reproche affectueusement d'être assez sot pour vouloir aller rejoindre dans sa fuite celui dont il n'a pas voulu partager la résistance ; puis, mettant bas toute vergogne, il ajoute : Dans les temps de discordes civiles, tant qu'on ne se bat qu'à coups de paroles, il faut embrasser le parti le plus honnête ; mais quand on en vient à l'épée, c'est le plus fort qu'on doit choisir ; et Cœlius prêche d'exemple en passant avec la fortune dans le camp du vainqueur. Mais Cicéron, bien que décidé, ne se pressait pas d'agir.
Suivant lui, une paix, même injuste, valait mieux que la guerre la plus
juste. Pendant deux mois, cédant aux obsessions de sa femme et de ses amis,
il retarda son départ, sans que sa résolution en fût ébranlée. Le 7 juin 704,
il s'embarqua enfin pour se rendre au camp de Pompée, en Epire. Des
transports de joie y saluèrent son arrivée ; mais, pendant que tout le monde
le louait, Caton seul le blâma, en disant que lui,
Caton, avait dû suivre Pompée pour rester fidèle à son passé, mais que rien
ne forçait Cicéron de prendre un parti, et qu'il aurait dû rester neutre pour
remplir au besoin l'office de médiateur. Cicéron, on le sait, n'épargne guère plus ses amis que ses
ennemis. L'illustre conscrit qui vient de s'enrôler dans le camp de Pompée
nous a peint l'aspect qu'il présentait. Le tableau n'a que trois lignes, mais
il est achevé : Peu de troupes, et encore moins
d'envie de combattre. Otez le chef et quelques autres avec lui, le reste ne
sont que à des pillards. Ecoutez-les parler, leur cruauté vous ferait prendre
la victoire même en horreur. En un mot, rien de bon dans le parti, si ce
n'est la cause qu'il défend. Accueilli d'abord avec joie, Cicéron ne
tarde pas à devenir à charge à ses anciens amis par la liberté de ses propos,
la seule qui survive à toutes celles que Rouie a perdues : Vous arrivez tard, lui a-t-on dit quand il
débarquait. — Comment, tard ? Je ne vois rien de
prêt ! — Pompée, voulant lui reprocher la défection de Dolabella, son
gendre, qui a embrassé le parti de César : Où est
votre gendre ? lui dit-il. — Avec votre
beau-père. Et Pompée, piqué au vif, s'oublie
jusqu'à dire : Je souhaite que Cicéron passe dans le
parti opposé pour apprendre à nous craindre. César, en revenant à Rome, avait trouvé la ville
abandonnée par l'élite de ses habitants ; mais à force d'instances, il
parvient à y ramener quelques personnages consulaires, et y organise un
semblant de sénat. Il daigne y paraître en personne et s'y justifier, en
rejetant tous les torts sur Pompée. Il conjure les
sénateurs de prendre en main la république et de l'administrer avec lui. Que
si la crainte les en éloigne, il ne refusera pas le fardeau. Il
propose ensuite une ambassade à Pompée pour lui offrir la paix. Il ne craint pas qu'on attribue son avis à la crainte. Il
s'est efforcé de vaincre son rival en courage, il veut aussi l'emporter en
équité et en justice. Puis, les laissant édifiés de tant de
désintéressement, ce qu'il a dit au sénat, il va le répéter au peuple, et,
pour donner plus de poids à son éloquence, il distribue aux citoyens du blé
et 300 sesterces par tête. Rome, officiellement rassurée, respire sur la parole du maitre. On y quitte l'habit de guerre qu'on y portait depuis le passage du Rubicon. Personne en Italie n'essaye plus de résister ; César a vaincu par la clémence qui, derrière elle, laisse percer la force, toujours prête à la remplacer. D'ambassade à Pompée, il n'en a été question que pour la forme. Les députés de César, ce sont ses soldats qui emplissent les rues de la ville, en attendant que leurs centurions viennent siéger au sénat. Le forum, étonné, entend retentir, à côté de la tribune où parla Cicéron, tous les jargons de la barbarie. Il ne tient qu'à Rome, de se croire revenue aux jours de Camille ; et prise d'assaut par les Gaulois ! Mais le temps de la dissimulation est passé ; César se
sent assez fort pour dire tout haut ce qu'il pense. Le tribun Metellus, qui
seul ose encore lui tenir tête, veut l'empêcher de puiser dans le trésor
public : Metellus, lui dit César, le temps des armes n'est pas celui des lois. Si tu
n'approuves pas ce que je veux faire, va-t-en ; la guerre ne souffre pas
cette liberté de langage. Quand, la paix faite, j'aurai posé les armes,
harangue alors tant que tu voudras. Je n'use pas encore de tous mes droits,
car vous m'appartenez par le droit de la guerre, toi et tous ceux qui vous
êtes déclarés contre moi. Et comme le tribun insistait encore, avec un
courage qu'on ne saurait trop admirer, Prends garde,
jeune homme, lui dit César, il y va de ta vie
! Et songe qu'il m'est plus aisé encore de le faire que de le dire. Certes, voilà qui sent son dictateur ! Le titre manque
encore, mais l'esprit de la dictature respire dans ces paroles hautaines,
échappées à un homme qui calcule tout, et n'a jamais donné rien à un premier
mouvement. César ici ne se trahit pas, il se révèle, et ce qui perce dans son
langage, c'est moins la vraie force, toujours maîtresse d'elle-même, que
l'impatience de tout frein, et le mépris de tout droit. Le tribun écarté, il
fait enfoncer à coups de hache les portes du trésor, et y puise à pleines
mains, comme dans le sien. Inutile d'ajouter que, dans ses Commentaires,
il n'est pas question de cette scène révoltante : César y insinue seulement
que le consul Lentulus, dans sa fuite précipitée, avait oublié de fermer le
trésor, croyant voir les Gaulois à ses trousses. Mais, quand nous
n'aurions pas le témoignage des autres historiens, un mot de Cicéron
suffirait pour trancher la question : César a donné
ici un double démenti, à sa clémence en maltraitant Metellus, à son opulence
en pillant le trésor. Avant de partir pour l'Espagne, le vainqueur avait encore à pourvoir à la sûreté de l'Italie, et à la protéger pendant son absence contre le retour de Pompée. Il confie Rome à Lepidus, l'Italie à Antoine. Il fait construire et équiper deux flottes, l'une dans l'Adriatique, l'autre dans la mer de Toscane. Puis, il se met en route par le midi de la Gaule pour l'Espagne. La guerre qu'il y fait est rude comme le pays : froid, famine, embûches, il supporte tout et triomphe de tout. Ses vétérans épuisés demandent grâce, mais ils le suivent. Il façonne au métier des armes ses recrues espagnoles, admirables soldats dès qu'ils sont commandés. Par des prodiges de tactique qui ont fait l'admiration de Condé, il triomphe, presque sans combat, d'Afranius et de Petreius, fait leur armée prisonnière, laisse les officiers libres d'aller retrouver Pompée, et les soldats de s'enrôler ou de rentrer dans leurs foyers. Aussi tout va à lui, comme le fer à l'aimant ; tout cède à ce prestige irrésistible de grâce et d'autorité ; jamais homme n'a agi sur l'humanité par tant de côtés à la fois. A ce point culminant de sa carrière, César se Montre vraiment grand, d'une grandeur que la morale cette fois n'a point à désavouer. Aussi mettrais-je volontiers à cette date le mot de Plutarque, qu'il place à tort, séton moi, avant la campagne des Gaules : Ici commence pour César comme une seconde vie, plus belle et plus noble que la première. L'Espagne ultérieure, où il a commandé autrefois, se soumet sans combat. Partout il pardonne et il pacifie, et les cœurs volent au devant de lui. Il a reçu du ciel ce don si beau de se faire aimer, arme irrésistible dans la main des puissants de la terre, quand ils daignent en user. On le voit, je n'ai point de parti pris contre César : il y a dans cette clémence inépuisable, dans ce dédain magne-aime de la vengeance quelque chose qui désarme les sévérités de l'histoire. En le voyant si grand et si aimable, on oublie presque le fond de perversité native qui se cache sous ces spécieux dehors. Pourquoi faut-il que d'aussi rares facultés n'aient été consacrées par lui qu'à asservir ses concitoyens ? Pourquoi, ne voulant que du bien à son pays et à l'humanité, leur a-t-il fait tant de mal par ses actes et par son exemple ? A cette question, la Providence a déjà répondu : elle a laissé César pendant trente ans marcher au pouvoir per fas et ne fas, et elle l'a retranché de ce monde au moment même où une carrière plus bienfaisante allait commencer pour lui. César quitte enfin l'Espagne et se dirige vers Rome. Il reçoit en passant la soumission de Marseille qui lui avait fermé ses portes, et qui attendait sa victoire pour se donner à lui. Il épargne à la cité phocéenne les horreurs du pillage, laisse aux habitants leur liberté et leurs biens, et ne leur prend que leurs vaisseaux. Partout où César se trouve en personne, sa fortune le suit ; mais ses lieutenants ne sont pas toujours aussi heureux. Dolabella s'est fait battre en Illyrie ; Curion, en Afrique, a perdu, en combattant le roi Juba, sa vie et son armée. Mais César revient, et tout va changer de face. Avant de quitter Marseille, il y reçoit le titre de dictateur que lui a fait décerner à Rome Lepidus, son lieutenant. A Plaisance, il réprime avec une fermeté hautaine une révolte de la neuvième légion ; mais en même temps il ferme les yeux sur les désordres de ses lieutenants. Antoine a scandalisé l'Italie de son faste et de ses débauches : il s'est fait, traîner, de Brindes à Rome, dans un char attelé par des lions, promenant avec lui la comédienne Cytheris, et forçant les magistrats des villes à venir rendre hommage à ce couple éhonté. César le blâme sans doute, mais il ne le punit pas : il a trop besoin de cet énergique et grossier soldat pour ne pas tout lui pardonner. Voilà donc César dictateur ! Il aurait pu se passer de ce titre pour régner ; mais c'est un dernier hommage qu'il rend à la légalité, tout en la violant. Sa dictature n'est pour lui qu'une transition : elle lui rend le service de préparer les esprits à la monarchie, et de déblayer le terrain pour l'édifice qu'il veut élever sur les ruines de la république. César est mal entouré, et son entourage pèse sur lui : tous ces nobles escrocs, endettés et ruinés, se flattent qu'ils en obtiendront l'abolition de toutes les dettes, et qu'une banqueroute universelle inaugurera le nouveau règne. Mais César, même avant d'avoir vaincu, se sent déjà responsable de la fortune publique. Du faîte où il est monté, il commence à s'apercevoir qu'on ne bannit pas impunément la bonne foi des transactions humaines, et que, pour faire une œuvre qui dure, il faut la faire reposer sur le droit, base éternelle de toute société. Toutefois, il faut une pâture à ces appétits déchaînés : il ne sait pas la leur refuser, et réduit d'un quart le chiffre de toutes les créances. Il cède encore sur la question du rappel des bannis, suspendue sur Rome comme une menace, depuis son triomphe. Les rappeler, c'est déclarer la guerre aux tribunaux et à leurs arrêts, et anéantir l'autorité de la chose jugée ; mais le dictateur a besoin de grossir ses rangs de cette écume des partis que, dans ses longues discordes, la république a rejetée de son sein. Graciés par lui, tous les anciens ennemis de Sylla et de Pompée vont se rencontrer à ses côtés clans une commune obéissance. Les fils des proscrits, sur, qui pesait encore, par une flagrante iniquité, la sentence de leurs pères, sont autorisés à aspirer aux charges que Sylla leur avait interdites, et l'opinion tient compte à César de cette réparation. Ainsi le bien s'allie partout au mal dans cette vie mêlée, sur qui l'histoire a hésité longtemps avant de rendre son arrêt. |