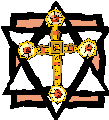MARC-AURÈLE OU LA FIN DU
XXX - Les moeurs chrétiennes.
|
LES MOEURS des chrétiens étaient la meilleure prédication
du christianisme. Un mot les résumait : la piété. C'était la vie de bonnes
petites gens, sans préjugés mondains, mais d'une parfaite honnêteté.
L'attente messianique s'affaiblissant tous les jours, on passait de la morale
un peu tendue qui convenait à un état de crise à la morale stable d'un monde
assis. Le mariage revêtait un haut caractère religieux. On n'eut pas besoin
d'abolir la polygamie : les moeurs juives, sinon la loi juive, l'avaient à peu
près supprimée en fait. Le harem ne fut, à vrai dire, chez les anciens juifs,
qu'un abus exceptionnel, un privilège de la royauté. Les prophètes s'y
montrèrent toujours hostiles ; les pratiques de Salomon et de ses imitateurs
furent un objet de blâme et de scandale. Dans les premiers siècles de notre
ère, les cas de polygamie devaient être très rares chez les juifs ; ni les
chrétiens ni les païens ne leur en font le reproche. Par la double influence
du mariage romain et du mariage juif, naquit ainsi cette haute idée de la
famille qui est encore de nos jours la base de la civilisation européenne, si
bien qu'elle est devenue comme une partie essentielle du droit naturel. Il
faut reconnaître cependant que, sur ce point, l'influence romaine a été
supérieure à l'influence juive, puisque c'est seulement par l'influence des
codes modernes, tirés du droit romain, que la polygamie a disparu chez les
juifs. L'influence romaine ou, si l'on veut, aryenne, est aussi plus sensible
que l'influence juive dans la défaveur qui frappait les secondes noces. On
les envisageait comme un adultère convenablement déguisé. Dans la question du
divorce, où certaines écoles juives avaient porté un relâchement blâmable, on
ne se montrait pas moins rigoriste. Le mariage ne pouvait être rompu que par
l'adultère de la femme. Ne pas séparer ce
que Dieu a uni devint la base du droit chrétien. Enfin l'église se mettait en pleine contradiction avec le
judaïsme, par le fait de considérer le célibat, la virginité, comme un état
préférable au mariage. Ici, le christianisme, précédé du reste en cela par
les thérapeutes, se rapprochait, sans s'en douter, des idées qui, chez les
anciens peuples aryens, présentent la vierge comme un être sacré. La
synagogue a toujours tenu le mariage pour obligatoire ; à ses yeux, le
célibataire est coupable d'homicide ; il n'est pas de la race d'Adam, car
l'homme n'est complet que quand il est uni à la femme ; le mariage ne doit
pas être différé au-delà de dix-huit ans. On ne faisait d'exception que pour
celui qui se livre à l'étude de Les sectes chrétiennes qui restèrent rapprochées du
judaïsme conseillèrent, comme la synagogue, les mariages précoces, et même
voulurent que les pasteurs eussent l'oeil ouvert sur les vieillards, qu'il
importait de soustraire au danger de l'adultère. Tout d'abord, cependant, le
christianisme versa dans le sens de Ben Azaï. Jésus, quoique ayant vécu plus
de trente ans, ne s'était pas marié. L'attente d'une fin prochaine du monde
rendait inutile le souci de la génération et l'idée s'établit qu'on n'est
parfait chrétien que par la virginité. Les patriarches
eurent raison de veiller à la multiplication de leur postérité ; le monde
alors était jeune ; maintenant, au contraire, toutes choses déclinent et
tendent vers leur fin. Les sectes gnostiques et manichéennes n'étaient
que conséquentes en interdisant le mariage et en blâmant l'acte générateur.
L'église orthodoxe, toujours moyenne, évita cet excès ; mais la continence,
même la chasteté dans le mariage, furent recommandées ; une honte excessive
s'attacha à l'exécution des volontés de la nature ; la femme prit une horreur
folle du mariage ; la timidité choquante de l'église en tout ce qui touche
aux relations légitimes des deux sexes provoquera un jour plus d'une
raillerie fondée. Par suite du même courant d'idées, l'état de viduité était
envisagé comme sacré ; les veuves constituaient un ordre ecclésiastique. La
femme doit toujours être subordonnée ; quand elle n'a plus son mari pour lui
obéir, elle sert l'église. La modestie des dames chrétiennes répondait à ces
sévères principes, et, dans plusieurs communautés, elles ne devaient sortir
que voilées. Il ne tint qu'à peu de chose que l'usage du voile recouvrant
toute la figure, à la façon de l'Orient, ne devînt universel pour les femmes
jeunes ou non mariées. Les montanistes regardèrent cet usage comme obligatoire
; s'il ne prévalut pas, ce fut par suite de l'opposition que provoquèrent les
excès des sectaires phrygiens ou africains, et surtout par l'influence des
pays grecs et latins, qui n'avaient pas besoin, pour fonder une vraie réforme
des moeurs, de ce hideux signe de débilité physique et morale. La parure, du moins, fut tout à fait interdite. La beauté
est une tentation de Satan ; pourquoi ajouter à la tentation ? L'usage des
bijoux, du fard, de la teinture des cheveux, des vêtements transparents fut une
offense à la pudeur. Les faux cheveux sont un péché plus grave encore ; ils
égarent la bénédiction du prêtre, qui, tombant sur des cheveux morts,
détachés d'une autre tête, ne sait où se poser. Les arrangements même les
plus modestes de la chevelure furent tenus pour dangereux ; saint Jérôme,
partant de là, considère les cheveux des femmes comme un simple nid à vermine
et recommande de les couper. Le défaut du christianisme apparaît bien ici. Il est trop
uniquement moral ; la beauté, chez lui, est tout à fait sacrifiée. Or, aux
yeux d'une philosophie complète, la beauté, loin d'être un avantage
superficiel, un danger, un inconvénient, est un don de Dieu, comme la vertu.
Elle vaut la vertu ; la femme belle exprime aussi bien une face du but divin,
une des fins de Dieu, que l'homme de génie ou la femme vertueuse. Elle le
sent, et de là sa fierté. Elle sent instinctivement le trésor infini qu'elle
porte en son corps ; elle sait bien que, sans esprit, sans talent, sans
grande vertu, elle compte entre les premières manifestations de Dieu. Et
pourquoi lui interdire de mettre en valeur le don qui lui a été fait, de
sertir le diamant qui lui est échu ? La femme, en se parant, accomplit un
devoir ; elle pratique un art, art exquis, en un sens le plus charmant des arts.
Ne nous laissons pas égarer par le sourire que certains mots provoquent chez
les gens frivoles. On décerne la palme du génie à l'artiste grec qui a su
résoudre le plus délicat des problèmes, orner le corps humain, c'est-à-dire
orner la perfection même, et l'on ne veut voir qu'une affaire de chiffons
dans l'essai de collaborer à la plus belle oeuvre de Dieu, à la beauté de la
femme ! La toilette de la femme, avec tous ses raffinements, est du grand art
à sa manière. Les siècles et les pays qui savent y réussir sont les grands
siècles, les grands pays, et le christianisme montra, par l'exclusion dont il
frappa ce genre de recherches, que l'idéal social qu'il concevait ne
deviendrait le cadre d'une société complète que bien plus tard, quand la
révolte des gens du monde aurait brisé le joug étroit imposé primitivement à
la secte par un piétisme exalté. C'était, à vrai dire, tout ce qui peut s'appeler luxe et
vie mondaine qui se voyait frappé d'interdiction. Les spectacles étaient
tenus pour abominables, non seulement les spectacles sanglants de
l'amphithéâtre, que tous les honnêtes gens détestaient, mais encore les
spectacles plus innocents, les scurrilités.
Tout théâtre, par cela seul que des hommes et des femmes s'y rassemblent pour
voir et être vus, est un lieu dangereux. L'horreur pour les thermes, les
gymnases, les bains, les xystes, n'était pas moindre, à cause des nudités qui
s'y produisaient. Le christianisme héritait en cela d'un sentiment juif. Ces
lieux publics étaient fuis par les juifs, à cause de la circoncision, qui les
y exposait à toute sorte de désagréments. Si les jeux, les concours, qui
faisaient pour un jour d'un mortel l'égal des dieux, et dont les inscriptions
conservaient le souvenir, tombent tout à fait au IIIe siècle, c'est le christianisme
qui en est la cause. Le vide se faisait autour de ces institutions antiques ;
on les taxait de vanité. On avait raison ; mais la vie humaine est finie
quand on a trop bien réussi à prouver à l'homme que tout est vanité. La sobriété des chrétiens égalait leur modestie. Les
prescriptions relatives aux viandes étaient presque toutes supprimées, le
principe tout est pur pour les purs
avait prévalu. Beaucoup cependant s'imposaient l'abstinence des choses ayant
eu vie. Les jeûnes étaient fréquents et provoquaient chez plusieurs cet état
de débilité nerveuse qui fait verser d'abondantes larmes. La facilité à
pleurer fut considérée comme une faveur céleste, le don des larmes. Les
chrétiens pleuraient sans cesse ; une sorte de tristesse douce était leur
état habituel. Dans les églises, la mansuétude, la piété, l'amour se
peignaient sur leur figure. Les rigoristes se plaignaient que souvent, au
sortir du lieu saint, cette attitude recueillie fît place à la dissipation ;
mais, en général, on reconnaissait les chrétiens rien qu'à leur air. Ils
avaient en quelque sorte des figures à part, de bonnes figures, empreintes
d'un calme n'excluant pas le sourire d'un aimable contentement. Cela faisait
un contraste sensible avec l'allure dégagée des païens, qui devait souvent
manquer de distinction et de retenue. Dans l'Afrique montaniste, certaines
pratiques, en particulier celle de faire à tout propos le signe de la croix
sur le front, décelaient encore plus vite les disciples de Jésus. Le chrétien était donc, par essence, un être à part, voué
à une profession même extérieure de vertu, un ascète enfin. Si la vie
monastique n'apparaît que vers la fin du IIIe siècle, c'est que, jusque-là,
l'église est un vrai monastère, une cité idéale où se pratique la vie
parfaite. Quand le siècle entrera en masse dans l'église, quand le concile de
Gangres, en 325, aura déclaré que les maximes de l'évangile sur la pauvreté,
sur le renoncement à la famille, sur la virginité, ne sont pas à l'adresse
des simples fidèles, les parfaits se créeront des lieux à part, où la vie
évangélique, trop haute pour le commun des hommes, puisse être pratiquée sans
atténuation. Le martyre avait offert, jusque-là, le moyen de mettre en
pratique les préceptes les plus exagérés du Christ, en particulier sur le mépris
des affections du sang ; le monastère va suppléer au martyre, pour que les
conseils de Jésus soient pratiqués quelque part. L'exemple de l'Égypte, où la
vie monastique avait toujours existé, put contribuer à ce résultat ; mais le
monachisme était dans l'essence même du christianisme. Dès que l'église
s'ouvrit à tous, il était inévitable qu'il se formât de petites églises pour
ceux qui prétendaient vivre comme Jésus et les apôtres de Jérusalem avaient
vécu. Une grosse lutte s'indiquait pour l'avenir. La piété chrétienne et l'honneur mondain seront deux antagonistes qui se livreront de rudes combats. Le réveil de l'esprit mondain sera le réveil de l'incrédulité. L'honneur se révoltera et soutiendra qu'il vaut bien cette morale qui permet d'être un saint sans être toujours un galant homme. Il y aura des voix de sirènes pour réhabiliter toutes les choses exquises que l'église a déclarées profanes au premier chef. On reste toujours un peu ce qu'on a été d'abord. L'église, association de saintes gens, gardera ce caractère, malgré toutes ses transformations. Le mondain sera son pire ennemi. Voltaire montrera que ces frivolités diaboliques, si sévèrement exclues d'une société piétiste, sont à leur manière bonnes et nécessaires. Le Père Canaye essaiera bien de montrer que rien n'est plus galant que le christianisme et qu'on n'est pas plus gentilhomme qu'un jésuite. Il ne convaincra pas d'Hocquincourt. En tout cas, les gens d'esprit seront inconvertissables. On n'amènera jamais Ninon de Lenclos, Saint-évremond, Voltaire, Mérimée, à être de la même religion que Tertullien, Clément d'Alexandrie et le bon Hermas. |