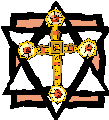
|
LE 5 AOÛT 178, le saint empereur quitta Rome pour
retourner, avec Commode, à ces interminables guerres du Danube qu'il voulait
couronner par la formation de provinces frontières solidement constituées.
Les succès furent éclatants. On semblait toucher au terme tant désiré, et qui
n'avait été retardé que par la révolte d'Avidius. Quelques mois encore et
l'entreprise militaire la plus importante du IIe siècle allait être terminée.
Malheureusement, l'empereur était très faible. Il avait l'estomac si ruiné,
qu'il vivait souvent un jour entier de quelques prises de thériaque. Il ne
mangeait que quand il avait à haranguer les soldats. Vienne sur le Danube
était, à ce qu'il semble, le quartier général de l'armée. Une maladie
contagieuse régnait dans le pays, depuis plusieurs années, et décimait les
légions. Le Le septième jour, il sentit sa fin approcher. Il ne reçut
plus que son fils, et il le congédia au bout de quelques instants, de peur de
le voir contracter le mal dont il était atteint ; peut-être ne fut-ce là
qu'un prétexte pour se délivrer de son odieuse présence. Puis il se couvrit
la tête comme pour dormir. La nuit suivante, il rendit l'âme. On rapporta son
corps à Rome et on l'enterra dans le mausolée d'Adrien. L'effusion de la
piété populaire fut touchante. Telle était l'affection qu'on avait pour lui,
qu'on ne le désignait jamais par son nom ou ses titres. Chacun selon son âge
l'appelait Marc mon père, Marc mon frère, Marc
mon fils. Le jour de ses obsèques, on ne versa presque point
de larmes, tous étant certains qu'il n'avait fait que retourner aux dieux,
qui l'avaient prêté un moment à la terre. Durant la cérémonie même des
funérailles, on le proclama dieu propice avec une spontanéité sans exemple.
On déclara sacrilège quiconque n'aurait pas, si ses moyens le lui
permettaient, son image dans sa maison. Et il n'en fut pas de ce culte comme
de tant d'autres apothéoses éphémères. Cent ans après, la statue de Marc Antonin
se voyait dans un grand nombre de laraires, entre les dieux pénates.
L'empereur Dioclétien avait pour lui un culte à part. Le nom d'Antonin
désormais fut sacré. Il devint, comme celui de César et d' Auguste, une sorte
d'attribut de l'empire, un signe de la souveraineté humaine et civile. Le
numen Antoninum fut comme l'astre bienfaisant de cet empire dont le programme
admirable resta, pour le siècle qui suivit, un reproche, une espérance, un
regret. On vit des âmes aussi peu poétiques que celle de Septime Sévère, en
rêver comme d'un ciel perdu. Même Constantin s'inclina devant cette divinité
clémente et voulut que la statue d'or des Antonins comptât parmi celles des
ancêtres et des tuteurs de son pouvoir, fondé pourtant sous de tout autres
auspices. Jamais culte ne fut plus légitime, et c'est le nôtre
encore aujourd'hui. Oui, tous tant que nous sommes, nous portons au coeur le
deuil de Marc-Aurèle, comme s'il était mort d'hier. Avec lui, la philosophie
a régné. Un moment, grâce à lui, le monde a été gouverné par l'homme le
meilleur et le plus grand de son siècle. Il est important que cette
expérience ait été faite. Le sera-t-elle une seconde fois ? La philosophie
moderne, comme la philosophie antique, arrivera-t-elle à régner à son tour ?
Aura-t-elle son Marc-Aurèle entouré de Frontons et de Junius Rusticus ? Le
gouvernement des choses humaines appartiendra-t-il encore une fois aux plus
sages ? Qu'importe, puisque ce règne serait d'un jour, et que le règne des
fous y succéderait sans doute une fois de plus ? Habituée à contempler d'un
oeil souriant l'éternel mirage des illusions humaines, la philosophie moderne
sait la loi des entraînements passagers de l'opinion. Mais il serait curieux
de rechercher ce qui sortirait de tels principes, si jamais ils arrivaient au
pouvoir. Il y aurait plaisir à construire a priori le Marc-Aurèle des temps
modernes, à voir quel mélange de force et de faiblesse créerait, dans une âme
d'élite appelée à l'action la plus large, le genre de réflexion particulier à
notre âge. On aimerait à voir comment la critique saurait s'allier à la plus
haute vertu et à l'ardeur la plus vive pour le bien, quelle attitude
garderait un penseur de cette école devant les problèmes sociaux du XIXe
siècle, par quel art il parviendrait à les tourner, à les endormir, à les
éluder ou à les résoudre. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'homme appelé à
gouverner ses semblables devra toujours méditer sur le modèle exquis de
souverain que Rome offrit en ses meilleurs jours. S'il est vrai qu'il soit
possible de le dépasser en certaines parties de la science du gouvernement,
qui n'ont été connues que dans les temps modernes, le fils d'Annius Verus
restera toujours inimitable par sa force d'âme, sa résignation, sa noblesse
accomplie et la perfection de sa bonté. Le jour de la mort de Marc-Aurèle peut être pris comme le
moment décisif où la ruine de la vieille civilisation fut décidée. En
philosophie, le grand empereur avait placé si haut l'idéal de la vertu, que
personne ne devait se soucier de le suivre ; en politique, faute d'avoir
séparé assez profondément les devoirs du père de ceux du césar, il rouvrit,
sans le vouloir, l'ère des tyrans et celle de l'anarchie. En religion, pour
avoir été trop attaché à une religion d'état, dont il voyait bien la
faiblesse, il prépara le triomphe violent du culte non officiel et il laissa
planer sur sa mémoire un reproche, injuste, il est vrai, mais dont l'ombre
même ne devrait pas se rencontrer dans une vie si pure. En tout, excepté dans
les lois, l'affaiblissement était sensible. Vingt ans de bonté avaient
relâché l'administration et favorisé les abus. Une certaine réaction dans le
sens des idées d'Avidius Cassius était nécessaire ; au lieu de cela, on eut
un total effondrement. Horrible déception pour les gens de bien ! Tant de vertu,
tant d'amour n'aboutissant qu'à mettre le monde entre les mains d'un
équarisseur de bêtes, d'un gladiateur ! Après cette belle apparition d'un
monde élyséen sur la terre, retomber dans l'enfer des Césars, qu'on croyait
fermé pour toujours ! La foi dans le bien fut alors perdue. Après Caligula,
après Néron, après Domitien, on avait pu espérer encore. Les expériences
n'avaient pas été décisives. Maintenant, c'est après le plus grand effort de
rationalisme gouvernemental, après quatre-vingt-quatre ans d'un régime
excellent, après Nerva, Trajan, Adrien, Antonin, Marc-Aurèle, que le règne du
mal recommence, pire que jamais. Adieu, vertu ; adieu, raison. Puisque Marc-Aurèle
n'a pas pu sauver le monde, qui le sauvera ? Maintenant, vivent les fous !
vive l'absurde ! vivent le Syrien et ses dieux équivoques ! Les médecins
sérieux n'ont rien pu faire. Le malade est plus mal que jamais. Faites venir
les empiriques ; ils savent souvent mieux que les praticiens honorables ce
qu'il faut au peuple. Ce qu'il y a de triste, en effet, c'est que le jour de la
mort de Marc-Aurèle, si lugubre pour la philosophie et la civilisation, fut
pour le christianisme un beau jour. Commode, ayant pris à tâche de faire en
tout le contraire de ce qu'il avait vu, se montra bien moins défavorable au
christianisme que son illustre père. Marc-Aurèle est le Romain accompli, avec
ses traditions et ses préjugés. Commode n'a pas de race. Il aimait les cultes
égyptiens ; lui-même, la tête rasée, présidait aux processions, portait
l'Anubis, accomplissait toutes les cérémonies où se plaisaient les
femmelettes. Il se fit représenter en cette attitude dans les mosaïques des
portiques circulaires de ses jardins. Il avait des chrétiens dans sa
domesticité. Sa maîtresse Marcia était presque chrétienne et se servit du
crédit que lui donnait l'amour pour soulager le sort des confesseurs
condamnés aux mines en Sardaigne. Le martyre des Scillitains qui eut lieu le Avec un principe moins désastreux que celui d'un
despotisme militaire sans frein, l'empire, même après la ruine du principe
romain par la mort de Marc-Aurèle, aurait pu vivre encore, donner la paix au
christianisme un siècle plus tôt qu'il ne le fit, éviter les flots de sang
que versèrent en pure perte Dèce et Dioclétien. Le rôle de l'aristocratie
romaine était fini ; après avoir usé la folie au Ier siècle, elle avait usé la
vertu au deuxième. Mais les forces cachées de la grande confédération
méditerranéenne n'étaient pas épuisées. De même que, après l'écroulement de
l'édifice politique bâti sur le titre de la famille d'Auguste, il se trouva
une dynastie provinciale, les Flavius, pour relever l'empire ; de même, après
l'écroulement de l'édifice bâti par les adoptions de la haute noblesse
romaine, il se trouva des provinciaux, des Orientaux, des Syriens, pour
relever la grande association où tous trouvaient paix et profit. Septime
Sévère refit sans élévation morale, mais non sans gloire, ce qu'avait fait
Vespasien. Certes, les hommes de cette dynastie nouvelle ne sont pas
comparables aux grands empereurs du IIe siècle. Même Alexandre Sévère, qui
égale Antonin et Marc en bonté, leur est bien inférieur en intelligence, en
noblesse. Le principe du gouvernement est détestable ; c'est la surenchère de
complaisance envers les légions, la révolte mise à prix ; on ne s'adresse au
soldat que la bourse au poing. Le despotisme militaire ne revêtit jamais de
forme plus éhontée ; mais le despotisme militaire peut avoir la vie longue. à
côté de spectacles hideux, sous ces empereurs syriens qu'on dédaigne, que de
réformes ! Quel progrès dans la législation ! Quel jour que celui (sous
Caracalla) où tout homme libre, habitant de l'empire, arrive à l'égalité des
droits ! Il ne faut pas s'exagérer les avantages qu'offrait alors cette
égalité ; les mots, cependant, ne sont jamais tout à fait vides en politique.
On héritait de choses excellentes. Les philosophes de l'école de Marc-Aurèle
avaient disparu ; mais les jurisconsultes les remplaçaient. Papinien, Ulpien,
Paul, Gaïus, Modestin, Florentinus, Marcien, pendant des années exécrables,
font des chefs-d'oeuvre et créent véritablement le droit de l'avenir. Très
inférieurs à Trajan et aux Antonins pour les traditions politiques, les
empereurs syriens, par cela même qu'ils ne sont pas Romains et n'ont rien des
préjugés romains, font souvent preuve d'une ouverture d'esprit que ne
pouvaient avoir les grands empereurs du IIe siècle, tous si profondément
conservateurs. Ils permettent, encouragent même les collèges ou syndicats. Se
laissant aller en cet ordre jusqu'à l'excès, ils voudraient des corps de
métiers organisés en castes, avec des costumes à part. Ils ouvrent à deux
battants les portes de l'empire. L'un d'eux, le fils de Mammée, ce bon et
touchant Alexandre Sévère, égale presque, par sa bonté plébéienne, les vertus
patriciennes des beaux siècles ; les plus hautes pensées pâlissent auprès des
droites effusions de son coeur. C'est surtout en religion que les empereurs dits syriens
inaugurent une largeur d'idées et une tolérance inconnues jusque-là. Ces
Syriennes d'Émèse, belles, intelligentes, téméraires jusqu'à l'utopie, Julia
Domna, Julia Maesa, Julia Mammaea, Julia Soémie, ne sont retenues par aucune
tradition ni convenance sociale. Elles osent ce que jamais Romaine n'avait
osé ; elles entrent au Sénat, y délibèrent, gouvernent effectivement
l'empire, rêvent de Sémiramis et de Nitocris. Voilà ce que n'eût pas fait une
Faustine, malgré sa légèreté ; elle eût été arrêtée par le tact, par le
sentiment du ridicule, par les règles de la bonne société romaine. Les
Syriennes ne reculent devant rien. Elles ont un sénat de femmes, qui édicte
toutes les extravagances. Le culte romain leur paraît froid et insignifiant.
N'y étant attachées par aucune raison de famille, et leur imagination se
trouvant plus en harmonie avec le christianisme qu'avec le paganisme italien,
ces femmes se complaisent en des récits de voyages de dieux sur la terre ;
Philostrate les enchante avec son Apollonius ; peut-être eurent-elles avec le
christianisme une secrète affiliation. Pendant ce temps, les dernières dames
respectables de l'ancienne société, comme cette vieille fille de Marc-Aurèle,
honorée de tous, que Caracalla fit tuer, assistaient obscures à une orgie qui
formait avec leurs souvenirs de jeunesse un si étrange contraste. Les
provinces et surtout les provinces d'Orient, bien plus actives et plus
éveillées que celles de l'Occident, prenaient définitivement le dessus.
Certes Héliogabale était un insensé ; et cependant sa chimère d'un culte
monothéiste central, établi à Rome et absorbant tous les autres cultes,
montrait que le cercle étroit des idées antonines était bien brisé. Mammée et
Alexandre Sévère iront plus loin ; pendant que les jurisconsultes continuent
de transcrire avec la quiétude de la routine leurs vieilles et féroces
maximes contre la liberté de conscience, l'empereur syrien et sa mère
s'instruiront du christianisme, lui témoigneront de la sympathie. Non content
d'accorder la sécurité aux chrétiens, Alexandre introduit Jésus dans son
laraire, par un éclectisme touchant. La paix semble faite, non comme sous
Constantin, par l'abaissement d'un des partis, mais par une large
réconciliation. Il y avait certes, dans tout cela, une audacieuse
tentative de réforme, rationnellement inférieure à celle des Antonins, mais
plus capable de réussir ; car elle était bien plus populaire, elle tenait
plus de compte de la province et de l'Orient. En une telle oeuvre
démocratique, des gens sans ancêtres comme ces Africains et ces Syriens
avaient plus de chance de succès que des gens raides et d'une tenue
irréprochable, tels que les empereurs aristocrates. Mais le vice profond du
système impérial se révéla pour la dixième fois. Alexandre Sévère fut
assassiné par les soldats le Alors s'ouvre cet enfer d'un demi-siècle (235-284), où
sombre toute philosophie, toute civilité, toute délicatesse. Le pouvoir à
l'encan, la soldatesque maîtresse de tout, par moments dix tyrans à la fois,
le barbare pénétrant par toutes les fissures d'un monde lézardé, Athènes
démolissant ses monuments anciens pour s'entourer de mauvais murs contre la
terreur des Goths. Si quelque chose prouve combien l'Empire romain était
nécessaire par raison intrinsèque, c'est qu'il ne se soit pas totalement
disloqué dans cette anarchie, c'est qu'il ait gardé assez de souffle pour
revivre sous la puissante action de Dioclétien et fournir encore une course
de deux siècles. Dans tous les ordres, la décadence est effroyable. En
cinquante ans, on a oublié de sculpter. La littérature latine cesse
complètement. Il semble qu'un mauvais génie couve sur cette société, boit son
sang et sa vie. Le christianisme prend pour lui ce qu'il y a de bon et
appauvrit d'autant l'ordre civil. L'armée se meurt faute d'un bon recrutement
d'officiers ; l'église attire tout. Les éléments religieux et moraux d'un
état ont une manière bien simple de punir l'état qui ne leur fait pas la
place à laquelle ils croient avoir droit : c'est de se retirer sous leur
tente ; car un état ne peut se passer d'eux. La société civile n'a dès lors
que le rebut des âmes. La religion absorbe tout ce qu'il y a de meilleur. On
se détache d'une patrie qui ne représente plus qu'un principe de force
matérielle. On choisit sa patrie dans l'idéal, ou plutôt dans l'institution
qui tient lieu de la cité et de la patrie écroulées. L'église devient
exclusivement le lien des âmes, et, comme elle grandit par les malheurs mêmes
de la société civile, on se console aisément de ces malheurs, où il est
facile de montrer une vengeance du Christ et de ses saints. S'il nous était permis de rendre le mal pour le mal, dit Tertullien, une seule nuit et quelques falots, c'en serait assez pour notre vengeance. On était patient, car on était sûr de l'avenir. Maintenant, le monde tue les saints ; mais demain les saints jugeront le monde. Regardez-nous bien tous au visage, pour nous reconnaître au jugement dernier, disait aux païens l'un des martyrs de Carthage. Notre patience, disaient les plus modérés, nous vient de la certitude d'être vengés ; elle amasse des charbons ardents sur la tête de nos ennemis. Quel jour que celui où le Très-Haut comptera ses fidèles, enverra les coupables à la géhenne et fera flamber nos persécuteurs au brasier des feux éternels ! Quel spectacle immense, quels seront mes transports, mon admiration et mon rire ! Que je trépignerai en voyant gémir au fond des ténèbres, avec Jupiter et leurs propres adorateurs, tant de princes que l'on disait reçus au ciel après leur mort ! Quelle joie de voir les magistrats persécuteurs du nom du Seigneur consumés par des flammes plus dévorantes que celles des bûchers allumés pour les chrétiens ! |