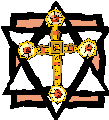MARC-AURÈLE OU LA FIN DU
XVI - Marc-Aurèle chez les Quades - Le livre des Pensées.
|
TROP PEU soucieux de ce qui se passait dans le reste du
monde, le gouvernement de Marc-Aurèle semblait n'exister que pour les progrès
de l'intérieur. Le seul grand empire organisé qui touchât aux frontières
romaines, celui des Parthes, cédait devant les légions. Lucius Verus et
Avidius Cassius conquéraient des provinces que Trajan n'avait occupées que
passagèrement, l'Arménie, L'expédition mal concertée de Varus (an 10 de J.-C.) et le
vide éternel qu'elle laissa dans les numéros des légions furent comme un épouvantail
qui détourna la pensée romaine de la grande Germanie. Tacite, seul, vit
l'importance de cette région pour l'équilibre du monde. Mais l'état de
division où étaient les tribus germaniques endormait les inquiétudes que les
esprits sagaces auraient dû concevoir. Tandis que ces peuplades, en effet,
plus portées vers l'indépendance locale que vers la centralisation, ne
formaient pas d'agrégat militaire, elles donnaient peu à craindre. Mais leurs
confédérations étaient redoutables. On sait quelles conséquences eut celle
qui se forma, au IIIe siècle, sur la rive droite du Rhin, sous le nom de
Francs. Vers l'an 166, une ligue puissante se forma en Bohême, en Moravie et
dans le nord de La digue crevait sur le Danube, dans la région de
l'Autriche et de C'est une vérité bien constatée que le progrès
philosophique des lois ne répond pas toujours à un progrès dans la force de
l'état. La guerre est chose brutale ; elle veut des brutaux ; souvent il
arrive ainsi que les améliorations morales et sociales entraînent un
affaiblissement militaire. L'armée est un reste de barbarie, que l'homme de
progrès conserve comme un mal nécessaire ; or, il est rare qu'on fasse avec
succès ce qu'on fait comme un pis aller. Antonin avait déjà une forte
aversion pour l'emploi des armes ; sous son règne, les moeurs des camps
s'amollirent beaucoup. On ne peut nier que l'armée romaine n'eût perdu sous Marc-Aurèle
une partie de sa discipline et de sa vigueur. Le recrutement se faisait
difficilement ; le remplacement et l'enrôlement des barbares avaient
entièrement changé le caractère de la légion ; sans doute le christianisme
soutirait déjà le meilleur des forces de l'état. Quand on songe qu'à côté de
cette décrépitude s'agitaient des bandes sans patrie, paresseuses au travail
de la terre, n'aimant qu'à tuer, ne cherchant que bataille, fût-ce contre
leurs congénères, il était clair qu'une grande substitution de races aurait
lieu. L'humanité civilisée n'avait pas encore assez dompté le mal pour
pouvoir s'abandonner au rêve du progrès par la paix et la moralité. Marc-Aurèle, devant cet assaut colossal de toute la
barbarie, fut vraiment admirable. Il n'aimait pas la guerre et ne la faisait
que malgré lui ; mais, quand il fallut, il la fit bien ; il fut grand
capitaine par devoir. Une effroyable peste se joignait à la guerre. Ainsi
éprouvée, la société romaine fit appel à toutes ses traditions, à tous les
rites ; il y eut, comme d'ordinaire à la suite des fléaux, une réaction en
faveur de la religion nationale. Marc-Aurèle s'y prêta. On vit le bon
empereur présider lui-même en qualité de grand pontife aux sacrifices,
prendre un fer de javelot dans le temple de Mars, le plonger dans le sang, le
lancer vers le point du ciel où était l'ennemi. On arma tout, esclaves,
gladiateurs, bandits, diogmites (agents de police) ; on soudoya des bandes
germaniques contre les Germains ; on fit argent des objets précieux du garde-
meuble impérial, pour éviter d'établir de nouveaux impôts. La vie de Marc-Aurèle presque entière se passa désormais
dans la région du Danube, à Carnonte près de Vienne, ou à Vienne même, sur
les bords du Gran, en Hongrie, parfois à Sirmium, Son ennui était immense ;
mais il savait vaincre son ennui. Ces insipides campagnes contre les Quades
et les Marcomans furent très bien conduites ; le dégoût qu'il en éprouvait ne
l'empêchait pas d'y mettre l'application la plus consciencieuse. L'armée
l'aimait et fit parfaitement son devoir. Modéré même envers les ennemis, il
préféra un plan de campagne long, mais sûr, à des coups foudroyants ; il
délivra complètement Il est probable que, de bonne heure, Marc tint un journal
intime de son état intérieur. Il y inscrivait, en grec, les maximes
auxquelles il recourait pour se fortifier, les réminiscences de ses auteurs
favoris, les passages des moralistes qui lui parlaient le plus, les principes
qui, dans la journée, l'avaient soutenu, parfois les reproches que sa
conscience scrupuleuse croyait avoir à s'adresser. On
se cherche des retraites solitaires, chaumières rustiques, rivages des mers,
montagnes ; comme les autres, tu aimes à rêver tout cela. Quelle naïveté,
puisqu'il t'est permis, à chaque heure, de te retirer en ton âme ? Nulle part
l'homme n'a de retraite plus tranquille, surtout s'il possède en lui-même de
ces choses dont la contemplation suffit pour rendre le calme. Sache donc
jouir de cette retraite, et là renouvelle tes forces. Qu'il y ait là de ces
maximes courtes, fondamentales, qui tout d'abord rendront la sérénité à ton
âme et te remettront en état de supporter avec résignation le monde où tu
dois revenir. Pendant les tristes hivers du Nord, cette consolation lui
devint encore plus nécessaire. Il avait passé cinquante ans ; la vieillesse
était chez lui prématurée. Un soir, toutes les images de sa pieuse jeunesse
remontèrent en son souvenir, et il passa quelques heures délicieuses à
supputer ce qu'il devait à chacun des êtres bons qui l'avaient entouré. Exemple de mon aïeul
Verus : douceur des moeurs, patience inaltérable. Qualités qu'on prisait
dans mon père, souvenir qu'il m'a laissé : modestie, caractère mâle. Souvenir de ma mère : sa
piété, sa bienfaisance ; pureté d'âme qui allait jusqu'à s'abstenir, non
seulement de faire le mal, mais même d'en concevoir la pensée ; vie frugale
et qui ressemblait si peu au luxe des riches. Puis lui apparaissaient tour à tour Diognète, qui lui
inspira le goût de la philosophie et rendit agréables à ses yeux le grabat,
la couverture consistant en une simple peau et tout l'appareil de la
discipline hellénique ; Junius Rusticus, qui lui apprit à éviter toute
affectation d'élégance dans le style et lui prêta les Entretiens d'épictète ;
Apollonius de Chalcis, qui réalisait l'idéal stoïcien de l'extrême fermeté et
de la parfaite douceur ; Sextus de Chéronée, si grave et si bon ; Alexandre
de Cotyée, qui reprenait avec une politesse si raffinée ; Fronton, qui lui apprit ce qu'il y a dans un tyran d'envie, de
duplicité, d'hypocrisie, et ce qu'il peut y avoir de dureté dans le coeur
d'un patricien ; son frère Severus, qui lui
fit connaître Thraséas, Helvidius, Caton, Brutus, qui lui donna l'idée de ce
qu'est un état libre, où la règle est l'égalité naturelle des citoyens et
l'égalité de leurs droits ; d'une monarchie qui respecte avant tout la
liberté des citoyens ; et, dominant tous les autres de sa grandeur
immaculée, Antonin, son père par adoption, dont il nous trace le portrait
avec un redoublement de reconnaissance et d'amour. Je remercie les dieux,
dit-il en terminant, de m'avoir donné de bons
aïeuls, de bons parents, une bonne soeur, de bons maîtres, et, dans mon
entourage, dans mes proches, dans mes amis, des gens presque tous remplis de
bonté. Jamais je ne me suis laissé aller à aucune marque d'égards envers eux
; par ma disposition naturelle, j'aurais pu, dans l'occasion, commettre
quelque irrévérence ; mais la bienfaisance des dieux n'a pas permis que la
circonstance s'en soit présentée. Je dois encore aux dieux d'avoir conservé
pure la fleur de ma jeunesse ; de ne m'être pas fait homme avant l'âge,
d'avoir même différé au-delà ; d'avoir été élevé sous la loi d'un prince et
d'un père qui devait dégager mon âme de toute fumée d'orgueil, me faire
comprendre qu'il est possible, tout en vivant dans un palais, de se passer de
gardes, d'habits resplendissants, de torches, de statues, m'apprendre enfin
qu'un prince peut presque resserrer sa vie dans les limites de celle d'un
simple citoyen, sans montrer pour cela moins de noblesse et moins de vigueur,
quand il s'agit d'être empereur et de traiter les affaires de l'état. Ils
m'ont donné de rencontrer un frère dont les moeurs étaient une continuelle
exhortation à veiller sur moi-même, en même temps que sa déférence et son
attachement devaient faire la joie de mon coeur... Si j'ai eu le bonheur d'élever ceux qui avaient soigné mon
éducation aux honneurs qu'ils semblaient désirer ; si j'ai connu Apollonius,
Rusticus, Maximus ; si, plusieurs fois, m'a été offerte, entourée de tant de
lumière, l'image d'une vie conforme à la nature (je suis resté en deçà du
but, il est vrai : mais c'est ma faute) ; si mon corps a résisté jusqu'à
cette heure à la rude vie que je mène ; si je n'ai touché ni à Benedicta ni à
Théodote ; si, malgré mes fréquents dépits contre Rusticus, je n'ai jamais
passé les bornes, ni rien fait dont j'aie eu à me repentir ; si ma mère, qui
devait mourir jeune, a pu néanmoins passer près de moi ses dernières années ;
si, chaque fois que j'ai voulu venir au secours de quelque personne pauvre ou
affligée, je ne me suis jamais entendu dire que l'argent me manquait ; si,
moi-même, je n'ai eu besoin de rien recevoir de personne ; si le sort m'a
donné une femme si complaisante, si affectueuse, si simple ; si j'ai trouvé
tant de gens capables pour l'éducation de mes enfants ; si, à l'origine de ma
passion pour la philosophie, je ne suis pas devenu la proie de quelque
sophiste, c'est aux dieux que je le dois. Oui, tant de bonheurs ne peuvent
être l'effet que de l'assistance des dieux et d'une heureuse fortune. Cette divine candeur respire à chaque page. Jamais on
n'écrivit plus simplement pour soi, à seule fin de décharger son coeur, sans
autre témoin que Dieu. Pas une ombre de système. Marc-Aurèle, à proprement
parler, n'a pas de philosophie ; quoiqu'il doive presque tout au stoïcisme
transformé par l'esprit romain, il n'est d'aucune école. Selon notre goût, il
a trop peu de curiosité ; car il ne sait pas tout ce que pouvait savoir un
contemporain de Ptolémée et de Galien ; il a sur le système du monde quelques
opinions qui n'étaient pas au niveau de la plus haute science de son temps.
Mais sa pensée morale, ainsi dégagée de tout lien avec un système, y gagne
une singulière élévation. L'auteur du livre de l'Imitation lui-même, quoique
fort détaché des querelles d'école, n'atteint pas jusque-là ; car sa manière
de sentir est essentiellement chrétienne ; ôtez les dogmes chrétiens, son
livre ne garde plus qu'une partie de son charme. Le livre de Marc-Aurèle,
n'ayant aucune base dogmatique, conservera éternellement sa fraîcheur. Tous,
depuis l'athée ou celui qui se croit tel, jusqu'à l'homme le plus engagé dans
les croyances particulières de chaque culte, peuvent y trouver des fruits
d'édification. C'est le livre le plus purement humain qu'il y ait. Il ne
tranche aucune question controversée. En théologie, Marc-Aurèle flotte entre
le déisme pur, le polythéisme interprété dans un sens physique, à la façon
des stoïciens, et une sorte de panthéisme cosmique. Il ne tient pas plus à
l'une des hypothèses qu'à l'autre, et il se sert indifféremment des trois
vocabulaires, déiste, polythéiste, panthéiste. Ses considérations sont
toujours à deux faces, selon que Dieu et l'âme ont ou n'ont pas de réalité. Quitter la société des hommes n'a rien de bien terrible,
s'il y a des dieux ; et, s'il n'y a pas de dieux, ou qu'ils ne s'occupent pas
des choses humaines, que m'importe de vivre dans un monde vide de dieux ou
vide de providence ? Mais certes, il y a des dieux, et ils ont à coeur les
choses humaines. C'est le dilemme que nous faisons à chaque heure ;
car, si c'est le matérialisme le plus complet qui a raison, nous qui aurons
cru au vrai et au bien, nous ne serons pas plus dupés que les autres. Si
l'idéalisme a raison, nous aurons été les vrais sages, et nous l'aurons été
de la seule façon qui nous convienne, c'est-à-dire sans nulle attente
intéressée, sans avoir compté sur une rémunération. Marc-Aurèle n'est donc pas un libre penseur ; c'est même à
peine un philosophe, dans le sens spécial du mot. Comme Jésus, il n'a pas de
philosophie spéculative ; sa théologie est tout à fait contradictoire ; il
n'a aucune idée arrêtée sur l'âme et l'immortalité. Comment fut-il profondément
moral sans les croyances qu'on regarde aujourd'hui comme les fondements de la
morale ? Comment fut-il éminemment religieux sans avoir professé aucun des
dogmes de ce qu'on appelle la religion naturelle ? C'est ce qu'il importe de
rechercher. Les doutes qui, au point de vue de la raison spéculative,
planent sur les vérités de la religion naturelle ne sont pas, comme Kant l'a
admirablement montré, des doutes accidentels, susceptibles d'être levés,
tenant, ainsi qu'on se l'imagine parfois, à certains états de l'esprit
humain. Ces doutes sont inhérents à la nature même de ces vérités et l'on
peut dire sans paradoxe que, s'ils étaient levés, les vérités auxquelles ils
s'attaquent disparaîtraient du même coup. Supposons, en effet, une preuve
directe, positive, évidente pour tous, des peines et des récompenses futures
; où sera le mérite de faire le bien ? Il n'y aurait que des fous qui, de
gaieté de coeur, courraient à leur damnation. Une foule d'âmes basses
feraient leur salut cartes sur table ; elles forceraient en quelque sorte la
main de Notre bon Marc-Aurèle, sur ce point comme sur tous les
autres, devança les siècles. Jamais il ne se soucia de se mettre d'accord
avec lui-même sur Dieu et sur l'âme. Comme s'il avait lu Est-ce à dire qu'il ne se révoltât pas quelquefois contre
le sort étrange qui s'est plu à laisser seuls face à face l'homme, avec ses
éternels besoins de dévouement, de sacrifice, d'héroïsme, et la nature, avec
son immoralité transcendante, son suprême dédain pour la vertu ? Non. Une
fois du moins l'absurdité, la colossale iniquité de la mort le frappa. Mais
bientôt son tempérament, complètement mortifié, reprend le dessus, et il se
calme. Comment se fait-il que les dieux,
qui ont ordonné si bien toutes choses et avec tant d'amour pour les hommes,
aient négligé un seul point, à savoir que les hommes d'une vertu éprouvée,
qui ont eu pendant leur vie une sorte de commerce avec Ah ! c'est trop de résignation, cher maître. S'il en est
véritablement ainsi, nous avons le droit de nous plaindre. Dire que, si ce
monde n'a pas sa contrepartie, l'homme qui s'est sacrifié pour le bien ou le
vrai doit le quitter content et absoudre les dieux, cela est trop naïf. Non,
il a le droit de les blasphémer ! Car enfin, pourquoi avoir ainsi abusé de sa
crédulité ? Pourquoi avoir mis en lui des instincts trompeurs, dont il a été
la dupe honnête ? Pourquoi cette prime accordée à l'homme frivole ou méchant
? C'est donc celui-ci qui ne se trompe pas, qui est l'homme avisé ?... Mais
alors maudits soient les dieux qui placent si mal leurs préférences ! Je veux
que l'avenir soit une énigme ; mais, s'il n'y a pas d'avenir, ce monde est un
affreux guet-apens. Remarquez, en effet, que notre souhait n'est pas celui du
vulgaire grossier. Ce que nous voulons, ce n'est pas de voir le châtiment du
coupable, ni de toucher les intérêts de notre vertu. Ce que nous voulons n'a
rien d'égoïste : c'est simplement d'être, de rester en rapport avec la
lumière, de continuer notre pensée commencée, d'en savoir davantage, de jouir
un jour de cette vérité que nous cherchons avec tant de travail, de voir le
triomphe du bien que nous avons aimé. Rien de plus légitime. Le digne
empereur, du reste, le sentait bien. Quoi ! la
lumière d'une lampe brille jusqu'au moment où elle s'éteint, et ne perd rien
de son éclat ; et la vérité, la justice, la tempérance, qui sont en toi,
s'éteindraient avec toi ! Toute la vie se passa pour lui dans cette
noble hésitation. S'il pécha, ce fut par trop de piété. Moins résigné, il eût
été plus juste ; car, sûrement, demander qu'il y ait un spectateur intime et
sympathique des luttes que nous livrons pour le bien et le vrai, ce n'est pas
trop demander. Il est possible aussi que, si sa philosophie eût été moins
exclusivement morale, si elle eût impliqué une étude plus curieuse de
l'histoire et de l'univers, elle eût évité certains excès de rigueur. Comme
les ascètes chrétiens, Marc-Aurèle pousse quelquefois le renoncement jusqu'à
la sécheresse et à la subtilité. Ce calme qui ne se dément jamais, on sent
qu'il est obtenu par un immense effort. Certes, le mal n'eut jamais pour lui
nul attrait ; il n'eut à combattre aucune passion : Quoi
qu'on fasse ou quoi qu'on dise, écrit-il, il
faut que je sois homme de bien, comme l'émeraude peut dire : Quoi qu'on dise ou qu'on fasse, il faut
bien que je sois émeraude et que je garde ma couleur. Mais, pour
se tenir toujours sur le sommet glacé du stoïcisme, il lui fallut faire de
cruelles violences à la nature et en retrancher plus d'une noble partie.
Cette perpétuelle répétition des mêmes raisonnements, ces mille images sous
lesquelles il cherche à se représenter la vanité de toute chose, ces preuves
souvent naïves de l'universelle frivolité, témoignent des combats qu'il eut à
livrer pour éteindre en lui tout désir. Parfois il en résulte quelque chose
d'âpre et de triste ; la lecture de Marc-Aurèle fortifie, mais ne console pas
; elle laisse dans l'âme un vide à la fois délicieux et cruel, qu'on
n'échangerait pas contre la pleine satisfaction. L'humilité, le renoncement,
la sévérité pour soi-même n'ont jamais été poussés plus loin. La gloire,
cette dernière illusion des grandes âmes, est réduite à néant. Il faut faire
le bien sans s'inquiéter si personne le saura. Il voit que l'histoire parlera
de lui ; mais de combien d'indignes ne parle-t-elle pas ? L'absolue
mortification où il était arrivé avait éteint en lui jusqu'à la dernière
fibre de l'amour-propre. On peut même dire que cet excès de vertu lui a nui.
Les historiens l'ont pris au mot. Peu de grands règnes ont été plus
maltraités par l'historiographie. Marius Maximus et Dion Cassius parlèrent de
Marc avec amour, mais sans talent ; leurs ouvrages, d'ailleurs, ne nous sont
parvenus qu'en lambeaux, et nous ne connaissons la vie de l'illustre
souverain que par la médiocre biographie de Jules Capitolin, écrite cent ans
après sa mort, grâce à l'admiration que lui avait vouée l'empereur Dioclétien. Heureusement la petite cassette qui renfermait les pensées des bords du Gran et la philosophie de Carnonte fut sauvée. Il en sortit ce livre incomparable, où épictète était surpassé, ce manuel de la vie résignée, cet évangile de ceux qui ne croient pas au surnaturel, qui n'a pu être bien compris que de nos jours. Véritable évangile éternel, le livre des Pensées ne vieillira jamais ; car il n'affirme aucun dogme. L'évangile a vieilli en certaines parties ; la science ne permet plus d'admettre la naïve conception du surnaturel qui en fait la base. Le surnaturel n'est dans les Pensées qu'une petite tache insignifiante, qui n'atteint pas la merveilleuse beauté du fond. La science pourrait détruire Dieu et l'âme, que le livre des Pensées resterait jeune encore de vie et de vérité. La religion de Marc-Aurèle, comme le fut par moments celle de Jésus, est la religion absolue, celle qui résulte du simple fait d'une haute conscience morale placée en face de l'univers. Elle n'est ni d'une race ni d'un pays. Aucune révolution, aucun progrès, aucune découverte ne pourront la changer. |