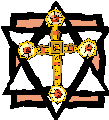MARC-AURÈLE OU LA FIN DU
IX - Suite de marcionisme - Apelle.
|
EXCELLENT pour produire la consolation et l'édification
individuelles, le gnosticisme était très faible comme église. Il ne pouvait
en sortir ni presbytérat ni épiscopat ; des idées aussi désordonnées ne
produisaient que des conciliabules de dogmatiseurs. Marcion seul réussit à
élever un édifice compact sur ce fond fuyant. Il y eut une église marcionite,
fortement organisée. Sûrement cette église fut entachée de quelque défaut
grave qui la fit mettre au ban de l'église du Christ. Ce n'est pas sans
raison que tous les fondateurs de l'épiscopat se réunissent en un sentiment
commun, l'aversion contre Marcion. La métaphysique ne dominait pas assez ces
sortes d'esprits pour qu'il n'y eût en cela, de leur part, qu'une simple
haine théologique. Mais le temps est bon juge ; le marcionisme dura. Il fut,
ainsi que l'arianisme, une des grandes fractions du christianisme, et non,
comme tant d'autres sectes, un météore bizarre et passager. Marcion, tout en restant fidèle à quelques principes qui
constituaient pour lui l'essence du christianisme, varia plus d'une fois dans
sa théologie. Il semble qu'il n'imposait à ses disciples aucun symbole bien
arrêté. Après sa mort, les divisions intérieures de la secte furent extrêmes.
Potitus et Basilique restèrent fidèles au dualisme ; Synérôs admit trois
natures, sans qu'on sache au juste comment il s'exprimait ; Apelle revint
décidément à la monarchie. Il avait d'abord été personnellement disciple de
Marcion ; mais il était doué d'un esprit trop indépendant pour rester
disciple ; il rompit avec son maître et quitta son église. Ces ruptures
étaient, hors de la communion catholique, des accidents qui arrivaient tous
les jours. Les ennemis d'Apelle essayèrent de faire croire qu'il avait été
chassé et que la cause de son excommunication fut une liberté de moeurs qui
contrastait avec la sévérité du maître. On parla beaucoup d'une vierge
Philumène, dont les séductions l'auraient entraîné à tous les égarements, et
qui aurait joué près de lui le rôle d'une Priscille ou d'une Maximille. Rien n'est
plus douteux. Rhodon, son adversaire orthodoxe, qui le connut, le présente
comme un vieillard vénérable par la règle ascétique de sa vie. Rhodon parle
de Philumène et la présente comme une vierge possédée, dont Apelle admit
réellement les inspirations comme divines. Pareils accidents de crédulité
arrivèrent aux docteurs les plus austères, en particulier à Tertullien. Le langage symbolique des doctrines gnostiques prêtait,
d'ailleurs, à de graves malentendus et donna souvent lieu à des méprises de
la part des orthodoxes, intéressés à calomnier de si dangereux ennemis. Ce ne
fut pas impunément que Simon le Magicien joua sur l'allégorie d'Hélène-Ennoia
; Marcion fut peut-être victime d'un quiproquo du même ordre, L'imagination
philosophique un peu changeante d'Apelle put aussi faire dire que,
poursuivant une amante volage, Philumène, il quitta la vérité pour courir
après de périlleuses aventures. Il est permis de supposer qu'il donnait pour
cadre à ses enseignements les révélations d'un personnage symbolique, qu'il
appelait Philouméné (la vérité aimée). Il est sûr, au moins, que les paroles
prêtées par Rhodon à notre docteur sont celles d'un honnête homme, d'un
sincère ami de la vérité. Après avoir quitté l'école de Marcion, Apelle se
rendit à Alexandrie, essaya une sorte d'éclectisme entre les idées
incohérentes qui défilèrent devant lui et revint ensuite à Rome. Il ne cessa
de remanier toute sa vie la théologie de son maître, et il semble qu'il finit
par une lassitude des théories métaphysiques qui, selon nos idées, le
rapprochait de la vraie philosophie. Les deux grandes erreurs de Marcion,
comme de la plupart des premiers gnostiques, étaient le dualisme et le
docétisme. Par la première, il donnait d'avance la main au manichéisme, par
la seconde à l'islam. Les docteurs marcionites et gnostiques de la fin du IIe
siècle essaient, en général, d'atténuer ces deux erreurs. Les derniers
basilidiens en venaient à un panthéisme pur. L'auteur du roman
pseudo-clémentin, malgré sa théologie bizarre, est un déiste. Hermogène se
débattait gauchement au milieu des insolubles questions soulevées par la
doctrine de l'incarnation. Apelle, dont les idées se rapprochent parfois
beaucoup de celles du faux Clément, cherche de même à échapper aux subtilités
de la gnose, en maintenant avec force les principes de ce qu'on peut appeler
la théologie du bon sens. L'unité absolue de Dieu est le dogme fondamental d'Apelle.
Dieu est la bonté parfaite ; le monde ne reflétant pas suffisamment cette
bonté, le monde ne saurait être son oeuvre. Le vrai monde créé par Dieu est
un monde supérieur, peuplé d'anges. Le principal de ces anges est l'ange
glorieux, sorte de démiurge ou de Logos créé, créateur à son tour du monde
visible ; celui-ci n'est qu'une imitation manquée du monde supérieur. Apelle
évitait ainsi le dualisme de Marcion et se plaçait dans une situation
intermédiaire entre le catholicisme et la gnose. Il corrigeait réellement le
système de Marcion et donnait à ce système une certaine conséquence ; mais il
tombait dans bien d'autres difficultés. Les âmes humaines, selon Apelle,
faisaient partie de la création supérieure, dont elles étaient déchues par la
concupiscence. Pour les ramener à lui, Dieu a envoyé son Christ dans la
création inférieure. Christ est venu ainsi améliorer l'oeuvre manquée et
tyrannique du démiurge. Apelle rentrait ici dans la doctrine classique du
marcionisme et du gnosticisme, selon laquelle l'oeuvre essentielle du Christ
a été de détruire le culte du démiurge, c'est-à-dire le judaïsme. L'Ancien
Testament et le Nouveau lui paraissent deux ennemis. Le Dieu des juifs, comme
le Dieu des catholiques (aux yeux d'Apelle, ces derniers étaient des
judaïsants), est un dieu pervers, auteur du péché et de la chair. L'histoire
juive est l'histoire du mal ; les prophètes eux-mêmes sont des inspirés de
l'esprit mauvais. Le Dieu du bien ne s'est pas révélé avant Jésus. Apelle
accordait à Jésus un corps céleste élémentaire, en dehors des lois ordinaires
de la physique, bien que doué d'une pleine réalité. À diverses reprises, Apelle paraît avoir senti que cette
doctrine de l'opposition radicale des deux Testaments avait quelque chose de
trop absolu, et, comme ce n'était pas un esprit obstiné, peu à peu il en vint
à des idées que saint Paul n'eût peut-être point repoussées. En certains
moments, l'Ancien Testament lui semblait plutôt incohérent et contradictoire
que décidément mauvais ; si bien que l'oeuvre du Christ aurait été d'y faire
le discernement du bien et du mal, conformément à ce mot si souvent cité par
les gnostiques : Soyez de bons trapézistes. De même que Marcion avait écrit
ses Antithèses pour montrer l'incompatibilité des deux Testaments, Apelle
écrivit ses Syllogismes, vaste compilation des passages faibles du
Pentateuque, destinée surtout à montrer l'inconstance de l'ancien législateur
et son peu de philosophie. Apelle y déploya une critique très subtile,
rappelant parfois celle des incrédules du XVIIIe siècle. Les difficultés que
présentent les premiers chapitres de Esprit trop juste pour le monde sectaire où il s'était
engagé, Apelle était condamné à changer toujours. Sur la fin de sa vie, il
désespéra tout à fait des écritures. Même son idée fondamentale de l'unité
divine vacilla devant lui, et il arriva, sans s'en douter, à la parfaite
sagesse, c'est-à-dire au dégoût des systèmes et au bon sens. Rhodon, son
adversaire, nous a raconté une conversation qu'il eut avec lui à Rome vers
180. Le vieil
Apelle, dit-il, s'étant abouché avec nous, nous lui montrâmes qu'il se
trompait en beaucoup de choses, si bien qu'il fut réduit à dire qu'il ne
fallait pas si fort examiner les matières de la religion, que chacun devait
demeurer dans sa croyance, que ceux-là seraient sauvés qui espéraient dans le
crucifié, pourvu qu'ils fussent trouvés gens de bien. Il avouait que le point
le plus obscur pour lui était ce qui concernait Dieu. Il n'admettait comme
nous qu'un seul principe... Où est la preuve de tout cela, lui demandai-je,
et qu'est-ce qui te permet d'affirmer qu'il n'y a qu'un seul principe ? Il
m'avoua alors que les prophéties ne peuvent nous rien apprendre de vrai,
puisqu'elles se contredisent et se renversent elles-mêmes ; que cette
assertion : Il n'y a qu'un principe, était plutôt chez lui l'effet d'un
instinct que d'une connaissance positive. Lui ayant demandé par serment de
dire la vérité, il me jura qu'il parlait sincèrement, qu'il ne savait pas
comment il n'y a qu'un seul Dieu non engendré, mais qu'il le croyait. Pour
moi, je lui reprochai en riant de se donner le titre de maître, sans pouvoir
alléguer aucune preuve en faveur de sa doctrine. Pauvre Rhodon ! C'était l'hérétique Apelle qui, ce
jour-là, lui donnait une leçon de bon goût, de tact et de vrai christianisme.
L'élève de Marcion était réellement guéri, puisqu'à une creuse Gnosis il
préférait la foi, l'instinct secret de la vérité, l'amour du bien,
l'espérance dans le crucifié. Ce qui donnait une certaine force à des idées comme celles
d'Apelle, c'est qu'elles n'étaient, à beaucoup d'égards, qu'un retour à saint
Paul. Il n'est pas douteux que saint Paul, ressuscitant à l'heure du
christianisme où nous sommes arrivés, n'eût trouvé que le catholicisme
faisait à l'Ancien Testament trop de concessions. Il eût protesté et soutenu
qu'on revenait au judaïsme, qu'on versait du vin nouveau dans de vieilles
outres, qu'on supprimait la différence de l'évangile et de Sévère semble avoir été un gnostique attardé plus encore
qu'un marcionite. Prépon l'Assyrien niait la naissance du Christ et soutenait
que, l'an 15 du règne de Tibère, Jésus descendit du ciel en la figure d'un
homme tout formé. Le marcionisme, ainsi que le gnosticisme, en était à la
seconde génération. Ces deux sectes n'auront plus désormais aucun docteur
illustre. Toutes les grandes fantaisies écloses sous Adrien disparaissaient
comme des songes. Les naufragés de ces petites églises aventureuses s'accrochaient
avidement aux bords de l'église catholique et y rentraient. Les écrivains
ecclésiastiques avaient sur eux l'avantage qu'ont auprès des foules ceux qui
ne cherchent pas et ne doutent pas. Irénée, Philippe de Gortyne, Modestus,
Méliton, Rhodon, Théophile d'Antioche, Bardesane, Tertullien, se donneront
pour tâche de démasquer ce qu'on appelait les ruses infernales de Marcion, et
s'interdiront dans leur langage aucune violence. Bien que frappée à mort,
l'église de Marcion resta longtemps, en effet, une communauté distincte à
côté de l'église catholique. Durant des siècles, il y eut, dans toutes les
provinces de l'Orient, des communautés chrétiennes qui s'honorèrent de porter
le nom de Marcion, et écrivirent ce nom sur le fronton de leurs synagogues. Ces églises montraient des
successions d'évêques comparables aux listes dont se glorifiait l'église
catholique. Elles avaient des martyrs, des vierges, tout ce qui constituait
la sainteté. Les fidèles y menaient une vie austère, affrontaient la mort,
portaient le sac monastique, s'imposaient des jeûnes rigoureux et
s'abstenaient de tout ce qui avait eu vie. Ce sont des frelons qui imitent les ruches
des abeilles, disaient les orthodoxes. Ces loups se revêtent de la peau des brebis
qu'ils tuent, disaient d'autres. Comme les montanistes, les
marcionites se fabriquaient de faux écrits apostoliques, de faux psaumes.
Inutile de dire que cette littérature hérétique a péri tout entière. Au IVe et au Ve siècle, la secte, vivace encore, est combattue avec énergie, comme un fléau actuel, par Jean Chrysostome, saint Basile, saint épiphane, Théodoret, l'Arménien Eznig, le Syrien Boud le Périodeute. Mais les exagérations la perdaient. Une horreur générale des oeuvres du Créateur portait les marcionites aux abstinences les plus absurdes. C'étaient, à beaucoup d'égards, de purs encratites ; ils s'interdisaient le vin, même dans les mystères. On leur prouvait que, pour être conséquents, ils auraient dû se laisser mourir de faim. Ils réitéraient le baptême comme moyen de justification et permettaient aux femmes d'officier dans les églises. Mal gardés contre la superstition, ils tombèrent dans la magie et l'astrologie. On les confondait peu à peu avec les manichéens. |