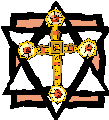LA VIE DE
CHAPITRE XI.
Le royaume de Dieu conçu comme l’avènement des pauvres.
|
Ces maximes, bonnes pour un pays où la vie se nourrit d’air et de jour, ce communisme délicat d’une troupe d’enfants de Dieu, vivant en confiance sur le sein de leur père, pouvaient convenir à une secte naïve, persuadée à chaque instant que son utopie allait se réaliser. Mais il est clair qu’elles ne pouvaient rallier l’ensemble de la société. Jésus comprit bien vite, en effet, que le monde officiel de son temps ne se prêterait nullement à son royaume. Il en prit son parti avec une hardiesse extrême. Laissant là tout ce monde au cœur sec et aux étroits préjugés, il se tourna vers les simples. Une vaste substitution de race aura lieu. Le royaume de Dieu est fait : 1° pour les enfants et pour ceux qui leur ressemblent ; 2° pour les rebutés de ce monde, victimes de la morgue sociale, qui repousse l’homme bon, mais humble ; 3° pour les hérétiques et schismatiques, publicains, samaritains, païens de Tyr et de Sidon. Une parabole énergique expliquait cet appel au peuple et le légitimait[1] : Un roi a préparé un festin de noces et envoie ses serviteurs chercher les invités. Chacun s’excuse ; quelques-uns maltraitent les messagers. Le roi alors prend un grand parti. Les gens comme il faut n’ont pas voulu se rendre à son appel ; eh bien! ce seront les premiers venus, des gens recueillis sur les places et les carrefours, des pauvres, des mendiants, des boiteux, n’importe ; il faut remplir la salle, et je vous le jure, dit le roi, aucun de ceux qui étaient invités ne goûtera mon festin. Le pur ébionisme, c’est-à-dire la doctrine que les pauvres (ébionim) seuls seront sauvés, que le règne des pauvres va venir, fut donc la doctrine de Jésus. Malheur à vous, riches, disait-il, car vous avez votre consolation ! Malheur à vous qui êtes maintenant rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous gémirez et vous pleurerez[2]. Quand tu fais un festin, disait-il encore, n’invite pas tes amis, tes parents, tes voisins riches ; ils te réinviteraient, et tu aurais ta récompense. Mais quand tu fais un repas, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux, les aveugles ; et tant mieux pour toi s’ils n’ont rien à te rendre, car le tout te sera rendu dans la résurrection des justes[3]. C’est peut-être dans un sens analogue qu’il répétait souvent : Soyez de bons banquiers[4], c’est-à-dire : Faites de bons placements pour le royaume de Dieu, en donnant vos biens aux pauvres, conformément au vieux proverbe : Donner au pauvre, c’est prêter à Dieu[5]. Ce n’était pas là, du reste, un fait nouveau. Le mouvement
démocratique le plus exalté dont l’humanité ait gardé le souvenir (le seul aussi qui ait
réussi, car seul il s’est tenu dans le domaine de l’idée pure),
agitait depuis longtemps la race juive. La pensée que Dieu est le vengeur du
pauvre et du faible contre le riche et le puissant se retrouve à chaque page
des écrits de l’Ancien Testament. L’histoire d’Israël est de toutes les histoires
celle où l’esprit populaire a le plus constamment dominé. Les prophètes,
vrais tribuns et en un sens les plus hardis tribuns, avaient tonné sans cesse
contre les grands et établi une étroite relation d’une part entre les mots de
riche, impie, violent, méchant, de
l’autre entre les mots de pauvre, doux, humble,
pieux[6].
Sous les Séleucides, les aristocrates ayant presque tous apostasié et passé à
l’hellénisme, ces associations d’idées ne firent que se fortifier. Le Livre
d’Hénoch contient des malédictions plus violentes encore que celles de
l’Évangile contre le monde, les riches, tes puissants[7]. Le luxe y est
présenté comme un crime. Le Fils de l’homme,
dans cette Apocalypse bizarre, détrône les rois, les arrache à leur vie
voluptueuse, les précipite dans l’enfer[8]. L’initiation de On entrevoit sans peine, en effet, que ce goût exagéré de pauvreté ne pouvait être bien durable. C’était là un de ces éléments d’utopie comme il s’en mêle toujours aux grandes fondations, et dont le temps fait justice. Transporté dans le large milieu de la société humaine, le christianisme devait un jour très facilement consentir à posséder des riches dans son sein, de même que le bouddhisme, exclusivement monacal à son origine, en vint très vite, dès que les conversions se multiplièrent, à admettre des laïques. Mais on garde toujours la marque de ses origines. Bien que vite dépassé et oublié, l’ébionisme laissa dans toute l’histoire des institutions chrétiennes un levain qui ne se perdit pas. La collection des Logia ou discours de Jésus se forma dans le milieu ébionite de la Batanée[12]. La pauvreté resta un idéal dont la vraie lignée de Jésus ne se détacha plus. Ne rien posséder fut le véritable état évangélique ; la mendicité devint une vertu, un état saint. Le grand mouvement ombrien du XIIIe siècle, qui est, entre tous les essais de fondation religieuse, celui qui ressemble le plus au mouvement galiléen, se passa tout entier au nom de la pauvreté. François d’Assise, l’homme du monde qui, par son exquise bonté, sa communion délicate, fine et tendre avec la vie universelle, a le plus ressemblé à Jésus, fut un pauvre. Les ordres mendiants, les innombrables sectes communistes du moyen âge (Pauvres de Lyon, Bégards, Bons-Hommes, Fraticelles, Humiliés, Pauvres évangéliques, etc.), groupés sous la bannière de l’Évangile Éternel, prétendirent être et furent en effet les vrais disciples de Jésus. Mais cette fois encore les plus impossibles rêves de la religion nouvelle furent féconds. La mendicité pieuse, qui cause à nos sociétés industrielles et administratives de si fortes impatiences, fut, à son jour et sous le ciel qui lui convenait, pleine de charme. Elle offrit à une foule d’âmes contemplatives et douces le seul état qui leur convienne. Avoir fait de la pauvreté un objet d’amour et de désir, avoir élevé le mendiant sur l’autel et sanctifié l’habit de l’homme du peuple, est un coup de maître dont l’économie politique peut n’être pas fort touchée, mais devant lequel le vrai moraliste ne peut rester indifférent. L’humanité, pour porter son fardeau, a besoin de croire qu’elle n’est pas complètement payée par son salaire. Le plus grand service qu’on puisse lui rendre est de lui répéter souvent qu’elle ne vit pas seulement de pain. Comme tous les grands hommes, Jésus avait du goût pour le peuple et se sentait à l’aise avec lui. L’évangile dans sa pensée est fait pour les pauvres ; c’est à eux qu’il apporte la bonne nouvelle du salut[13]. Tous les dédaignés du judaïsme orthodoxe étaient ses préférés. L’amour du peuple, la pitié pour son impuissance, le sentiment du chef démocratique, qui sent vivre en lui l’esprit de la foule et se reconnaît pour son interprète naturel, éclatent à chaque instant dans ses actes et ses discours[14]. La troupe élue offrait en effet un caractère fort mêlé et dont les rigoristes devaient être très surpris. Elle comptait dans son sein des gens qu’un juif qui se respectait n’eût pas fréquentés[15]. Peut-être Jésus trouvait-il dans cette société en dehors des règles communes plus de distinction et de cœur que dans une bourgeoisie pédante, formaliste, orgueilleuse de son apparente moralité. Les pharisiens, exagérant les prescriptions mosaïques, en étaient venus à se croire souillés par le contact des gens moins sévères qu’eux ; on touchait presque pour les repas aux puériles distinctions des castes de l’Inde. Méprisant ces misérables aberrations du sentiment religieux, Jésus aimait à dîner chez ceux qui en étaient les victimes[16] ; on voyait à table à côté de lui des personnes que l’on disait de mauvaise vie, peut-être pour cela seul, il est vrai, qu’elles ne partageaient pas les ridicules des faux dévots. Les pharisiens et les docteurs criaient au scandale. Voyez, disaient-ils, avec quelles gens il mange ! Jésus avait alors de fines réponses, qui exaspéraient les hypocrites : Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecin[17] ; ou bien : Le berger qui a perdu une brebis sur cent laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres pour courir après la perdue, et, quand il l’a trouvée, il la rapporte avec joie sur ses épaules[18] ; ou bien : Le fils de l’homme est venu sauver ce qui était perdu[19] ; ou encore : Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pêcheurs[20] ; enfin cette délicieuse parabole du fils prodigue, où celui qui a failli est présenté comme ayant une sorte de privilège d’amour sur celui qui a toujours été juste. Des femmes faibles ou coupables, surprises de tant de charme, et goûtant pour la première fois le contact plein d’attrait de la vertu, s’approchaient librement de lui. On s’étonnait qu’il ne les repoussât pas. Oh ! se disaient les puritains, cet homme n’est point un prophète ; car, s’il l’était, il s’apercevrait bien que la femme qui le touche est une pécheresse. Jésus répondait par la parabole d’un créancier qui remit à ses débiteurs des dettes inégales, et il ne craignait pas de préférer le sort de celui à qui fut remise la dette la plus forte[21]. Il n’appréciait les états de l’âme qu’en proportion de l’amour qui s’y mêle. Des femmes, le cœur plein de larmes et disposées par leurs fautes aux sentiments d’humilité, étaient plus près de son royaume que les natures médiocres, lesquelles ont souvent peu de mérite à n’avoir point failli. On conçoit, d’un autre côté, que ces âmes tendres, trouvant dans leur conversion à la secte un moyen de réhabilitation facile, s’attachaient à lui avec passion. Loin qu’il cherchât à adoucir les murmures que soulevait son dédain pour les susceptibilités sociales du temps, il semblait prendre plaisir à les exciter. Jamais on n’avoua plus hautement ce mépris du monde, qui est là condition des grandes choses et de la grande originalité. Il ne pardonnait au riche que quand le riche, par suite de quelque préjugé, était mal vu de la société[22]. Il préférait hautement les gens de vie équivoque et de peu de considération aux notables orthodoxes. « Des publicains et des courtisanes, leur disait-il, vous précéderont dans le royaume de Dieu. Jean est venu ; des publicains et des courtisanes ont cru en lui, et malgré cela vous ne vous êtes pas convertis[23] ». On comprend combien le reproche de n’avoir pas suivi le bon exemple que leur donnaient des filles de joie, devait être sanglant pour des gens faisant profession de gravité et d’une morale rigide. Il n’avait aucune affectation extérieure, ni montre
d’austérité. Il ne fuyait pas la joie, il allait volontiers aux
divertissements des mariages. Un de ses miracles fut fait pour égayer une
noce de petite ville. Les noces en Orient ont lieu le soir. Chacun porte une
lampe ; les lumières qui vont et viennent font un effet fort agréable.
Jésus aimait cet aspect gai et animé, et tirait de là des paraboles[24]. Quand on
comparaît une telle conduite à celle de Jean Baptiste, on était scandalisé[25]. Un jour que les
disciples de Jean et les Pharisiens observaient le jeûne : Comment se fait-il, lui dit-on, que tandis que les disciples de Jean et des Pharisiens
jeûnent et prient, les tiens mangent et boivent ? — Laissez-les, dit Jésus ; voulez-vous faire jeûner les paranymphes de l’époux,
pendant que l’époux est avec eux. Des jours viendront où l’époux leur sera
enlevé ; ils jeûneront alors[26]. Sa douce gaieté
s’exprimait sans cesse par des réflexions vives, d’aimables plaisanteries. A qui, disait-il, sont
semblables les hommes de cette génération, et à qui les comparerai-je ?
Ils sont semblables aux enfants assis sur les places, qui disent à leurs
camarades : Voici que nous chantons, Et vous ne dansez pas. Voici que nous pleurons, Et vous ne pleurez pas[27]. Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et vous dîtes : C’est un fou. Le Fils de l’homme est venu, vivant comme tout le inonde, et vous dites : C’est un mangeur, un buveur de vin, l’ami des douaniers et des pécheurs. Vraiment, je vous l’assure, la sagesse n’est justifiée que par ses œuvres[28]. Il parcourait ainsi La religion naissante fut ainsi à beaucoup d’égards un mouvement de femmes et d’enfants. Ces derniers faisaient autour de Jésus comme une jeune garde pour l’inauguration de son innocente royauté, et lui décernaient de petites ovations auxquelles il se plaisait fort, l’appelant fils de David, criant Hosanna[34], et portant des palmes autour de lui. Jésus, comme Savonarole, les faisait peut-être servir d’instruments à des missions pieuses ; il était bien aise de voir ces jeunes apôtres, qui ne le compromettaient pas, se lancer en avant et lui décerner des titres qu’il n’osait prendre lui-même. Il les laissait dire, et quand on lui demandait s’il entendait, il répondait d’une façon évasive que la louange qui sort de jeunes lèvres est la plus agréable à Dieu[35]. Il ne perdait aucune occasion de répéter que les petits sont des êtres sacrés[36], que le royaume de Dieu appartient aux enfants[37], qu’il faut devenir enfant pour y entrer[38], qu’on doit le recevoir en enfant[39], que le Père céleste cache ses secrets aux sages et les révèle aux petits[40]. L’idée de ses disciples se confond presque pour lui avec celle d’enfants[41]. Un jour qu’ils avaient entre eux une de ces querelles de préséance qui n’étaient point rares, Jésus prit un enfant, le mit au milieu d’eux, et leur dit : Voilà le plus grand ; celui qui est humble comme ce petit est le plus grand dans le royaume du ciel[42]. C’était l’enfance, en effet, dans sa divine spontanéité,
dans ses naïfs éblouissements de joie, qui prenait possession de la terre.
Tous croyaient à chaque instant que le royaume tant désiré allait poindre.
Chacun s’y voyait déjà assis sur un trône[43] à côté du
maître. On s’y partageait les places[44] ; on cherchait
à supputer les jours. Cela s’appelait |