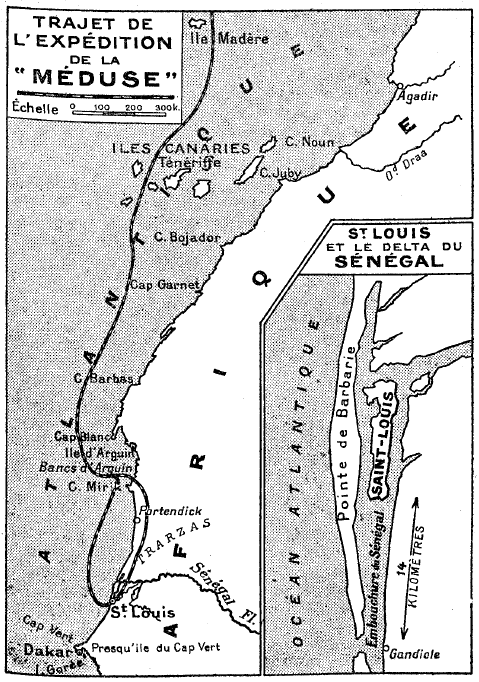LE RADEAU DE LA MÉDUSE
PREMIÈRE PARTIE. — LE NAUFRAGE
CHAPITRE IV. — VAINS EFFORTS.
|
La Méduse échouée, on amena toutes les voiles, on dépassa les mâts de perroquet, on recala ceux de hune. Ayant ainsi descendu tous les hauts mâts, on travailla à alléger le plus possible la frégate ; on défonça les pièces à eau qui se trouvaient dans la cale et on s'attela aux pompes. Les embarcations furent mises à la mer ; elles étaient toutes en bon état, sauf la chaloupe qui avait grand besoin d'être calfatée : on s'y activa aussitôt. La nuit tomba sur ces entrefaites. Le 3 juillet, à l'aube, la manœuvre commença. Le commandant projetait de dégager son navire en le faisant reculer sur des ancres que l'on irait mouiller en arrière, le plus loin qu'il se pourrait. On ne devait pas compter, en effet, sur la marée : l'accident était survenu au moment où la mer se trouvait le plus élevée et maintenant la frégate déjaugeait d'un mètre. Cet étiage allait encore diminuer. L'équipage vira au cabestan : l'ancre fixée à l'arrière céda presque tout de suite. On décida de reprendre l'opération avec ampleur. Deux canots furent chargés de porter une ancre de bossoir à une plus grande distance ; on la plaça en cravate derrière l'un d'eux, que l'on soutint avec un chapelet de barriques vides. Mais la mer était déjà moins étale, le vent soufflait. Les embarcations, surchargées, dérivaient sous les lames, perdaient leur direction. Elles ne purent mouiller l'ancre solidement l'une de ses extrémités touchait déjà le fond, tandis que le joli, fixé à l'arrière du canot, était encore hors de l'eau. Pas plus que la précédente, elle ne résista au cabestan, elle revint, râclant le fond qui cédait, mêlé de vase grisâtre et de petits coquillages. Il serait vraiment bien difficile de ramener la Méduse sur les accores du banc, jusqu'au point où elle recommencerait à flotter ! Les officiers de terre et de mer tinrent conseil : MM. de Chaumareys, Schmaltz, Poincignon, Reynaud, Lapeyrère, Maudet, Chaudière, Espiaux et Richefort. A la fin de l'après- midi, ils élaborèrent un nouveau projet. Au lieu de s'évertuer à amener le vaisseau jusqu'à Saint-Louis, pourquoi ne pas s'y transporter par d'autres moyens ? Les passagers étaient nombreux ? Qu'à cela ne tienne ! M. Schmaltz crayonna rapidement, sur le petit cabestan de l'arrière, le plan d'un radeau ou d'un raz-d'eau, comme on écrivait à cette époque, qui pourrait porter deux cents hommes et des vivres. Les autres deux cents hommes seraient répartis dans les six embarcations de la frégate. Aux heures des repas, les canots et la chaloupe viendraient prendre leurs rations sur le radeau. Le temps se montrait favorable. La côte, on la savait toute proche. On atterrirait en quelques heures. Une fois débarqués, le bataillon, les marins, les fonctionnaires se formeraient en caravane avec les armes et les munitions que l'on emporterait, et la colonne se dirigerait sur Saint-Louis. Ce plan, exposé avec beaucoup d'assurance, parut des plus réalisables : il ne concordait nullement avec les traditions de la marine. Si M. de Chaumareys les eût mieux connues, il ne se serait pas rallié aux conclusions du colonel Schmaltz. Son devoir primordial, en effet, était de ne pas abandonner son navire, et, dès le premier moment, d'expédier la chaloupe, sous les ordres d'un officier, pour réclamer du secours soit à Gorée, soit à Saint-Louis. Nul doute que le reste de la division, dont on avait eu le grand tort de se séparer, ne tarderait pas à venir à l'aide de la Méduse et de ses passagers. Malheureusement, on crut alors possible de traîner à travers les vagues un énorme radeau surchargé d'hommes le simple bon sens eût dû démontrer que cette machine à convoyer serait épuisante pour les avirons par temps calme, et que, par tempête, elle risquait de faire tout sombrer. Mais on n'examina rien avec sérieux. Les uns ne songeaient qu'à évacuer un navire qu'ils estimaient en perdition ; les autres pensaient que, grâce au radeau, on allégerait considérablement la frégate et que l'on parviendrait ainsi à la renflouer ; bref, tout conspirait à faire adopter le dessein désastreux de M. Schmaltz. On se remit donc au travail avec rage : les vergues, la beaume, toutes les pièces de bois qui composaient la drôme furent débarquées. On conserva seulement les deux basses vergues en place pour servir de béquilles au navire échoué. La seconde nuit allait troubler les esprits, les acheminer vers l'idée de fuite. Elle fut franchement mauvaise. Le vent fraîchit. La mer grossit. Des paquets de lames inondèrent le pont. A tel point que, chacun, à tout instant, se voyait obligé de cesser le travail pour saisir une bite ou un taquet et de s'y cramponner. L'impression dominait qu'il fallait se hâter d'abandonner cette épave si l'on voulait s'échapper aux flots. Aussi la journée du 4 juillet fut-elle fébrilement consacrée à la construction du radeau, que menèrent à bien quarante hommes sous la direction d'un officier. Cette énorme et sinistre machine désormais historique était composée des mâts de hune de la Méduse, vergues, jumelles, beaume, etc. Quatre d'entre eux étaient réunis deux par deux au centre ; deux autres à quelque distance formaient les bords. D'autres pièces de bois, solidement arrimées, s'allongeaient entre ces organes essentiels, et, au-dessus d'elles, des planches, clouées tant bien que mal, constituaient une espèce de bastingage, d'ailleurs beaucoup trop bas. Sur les côtés, une petite drôme de quarante centimètres environ servait de garde-fou. Pour renforcer la résistance de l'ensemble, des madriers avaient été fixés en travers, qui, de chaque côté, dépassaient de trois mètres environ. Ils nuiraient à la marche du radeau et le rendraient impropre à toute manœuvre. Cependant, afin de donner à cette plate-forme flottante un aspect vaguement navigable, on lui fabriqua une sorte d'avant en pointe, avec deux vergues de perroquets, dont les extrémités furent fortement assujetties. On prévit également une mâture : le cacatois de perruche et le grand cacatois furent jetés sur le radeau, afin d'aider à sa marche, si le vent venait à souffler vers le rivage. Ainsi fut exécuté le plan du colonel. Il coûta beaucoup d'efforts, car les dimensions de la machine étaient considérables vingt mètres de long sur sept de large, et il fallait en prémunir la construction contre les plus violents coups de mer. Toutefois, avant de l'utiliser, on voulut tenter encore de dégager le navire. Après l'avoir allégé follement des barils de farine, des pièces à eau, des quarts de poudre à canon, objet de traite pour le Sénégal, on commença à le tirer au cabestan sur une ancre que les canots étaient allés mouiller assez loin dans la direction Nord-Ouest. Le grelin frappé sur son anneau venait par le devant de la frégate et tendait à la faire éviter, tandis qu'une autre ancre, beaucoup plus forte, dont le câble passait par une des ouvertures de la poupe, maintenait son arrière et l'empêchait de courir en avant. Sous l'influence de ces deux forces conjuguées, la Méduse effectua un léger mouvement sur bâbord, ce qui décupla toutes les énergies. Marins, passagers, soldats se relayèrent au cabestan : à leur grande joie, le malheureux vaisseau commença d'éviter d'une manière sensible. Hourra ! On redoubla d'efforts. Il évita entièrement et présenta son avant au large. Il était presque à flot, ayant bougé de deux cents mètres environ, seul son arrière touchait encore... ratait-ce le salut ? Hélas ! Il fallut s'arrêter, car maintenant on se trouvait trop près de l'ancre, et, en tirant davantage, on l'eût soulevée. Si une touée avait été élongée plus au large, on aurait pu continuer à haler dessus, et la Méduse eût flotté librement. Allégée de vingt à trente centimètres, elle pesait à peine sur sa quille... Mais on dut s'arrêter la mer baissa et la frégate se reposa de nouveau, inclinée sur le sable. On devait épiloguer longtemps sur les causes de cet échec définitif. Le navire aurait pu être allégé bien davantage et avec plus de méthode. De nombreux barils de farine y avaient été laissés, malgré leur poids considérable. M. Schmaltz s'était formellement opposé à ce qu'on les jetât à la mer, car le futur gouverneur du Sénégal les destinait à combattre la disette qui régnait dans les comptoirs européens. Cependant ces barils auraient pu provisoirement être mis à la mer en chapelets, avec des palans de bouts de vergues. On les aurait repris après le dégagement de la Méduse. La farine qu'ils contenaient n'en aurait pas été gâtée, car, une fois plongée dans l'eau, elle aurait formé autour du bois une croûte assez épaisse, résultat de l'humidité, et l'intérieur n'aurait été nullement atteint. D'autre part, pourquoi ne pas immerger les quatorze canons de vingt-quatre qui alourdissaient énormément le navire ? On avait essayé des chapelets de barils ; puis, sur l'avis de quelqu'un, on y renonça. Ce travail, d'un résultat incertain, prenait beaucoup de temps. Quant aux canons, il avait semblé sacrilège d'y toucher. Il est facile de reconstituer que, durant toutes ces tentatives, la dualité de commandement avait multiplié ordres et contre-ordres. L'autorité s'énervait. La discipline se relâchait. Là où il aurait fallu un chef calme, sûr de lui-même, il n'y avait plus qu'un homme terriblement diminué par ses premières fautes, et dont chacun, à propos de tout, se méfiait. Ainsi sur un nouvel échec se termina la journée épuisante du 4 juillet. La nuit fut pire. L'océan, si paisible durant le jour, se déchaîna tout à coup, sous les vents venus du large. La Méduse, violemment balayée par des montagnes d'eau, sursautait comme une bête blessée et donnait de furieux coups de talon, qui rompirent sa quille en deux parties. A ces craquements effroyables répondaient des coups venant de l'arrière : le gouvernail démonté n'y était plus retenu que par ses chaînes et frappait dans la poupe comme un bélier. A cet assaut imprévu, les cloisons crevèrent ; tout l'arrière du parquet de la chambre du commandant fut soulevé... La mer commença d'envahir l'entrepont. Et le suprême espoir de salut, le radeau, le radeau que l'on venait d'achever de bâtir avec tant de peines, rompit ses amarres et flotta à la dérive. Il fallut mettre les canots à la mer pour le ramener. En voyant cette manœuvre, vers onze heures du soir, les soldats du bataillon furent pris d'épouvante. Ils crurent que la frégate, effroyablement secouée, allait se rompre et couler à pic, et que l'équipage commençait à les abandonner. Ils poussèrent des cris de fureur, saisirent leurs armes, houspillèrent leurs officiers. Envahissant le pont balayé par les lames, ils en occupèrent les issues, jurèrent que personne ne quitterait le navire avant eux. Commencement d'émeute au milieu de la tempête. Il devait justifier, ou servir à essayer de justifier une part des cruelles mesures qui allaient suivre. De quoi se composait le bataillon destiné à l'occupation du Sénégal ? Certains, dont le dessein apparaît trop fortement appuyé, ont représenté ce corps colonial ainsi qu'un ramassis de forbans, écume de la population et de l'armée, de gens recrutés dans les bagnes et marqués déjà au fer rouge. C'était fournir un singulier motif de consolation à leur perte, à leurs souffrances, à leur immolation. Leurs officiers ont protesté contre ces renseignements infamants, au nom de l'honneur de l'armée. On ne peut se dissimuler qu'à cette époque, les conceptions militaires de l'ancien régime avaient résisté aux levées en masse de la Révolution, à la conscription impériale. Les troupes destinées aux colonies particulièrement ne se distinguaient point par ce que l'on pourrait appeler un recrutement d'élite ; elles comprenaient des soldats venus d'un peu partout, des Espagnols, des Italiens, voire des noirs. On leur appliquait une discipline assez brutale. Les idées aristocratiques reparaissaient ici, non point pour élever au-dessus d'eux une caste nobiliaire, mais pour faire de leurs chefs une race privilégiée. Ils n'avaient donc pas tout à fait tort de croire que, dans des circonstances extrêmes, on n'hésiterait pas à les sacrifier. Toutefois, le moment n'était pas venu. On réprima le mieux possible leur fureur et leur désespoir ; on leur assura que le radeau allait être ramené, et qu'il suffirait largement avec les embarcations du bord à évacuer la Méduse, si la frégate paraissait vraiment en danger. Ils se calmèrent peu à peu, déposèrent leurs armes et attendirent le jour.
|