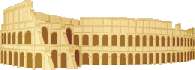CONSIDÉRATIONS
Sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence
CHAPITRE XVII - Changement dans l'état.
|
Pour prévenir les trahisons continuelles des soldats, les
Empereurs s’associèrent des personnes en qui ils avaient confiance, et
Dioclétien, sous prétexte de la grandeur des affaires, régla qu’il y aurait
toujours deux empereurs et deux césars. II jugea que, les quatre principales
armées étant occupées par ceux qui auraient part à l’empire, elles
s’intimideraient les unes les autres ; que les autres armées, n’étant pas
assez fortes pour entreprendre de faire leur chef empereur, elles perdraient
peu à peu la coutume d’élire ; et qu’enfin, la dignité de césar étant
toujours subordonnée, la puissance, partagée entre quatre pour la sûreté du
Gouvernement, ne serait pourtant, dans toute son étendue, qu’entre les mains
de deux. Mais ce qui contint encore plus les gens de guerre, c’est
que, les richesses des particuliers et la fortune publique ayant diminué, les
Empereurs ne purent plus leur faire des dons si considérables ; de manière
que la récompense ne fût plus proportionnée au danger de faire une nouvelle
élection. D’ailleurs, les préfets du prétoire, qui, pour le pouvoir
et pour les fonctions, étaient, à peu près, comme les grands vizirs de ces
temps-là et faisaient à leur gré massacrer les Empereurs pour se mettre en
leur place, furent fort abaissés par Constantin, qui ne leur laissa que les
fonctions civiles et en fit quatre au lieu de deux. La vie des Empereurs commença donc à être plus assurée ;
ils purent mourir dans leur lit, et cela sembla avoir un peu adouci leurs
moeurs : ils ne versèrent plus le sang avec tant de férocité. Mais, comme il
fallait que ce pouvoir immense débordât quelque part, on vit un autre genre
de tyrannie, mais plus sourde. Ce ne furent plus des massacres, mais des
jugements iniques, des formes de justice qui semblaient n’éloigner la mort
que pour flétrir la vie. Ce faste et cette pompe asiatiques s’établissant, les yeux
s’y accoutumèrent d’abord, et, lorsque Julien voulut mettre de la simplicité
et de la modestie dans ses manières, on appela oubli de la dignité ce qui
n’était que la mémoire des anciennes moeurs. Quoique, depuis Marc-Aurèle, il
y eût eu plusieurs empereurs, il n’y avait eu qu’un Empire, et, l’autorité de
tous étant reconnue dans les provinces, c’était une puissance unique exercée
par plusieurs. Mais Galère et Constance Chlore n’ayant pu s’accorder, ils partagèrent
réellement l’Empire[2] ; et, par cet exemple,
qui fut dans la suite suivi par Constantin, qui prit le plan de Galère, et
non pas celui de Dioclétien, il s’introduisit une coutume qui fut moins un
changement qu’une révolution. De plus, l’envie qu’eut Constantin de faire une
ville nouvelle, la vanité de lui donner son nom, le déterminèrent à porter en
Orient le siège de l’empire. Quoique l’enceinte de Rome ne fût pas à beaucoup
près si grande qu’elle est à présent, les faubourgs en étaient
prodigieusement étendus[3] : l’Italie,
pleine de maisons de plaisance, n’était proprement que le jardin de Rome ;
les laboureurs étaient en Sicile, en Afrique, en Égypte[4] ; et les
jardiniers, en Italie. Les terres n’étaient presque cultivées que par les
esclaves des citoyens romains. Mais, lorsque le siège de l’empire fut établi
en Orient, Rome presque entière y passa : les Grands y menèrent leurs
esclaves, c’est-à-dire presque tout le peuple, et l’Italie fut privée de ses
habitants. Pour que la nouvelle ville ne cédât en rien à l’ancienne,
Constantin voulut qu’on y distribuât aussi du blé, et ordonna que celui
d’Égypte serait envoyé à Constantinople, et celui de l’Afrique, à Rome ; ce
qui, me semble, n’était pas fort sensé. Dans le temps de Constantin[9], après avoir
affaibli la capitale, frappa un autre coup sur les frontières : il ôta les
légions qui étaient sur le bord des grands fleuves, et les dispersa dans les
provinces ; ce qui produisit deux maux : l’un, que la barrière qui contenait
tant de nations fut ôtée ; et l’autre, que les soldats[10] vécurent et
s’amollirent dans le cirque et dans les théâtres[11]. Lorsque
Constantius envoya Julien dans les Gaules, il trouva que cinquante villes le
long du Rhin[12]
avaient été prises par les Barbares ; que les provinces avaient été saccagées
; qu’il n’y avait plus que l’ombre d’une armée romaine, que le seul nom des
ennemis faisait fuir. Ce prince, par sa sagesse, sa constance, son économie,
sa conduite, sa valeur et une suite continuelle d’actions héroïques, rechassa
les Barbares[13],
et la terreur de son nom les contint tant qu’il vécut[14]. La brièveté des règnes, les divers partis politiques, les
différentes religions, les sectes particulières de ces religions, ont fait
que le caractère des Empereurs est venu à nous extrêmement défiguré. Je n’en
donnerai que deux exemples : cet Alexandre, si lâche dans Hérodien, paraît
plein de courage dans Lampridius ; ce Gratien, tant loué par les Orthodoxes,
Philostorgue le compare à Néron. Valentinien sentit plus que personne la
nécessité de l’ancien plan : il employa toute sa vie à fortifier les bords du
Rhin, à y faire des levées, y bâtir des châteaux, y placer des troupes, leur
donner le moyen d’y subsister. Mais il arriva dans le monde un événement qui
détermina Valens, son frère, à ouvrir le Danube et eut d’effroyables suites.
Dans le pays qui est entre les Palus-Méotides, les montagnes du Caucase et D’abord, des corps innombrables de Huns passèrent, et, rencontrant les Goths les premiers, ils les chassèrent devant eux. Il semblait que ces nations se précipitassent les unes sur les autres, et que l’Asie, pour peser sur l’Europe, eût acquis un nouveau poids. Les Goths, effrayés, se présentèrent sur les bords du Danube et, les mains jointes, demandèrent une retraite. Les flatteurs de Valens saisirent cette occasion et la lui représentèrent comme une conquête heureuse d’un nouveau peuple qui venait défendre l’Empire et l’enrichir[19]. Valens ordonna qu’ils passeraient sans armes ; mais, pour de l’argent, ses officiers leur en laissèrent tant qu’ils voulurent[20]. Il leur fit distribuer des terres ; mais, à la différence des Huns, les Goths n’en cultivaient point[21] ; on les priva même du blé qu’on leur avait promis ; ils mouraient de faim, et ils étaient au milieu d’un pays riche ; ils étaient armés, et on leur faisait des injustices. Ils ravagèrent tout, depuis le Danube jusqu’au Bosphore, exterminèrent Valens et son armée, et ne repassèrent le Danube que pour abandonner l’affreuse solitude qu’ils avaient faite[22]. |