LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS
TOME IV — LES INSTITUTIONS DE L’ANTIQUITÉ
LA GUERRE. — V. - LES ARMÉES ROMAINES
|
LA DÉCLARATION DE GUERRE. - LA LEVÉE DES HOMMES. - ORGANISATION DE L’ARMÉE. - LES CAMPS. - LES MACHINES DE GUERRE. - LA FLOTTE. - LE TRIOMPHE. - LES ENNEMIS DES ROMAINS. LA DÉCLARATION DE GUERRE. — Les Romains ne commençaient jamais une guerre sans l’avoir solennellement déclarée par l’intermédiaire de prêtres nommés féciaux. Ces prêtres faisaient l’office de hérauts et étaient revêtus du caractère sacré qu’ont toujours eu les ambassadeurs. Tite-Live rapporte ainsi le cérémonial qui s’accomplissait dans cette occasion : Le fécial, arrivé sur le territoire du peuple contre lequel on a des sujets de plainte, se couvre la tête d’un voile de laine. Il dit : Entends-moi, Jupiter ; entends-moi, contrée (il nomme le peuple qui l’habite), et vous, religion sainte. Je suis l’envoyé du peuple romain. Chargé d’une mission juste et pieuse, je viens la remplir ; qu’on ajoute foi en mes paroles. Alors il expose ses griefs. Puis, prenant Jupiter à témoin : Si j’enfreins, dit-il, les lois de la justice et de la religion, en exigeant que tels hommes, que telles choses me soient livrés, moi, l’envoyé du peuple romain, ne permets pas, grand dieu, que je puisse jamais revoir ma patrie. Voilà ce qu’il dit en mettant le pied sur le territoire. Il le répète au premier habitant qu’il rencontre ; il le répète aux portes de la ville, dans la place publique ; il le répète, à quelques changements près, dans la formule et dans le serment. Si on ne lui donne point ce qu’il demande, au bout de trente-trois jours, car ce nombre est solennellement prescrit, il fait la déclaration suivante : Entends-moi, Jupiter, et toi Junon, Quirinus, vous tous, dieux du ciel, de la terre et des enfers, entendez-moi. Je vous prends à témoin que ce peuple (il le nomme) est injuste, et qu’il se refuse à d’équitables réclamations. Au reste, le sénat de ma patrie, légalement convoqué, avisera au moyen de les faire valoir. Le férial revenait ensuite pour attendre la décision du sénat, et si la majorité votait pour la guerre, il était chargé d’en informer définitivement l’ennemi. L’usage était alors, continue Tite-Live, que le férial se transportât aux confins du territoire ennemi avec une javeline ferrée, ou avec un pieu durci au feu et ensanglanté. Là, en présence de trois jeunes gens au moins, il disait : Puisque ce peuple (il le nomme) s’est permis d’injustes agressions, que le peuple romain a ordonné la guerre contre ce peuple, que le sénat du peuple romain l’a proposée, décrétée, arrêtée, moi, au nom du peuple romain, je la déclare et je commence les hostilités. En disant ces mots, il lançait sa javeline sur le territoire ennemi. LA LEVÉE DES HOMMES. — Les romains formaient un peuple essentiellement militaire. Tout citoyen âgé de seize à quarante-six ans était inscrit sur les contrôles de l’armée et pouvait être appelé chaque fois qu’on avait besoin de lui. Nul n’était admis à remplir une fonction publique s’il n’avait préalablement servi dans les armées. Dans l’origine, comme les citoyens étaient tenus de s’équiper eux-mêmes, l’armement n’était pas le même. pour tous les combattants, qui étaient répartis en plusieurs classes, déterminées par la fortune personnelle. Tite-Live décrit ainsi le classement de l’armée romaine au commencement de la république : Tous ceux qui avaient cent mille as de revenu et au delà formèrent quatre-vingts centuries, la moitié de jeunes gens, l’autre d’hommes plus âgés. Ces quatre-vingts centuries composèrent la première classe. Les vieillards étaient destinés pour la garde de la ville, les jeunes gens pour faire la guerre au dehors. On leur prescrivit, pour armes défensives, le casque, le bouclier, la bottine, la cuirasse de cuivre, et pour armes offensives la lance et l’épée. On y joignit deux centuries d’ouvriers, qui n’étaient point armés et qui se chargeaient du transport des machines de guerre. La seconde classe était composée de ceux qui avaient depuis soixante-quinze mille as de revenu jusqu’à cent exclusivement. Elle comprenait vingt centuries, tant d’hommes faits que de jeunes gens ; ils portaient l’écu au lieu du bouclier, et, à l’exception de la cuirassé qu’ils n’avaient pas, les autres armes étaient les mêmes. Le revenu fixé pour la troisième classe était de cinquante mille as ; il y avait le même nombre de centuries, la même séparation pour les âges, enfin les mêmes armes : seulement on leur supprima les bottines. La quatrième classe, dont le revenu se bornait à vingt-cinq mille as, conserva le même nombre de centuries, mais les armes furent changées ; on ne leur donna que la lance et pépée. Le nombre des centuries fut augmenté dans là cinquième classe : il y en avait trente. Ils n’avaient d’autres armes que la fronde et les pierres. On porta dans cette classe les accensi, les cors, les trompettes, distribués en trois centuries. Le revenu était fixé à onze mille as. Tous ceux qui en avaient un moindre furent réunis dans une seule centurie exempte du service militaire. On voit que les hommes absolument pauvres n’étaient pas astreints au service militaire, au moins pendant les premiers temps de la République. Il en était de même des affranchis et à plus forte raison des esclaves. Les riches ne cherchaient nullement à se soustraire au service militaire qu’ils considéraient au contraire comme un honneur et un privilège. Mais lorsqu’au lieu d’avoir à défendre ses foyers ou à combattre des ennemis qui étaient en même temps des voisins, on commença à faire des campagnes plus longues, parce qu’elles étaient plus lointaines, il fut nécessaire d’établir une solde pour l’armée. Cette solde, d’abord très minime, fut peu à peu augmentée, à cause de l’impossibilité où étaient des soldats laissés en garnison dans des villes lointaines de revenir cultiver leur champ ou exercer un métier quelconque pour subvenir à leur existence. A partir de Marius et des grandes guerres civiles, la composition de l’armée se modifia sensiblement. Les soldats se recrutèrent peu à peu parmi les habitants des provinces conquises. A la fin de l’empire, les véritables Romains avaient complètement disparu des armées qui se composaient à peu près exclusivement d’auxiliaires barbares. L’organisation des légions était restée la même, mais l’ancien patriotisme avait disparu et les soldats n’étaient plus que des mercenaires vendant leurs services au chef qui leur offrait le plus d’avantages. Il est donc nécessaire, lorsqu’on veut étudier les institutions militaires des Romains, de ne tenir compte ni de la première période historique, pendant laquelle l’armée n’est pas encore constituée, ni de la dernière pendant laquelle son organisation se ressent nécessairement de la décomposition générale de l’empire.
La cohorte prétorienne, fondée par Scipion l’Africain, était une sorte de gardé d’honneur qui ne devait jamais quitter le général en chef. Primitivement elle ne comprenait que cinq ou six cents hommes qui avaient tous fait leurs preuves sur les champs de bataille ; les prétoriens étaient exemptés des corvées et travaux du camp, et recevaient une paye plus forte que les autres soldats. Leur nombre fut augmenté pendant les guerres civiles et Auguste les logea à Rome où ils furent réunis dans un camp spécial. Leurs privilèges s’accrurent encore par la suite, et comme ils étaient attachés à la personne de l’empereur ils finirent par devenir une véritable puissance. Ce furent les prétoriens qui, après le meurtre de Caligula, portèrent Claude au pouvoir, et ce furent eux qui plus tard mirent l’empire à l’encan. Constantin, après sa victoire sur Maxence, abolit cette milice turbulente et détruisit son camp. La figure 354 montre des soldats de la garde prétorienne, d’après un bas-relief du Louvre.
Avant la bataille, il était d’usage que le général en chef, entouré de ses officiers, fit aux troupes une allocution pour enflammer leur courage. Pour être plus facilement aperçu, il montait sur un tertre, quand le terrain s’y prêtait, et quand le sol était plat on dressait une estrade sur laquelle il se plaçait pour faire sa harangue. Les auteurs anciens font tous mention de cet usage et les monuments montrent plusieurs représentations qui s’y rattachent. C’est ainsi que sur la colonne Antonine on voit l’empereur en train de faire une allocution. Il tient en main la lance et, recouvert de son manteau de campagne, il parle à ses soldats placés au bas de son estrade (fig. 355).
ORGANISATION DE L’ARMÉE.
— L’armée romaine a été dès l’origine divisée en légions, mais le nombre des
soldats qui composaient une légion a varié suivant les temps. Le nombre des
légions a naturellement suivi la même progression que la puissance militaire
de Rome. Malheureusement tout ce qui concerne Romulus et les premiers rois de
Rome ressemble tellement à la légende, qu’il est impossible de rien affirmer
sur ces époques reculées ; on ne peut consulter à cet égard que la tradition.
D’après les récits les plus accrédités il n’y aurait eu d’abord à Rome qu’une
seule légion composée de trois mille hommes. Après la réunion des Sabins,
Rome aurait eu trois légions, comprenant chacune tro Pour la cavalerie, on prenait un homme sur dix fantassins. Chaque légion avait ainsi trois compagnies équestres. Au reste, les écrivains anciens n’ont rapporté que des traditions assez vagues sur cette période. La légion comprit quatre mille hommes environ, à partir de Servius Tullius ; ce nombre fut élevé à cinq mille après la bataille de Cannes, et Marius le porta à six mille hommes, nombre qui a toujours été maintenu sous l’empire. Ainsi constituée, la légion comprenait dix cohortes de six cents hommes ; chaque cohorte se divisait en trois manipules de deux cents hommes, chaque manipule en deux centuries, chaque centurie en dix décuries. Le nombre des légions s’est augmenté avec la puissance romaine. Sous l’empire elles étaient ainsi distribuées : trois en Bretagne, seize sur les frontières du Rhin et du Danube, huit sur l’Euphrate, trois en Égypte, en Afrique et en Espagne. Mais ce nombre a varié et les légions ont souvent été employées à l’intérieur dans les discordes civiles.
L’étendard de la légion était primitivement un loup, en
souvenir de Romulus. Sous Marius, on adopta un aigle d’argent, tenant le
foudre dans ses serres. L’aigle de la légion est représenté sur la figure 356.
Au reste, il n’a pas toujours eu la même forme. Ainsi la figure 357, tirée de
la colonne Trajane, nous montre un aigle posé sur un support e La figure 359 montre un porte-enseigne de cohorte vu de dos. On y voit très bien comment la peau de bête qui lui couvre la tête se lie autour du cou par les pattes et retombe ensuite jusqu’aux reins. Le dragon est devenu, à partir de Trajan, l’enseigne des cohortes. C’était une sorte de drapeau militaire qui affectait la forme d’un serpent ou plutôt d’un dragon dont la gueule d’argent était entrouverte, tandis que le reste du corps était formé de peaux vides ou d’étoffes peintes. Le vent entrait dans la gueule du dragon et s’engouffrait dans les étoffes ou les peaux qu’il agitait en tous sens. Des emblèmes du même genre sont employés de nos jours par les Chinois et les Japonais. Ceux dont se servaient les Romains étaient empruntés aux barbares, et le dragon était en quelque sorte le drapeau caractéristique de ceux que Trajan a combattus. Sur la colonne Trajane on voit un chariot couvert de ces enseignes conquises sur l’ennemi (fig. 360).
L’étendard des manipules est tout différent. Le mot manipule vient de la petite botte de foin que les premiers Romains portaient au haut d’une perche et qui leur servait d’enseigne. Plus tard, le manipule, qui formait, comme nous l’avons dit, la troisième partie d’une cohorte, eut pour étendard une succession de patères superposées et surmontées d’une couronne encadrant une main. Les figures 361 à 363 montrent les trois étendards les plus employés dans les armées romaines.
L’étendard de la cavalerie (vexillum) était une pièce d’étoffe carrée attachée par le haut à une traverse horizontale. C’était l’enseigne spéciale de la cavalerie romaine, mais elle fut plus tard employée pour les troupes auxiliaires. La figure 366 montre le manche et la traverse de cet étendard, dont l’étoffe était frangée par le bas. Les soldats romains se ralliaient au son du buccin, grande trompette recourbée que l’on voit sur un assez grand nombre de monuments et dont le son strident devait ressembler un peu à celui de notre cor de chasse. Le joueur de buccin, caractérisé par sa coiffure en tête d’ours, marchait derrière l’officier, comme le montre la figure 367, d’après un bas-relief de la colonne Trajane. Le buccin s’employait également dans la cavalerie. La figure 368, d’après un bas-relief de l’arc de Constantin, montre une charge de cavalerie au son du buccin. La légion romaine constituait un corps complet renfermant toutes les armes : les troupes légères ou vélites combattaient en avant du front. Ensuite venaient successivement les hastaires, qui formaient la première ligne, les princes qui formaient la seconde, et les triaires qui formaient la troisième. Les triaires étaient composés de vieux soldats d’élite formant un corps de réserve ; quand les deux premières lignes étaient renversées, ils ramenaient souvent la victoire par leur inébranlable discipline. Les hastaires et les princes se disposaient en pelotons ayant entre eux une distance égale à l’étendue de leur front : mais il y avait une distance double entre les pelotons des triaires, afin que quand les pelotons des premières lignes étaient renversés ou bousculés, les hommes qui les composaient pussent reformer aussitôt leurs rangs entre ces soldats aguerris et incapables de faiblesse. La cavalerie se plaçait habituellement sur les ailes ; généralement elle se disposait en petits carrés de huit hommes de front sur autant en profondeur. D’après ce qui précède on peut se faire une idée du choc d’une légion romaine. Les troupes légères commençaient en faisant voler une nuée de traits et aussitôt après elles s’écoulaient rapidement entre les pelotons de l’infanterie. Les trois lignes s’avançaient aussitôt au son des instruments et en accélérant le mouvement. Arrivés à vingt pas de l’ennemi, les hastaires lançaient le pilum, et se précipitaient en avant l’épée à la main. S’ils ne réussissaient pas à rompre au premier choc les rangs ennemis, ils se repliaient derrière les princes qui recommençaient la même manœuvre. Les triaires arrivaient ensuite et quand ils combattaient, les corps qui avaient donné le premier choc se trouvaient reformés en arrière. De cette façon l’ennemi était déjà fort ébranlé, lorsqu’il recevait le choc des triaires. Les hastaires, dit Polybe, plus avancés en âge que les vélites, ont ordre de porter l’armure complète, c’est-à-dire un bouclier convexe, large de deux pieds et demi et long de quatre pieds. Il est fait de deux planches collées l’une sur l’autre avec de la gélatine de taureau et couvertes en dehors, premièrement d’un linge, et par dessus d’un cuir de veau. Les bords de ce bouclier en haut et en bas sont garnis de fer pour recevoir les coups de taille, et pour empêcher qu’il ne se pourrisse contre terre. La partie convexe est encore couverte d’une plaque de fer, pour parer les coups violents comme ceux des pierres, des sarisses et de tout autre trait envoyé avec une grande force. L’épée est une autre arme des hastaires, qui la portent sur la cuisse droite et l’appellent l’ibérique. Elle frappe d’estoc et de taille, parce que la lame en est forte. Ils portent outre cela deux javelots, un casque d’airain et des bottines. De ces javelots, les uns sont gros, les autres minces : les plus forts sont ronds ou carrés ; les ronds ont quatre doigts de diamètre, et les carrés ont le diamètre d’un de leurs côtés ; les minces ressemblent assez aux traits que les hastaires sont encore obligés de porter. La hampe de tous ces javelots, tant gros que minces, est à peu près de trois coudées ; le fer, en forme de hameçon, qui y est attaché est de la même longueur que la hampe. Il avance jusqu’au milieu du bois et y est si bien cloué, qu’il ne peut s’en détacher sans se rompre, quoiqu’en bas et à l’endroit où il est joint avec le bois, il ait un doigt et demi d’épaisseur. Sur leur casque, ils portent encore un panache rouge ou noir formé de trois plumes droites, et hautes d’une coudée, ce qui, joint à leurs autres armes, les fait paraître une fois plus haut et leur donne un air grand et formidable. Les moindres soldats portent outre cela sur la poitrine une lame d’airain, qui a douze doigts de tous les côtés et qu’ils appellent le pectoral : c’est ainsi qu’ils complètent leur armure. Mais ceux qui sont riches de plus de dix mille drachmes, au lieu de ce plastron, portent une cotte de mailles. Les princes et les triaires sont armés de la même manière, excepté qu’au lieu de javelots ils ont des demi-javelots. Les vélites sont armés d’une épée, d’un javelot et d’une parme, espèce de bouclier fort et assez grand pour mettre un homme à couvert, car il est de figure ronde et il a trois pieds de diamètre. Ils ont aussi sur la tête un casque sans crinière, qui cependant est quelquefois couvert de la peau d’un loup ou de quelque autre animal, tant pour les protéger que pour les distinguer, et faire reconnaître à leurs chefs ceux qui se sont signalés dans les combats. Leur javelot est un espèce de dard, dont le bois a ordinairement deux coudées de long et un doigt de grosseur. La pointe est longue d’une grande palme, et si effilée qu’au premier coup elle se fausse, de sorte que lés ennemis ne peuvent la renvoyer. C’est ce qui la distingue des autres traits. A ces troupes légères se joignaient quelquefois les accensi, soldats auxiliaires qui étaient généralement assez mal armés, et que pour cette raison on reléguait plus souvent au dernier rang. La figure 369, tirée de la colonne Trajane, montre un de ces soldats auxiliaires qui tient dans les plis de sa tunique des balles de terre cuite, en même temps qu’il se sert de la fronde avec la main droite.
Tite-Live nous montre l’emploi de ces différentes troupes dans le récit suivant : Cette bataille, dit Tite-Live, eut toutes les apparences d’une guerre civile, tant la ressemblance était parfaite entre l’armée romaine et l’armée latine. Les Romains s’étaient servis auparavant du bouclier ; depuis qu’on eut établi une solde ils y substituèrent l’écu ; et au lieu que leur ordre de bataille était le même d’abord que celui de la phalange macédonienne, ils admirent depuis la division par manipules ; le manipule ensuite était subdivisé en plusieurs compagnies, dont chacune était composée de soixante-deux soldats, d’un centurion et d’un porte-drapeau. Sur le champ de bataille, la première ligne était formée par les hastaires, composant dix manipules, laissant entre eux un petit intervalle. Dans chacun de ces manipules d’hastaires il y avait vingt hommes de troupes légères ; le reste était la grosse infanterie armée de l’écu. Les troupes légères avaient pour toutes armes une haste et quelques dards gaulois. C’était dans ce corps de hastaires, qui formaient toujours le front de la bataille, que l’on plaçait cette première fleur de la jeunesse romaine, tous ceux qui entraient dans la puberté militaire. Derrière les hastaires venaient en seconde ligne ceux qu’on appelait les princes, d’un âge plus robuste, partagés également en dix, manipules, ayant tous l’écu et se faisant remarquer par la beauté de leurs armes : ces deux lignes d’hastaires et de princes s’appelaient les antepilani, parce qu’en effet ils étaient en avant d’un troisième corps, celui des triaires, composé de dix manipules aussi, mais chaque manipule de trois compagnies dont la première se nommait pilani. Chacun de ces manipules comprenait, sous trois drapeaux, cent quatre-vingt-six hommes. Sous le premier drapeau marchaient les triaires, vieux soldats d’une valeur éprouvée ; sous le second, les roraires, d’un âge moins avancé, ayant le moins de belles actions ; et sous, le troisième, enfin, les accensi, auxquels on avait le moins de confiance et qui, pour cette raison, étaient rejetés sur les derrières de l’armée, à l’extrémité de la ligne. Toutes les parties des légions qui composaient l’armée étaient rangées dans cet ordre ; c’étaient toujours les hastaires qui, les premiers, engageaient l’action. S’ils ne pouvaient suffire : à enfoncer l’ennemi, ils se retiraient à petits pas dans la ligne des princes, qui, après avoir ouvert leurs rangs pour les y recevoir, prenaient immédiatement leur place ; et alors les princes formaient la tête de la bataille ; les hastaires n’étaient plus qu’en seconde ligne. Pendant ce temps, les triaires restaient sous leurs drapeaux, un genou en terre, la jambe gauche étendue en avant, leurs écus sur l’épaule, leur javeline enfoncée en terre, dont ils tenaient la pointe presque droite ; et, dans cet état, ils présentaient l’aspect d’une armée retranchée derrière une haie de palissades. Si les princes ne réussissaient point encore dans leur attaque, ils reculaient insensiblement de la première ligne sur les triaires ; et de là ce proverbe si usité, qu’on en vient aux triaires, lorsqu’on éprouve une crise alarmante. Les triaires se remettant sur pied, après avoir ouvert leurs rangs pour laisser passer les princes et les hastaires, les resserraient aussitôt comme pour fermer tous les passages ; et, formant une ligne pressée et continue, ils tombaient sur l’ennemi. Ce corps battu, il n’y avait plus d’espoir ; mais il manquait rarement d’imprimer une grande terreur à l’ennemi, qui, au moment où il croyait n’avoir que des vaincus à poursuivre, voyait se lever tout à coup une ligne de bataille, composée de troupes fraîches, plus forte que toutes les autres. On levait ordinairement quatre légions, d’environ cinq mille fantassins chacune, avec un corps de trois cents cavaliers qui y était attaché. On y joignait un nombre égal de troupes que fournissaient les Latins, qui étaient alors nos ennemis, et qui avaient exactement la même ordonnance de bataille ; en sorte que non seulement les corps entiers de triaires, de princes, d’hastaires, trouvaient chacun dans l’armée latine un corps correspondant, mais il n’y avait pas même un centurion qui, à moins que les rangs ne se confondissent dans la mêlée, ne sût précisément à quel centurion il aurait affaire dans l’autre armée. Toute cette organisation paraît avoir disparu vers la fin de la république, quand la division en cohortes remplaça les anciennes divisions de la légion. On cessa alors de distinguer les légionnaires en hastaires, princes, triaires et vélites.
Les figures 370 à 372, tirées de la colonne Trajane, représentent des soldats romains, auxquels est confiée la garde des postes d’observation placés sur les bords du fleuve. Ils sont vêtus d’un pourpoint à bordure dentelée, par-dessus lequel est jeté un manteau (sagum). Ils portent un pantalon collant, et ont pour armes une épée et un bouclier : ils devraient également avoir la lance (hasta), mais comme elle n’est pas dans leur main, on peut supposer qu’ils l’ont déposée dans la tour, et qu’ils la reprendront au premier signal, d’autant plus que quelques-uns sont sans casques.
Plusieurs monuments nous montrent aussi les costumes de la cavalerie. La figure 373, d’après une statue équestre, est intéressante parce qu’elle montre l’équipement d’un officier supérieur. Cette figure, découverte à Herculanum, représente Marcus Balbus. L’armure de ce personnage est formée de deux pièces principales, celle de devant et celle de derrière ; elles offrent une particularité dans la manière dont on les reliait l’une à l’autre. Le côté droit montre une série de charnières traversées par une tige mobile, de façon que les deux plaques pouvaient être écartées ou rapprochées assez promptement, lorsqu’on voulait mettre ou ôter l’armure : les boucles et les agrafes ne paraissent que du côté gauche. Ce genre de cuirasse est celle que portaient généralement les officiers supérieurs, et quand on la posait par terre, les deux pièces qui la composaient demeuraient unies et la cuirasse vide se tenait debout. Dans cette armure, l’abdomen, les cuisses et les épaules étaient protégés par des bandes de cuir adaptées dans de petits trous pratiqués autour de la cuirasse.
Un cavalier romain est représenté sur la figure 374. Dans la colonne Trajane, d’où il est tiré, ce soldat fait partie d’un groupe de cavaliers qui repousse les Parthes envoyés au secours de l’ennemi.
Les armes de la cavalerie, dit Polybe, sont à peu près les mêmes que celles des Grecs ; mais anciennement les cavaliers n’avaient point de cuirasses, ils combattaient avec leurs simples vêtements : cela leur donnait beaucoup de facilité pour descendre promptement de cheval et pour y remonter de même. Comme ils étaient dénués d’armes défensives, ils couraient de grands risques clans la mêlée. D’ailleurs, leurs lances leur étaient fort inutiles pour deux raisons : la première, parce que, étant minces et branlantes, elles ne pouvaient être lancées juste, et qu’avant de frapper l’ennemi, la plupart se brisaient par la seule agitation des chevaux. La seconde raison, c’est que ces lances n’étant point ferrées par le bout d’en bas, quand elles s’étaient rompues par le premier coup, le reste ne pouvait plus leur servir en rien. Leur bouclier était fait de cuir de bœuf et assez semblable à ces gâteaux ovales dont on se sert dans les sacrifices. Cette sorte de bouclier n’était d’aucune défense dans aucun cas, il n’était pas assez ferme pour résister, et il l’était encore beaucoup moins, lorsque les pluies l’avaient amolli et gâté. C’est pourquoi leur armure ayant bientôt déplu, ils la changèrent contre celle des Grecs. En effet, les lances de ceux-ci se tenant raides et fermes portent le premier coup juste et violent, et servent également par l’extrémité inférieure qui est ferrée. De même leurs boucliers sont toujours durs et fermes, soit pour se défendre, soit pour attaquer. Aussi les Romains préférèrent bientôt ces armes aux leurs, car c’est de tous les peuples celui qui abandonne le plus facilement ses coutumes pour en prendre de meilleures. Après avoir pourvu à l’équipement et à la composition de l’infanterie, Servius forma douze centuries de chevaliers, tous pris parmi les citoyens les plus distingués. Il en ajouta six autres, qu’il attacha aux trois centuries de Romulus, sous les mêmes noms que celles-ci avaient reçus à leur inauguration. L’État fournit un fends de dix mille as pour l’achat des chevaux ; et pour leur nourriture on imposa sur les veuves une taxe annuelle de deux mille as. Toutes ces opérations soulagèrent le pauvre en faisant retomber toutes les charges sur les riches. A l’égard de la cavalerie, les mouvements que Scipion croyait les plus utiles en tout temps et auxquels il fallait qu’elle s’exerçât étaient de faire tourner le cheval à gauche, puis à droite, ensuite de le faire reculer. Pour les manœuvres d’escadrons, il les instruisait à faire face en arrière par escadrons en une seule conversion et à revenir ensuite à leur première position, ou à faire des mouvements circulaires par deux conversions, et enfin aux mouvements circulaires par trois conversions, à se porter en avant au trot des ailes ou du centre ; un ou deux pelotons ensemble, à revenir à. leur poste sans se désunir et sans perdre leurs rangs, à se ranger à l’une ou l’autre aile. Il exerçait aussi ses troupes à se ranger en bataille, soit en intervertissant l’ordre des rangs, soit en les faisant placer les uns derrière les autres. Il les exerçait encore à avancer sur l’ennemi et à faire retraite de manière que même en courant on ne quittât pas ses rangs, et que le même intervalle se trouvât toujours entre les escadrons ; car rien n’est plus inutile et plus dangereux que de faire charger une cavalerie qui a rompu ses rangs.
Des armées aussi considérables que celles des Romains devaient nécessairement emporter avec elles un matériel de guerre considérable. Les chariots consacrés à ces transports sont représentés sur plusieurs monuments. Sur la colonne Trajane, on voit un petit chariot à deux roues traîné par deux bœufs et transportant deux petits tonneaux qui renferment probablement du vin ou des subsistances (fig. 376). Ces chariots, qui accompagnaient l’armée dans toutes ses marches, étaient toujours escortés par des soldats. Une autre espèce de chariot, qui, cette fois, est traîné par des chevaux, est représenté sur la colonne Antonine (fig. 377). Celui-ci ne porte pas des vivres, nais des boucliers et des armures. Il est également escorté par un soldat qui tient la bride des chevaux.
Indépendamment des équipages qui accompagnent toujours une armée en marche, chaque soldat portait avec lui les bagages qui lui étaient personnellement nécessaires. Ces bagages étaient reliés ensemble et fixés au bout d’un bâton comme le montre la figure 378. On remarquera la même disposition sur les soldats qui traversent un pont sur la figure suivante.
Jules César fournit sur ce sujet quelques renseignements. Voici sur quel plan il fit construire le pont ; on joignait ensemble, à deux pieds d’intervalle, deux poutres d’un pied et demi d’équarrissage, un peu aiguisées par le bas, d’une hauteur proportionnée à celle du fleuve. Introduites dans l’eau à l’aide de machinés, elles y étaient fichées et enfoncées à coups de masse, non dans une direction verticale, mais en suivant une ligne en marche oblique et inclinée selon le fil de l’eau. En face et en descendant, à la distance de quarante pieds, on en plaçait deux autres, assemblées de la même manière et tournées contre la violence et l’effort du courant. Sur ces quatre poutres on en posait une de deux pieds d’équarrissage qui s’enclavait dans leur intervalle et était fixée à chaque bout par deux chevilles. Ces quatre pilotis, réunis par une traverse, offraient un ouvrage si solide, que plus la rapidité du courant était grande, plus elle consolidait cette construction. On jeta ensuite des solives d’une traverse à l’autre, et on couvrit le tout de fascines et de claies. De plus, des pieux obliquement fichés vers la partie inférieure du fleuve s’appuyaient contre les pilotis en forme de contreforts et servaient à briser le courant. Enfin, d’autres pieux étaient placés en avant du pont, à peu de distance, afin que, si les barbares lançaient des troncs d’arbres ou des bateaux pour abattre ces constructions, elles fussent ainsi protégées contre ces tentatives et que le pont n’en eût point à souffrir.
Les habitudes des Romains se modifièrent sensiblement vers la fin de l’empire, quand les armées furent presque complètement composées de barbares. Le costume des soldats se transforma également. Un soldat dalmate, sculpté sur un monument du musée de Bonn, porte un costume assez curieux qui s’arrondit en draperie devant les cuisses. Son glaive du côté droit et son poignard du côté gauche sont suspendus à des ceintures ou baudriers qui lui entourent le corps : la main droite porte une lance, et la tête est dépourvue de casque (fig. 380).
La figure 381 montre un soldat de l’empire d’Orient et peut ainsi nous faire connaître la physionomie que pouvaient présenter les armées de Théodose ou d’Héraclius. Le bouclier est rond et d’une convexité très prononcée. Ce guerrier, qui est probablement un officier, porte une longue chevelure, qui se bifurque au-dessus du front et retombe en boucles sur les épaules, tandis que les soldats romains portent toujours les cheveux courts.
On remarquera que ce costume est celui sous lequel on a représenté saint Michel, le chef de la milice céleste, pendant une grande partie du moyen âge. La raison en est que la plupart dès monuments des premiers siècles de l’ère chrétienne sont dus à des artistes byzantins, qui naturellement attribuaient aux saints et aux personnages célestes les costumes qu’ils avaient habituellement sous les yeux. LE CAMP. — Quand le temps de camper approche, dit Polybe, un tribun et quelques centurions prennent les devants. Après avoir examiné l’endroit oit le camp doit être assis, ils commencent d’abord par choisir un terrain, pour la tente du conseil, et l’aspect ou le côté de ce terrain où l’on devra loger les légions. Cela fait, on mesure l’étendue de terrain que doit occuper, le prétoire ; ensuite, on tire la ligne sur laquelle se dresseront les tentes des tribuns, au côté opposé, une autre ligne pour le logement des légions, et enfin on prend les dimensions de l’autre côté du prétoire. Comme toutes les distances sont marquées et connues par un long usage, ces mesures sont prises en fort peu de temps ; après quoi on plante le premier drapeau à l’endroit ou sera logé le consul, le second au côté que l’on a choisi, le troisième au milieu de la ligne sur laquelle seront les tribuns, le quatrième au logement des légions. Ces drapeaux sont de couleur pourpre, celui du consul est blanc. Aux autres endroits, on fiche de simples piques ou des drapeaux d’autre couleur. Les rues se forment ensuite, et l’on plante des piques dans chacune ; en sorte que quand les légions en marche approchent et commencent à découvrir le camp, elles en connaissent d’abord toutes les parties, le drapeau du consul leur servant à distinguer tout le reste ; et comme d’ailleurs chacun occupe toujours la même place dans le camp, chacun sait aussi dans quelle rue et en quel endroit de cette rue il doit loger, à peu prés comme si un corps de troupes entrait dans une ville où il aurait pris naissance.
La figure 382 se rattache à l’établissement d’un camp romain ; on y voit des soldats romains qui vont déposer leurs bagages ; ils sont accompagnés de leurs chevaux. Sur la figure 383, on voit charger des bagages sur le dos des mulets ; c’est encore un sujet se rattachant à la formation des camps.
C’est à Polybe qu’il faut nécessairement recourir quand on veut connaître la disposition d’un camp romain ; quoique sa description soit un peu étendue nous n’avons pas cru devoir en rien retrancher. Voici, dit-il, de quelle manière campaient les Romains : le lieu choisi pour y asseoir le camp, on dresse la tente du général dans l’endroit d’où il pourra le plus facilement voir tout ce qui se passe et envoyer ses ordres. On plante un drapeau où la tente doit être mise, et autour Mon mesure un espace carré, en sorte que les quatre côtés soient éloignés du drapeau de cent pieds et que le terrain que le consul occupe soit de quatre arpents. On loge les légions romaines à l’un des côtés le plus commode pour aller chercher de l’eau et des fourrages. Pour chaque légion, il y a six tribuns, et il y a deux légions pour chaque consul ; ils ont donc l’un et l’autre chacun douze tribuns, qui sont tous logés sur une ligne droite, parallèle au côté qu’on a choisi et distante de ce côté de cinquante pieds. C’est dans cet espace que sont les chevaux, les bêtes de charge et tout l’équipage des tribuns. Leurs tentes sont tournées de façon qu’elles ont derrière elles le prétoire (fig. 384 E), et devant, tout le reste du camp. C’est pourquoi nous appellerons désormais le front, cette ligne qui regarde le camp ; les tentes des tribuns, également distinctes les unes des autres, remplissent en travers autant de terrain que les légions. On mesure ensuite un autre espace de cent pieds, le long des tentes des tribuns, et ayant tiré une ligne qui, parallèle à ces tentes, ferme la largeur du terrain, on commence à loger les légions. Pour cela on coupe perpendiculairement la ligne par le milieu ; du point où elle est coupée on tire une ligne droite, et à vingt-cinq pieds de chaque côté de cette ligne on loge la cavalerie des deux légions vis-à-vis l’une de l’autre et séparées par un espace de cinquante pieds. Les tentes, soit de l’infanterie, soit de la cavalerie, sont disposées de la même manière, car les compagnies et les cohortes occupent un espace carré et sont tournées vers les rues : la longueur de cet espace est de cent pieds le long de la rue, et pour la largeur on fait en sorte ordinairement qu’elle soit égale à la longueur, excepté au logement des alliés. Quand les légions sont plus nombreuses, on augmente à proportion la longueur et la largeur du terrain. La cavalerie ainsi logée vers le milieu des tentes des tribuns, on pratique une sorte de rue qui commence à la ligne dont nous avons parlé, et à la place qui est devant les tentes des tribuns. Tout le camp est ainsi coupé en rues, parce que des deux côtés les cohortes sont rangées en longueur. Derrière la cavalerie sont logés les triaires, une compagnie derrière une cohorte, Dune et l’autre dans la même forme. Ils se touchent par le terrain, mail les triaires tournent le dos à la cavalerie, et chaque compagnie n’a de largeur que la moitié de sa longueur, parce que pour l’ordinaire ils sont moitié moins nombreux que les autres corps. Malgré cette inégalité de nombre, comme on diminue de la largeur, ils ne laissent pas d’occuper en longueur un espace égal aux autres. A cinquante pieds des triaires, vis-à-vis, on place les princes sur le bord de l’intervalle, ce qui fait une seconde rue, qui commence, aussi bien que celle de la cavalerie, à la ligne droite ou à l’espace de cent pieds qui sépare les tribuns et finit au côté que nous avons appelé le front du camp. Au dos des princes on met les hastaires qui, tournés à l’opposite, se touchent par le terrain, et comme chaque partie d’une légion est composée de dix compagnies, il arrive de là que toutes les rues sont également longues et qu’elles aboutissent toutes au côté qui est le front du camp, vers lequel sont aussi tournées les dernières compagnies. Les hastaires logés, à cinquante pieds d’eux et vis-à-vis campe la cavalerie des alliés, commençant à la même ligne et s’étendant jusqu’au même côté que les hastaires. Or, les alliés, après qu’on en a retranché les extraordinaires, sont en infanterie égaux en nombre aux légions romaines ; mais, en cavalerie, ils sont le double plus nombreux, et on en ôte un tiers pour faire la cavalerie extraordinaire. On leur donne donc en largeur du terrain à proportion de leur nombre, mais en longueur, ils n’occupent pas plus d’espace que les légions romaines. Les quatre rues faites, derrière cette cavalerie se place l’infanterie des alliés, en donnant à leur terrain une largeur proportionnée, et se tournant du côté du retranchement de sorte qu’elle a vue sur les deux côtés du camp. A la tête de chaque compagnie sont, sur les deux côtés, les tentes des centurions. Dans la disposition tant de la cavalerie que de l’infanterie, on fait en sorte qu’entre la cinquième et sixième cohorte, il y ait une séparation de cinquante pieds, laquelle fait une nouvelle rue qui, traversant le camp, est parallèle aux tentes des tribuns. Cette rue s’appelle la. Quintaine, parce qu’elle se trouve au-dessous de cinq cohortes. L’espace qui reste derrière les tentes des tribuns et aux deux côtés de la tente du consul, on en prend une partie pour le marché et l’autre pour le questeur et les munitions. A droite et à gauche, derrière la dernière tente des tribuns, près des côtés du camp et en ligne droite, est le logement de la cavalerie extraordinaire et des autres cavaliers volontaires. Toute cette cavalerie a vue, une partie sur la place du questeur et l’autre sur le marché. Elle ne campe pas seulement auprès des consuls, souvent elle les accompagne dans les marchés, en un mot elle est habituellement à portée du consul et du questeur pour exécuter ce qu’ils jugent à propos. Derrière ces cavaliers se loge l’infanterie extraordinaire et la volontaire. Ils ont vue sur le retranchement et font pour le consul et le questeur le même service que la cavalerie dont nous venons de parler. Devant ces dernières troupes, on laisse un espace de cent pieds, parallèle aux tentes des tribuns, et qui, s’étendant sur les places du marché et du trésor, traverse toute l’étendue du camp. Au-dessous de cet espace est logée la cavalerie extraordinaire des alliés, ayant vue sur le marché, le prétoire et le trésor. Un chemin ou une rue large de cinquante pieds partage en deux le terrain de la cavalerie extraordinaire, descendant à angle droit depuis le côté qui ferme le derrière du camp jusqu’à l’espace dont nous parlions tout à l’heure et au terrain qu’occupe le prétoire. Enfin, derrière la cavalerie extraordinaire des alliés campe leur infanterie extraordinaire, tournée du côté du retranchement et des derrières du camp. Ce qui reste d’espace vide des deux côtés est destiné aux étrangers et aux alliés qui viennent au camp pour quelque occasion que ce soit, Toutes choses ainsi rangées, on voit que le camp forme une figure carrée et que, tant par le partage des terres que pour la disposition du reste, il ressemble beaucoup à une ville. Du retranchement aux tentes, il y
a deux cents pieds de distance, et ce vide leur est d’un très grand usage
soit pour l’entrée, soit pour la sortie des légions, car chaque corps
s’avance dans cet espace par la rue qu’il a devant lui, et les troupes ne
marchant point par le même chemin ne courent pas risque de se renverser et de
se fouler aux pieds. De plus on met là les bestiaux et tout ce qui se prend
sur l’ennemi, et on y monte la garde pendant la nuit. Un autre avantage
considérable, c’est que dans les attaques de nuit, il n’y a ni feu ni trait
qui puisse être jeté jusqu’à eux, ou si cela arrive, ce n’est que très
rarement ; et encore qu’en peuvent-ils souffrir, étant à une si grande
distance et à couvert sous leurs tentes ? Après le détail que nous avons donné du nombre des fantassins et des chevaux dans chaque légion, soit qu’elles soient de quatre ou cinq mille hommes ; de la hauteur, longueur et largeur des cohortes, de l’intervalle qu’on laisse pour les rues et pour les places, il est aisé de concevoir l’étendue du terrain qu’occupe une armée romaine, et par conséquent toute la circonférence du camp. Si, dès l’entrée de la campagne, il s’assemble un plus grand nombre d’alliés qu’à l’ordinaire, ou que pour quelque raison, il en vienne de nouveaux pendant son cours, outre le terrain que nous avons marqué, on fait un logement à ceux-ci dans le voisinage du prétoire, dût-on pour cela, s’il était nécessaire, ne se servir que d’une place pour le marché ou pour le trésor. A l’égard de ceux qui ont joint d’abord l’armée romaine, des deux côtés du camp on leur fait une rue pour les loger à la suite des légions. S’il arrive que quatre légions et deux consuls se rencontrent en dedans du même retranchement, pour comprendre la manière dont ils sont campés, il ne faut que s’imaginer deux armées tournées l’une vers l’autre, et jointes par les côtés où les extraordinaires de l’une et l’autre armée sont placés, c’est-à-dire par la queue du camp ; et alors le camp fait un carré long, qui occupe un terrain double du premier et qui a une fois et demie de plus de tour. Telle est la manière de se camper des consuls lorsqu’ils se joignent ensemble ; toute la différence qu’il y a, c’est que le marché, le trésor et les tentes des consuls se mettent entre les deux camps.
La figure 384 reproduit le plan consulaire d’un camp romain, d’après Polybe. L’encadrement noir indique le fossé avec le retranchement qui entoure le camp, dont la forme est rigoureusement carrée. Le haut de ce fossé était défendu par une forte enceinte de palissades. Chacun des quatre côtés du camp avait une entrée particulière marquée par A. B. C. D. sur le plan. Une grande rue latérale allant de B à C, et appelée voie principale sépare le camp en deux parties de grandeur inégale. Dans la plus petite, qui forme la partie supérieure du plan, on trouve le prétoire ou tente du général, E, en dessous de laquelle sont indiquées les tentes des tribuns romains et des généraux alliés ; rangées en files le long de la voie principale. L’espace concédé au questeur et au commissariat placé sous ses ordres est indiqué en M, et la lettre N montre l’emplacement de la place du marché. Les autres lettres de la partie supérieure indiquent le lieu de campement de quelques troupes d’élite, romaines ou alliées, formant la garde consulaire et autre. La partie inférieure du plan comprend les soldats des deux légions qui constituent le camp. Elles sont séparées par une rue centrale allant du prétoire à la porte D, et sont disposées de telle façon que les Romains occupent le centre et les alliés la partie extérieure. Les tours que les Romains élevaient soit pour observer les mouvements de l’ennemi, soit comme fortifications dans les postes avancés, étaient quelquefois bâties en pierre de taille ; elles étaient pourvues d’un toit pointu et entourées d’une palissade de pieux disposée circulairement autour de la construction. C’est ce que montre la figure 385, qui est tirée de la colonne Trajane. Il faut observer toutefois que cette tour, sculptée dans la partie la plus mince du bas-relief, et tout en bas de la spirale, a peut-être été raccourcie pour une nécessité de la sculpture ; car les tours qu’on voit sur d’autres monuments sont généralement plus élevées.
La figure 386 représente un bâtiment d’avant-poste et sur la figure 387 on voit un retranchement des Daces posé sur une colline c’est une muraille crénelée, sur laquelle on aperçoit des têtes de prisonniers romains fixées sur des lances, ainsi qu’un vexillum (drapeau de la cavalerie romaine). On voit aussi des constructions en bois élevées sur des pieux et le dragon qui semble dominer le tout. Ce dragon était l’enseigne des Daces : sa gueule est fixée sur une longue perche et son corps, formé d’étoffes bariolées et enflé par le vent, imite les mouvements du serpent. Lorsque le camp est établi, dit Polybe, les tribuns assemblés reçoivent le serment de tout ce qu’il y a d’hommes dans chaque légion tant libres qu’esclaves. Tous jurent l’un après l`autre et le serment qu’ils font consiste à promettre qu’ils ne voleront rien dans le camp, et que ce qu’ils trouveront ils le porteront aux tribuns. Ensuite, on commande deux cohortes tant des princes que des hastaires de chaque légion, pour garder le quartier des tribuns ; comme pendant le jour, les Romains passent la plupart du temps dans cette place, on a soin d’y faire jeter de l’eau et de la tenir propre. Des cohortes qui restent (car nous avons vu que dans chaque légion il y avait six tribuns et vingt cohortes de princes et de hastaires), chaque tribun en tire trois ad sort pour son usage particulier. Ces trois cohortes sont obligées, chacune à son tour, de dresser sa tente, d’aplanir le terrain d’alentour et de clore, s’il en est besoin, ses équipages de haies pour la plus grande sûreté. Elles font aussi la garde autour de lui. Cette garde est de quatre soldats, deux devant la tente et deux derrière près des chevaux. Comme chaque tribun a trois cohortes, et que chacune d’elles est de plus de cent hommes, sans compter les triaires et les vélites qui ne servent point, ce service n’est pas pénible, puisqu’il ne revient à chaque compagnie que de quatre en quatre jours. Cette garde est non seulement chargée de faire toutes les fonctions auxquelles il plaît aux tribuns de l’employer ; elle est destinée aussi à relever sa dignité et son autorité. Pour les triaires, exempts du service des tribuns, ils font la garde auprès des chevaux, quatre par cohorte chaque jour pour la compagnie qui est immédiatement derrière eux. Leur fonction est de veiller sur bien des choses, mais particulièrement sur les chevaux, de’ peur qu’ils ne s’embarrassent dans leurs liens, ou que, détachés ou mêlés parmi d’autres chevaux, ils ne causent du trouble et du mouvement dans le camp. De toutes les cohortes d’infanterie, il y en a toujours une qui à son tour garde la tente du consul, tant pour la sûreté de sa personne que pour l’ornement de sa dignité. Pour le fossé et le retranchement, c’est aux alliés à les faire aux deux côtés où ils sont logés ; les deux autres côtés sont pour les Romains, un pour chaque légion. Chaque côté se distribue par parties, selon le nombre des cohortes et à chacune il y a un centurion qui préside à l’ouvrage ; et quand tout le côté est fini, ce sont deux tribuns qui l’examinent et l’approuvent. Les tribuns sont encore chargés du soin de tout le reste du camp, où ils commandent deux tour à tour pendant deux des six mois que dure la campagne. Ceux à qui ce commandement échoit par le sort président à tout ce qui se fait dans-le camp. Cette charge parmi les alliés est exercée par les préfets. Dès le point du jour, les cavaliers et les centurions se rendent aux tentes des tribuns, et ceux-ci à celle du consul, de qui ils apprennent ce qui doit se faire, et ils en font part aux cavaliers et aux centurions, qui le communiquent aux soldats quand l’occasion s’en présente. Le mot d’ordre de la nuit se donne de cette manière. Parmi les cohortes de la cavalerie et de l’infanterie qui ont leurs logements au dernier rang, on choisit un soldat que l’on exempte de toutes les gardes. Tous les jours au coucher du soleil, ce soldat se rend à la tente du tribun, y prend le mot d’ordre qui est une petite planche où l’on a écrit quelques mots, et s’en retourne à sa cohorte. Ensuite, prenant (les témoins, il met la planche et le mot d’ordre entre lés mains du chef de la cohorte suivante. Celui-ci le donne à celui qui le suit, et ainsi des autres, jusqu’à-ce que le mot d’ordre passe aux cohortes qui sont les plus voisines des tribuns, auxquels il faut que ce signal soit reporté avant la fin du jour ; et c’est par ce moyen qu’ils savent que ce mot d’ordre a été donné à toutes les cohortes, et que c’est par elles qu’il leur est venu. S’il en manque quelqu’un, sur-le-champ il examine le fait, et voit par l’inscription quelle cohorte n’a point apporté le signal, et celui qui en est cause est aussitôt puni selon qu’il le mérite. Pour les gardes de la nuit, il y a une cohorte entière pour le général et le prétoire. Les tribuns et les chevaux sont gardes par les soldats que l’on tire pour cela de chaque cohorte, selon ce que nous avons dit plus haut. La garde de chaque cohorte se prend dans la cohorte même. Les autres gardes se distribuent au gré du général. Pour l’ordinaire, on en donne trois au questeur et trois à chacun des deux lieutenants. Les côtés extérieurs sont confiés au soin des vélites qui, pendant le jour, montent la garde tout le long du retranchement ; car tel est leur service ; et, de plus, il y en a dix pour chaque porte du camp. Des quatre qui sont tirés de chaque cohorte pour la garde, celui qui la doit monter le premier est conduit sur le soir par un officier subalterne au tribun, qui leur donne à tous une petite pièce de bois marquée de quelque caractère ; après quoi ils s’en vont chacun à son poste. C’est la cavalerie qui fait les rondes. Dans chaque légion, le capitaine de la première compagnie avertit le matin un de ses officiers subalternes de donner ordre à quatre cavaliers de sa compagnie de faire la ronde avant le dîner. Sur le soir, il doit encore avertir le capitaine de la seconde compagnie de faire la ronde le jour suivant. Celui-ci averti donne le même avis pour le troisième jour et les autres de suite font la même chose. Là-dessus l’officier subalterne de la première compagnie en prend quatre cavaliers qui tirent au sort la garde. Ensuite ils se rendent à la tente du tribun, de qui ils apprennent par écrit quel corps et combien de gardes ils doivent visiter. Après quoi ces quatre cavaliers montent la garde à la première compagnie des triaires, dont le capitaine est chargé de sonner de la trompette à chaque heure que la garde doit être montée. Le signal donné, le cavalier à qui la première garde est échue en fait la ronde, accompagné de quelques amis, dont il se sert pour témoins ; et il visite non seulement les gardes postées au retranchement et aux portes, mais encore toutes celles qui sont à chaque cohorte et à chaque compagnie. S’il trouve la garde de la première veille sur pied et alerte, il reçoit d’elle la petite pièce de bois ; s’il la rencontre endormie ou si quelqu’un y manque, il prend à témoin ceux qui sont près de lui et se retire. Toutes les autres rondes se font de la même manière. A chaque veille on sonne de la trompette afin que ceux qui font la garde soient avertis en même temps ; et c’est pendant le jour une des fonctions des capitaines de la première cohorte des triaires de chaque légion. Pour lever le camp, voici la manière dont les Romains s’y prennent : le premier signal donné, on détend les tentes et on plie bagage, en commençant néanmoins par celles des consuls et des tribuns ; car il n’est pas permis de dresser et de détendre des tentes avant que celles-ci aient été dressées ou étendues. Au second signal, on met les bagages sur les bêtes de charge et au troisième signal les premières marchent et tout le camp s’ébranle. LES MACHINES DE CUERRE. — Les machines de jet étaient de trois espèces : les catapultes et les scorpions qui lançaient spécialement des traits, et les balistes avec lesquelles on lançait des pierres. La catapulte, qui envoie de grosses flèches à des distances souvent considérables, est une machine composée d’un châssis de charpente à deux montants verticaux assemblés par deux traverses parallèles. Un écheveau de cordes de nerfs, faisant l’office de la corde d’un arc, est tendu à l’aide d’un moulinet mû par deux ou quatre hommes et lance le trait qu’un servant pointe tandis qu’un autre fait partir la détente. Le trait vole avec une vitesse double de celle des flèches ordinaires et porte beaucoup plus loin. Tout l’appareil, qui forme une sorte de batterie, repose sur une forte colonne de charpente que l’on peut faire pivoter pour tirer à droite ou à gauche. Le scorpion est une machine du même genre, mais beaucoup plus petite et par conséquent plus portative, et qui, au lieu d’envoyer un gros trait, lance une infinité de petits traits. Le rapport du scorpion avec la catapulte est donc à peu près le même que celui qui existe aujourd’hui entre la mitrailleuse et le canon de gros calibre. La baliste, qui lance des pierres, est également mise en mouvement par un gros écheveau de nerfs. Un levier, maintenu verticalement par un crochet, s’abat horizontalement quand le crochet est défait par un coup de maillet et envoie le projectile dont la course décrit environ le quart d’un cercle. Des chariots attelés de mulets traînaient les catapultes toutes montées à la suite des cohortes, ainsi que les scorpions, mais pour les balistes on employait des chariots plats traînés par des bœufs. Les engins envoyés par les machines de guerre pouvaient atteindre à six ou huit cents mètres de distance. Les projectiles enflammés dont se servaient les anciens étaient de plusieurs sortes. César parle de boulets d’argile rougis au feu qu’on lançait avec la fronde et de dards enflammés qui incendiaient les huttes couvertes en paille. il parle également de tonneaux de suif, de poix et de menu bois, que les défenseurs d’une ville assiégée faisaient rouler sur les travaux des assaillants, afin de les incendier. Un fragment de Polybe décrit une machine à lancer du feu qui était employée sur les vaisseaux rhodiens. Des deux côtés de la proue, dit-il, à l’intérieur du bâtiment, sur la partie supérieure, deux ancres étaient placées l’une près de l’autre et fixées par des coins, de manière que leurs extrémités s’avançaient assez loin dans la mer ; de la tête d’un de ces coins pendait, à l’aide d’une chaîne de fer, un vase portant une grande quantité de feu ; de telle sorte qu’à chaque fois qu’approchait, soit vis-à-vis, soit sur les côtés, un vaisseau ennemi, on secouait sur lui ce feu qui ne pouvait endommager le bâtiment sur lequel il était placé, attendu que par l’inclinaison de la machine, il s’en trouvait fort éloigné. Le feu grégeois, qui a eu tant d’importance au moyen âge, ne paraît pas avoir été employé avant le VIIe siècle de notre ère ; il n’y a donc pas lieu de s’en occuper ici.
Le bélier était une puissante machine dont les anciens se servaient dans les siéges, à peu près dans les mêmes cas où nous employons aujourd’hui l’artillerie. Elle se composait d’une grosse poutre de bois, munie à l’extrémité d’une masse de fer en forme de tête de bélier (fig. 388) : quand on voulait pratiquer une brèche contre les murailles d’une place fortifiée, on poussait la poutre avec violence de manière que la tête du bélier allât heurter contre les pierres et les désagréger. Primitivement le bélier était porté par un grand nombre d’hommes qui n’avaient d’autres ressources que leurs bras pour le faire manœuvrer. C’est ainsi que les Daces l’emploient sur un bas-relief de la colonne Trajane. Plusieurs perfectionnements furent apportés dans l’emploi du bélier : le plus important consista à le suspendre à une poutre placée sur des montants : on le manœuvrait ainsi dans tous les sens avec beaucoup moins de fatigue corporelle et en même temps avec beaucoup plus de force. Ensuite on imagina de le fixer sur un châssis monté sur des roues et on le couvrit de planches pour protéger les combattants contre les traits de l’ennemi. La figure 389 nous montre un bélier en mouvement. Comme toutes les villes assiégées étaient munies de fortes murailles crénelées et garnies de tours ; l’assiégeant creusait devant la place une contrevallation renforcée aux angles de tours en charpentes, et s’il craignait l’arrivée d’une armée de secours, il traçait une circonvallation qui le protégeait lui-même, de manière à pouvoir jouer à la fois le rôle d’assiégé et d’assiégeant, comme le fit César au siège d’Alise. Les Romains élevaient en outre de grandes tours roulantes, construites en charpentes, et dont la hauteur dépassait quelquefois celle des tours qui défendaient la place. Ces tours, nommées ambulatoires, parce qu’on les changeait de place en les poussant le plus près possible des murailles ennemies, avaient généralement huit étages. Elles étaient garnies de soldats et revêtues à l’extérieur de peaux mouillées, qui les préservaient de l’incendie qu’auraient pu causer les projectiles enflammés lancés de la place. Les tours ambulatoires contenaient presque toujours un bélier, qui sapait le bas de la muraille, tandis que les archers et les frondeurs placés en haut s’efforçaient de dégarnir le rempart de ses défenseurs. En général, ce n’est qu’après plusieurs attaques réitérées qu’on pouvait donner l’assaut.
Un groupe de la colonne Antonine montre comment les soldats romains réunissaient leurs boucliers de manière à se préserver des projectiles que les assiégés pouvaient lancer sur eux. Il représente en effet des soldats se préparant à faire l’assaut d’une forteresse des Germains : on les voit s’avancer jusqu’au pied de la muraille, en élevant les boucliers au-dessus de leurs têtes et de leurs épaules (fig. 390). Ils sont très rapprochés, de sorte que les boucliers non seulement se touchent, mais se recouvrent mutuellement par leur bord ; leur réunion forme une masse compacte comme l’écaille d’une tortue ou la pente d’un toit et les projectiles glissaient dessus sans avoir blessé personne. Dans cette manœuvre une partie des soldats mettaient un genou en terre tandis que les autres se tenaient debout, de façon que l’inclinaison des boucliers rejetât promptement hors des rangs les projectiles qui tombaient. L’historien Polybe, faisant le récit de l’attaque de Syracuse, que défendait Archimède, décrit ainsi les machines de guerre employées dans ce combat célèbre : Lorsque Marcus Marcellus attaqua l’Achradine de Syracuse, sa flotte était composée de soixante galères à cinq rangs de rames, qui étaient remplies d’hommes armés d’ares, de frondes et de javelots pour balayer les murailles. Il avait encore huit galères à cinq rangs de ramis, d’un côté desquelles on avait ôté les bancs, aux unes à droite, aux autres à gauche, et que l’on avait jointes ensemble deux à deux par les côtés où il n’y avait plus de bancs. C’étaient ces galères qui, poussées par les rameurs du côté opposé à la ville, approchaient des murailles les machines appelées sambuques, et dont il faut expliquer la construction. C’est une échelle de la largeur de quatre pieds qui, étant dressée, est aussi haute que les murailles. Les deux côtés de cette échelle sont garnis de balustrades et de courroies de cuir qui règnent jusqu’à son sommet. On la couche en long sur les côtés des deux galères jointes ensemble, de sorte qu’elle passe de beaucoup les éperons ; et au haut des mâts de ces galères, on attache des poulies et des cordes. Quand on doit se servir de cette machine, on attache les cordes à l’extrémité de la sambuque, et des hommes l’élèvent de dessus la poupe par le moyen -des poulies : d’autres sur la proue aident aussi à l’élever avec des leviers : Ensuite, lorsque les galères ont été poussées à terre par les rameurs des deux côtés extérieurs, on applique ces machines à la muraille. Au haut de l’échelle est un petit plancher bordé de claies de trois côtés, sur lequel quatre hommes repoussent en combattant ceux qui des murailles empêchent qu’on applique la sambuque. Quand elle est appliquée et qu’ils sont arrivés sur la muraille, ils jettent bas les claies et, à droite et à gauche, ils se répandent dans les créneaux des murs et dans les tours. Le reste des troupes les suit sans crainte que la machine leur manque, parce qu’elle est fortement attachée avec des cordes aux deux galères. Or ce n’est pas sans raison que cette machine a été appelée sambuque ; on lui a donné ce nom, parce que l’échelle étant dressée, elle forme avec le vaisseau un ensemble qui a l’air d’une sambuque. Tout étant préparé, les Romains se disposaient à attaquer les tours ; mais Archimède avait aussi, de son côté, construit des machines propres à lancer des traits à quelque distance que ce fût. Les ennemis étaient encore loin de la ville qu’avec des balistes et des catapultes plus grandes et plus fortement bandées, il les perçait de tant de traits qu’ils ne savaient comment les éviter. Quand les traits passaient au delà, il en avait de plus petites proportionnées à la distance, ce qui jetait une, si grande confusion parmi les Romains, qu’ils ne pouvaient rien entreprendre, de sorte que Marcellus, ne sachant quel parti prendre, fut obligé de faire avancer sans bruit ses galères pendant la nuit. mais quand elles furent vers la terre à portée du trait, Archimède inventa un autre stratagème contre ceux qui combattaient de dessus leurs vaisseaux. Il fit percer à hauteur d’homme et dans la muraille des trous nombreux et de la largeur de la main. Derrière ces meurtrières, il avait posté des archers et des arbalétriers qui, tirant. sans cesse sur la flotte, rendaient inutiles tous les efforts des soldats romains. De cette manière, soit que les ennemis fussent près, soit qu’ils fussent loin, non seulement il empêchait tous leurs projets de réussir, mais encore il en tuait un grand nombre. Et quand on commençait à dresser des sambuques, des machines disposées au dedans des murailles et que l’on n’apercevait pas la plupart du temps s’élevaient sur les forts et étendaient leurs becs bien loin en dehors de remparts. Les unes portaient des pierres qui ne pesaient pas moins de six cents livres, les autres des masses de plomb d’une égale pesanteur. Quand les sambuques s’approchaient, on tournait avec un câble les becs de ces machines où il était nécessaire, et par le moyen d’une poulie que l’on lâchait, on faisait tomber sur la sambuque une pierre, qui ne brisait pas seulement cette machine, mais encore le vaisseau, et jetait ceux qui s’y trouvaient dans un extrême péril. Il y avait encore d’autres machines qui lançaient sur les ennemis qui s’avançaient, couverts par des claies, des pierres d’une grosseur suffisante pour faire quitter la proue des navires à ceux qui y combattaient. Outre cela, on faisait tomber une main de fer attachée à une chaise, avec laquelle celui qui dirigeait le bec de la machine comme le gouvernail d’un navire ; ayant saisi la proue d’un vaisseau, abaissait l’autre bout du côté de la ville. Quand, soulevant la proue dans les airs, il avait dressé le vaisseau sur la poupe, alors liant le bras du levier pour le rendre immobile, il lâchait la chaîne par le moyen d’un moulinet ou d’une poulie. 11 arrivait nécessairement alors que ces vaisseaux ou bien tombaient sur le côté, ou bien étaient entièrement culbutés ; et, la plupart du temps, la proue retombant de très haut dans la mer, ils étaient submergés au grand effroi de ceux qu’ils portaient. Marcellus était dans un très grand embarras ; tous ses projets étaient renversés par les inventions d’Archimède ; il faisait des pertes considérables, les assiégés se riaient de tous ses efforts. Cependant il ne laissait pas que de plaisanter sur les inventions du géomètre. Cet homme, disait-il, se sert de nos vaisseaux comme de cruches pour puiser de l’eau, et il chasse ignominieusement nos sambuques à coups de bâton, comme indignes de sa compagnie. LES SIGNAUX. — Les pays voisins des frontières où l’on pouvait redouter des incursions et les côtes de la Méditerranée étaient garnis de petites tours d’observation, qui, s’échelonnaient de distance en distance, et qui autant que possible étaient placées sur de petites éminences. Les gardes qui veillaient dans ces tours étaient chargés de surveiller les environs et de transmettre les signaux. Une peinture de Pompéi montre une côte sur laquelle sont représentées plusieurs de ces tours d’observation (fig. 391).
La figure 392 montre une autre construction entourée d’une palissade carrée. Une balustrade en bois fait le tour du premier étage, et on voit à la fenêtre une longue torche allumée qui servait à faire des signaux aux troupes éloignées. Un fragment de Polybe nous fournit de curieux renseignements sur les méthodes employées dans l’antiquité pour les signaux. De toutes les inventions, dit Polybe, aucune n’est plus utile que les signaux par le feu. Que les choses viennent de se passer ou qu’elles se passent actuellement, on peut par ce moyen en instruire à trois ou quatre journées de là, et quelquefois même à une plus grande distance, de sorte qu’on est surpris de recevoir le secours dont on avait besoin. Autrefois, cette manière d’avertir était trop simple, et perdait par là beaucoup de son utilité. Car pour en faire usage, il fallait être convenu de différents signaux, et comme il y a une infinité de différentes affaires, la plupart ne pouvaient se connaître par des fanaux. Il était aisé, par exemple, d’avertir ceux avec qui l’on en était convenu ; mais des événements qui arrivent sans qu’on s’y attende, et qui demandent qu’on tienne conseil sur-le-champ, et qu’on y apporte du remède, comme une révolte, une trahison, un meurtre ou autre chose semblable, ces sortes d’événements ne pouvaient s’annoncer par le moyen des fanaux. Car il n’est pas possible de convenir d’un signal pour des événements qu’il n’est pas possible de prévoir. Énée, cet auteur dont nous avons un ouvrage de tactique, s’est efforcé de remédier à cet inconvénient, mais il s’en faut de beaucoup qu’il l’ait fait avec tout le succès qu’on aurait souhaité. On en va juger. Ceux, dit-il, qui veulent s’informer mutuellement par des fanaux de ce qui se passé n’ont qu’à prendre des vases de terre également larges, profonds et percés en quelques endroits : ce sera assez qu’ils aient trois coudées de hauteur et une de largeur ; qu’ils prennent ensuite des morceaux de liége un peu plus petits que l’ouverture des vaisseaux, qu’ils fichent au milieu de ce liége un bâton distingué par quelque enveloppe fort apparente, et qu’ils écrivent sur chacune de ces enveloppes les choses qui arrivent le plus ordinairement pendant une guerre. Sur l’une, par exemple, il est entré de la cavalerie ; sur l’autre, il est arrivé de l’infanterie ; sur une troisième, de l’infanterie légère ; sur la suivante de l’infanterie et de la cavalerie. Sur une autre encore, des vaisseaux ; ensuite des vivres, et de même sur toutes les autres enveloppes, tous les autres événements qu’ils pourront prévoir à juste titre devoir arriver, eu égard à la guerre qu’on aura à soutenir : que de part et d’autre on attache à ces vaisseaux de petits tuyaux d’une exacte égalité, en sorte qu’il ne s’écoule ni plus ni moins d’eau des uns que des autres, qu’on remplisse les vases d’eau, qu’on pose dessus les morceaux de liége avec leurs bâtons, et qu’ensuite on ouvre les tuyaux. Cela fait, il est clair que les vases étant égaux, le liége descendra et les bâtons s’enfonceront dans les vases à proportion que ceux-ci se videront ; qu’après avoir fait cet essai avec une égale promptitude et de concert, on porte les vaisseaux aux endroits où l’on doit donner et observer les signaux et qu’on y mette le liège, et à mesure qu’il arrivera quelqu’une de ces choses qui auront été écrites sur les bâtons, qu’on lève un fanal et qu’on le tienne élevé jusqu’à ce que, de l’autre côté, on en lève un autre ; qu’alors on baisse le fanal et qu’on ouvre les tuyaux ; quand l’enveloppe ou la chose dont on veut avertir est écrite et sera descendue au niveau des vases, qu’on lève le flambeau, et que de l’autre côté, sur-le-champ, on bouche les tuyaux et qu’on regarde ce qui est écrit sur la partie du bâton qui touche à l’ouverture du vaisseau ; alors, si tout a été exécuté de part et d’autre avec la même promptitude, de part et d’autre on lira la même chose. Mais cette méthode, quoique un peu différente de celle qui employait, avec les fanaux, des signes dont on était convenu, ne paraît pas encore suffisante. Car on ne peut pas prévoir toutes les choses qui peuvent arriver, et quand on pourrait les prévoir, il ne serait pas possible de les marquer toutes sur un bâton. La dernière méthode a pour auteur Cléoxène et Démoclite, mais nous l’avons perfectionnée. Elle est certaine et soumise à des règles fixes ; par son moyen on peut avertir de tout ce qui se passe. Elle demande Seulement beaucoup de vigilance et d’attention, la voici : Que l’on prenne toutes les lettres de l’alphabet et qu’on en fasse cinq classes en mettant cinq lettres dans chacune. II y en aura une qui n’aura que quatre lettres, mais cela est sans aucune conséquence pour le but que l’on se propose. Que ceux qui seront désignés pour donner et recevoir les signaux écrivent sur cinq tablettes ces cinq classes de lettres, et conviennent ensuite entre eux que celui qui devra donner le signal lèvera d’abord deux fanaux à la fois, et qu’il les tiendra levés jusqu’à ce que de l’autre côté on en ait aussi levé deux, afin que de part et d’autre on soit averti que l’on est prêt. Que les fanaux baissés, celui qui donnera le signal élèvera des fanaux par sa gauche pour faire connaître quelle tablette il doit regarder ; en sorte que si c’est la première il n’en élève qu’un, si c’est la seconde il en élève deux et ainsi du reste, et qu’il fera de même par sa droite, pour marquer à celui qui reçoit le signal quelle lettre d’une tablette il faudra qu’il observe et qu’il écrive. Après ces conventions chacun s’étant mis à son poste, il faudra que les deux hommes chargés de donner les signaux aient chacun une lunette garnie de deux tuyaux, afin que celui qui les donne voie par l’un la droite, et par l’autre la gauche de celui qui doit lui répondre. Près de cette lunette, ces tablettes dont nous venons de parler doivent être fichées droites en terre, et qu’à droite et à gauche, on élève une palissade de dix pieds de largeur et environ de la hauteur d’un homme, afin que les fanaux élevés au-dessus donnent par leur lumière un signal indubitable, et qu’en les baissant elles se Trouvent tout à fait cachées ; tout cet apprêt disposé avec soin de part et d’autre, supposé , par exemple, qu’on veuille annoncer que quelques auxiliaires, au nombre d’environ cent hommes, sont passés dans les rangs de l’ennemi, on choisira d’abord les mots qui expriment cela avec le moins de lettres qu’il sera possible, comme cent Krétois (Crétois) ont déserté, ce qui exprime la même chose avec moitié moins de lettres. On écrira donc cela sur une petite tablette, et ensuite on l’annoncera de cette manière. La première lettre est un K, qui est dans la seconde série des lettres de l’alphabet et sur la seconde tablette : on élèvera donc à gauche deux fanaux pour marquer à celui qui reçoit le signal que c’est la seconde tablette qu’il doit examiner, et à droite cinq qui lui feront connaître que c’est un K, la cinquième lettre de la seconde série qu’il doit écrire sur une petite tablette ; ensuite quatre à gauche pour désigner la lettre R, qui est dans la quatrième série, puis deux à droite pour l’avertir que cette lettre est la seconde de la quatrième série. Celui qui observe les signaux devra donc écrire une R sur sa tablette. Par cette méthode, il n’arrive rien qu’on ne puisse annoncer d’une manière fixe et déterminée. Si l’on y emploie plusieurs fanaux, c’est parce que chaque lettre demande d’être indiquée deux fois ; mais d’un autre côté, si l’on y apporte les précautions nécessaires, on en sera satisfait. L’une et l’autre méthode ont cela de commun qu’il faut s’y être exercé avant de s’en servir, afin que l’occasion se présentant, on soit en état, sans faire faute, de s’instruire réciproquement de ce qu’il importe de savoir. LA FLOTTE. — Pendant longtemps les Romains s’occupèrent fort peu de leur marine. Dans les premiers temps, ils n’avaient que des bateaux fort grossiers, semblables à ceux que portait le Tibre, et c’est seulement à partir des guerres puniques qu’ils sentirent la nécessité d’un armement naval. Les vaisseaux de guerre qu’ils construisirent alors ne se distinguaient des autres que par leur dimension qui était généralement plus grande. Les monuments, et notamment la colonne Trajane, en offrent plusieurs représentations. La proue, c’est-à-dire l’avant, est représentée sur la figure 393, et la poupe, c’est-à-dire l’arrière, sur la figure 394. Dans la première, on voit sur le rivage un autel avec la flamme sacrée et un bœuf qui va être immolé. C’était, en effet, l’usage d’offrir un sacrifice au moment où une expédition navale se mettait en route. La disposition générale d’un navire est très visible sur la figure 395, qui représente l’empereur Trajan quittant le port d’Ancône. On remarquera la cabine du commandant placée à la poupe du navire. C’est près de là qu’on mettait les drapeaux et enseignes militaires, ainsi que la lanterne destinée à éclairer le bâtiment. Mais ce qui distingue surtout les bâtiments destinés à là guerre, c’est le rostrum ou saillie en forme de pointe qui forme l’avant d’un navire, et qui ici est décoré d’un œil.
On donne le nom de rostrum à une sorte d’éperon, qui faisait saillie sur la proue des bâtiments de guerre et se terminait par une pointe en bronze ou en fer. Dans la marine primitive c’était une simple poutre, dont l’extrémité était en métal et représentait, habituellement la tête d’un animal : c’est dans ce genre qu’est le rostrum antique trouvé au fond du port de Gênes. Mais plus tard, le rostrum fut formé de plusieurs poutres en saillie, dont une dominant toutes les autres, et au lieu d’apparaître en saillie au-dessus de la ligne de flottaison, il fut placé plus bas, de manière à ouvrir une terrible voie d’eau au navire endommagé. Les Romains se servaient aussi dans les armées navales d’une machine de guerre appelée corbeau, qui servait à l’abordage du vaisseau ennemi et dont Polybe donne la description suivante : Comme les vaisseaux romains étaient mal construits et d’une extrême pesanteur, quelqu’un suggéra l’idée de se servir de ce qui fut depuis ce temps appelé des corbeaux. Voici ce que c’était : Une pièce de bois ronde, longue de quatre aunes, grosse de trois palmes de diamètre, et autour, une échelle clouée à des planches de quatre pieds de largeur sur six aunes de longueur, dont on avait fait un plancher, percé au milieu d’un trou oblong, qui embrassait la pointe à deux aunes de l’échelle. Des deux côtés de l’échelle, sur la longueur, on avait attaché un garde-fou qui couvrait jusqu’aux genoux. Il y avait au bout du mât une espèce de pilon de fer pointu, au haut duquel était un anneau, de sorte que toute cette machine paraissait semblable à celles dont on se sert pour faire la farine. Dans cet anneau passait une corde avec laquelle, par le moyen de la poulie qui était au haut de la poutre, on élevait les cordages lorsque les vaisseaux s’approchaient et on les jetait sur les vaisseaux ennemis, tantôt du côté de la proue, tantôt sur les côtés, selon différentes rencontres. Quand les corbeaux accrochaient -un navire, si les deux étaient joints par leurs côtés, les Romains sautaient dans le vaisseau ennemi d’un bout à l’autre ; s’ils n’étaient joints que par la proue, ils avançaient deux à deux au travers du corbeau. Les premiers se défendaient avec leurs boucliers des coups qu’on leur portait par devant ; et les suivants, pour parer les coups portés de côté, appuyaient leurs boucliers sur le garde-fou. Outre les rameurs et les matelots chargés de la manœuvre, il y avait toujours, sur les navires romains, des soldats exercés à combattre sur mer et qui répondaient à ce que sont aujourd’hui nos soldats de marine.
Les vaisseaux de guerre, lorsqu’ils étaient en route, ne
marchaient qu’à la voile, et on n’employait la rame que pour la tactique. Dès
que l’ennemi était signalé les matelots carguaient les voiles, et amenaient
les antennes, en même temps que les soldats élevaient à la proue et à la
poupe des tours de combat, dont on voit une représentation sur la figure 396.
Ces tours s’emportaient démontées, parce que pendant le trajet, elles
auraient gêné la man Après la bataille d’Actium on adopta dans la marine militaire une forme de navire analogue à celle des bâtiments que montaient les pirates illyriens (fig. 397). C’était un navire mince et allongé présentant une pointe à l’arrière comme à l’avant, et pouvant contenir quelquefois plusieurs bancs de rameurs. Le mât était placé au milieu du navire et on se servait de la voile levantine ou triangulaire, au lieu de la voile latine ou carrée qu’on employait pour les autres navires. Ces vaisseaux apparaissent quelquefois sur les médailles de Claude ou de Domitien. LE TRIOMPHE. — Le triomphe, cérémonie purement romaine et dont on ne trouve pas l’analogue chez les autres peuples de l’antiquité, avait pour but avoué d’offrir un sacrifice d’actions de grâce à Jupiter Capitolin, mais le véritable but était de montrer au peuple toute la gloire qu’on avait acquise et tout le butin qu’on avait fait. Pour avoir droit aux honneurs du triomphe, il fallait avoir commandé en chef les armées romaines, remporté une grande victoire et tué au moins cinq mille ennemis dans une bataille rangée, avoir agrandi le territoire de la république et terminé la guerre sans avoir éprouvé de défaites. Celui qui avait obtenu le triomphe ne pouvait pas rentrer dans. Rome avant la cérémonie, et le sénat qui décernait le triomphe devait se réunir dans un temple situé hors de l’enceinte de la ville, pour entendre le candidat et examiner ses droits. Le costume du triomphateur était une tunique bordée de palmes et une toge de pourpre à rosaces d’or, que l’on conservait dans le temple de Jupiter Capitolin. Il tenait à la main un sceptre d’ivoire surmonté d’un aigle et conservait à perpétuité le droit de porter en public une couronne de laurier. Le triomphe était toujours accompagné d’un immense appareil militaire. Des poteaux placés le long du chemin triomphal portaient des écriteaux où étaient relatés les principaux faits d’armes de la campagne. Le butin était exposé sur des chariots et accompagné des prisonniers de guerre garrottés. Des couronnes d’or offertes par les villes alliées du peuple romain précédaient le char triomphal. Ce char, splendidement décoré, était tiré par quatre chevaux blancs, marchant de front et quelquefois par des éléphants. Les figures 398 et 399 montrent ces chars dans leur forme la plus habituelle. Mais cette forme n’était pas toujours la même. Aussi une médaille de Vespasien montre un char triomphal qui, au lieu de s’ouvrir par derrière comme les chars ordinaires, était complètement circulaire et fermé de tous les côtés : les panneaux extérieurs étaient décorés de sculptures en ivoire. Enfin, la figure 400 montre un char de triomphe de l’empire d’Orient. Les clients et les amis du triomphateur, le sénat, les consuls et tous les grands magistrats suivaient à pied le char triomphal et les soldats venaient ensuite chantant leurs propres louanges qu’ils accompagnaient quelquefois de satires contre leur général. La pompe triomphale traversait le Champ de Mars, passait dans le Vélabre, dans le cirque Maxime, longeait le mont Palatin, prenait la voie Sacrée, traversait le Forum et montait au temple de Jupiter Capitolin. Là, le triomphateur présentait au dieu une branche de laurier et lui adressait une prière d’actions de grâces pour la république. Les grands et sérieux triomphes ont été ceux de la république ; nais les plus pompeux ont été ceux de l’époque impériale. Sous l’empire, l’honneur du triomphe fut réservé à l’empereur seul, parce que les autres généraux commandaient seulement à titre de lieutenants et les empereurs se sont souvent fait décerner des triomphes peu mérités. Un des plus célèbres triomphes de la période républicaine a été celui de Paul-Émile, après sa victoire sur Persée, roi de Macédoine. Plutarque en a laissé la description suivante : On avait dressé dans les théâtres où se font les courses de chevaux et qu’on appelle cirques, dans les places publiques et dans tous les lieux de la ville d’où l’on pouvait voir la pompe, des échafauds, sur lesquels se placèrent les spectateurs, vêtus de robes blanches. On ouvrit les temples, on les couronna de festons, et on y brûla continuellement des parfums. Un grand nombre de licteurs et d’autres officiers publics, écartant ceux qui couraient sans ordre de côté et d’autre, ou qui se jetaient trop en avant, tenaient les rues libres et dégagées. La marche triomphale dura trois jours entiers ; le premier suffit à peine à voir passer les statues, les tableaux et les figures colossales, qui, portés sur deux cent cinquante chariots, offraient un spectacle imposant. Le second jour, on vit passer également sur un grand nombre de chariots les armes les plus belles et les plus riches des Macédoniens, tant d’airain que d’acier et qui, nouvellement fourbies, jetaient le plus vif éclat. Quoique rassemblées avec beaucoup de soin et d’art, elles semblaient avoir été jetées au hasard par monceaux ; c’étaient des casques sur des boucliers, des cuirasses sur des bottines, des pavois de Crète, des targes de Thrace, des carquois entassés pêle-mêle avec des mors et des brides ; des épées nues et de longues piques sortaient de tous les côtés et présentaient leurs pointes menaçantes. Toutes ces armes étaient retenues par des liens un peu lâches, et le mouvement des chariots les faisant se froisser les unes contre les autres, elles rendaient un son aigu et effrayant ; la vue seule des armes d’un peuple vaincu inspirait une sorte d’horreur. A la suite de ces chariots marchaient trois mille hommes, qui portaient l’argent monnayé dans sept cent cinquante vases, dont chacun contenait le poids de trais talents, et était soutenu par quatre hommes. D’autres étaient chargés de cratères d’argent, de coupes en forme de cornes, de gobelets et de flacons, disposés de manière à être bien vus, et aussi remarquables par leur grandeur que par la beauté de leur ciselure. Le troisième jour, dès le matin, les trompettes se mirent en marche ; elles firent entendre, non les airs qu’on a coutume de jouer dans les processions et les pompes religieuses, mais ceux que les Romains sonnent pour exciter les troupes au combat. A leur suite étaient cent vingt taureaux qu’on avait engraissés, leurs cornes étaient dorées et leurs corps ornés de bandelettes et de guirlandes. Leurs conducteurs, qui devaient les immoler, étaient de jeunes garçons ceints de tabliers richement brodés, et suivis d’autres jeunes gens qui portaient les vases d’or et d’argent pour Ies sacrifices. On avait placé derrière eux ceux qui étaient chargés de l’or monnayé ; il était distribué, comme la monnaie d’argent, dans des vases qui contenaient chacun trois talents (seize mille six cent quatre-vingts francs). Il y en avait soixante-dix-sept. Ils étaient suivis de ceux qui portaient la coupe sacrée d’or massif, du poids de dix talents (environ deux cent soixante et un kilogrammes), que Paul-Émile avait fait faire, et enrichie qui était de pierres précieuses. On portait à la suite les vases qu’on appelait antigonides, séleucides, thériclées, et toute la vaisselle d’or de Persée ; on voyait ensuite le char de Persée et ses armes surmontées de son diadème. A peu de distance, marchaient ses enfants captifs, avec leurs gouverneurs, leurs précepteurs et leurs officiers, qui tous fondaient en larmes, tendaient les mains aux spectateurs, et montraient à ces enfants à intercéder auprès du peuple et à lui demander grâce. Il y avait deux garçons et une fille ; leur âge tendre les empêchait de sentir toute la grandeur de leurs maux, et un si grand changement de fortune les rendait d’autant plus dignes de pitié, qu’ils y étaient moins sensibles. Peu s’en fallut même que Persée ne passât sans être remarqué, tant la compassion fixait les yeux des Romains sur ces tendres enfants et leur arrachait des larmes1 Ce spectacle excitait un sentiment mêlé de plaisir et de douleur, qui ne cessa que lorsque cette troupe fut passée. Persée venait après ses enfants et leur suite ; il était vêtu d’une robe noire et portait des pantoufles à la macédonienne ; on voyait à son air que la grandeur de ses maux lui en faisait craindre de plus grands encore et lui avait troublé l’esprit. Il était suivi de la foule de ses amis et de ses courtisans, qui, marchant accablés de douleur, baignés de larmes, et les regards toujours fixés sur Persée ; faisaient juger à tous les spectateurs que, peu sensibles à leur propre malheur, ils ne déploraient que l’infortune de leur prince. Après cette dernière troupe, on vit passer quatre cents couronnes d’or, que les villes avaient envoyées à Paul-Émile par des ambassadeurs, pour prix de sa victoire. Enfin paraissait le triomphateur, monté sur un char magnifiquement paré ; mais il n’avait pas besoin de cette pompe majestueuse pour attirer tous les regards ; vêtu d’une robe de pourpre brodée en or, il tenait clans sa main droite une branche d’olivier. Toute son armée en portait aussi et suivait son char, rangée par compagnies, chantant ou des chansons usitées dans ces sortes de pompes et mêlées de traits satiriques, ou des chants de victoire pour célébrer les exploits de Paul-Émile, qui, admiré et applaudi de tout le monde, ne voyait pas un seul homme de bien porter envié à sa gloire. L’arc de triomphe est un édifice dont le caractère revient en propre aux Romains, et rien de pareil n’a existé en Grèce. On croit trouver l’origine de cette classe de monuments dans l’habitude qu’avaient les Romains de faire, dans les rues où devait passer le triomphateur, des décorations provisoires où l’on suspendait les dépouilles des vaincus. En général les arcs de triomphe des Romains n’étaient pas, comme ceux des peuples modernes, des monuments élevés à la gloire militaire d’une nation et représentant par conséquent une idée générale. C’était en quelque sorte de l’architecture historique, et un arc triomphal devait consacrer par des représentations non équivoques le souvenir du triomphe particulier qui avait motivé son érection. De là un style spécial dans la décoration de ces monuments, qui devaient rappeler d’une manière symbolique ou réelle les nations vaincues, les villes prises, les rois captifs, que chacun devait être en mesure de reconnaître. Pendant longtemps l’arc de triomphe n’a été qu’un arc plein cintre au-dessus duquel on plaçait la statue du triomphateur et les trophées de la victoire. C’est ainsi qu’on les voit représentés sur plusieurs médailles : ces constructions n’étaient le plus souvent que provisoires, et à part une colonne qui était placée de chaque côté de l’arcade, ils étaient à peu près nus. Plus tard, l’édifice forma un carré percé de trois arcades surmontées d’un attique assez élevé. Le triomphateur passait par l’arcade du milieu et, au moment de son passage, de petites figures ailées que faisait mouvoir un ressort posaient une couronne sur sa tête. C’est là, selon Quatremère de Quincy, l’origine de ces victoires ailées qui figurent sur les arcs de triomphe. Ce sont ces monuments, qui n’étaient d’abord construits que provisoirement, qui ont servi de types aux arcs de triomphe qu’on a élevés ensuite. Il y en a encore d’une autre espèce qui présentent des arcs doubles. Mais ceux-ci n’avaient pas toujours de signification particulière et s’employaient surtout pour les portes des villes. Les deux arcades s’employaient pour l’entrée et la sortie. Les arcs de Titus, de Septime Sévère, de Constantin, à Rome, l’arc de Trajan, à Ancône et à Bénévent, et en France, l’arc d’Orange sont les plus célèbres monuments de ce genre qui nous aient été conservés.
Tout soldat romain qui avait fait prisonnier un soldat ennemi avait droit à une récompense spéciale. La figure 403 représente un prisonnier dace qu’un soldat romain amène devant l’empereur, et la figure 404 deux cavaliers barbares qui sont également conduits par un soldat romain ; celui-ci porte le vexillum qui est le drapeau de la cavalerie. Outre les récompenses spéciales affectées à certains actes de cou rage, le butin pris sur l’ennemi entrait pour une forte part dans lez avantages qu’un soldat pouvait tirer de sa profession. L’histoire offre plus d’un exemple d’une armée victorieuse qui, pendant qu’elle se livre au pillage, est exposée à un retour offensif de l’ennemi, ou qui, après la bataille, se mutine à cause de l’inégalité des parts faites à chacun. Les généraux romains avaient prévu cela et Polybe nous apprend comment se fit le partage du butin après la prise de Carthagène. Le lendemain, tout le butin qu’on avait fait, tant sur la garnison que sur les citoyens et les artisans, ayant été rassemblé sur la place publique, les tribuns le distribuèrent à leurs légions, selon l’usage établi chez les Romains. Or telle est la manière d’agir de ce peuple, lorsqu’ils prennent une ville d’assaut. Chaque jour, on tire des légions un certain nombre de soldats, selon que la ville est grande ou petite, mais jamais plus de la’ moitié. Les autres demeurent à leur poste, soit hors de la ville, soit au dedans, selon qu’il est besoin. Ces troupes se dispersent pour butiner et on porte ensuite ce que l’on a pris, chacun à sa légion. Le butin vendu à l’encan, les tribus en partagent le prix en parties égales, qui se donnent non seulement à ceux qui sont aux différents postes, mais encore à ceux qui ont été laissés à la garde du camp, aux malades et aux autres qui ont été détachés pour quelque mission que ce soit. LES ENNEMIS DES ROMAINS. — Les petites peuplades qui habitaient le Latium, et qui étaient dans le voisinage immédiat de Rome, ont été naturellement les premiers ennemis que Rome ait eu à combattre. Riais tout ce qui concerne l’époque des rois est tellement légendaire qu’il est impossible de rien préciser sur cette période. On peut du moins présumer que ces luttes devaient ressembler passablement à celles des héros grecs de la même époque. Il semble que la guerre ait consisté en luttes individuelles dont le fameux combat des Horaces et des Curiaces présente certainement le récit le plus curieux. Mais c’est un duel plutôt qu’une bataille, et pour tout ce qui concerne l’organisation militaire des populations primitives de l’Italie, les textes fournissent en somme bien peu de renseignements. Néanmoins les Étrusques nous ont laissé, à défaut de documents écrits, quelques monuments qui, s’ils ne nous éclairent pas beaucoup sur les grandes divisions d’une armée, et sur les manœuvres qu’on pouvait lui faire exécuter, nous montrent du moins l’équipement du guerrier et les armes qu’il avait à sa disposition. Le soldat de style archaïque que montre la figure 405 porte un casque peu différent de celui des Grecs de l’âge héroïque ; il tient en main deux javelots et n’a pas de bouclier. La poitrine est entièrement préservée des coups de l’ennemi par une forte cuirasse, mais les jambes semblent tout à fait à découvert. Mais il n’en est pas de même de la très curieuse statuette représentée sur la figure 406, qui est pourvue de jambards, mais dont les pieds sont entièrement nus, particularité que l’on remarque assez fréquemment sur les monuments étrusques. Quant aux cavaliers étrusques représentés sur un bas-relief (figure 407), qui rappelle sous une forme plus barbare ceux de la grande cavalcade du Parthénon, ils sont remarquables par la coiffure et par la tunique serrée à la ceinture, mais ils fournissent en somme peu de renseignements sur l’armement ries Étrusques. Le personnage représenté sur la figure 408 est probablement un chef plutôt qu’un simple soldat : c’est du moins ce qui paraît résulter de son équipement qui montre un certain luxe. La tête de ce guerrier est coiffée d’un casque surmonté d’un grand panache qui retombe jusqu’au milieu du dos, comme le montre la figure 409, qui représente le même guerrier vu de dos. Ce casque est garni d’ailerons pour protéger les oreilles. La poitrine est garantie par un corselet, serré par une ceinture et surmonté de deux épaulettes qui redescendent en pointe par devant. Sous ce corselet est une tunique courte, dont le bas est apparent sur le haut des cuisses. Des jambières, qui couvrent entièrement le genou et descendent jusqu’aux chevilles, enveloppent les membres inférieurs en laissant à découvert une partie du mollet. Ce guerrier porte un bouclier rond, analogue à ceux qu’on trouve chez tous les peuples de l’Italie primitive et qui est également la forme du bouclier romain des premiers âges. Un vase peint du Louvre nous donne la représentation d’un guerrier samnite (fig. 410). Il a le corps protégé par une espèce de cuirasse, garnie d’une ceinture ; un manteau court fixé sur le devant de la poitrine flotte sur ses épaules. Son casque est garni de plumes ; il tient un javelot dans sa main droite et porte au bras gauche un bouclier. Les figures 411 à 414, d’après des peintures découvertes dans un tombeau de Pœstum, montrent également des guerriers de l’Italie méridionale. Les Samnites, dit Tite-Live, avaient imaginé de frapper les regards par l’éclat d’une nouvelle armure. Il g avait deux corps d’armée ; l’un avait ses boucliers ciselés en or, l’autre en argent. Le bouclier avait une forme particulière : plus évasé vers l’endroit qui couvre les épaules et la poitrine, il offrait dans toute sa partie supérieure une largeur égale, tandis que vers le bas il s’amincissait en coin pour être plus maniable ; la poitrine était garantie par une cotte de mailles tissue en éponge et la jambe gauche par une bottine de fer ; les casques étaient rehaussés par un panache, qui donnait à la taille un air gigantesque. L’uniforme du corps aux boucliers dorés était bigarré de différentes couleurs ; celui du corps aux boucliers d’argent était blanc. Ceux-ci formaient l’aile droite, les autres l’aile gauche. Un cavalier samnite est représenté sur la figure 415, d’après une peinture de vase. Son costume ne diffère pas beaucoup de celui des fantassins : le cheval n’a pas de selle ni le coussinet ou le tapis qui la remplace habituellement dans la cavalerie antique. Si la lutte contre les Samnites a établi la prédominance des Romains en Italie, ce sont les guerres puniques qui marquent l’avènement de leur grande puissance. Carthage entretenait, surtout à l’époque des guerres puniques, des armées considérables. Elles se composaient en grande partie de soldats mercenaires levés en différents pays. Cependant il y avait toujours dans une armée un corps spécial formé de Carthaginois, mais il était peu nombreux, et il semble avoir été destiné plutôt à former des officiers capables de commander qu’à constituer un véritable corps d’armée. Ainsi dans un ensemble de soixante-six mille hommes, il n’y en avait pas, suivant Diodore de Sicile, plus de deux mille cinq cents qui fussent de Sicile. Les peuples tributaires d’Afrique formaient la plus grande partie du contingent. Il y avait aussi un assez grand nombre de Gaulois et d’Espagnols : ceux-ci formaient habituellement la grosse infanterie, car les Africains étaient plutôt cavaliers. Les frondeurs des Baléares formaient un corps très redouté. Les Grecs, les Campaniens et les Liguriens figuraient aussi en assez grand nombre dans les armées carthaginoises. Quelques statuettes d’un travail très grossier, découvertes dans la Campanie et la Grande-Grèce, passent pour représenter des soldats au service de Carthage. Telles sont les deux figurines en bronze trouvées près de Capoue, que reproduisent les figures 416 et 417. Ces deux cavaliers campaniens portent une coiffure en forme de capuchon, une tunique fermée par une large ceinture et un pantalon collant à carreaux avec des genouillères. Une autre statuette en bronze trouvée près de Grumentum, en Lucanie, représente un cavalier qui en porte un autre en croupe. On attribue également à ce groupe une origine carthaginoise, sans toutefois qu’il y ait beaucoup de preuves à l’appui ; le travail en est extrêmement grossier et rappelle les images phéniciennes de l’île de Sardaigne (fig. 418). Les cavaliers numides, qui sont probablement les ancêtres de, nos Kabyles d’Afrique, étaient très redoutés des Romains. Quand nos cohortes se détachaient, dit J. César (Guerre civile), les Numides évitaient leur choc par la fuite, puis, revenant les envelopper dans leur mouvement de retraite, les empêchaient de rejoindre l’armée. Ainsi elles ne pouvaient, sans péril, ni garder leur poste et leur rang, ni se porter en avant et tenter les hasards. L’armée ennemie, à laquelle le roi ne cessait d’envoyer des renforts, grossissait à tout moment ; les nôtres tombaient de lassitude ; les blessés ne pouvaient ni se retirer du combat, ni être transportés en lieu sûr, à cause de la cavalerie numide qui nous enveloppait de toutes parts. Ces Numides si redoutés des Romains formaient en grande partie la cavalerie légère de l’armée carthaginoise. Les éléphants guidés par les Éthiopiens formaient aussi un appoint important de l’armée carthaginoise ; mais dans les guerres lointaines ils sont souvent cause de sérieux embarras pour la difficulté du transport. Polybe raconte la manière qu’employa Annibal pour faire passer le Rhône à ses éléphants : Après avoir fait plusieurs radeaux, d’abord on en joignit deux l’un à l’autre, qui faisaient ensemble cinquante pieds de largeur et on les mit au bord de l’eau où ils étaient retenus avec force et arrêtés à terre. Au bout, qui était hors de l’eau, on en attacha deux autres, et l’on poussa cette espèce de pont sur la rivière. Il était à craindre que la rapidité du fleuve n’emportât tout l’ouvrage. Pour prévenir ce malheur, on retint le côté exposé au courant par des cordes attachées aux arbres qui bordaient le rivage. Quand on eut porté ces radeaux à la longueur d’environ deus cents pieds, on en construisit deux autres beaucoup plus grands que l’on joignit aux derniers. Ces deux furent liés fortement l’un à l’autre ; mais ils ne le furent pas tellement aux plus petits qu’il ne fût aisé de les détacher. On avait encore attaché beaucoup de cordes aux petits radeaux, par le moyen desquelles les nacelles destinées à les remorquer pussent les affermir contre l’impétuosité de l’eau et les amener jusqu’au bord avec les éléphants. Les deux grands radeaux furent ensuite couverts de tertre et de gazon, afin que ce pont fût semblable en tout au chemin qu’avaient à faire les éléphants pour en approcher. Sur terre ces animaux s’étaient toujours laissé manier par leurs conducteurs ; mais ils n’avaient pas encore osé mettre les pieds dans l’eau. Pour les y faire entrer, on mit à leur tête deux éléphants femelles, qu’ils suivaient sans hésiter. Ils arrivent sur les derniers radeaux, on coupe les cordes qui tenaient ceux-ci attachés aux deux plus grands ; les nacelles remorquent et emportent bientôt les éléphants loin des radeaux qui étaient couverts de terre. D’abord ces"animaux, effrayés, inquiets, allèrent et vinrent de côté et d’autre. Mais l’eau dont ils se voyaient environnés leur fit peur et les retint en place. C’est ainsi qu’Annibal, en joignant des radeaux deux à deux, trouva le secret de faire passer le Rhône à la plupart de ses éléphants. Je dis à la plupart, car ils ne passèrent pas tous de la même manière. Il y en eut qui, au milieu du trajet, tombèrent de frayeur dans la rivière. Mais leur chute ne fut funeste qu’aux conducteurs. Pour eux la force et la longueur de leurs trompes les tira du danger. En élevant ces trompes au-dessus de l’eau, ils respiraient et éloignaient tout ce qui pouvait leur nuire, et par ce moyen ils vinrent droit au bord malgré la rapidité du fleuve. Les vaisseaux des Carthaginois étaient mieux bâtis que ceux des Romains, et leurs marins beaucoup plus expérimentés. C’est ce que démontre clairement le récit d’un combat naval dans Polybe. Les Carthaginois eurent pendant tout le combat bien des avantages sur les Romains : leurs vaisseaux étaient construits de manière à se mouvoir en tous sens avec beaucoup de légèreté ; leurs rameurs étaient experts, et enfin ils avaient eu la sage précaution de se ranger en bataille en pleine mer. Si quelques-uns des leurs étaient pressés par l’ennemi, ils se retiraient sans courir aucun risque, et avec des vaisseaux aussi légers, il leur était aisé de prendre le large. L’ennemi s’avançait-il pour les poursuivre, ils se tournaient, voltigeaient autour ou lui tombaient sur le’ flanc et le choquaient sans cesse, pendant que le vaisseau romain pouvait à peine revirer à cause de sa pesanteur et du peu d’expérience des rameurs ; ce qui fut cause qu’il y en eut un grand nombre de coulés à fond, tandis que, si un des vaisseaux carthaginois était en péril, on pouvait en sûreté aller à son secours, en se glissant derrière la poupe des vaisseaux. Quelques monuments peu nombreux, il est vrai, et des textes très précis, dus aux deux grands écrivains militaires de l’antiquité, Polybe et Jules César, nous font connaître la manière de combattre des Gaulois et nous initient à leurs habitudes militaires. L’enseigne militaire des Gaulois était un sanglier. Un bas-relief de l’arc de triomphe d’Orange nous montre comment cette enseigne était disposée sur son manche. Nous la reproduisons figure 419. Une sculpture d’un sarcophage de la vigne Ammendola représente un Gaulois qui tombe en arrachant l’arme qui vient de lui transpercer la poitrine. Il a les bras et les jambes nues ; le corps est recouvert par une tunique sans manches (fig. 420). Un fragment de bas-relief encastré dans le piédestal de la Melpomène, au musée du Louvre, représente tin Gaulois défendant sa maison contre les soldats romains. Le bras du Gaulois est recouvert d’une manche qui descend jusqu’au poignet. La maison, ou plutôt la hutte qu’on voit au fond, paraît construite avec des joncs et des roseaux (fig. 421). La bravoure des Gaulois était proverbiale et leur élan était irrésistible : leurs armes étaient mauvaises. Telle est à peu près l’impression que nous donne Polybe. Les Romains, dit Polybe, voyant les Gaulois serrés entre deux armées et enveloppés de toutes parts, ne pouvaient que bien espérer du combat ; mais, d’un autre côté, la disposition de ces troupes et le bruit qui s’y faisait les jetaient dans l’épouvante. La multitude des cors et des trompettes y étaient innombrable, et toute l’armée ajoutant à ces instruments ses cris de guerre, le vacarme était tel que les lieux voisins qui le renvoyaient semblaient d’eux-mêmes joindre des cris au bruit que faisaient les trompettes et les soldats. Ils étaient effrayés aussi de l’aspect et des mouvements des soldats des premiers rangs, qui, en effet, frappaient autant par la beauté et la vigueur de leurs corps que par leur nudité ; outre qu’il n’y en avait point dans les premières compagnies qui n’eussent le cou et les bras ornés de colliers et de bracelets d’or. A l’aspect de cette armée, les Romains ne purent à la vérité se défendre de quelque frayeur, mais l’espérance d’un riche butin enflamma leur courage... Les archers s’avancèrent sur le front de la première ligne, selon la coutume des Romains, et commencèrent l’action par une grêle épouvantable de traits. Les Gaulois des derniers rangs n’en souffrirent pas extrêmement, leurs braies et leurs saies les en défendirent ; mais ceux des premiers, qui ne s’attendaient pas à ce prélude et n’avaient rien sur leur corps qui les mît à couvert, en furent très incommodés. Ils ne savaient que faire pour parer les coups. Leur bouclier n’était pas assez large pour les couvrir ; ils étaient nus, et plus leurs corps étaient grands, plus il tombait de traits sur eux. Se venger sur les archers mêmes des blessures qu’ils recevaient, cela était impossible, ils en étaient trop éloignés ; et d’ailleurs comment avancer au travers d’un si grand nombre de traits ? Dans cet embarras, les uns, transportés de colère et de désespoir, se jettent inconsidérément parmi les ennemis, et se livrent involontairement à la mort ; les autres pâles, défaits, tremblants, reculent et rompent les rangs qui étaient derrière eux... Si les armes des Gaulois eussent été les mêmes que celles des Romains, ils remportaient la victoire. Ils avaient à la vérité comme eux des boucliers pour parer, mais leurs épées ne leur rendaient pas les mêmes services. Celles des, Romains taillaient et perçaient, au, lieu que les leurs ne frappaient que de taille. Cette bataille est célèbre par l’intelligence avec laquelle les Romains s’y conduisirent. Tout l’honneur en est dû aux tribuns qui instruisirent l’armée en général, et chaque soldat en particulier, de la manière dont on devait combattre. Ceux-ci, dans les combats précédents, avaient observé que le feu et l’impétuosité des Gaulois, tant qu’ils n’étaient pas entamés, les rendaient à la vérité formidables dans le premier choc ; mais que leurs épées n’avaient pas de pointes, qu’elles ne frappaient que de taille et d’un seul coup ; que le fil s’en émoussait, et qu’elles se pliaient d’un bout à l’autre ; que si les soldats, après le premier coup, n’avaient pas le temps de les appuyer contre terre et de les redresser avec le pied, le second n’était d’aucun effet. Sur ces remarques, les tribuns donnent à la première ligne les piques des triaires qui sont à la seconde et commandent à ces derniers de se servir de leurs épées. On attaque de front les Gaulois, qui n’eurent pas plutôt porté les premiers coups, que leurs sabres leur devinrent inutiles. Alors les Romains fondent sur eux l’épée à la main, sans que ceux-ci puissent faire aucun usage des leurs, au lieu que les Romains, ayant des épées pointues et bien affilées, frappent d’estoc et non pas de taille. Portant alors des coups et sur la poitrine et au visage des Gaulois, et faisant plaie sur plaie, ils en jetèrent la plus grande partie sur le carreau. Jules César a jugé les Gaulois sous un tout autre point de vue : A la valeur singulière de nos soldats, dit-il, les Gaulois opposaient des inventions de toute espèce, car cette nation est très industrieuse et très adroite à imiter et à exécuter tout ce qu’elle voit faire. Ils détournaient nos faux avec des lacets, et lorsqu’ils les avaient saisies, ils les attiraient à eux avec des machines. Ils ruinaient notre terrasse, en la minant avec d’autant plus d’habileté qu’ayant des mines de fer considérables, ils connaissent et pratiquent toutes sortes de galeries souterraines. Ils avaient de tous côtés garni leurs murailles de tours recouvertes de cuir. Faisant de jour et de nuit de fréquentes sorties, tantôt ils mettaient le feu aux ouvrages, tantôt ils tombaient sur les travailleurs. L’élévation que gagnaient nos tours par l’accroissement journalier de la terrasse, ils la donnaient aux leurs en y ajoutant de longues poutres liées ensemble ; ils arrêtaient nos mines avec des pieux aigus, brillés par le bout, de la poix bouillante, d’énormes quartiers de roches, et nous empêchaient ainsi de les approcher des remparts. Voici quelle est à peu près la forme des murailles dans toute la Gaule : à la distance régulière de deux pieds, on pose sur leur longueur des poutres d’une seule pièce, on les assujettit intérieurement entre elles et on les revêt de terre foulée. Sur le devant, on garnit de grosses pierres les intervalles dont nous avons parlé. Ce rang ainsi disposé et bien lié, on en met un second en conservant le même espace de manière que les poutres ne se touchent pas, mais que dans la construction elles se tiennent à une distance uniforme, un rang de pierres entre chacune. Tout l’ouvrage se continue ainsi, jusqu’à ce que le mur ait atteint une hauteur convenable. Non seulement une telle construction, formée de rangs alternatifs de poutres et de pierres, n’est point, à cause de cette variété même, désagréable à l’œil, mais elle est encore d’une grande utilité pour la défense et la sûreté des villes ; car la pierre protège le mur contre l’incendie, et le bois contre le bélier ; et on ne peut renverser ni même entamer un enchaînement de poutres de quarante pieds de long, la plupart liées ensemble dans l’intérieur. On voit que le général romain semble apprécier vivement les Gaulois pour tout-ce qui concerne l’attaque et la défense des places : Dans un autre endroit, Jules César parle des chariots que les Gaulois employaient à la guerre : Voici, dit Jules César, leur manière de combattre avec ces chariots : d’abord ils les font courir sur tous les points en lançant des traits ; et par la seule crainte qu’inspirent les chevaux et le bruit des roues, ils parviennent souvent à rompre les rangs. Quand ils ont pénétré dans les escadrons, ils sautent à bas de leurs chariots et combattent à pied. Les conducteurs se retirent peu à peu de la mêlée et placent les chars de telle façon que si les combattants sont pressés par le nombre, ils puissent aisément se replier sur eux. C’est ainsi qu’ils réunissent dans les combats l’agilité du cavalier à la fermeté du fantassin ; et tel est l’effet de l’habitude et de leurs exercices journaliers, que, dans les pentes les plus rapides, ils savent arrêter leurs chevaux au galop, les modérer et les détourner aussitôt, courir sur le timon, se tenir ferme sur le joug et de là s’élancer précipitamment dans leurs chars. Nous avons déjà parlé des Germains, des Daces et des Sarmates (t. II). Nous n’avons donc pas à revenir sur ces peuples. La figure 422 représente un soldat dace combattant les Romains. Voici maintenant, figure 423, les archers daces avec leurs casques coniques. Remarquons en passant combien ces archers daces ressemblent par leur tournure et leur costume à tout ce que les écrivains nous ont rapporté sur les Parthes. Les royaumes grecs fondés en Asie subirent la loi commune et tombèrent tour à tour sous la domination romaine. Mais les Parthes, les Sarmates et en général tous les peuples originaires de Scythie, avaient conservé les mœurs belliqueuses des anciens barbares, et arrêtèrent les Romains dans leur marche conquérante. Rome ne put jamais s’étendre bien loin du côté de l’Orient, et les frontières de l’empire romain furent au contraire exposées à de continuelles dévastations. Les Parthes étaient renommés comme cavaliers et comme archers ; ils vivaient presque toujours à cheval et c’était en fuyant qu’ils étaient les plus redoutables, attirant l’ennemi sur leurs traces et lui décochant des flèches en courant. Les cavaliers parthes ou sarmates représentés sur la colonne Trajane sont revêtus, ainsi que leurs chevaux, d’une cotte de mailles qui les protège entièrement (fig. 424 et 425). On distingue ici l’agencement de leur casque qui est un bonnet de cuir de farine conique, entouré de cercles de métal et garni de mentonnières. Nous avons parlé plus haut des Perses sassanides (tome I). La figure 426 montre des cavaliers de Sapor et la figure 427, des fantassins de la même armée. L’allure de ces personnages a encore un peu du caractère antique ; mais la figure 428, qui représente un cavalier sculpté sur le rocher de Bisoutoun, quoique de la période sassanide, présente déjà une allure complètement moyen âge. Ce cavalier porte une cotte de mailles qui retombe sur les genoux et remonte sur le casque de manière à masquer complètement le visage. Il tenait une lance de la main droite qui est brisée ; le bras gauche porte un petit bouclier rond. De riches vêtements décorés avec la profusion ordinaire aux Sassanides sortent de cette cotte de mailles. Le cheval, qui est fort endommagé, est couvert d’un chanfrein et de tout un harnachement de guerre : les glands très nombreux qui décorent son poitrail paraissent avoir été un ornement depuis longtemps goûté dans le pays, puisqu’on en retrouve déjà dans le harnachement des chevaux assyriens. |
 En prenant
possession de leurs charges, les consuls indiquaient le jour où tous les
citoyens que leur âge appelait à faire partie de l’armée étaient tenus à se
rendre au Capitole. On y faisait le dénombrement et chacun devait répondre à
son nom, sous peine d’un châtiment sévère. Les consuls ont été quelquefois
remplacés dans cette fonction par les tribuns militaires. Mais il ne faut pas
confondre ces magistrats faisant fonction de consuls avec les tribuns de
légions, officiers dont le rang répondait à peu près à celui de nos colonels.
Polybe nous raconte ainsi la manière dont se faisait la répartition des
soldats dans les légions.
En prenant
possession de leurs charges, les consuls indiquaient le jour où tous les
citoyens que leur âge appelait à faire partie de l’armée étaient tenus à se
rendre au Capitole. On y faisait le dénombrement et chacun devait répondre à
son nom, sous peine d’un châtiment sévère. Les consuls ont été quelquefois
remplacés dans cette fonction par les tribuns militaires. Mais il ne faut pas
confondre ces magistrats faisant fonction de consuls avec les tribuns de
légions, officiers dont le rang répondait à peu près à celui de nos colonels.
Polybe nous raconte ainsi la manière dont se faisait la répartition des
soldats dans les légions.  Sous
l’empire, le souverain est de droit général en chef de toutes les armées, et
si d’autres généraux répondent pour lui, c’est seulement en vertu d’une
délégation temporaire et toujours révocable. L’empereur ne porte d’ailleurs
aucun insigne de son pouvoir suprême et il ne se distingue en rien du général
en chef, dont le costume est très nettement établi sur la figure 352. Encore
est-ce là un costume de parade, car celui que le général en chef portait en
campagne était, en général, beaucoup plus simple. La figure 353 représente
l’empereur Trajan avec le vêtement qu’il portait dans sa campagne contre les
Daces. L’empereur, qui reçoit une députation des Sarmates venant faire leur
soumission, est simplement vêtu d’une tunique longue avec un petit manteau.
Sous
l’empire, le souverain est de droit général en chef de toutes les armées, et
si d’autres généraux répondent pour lui, c’est seulement en vertu d’une
délégation temporaire et toujours révocable. L’empereur ne porte d’ailleurs
aucun insigne de son pouvoir suprême et il ne se distingue en rien du général
en chef, dont le costume est très nettement établi sur la figure 352. Encore
est-ce là un costume de parade, car celui que le général en chef portait en
campagne était, en général, beaucoup plus simple. La figure 353 représente
l’empereur Trajan avec le vêtement qu’il portait dans sa campagne contre les
Daces. L’empereur, qui reçoit une députation des Sarmates venant faire leur
soumission, est simplement vêtu d’une tunique longue avec un petit manteau.

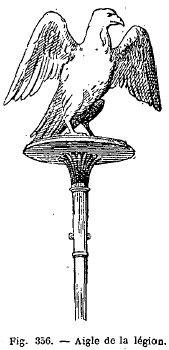 is mille hommes
d’infanterie. On raconte que Romulus, lorsqu’il conduisit sa troupe de
pasteurs et d’aventuriers, leur donna pour signe de ralliement une botte de
foin portée au haut d’une pique. Cet insigne servait pour une compagnie de
cent hommes, commandés par un centurion, qui avait sous ses ordres dix
décurions, faisant les fonctions de sous-officiers : la compagnie ainsi
formée prenait le nom de manipule, à cause de sa botte de foin
is mille hommes
d’infanterie. On raconte que Romulus, lorsqu’il conduisit sa troupe de
pasteurs et d’aventuriers, leur donna pour signe de ralliement une botte de
foin portée au haut d’une pique. Cet insigne servait pour une compagnie de
cent hommes, commandés par un centurion, qui avait sous ses ordres dix
décurions, faisant les fonctions de sous-officiers : la compagnie ainsi
formée prenait le nom de manipule, à cause de sa botte de foin 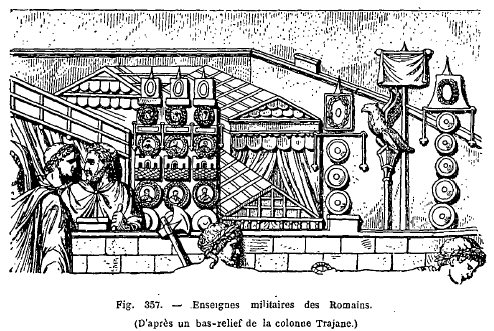
 n forme de
chapiteau : c’est la troisième enseigne en partant du côté droit. Le
porte-enseigne qui tenait l’aigle de la légion s’appelait
n forme de
chapiteau : c’est la troisième enseigne en partant du côté droit. Le
porte-enseigne qui tenait l’aigle de la légion s’appelait  . Les trois étendards que l’on voit à
gauche, très rapprochés l’un de l’autre, sont ceux des
. Les trois étendards que l’on voit à
gauche, très rapprochés l’un de l’autre, sont ceux des 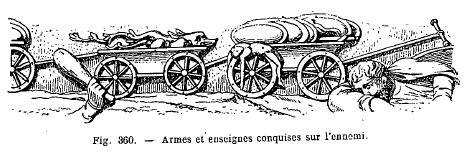
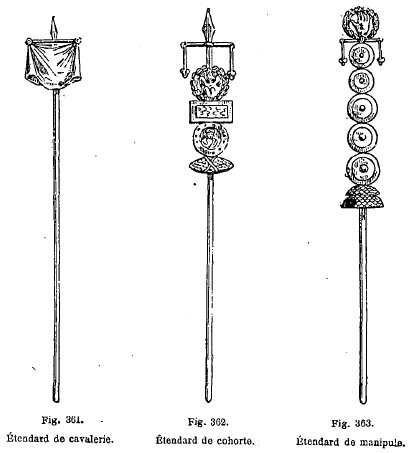


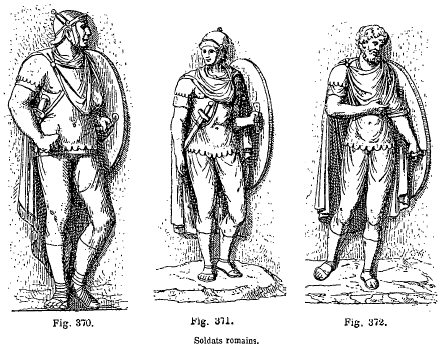
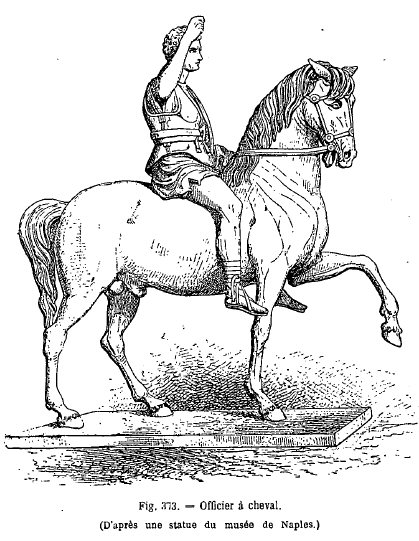

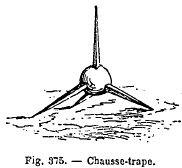 Pour empêcher
les manœuvres de la cavalerie ennemie on employait des chausse-trappes,
boules de métal garnies de pointes, que l’on dissimulait dans l’herbe des
prairies et qui blessaient à l’improviste les pieds des chevaux : la forme de
cet engin explique d’ailleurs son usage
Pour empêcher
les manœuvres de la cavalerie ennemie on employait des chausse-trappes,
boules de métal garnies de pointes, que l’on dissimulait dans l’herbe des
prairies et qui blessaient à l’improviste les pieds des chevaux : la forme de
cet engin explique d’ailleurs son usage 
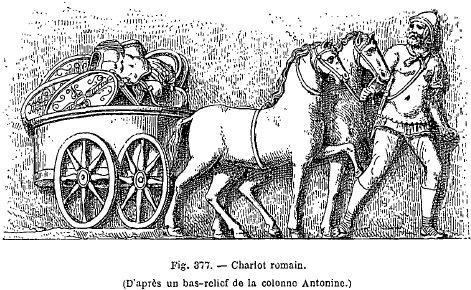
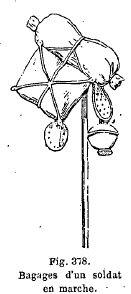 Pour faire
traverser à un corps d’armée une rivière considérable, on y jetait un pont de
bateaux, comme on le voit sur la figure 379, qui est tirée de la colonne
Antonine. On le construisait en attachant sur les deux rives du fleuve, l’un
à côté de l’autre, autant de bateaux qu’il en fallait pour soutenir un chemin
de planches allant d’un bord à l’autre.
Pour faire
traverser à un corps d’armée une rivière considérable, on y jetait un pont de
bateaux, comme on le voit sur la figure 379, qui est tirée de la colonne
Antonine. On le construisait en attachant sur les deux rives du fleuve, l’un
à côté de l’autre, autant de bateaux qu’il en fallait pour soutenir un chemin
de planches allant d’un bord à l’autre.



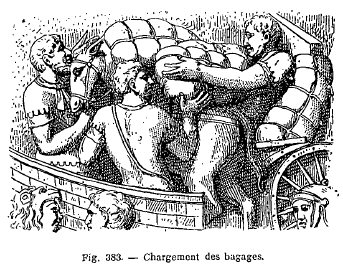
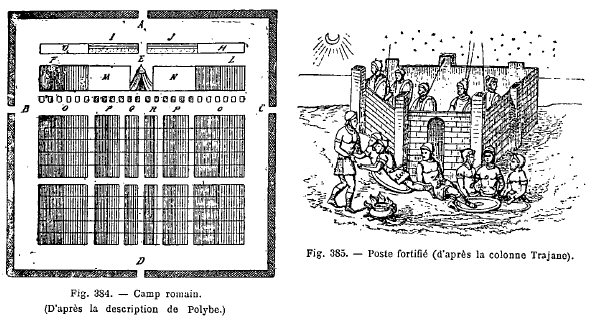
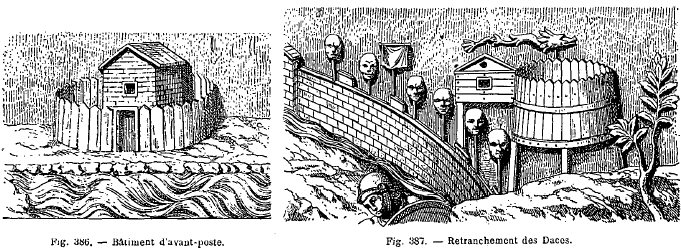
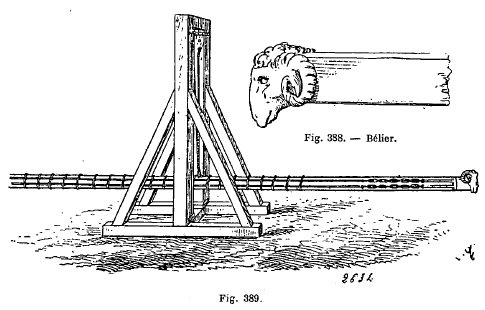
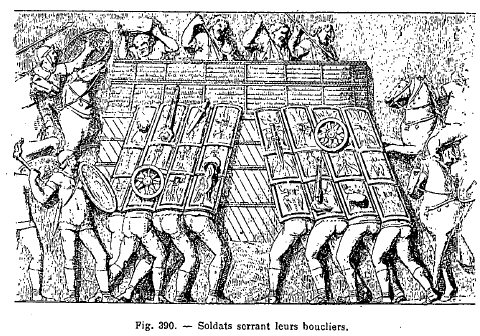
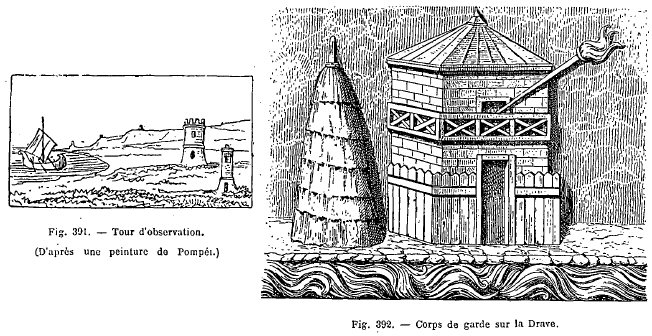
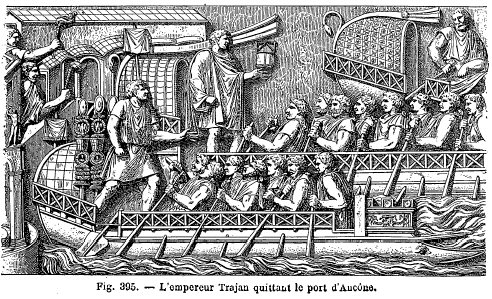
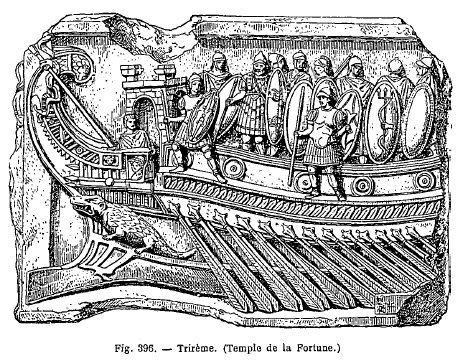
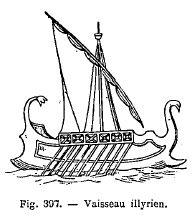 œuvre. Les soldats combattaient avec leurs armes
ordinaires, mais les rameurs étaient généralement nus jusqu’à la ceinture,
pour avoir plus de liberté clans leurs mouvements. En général, les flottes
romaines ne s’écartaient guère des côtes qu’elles étaient chargées de
défendre ou d’attaquer, et c’est toujours à proximité du rivage que les engagements
maritimes avaient lieu.
œuvre. Les soldats combattaient avec leurs armes
ordinaires, mais les rameurs étaient généralement nus jusqu’à la ceinture,
pour avoir plus de liberté clans leurs mouvements. En général, les flottes
romaines ne s’écartaient guère des côtes qu’elles étaient chargées de
défendre ou d’attaquer, et c’est toujours à proximité du rivage que les engagements
maritimes avaient lieu. Plusieurs
espèces de couronnes honorifiques étaient également décernées comme
récompenses au mérite militaire. La
Plusieurs
espèces de couronnes honorifiques étaient également décernées comme
récompenses au mérite militaire. La  Outre les
couronnes, les Romains honoraient le courage guerrier par des récompenses qui
répondaient à peu près à la médaille militaire de l’armée française, ou la
décoration de la Légion d’honneur. Il y en avait de plusieurs sortes : les
soldats et officiers qui avaient fait quelque action d’éclat recevaient une
phalère, ornement en pierre dure ou en métal précieux travaillé avec art et
affectant généralement la forme d’un gros médaillon. On portait les phalères
par-dessus l’armure : elles étaient suspendues sur la poitrine au moyen de
buffleteries qui passaient devant la cuirasse. Plusieurs monuments
représentent des soldats romains pourvus de cette espèce de décoration
militaire
Outre les
couronnes, les Romains honoraient le courage guerrier par des récompenses qui
répondaient à peu près à la médaille militaire de l’armée française, ou la
décoration de la Légion d’honneur. Il y en avait de plusieurs sortes : les
soldats et officiers qui avaient fait quelque action d’éclat recevaient une
phalère, ornement en pierre dure ou en métal précieux travaillé avec art et
affectant généralement la forme d’un gros médaillon. On portait les phalères
par-dessus l’armure : elles étaient suspendues sur la poitrine au moyen de
buffleteries qui passaient devant la cuirasse. Plusieurs monuments
représentent des soldats romains pourvus de cette espèce de décoration
militaire 