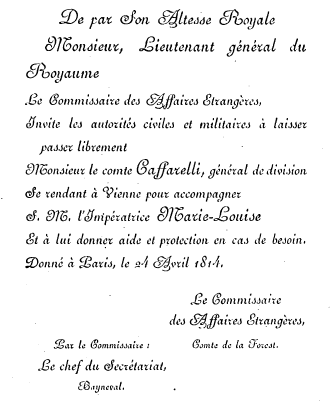L'IMPÉRATRICE MARIE-LOUISE
XII. — LA SÉPARATION.
Hésitations de Marie-Louise. — Influences qui s'exercent sur elle. — Défiances contre les Bonaparte. — Appels désespérés à son père. — Eveil d'une sorte d'ambition. — Velléité d'aller à Fontainebleau. — Arrivée d'un commissaire des Alliés. — Départ de Blois pour Orléans. — Abandon de l'Entourage. — Versatilité du Peuple. — Séjour à Orléans. — Lettres de Napoléon à Méneval. — Premier bruit de son suicide. — Inquiétudes de Marie-Louise. — Elle veut se réfugier près de son père. — Sentiments de Napoléon. — Il ne se croit pas le droit de contraindre sa femme. — Mme de Montebello. — Corvisart. — La Journée du li Avril. — La Journée du 12 Avril. —L'Empereur apprend le départ de Marie-Louise pour Rambouillet. — Tentative de suicide. — Marie-Louise à Rambouillet. — L'Entourage. — Lettre de l'empereur d'Autriche à Napoléon. — Préparatifs de Départ. — Lettres de Napoléon. — Passeports de Marie-Louise. — Son départ. — Ses sentiments pendant le Voyage. — Son Arrivée à Schœnbrunn. — Départ pour Aix en Savoie. — Le comte de Neipperg désigné pour l'accompagner. — Sa Carrière. — Séjour de Marie-Louise à Aix. — Dernières velléités. — Le Retour à Vienne. —La vaine Attente de l'Empereur. — Emissaires. — Lettres. — Le Retour de l'île d'Elbe. — Sept Lettres en un mois à Marie-Louise. — Ses sentiments. — Arrivée à Paris des revenants de Vienne. — Silence de Napoléon. — La Femme et l'Homme. — Les Pensées de Sainte-Hélène. — La Mort de Napoléon et Marie-Louise. — Sentiments bourgeois de l'Empereur. — L'Atavisme corse en face de l'Atavisme allemand. — Tentative de Jugement impartial.Dans cette journée du 7 avril prennent place toutes les incertitudes qui doivent, à la fin, déterminer la destinée de Marie-Louise et, par un enchaînement de circonstances auxquelles son éducation, la faiblesse de son âme, la fragilité de ses sentiments, les exigences de son tempérament ne lui permettront pas de se soustraire, la livreront quelque jour inerte et sans défense aux desseins que sa belle-mère et les ministres de Sa Majesté Apostolique ont formés sur elle. Rejoindra-t-elle ou non l'Empereur ? Jusqu'au 6 avril, Napoléon ne pouvait désirer qu'elle vînt. Fontainebleau était un quartier général que, d'un moment à l'autre, il devait quitter. S'il abdiquait en faveur de son fils, quelle valeur attacherait-on à sa parole dès qu'on le verrait réuni à l'Impératrice ? Si, à quelque moment, pour assurer son trône à ce fils, il ne voyait d'autre moyen que la mort, la mort volontaire, pouvait-il condamner Marie-Louise à en être témoin ? Elle-même, attendant tout de son père, peut-elle se livrer à une démarche aussi imprudente et la prendre sur elle, lorsque son mari ne la lui commande pas et que Joseph lui affirme que les communications sont coupées, qu'il, vient d'essayer et a du retourner ? Galbois vient de le lui répéter, et pourtant elle voudrait aller à Fontainebleau. Les obstacles qui s'opposent à l'accomplissement de ce désir, le conflit des opinions contradictoires de son entourage lui font différer de tenter cette réunion qui est dans sa pensée. Son anxiété est au comble ; les émotions violentes qu'elle a éprouvées, les pleurs qu'elle répand continuellement, ses douloureuses insomnies, lui ont causé un état nerveux et presque convulsif. Elle ne peut se faire une idée des passions qui agitent la France, Les assurances qu'elle a reçues de son père lui reviennent constamment à la mémoire. Elle ne peut se persuader que l'empereur d'Autriche la sacrifiera ainsi que son époux et son fils... Son devoir, son affection, la portent à Fontainebleau ; son intérêt, son indolence, sa santé, la retiennent à Blois : pourtant, il suffit d'un instant pour que sa décision soit prise et porte ses effets. Qu'il se trouve là, entre tant de courtisans, un être reconnaissant et fidèle, que Mme de Luçay — il la faut nommer — ait assez d'influence pour la déterminer à monter dans la voiture préparée pour ce départ et qui attend au pied d'un escalier dérobé, pour Marie-Louise tout est sauvé, mais, pour d'autres tout est perdu. A ce moment même, Mme de Montebello se fait annoncer. Aussitôt, l'Impératrice troublée fait précipitamment entrer sa dame d'Atours dans un cabinet voisin, et, de là, Mme de Luçay peut entendre et n'entend que trop bien avec quel art perfide on parvient à changer la résolution qu'elle a suggérée. Aussi bien, comme les idées peuvent encore varier, la duchesse se charge d'y porter un obstacle décisif. Elle fait avertir de ces incertitudes Schwarzenberg, avec qui elle est, de longue date, en rapports, et lui demande d'y mettre un terme. D'elle-même, Marie-Louise, toujours combattue entre la
pensée de remplir ses devoirs d'épouse et celle d'obtenir pour son fils un
établissement convenable, n'est que
trop disposée à céder à des avis intéressés. Ce qu'elle ne veut à aucun prix,
c'est se livrer aux Bonaparte et se joindre à leur fortune ; or, pour les
Bonaparte, — Joseph et Jérôme, — l'intérêt décisif est de ne pas souffrir
qu'elle s'éloigne, soit pour rejoindre l'Empereur, soit pour retrouver son
père, et de l'entraîner avec eux pour continuer la résistance ou pour se
ménager des conditions plus avantageuses. S'ils la laissent à Blois, elle
prendra l'un des deux partis qu'ils redoutent. Le 8 au matin, Ms se
présentent donc à elle, lui disent qu'il n'y a plus de sûreté dans la ville,
que les troupes alliées en sent tout près, qu'il faut partir au delà de la
Loire et y porter le siège du Gouvernement. Elle refuse nettement. Elle
déclare qu'elle ne veut pas quitter Blois. Jérôme s'emporte, menace presque.
Elle se retire, trouve des gens de sa maison d'honneur qui, saisissant
l'occasion de se séparer hautement des Bonaparte et d'affirmer —ce qui
deviendra leur habituelle justification — qu'ils ne sont entrés dans
l'antichambre de Napoléon que pour y attendre l'archiduchesse, nièce de
Marie-Antoinette, appellent les officiers de l'escorte. Ceux-ci accourent assurer l'Impératrice qu'ils n'obéiront
qu'à elle seule et qu'on ne lui fera pas quitter Blois contre sa volonté.
Cette résistance, si inusitée chez l'Impératrice, a-t-elle pour motif
seulement un défaut de confiance en ses conseillers
ou, dans l'état d'agitation où elle se trouve,
est-elle dominée par la crainte presque physique d'un déplacement qui la
rejetterait dans les hasards d'une vie errante dont elle ne prévoit pas le terme
? En tout cas, partagée entre la volonté de ne pas suivre ses
beaux-frères et la crainte de voir arriver Czernicheff et les trois mille
cosaques dont on Ta menacée, elle ne pense plus à Fontainebleau ; elle dépêche
à l'empereur d'Autriche un nouvel officier — Sainte-Aulaire — pour le prier de lui donner quelque refuge dans ses Etats, ainsi qu'à
quelques serviteurs qui lui sont restés fidèles. Elle entend rester en
communication étroite avec son père. Je vous
enverrai donc chaque jour, lui dit-elle, un courrier
pour vous dire l'endroit où je serai, et je vous prie de me le renvoyer
chaque jour pour me dire l'endroit où vous êtes, afin que je puisse aller
vous retrouver tout de suite dans un cas malheureux. Tout ce que je désire
est de vivre tranquille quelque part dans vos Etats et de pouvoir élever mon
fils. Dieu sait que je lui dirai de ne pas avoir d'ambition ! Pourtant, peut-être à propos de ce fils, plus sûrement par
un retour sur elle-même, celle ambition s'éveille ; séparant pour la première
fois — sous quelles influences, on ne saurait le dire — ses destinées de
celles de Napoléon. Il lui faut, à elle, un établissement : qui soit digne
d'une archiduchesse. Pour moi et pour mon fils,
surtout pour ce dernier, écrit-elle à son père, je suis convaincue que vous ne voulez pas lui donner l'île
d'Elbe pour unique héritage. Je suis persuadée que vous défendrez ses droits
et que vous lui obtiendrez un meilleur sort. Tout ce que je désire est que
vous puissiez le voir ; ce malheureux enfant, qui est innocent de toutes les
fautes de son père, ne mérite pas de partager avec lui une si triste position.
En même temps qu'elle se détache ainsi du vaincu et qu'elle lui reproche toutes ses fautes, elle semble encore décidée à lui
faire visite. Je vais demain matin à Fontainebleau,
dit-elle, je suis encore très malade et je crains
d'être plus malade encore. J'ai de fortes douleurs de poitrine et des
vomissements de sang qui me font craindre que ma santé ne soit toute troublée
et j'ai peur de ne pouvoir entreprendre de longs voyages. Ce qui coupe court au projet, sinon de réunion, au moins de course à Fontainebleau, sincère sans doute, mais demeuré à l'étal de velléité et subordonné à une santé sur laquelle l'on a soin d'entretenir ses inquiétudes, c'est, à deux heures, l'arrivée du comte Schouwalof, aide de camp d'Alexandre, nommé commissaire des puissances alliées. Il est accompagné du baron de Saint-Aignan, écuyer de l'Empereur, beau-frère de Caulaincourt et ami intime de Mme de Montebello. — Lequel des deux amène l'autre ?— Schouwalof annonce qu'il a mission de conduire à Orléans l'Impératrice et son fils, et il prend possession de leurs personnes. C'est le signal du dispersement : ministres, conseillers d'Etat, dames du Palais, chambellans, premier écuyer, chevalier d'honneur, accourent à la mairie pour chercher des passeports qu'ils font viser par le commissaire russe ; et la plupart s'envolent vers Paris. Les gens delà Maison tiennent déjà leurs gratifications. L'Impératrice a distribué cent cinq mille francs aux vingt-trois personnes de son service d'honneur, cinquante mille aux employés et domestiques de sa maison et de celle de son fils, cent soixante mille aux employés de la Maison de l'Empereur, quatre-vingt-trois mille aux treize cents officiers et soldats de la Garde qui ont formé son escorte. Il ne reste auprès d'elle que ceux — combien peu nombreux ! — que leur dévouement retient, ceux qu'oblige encore une sorte de pudeur, enfin ceux qui prétendent jouer un rôle et préparent dès lors, par des correspondances ou des voyages, de fructueux marchés. Dans la dernière classe, on est muet, respectueux et affligé ; dans la première, agité, verbeux, plein d'expédients, d'avis et de conseils ; mais dans la seconde, où l'on ne s'abstient pourtant pas de démarches souterraines, — témoin l'arrivée de Schouwalof, — plu-Jours montrent ouvertement leur fatigue, leur dépit et leur mauvaise volonté : Qu'il me tarde que cela finisse ! dit ouvertement Mme de Montebello. Que je voudrais être tranquille, avec mes enfants, dans ma petite maison de la rue d'Enfer ! Ainsi, c'est là l'amitié si chèrement acquise, c'est là le dévouement solennellement attesté, et cette débandade des courtisans, qu'est-ce encore devant l'effondrement de la nation ? Quoi ! ces acclamations enthousiastes par qui elle fut accueillie il y a quatre ans et qui, hier encore, retentissaient à ses oreilles, ce trône si solidement élevé par la volonté du peuple, qu'ombrageaient de palmes glorieuses les victoires fidèles, qu'environnaient dans un religieux silence les représentants de la France entière, — prêtres, nobles, soldais, le passé de toute une histoire et le présent de toute une épopée, — ce trône où elle répugnait tant à monter et où son père l'a contrainte de s'asseoir, il a suffi d'un revers de la fortune pour qu'il s'écroulât, et celle foule, tout entière exultante, attendrie, délirante de joie, d'amour et d'orgueil, s'empresse à présent, dans ce Paris servile, à porter aux ennemis et à ceux qu'ils ramènent de pareils serments et des protestations semblables ; elle charge de ses malédictions le nom qu'elle adorait tout à l'heure ; elle n'a pitié ni de la faiblesse, ni du malheur, ni de la gloire ; elle est lâche, elle est odieuse, elle est infâme, —- pire à mesure que, dans la mémoire de l'archiduchesse, se lèvent les souvenirs de Vienne et des patriotiques triomphes qu'au lendemain de désastres sans nom, un peuple reconnaissant vouait à son souverain vaincu ! A qui se fierait-elle, quand les personnes même que Napoléon lui a données pour les plus fidèles l'abandonnent ou la trahissent, qu'elles n'attendent qu'une occasion et le partage de quelque argent pour se ruer vers Paris, que sans cesse elles maudissent l'Empereur, l'injurient et le tournent en risée ? Quel refuge, hormis son père ? Quelle direction, sauf celle qu'il daignera donner ? Aussi bien, il n'y a pas à discuter : le comte Schouwalof a décidé que le 9, à dix heures du malin, on partirait de Blois pour Orléans. La roule paraît peu sure : il n'importe. L'Impératrice prend avec elle ses parures et celles qu'on lui forma des diamants de la Couronne ; Méneval est chargé de l'épée sur laquelle est enchâssé le Régent. Avant de monter en voiture, sentant où on le conduit, il brûle les papiers de famille et les pièces secrètes dont il est dépositaire. Selon les usages, il laisse 3.000 francs au préfet pour les pauvres de la ville. Lui, du moins, reste impérial. On part à l'heure dite : les princes et les princesses de la Famille, ne sachant où aller, suivent machinalement, de même quelques personnes de la Maison ; des Grenadiers à cheval font l'escorte. A Beaugency, des cosaques arrêtent les dernières voilures et les pillent, mais Schouwalof intervient, fait rendre ce qui a été pris. A six heures, on arrive à Orléans. L'Impératrice y est reçue avec les honneurs souverains. Elle descend à l'évêché où l'évêque nommé, le baron Raillon, s'empresse de tout mettre à ses ordres. Le 10, qui est le jour de Pâques, après la messe dite par l'évoque, elle reçoit Champagny, revenu de Chanceaux avec une lettre de l'empereur d'Autriche. Rien que des phrases vagues : Je n'ai nullement à me plaindre de mon gendre, a dit l'empereur. Je lui dois, au contraire, une profonde reconnaissance pour le bonheur dont il a fait jouir ma fille. Je voudrais, au prix de tout mon sang, faire leur bonheur à l'un et à l'autre. Tels sont mes sentiments paternels envers eux. Gomme empereur, j'ai d'autres devoirs ; j'ai contracté une alliance avec d'autres souverains, et cette alliance m'impose l'obligation d'accéder à leurs déterminations. Je ne sais pas ce qu'elles seront. J'ai envoyé Metternich en avant pour en prendre connaissance. Quelles qu'elles seront, je dois les adopter et concourir à leur exécution, mais je serai désespéré de tout le mal qui sera fait à mon gendre. C'est de cela que Champagny a du se contenter, et c'est ce qu'il rapporte. Dans la nuit, Méneval a reçu de Napoléon une lettre, en date du 8, qui, de Blois, lui a été renvoyée à Orléans. L'Empereur semblait croire encore à la Régence et faisait dire que, dans cet état de choses, il était nécessaire que l'Impératrice se tint constamment informée du lieu où se trouverait son père, car il fallait tout prévoir, même la mort de l'Empereur, Méneval, très frappé par ces derniers mots, n'a pu se retenir d'en parler à Mme de Montebello, qui, sans doute, en a averti l'Impératrice, et l'on peut croire que, dans l'esprit de celle-ci, passe encore en ce moment, comme on l'a dit, la pensée de rejoindre l'Empereur. Il semble qu'alors elle va trouver Mme de Montesquiou qui l'affermit dans sa résolution, lui parle devoir, honneur, fidélité. Mais Marie-Louise ne doit-elle pas attendre le retour de Bausset et de Sainte-Aulaire qu'elle a envoyés à son père ? D'ailleurs, l'influence de Mme de Montesquiou est fugitive : d'autres s'exercent. Cette mort, ce serait, à la fin, une solution, et quel débarras ! Eh bien, est-ce fini ? Est-il mort ? crie Mme de Montebello à Anatole de Montesquiou qui, arrivant de Fontainebleau, se présente à l'évêché. — Qui, Madame ? — Mais, l'Empereur ! — Non, Madame. Il n'est pas mort. Il se porte bien. Voici même une lettre qu'il m'a chargé de remettre à l'Impératrice. Quelle arme nouvelle pour empêcher qu'on s'attendrisse et qu'on fasse des bêtises ! D'ailleurs en dernière analyse, n'a-t-on pas Schouwalof ? Deux lettres arrivées dans la journée du 10 prouvent, en effet, que l'idée de suicide a été passagère. Dans l'une, l'Empereur envoie les termes de l'armistice ; dans l'autre, il parait résigné, il dit qu'il attend des nouvelles de Paris pour se déterminer sur le voyage, qu'il voudrait se réunir à l'Impératrice du côté de Gien ; il entre dans tous les détails qui la touchent et termine en disant que sa plus grande peine est de penser aux embarras qu'éprouve l'Impératrice et au mal que cela doit faire à sa santé. L'impulsion vers Fontainebleau est donc arrêtée, et il n'est pas douteux que certaines personnes profitent de la réaction qui se produit, mais, à ce moment même, Joseph leur fournit l'arme décisive. Il vient d'écrire à l'Empereur pour lui conseiller de reprendre les armes en proclamant la paix, en abolissant la conscription, les droits réunis, en adoptant enfin une constitution vraiment monarchique : Décision prompte, militaire et politique, a-t-il dit, et tout est peut-être réparable en faveur de votre fils. Ces projets impliquent que, malgré Schouwalof, il compte obliger, de façon ou d'autre, l'Impératrice à le suivre. Le lui a-t-il dit, l'a-t-il laissé entendre à quelqu'un par qui il est trahi ? En tout cas, Marie-Louise l'apprend, et elle écrit à son père : Très cher papa, je-vous envoie cette lettre par un de mes officiers, pour vous demander la permission de voyager vers vous afin de vous voir à l'endroit où vous vous trouvez maintenant. L'Empereur part pour l'île d'Elbe. Je lui ai déclaré que rien ne m'amènera à partir d'ici avant que je ne vous aie vu et que je n'aie su de vous ce que vous me conseillez. Je vous supplie aussi de me donner une réponse. Je suis décidée à faire pour mon fils tout ce que vous trouverez utile que je fasse. Je sais qu'on vous a demandé, en mon nom, le grand-duché de Toscane. Soyez certain que cela a été fait sans que je le sache. Je sais que vous nous aimez trop pour ne pas penser au sort à venir de mon fils et au mien. Tout ce que je désire, c'est la paix, et elle est nécessaire pour ma santé. Je vous prie donc, mon très cher papa, de me recevoir et de me permettre de vous voir. Ma position devient chaque jour plus critique et plus pressante. On veut m'enlever d'ici contre mon gré, sans vous voir, et je m'en rapporte absolument à votre conseil. Je vous entretiendrai de tout cela verbalement. Je vous supplie de m'envoyer, le plus lot possible, une réponse, car je meurs de peur. Napoléon est bien moins éloigné, en ce qui regarde sa
femme, de cette forme de pensée qu'il ne l'est des projets de Joseph. Il n'a
pas de répugnance à ce qu'elle aille, voir son père, et il ne sent pas les
inconvénients de celle visite. D'ailleurs, dans l'état où est sa fortune, il
ne se sent pas le droit d'exiger ce que Marie-Louise n'offrirait pas de bonne
grâce. Si elle accepte les conséquences de l'union indissoluble, il s'en
trouvera très heureux, mais il ne la contraindra pas ; César peut redevenir citoyen, dit-il à
Caulaincourt, mais sa femme peut difficilement se
passer d'être l'épouse de César. Encore s'il avait, pour elle, obtenu
la Toscane, elle aurait encore trouvé à Florence un
reste de la splendeur dont elle était entourée à Paris ; elle n'aurait eu que
le canal de Piombino à traverser pour me rendre visite ; ma prison aurait été
comme enclavée dans ses Etats : à ces conditions, j'aurais pu espérer de la
voir, j'aurais même pu aller la visiter, et, quand on aurait reconnu que
j'avais renoncé au monde, que, nouveau Sancho, je ne songeais plus qu'au
bonheur de mon île, on m'aurait permis ces petits voyages, j'aurais retrouvé
le bonheur dont je n'ai guère joui même au milieu de tout l'éclat de ma
gloire. Mais maintenant, quand il faudra que ma femme vienne de Parme,
traverse plusieurs principautés étrangères pour se transporter près de moi...
Dieu sait !... Et, comme voulant en avoir le
cœur net, il fait écrire à Méneval : L'Empereur
désire que vous lâchiez de pénétrer ses véritables intentions et de savoir si
elle préfère suivre l'Empereur dans toutes les chances de sa mauvaise fortune
ou se retirer, soit dans un Etat qu'on lui donnerait, soit chez son père,
avec son fils. Cette mauvaise santé que Marie-Louise allègue sans
cesse et dont elle se plaint à tout moment, est-elle une réalité ou un
prétexte ? faut-il penser que l'Impératrice est sérieusement atteinte et
qu'elle a besoin de soins particuliers ou que, seulement, elle cherche un
prétexte pour couvrir une séparation à laquelle il ne s'opposerait pas, mais
où il prétend n'être pas pris pour dupe ? Il demande donc, sur le voyage, le
climat de l'île d'Elbe, la manière dont l'Impératrice Je supporterait, une
consultation en forme au médecin en qui il a mis toute sa confiance, à
l'homme qu'il croit dévoué, honnête et reconnaissant, Corvisart. Cette
consultation est rédigée le même jour, sous les yeux de Mme de Montebello.
Elle est aussi pessimiste qu'il est possible, et interdit à l'Empereur, non
seulement d'ordonner, mais de souhaiter même que Marie-Louise l'accompagne,
en ce moment, à l'île d'Elbe ; le médecin met en doute qu'elle y puisse vivre
jamais, non plus que le roi de Rome, — ce qui supprime toute difficulté pour
les gens qui devraient l'y suivre, —
en tout cas, elle ne saurait penser à un séjour, si bref soit-il, avant une
longue saison à Aix. — Aix ? répond
l'Empereur. N'y a-t-il pas en Italie, aux environs
de Florence, aux entours de l'île d'Elbe, quelque station par laquelle l'on
puisse suppléer aux inconvénients et à
l'inconvenance d'Aix, qui sera en France ? — Non,
répond Corvisart, Aix est le salut, l'île d'Elbe est
la mort, et pour la mère comme pour l'enfant. Ainsi a-t-on trouvé le moyen — et dans quelle vue mesquine et honteuse, car on n'en veut pas envisager d'autre — de convaincre Napoléon et vraisemblablement Marie-Louise que, si elle va partager la déportation princière de l'île d'Elbe, autant vaut pour elle monter à l'échafaud. Mais, ce n'est pas tout pour cette journée du II avril, décisive à tous les points de vue : Metternich, arrivé le matin même à Paris, a, comme il l'écrit à son maître, cru pouvoir assigner à l'Impératrice les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla comme étant l'objet le plus convenable à lui assigner, et le traité a été signé, au nom de Napoléon, par les maréchaux porteurs de ses pouvoirs, au nom des puissances par leurs ministres ou leurs plénipotentiaires autorisés. Metternich écrit à l'Impératrice qu'on lui réserve une existence indépendante qui passera à son auguste fils ; que l'arrangement le plus convenable serait qu'elle se rendit momentanément en Autriche avec son enfant, en attendant qu'elle ait le choix entre les lieux où se trouvera l'Empereur Napoléon et son propre établissement ; qu'elle sera tranquille pour le moment et libre pour l'avenir ; enfin, que ce qu'il lui dit sur son voyage en Autriche est entièrement conforme aux intentions paternelles de son auguste père. Porteur de cette lettre de Metternich, Bausset, pour
rentrer à Orléans, passe par Fontainebleau. Il y a,
avec l'Empereur, une conversation de quelques heures qui lui donne,
écrit-il, de puissantes armes pour délier ces nœuds
d'une conjugalité qu'il regarde comme expirée, car le baron, préfet du
Palais, qui, tout à l'heure, en envoyant aux Bourbons l'expression de son
continuel dévouement, fera sonner son titre de marquis, qui, dans ses
mémoires de 1827, se présentera comme un fidèle de la dernière heure, est
alors l'un des plus ardents à combattre,
comme il dit, le retour d'une niaiserie sentimentale. Son arrivée à Orléans, le 12, n'est pas sans influer sur les décisions de l'Impératrice. Sans doute il apporte une lettre où l'Empereur, en annonçant la signature du traité, exprime l'espérance que Marie-Louise le rejoindra à Briare et, de là, continuera sur Nevers, Moulins et le Mont-Cenis jusqu'à Parme, où elle se reposera avec son fils, tandis que lui-même ira tout préparer à l'île d'Elbe pour la recevoir, mais la lettre de Metternich, avec les commentaires dont l'entoure Bausset, est pour détruire l'effet de la lettre de Napoléon. Sans doute, le départ des Bonaparte a retiré de l'esprit de Marie-Louise la crainte d'être entraînée par eux, mais, dans ce désastre à présent achevé par la dispersion des débris de sa maison d'honneur, par le vol de ses bijoux particuliers, par le pillage du Trésor de la Couronne, livré par celui-là même qui en a la garde — sauf six millions sauvés à grand'peine — elle ne voit de refuge assuré que près de son père ; elle veut d'abord lui présenter son fils, lui demander sa protection, recevoir ses avis et sa direction, quitte à retourner ensuite près de l'Empereur. Cette dernière idée, d'ailleurs, s'embrume, se subordonne à quantité d'autres, devient d'une réalisation plus douteuse à proportion qu'elle la remet, qu'elle s'éloigne de l'émotion delà catastrophe, qu'elle écoute ces voix intéressées et hostiles. Elle accueille donc avec joie l'arrivée du prince Paul Esterhazy et du prince Wenzel Lichtenstein, envoyés par Metternich pour lui donner officiellement connaissance de l'arrangement relatif à Parme et l'inviter à se rendre à Rambouillet, où elle trouvera son père. Elle écrit un mot à l'Empereur qui, lu assure-t-on, est prévenu et, pressée par les Autrichiens, elle part le soir même pour Rambouillet. On a pu lui dire qu'on avait le consentement de Napoléon ;
car, si on ne l'a point reçu, on l'a demandé. Metternich en a écrit au duc de
Vicence ; seulement, sa lettre, datée du 11, est parvenue à Fontainebleau le
12 à dix heures du matin, et c'est ce même jour, à huit heures du soir, qu'on
fait partir l'Impératrice, d'Orléans, sans attendre que l'Empereur ait envoyé
ses instructions. Pourtant, on connaît ses intentions : par une lettre du 12,
à quatre heures du matin, il a fait savoir qu'il réprouvait et le choix de
Rambouillet pour le rendez-vous et le voyage qu'y ferait l'Impératrice : Si l'empereur d'Autriche veut réellement la voir,
a-t-il fait écrire, elle pourrait lui dire de venir
la trouver à huit ou dix lieues d'Orléans, sa sauté lui permettant à peine de
faire ce mouvement. Et il a ajouté : L'Empereur
pense toujours que ce qu'il y a de mieux, c'est que l'Impératrice vienne avec
lui à petites journées. Elle pourra rester à Parme ou à Plaisance ou à
quelques eaux minérales d'Italie. L'Empereur croit que rien ne peut être plus
avantageux à la santé de l'Impératrice que de se trouver avec l'Empereur. Cette conviction est si forte en lui que, dans la lettre qu'il fait écrire le 12, à onze heures du matin, aussitôt après avoir reçu la communication de Metternich, — lettre qui arrive après le départ de l'Impératrice — il répète : Ce qui paraît de plus en plus convenable, c'est que l'Impératrice, le roi de Rome et l'Empereur voyagent ensemble. Bien mieux, il fait partir à marche forcée, sur Orléans, un détachement de la Vieille garde, commandé par Cambronne : et si Cambronne a pour mission ostensible de ramasser et rapporter les débris du Trésor échappés à La Bouillerie, il a pour mission réelle de protéger l'Impératrice contre elle-même et de l'escorter jusqu'à Fontainebleau. Malgré toute sa diligence, Cambronne arrive trop tard, le 13. A ce moment, l'Empereur sait à quoi s'en tenir, il le sait
depuis le milieu de la nuit (12 au 13)
; il le sait par le billet que l'Impératrice lui a écrit avant son départ et
par une lettre de Méneval. C'est trop : il a compté qu'à défaut du monde
perdu, de son épée brisée, de sa gloire ternie, il lui resterait sa femme et
son fils ; il s'est bercé de rêves d'une existence familiale dans la douceur
oisive d'une petite cour italienne. S'il a insisté comme il a fait pour que
Marie-Louise eût la Toscane au lieu de Parme, c'a été pour l'approcher de lui
davantage. Il est content qu'elle ait Parme et
Plaisance dans la seule idée que cela assure son indépendance et qu'elle aura
le plus beau pays du monde à habiter si elle vient à s'ennuyer des rochers de
l'île d'Elbe, tandis que l'île d'Elbe est une retraite qui ne peut plus
convenir qu'à l'Empereur, qui ne veut plus rien gouverner. Tout, de
ses lettres à Méneval — les seuls documents réellement émanés de lui qu'on
ait du 8 au 12 — démontre qu'entre ces deux dates, il a accepté les termes et
l'esprit du traité dont Caulaincourt est le négociateur. Depuis le 6, il ne
garde aucune illusion sur l'Empire ; le 8, l'idée de suicide a traversé son
esprit ; mais, à partir du 9, il pense au voyage et en règle les détails ; il
s'établit dans son île et en veut des notions précises ; son imagination s'y
attache et même s'y plaît. Les termes du traité du Il sont trop nets, trop
précis, trop pénétrés de sa pensée pour qu'il ne les ait pas pesés, débattus,
réglés lui-même. Un plénipotentiaire bien intentionné aurait pu soutenir, à
lui seul, le paragraphe 1 de l'article II, sur la conservation des titres et
qualités de l'Empereur et l'Impératrice ; Metternich aurait pu stipuler en
faveur de Marie-Louise la donation de Parme, Plaisance et Guastalla et même
l'hérédité de ces duchés à son fils ; Caulaincourt ou Metternich aurait pu,
par le paragraphe 2 de l'article III, penser à attribuer à l'Impératrice un
douaire annuel d'un million sur le revenu des deux millions, en rentes sur le
Grand-Livre de France, donnés en toute propriété à l'Empereur ; mais le
partage inégal entre les membres de la Famille d'un revenu net de 2.500.000
francs, mais les attributions diverses à Joséphine et à Eugène ; mais la
réserve de deux millions destinés à des gratifications en faveur des personnes qui seront portées sur l'état que
signera l'empereur Napoléon, cela ne vient ni d'Alexandre, ni de
Caulaincourt, ni de Metternich, cela est de lui, porte le cachet de son
esprit, la trace ineffaçable de sa plume. On a dit que le 12, il s'était
refusé à signer la ratification, et l'instrument officiel porte la date du
12. Pourquoi eût-il refusé de signer puisque son sacrifice était fait ?
Comment — bien plus ! —eût-il enlevé à sa femme, à son fils, à sa mère, à tous
les siens, la seule garantie d'avenir qu'ils pussent trouver, à ses
serviteurs la seule récompense qu'il pût leur laisser ? Mais lorsque, après cette suite de désastres, dans la solitude de ce palais déserté par les maréchaux, les ministres, les laquais même, tombe la nouvelle que l'Impératrice aussi l'abandonne, lorsqu'il voit trait pour trait se réaliser ce qu'il annonçait à Joseph le 8 février : L'Autriche emmenant à Vienne l'Impératrice avec un bel apanage et sous prétexte de la voir heureuse, la mort, dont l'idée le hante depuis un an, qu'il a tant cherchée sur les champs de bataille, à qui vainement il s'est tant de fois offert, se présente à lui comme le refuge. Il ne voulait pas se tuer lui-même ; il en avait encore rejeté la tentation il y a quatre jours ; mais à présent, c'est trop. Il ne veut plus souffrir. Il tend la main vers le poison que, depuis 1808, il tient dans le secret de son nécessaire, qu'il porte dans un sachet noir à même sa peau. Il se lève, il le prépare. La formule est infaillible, lui a-t-on dit : c'est celle que Cabanis a donnée à Condorcet pour le soustraire au bourreau. Il boit et il s'étonne de vivre. Il souffre, il appelle ; on le sauve. Allons ! la mort ne veut pas de lui ! Désormais, à quoi bon ? Il attend sa destinée ; il attend avec une sorte de patience lassée qui lient au double brisement de l'âme et du corps que les commissaires alliés viennent prendre possession de lui pour le mener à l'île d'Elbe. Cependant, pressée par les Autrichiens, qui lui ont fait
entendre que son père est pour elle à Rambouillet, harcelée par les gens de
sa cour, dont quelques-uns, tel Bausset, se vantent d'avoir
contribué à la faire partir sans attendre les ordres ou le consentement de
Fontainebleau, Marie-Louise a quitté Orléans le 12, à huit heures du
soir. A Angerville, elle a rencontré les troupes russes, congédié l'escorte
de Grenadiers à cheval qui l'accompagne depuis Orléans ; Schouwalof a
réquisitionné vingt-cinq cosaques, et c'est ainsi que l'Impératrice est
arrivée à Rambouillet le 13, à midi. Tout de suite, elle a écrit à son père
pour lui exprimer son impatience de le voir — car on lui cache encore que
l'empereur François n'arrivera que le 14 à Paris. Malgré tout, elle n'a pas
encore pris sa résolution Certains sentiments sont touchés, l'orgueil est
blessé, la foi est ébranlée, l'infaillibilité du mari a disparu, mais la conjugalité subsiste. Dans celle lettre que,
morte de fatigue, elle écrit à son père avant de se mettre au lit, elle dit :
Cette cause seule (le désir de le voir après une aussi longue séparation) a pu me déterminer à faire ce voyage et m'empêcher
d'aller de suite trouver l'Empereur à Fontainebleau. Trois jours elle attend, sous l'œil des Russes qui gardent toutes les grilles, et ce sont trois jours singulièrement pénibles. Dans ce tout petit groupe qui la suit encore, il y a des partis, des rivalités d'influence, surtout des ambitions et des volontés qui diffèrent. Mme de Montebello, Mme Brignole, Bausset, Saint-Aignan et Corvisart comptent que l'entrevue rendra pour toujours à sa famille l'Impératrice Marie-Louise et mettra une éternelle barrière entre l'île d'Elbe et les principautés de Parme et de Plaisance. Ce n'est pourtant pas que tous obéissent aux mêmes mobiles : Mme de Montebello qui, dès Blois, a formellement déclaré qu'elle n'irait jamais à l'île d'Elbe, n'aspire qu'à secouer la servitude, à rentrer chez elle et à se rendre libre. Chaque étape du retour l'a si fort réjouie que, lorsque le départ pour Rambouillet a été décidé, on l'a entendue rire à gorge déployée avec sa femme de chambre dans son appartement. Saint-Aignan et Corvisart suivent ses directions et Corvisart les rédige en ordonnances. Le marquis de Bausset qui vient d'envoyer aux Bourbons son adhésion enthousiaste, aspire à une place dans la Maison royale, une place de maréchal de Cour, car ce ridicule nom de préfet du Palais ne saurait subsister, mais, à défaut, il se contenterait avec celle de grand maître de la cour de Parme. Quant à Mme Brignole, la fidèle amie du prince de Bénévent, la mère de la duchesse Dalberg, liée ainsi aux deux hommes les plus importants du Gouvernement provisoire, elle est, près de Marie-Louise, l'agent sur qui ils comptent et, se retrouvant dans cette atmosphère d'intrigues où elle se meut avec la dextérité génoise, elle mène d'abord celle-ci, en noue d'autres en Sardaigne, à Gênes, à Parme même, par son fils, par d'anciens amants, par Marescalchi, beau-père de son autre fille, tout à l'heure envoyé à Parme avec des pleins pouvoirs autrichiens ; elle embrouille tous ces fils que sont incapables de démêler de braves gens tels que Caffarelli et Méneval, et que tenterait vainement de rompre Mme de Montesquiou. C'est d'elle et de Talleyrand l'idée géniale de faire venir à Rambouillet Constant et Roustam pour ébranler en Marie-Louise la conjugalité subsistante par des histoires de femmes, de maîtresses qu'a eues l'Empereur, tout ce que peut dire un domestique d'intimité qui a du babil et qui peut donner à ce qu'il débite un air d'intimité, surtout lorsqu'il raconte des détails d'intérieur. Les communications avec Fontainebleau continuent très fréquentes, plus que quotidiennes. On voit constamment sur les routes Caulaincourt, Laplace, Montesquiou, Bausset malgré ses nouveaux serments, Bâillon, Marchand, d'autres encore. Aux assurances d'affection se mêlent des questions d'argent qui pourraient être irritantes, car, dans ce désastre, l'argent aussi joue son rôle. A Orléans, lors de la remise, au moins prématurée, du Trésor particulier au baron de la Bouillerie et à M. Dudon, l'Impératrice a fait mettre de côté six millions pour ses besoins et ceux de sa maison. Elle en a distrait 500.000 francs pour gratifier ses gens et sa garde. Le trésorier Peyrusse, accouru trop lard de Fontainebleau, n'a pu sauver le Trésor, mais il a du moins obtenu que l'Impératrice remit pour l'Empereur 2.580.000 francs : il est envoyé à Rambouillet pour prendre le reste. Il ne peut obtenir que 911.000 francs. L'Impératrice fait dire par Méneval que, vu la pénurie du trésor de l'empereur d'Autriche, elle est obligée de garder deux millions pour ses besoins, mais elle charge liés expressément Peyrusse de déclarer à l'Empereur que, dès son retour à Vienne, elle fera rendre les deux millions. Napoléon n'en vit jamais rien, et resta uniquement avec ce qu'il possédait à son départ : 3.9.79.915 francs 1G centimes. Il n'y fil jamais une allusion ; peut-être Marie-Louise y fut-elle moins insensible. A la fin, le 10, dans l'après-midi, l'empereur François arrive, accompagné de Metternich. Marie-Louise, entourée de son apparence de cour, le reçoit au perron du château, prend son fils, le lui jette presque dans les bras, puis, tète à tête, s'enferme avec lui. Il se justifie alors : il n'est pour rien dans la chute de son gendre ; tout s'est passé à Paris sans son concours ; la fatalité l'a retenu à Chanceaux sans qu'il pût communiquer avec Schwarzenberg ; certes, l'Impératrice ira rejoindre son mari, elle n'y saurait manquer, mais d'abord il faut qu'elle vienne se reposer quelque temps dans sa famille, retrouver, dans cette bonne Autriche, les souvenirs de son heureuse jeunesse. Il y faut le consentement de Napoléon ? — N'est-ce que cela, on lui écrira. Et, de Rambouillet, ce même jour, il écrit : Monsieur mon frère et cher beau-fils, la tendre sollicitude que je porte à l'Impératrice, ma fille, m'a engagé à lui donner un rendez-vous ici. J'y suis arrivé il y a peu d'heures et je ne suis que trop convaincu que sa santé a prodigieusement souffert depuis que je ne l'avais vue. Je me suis décidé à lui proposer de se rendre pour quelques mois dans le sein de sa famille. Elle a trop grand besoin de calme et de repos, et Votre Majesté lui a donné trop de preuves de véritable attachement pour que je ne sois pas convaincu qu'elle partagera mes vœux à cet égard et qu'elle approuvera ma détermination. Rendue à la santé, ma fille ira prendre possession de son pays, ce qui la rapprochera tout naturellement du séjour de Votre Majesté. Il serait superflu, sans doute, que je donnasse à Voire Majesté l'assurance que son fils fera partie de ma famille et que, pendant mon séjour dans mes Etals, il partagera les soins que lui voue sa mère. Recevez, Monsieur mon frère, l'assurance de ma considération très distinguée, et il signe de Votre Majesté impériale, le bon frère et beau-père FRANÇOIS. C'est le même homme qui, quatre jours auparavant, de
Troyes, le 12 avril, a écrit à Metternich au sujet du traité signé la veille
: L'important est d'éloigner Napoléon de la France,
et plût à Dieu qu'on l'envoyât bien loin ! Aussi avez-vous eu raison de ne
pas différer la signature du traité jusqu'à mon arrivée à Paris, car ce n'est
que par ce moyen qu'on peut mettre fin à la guerre. Je n'approuve pas le
choix de l'île d'Elbe comme résidence de Napoléon : on la prend à la Toscane,
on dispose en faveur d'étrangers d'objets qui conviennent à ma famille. C'est
un fait qu'on ne peut admettre pour l'avenir. D'ailleurs, Napoléon reste trop
près de la France et de l'Europe. Voilà le fond de la pensée du bon frère et beau-père. Dès ce jour 16, le voyage est décidé, l'itinéraire tracé, car, le 17, lorsque l'empereur François a quitté Rambouillet, Marie-Louise lui écrit pour le prier de la laisser aller plutôt par Salzbourg que par n'importe où... Cependant, si vous ne voulez pas, ajoute-t-elle, j'irai par l'autre chemin. Toutefois, ce voyage ne peut s'improviser comme d'Orléans à Rambouillet, et Trauttmansdorff vient pour l'organiser. L'Impératrice est indisposée ; le jeune prince est enrhumé ; il y a des dispositions à prendre à Paris, l'emballage du mobilier personnel de l'Impératrice, de la toilette de la Ville, du berceau du roi de Rome, des robes, des effets, des joujoux, de toute la splendeur impériale qui se trouve tenir en cent vingt-neuf caisses. Il y a des adieux à recevoir — bien peu ! car, des personnes de la Maison, on ne voit guère que Mme de Luçay, la duchesse Charles de Plaisance, Mme Mollien, peut-être Mme Alfred de Noailles ; en hommes le grand écuyer, Flahaut et Turenne. Il ne semble pas qu'on en oublie. Nulle chance qu'on puisse échapper ; deux bataillons d'infanterie et deux escadrons de cuirassiers autrichiens ont relevé la garde russe et occupent toutes les issues. Marie-Louise est nerveuse, agitée. Elle se retire fréquemment dans sa chambre et là, les coudes appuyés
sur les genoux et la tête dans ses mains, elle s'abandonne à toute l'amertume
de ses pensées et verse d'abondantes larmes. Par surcroit, elle est
obligée de subir les hommages des souverains qui l'ont détrônée : le 19, la
visite de l'empereur de Russie, et il est facile de
voir à son visage décomposé, à ses larmes récemment essuyées, quelle
contrainte elle subit. Pour éviter la visite du roi de Prusse, elle
écrit à son père : Je crains qu'il ne se conduise
pas aussi noblement que l'empereur Alexandre, et vous pouvez vous représenter
combien il serait désagréable de lui entendre tenir certains propos. Elle
ne peut pourtant l'éviter et, quoiqu'il ne reste que quelques instants, ces politesses, comme dit une de ces dames, étouffent celle à qui on les adresse. Tout semble aller
mal pour son cœur. Pourtant, de Napoléon, elle ne reçoit aucune contradiction
au sujet de son voyage. Plein de confiance dans le dévouement, la compétence
et l'intégrité de Corvisart, rassuré — faut-il l'avouer ? — par la parole
impériale et paternelle de l'empereur d'Autriche, l'Empereur n'élève aucun
doute sur la véracité de la consultation rédigée le 11 à Orléans, sur la
nécessité où est Marie-Louise de prendre les eaux d'Aix de préférence à
toutes les eaux d'Italie, sur l'indépendance qui lui sera laissée, sur le
prompt voyage qu'elle fera pour le rejoindre. Ma
bonne Louise, écrit-il, j'ai reçu ta lettre ;
j'y vois toutes tes peines, ce qui accroît les miennes. Je vois avec plaisir
que Corvisart t'encourage. Je lui en sais un gré infini. Il justifie par
celle noble conduite tout ce que j'attendais de lui, dis-le-lui de ma part.
Qu'il m'envoie un petit bulletin fréquemment de ton état. Tache d'aller de
suite aux eaux d'Aix que l'on m'a dit que Corvisart l'avait conseillées. Porte-toi
bien. Conserve ta santé pour [ton époux] et ton fils qui a besoin de tes soins. Je vais partir
pour l'île d'Elbe d'où je t'écrirai. Je ferai tout aussi pour le recevoir...
Adieu, ma bonne Louise-Marie. Le 18, il
insiste pour que l'Impératrice aille tout de suite aux eaux d'Aix puisqu'on
est dans la saison. Il s'étonne que l'empereur
d'Autriche n'ait pas senti l'inconvenance de faire venir l'empereur de Russie
et le roi de Prusse à Rambouillet, surtout l'Impératrice étant malade,
et cette maladie qu'on emploie si à propos contre lui, il s'étonne qu'on ne
l'invoque guère contre d'autres, mais il s'arrête à cette limite, fermement
convaincu des dangers que court Marie-Louise. Le 19, en effet, en même temps
qu'il envoie une notice sur l'île d'Elbe, il demande instamment qu'on lui
adresse des nouvelles de l'Impératrice, d'abord à Briare où il couchera, puis
à Saint-Tropez ; le 20, au moment de quitter Fontainebleau, il confie une
dernière lettre à Bausset qui, sous prétexte de lui porter un message de
l'Impératrice, est venu l'espionner et qui, pour mieux jouer son rôle, lui a
demandé de l'accompagner. Dans cette lettre que Bausset intercepte, car elle
révèle sa double face, l'Empereur dit : J'espère que
ta santé se soutiendra et que tu pourras venir me rejoindre... Tu peux toujours compter sur le courage, le calme et
l'amitié de ton époux. De Fréjus, le 28 avril, il écrit à Corvisart
pour le remercier des nouvelles qu'il lui a données de l'Impératrice : J'ai vu avec plaisir, lui dit-il, la bonne conduite que vous avez tenue dans ces derniers
temps où tant d'autres se sont mal conduits. Je vous en sais gré et cela me
confirme dans l'opinion que j'avais conçue de votre caractère. Voilà les sentiments qu'il emporte à l'île d'Elbe : la
conviction que tout à l'heure, dès que sa santé sera rétablie, l'Impératrice
le rejoindra et lui amènera son fils, la certitude que cette santé, ainsi que
Corvisart le lui a affirmé sur l'honneur, oppose le seul obstacle à la
réunion et que, grâce au même Corvisart, cet obstacle va être levé. Il est
d'autant mieux fondé à prendre une telle opinion qu'il a laissé Marie-Louise
plus libre de sa décision. A Caulaincourt qu'il lui a envoyé, il a recommandé itérativement de ne pas la presser de le
rejoindre, de laisser à cet égard, les résolutions naître de son cœur, car,
a-t-il dit plusieurs fois, je connais les femmes et surtout la mienne ! Au
lieu de la cour de France telle que je l'avais faite, lui offrir une prison,
c'est une bien grande épreuve ! Si elle m'apportait un visage triste ou
ennuyé, j'en serais désolé. J'aime mieux la solitude que le spectacle de la
tristesse ou de l'ennui : si son inspiration la porte vers moi, je la
recevrai à bras ouverts ; sinon, qu'elle reste à Parme ou à Florence, là où
elle régnera enfin. Je ne lui demanderai que mon fils. A cela,
Marie-Louise a répondu en chargeant le duc de
Vicence d'assurer Napoléon de son affection, de sa constance, de son désir de
le rejoindre le plus tôt possible et de sa résolution de lui amener son fils
dont elle promet de prendre le plus grand soin. A Rambouillet, le temps a passé plutôt mal que bien. La duchesse qui a dû, sur les instances de l'Impératrice, se résigner à faire le voyage de Vienne, est venue à Paris pour ses préparatifs. Mme de Luçay l'a suppléée, mais il n'est plus temps de rien tenter, car le 20, Napoléon a quitté Fontainebleau. Le 22 arrivent, aussitôt après le roi de Prusse, les Autrichiens chargés de conduire Marie-Louise jusqu'à Vienne. Le 23 on part, mais on ne va que jusqu'à Grosbois ; l'empereur d'Autriche vient y prendre congé de l'Impératrice. Grosbois ! quel choix on fait là et quels souvenirs on évoque ! Bien des gens de la Maison en profitent. Sous prétexte d'offrir leurs hommages à l'Impératrice déchue, ils obtiennent d'être présentés à l'empereur régnant. On séjourne le 24, car on n'a pas les passeports que Caffarelli est allé chercher à Paris et les voici :
Le lendemain, 25, l'Impératrice prend le chemin de Vienne : sa suite se compose uniquement de la duchesse et de Mme Brignole, de Saint-Aignan, Bausset et Corvisart, puis de Méneval et de Caffarelli, deux femmes rouges, Mmes Hurault et Rabusson, et deux femmes noires ; d'autres suivront. Les domestiques sont en nombre et la livrée. En cinq étapes : Provins, Troyes, Châtillon, Dijon, on arrive à Bâle. Les troupes autrichiennes sous les armes rendent les honneurs, et, par excès de zèle, les commandants autrichiens voudraient qu'on illuminât les villes. Le 30 avril, l'Impératrice Marie-Louise passe la frontière de ce qui fut son empire. De Provins, le 25, elle écrit à Napoléon une lettre qu'il recevra seulement un mois après à l'île d'Elbe ; de Bàle, le 2 mai, elle transmet à son père une note que l'Empereur a expédiée de Fréjus pour réclamer le Trésor particulier, l'argenterie et la bibliothèque pillés à Orléans. Elle reste dans les sentiments où elle était au départ de Blois : triste, agitée, toute au remords de n'avoir pas eu l'énergie de remplir son devoir et de rejoindre l'Empereur. Durant le voyage — par Schaffouse, Zurich, Constance, Waldsee — sa tristesse redouble ; ses nuits sont troublées par de pénibles insomnies, son visage est souvent baigné de pleurs... Elle confesse, les larmes aux yeux, à Méneval, qu'elle a manqué de résolution et qu'aucune raison n'aurait dû retarder son départ de Blois pour Fontainebleau. Jusqu'à la frontière autrichienne, elle reçoit des honneurs et des hommages, mais, en Tyrol, c'est une sorte de triomphe, un vrai délire, sa voilure dételée à l'entrée de chaque ville et traînée par la foule, la continuelle acclamation des peuples à l'otage revenue. Elle ne s'en émeut ni ne s'en réjouit, et sa pensée reste fidèle. A quatre lieues de Vienne, à Molk, elle trouve Maria-Ludovica : Dieu protège notre chère Louise. dit cette bonne amie, qui s'est si réjouie du retour des rois légitimes. A Schœnbrunn, ses sœurs, ses frères, ses oncles l'accueillent comme une ressuscitée., comme la belle princesse échappée de la caverne de l'ogre. Mais l'ogre ne lui semble pas si déplaisant et elle regrette bien des choses : les splendeurs des Tuileries, les marchands de Paris, le trône écroulé, la France, même le mari. Pendant les six semaines qu'elle passe à Schœnbrunn, très isolée des Autrichiens et dédaignant les tendresses dont sa famille parait la combler, elle vit presque exclusivement dans sa petite cour française, avec laquelle on lui laisse pleine liberté d'agir et de se mouvoir ; elle voit à plusieurs reprises le comte de Lobau qui a été retenu prisonnier au mépris de la capitulation de Dresde ; elle reçoit fréquemment des lettres de l'Empereur et elle y répond exactement. Malgré sa belle-mère, qui essaie de lui démontrer comme elle se trouverait bien d'un séjour dans un château de Bohême et d'une cure à Carlsbad, elle tient obstinément à Aix, d'où elle viendra à Parme et à l'ile d'Elbe où l'Empereur l'attend au mois d'août. N'a-t-il pas à Vienne trouvé une alliée inattendue en la grand'mère de sa femme, Marie-Caroline de Naples, qui prêche à Marie-Louise que, si l'on s'oppose à son départ, il faut qu'elle attache les rideaux de son lit à sa fenêtre et qu'elle s'enfuie déguisée, qu'elle doit rejoindre son mari ; car, lorsqu'on est mariée, dit-elle, c'est pour la vie. Le 15 juin, lorsque l'empereur François revient en vainqueur, Marie-Louise obtient qu'il lui renouvelle l'autorisation d'aller à Aix. Le 28, elle écrit à Mme de Luçay : Je pars demain pour les eaux où je compte être dans les premiers jours de juillet, et si, retardée par une indisposition de Mme Brignole, elle laisse, le 30, partir la duchesse, Saint-Aignan et Corvisart, c'est pour les rejoindre presque tout de suite. Elle part, en effet, le 6 juillet. Elle voyage incognito sous le nom de la duchesse de Colorno, mais avec ses voitures aux armes françaises et ses gens à livrée napoléonienne. Sous prétexte que son fils peut l'embarrasser, on l'a gardé à Vienne. C'est une attention qu'on a, et c'est un otage qu'on tient. L'empereur d'Autriche a lui-même désigné pour l'accompagner et lui servir de mentor le vieux prince Nicolas Esterhazy, vraiment digne de cette confiance. Au dernier moment, cette nomination est rapportée. La chancellerie autrichienne — avec une arrière-pensée qui ne peut être soufflée que par une femme — substitue au prince Esterhazy le général comte de Neipperg qui commande une division à Pavie et qui reçoit l'ordre de se rendre à Aix. C'est cet Adam-Albert comte de Neipperg qui, depuis 1797, semble, dans les obscures régions où il se meut, avoir proposé pour but à sa vie l'abaissement de Bonaparte et entretient avec lui une sorte de rivalité étrange et secrète. Elevé à Paris, où sa mère, née Hatzfeld-Wildenberg-Werther, est morte en 1783, officier, tout jeune, dans les troupes autrichiennes en Belgique, il a, dans une rencontre, été fait prisonnier par les Français, qui lui ont, d'un coup de sabre, crevé l'œil droit sur lequel depuis lors il porte un bandeau noir. Ce furent ses débuts. En 1797, il est en Tyrol, chef d'état-major de Loudon, et, sans l'armistice consenti par l'archiduc Charles, il eût, dit-il, forcé Bonaparte et son armée à capituler. En juin 1800, il est à Alexandrie avec Mélas auquel il prétend inspirer de combattre jusqu'au bout. Fin juillet, il est avec Saint-Julien à Paris et, peut-être seul chargé du secret de sa cour, mène l'artificieuse négociation qui permet à l'Autriche d'attendre les subsides anglais pour reprendre les hostilités. Après une apparente disgrâce, il est décoré, en 1802, de la croix de Marie-Thérèse ; trois ans plus tard, il prend la part la plus active à la campagne ; en 1807 et 1808, commandant le cordon autrichien en Galicie, il est en lutte perpétuelle avec Davout qui le qualifie : un des intrigants les plus effrontés que l'on puisse rencontrer : il est dès lors si bien signalé par sa haine contre l'Empire que Napoléon sait son nom et écrit de lui : M. de Neipperg est publiquement connu pour avoir été l'ennemi des Français ; c'est lui qui a fait déserter un petit chirurgien neveu de Percy ; en 1810, attiré vers Paris, semble-t-il, par quelque dessein romanesque, il se fait attacher à l'ambassade extraordinaire de Schwarzenberg.et s'introduit aux Tuileries, à telle enseigne que, le 7 juin, il est officiellement présenté à Leurs Majestés, et que, le 26 juillet, il est décoré de l'aigle d'or de la Légion. Au mois de novembre de la même année, accrédité comme ministre d'Autriche près du roi de Suède, il s'emploie à la tâche, d'ailleurs facile, d'acquérir aux coalitions futures le concours de Bernadotte ; en avril 1812, peut-être est-ce lui qui vient chercher Marie-Louise à Dresde et à Prague et se fait attacher à sa personne : en 1813, il est ministre à Naples et c'est lui qui, le 11 janvier 1814, fait signer à Mural le traité de trahison : le 16 avril, c'est lui qui, aux avant-postes de l'armée franco-italienne, vient avec le comte de Warlenbeig, trouver Eugène pour l'inviter à abandonner une cause désespérée. Partout où il y a un ennemi à susciter à Napoléon, on le trouve ou on le soupçonne : car il échappe, ne se vante pas et agit. Dans la sphère où il évolue, nul ne contribue davantage à la chute ; nul ne semble en éprouver une telle joie, comme la revanche d'une haine privée. Et, en même temps, c'est un personnage de roman qui enlève des femmes partout où il pisse et court à travers l'Europe les aventures galantes ; avec ses quarante-deux ans, son œil crevé et son bandeau noir, l'homme irrésistible, une façon de Don Juan à qui la pudique Autriche pardonne toutes ses fredaines, dont elle légitime les cinq enfants, dont elle accueille presque la femme, — celle-là, Thérèse Pola, qu'à Mantoue, en 1801, il a enlevée à son mari le sieur Remondini, de Brescia, et qu'il n'a épousée qu'en 1813. Tel est l'homme que la Chancellerie désigne à l'Archiduchesse-Impératrice, fille aînée de Sa Sacrée Majesté Impériale, pour guide, pour chevalier, pour compagnon. Avant six mois, dit Neipperg à sa maîtresse en quittant Milan, je serai son amant et bientôt son mari. Il ne fallut pas six mois... Marie-Louise a pris son voyage comme à dessein par les résidences d'exil des Bonaparte : à Munich elle a soupe avec Eugène et la vice-reine ; à Baden elle a rencontré Louis ; à Payerne, elle a vu Jérôme ; à Allaman, elle a séjourné chez Joseph. Le 10 juillet, elle arrive à Genève, accompagnée seulement de Mme Brignole, de Méneval, de Mlle Rabusson, femme rouge promue lectrice, et du fiancé de celle-ci, le docteur Héreau. De Genève, pendant six jours, elle fait à Chamonix et aux glaciers de Savoie, une excursion qui l'enchante et. le 17, passant par Carrouge où Neipperg à cheval vient la saluer et prendre possession de ses fonctions, elle fait son entrée à Aix où elle retrouve, avec le reste de sa maison, Corvisart, Isabey et Mme de Montebello. C'est avec eux qu'elle passe sa vie, car, au premier aspect, Neipperg lui a fort déplu. Elle est partagée entre le désir d'aller à Parme où elle souhaite infiniment régner et être libre, et la velléité, déjà plus confuse, de rejoindre l'Empereur à l'île d'Elbe ; si elle en forme encore le projet, elle le subordonne aux ordres qu'elle recevra de son père et à l'établissement qu'on lui a promis à Parme et qui forme à présent l'objet de toutes ses ambitions. Par malheur pour ses bonnes résolutions, Méneval s'en .est allé à Paris, et la vie qu'elle mène à Aix n'est de nature ni à les suggérer, ni à les affermir. Quoique son habitation, celle qu'occupait Hortense les années précédentes, soit en dehors de la ville, dans cet Aix qui est resté français, où elle se trouve dans les pays de la domination du roi de France, elle prend sa part de tous les divertissements publics et, mêlée au monde cosmopolite d'une ville d'eaux, elle se conduit, non pas à la façon d'une impératrice — et de l'Impératrice des Français découronnée depuis deux mois, exilée à la fois de son mari et de son fils, — mais à la façon, d'une jeune élégante qui s'émancipe et s'étourdit. Au milieu de ce désastre de l'Empereur, de l'Empire et de la France, elle s'amuse. Dans ses voitures aux armoiries d'empire, aux laquais à livrée impériale, elle va, en compagnie de Mme de Montebello qui ne la quitte point, aux bals qu'on donne par souscription ; elle organise des excursions, elle reçoit et offre des fêtes champêtres. A la fin, elle fait tant de bruit que, à Paris, le duc de Berry se fâche et que, le 9 août, Talleyrand écrit à Metternich que la saison des eaux ayant été bien complète pour Mme l'archiduchesse, il conviendrait que son séjour ne se prolongeât pas. On a pensé de même à Vienne, et, vers le 15, elle reçoit de Metternich une lettre où son père lui interdit d'aller à Parme et lui ordonne de revenir en droiture. Corvisart, Isabey et Mme de Montebello l'ont quittée à ce moment même. Méneval est toujours à Paris. Elle est seule, livrée à Neipperg qui, chargé de la reconduire à Vienne, désigné uniquement à sa confiance, lui prêche la soumission par qui seule, dit-il, elle peut obtenir des souverains alliés, maîtres du monde, un établissement, une couronne et l'indépendance. Pour gagner l'île d'Elbe, si elle y songeait encore, quel moyen ? Neipperg n'est-il pas expressément chargé de l'observer pour le cas où elle voudrait aller trouver son mari et alors, après des représentations, passer à la défense absolue si elle persistait. Il faut donc qu'elle parle, mais, pour éviter les fêtes du Congrès où elle jouerait un méchant rôle, elle voyagera en Suisse, elle passera des jours à Genève, elle fera des excursions dans l'Oberland, elle verra des reines qui ont jeté leur couronne par-dessus les mers et des princesses qui se sont fait enlever. Bausset, qui l'a rejointe après un infructueux voyage à Parme, est goutteux, d'ailleurs en continuelle admiration devant ce qui s'élève. Méneval s'oublie à Prangins près de Joseph. Nul secours à attendre du dehors ; c'est à soi seul à se défendre. Neipperg est aimable, empressé, tout brillant de la volonté de plaire, tout ardent d'obtenir encore cette suprême vengeance ; il est infatigable aux excursions ; il fait passer des soirées charmantes ; il chante délicieusement ; il est romantique, plein de mystères, héroïque et sentimental ; il prend une influence décisive que récompensera au retour à Vienne le titre de chevalier d'honneur de l'Impératrice. Qu'elle ait cédé dès lors, peu importe ; elle est livrée, elle a un maître. Petitement et par degrés, on efface autour d'elle tout ce qui est de l'Empereur : d'abord les armoiries de ses voitures, les boutons armoriés de ses laquais ; puis, son père exige la promesse qu'elle communiquera toute lettre venant de l'île d'Elbe ; puis, qu'elle n'écrira pas sans son assentiment à l'Empereur. A chaque fois, Neipperg affirme que, si elle se rend, on lui donnera Parme, on lui permettra d'y vivre, d'y tenir sa cour, d'y être indépendante et libre. Ces fêles dont elle entend le bruit, où elle n'est pas conviée et dont elle regarde les splendeurs par le trou du plafond, ces plaisirs qu'on prend sans qu'elle y ait part et qui traversent son appartement sans qu'on la salue au passage, ce déploiement d'un luxa dont elle a commencé à jouir et dont brusquement elle se trouve sevrée, n'est pas encore un moyen qu'on prend pour la tenter ? Elle a vingt-trois ans et elle est femme ; père, belle-mère, frères, sœurs, tous les souverains d'Europe guettent sa chute pour lui en faire un triomphe... C'est de la pitié qu'elle mérite et non de la haine. Alors, entre elle et Napoléon un silence s'établit que rompt à peine, au 1er janvier 1815, une lettre insignifiante pour des nouvelles de l'enfant. Puis, délibérément, la rupture se consomme, sans un mot qui en avertisse. Qui sait si quelque jour on ne trouvera pas dans quelque archive par quoi l'on sut rassurer cette conscience timide et enlever les derniers scrupules ? Presque jusqu'à la fin de 1814, l'Empereur a cru qu'elle allait arriver. Au début, la conviction était si forte qu'il a envoyé à Parme, pour le service de l'Impératrice, cinquante chevau-légers et un nombre de chevaux d'attelage. Lorsqu'il s'installe, il désigne les meilleures chambres, les plus fraîches, les plus jolies, pour l'appartement de l'Impératrice. Dans le plan de la maison de Porto-Longone, il en réserve six pour elle. A Porto-Ferrajo, il veut qu'on se presse d'élever l'étage, afin que l'Impératrice le trouve prêt. Ce sera pour août sans doute, et on tirera alors les feux d'artifice. N'aura-t-elle pas, à ce moment, fini sa saison d'eaux, et, puisque, au lieu d'aller en Toscane, elle a voulu venir à Aix et qu'on l'a laissée libre, quelle raison pour qu'elle retarde ? D'ailleurs, n'en a-t-on pas là l'assurance, tout entière écrite, signée de la main de l'empereur d'Autriche ? En août, comme elle n'arrive pas, il commence à s'inquiéter. Il expédie, avec une lettre, le colonel Laczinski : Ecrivez à Méneval, dicte-t-il à Bertrand, que j'attends l'Impératrice à la fin d'août, que je désire qu'elle fasse venir mon fils et qu'il est singulier que je ne reçoive pas de ses nouvelles, ce qui vient de ce qu'on retient les lettres ; que celle mesure ridicule a lieu probablement par les ordres de quelque ministre subalterne et ne peut pas venir de son père ; toutefois, que personne n'a de droit sur l'Impératrice et son fils. Dix jours après, il n'y tient plus. Dans lès fidèles de la Garde, il a le capitaine Hurault, qu'il a marié à une femme rouge de l'Impératrice, Mlle Katzener ; il le fait venir, lui parle, lui donne ses instructions. Hurault ira à Aix et partout où sera l'Impératrice. Il s'arrangera de manière à n'être pas retenu. Il faut qu'il arrive à Aix et qu'il se trouve chez sa femme ou chez Méneval sans qu'on puisse s'en douter. Hurault part sur l'Inconstant, se débrouille, parvient à Aix, fait passer la lettre qu'il apporte, mais il est dénoncé à Neipperg par Mme Brignole, arrêté, dirigé sur Paris, où le directeur général de la Police lui interdit de retourner à l'île d'Elbe, mais lui permet, après quelque temps, de rejoindre sa femme à Schœnbrunn. A la fin, le 28 août, l'Empereur reçoit des nouvelles. Le 31 juillet, Marie-Louise a confié à Bausset, qui allait à Parme, une lettre qui arrive un grand mois après ; vers le 10 août, par une autre voie, elle a expédié une autre lettre où elle annonce qu'elle est contrainte de retourner à Vienne et d'obéir à son père, mais avec des assurances de tendresse et de prochain retour. L'Empereur en reprend courage : il compte qu'une correspondance va s'établir régulièrement et donne des adresses d'intermédiaires à Gènes : c'est bien inutile. Cette lettre du 10 est la dernière qu'il recevra. Septembre passe tout entier dans un silence qui l'exaspère. Le 10 octobre, il se détermine à écrire au grand-duc de Toscane. C'est celui-là qui fut si longtemps son courtisan, ce grand-duc de Wurtzbourg qu'il menait à sa suite dans ses voyages à travers l'Empire, qu'il logeait dans ses palais, qu'il associait à ses plaisirs, qu'il traitait comme un ami avant de le traiter comme l'oncle préféré de sa femme. Il l'a connu grand-duc de Toscane et l'a ménagé en 1796 ; il l'a maintenu, à travers toutes les révolutions, en état de souverain, à Salzbourg ou à Wurtzbourg, alors qu'il destituait de leurs trônes les autres archiducs. Il a pris si grande confiance en son amitié qu'en 1809, songeant à arranger l'Autriche à sa guise, il lui en réservait la couronne. C'est le témoin de son mariage, de la naissance du roi de Rome, le parrain par procuration de son fils, et, à chaque occasion, de quels présents ne l'a-t-il pas comblé ! A présent, voici l'unique service qu'il lui demande en échange de tant de services qu'il lui a rendus : Monsieur mon frère et très cher oncle, lui écrit-il, n'ayant pas reçu de nouvelles de ma femme depuis le 10 août, ni de mon fils depuis six mois, je charge le chevalier Colonnade cette lettre. Je prie Votre Altesse Royale de me faire connaître si elle veut permettre que je lui adresse tous les huit jours une lettre pour l'Impératrice et m'envoyer en retour de ses nouvelles et les lettres de Mme la comtesse de Montesquiou, gouvernante de mon fils. Je me flatte que, malgré les événements qui ont changé tant d'individus, Votre Altesse Royale me conserve quelque amitié. Sicile veut bien m'en donner l'assurance formelle, j'en recevrai une sensible consolation. Dans ce cas, je la prierai d'être favorable à ce petit canton qui partage les sentiments de la Toscane pour sa personne. Que Votre Altesse Royale ne doute pas des sentiments qu'elle me connaît pour elle ainsi que de la parfaite estime et de la haute considération que je lui porte ; qu'elle me rappelle au souvenir de ses enfants. À une telle lettre — et de ce ton si humble, si fier et si touchant — pas de réponse, mais la lettre destinée à Marie-Louise transmise à l'empereur d'Autriche. Celui-ci l'ouvre, la garde quatre jours, la remet à la fin à sa fille, mais lui interdit de répondre. Napoléon apprend la violation de son cachet, la défense qu'a reçue sa femme, la surprise par ce père de ses secrets conjugaux ; il n'écrira plus, mais, par des négociants et des banquiers, il aura encore les nouvelles que Méneval fera passer à Bertrand. Cela est dangereux. Avec ses quatre cents hommes, le prince de l'île d'Elbe reste un épouvantait pour les trois millions de soldais des rois d'Europe. A la première occasion, on le déportera quelque part, très loin. Talleyrand a déjà proposé une des Açores : C'est à cinq cents lieues d'aucune terre. D'autres disent Sainte-Hélène, et l'on hésite sur le pire climat. Ainsi, que reste-t-il du traité du 11 avril et des solennelles promesses reçues en échange de l'abdication ? Les Bourbons n'ont pas payé un centime de la rente de deux millions ; ils ont gardé le Trésor particulier et jusqu'aux bijoux personnels de l'Impératrice, aux livres de l'Empereur. De Corse, Brulart prépare des attaques de barbaresques prétendus, racole les briganti des maquis, les lâche sur l'île d'Elbe. A Vienne, on délibère sur la déportation définitive, et l'empereur d'Autriche déclare que ce vaincu n'a plus droit à une famille, n'a plus de femme et n'a plus de fils. C'est de Grenoble, le 8 mars, que Napoléon date la réponse
à la lettre qu'au jour de l'an il a reçue de sa femme ; elle ne parvient pas
; de Lyon, le 11, nouvelle lettre, à laquelle il joint ses proclamations : il
dit ses forces, l'enthousiasme du peuple, donne rendez-vous à sa femme et à
son fils à Paris, où il sera le 21. Remise au général Bubna par un officier
du 7e Hussards, cette lettre, tous les souverains et les ministres la
tiennent et la lisent ; l'Impératrice seule ne la voit pas. De Paris, le 22,
par un des secrétaires de- l'ambassade d'Autriche, il écrit ; le 26, par
Montrond, il écrit : c'est la lettre que Mme de Montesquiou et Méneval
brûlent pour que Marie-Louise ne la livre pas à son père ; le 28, il écrit,
et c'est cette lettre : Ma bonne Louise, je suis
maître de toute la France ; tout le peuple et toute l'armée sont dans le plus
grand enthousiasme. Le soi-disant roi est passé en Angleterre... Je passe toute la journée des revues de 25.000 hommes. Je
t'attends pour le mois d'avril. Sois à Strasbourg du 10 au 20 avril.
Le 1er avril, par Flahaut, il écrit, mais, en même temps à l'empereur de
Russie et à l'empereur d'Autriche ; et, s'il saisit l'occasion de parler de
paix à celui-ci, c'est d'abord sa femme et son fils qu'il réclame : Je connais trop, dit-il, les
principes de Votre Majesté, je sais trop quelle valeur elle attache à ses
affections de famille pour n'avoir pas l'heureuse confiance qu'elle sera
empressée, quelles que puissent être d'ailleurs les dispositions de son
cabinet et de sa politique, de concourir à accélérer l'instant de la réunion
d'une femme avec son mari, d'un fils avec son père. Le 4, il écrit : Ma bonne Louise, je t'ai écrit bien des fois, je t'ai
envoyé F... (Flahaut) il y a trois jours. Je t'expédie un homme pour te dire
que tout va très bien. Je suis adoré et maître de tout. Il ne me manque que
loi, ma bonne Louise, et mon fils. Viens donc de suite me rejoindre par
Strasbourg. Le porteur le racontera quel est l'esprit de la France. Adieu,
mon amie, tout à toi. Ce sont là des dates certaines ; il existe sûrement d'autres lettres ; celles-ci, du 8, du 11, du 22, du 20, du 28 mars, du 1er et du 4 avril, marquent seulement les points de repère. Dans une agitation qui se contient à peine, l'Empereur accumule les billets et multiplie les émissaires. Enfin, il va peut-être avoir des nouvelles. Hurault, accouru de Vienne à la première annonce du débarquement, arrive à la fin de mars, mais il ne sait rien ou ne veut rien dire. Vers le 15 avril, Montrond apporte une lettre de Méneval : L'esprit de l'Impératrice, dit Méneval, est tellement travaillé qu'elle n'envisage son retour en France qu'avec terreur ; tous les moyens ont été employés depuis six mois, pour l'éloigner de l'Empereur. En effet, après avoir obtenu d'elle, le 12 mars, une lettre officielle par laquelle elle s'est déclarée absolument étrangère aux projets de Napoléon et s'est mise sous la protection des puissances, — ce qui a permis au représentant de l'empereur d'Autriche de signer, sans rendre son maître odieux, la déclaration du 13, proclamant Napoléon au ban de l'Europe, — on l'a récompensée en lui assurant solennellement, en dépit des réclamations de la ci-devant reine d'Etrurie, la possession des duchés de Parme, avec un revenu de douze cent mille francs jusqu'au moment où elle recevra l'administration de ses Etats ; la possession, d'ailleurs, est viagère et ne passera pas à son fils. Là-dessus, elle a déclaré à Méneval qu'elle a pris une résolution irrévocable, celle de ne jamais se réunir à l'Empereur. Elle refuse donc de recevoir les lettres que Napoléon lui adresse, disant qu'elle ne le pourrait faire que pour les montrer à son père, qu'elle ne veut pas aller en France, qu'elle en a l'horreur, que son père lui-même n'aurait pas le droit de l'y forcer. L'impression de la chute, du revirement brutal des opinions, des acclamations changées si tôt en insultes, de l'instabilité de ce peuple, de l'infamie de ces courtisans, est chez elle ineffaçable et reste atroce, et, dans cette haine qui lui est venue et qu'en vérité il faut bien au moins comprendre, sinon excuser, chez une Autrichienne si brusquement et si peu de temps Française, c'est tout juste si elle ne confond pas l'Empereur. En tout cas, de l'homme qui lui a attiré toutes les émotions, toutes les fatigues, tous les déboires qu'elle a éprouvés et qu'elle reçoit encore, du mari qui n'a pas même su lui rester fidèle en échange de la captivité où il l'a mise, de l'aventurier couronné dont la fortune seule pouvait — et dans quelle mesure ! — faire excuser l'alliance, elle ne veut plus qu'on lui parle. Si jamais elle l'a aimé, — et elle l'a aimé, — à présent, c'est fini. C'est à de telles cruautés pour l'ancien amour que le nouveau se montre chez les femmes. Que pourrait raconter de plus fort Ballouhey qui arrive peu après Montrond ? Que dira de plus Méneval qui, ayant quitté Vienne le 6 mai, arrive à Paris vers le 10 ? L'Empereur pourtant, qui d'abord ne veut pas comprendre, ne se lasse pas de l'interroger : le premier jour, de midi à six heures du soir ; les jours suivants, depuis la toilette jusqu'au lover parfois retardé de deux heures. Mais Méneval est discret et ne dit pas tout, et l'Empereur ne tient pas à tout apprendre. Tout ce qu'il dit de l'Impératrice est plein de convenance et de ménagements pour elle. Il la plaint des épreuves auxquelles elle a été exposée ; il va au-devant de ce que Méneval pourrait dire dans son intérêt et ne met pas en doute que ses sentiments pour la France et pour lui n'aient été violentés. Il ne réclame pas sa femme contre son gré. Il n'essaiera pas de la contraindre. Un moment il a pensé attester, devant les Chambres et le pays, la félonie de l'empereur d'Autriche, il a fait préparer les pièces où éclate l'injustice qu'on lui fait en retenant sa femme et son fils. Par égard pour la femme, semble-t-il, il remet, après la victoire ou la défaite, à redemander son enfant. Il ne se plaint pas et n'entend pas qu'on le plaigne, car ce serait la critiquer ou l'attaquer. A présent, elle est devenue comme un être qu'il a rencontré dans une vie antérieure, un être aimé mais disparu, rentré dans l'ombre, perdu dans la nuit. Entre eux, une sorte d'abîme s'est ouvert : comme après les définitives ruptures entre amant et maîtresse, même ceux qui se sont le mieux aimés, un brouillard s'élève qui, s'il voile bientôt à la femme tout le passé, laisse à l'homme seulement un souvenir vague, reconnaissant et attendri. La femme, le jour où, aux eaux de Baden, on apprend l'aventure du Bellérophon, l'hospitalité anglaise et la définitive déportation, répond à ceux qui l'en instruisent : Je vous remercie, je savais la nouvelle que vous m'annoncez. J'ai envie de faire une promenade achevai à Merkenstein. Croyez-vous qu'il fasse assez beau pour la risquer ? L'homme, durant les six années que va durer encore son agonie, à chaque fois que son souvenir se portera vers cette tête blonde, — et c'est chaque jour, — ne trouvera pour l'évoquer que des mots de tendresse, de reconnaissance et de regret. Il sait à présent que par elle, on l'a attiré sur le gouffre où il s'est perdu ; il a compris quel rôle on a fait jouer à cette femme et comme d'elle tout s'est trouvé néfaste ; mais il ne la rend pas responsable ; il l'excepte de l'anathème ; il la voit toujours tendre et facile, parée des roses qui seyaient à son teint clair, timide et franche, soumise surtout et complaisante. Il n'est pas de jour où elle ne reparaisse dans ses conversations ; pour peu qu'elles se prolongent, elle finit tôt ou tard, de manière ou d'autre, par y être quelque chose ou en devenir l'objet. Il n'est point de circonstance, de plus petit détail intime relatif à elle qu'il ne répète cent fois. A travers les pompes triomphales et les majestueux cortèges, dans les palais dorés, sous les ombrages de Saint-Cloud et de l'Elysée, il se plaît à la suivre et à la faire valoir. Si brisés que soient à présent ces liens que jadis, en l'attendant, il symbolisait au plafond de son salon de San-Martino, en donnant pour thème au décorateurs deux pigeons attachés à un même lien dont le nœud se resserre à mesure qu'ils s'éloignent, il lui semble que, dans ce cœur qu'il a cru jadis tout à lui, subsiste au moins la trace de l'ancien amour. Chaque fois qu'un de ses compagnons vient à le quitter et s'embarque pour l'Europe, il le charge d'une tendresse pour elle. A Las Cases il écrit : Si vous voyez un jour ma femme et mon fils, embrassez-les ; depuis deux ans, je n'en ai aucunes nouvelles directes ni indirectes. A O'Meara, il donne ce billet : S'il voit ma bonne Louise, je la prie de permettre qu'il lui baise les mains. Gourgaud, Mme de Montholon, Piontowski. Santini, les domestiques qui partent, ont des commissions pareilles. A des jours, lorsqu'un bâtiment d'Europe jette l'ancre, il interrompt le travail, il attend fiévreusement, persuadé qu'il va recevoir des lettres d'elle. Trouve-t-il, dans un journal anglais, quelque note qui la concerne, le récit d'un accident qui lui est arrivé par sa manie d'équitation, il se fait expliquer l'article jusqu'à trois fois, et, toute la journée, demeure inquiet et affecté. Le 15 avril 1821, lorsque la délivrance approche avec la mort et i qu'il les écoute venir, il écrit : J'ai toujours eu à me louer de ma très chère épouse l'Impératrice Marie-Louise. Je lui conserve, jusqu'au dernier moment, les plus tendres sentiments. Je la prie de veiller pour garantir mon fils des embûches qui environnent encore son enfance. Dans l'état A qu'il joint au Testament, il écrit : Je lègue à l'Impératrice Marie-Louise mes dentelles. Le 28 avril, il dit à Antommarchi : Je souhaite que vous preniez mon cœur, que vous le mettiez dans l'esprit de vin, que vous le portiez à Parme, à ma chère Marie-Louise. Vous lui direz que je l'ai tendrement aimée, que je n'ai cessé de l'aimer... Et comme, malgré tout, il est un homme, donc qu'il se déçoit et se trompe toujours à la femme, il croit qu'elle l'aime toujours, il n'en peut, il n'en veut douter, plaçant là comme le suprême orgueil de son humanité qui expire. Il prétend emporter dans la mort la consolation de cet amour fidèle, il berce son agonie de ce mensonge, — qui sait ? peut-être de cette illusion. Car on n'a point osé tout lui dire, et surtout il n'a pas voulu tout savoir. N'est-ce pas le mieux qu'il ait pu faire, et, pour s'épargner de souffrir par la femme, est-il d'autre moyen que la bannir de sa pensée ou, pour si peu qu'on l'y ait admise, se rendre sur elle obstinément aveugle ? Elle, à l'heure où elle apprend la mort, dans ces ténèbres
à dessein épaissies où l'on a égaré sa conscience, elle a presque un sursaut
et un éveil. J'avoue, écrit-elle, que j'en ai été extrêmement frappée. Quoique je n'ai
jamais eu de sentiment vif d'aucun genre pour lui, je ne puis oublier qu'il
est le père de mon fils et que, loin de me maltraiter, comme tout le monde le
croit, il m'a toujours témoigné tous les égards, seule chose que l'on puisse
désirer dans un mariage de politique. J'en ai donc été très affligée, et
quoiqu'on doit être heureux qu'il ait fini son existence malheureuse d'une
manière chrétienne, je lui aurais cependant désiré encore bien des années de
bonheur et de vie — pourvu que ce fût loin de
moi. C'est là le dernier mot, le mot sincère qui explique l'entier
malentendu qui fut entre eux. Elle, archiduchesse mais Allemande, s'est
soumise au mariage de politique ; elle y fût restée vraisemblablement fidèle
— comme elle le fut invariablement et jusqu'à la mort, aux deux liaisons
d'amitié contractées à Paris avec Mme de Montebello et Corvisart — si
l'époux, imposé d'abord, puis accepté, ne s'était trouvé éloigné par des
circonstances qui ont fait reparaître toutes les antipathies de race et
d'éducation, toutes les hostilités patriotiques et familiales ; elle a
éprouvé pour cet époux les sentiments qui conviennent, mais dont aucun n'est vif. Elle eût souhaité qu'il vécût pour elle, ne
s'occupât que d'elle, qu'il partageât ses goûts de chant, de musique, de
dessin, de promenades et de belle nature, qu'il l'encensât, la glorifiât, la
mît sur un piédestal, tandis que seulement il l'y a fait monter près de lui.
Comme toute femme, elle a subi avec contrainte que l'homme avec qui elle
vivait lui fût supérieur par l'intelligence et par le cœur, et qu'il ne
s'abaissât pas au-dessous d'elle. Toutes impressions de politique, de
nationalité, de noblesse, de haine de la France mises à part, et aussi tous
les souvenirs de captivité, de servitude, de fatigues sans fin, d'émotions,
de larmes et de désespoir, sur ce cerveau allemand fort épris de littérature,
qui sait si le romantisme, en sa pleine mode à Vienne, n'a pas exercé son
influence, et si Neipperg, avec sa pelisse de hussard, son bandeau noir, ses
aventures et ses talents d'agrément, n'a pas apparu à Marie-Louise infiniment
plus romantique que Napoléon ? Car Napoléon, après l'orgueil joyeux de violer sa fortune et cette vierge ce qui il l'a incarnée, a aimé sa femme d'une façon conjugale, en plein repos, sans extase et sans poésie. Il y a porté, comme il a dit, un cœur trop bourgeois. Il lui a donné des fêtes somptueuses, il l'a menée en des voyages impériaux, il lui a fait de belles cérémonies, mais le reste du temps, il l'a traitée en bonne épouse, dînant avec elle, et si elle l'eût désiré, faisant lit commun, car c'est son droit. Pour le reste, rien du compagnon qu'elle eût rêvé. Les aventures qu'il a n'ont rien du roman, c'est l'Histoire ; il chaule faux, ses dessins sont des gribouillages et il ne s'entend pas mieux à la belle conversation qu'aux compliments et aux galanteries. N'est-ce pas qu'il a, au fond de lui, une idée première de la vie conjugale très corse, très pareille, toutes proportions gardées, à la conception qu'il en a prise d'enfance et dont il n'a été détourné qu'en apparence par sa passion, puis sa tendresse pour Joséphine, la maîtresse. Ici, c'est l'épouse ; ici, il se trouve dans le sérieux de la vie et hors de la passion et il revient, par une pente naturelle, à ce qui a été la formule primitive qu'il a reçue de la famille. Le mari suit ses affaires, ses habitudes, ses besoins d'esprit, ses goûts d'ambition ; la femme reste à la maison, tient le ménage, élève les enfants ; on est bons amis, même très tendres quand on se retrouve, mais la communauté de vie n'est que physique et ne s'étend point aux idées. A Paris, il a vu que bien des femmes trompaient leurs maris et, comme il veut, pour quantité de raisons, ne point douter que la sienne ne soit fidèle, il ne s'en rapporte pas à sa vertu et la met dans l'impossibilité physique de voir tout autre homme. Cela vient par surcroit, mais l'idée corse prédomine, l'atavisme et l'éducation corses. Un ennemi perspicace a remarqué qu'il y avait en sa vie familiale ces nuances que l'on rencontre plus particulièrement dans les familles bourgeoises italiennes. Lui-même, en disant que son cœur était demeuré à sa place pour les sentiments de famille, ne donne-t-il pas la clef de son caractère, car, où a-t-il connu la famille, sinon en Corse, et quels sentiments de famille peut-il éprouver hormis à la façon corse ? Et n'est-ce pas tout corse aussi cette idée que, subordonnée et obéissante, courbée au moindre désir du maître, réjouie seulement par les fêtes où il lui donne entrée, satisfaite par ses succès et contente par sa gloire, l'épouse, par cela seul qu'elle est devenue mère, pour défendre son petit, trouvera en soi toutes les ressources, devinera tous les pièges, éventera toutes les embûches et, prenant aux dents son lionceau pour l'arracher aux chasseurs, prudente, ingénieuse, calculée, le sauvera ou mourra près de lui. Telles il a vu des mères là-bas, telles il en sait ; mais Marie-Louise n'est pas plus l'épouse comme il la conçoit que la mère comme il l'imagine. Qu'est-elle donc ? Elle est une Allemande de vingt-trois ans, princesse du sang impérial d'Autriche — et lorsqu'elle s'est trouvée avoir à choisir entre la misère, l'exil, la captivité, la vie solitaire avec le mari déchu, et l'indépendance, des litres, une principauté, de l'argent et la vie somptueuse avec un favori poétisé, elle a préféré le premier lot au second, et plutôt que devenir la femme de l'usurpateur, l'ogresse de Corse, elle est restée Sa Majesté la Princesse Impériale d'Autriche, archiduchesse Marie-Louise, duchesse régnante de Parme, Plaisance et Guastalla. Elle a cru prendre le bon lot : pour la gloire de régner à Parme et d'y continuer les Farnèse, elle a renoncé à paraître devant l'histoire l'épouse de Napoléon le Grand et la mère de Napoléon II. — Oui, mais l'histoire, c'est lorsqu'on est mort, et elle a voulu vivre. D'ailleurs, si elle se dépouille des préjugés et s'élève à la justice, que dira-t-elle, l'histoire ? Que cette fille d'Autriche, sacrifiée par les aristocrates à leur cause, a été sincère en sa haine première contre Napoléon, comme elle l'a été en son amour pour lui ; qu'elle fut la victime des rois, non leur complice ; que le rôle qu'elle a joué, elle l'a joué au naturel, et que, si elle y a mérité leurs applaudissement, si elle y a gagné leur flétrissante récompense, au moins n'a-t-elle jamais compris qu'après l'avoir engagée pour représenter Iphigénie, on lui réservait d'être Dalila. L'histoire dira que celle enfant a désiré, a presque voulu rejoindre l'Empereur, mais qu'en employant toutes les supercheries, en séduisant tous les en tours, en faisant agir toutes les autorités, l'amie, le médecin, le père, le mari, on l'a entraînée sur un marais où, peu à peu, elle s'est enlisée. Dans la boue grasse et fétide, ses pieds se sont pris, et elle n'a pu marcher vers l'austère devoir que le malheur rendait sacré. Et puis, durant qu'elle écoutait des paroles d'amour, d'indépendance, même d'ambition, peu à peu, sans assez se débattre ni s'insurger, elle a glissé dans ce bourbier si avant qu'elle y a trouvé une couronne. A présent, à Parme, le gouffre est refermé, la boue s'est affermie ; l'herbe y croit épaisse et drue ; des violettes sans nombre y fleurissent, et, seul, leur parfum léger qui évoque l'Empereur et ses gloires, appelle au souvenir le nom de Marie-Louise. FIN DE L'OUVRAGE |