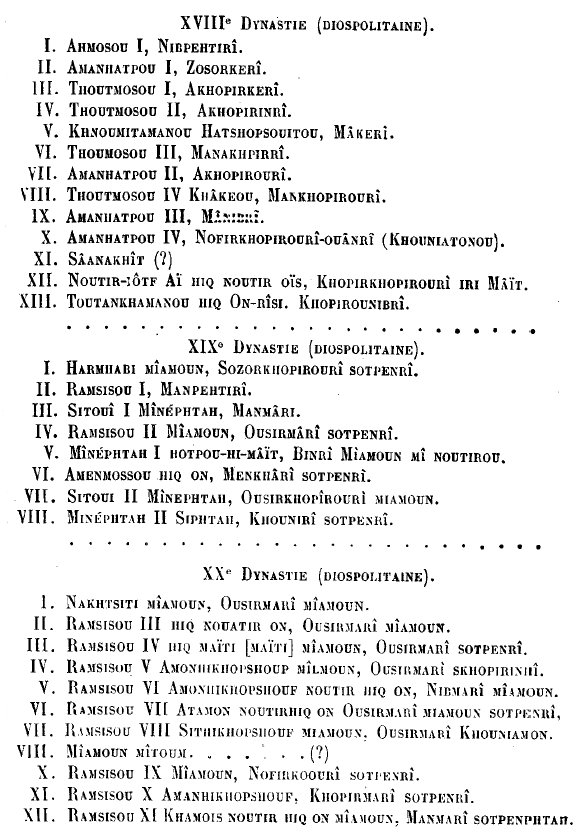HISTOIRE ANCIENNE DES PEUPLES DE L’ORIENT
L’ASIE ANTÉRIEURE AVANT
ET PENDANT
CHAPITRE VI – LES GRANDES MIGRATIONS MARITIMES ET LA VINGTIÈME DYNASTIE.
La colonisation sidonienne, l’Asie Mineure et les Khati.Parmi les peuples de Syrie, les Phéniciens étaient celui qui avait le mieux profité de la conquête égyptienne. Placés en dehors de la route ordinaire des armées, ils n’avaient pas eu à souffrir de leur passage non plus que des péripéties de la lutte, comme les autres nations de Canaan. Le groupe du Nord, celui qui comprenait les cités d’Arad et de Simyra, s’était révélé au début assez rebelle ; on l’avait vu, sous Thoutmosis III, associé à plusieurs reprises aux révoltes des Routonou, mais il avait été châtié d’une manière qui lui avait ôté l’envie de recommencer. Le groupe du Centre et celui du Sud, Gebel et Bérouth, Sidon et Tyr, s’étaient montrés plus résignés à leur sort, depuis le temps de Thoutmosis 1er jusqu’à celui de Ramsès II, et leur résignation leur avait valu des avantages sérieux. Leurs marins pratiquaient le commerce de commission en Égypte pour le compte des étrangers, et à l’étranger pour le compte de l’Égypte : grâce à la paix dont elles jouissaient, Sidon et Tyr avaient développé leurs flottes et elles étaient parvenues au plus haut degré de la richesse et de l’activité. Les Phéniciens trafiquaient avec le dehors à la fois par
terre et par mer, au moyen de caravanes et sur des vaisseaux. Toutes les
routes qui, des principaux marchés de l’Orient, de Mais Hamath, Thapsaque, Nisibis, perdues au milieu des
terres, n’étaient pas, à proprement parler, des possessions
sidoniennes : c’étaient des comptoirs dépendants des princes ou des
tribus voisines, nullement de la métropole. Le commerce maritime avec les
peuples méditerranéens amena, au contraire, la création d’un véritable empire
colonial. Les débuts et les progrès des croisières, qui changèrent Les Giblites avaient été peut-être les premiers à essaimer sur les côtes environnantes[5]. Mais Byblos était un rendez-vous de pèlerins, plutôt qu’une ville de commerce[6]. Les Sidoniens continuèrent et poussèrent plus loin leurs explorations : ils occupèrent Chypre, où Byblos n’avait que des établissements de peu d’importance. Au jugement des anciens, Chypre n’était inférieure à aucune des îles du monde alors connu[7]. Elle est longue d’environ soixante lieues et large en moyenne de vingt ; elle projette vers le nord-est une péninsule étroite, assez semblable à un doigt tendu vers l’embouchure de l’Oronte. Deux chaînes de montagnes peu élevées la traversent presque parallèlement de l’est à l’ouest ; aujourd’hui encore la vallée qui les sépare étonne les voyageurs par sa fertilité. Le sol est un dépôt d’humus noir, aussi profond que celui de l’Égypte[8], et renouvelé chaque année par les crues du Pediæos et de ses affluents[9]. Jadis les montagnes étaient boisées[10] et offraient à une puissance maritime des ressources inépuisables : sous les empereurs romains, les Chypriotes se vantaient de pouvoir construire et gréer un grand navire, de la quille à la pointe des mâts, sans rien emprunter à l’étranger[11]. Le sol est généralement fertile. Il produit du blé en quantité suffisante pour la nourriture des habitants et il se prête à l’élève de la vigne et de l’olivier : mais sa richesse véritable est dans les mines. On y rencontre encore du fer, de l’alun, de l’amiante, de l’agathe, de la sardoine et des pierres précieuses : les collines de Tamassos renfermaient tant de cuivre, que les Romains s’accoutumèrent à désigner ce métal par l’épithète de cyprium[12], et le mot s’est glissé depuis dans toutes les langues de l’Europe. On ne sait ni quel nom avaient les premiers habitants de l’île, ni à quelle race il convient de les rattacher. Les documents égyptiens semblent enregistrer Chypre sous le nom d’Asi, mais, dès le temps de la dix-huitième dynastie, Chypre était déjà une terre phénicienne. Byblos avait fondé le célèbre sanctuaire de Paphos sur la côte ouest ; Golgos, Lapethos, Kourion, Karpasia, Soli, Tamassos, étaient autant de petits États distincts, gouvernés par des rois indépendants l’un de l’autre. D’abord placés sous l’influence de Byblos, les royaumes de Chypre se rangèrent ensuite sous celle de Sidon. Ils reçurent alors des colons sidoniens qui garantirent leur fidélité à la métropole et qui achevèrent de faire de l’île un pays sémitique[13]. Vers le Sud, les Phéniciens ne possédaient pas d’établissements
durables. Ils eurent des postes fortifiés sur la côte méridionale de Aussi bien les pays du Nord offraient à leurs armateurs un
vaste champ de gains et d’aventures. Un peu au delà de l’Oronte, le rivage
tourne vers l’ouest et ne quitte plus de longtemps cette direction : Nulle part plus qu’en Asie
Mineure on n’observe le contraste de l’intérieur et du littoral. La côte est
comme une autre terre, soumise à d’autres lois que l’intérieur[18] Dans la zone
occidentale, ce sont des vallées larges et profondes, ouvertes à l’ouest et
arrosées par des fleuves travailleurs, dont les alluvions empiètent chaque
année sur la mer : le Kaïkos, l’Hermos, le Caystre, le Méandre. Ils
roulaient tous de l’or en abondance, au moins dans la haute antiquité, et ils
sont isolés l’un de l’autre par des lignes de montagnes, qui se dressent subitement
sur la surface unie de la plaine, comme des îles sur le miroir de l’Océan, le
Messogis (Kastanêh-dagh), entre le Méandre et le Caystre ; le Tmolos
(Kisilia-mousa-dagh), entre le Caystre et l’Hermos. La côte, profusément dentelée,
est flanquée de grandes îles : Lesbos, Chios, Samos, Cos, Rhodes, la
plupart assez rapprochées du continent pour en commander les débouchés, assez
éloignées de lui pour être à l’abri d’une invasion soudaine. Terroir fertile
en blés, en vignes, en olives, comme en marbres et en métaux, ports nombreux
et sûrs, cette région de l’Asie Mineure réunissait tous les avantages d’un
pays de culture intense et d’un pays de commerce : elle devait être forcément
le siège de peuples à la fois laboureurs et marins, producteurs et marchands.
Elle était enserrée entre deux groupes de montagnes mal liés au plateau du
centre au nord, l’Ida, revêtu de forêts, riche en métaux, riche en
troupeaux ; au sud, les cimes volcaniques de Toutes les races du monde antique semblent s’être donné
rendez-vous en Asie Mineure. Au nord-ouest, c’était des peuples barbares,
apparentés peut-être aux plus anciens habitants de Plus au sud, dans la masse tourmentée du Tauros, s’abritaient
les Khati et beaucoup de clans alliés aux Khati, dont quelques-uns étaient d’origine
sémitique. Il est assez probable en effet que, dans les premiers moments de l’invasion,
les Sémites ne se bornèrent pas à coloniser La péninsule proprement dite était donc aux mains d’une
race aryenne. L’Hellespont et le Bosphore n’ont jamais constitué une
frontière ethnographique : les deux continents entre lesquels ils
roulent ne sont, en cet endroit, que les deux rives d’un même bassin, les
deux versants d’une même vallée, dont le fond aurait été enseveli sous les
eaux. Les peuples qui avaient envahi la presqu’île des Balkans, et colonisé Au nord de Un groupe de race indécise, Lydiens, Lélèges, Lyciens,
Cares, flottait au sud de Tandis que l’émigration arienne accélérait son mouvement du nord-ouest au sud-est, des peuples d’origine différente montaient à sa rencontre du côté diamétralement opposé. Vers la fin de la dix-huitième dynastie, les Khati avaient pénétré au centre de l’Asie Mineure et porté peut-être leurs armes jusqu’à la mer Egée. Le souvenir de leurs conquêtes s’effaça promptement et ne laissa que des traces incertaines dans l’esprit des générations postérieures. Les poètes homériques savaient encore vaguement que, parmi les guerriers venus au secours de Troie, des Kétéens figuraient, dont le prince avait été tué par Néoptolème[42]. D’ordinaire cependant on confondait les Khati avec leurs adversaires d’Égypte ou d’Assyrie, et l’on inscrivait au compte de ces derniers les légendes qui peut-être avaient eu cours sur les premiers on attribuait à Sésostris une conquête de l’Asie Mineure et de la Thrace[43], et l’on convertit le dernier allié de Priam contre les Grecs en un roi de Suse, Memnon, fils de l’Aurore[44]. Vers le même temps que les Khati entamaient l’intérieur, les Phéniciens battaient les côtes avec assiduité. Les Ciliciens ne paraissent pas avoir répugné à s’allier avec eux, et le rivage opposé à Chypre se couvrit de comptoirs à noms sémitiques, Kibyra, Masoura, Rouskopous, Sylion, Mygdalé, Phaselis, Sidyma[45]. Au lieu d’accueillir les marins qui leur apportaient des produits des civilisations orientales, les Lyciens s’opposèrent à leur établissement et ne permirent point qu’ils fondassent des colonies chez eux. Du promontoire sacré à la pointe de Cnide, il n’y eut sur le continent qu’un seul entrepôt phénicien autonome, Astyra, en face de Rhodes[46]. Les Cares y mirent plus de complaisance. Ils laissèrent les Sidoniens débarquer à Rhodes, refouler dans les montagnes les habitants indigènes et s’emparer des trois ports, Jalysos, Lindos et Camyros[47]. Beaucoup d’entre eux s’engagèrent au service des étrangers et s’unirent à eux par des mariages; la proportion de sang phénicien s’accrut Si fort qu’elle valut parfois à leur pays le sobriquet de Phœnikê, terre phénicienne[48]. Le peuple issu de ce métissage eut pendant longtemps une importance inestimable pour le développement de la civilisation dans les pays qui bordent la mer Egée. Il essaima partout, à Mégare, en Attique, où plusieurs des grandes familles tiraient de lui leur origine ; puis il s’étiola et il mourut sans avoir accompli aucune oeuvre durable, comme c’est le cas pour la plupart des peuples bâtards. L’arrivée et le contact des Phéniciens l’avaient fait naître à la vie civilisée. Uni aux Phéniciens et monté sur leurs vaisseaux, il courut le monde à leurs côtés ; quand la puissance des Phéniciens commença de déchoir, la sienne décrut du même coup. Son rôle cessa le jour où la dernière colonie égéenne des Phéniciens succomba sous l’influx de la civilisation grecque. Au delà de Rhodes, deux voies contraires s’offraient au
navigateur. S’il tournait au nord et s’il rangeait à droite la côte d’Asie,
il gagnait l’embouchure de l’Hellespont. Une partie des flottes phéniciennes
suivit cette première route. Toujours écartées du continent par les
indigènes, elles se dédommagèrent de leur impuissance en occupant celles des
Sporades et des Cyclades que leur position ou leurs richesses naturelles
désignaient à leur attention[49]. Aidées par les
Cares[50], elles eurent
escale à Délos, à Rhénée, à Paros et sur les îlots voisins. Oliaros tomba
entre les mains des Sidoniens[51], Mélos entre
celles des Giblites[52]. Mélos
produisait en abondance le soufre, l’alun, le blanc de foulon ; elle
contenait des mines aussi riches que celles de Thèra et de Siphnos. Il y eut
des pêcheries de pourpre célèbres à Nisyra, à Gyaros, des teintureries et des
manufactures d’étoffes à Cos, Amorgos, Mélos. C’étaient autant de postes
moins faciles à assaillir et plus commodes à fortifier que n’étaient les
comptoirs de terre ferme[53]. Les Sidoniens
ne s’en tinrent pas là ; ils remontèrent aux côtes de Les Cyclades ne furent pas de ce côté le dernier terme de
leur activité. Toujours en quête de marchés nouveaux, ils s’engagèrent
hardiment dans le canal sinueux de l’Hellespont et ils pénétrèrent dans un
bassin spacieux et tranquille, bordé au sud de grandes îles aisées à
conquérir et à garder. Après s’en être assuré la libre pratique par la
fondation de Lampsaque et d’Abydos, ils se logèrent à Pronectos[54], vers la pointe
du golfe d’Ascanie, à proximité des mines d’argent que les Bithyniens
exploitaient dans les montagnes[55]. Au fond de
cette première mer intérieure un nouveau goulet se creusait, plus semblable à
la bouche d’un grand fleuve qu’à un détroit ; ils le franchirent avec
peine, sans cesse en danger d’être drossés à la côte par la violence du
courant et brisés contre les écueils qui semblaient se rapprocher pour les
écraser[56],
puis ils tombèrent dans une mer immense, aux flots orageux, dont les rives
boisées s’enfuyaient à perte de vue vers l’orient et l’occident. Ils filèrent
le long de la côte orientale où la renommée des mines du Caucase les attirait[57], et ils
rapportèrent de ces croisières hardies le thon et la sardine, la pourpre, l’ambre,
l’or et l’argent, le plomb, l’étain nécessaire à la fabrication du bronze, et
qui leur parvenait aussi par voie de terre, à travers l’Arménie et De Rhodes on aperçoit, à l’horizon du sud-ouest, les cimes
des montagnes crétoises. Tandis que certains des amiraux phéniciens couraient
à la découverte du Pont-Euxin, d’autres cinglèrent vers Les migrations des peuples de l’Asie Mineure et l’Exode.La réaction fut prompte à venir : réaction des
Phrygiens et des autres tribus de l’intérieur contre les Khati, réaction des
Grecs et des gens de la côte contre les Phéniciens. Nous
donnons aux peuples maritimes de l’Asie Mineure ; à ceux du moins qui appartiennent
à la race phrygo-pélasgique, le nom de Grecs orientaux. Si différent qu’ait
été le maintien de chacun d’eux vis-à-vis des Phéniciens, tous sans exception
surent s’approprier la civilisation de l’étranger plus cultivé et lui prendre
habilement ses arts. Habitués de longue date à la pêche, ils commencèrent à
munir leurs barques de quilles, qui les rendirent capables de trajets plus
audacieux ; sur le modèle du navire de commerce, aux formes arrondies et
au large ventre, ils construisirent le cheval
de mer, comme ils l’appelaient ; ils apprirent à user de la voile en
même temps que de la rame ; le pilote, à son banc, fixa le regard, non
plus sur les accidents successifs du rivage, mais sur les constellations. Les
Phéniciens avaient découvert au pôle l’étoile sans éclat qu’ils
reconnaissaient comme le guide le plus sûr de leurs courses nocturnes les
Grecs choisirent une constellation plus brillante, Les Sidoniens et les Cares ne s’étaient pas privés d’écumer
longuement les mers de l’Archipel. Comme les Normands du moyen âge, ils s’embarquaient
hardiment à la recherche des aventures profitables ; ils rôdaient le
long des côtes, toujours à l’affût des belles occasions et des bons coups de
main. S’ils n’étaient point en force, ils abordaient paisiblement, étalaient
leurs marchandises et se contentaient, comme pis-aller, du gain légitime que
l’échange de leurs denrées leur procurait. S’ils se croyaient assurés du
succès, ils livraient la bride à l’instinct pillard : ils brûlaient les
moissons, saccageaient les bourgs et les temples isolés, enlevaient tout ce
qui leur tombait entre les mains, principalement les femmes et les enfants,
qu’ils couraient ensuite vendre comme esclaves sur les marchés de l’Orient,
où le bétail humain était taxé au plus haut prix. Les Grecs s’habituèrent à voir dans la piraterie un métier comme un
autre, celui de chasseur ou de pêcheur, par exemple : quand des inconnus
débarquaient quelque part, on leur demandait ingénument (c’est Homère qui l’affirme)
s’ils étaient marchands ou pirates. Ils usèrent de représailles contre
les flottes et les factoreries phéniciennes, et ils eurent vite fait de
reconquérir les Cyclades. Les Sidoniens ne songèrent bientôt plus qu’à se
retrancher sur quelques points importants, à Thasos au nord, à Mélos et à
Thèra au centre, à Rhodes et à Cythère au sud. Les Crétois prirent, ce semble,
une part active à cette revanche, et ils eurent pendant quelque temps un
royaume de cent villes, dont la capitale fut Cnôsos. Le
premier empire de Nous ignorons tout des guerres qu’entreprirent les peuples
de l’intérieur contre les Khati. L’influx perpétuel des tribus thraces n’était
pas sans jeter un trouble profond dans les relations des peuples qui avaient
habité jusqu’alors les rives de la mer Égée. Il fallait de l’espace pour les
nouveaux venus. Les Méoniens, les Tyrséniens, les Troyens, les Lyciens,
durent déverser au dehors une portion au moins de leur trop-plein[69]. D’après la tradition
locale, Manès, fils de Zeus et de Au moment où il traitait avec Khatousîl, Ramsès II était déjà âgé d’au moins cinquante ans et il avait fourni trente années de guerres[75]. On conçoit qu’il ait ressenti le désir du repos et délégué le pouvoir royal à l’un de ses fils. Les trois premiers étant morts, il choisit vers l’an XXX le quatrième, Khâmoïsit qui était chef du sacerdoce memphite. L’autorité de Khâmoïsit dura jusqu’en l’an LV[76] qu’il mourut, et elle dévolut ensuite au treizième fils, Mînéphtah. Nommé héritier présomptif presque dès l’enfance, décoré des titres les plus honorifiques, Mînéphtah paraît avoir partagé avec la princesse Bit-Anati et le prince Khâmoïsit, tous deux nés, comme lui, de la reine Isinofrit, la faveur particulière de Sésostris. Au moins est-il dit plusieurs fois qu’il a surgi comme Phtah au milieu des multitudes, pour édicter des lois excellentes sur les deux terres. Il fut régent douze ans, de l’an LV à l’an LXVII, puis il devint roi à son tour, sous les noms de Binrî-Mînoutîrou, fils du Soleil, Mînéphtah hotphimâït. Tant s’en faut qu’il fût un jeune homme lors de son
avènement. Né, au plus tard, dans les premières années de Ramsès, il comptait
donc soixante ans, sinon davantage ; c’était un vieillard succédant à un
autre vieillard, dans un moment où l’Égypte aurait eu besoin d’un chef jeune
et actif. Néanmoins, le début ne fut pas trop malheureux. Au dehors, les
garnisons des villes syriennes ne furent point inquiétées[77] ; les
Khati, qu’une famine désolait, obtinrent de l’Égypte des secours en blé et ne
rompirent point la paix, par reconnaissance. Au dedans, les grandes
constructions continuèrent à Thèbes, à Abydos, à Memphis, surtout dans le
Delta, où Mînéphtah avait fixé sa résidence, à l’exemple de son prédécesseur.
Tout semblait donc annoncer un règne paisible, sinon un règne glorieux. Mais,
depuis leur défaite sous Sétoui et sous Ramsès II, les peuples de l’Asie
Mineure et de L’annonce de leur approche terrifia l’Égypte. La longue paix dont on avait joui depuis l’an XXI de Ramsès II, pendant un demi-siècle, avait calmé singulièrement l’ardeur belliqueuse de la population. L’armée, réduite en nombre, n’avait plus de corps auxiliaires, et les forteresses, mal entretenues, ne protégeaient plus la frontière de manière efficace : les nomes directement menacés se soumirent sans combat. Mînéphtah, accouru sur le lieu du danger, rétablit l’ordre et la discipline. Il rassembla et recruta l’armée, il appela d’Asi des troupes mercenaires, il lança ses chars en avant, avec ordre de lui signaler le moindre mouvement de l’ennemi. Lui-même il couvrait Memphis du gros de ses forces et il fortifiait le bras central du Nil, pour garantir d’une incursion au moins la partie orientale du Delta. Les préparatifs étaient à peine achevés, que l’ennemi parut à Pirishopsit (Prosopis)[81] et se répandit sur les villages environnants. Mînéphtah lui opposa d’abord sa charrerie et ses mercenaires, et promit aux généraux de l’avant-garde de les rejoindre avec le reste de ses régiments au bout de quatorze jours. Dans l’intervalle, le dieu Phtah se manifesta à lui en songe et lui ordonna de ne point se hasarder sur le champ de bataille[82]. Cette circonstance lâcheuse ne refroidit pas, à ce qu’il paraît, l’ardeur des Égyptiens : le 3 Épiphi, après six heures de mêlée, les confédérés essuyèrent une défaite sanglante. La garde de Mirmaïou fut enfoncée et détruite, lui-même obligé de se sauver en abandonnant son arc, son carquois et sa tente. Le camp enlevé, le butin reconquis, les barbares, poursuivis sans relâche par la charrerie égyptienne, ne réussirent pas à se rallier et ils évacuèrent le pays plus vite qu’ils ne l’avaient envahi. C’est à peine si le chef libyen s’échappa sain et sauf. La nouvelle de cette victoire remplit l’Égypte d’un enthousiasme d’autant plus sincère que l’effroi avait été plus grand. Le retour du roi et de son escorte à Thèbes ne fut qu’un triomphe continuel. Il est très fort, Binri v. s. f. ; - très prudents sont ses projets ; - ses paroles sont bienfaisantes comme Thot ; - tout ce qu’il fait s’accomplit. - Lorsqu’il est comme un guide à la tête des archers, - ses paroles pénètrent les murailles. - Très amis de qui a courbé son échine - devant Mîamoun v. s. f., - ses soldats vaillants épargnent celui qui s’est humilié - devant son courage et sa force ; - ils tombent sur les Libyens, - consument le Syrien. - Les Shardanes, que tu as ramenés de ton glaive, - font prisonniers leurs propres tribus. - Très heureux ton retour à Thèbes, - triomphant ! Ton char est traîné à la main, - les chefs vaincus marchent à reculons devant toi, - tandis que tu les conduis à ton père vénérable, - Amon, mari de sa mère[83]. Cette victoire délivrait l’Égypte du danger présent ; mais, pour l’arracher à la torpeur que signalent les inscriptions, il aurait fallu une main plus ferme que celle d’un vieillard de soixante à soixante-dix ans. La faiblesse de Mînéphtah encouragea les espérances des princes qui se croyaient des droits à la couronne : il semble même que certains d’entre eux n’attendirent pas sa mort pour afficher ouvertement leurs prétentions. Sur une stèle d’Abydos, conservée au Musée du Caire, un premier ministre du roi, Ramsèsempirinri, dit Minou, écrit à la suite de son nom la formule inusitée : aimé de Ramsès Mîamoun comme le soleil, pour l’éternité. En se rappelant que Ramsès II a été divinisé, et en suppléant après aimé de Ramsès Mîamoun les mots tâankh (vivificateur), on n’en sera pas moins surpris de voir qu’un particulier, si élevé en dignité qu’il ait pu être, se soit attribué un titre ordinairement réservé aux rois. En l’absence de documents, il nous est impossible d’apprécier à sa valeur l’espèce d’usurpation dont cette stèle porte la trace[84]. Après tout, ce Ramsèsempirinri, au lieu d’être un usurpateur, n’était peut-être qu’un vice-roi, investi d’attributions extraordinaires et de la même autorité que Mînéphtah lui-même avait eue comme lieutenant de Ramsès II. Même si l’on admet que les compétitions plus ou moins déguisées ne commencèrent peut-être pas du vivant de Mînéphtah, on ne saurait nier qu’elles se produisirent au lendemain de sa mort[85]. Sur le fond d’obscurité qui enveloppe cette époque, un seul fait ressort à peu près certain : Sétoui II, fils de Mînéphtah, qui, durant la vie de son père, était déjà prince de Koush et héritier présomptif[86], ne monta pas immédiatement sur le trône. Il fut supplanté par un certain Amenmossou, fils ou petit-fils d’un des enfants de Ramsès II morts avant ce Pharaon[87] : Amenmossou régna, quelques années au moins, sur Thèbes et probablement sur l’Égypte entière, puis Sétoui II le remplaça. Il régna un peu plus de six ans, sans grand éclat. Une inscription de l’an II lui attribue des victoires sur les nations étrangères[88], et l’un des papyrus du Musée Britannique exalte sa grandeur en termes éloquents. Je ne sais trop jusqu’à quel point on doit se fier à ces indications : le chant de victoire contenu au Papyrus Anastasi IV n’est que la copie, presque mot pour mot, d’un chant de triomphe dédié jadis à Mînéphtah et approprié à Sétoui II par une simple substitution de noms. Plusieurs documents contemporains indiquent d’ailleurs des troubles et des usurpations analogues à celles qui avaient attristé les années précédentes. Sétoui II était déjà sans doute d’un certain âge lors du couronnement de son père, à moins qu’on ne préfère voir en lui un enfant né sur le tard et écarté pendant dix à douze ans du pouvoir par l’ambition de ses cousins ; de toute manière, il n’avait aucunement l’énergie nécessaire pour tenir tête à l’orage. Une des statuettes du Louvre représente un homme accroupi qui presse entre ses jambes un naos, où figure le dieu Phtah-Sokari. Les cartouches du roi Sétoui II sont gravés sur ses épaules et déterminent son époque ; son nom se lit Aiari. Ses titres sont tellement élevés qu’ils ne conviendraient qu’à un prince héritier du trône, si les troubles profonds qui suivirent le règne de Mînéphtah ne nous permettaient pas de soupçonner ici l’usurpation d’un degré d’honneur illégitime. Outre les titres ordinaires du souverain pontife de Memphis, que notre personnage s’attribue comme droit héréditaire, il se qualifie héritier dans la demeure du dieu Gabou (l’Égypte), et héritier supérieur des deux pays. La fin de la légende est brisée, mais aucune parenté royale n’est alléguée, malgré ces titres si éminents[89]. Avait-il des fils qui furent écartés du trône ? ou bien mourut-il sans enfants ? Sa veuve, la princesse Taouasrît, qui paraît avoir été l’héritière légitime du pouvoir royal, épousa un de ses cousins, probablement un petit-fils de Ramsès II, qui en montant sur le trône s’intitula pendant quelques mois Ramsès-Siphtah, mais qui prit bientôt le nom de Siphtah-Ménéphtah. Il est vraisemblable qu’un certain Baî, qui occupait déjà sous Sétoui II le poste de premier ministre, eut grande part à son élévation : du moins il continua à exercer l’autorité souveraine. Le règne de Siphtah ne dura pas longtemps, et nous ignorons quels événements le remplirent ou en précipitèrent la fin. Ces causes diverses, impuissance des maîtres trop âgés,
révoltes des hauts fonctionnaires, accessions des dynasties collatérales,
qui, depuis près d’un demi-siècle travaillaient l’Égypte, amenèrent enfin,
sous lui-même ou immédiatement après sa mort, la dissolution, je ne dirai pas
de l’empire égyptien, mais de l’Égypte elle-même. Le
pays de Kîmit s’en allait à la dérive[90] : les gens qui s’y trouvaient, ils n’avaient plus de
chef suprême, et cela pendant des années nombreuses, jusqu’à ce que vinrent d’autres
temps, car le pays de Kîmit était aux mains de chefs des nomes qui se tuaient
entre eux, grands et petits. D’autres temps vinrent après cela, pendant des
années de néant[91], où un Syrien, nommé Irisou[92], fut chef parmi
les princes des nomes, et força le pays entier à prêter hommage devant
lui : chacun complotait avec le prochain pour piller les biens l’un de l’autre,
et comme on traitait les dieux de même que les hommes, il n’y eut plus d’offrandes
faites dans les temples[93]. » Les
termes sont explicites et témoignent d’une anarchie complète. Ils nous
montrent avec quelle facilité le faisceau d’éléments dont le royaume des Pharaons
se composait pouvait se disjoindre dès que le pouvoir central faiblissait.
Sésostris parcourait l’Asie et l’Afrique à la tête de ses armées
victorieuses ; moins de cinquante ans après sa mort, l’Égypte était
morcelée. « Supposez que le désert devienne plaine et que les montagnes
s’abaissent, disait un scribe du temps, les barbares du dehors viendront
en Kîmit. » Il n’y eut pas
besoin de ces miracles pour que la prédiction s’accomplît. Depuis Ramsès II,
la puissance militaire de la dynastie et sa domination extérieure avaient
périclité rapidement. Mînéphtah avait encore cultivé soigneusement l’alliance
hittite et tenu garnison dans les villes principales de A la faveur des discordes et de l’invasion, les captifs
asiatiques ou africains que les Pharaons de la dix-huitième et de la
dix-neuvième dynastie avaient ramenés s’insurgèrent de toutes parts. On dit que ceux des prisonniers de Sésoôsis qui étaient
Babyloniens se révoltèrent contre lui, incapables qu’ils étaient de supporter
plus longtemps les travaux auxquels on les soumettait. Ils s’emparèrent d’une
position très forte qui domine le fleuve, livrèrent divers combats aux
Égyptiens et gâtèrent tout le pays environnant ; à la fin, quand on leur
eut accordé l’impunité, ils colonisèrent la place et l’appelèrent Babylone,
du nom de leur patrie. On contait une histoire analogue sur la
bourgade voisine de Troja[94]. Condamnés à
extraire la pierre, à mouler la brique, à creuser les canaux, à bâtir les
temples, les palais et les forteresses, les esclaves avaient une vie fort
pénible et ils ne demeuraient tranquilles que par l’effet d’une surveillance
perpétuelle[95].
A la première occasion, ils se mutinaient et ils cherchaient à s’évader. Leur
nombre était considérable, surtout dans La tradition la plus accréditée place l’Exode sous le
règne de Mînéphtah[98], et de fait c’est
sur une stèle de ce prince, à propos de la victoire qu’il remporta sur les
Libyens, que le nom d’Israël parait pour la première fois avec certitude[99] : Israël y
est mentionné parmi les cités de Les traditions nationales des Juifs contaient que Pharaon, mécontent de l’accroissement d’Israël, ordonna de tuer tous les enfants mâles qui naîtraient. Une femme de la tribu de Lévi, après avoir caché le sien pendant trois mois, l’exposa sur le Nil dans un berceau d’osier, à l’endroit où la fille du souverain avait accoutumé de se baigner. La princesse eut pitié de la petite victime, l’appela Moïse, le sauvé des eaux, et la nourrit près d’elle dans toute la science de l’Égypte. Il avait déjà quarante ans, lorsqu’un jour il assassina un Égyptien qui frappait un Hébreu, et il se sauva au Sinaï. Après quarante années d’exil, Dieu lui apparut dans un buisson ardent et lui commanda de tirer son peuple d’esclavage. Il se rendit donc à la cour avec son frère Aaron, et il sollicita pour les Hébreux l’autorisation d’aller sacrifier dans le désert. Il ne l’obtint qu’après avoir déchaîné sur la vallée du Nil les dix plaies légendaires et fait périr les premiers-nés de la nation. Poursuivies par Pharaon, les tribus traversèrent à pied sec la mer Rouge, dont les eaux se séparèrent pour les laisser passer et se refermèrent pour engloutir les Égyptiens[100]. Alors Moïse et les enfants d’Israël chantèrent ce cantique à l’Éternel et dirent : Je chanterai à l’Éternel, car il s’est hautement élevé ; il a jeté dans la mer le cheval et celui qui le montait. - L’Éternel est ma force et ma louange et il a été mon Sauveur, mon Dieu fort. Je lui dresserai un tabernacle, c’est le Dieu de mon père, je l’exalterai. - L’Éternel est un vaillant guerrier, son nom est l’Éternel. - Il a jeté dans la mer les chariots du Pharaon et son armée ; l’élite de ses capitaines a été submergée dans la mer Rouge. - Les gouffres les ont couverts ; ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. - … L’ennemi disait : Je poursuivrai, j’atteindrai, je partagerai le butin ; mon âme sera assouvie d’eux ; je tirerai mon épée, ma main les détruira. - Tu as soufflé de ton vent : la mer les a couverts ; ils ont été enfoncés comme du plomb au profond des eaux[101]. Telle est l’histoire qui avait cours chez les Hébreux, au moment où leurs livres sacrés furent rédigés en la forme qu’ils ont aujourd’hui. Un seul fait est à conserver dans ce récit : une bande d’Hébreux, lasse de sa condition, profita du désordre pour s’évader et pour se réfugier au désert. Après le premier moment de surprise, les Égyptiens ne s’inquiétèrent plus de ce qu’étaient devenus leurs esclaves fugitifs. Mais plus tard, vers l’époque macédonienne, quand les Juifs commencèrent à jouer un rôle auprès des Ptolémée, on s’ingénia à découvrir dans les annales du passé la mention de l’Exode. La tradition hébraïque, superposée plus ou moins heureusement à diverses données des annales et de la légende égyptiennes, fournit à Manéthon la matière d’une version nouvelle. Le roi Aménophis eut, dit-on, la fantaisie de contempler les dieux comme avait fait Hôros, un de ses ancêtres. Un voyant qu’il consulta à cet égard lui répondit qu’il devait avant tout purifier le pays des lépreux et autres hommes impurs ; sur quoi, il rassembla, au nombre de quatre-vingt mille, les Égyptiens affligés de vices corporels et il les jeta dans les carrières de Tourah. Il y avait parmi eux des prêtres, dont le malheur irrita les dieux : le voyant, craignant leur colère, écrivit une prophétie, dans laquelle il annonçait que certaines gens s’allieraient avec les Impurs et domineraient en Kîmit pendant treize ans, puis il se tua. Le roi cependant eut pitié des proscrits et leur concéda la ville d’Avaris, demeurée déserte depuis l’expulsion des Hyksôs. Ils s’y constituèrent en corps de nation sous la conduite d’un prêtre d’Héliopolis, Osarsyph ou Moïse, qui leur imposa des lois contraires à leurs coutumes originelles, les arma et conclut une alliance avec les débris des Pasteurs exilés en Syrie depuis plusieurs siècles. Tous ensemble ils attaquèrent la vallée et ils l’occupèrent sans combat. Aménophis se rappela la prédiction du voyant, ramassa les images des dieux, et s’enfuit en Éthiopie avec son armée et une multitude d’Égyptiens. Les Solymites, qui avaient envahi le pays avec les Impurs, se comportèrent si indignement envers les hommes, que leur domination devint insupportable à ceux qui durent alors subir leurs impiétés. En effet, non seulement ils incendièrent les villes et les villages, et ne se retinrent point de piller les temples et de briser les images des dieux, mais ils se servirent pour leur cuisine des animaux les plus révérés et forcèrent à les immoler et à les dépecer les prêtres et les prophètes qu’ensuite ils jetaient nus dehors… Après cela, Aménophis revint d’Éthiopie avec une grande armée, ainsi que son fils Ramsès, qui, lui aussi, avait une armée. Tous deux assaillirent ensemble les Pasteurs et les Impurs, les vainquirent et, après en avoir tué un grand nombre, les poursuivirent jusqu’aux frontières de Syrie[102]. Ramsès III et la vingtième dynastie ; les grands-prêtres d’Amon.Une dynastie nouvelle se manifesta au milieu de l’incertitude générale. Son chef Setnakhîti, descendant de Ramsès II, maître de Thèbes, eut raison des rebelles et déposséda le Syrien Irisou, non sans peine. Il fut comme les dieux Khopri et Soutkhou en sa violence, remettant en état le pays entier qui était en désordre, tuant les barbares qui étaient dans le Delta, purifiant le grand trône d’Égypte ; il fut régent des deux terres à la place de Toumou, s’appliquant à réorganiser ce qui avait été bouleversé, si bien que chacun reconnut un frère dans ceux qui avaient été séparés de lui pendant si longtemps[103], rétablissant les temples et les sacrifices, si bien qu’on rendit aux cycles divins leur hommages traditionnels[104]. Son fils Ramsès III, qu’il avait déjà associé au trône de
son vivant, fut le dernier des grands souverains de l’Égypte. Ambitieux d’égaler
en tout son homonyme Ramsès II[105], pendant les
trente-deux années de son règne, il ne cessa de travailler à rétablir au dehors
l’intégrité de l’empire, au dedans la prospérité du pays. Malgré les succès
que son père avait remportés, il trouva les provinces syriennes perdues et
les frontières entamées. A l’est, les Bédouins harcelaient les postes
fortifiés du Delta et les colonies minières du Sinaï ; à l’ouest, les
nations de Libye avaient débordé sur la vallée du Nil. Entraînés par leurs
chefs, Didi, probablement le fils du Mirmaïou contemporain de Mînéphtah,
Mashaken, Tamar et Zaoutmar, les Tahonou, les Timihou, les Kehaka et leurs
voisins avaient surgi des profondeurs du désert, et ils avaient conquis le
nome Maréotique, le nome Saïtique, les embouchures du Nil jusqu’au grand bras
du fleuve, bref toute la région partie occidentale du Delta depuis la ville de
Karbina à l’ouest[106] jusqu’à la
banlieue de Memphis au sud. Ramsès III, après avoir châtié vertement les
Bédouins, marcha contre les Libyens en l’an V,
et les battit complètement. Ils furent épouvantés
comme des chèvres assaillies par un taureau qui bat du pied, frappe de la
corne et ébranle les montagnes en se ruant sur qui l’approche. Les
ravages des barbares avaient exaspéré les Égyptiens : ils n’accordèrent
point de quartier. Les Libyens s’enfuirent en désordre : quelques-uns de
leurs clans, attardés dans le Delta, furent enveloppés, rendus et incorporés
à l’armée auxiliaire[107]. A peine dégagé
de ce côté, Ramsès III se tourna contre Cette exécution si prompte ne termina pas cependant les épreuves de Ramsès III. Les anciens alliés des peuples de la mer, les Libyens, n’auraient pas mieux demandé que d’intervenir dans la campagne de l’an VIII contre l’Égypte. S’ils ne le firent pas, ce fut sans doute qu’ils n’avaient pas encore eu le temps de réparer leurs pertes : dès qu’ils se sentirent prêts, ils rentrèrent en scène. Leur chef Kapour et son fils Mashashar entraînèrent les Mashouash, les Sabita, les Kaïqash, et d’autres tribus moins importantes, puis, aidés par des auxiliaires tyrséniens et lyciens, ils revinrent à l’assaut du Delta en l’an XI. Leur âme s’était dit pour la deuxième fois qu’ils passeraient leur vie dans les nomes de l’Égypte, qu’ils en laboureraient les vallées et les plaines comme leur propre territoire. Le succès ne répondit pas à leur attente. La mort fondit sur eux en Égypte, car ils étaient accourus de leurs propres pieds vers la fournaise qui consume la corruption, sous le feu de la vaillance du roi qui sévit comme Baal du haut des cieux. Tous ses membres sont investis de force victorieuse ; de sa droite il saisit les multitudes, sa gauche s’étend sur ceux qui sont devant lui, semblable à des flèches contre eux, pour les détruire ; son glaive est tranchant comme celui de son père Montou. Kapour, qui était venu pour exiger l’hommage, aveuglé par la peur, jeta ses armes et ses troupes agirent comme lui : il éleva au ciel un cri suppliant, et son fils suspendit son pied et sa main. Mais voilà que se dressa près de lui le dieu qui connaissait ses plus secrètes pensées. Sa Majesté tomba sur leur tête comme une montagne de granit ; elle les écrasa et pétrit la terre de leur sang comme de l’eau : leur armée fut massacrée, massacrés leurs soldats… On s’empara d’eux ; on les traîna, les bras attachés, pareils à des oiseaux entassés au fond d’une barque, sous les pieds de Sa Majesté. Le roi était semblable à Montou ; ses pieds victorieux pesèrent sur la tête de l’ennemi ; les chefs qui étaient devant lui furent frappés et tenus dans son poing. Ses pensées étaient joyeuses, car ses exploits étaient accomplis[111]. Les Libyens y regardèrent à deux fois désormais avant de troubler la paix de l’Égypte. Les victoires de ces douze années avaient racheté largement
les défaites des années précédentes. Une course de la flotte le long des
côtes réintégra dans le devoir les anciennes provinces syriennes, et les
nations de Khati, de Gargamish, du Qidi, rentrèrent d’elles-mêmes dans l’alliance.
Une expédition maritime suivit presque aussitôt contre les régions de l’encens.
J’équipai des vaisseaux et des galères, pourvus de
nombreux matelots et de nombreux ouvriers. Les chefs des auxiliaires
maritimes y étaient avec des vérificateurs et des comptables, pour les
approvisionner des produits innombrables de l’Égypte : il y en avait de
toute grandeur par dizaines de mille. Allant sur la grande mer de l’eau de
Qiti[112], ils arrivèrent au pays de Pouanît, sans que le mal les
abattît, et préparèrent le chargement des galères et des vaisseaux en
produits du Tonoutir, avec toutes les merveilles mystérieuses de leur pays,
et en des quantités considérables de parfums de Pouanît, chargés par dizaines
de mille, innombrables. Leurs fils, les chefs du Tonoutir, vinrent eux-mêmes
en Égypte avec leurs tributs ; ils arrivèrent sains et saufs au pays de
Coptos, et abordèrent en paix avec leurs richesses. Ils les apportèrent en caravanes
d’ânes et d’hommes et les chargèrent sur le fleuve, au port de Coptos[113] Quelques
soldats dépêchés au Sinaï y replacèrent les districts miniers sous l’autorité
du Pharaon[114].
L’empire égyptien était reconstitué tel qu’il était un siècle auparavant, au
temps de Ramsès II. On ne vit plus les Shardanes, les Tyrsênes, les Lyciens,
les Achéens, débarquer en masse sur les côtes d’Afrique. Le courant de l’émigration
asiatique, tourné contre la vallée du Nil pendant cent cinquante ans au
moins, reflua vers l’ouest et inonda l’Italie au même temps que les colons
phéniciens y arrivaient. Les Tyrsênes prirent terre au nord de l’embouchure
du Tibre ; les Shardanes se jetèrent sur la grande île qui fut plus tard
appelée Sardaigne. Il ne resta bientôt plus en Asie et en Égypte que le
souvenir de leurs déprédations, et le récit légendaire des migrations qui les
avaient conduits des parages de l’Archipel à ceux de Hérodote racontait qu’au retour de ses campagnes Sésostris faillit être tué par trahison. Son frère, à qui il avait confié le gouvernement, l’invita à un grand repas et avec lui ses enfants, puis il entoura de bois la maison où était le roi et ordonna qu’on y allumât le feu. Le roi l’ayant appris, délibéra sur-le-champ avec sa femme qu’il avait amenée avec lui : celle-ci lui conseilla de prendre deux de ses six enfants, de les étendre sur le bois enflammé et de se sauver sur leurs corps comme sur un pont. Sésostris le fit, et brûla de la sorte deux de ses enfants ; les autres se sauvèrent avec le père[115]. Les monuments nous ont prouvé que le Sésostris de la légende d’Hérodote est ici non pas Ramsès II, mais son homonyme Ramsès III. Un des frères du roi, que les pièces officielles désignent sous le pseudonyme de Pentoêrit, conspira contre lui avec un grand nombre de courtisans et de femmes du harem : il s’agissait de l’assassiner et d’introniser le frère à sa place. Le complot fut découvert, les conjurés cités devant les tribunaux et condamnés, les uns à mort, les autres à la prison perpétuelle[116]. Ramsès III vécut en paix les dernières années de son règne. Il construisit à Thèbes, en souvenir de ses guerres, le grand palais de Médinet-Habou, élargit Karnak, restaura Louqsor. Le détail de ses fondations pieuses dans le Delta nous a été conservé par un manuscrit de la bibliothèque d’Héliopolis, le grand Papyrus Harris[117]. On y voit que l’Égypte avait recouvré non seulement son empire extérieur, mais son activité commerciale et industrielle. Les beaux jours de Thoutmosis III et de Ramsès II semblaient être revenus. La décadence s’accentuait davantage. L’Égypte, éprouvée
par quatre siècles de batailles perpétuelles, devenait de plus en plus
incapable d’un élan sérieux : la population, décimée par le recrutement,
mal renouvelée par l’introduction incessante d’éléments étrangers, n’avait
plus l’endurance ni l’enthousiasme des premiers temps. Les classes nobles,
amollies par le bien-être et par la richesse, n’estimaient plus que les professions
civiles et raillaient tout ce qui touchait au militaire. Pourquoi dis-tu que l’officier d’infanterie est plus
heureux que le scribe ? demandait un scribe à son élève. - Arrive, que
je te peigne le sort de l’officier d’infanterie, l’étendue de ses misères !
- On l’amène, tout enfant, pour l’enfermer dans la caserne : - une plaie
qui le coupe se forme sur son ventre, - une plaie d’usure est sur son oeil, -
une plaie de déchirure est sur ses deux sourcils ; sa tête est fendue et
couverte de pus[118]. - Bref, il est battu comme un rouleau de papyrus, - il
est brisé par la violence. - Arrive, que je te dise ses marches vers On le vit bien au cours de la vingtième dynastie. En l’an XXXII, Ramsès, fatigué du pouvoir, appela son
fils Ramsès IV à le partager[124]. Il mourut
quatre ans après, et Ramsès IV lui-même, après avoir régné trois ou quatre années
au plus, fut remplacé par un parent éloigné qui fut Ramsès V. Vinrent ensuite
les quatre fils de Ramsès III, Ramsès VI, Ramsès VII, Ramsès VIII et
Miamoun-Miritoumou, qui se succédèrent rapidement sur le trône. Ces
Ramessides firent çà et là quelques expéditions, jamais de grandes
guerres ils consumèrent leurs jours
dans le calme du dehors et le calme du dedans, et, s’il est vrai que ces
peuples-là sont heureux qui n’ont pas d’histoire. les Égyptiens furent heureux
sous leur sceptre. Plus de courses annuelles, plus de razzias aventureuses
aux montagnes de Cilicie et dans les plaines du Haut Nil. Les monuments nous font assister à son agonie. Non les monuments officiels, car ceux-là répètent sans vergogne les phrases pompeuses en usage sous les dynasties précédentes ; mais les documents privés, mais les carnets d’entrepreneur, les pièces juridiques, la correspondance des particuliers ou des fonctionnaires[125]. Ils nous révèlent l’histoire anecdotique de Thèbes pendant plus d’un siècle, et ils étaient à nos yeux l’appauvrissement graduel de la grande ville. La population avait grossi considérablement depuis l’expulsion des Pasteurs. Sous les Pharaons conquérants, chaque guerre lui avait fourni son contingent de Syriens, de Libyens, de nègres ; sous les derniers Ramessides, le commerce soutint le rôle de pourvoyeur d’esclaves, qui avait été réservé si longtemps à la guerre. Tous ces étrangers, hommes ou femmes, finissaient par s’allier aux Égyptiens de sang pur, et se fondaient en une race bâtarde, où les défauts des deux races mères étaient réunis, comme c’est le cas en Orient. Affranchis au bout de deux ou trois générations, ils ne gardaient plus de leur origine que leurs noms exotiques ou un sobriquet, Pikharoui (le Syrien), Plamnani (l’homme du Liban), Pinahsi (le Nègre), Pashouroui (l’Assyrien). Il n’y a pas besoin d’avoir habité longtemps le Caire pour savoir par expérience de quelle corruption profonde une engeance pareille est susceptible. Les temples en occupaient la majeure partie autour d’eux, d’autres étaient directement dans la main du roi ou du grand prêtre, d’autres ne dépendaient que d’eux-mêmes. Les chantiers de constructions fournissaient de l’ouvrage à la moitié au moins de ce monde ; presque tout le reste était employé sur la rive gauche du Nil, dans les différents métiers qui se rattachaient au culte des morts et aux manipulations de l’embaumement. Les salaires étaient peu considérables, au moins pour les simples ouvriers. Le meilleur de la paye consistait en céréales ou en pains, que l’on distribuait le premier de chaque mois, et qui devaient durer jusqu’au premier du mois suivant. Il est probable que la quantité allouée à chacun aurait suffi à des gens tant soit peu économes ; mais l’imprévoyance naturelle aux ouvriers, en général, ne permettait pas souvent qu’il en fût ainsi. Les premiers jours, ils puisaient amplement à la réserve sans ménager les provisions : vers le milieu, la nourriture manquait et ils commençaient à se plaindre. Nous avons faim, et il y a encore dix-huit jours jusqu’au mois prochain. Bientôt le travail est suspendu, les affamés quittent l’atelier et vont se réunir sur une place publique, auprès du monument le plus proche, à la porte du temple de Thoutmosis III, derrière la chapelle de Mînéphtah, au Memnonium de Sétoui 1er. Leurs contremaîtres les poursuivent, les commissaires de police du quartier, les gendarmes Mazaiou, les scribes du voisinage accourent et parlementent avec eux. Souvent on les ramène par de bonnes paroles, souvent aussi ils ne veulent rien écouter : Nous ne reviendrons pas, déclare-le à tes supérieurs qui sont là-bas assemblés. Il fallait bien confesser que leurs griefs étaient fondés ; nous allâmes pour entendre leur bouche, et ils nous dirent des paroles vraies. Le plus souvent la révolte n’avait d’autres conséquences qu’un chômage prolongé : les distributions du mois nouveau rendaient aux mutins le courage et la force du travail. Quelquefois pourtant ces alternatives de privations et d’abondance devenaient une cause de troubles sérieux. L’homme n’était pas seul à souffrir : il avait une femme, une soeur, des enfants qui pleuraient la faim, et les magasins du clergé ou de l’État étaient là sous ses yeux, remplis à regorger d’orge et de blé. La tentation devait être vive d’entrer et de s’approprier ce dont on avait besoin : les grévistes n’y résistaient pas toujours. Ils partaient en bande, ils franchissaient les deux ou trois enceintes derrière lesquelles les greniers s’abritaient, mais arrivés là, le coeur leur faillait, et ils se bornaient à dépêcher l’un d’eux au scribe directeur pour lui exposer leur requête. Nous venons pressés par la faim, pressés par la soif, n’ayant plus de vêtements, n’ayant plus d’huile, n’ayant plus de poissons, n’ayant plus de légumes. Envoyez au Pharaon, v. s. f., notre maître, envoyez au roi, notre supérieur, pour qu’on nous fournisse les moyens de vivre. Si l’un d’eux, moins patient que les autres, s’emportait, jurait : Par Amon ! par le souverain, v. s. f., dont la colère est la mort ! demandait à être conduit devant un magistrat pour y déposer sa plainte, les autres s’entreposaient auprès du chef en sa faveur, priaient qu’on ne lui appliquât pas les peines sévères que la loi décrétait contre le blasphème : le scribe, bon homme, laissait tomber la chose et, s’il le pouvait, leur accordait satisfaction, prélevait, sur l’excédent des mois écoulés, de quoi les nourrir pendant quelques jours, ou transmettait leur pétition à qui de droit et obtenait pour eux un supplément de rations au nom de Pharaon. Nous avions dit : Ne nous sera-t-il pas alloué de grains en sus de ce qui nous est attribué, sinon nous ne bougeons d’ici ? Voici donc, le dernier du mois, il arriva que l’on comparut par-devant les magistrats, et ils dirent : Qu’on mande le scribe comptable Khâmoisit ! Il fut amené devant les grands magistrats de la ville et ils lui dirent : Vois les grains que tu as reçus et en donne aux gens de la nécropole. On fit donc venir Pmontouniboïsit, et l’on nous servit des rations supplémentaires, chaque jour[126]. Les délits de tout genre étaient nombreux au sein de cette
population besogneuse et turbulente. L’Égyptien encore aujourd’hui est larron
de naissance : il vole pour le plaisir de voler, souvent même des objets
qui ne lui serviront à rien. Les nécropoles offraient une riche proie à l’Égyptien
de jadis : beaucoup de tombes, mal gardées, renfermaient des momies
couvertes d’or et de bijoux. C’était grosse affaire d’y atteindre, car il
fallait creuser des mines, avant de se glisser jusqu’à la chambre du
sarcophage ; les voleurs s’associèrent donc en bandes considérables qui
exploitaient les sépultures. Il y avait de tout dans ces syndicats, de
simples ouvriers, des vagabonds, des employés, des prêtres, même des affiliés
de la police : la nécropole entière fut livrée au pillage, et les tombes
des rois ne furent pas plus respectées que les autres. Sous Ramsès IX, une
enquête révéla que l’hypogée du roi Sovkoumsaouf et de sa femme avaient été
violé ; que celui d’Amenôthès 1er et celui d’Antouf IV
avaient été attaqués à la sape ; que d’autres rois avaient été menacés[127]. Derrière la
montagne qui borne au nord le ravin de Déir el-Bahari se creusait jadis une
sorte de bassin, clos de tous les côtés et sans autre communication avec la
plaine que des sentiers dangereux. Il se divise en deux branches qui se
croisent presque en équerre l’une regarde le sud-est, tandis que l’autre s’allonge
vers le sud-ouest et se subdivise en rameaux secondaires. A l’est, une
montagne se dresse, dont la croupe rappelle, avec des proportions
gigantesques, le profil de la pyramide à degrés de Saqqarah. Nul endroit n’était
mieux approprié à servir de cimetière : la difficulté d’y accéder
empêcha cependant qu’on n’y creusât des tombeaux pendant l’Ancien et le Moyen
Empire. Enfin, vers le début de la dix-huitième dynastie, les ingénieurs, en
quête d’emplacements favorables, remarquèrent que le vallon était séparé d’un
ravin, qui débouche au nord de Gournah, par un simple seuil d’environ cinq
cents coudées d’épaisseur. Ce n’était pas de quoi effrayer des mineurs aussi
exercés qu’ils l’étaient. Ils taillèrent rapidement dans la roche vive une
tranchée profonde de cinquante à soixante coudées, au bout de laquelle un
passage étranglé, semblable à une porte, donne accès dans le vallon. est-ce
sous Amenôthès 1er, est-ce sous Thoutmosis 1er que ce
travail gigantesque fut entrepris ? Thoutmosis 1er est le
plus ancien roi dont on ait retrouvé la sépulture en cet endroit. Son fils
Thoutmosis II, puis son petit-fils Thoutmosis III, vinrent s’y loger à ses
côtés, puis, à l’exemple des Pharaons de Au milieu de la faiblesse générale, Amon seul et ses prêtres avaient grandi. Depuis la lutte qu’ils avaient soutenue contre Khouniatonou, la suprématie d’Amon n’avait plus été contestée, et le dogme de l’unité divine, élaboré dans le sanctuaire de Karnak, avait prédominé au sud de l’Égypte. Les anciens textes furent interprétés dans le sens le plus favorable à ses prétentions, et souvent même interpolés de gloses destinées à mettre sa suprématie en évidence. Tout le système religieux d’autrefois fut adapté insensiblement aux idées nouvelles, et une cosmogonie habilement combinée montra le dieu unique à l’oeuvre sur les éléments. Au commencement était le Nou, l’Océan primordial, dans les profondeurs insondées duquel les germes des choses flottaient confondus. De toute éternité, le Dieu s’engendra et s’enfanta lui-même au sein de cette masse liquide, sans forme encore et sans usage. Ce Dieu des théologiens thébains était un être parfait, doué d’une science et d’une intelligence certaines, le un unique, celui qui existe par essence, le seul qui vive en substance, le seul générateur dans le ciel et sur la terre qui ne soit pas engendré ; le père des pères, la mère des mères. Toujours égal, toujours immuable dans son immuable perfection, toujours présent au passé comme à l’avenir, il remplit l’univers sans qu’image au monde puisse fournir même une faible idée de son immensité : on le sent partout, on ne le saisit nulle part. Unique en essence, il n’est pas unique en personne. Il est père par cela seul qu’il est, et la puissance de sa nature est telle, qu’il engendre éternellement sans jamais s’affaiblir ou s’épuiser. Il n’a pas besoin de sortir de lui-même pour devenir fécond ; il a en son propre sein la matière de sa création, il conçoit son fruit, et, comme chez lui la conception ne saurait être distinguée de l’enfantement, de toute éternité il produit en lui-même un autre lui-même. Il est à la fois le père, la mère et le fils de Dieu. Engendrées de Dieu, enfantées de Dieu, sans sortir de Dieu, ces trois personnes sont Dieu en Dieu, et, loin de diviser l’unité de la nature divine, elles concourent toutes trois à son infinie perfection. Ce Dieu triple et un a tous les attributs de Dieu, l’immensité, l’éternité, l’indépendance, la volonté souveraine, la bonté sans limites. Il développe éternellement ces qualités maîtresses, ou plutôt, pour me servir d’une expression chère aux écoles religieuses de l’ancienne Thèbes, il crée ses propres membres, qui sont les dieux[129], et qui s’associent à son action bienfaisante. Chacun de ces dieux seconds, considéré comme identique au Dieu un, peut former un type nouveau d’où émanent à leur tour, et par le même procédé, d’autres types inférieurs. De trinité en trinité, de personnification en personnification, on en arrive bientôt à ce nombre vraiment incroyable de divinités aux traits parfois grotesques et souvent monstrueux, qui descendent par degrés presque insensibles de l’ordre le plus élevé aux derniers étages de la nature. Néanmoins, les noms variés, les aspects innombrables que le vulgaire est tenté d’attribuer à autant d’êtres distincts et indépendants, n’étaient pour l’adorateur thébain que des noms et des aspects d’un même être. Tous les types divins se pénétraient réciproquement et s’absorbaient dans le dieu suprême : leur division, même poussée à l’infini, ne rompait en aucune manière l’unité de la substance divine. Ce dieu unique, Amon-Râ, est-il le soleil lui-même ou simplement l’âme du soleil ? La plupart convenaient qu’il était le soleil lui-même, et c’est au soleil que sont adressés les grands hymnes dont la littérature de l’époque des Ramessides nous a légué de si beaux modèles. Sa vie journalière, depuis le moment où il surgissait à l’horizon du matin jusqu’au moment où il sombrait derrière la montagne d’Occident, devint la vie du Dieu suprême, et sa lutte contre l’obscurité, la lutte du Dieu contre les mauvais principes. C’est lui : le voici qui se dégage lentement des étreintes de la nuit. Il ne fait que pointer à l’horizon oriental du ciel, et déjà les rayons vivants de ses yeux pénètrent, animent, fortifient tous les êtres. Debout dans la cabine de sa barque sacrée, la bonne barque des millions d’années, enveloppé dans les replis du serpent Mihni, qui est l’emblème de son cours, il glisse lentement sur le flux éternel des eaux célestes, guidé et suivi par cette armée de dieux secondaires dont les peintures nous enseignent les figures bizarres. Un Horus, debout à l’avant, sonde l’horizon du regard et signale l’ennemi, qu’il se tient prêt à percer de sa lance ; un autre Horus est au gouvernail. Les Akhimou-Ourdou, ceux qui jamais n’endurent l’inertie de la mort, et les Akhimou-Sokou, ceux qui jamais ne sont détruits, armés de longues rames, manoeuvrent la barque et la maintiennent au fil de l’eau : ils se recrutent sans cesse parmi les âmes des fidèles, et les rois des deux Égyptes eux-mêmes réclament comme un honneur d’être affiliés à leur troupe. Tu t’éveilles bienfaisant, Amon-Râ-Harmakhis ! tu t’éveilles juste de voix, Amon-Râ, seigneur des deux horizons ! Ô bienfaisant, resplendissant, flamboyant ! Ils rament tes nautoniers, ceux-là qui sont les Akhimou-Ourdou ! Ils te font avancer tes nautoniers, ceux-là qui sont les Akhimou-Sokou ! Tu sors, tu montes, tu culmines en bienfaiteur, guidant ta barque sur laquelle tu croises, par l’ordre souverain de ta mère Nouit[130], chaque jour ! Tu parcours le ciel d’en haut, et tes ennemis sont abattus ! Tu tournes ta face vers le couchant de la terre et du ciel : éprouvés sont tes os, souples tes membres, vivantes tes chairs, gonflées de sève tes veines, ton âme s’épanouit ! On adore ta forme Sainte, on te guide sur le chemin des ténèbres, et tu entends l’appel de ceux qui t’accompagnent derrière la cabine en poussant des exclamations. Les nautoniers de ta barque, leur coeur est content ; le seigneur du ciel est en joie ; les chefs du ciel inférieur sont en allégresse ; les dieux et les hommes poussent des exclamations et s’agenouillent devant le soleil sur son pavois, par l’ordre souverain de ta mère Nouit ; leur coeur est content parce que Râ a renversé ses ennemis ! Le ciel est en allégresse, la terre est en joie, les dieux et les hommes sont en fête, afin de rendre gloire à Râ-Harmakhis, lorsqu’ils le voient se lever dans sa barque et qu’il a renversé les ennemis à son heure ! La cabine est en sûreté, car le serpent Mihni est à sa place et l’uræus a détruit les ennemis. Avance sur ta mère Nouit, seigneur de l’éternité ! Après avoir récité pour toi les charmes de l’enfantement, elles se relèvent Isis et Nephtys, lorsque tu sors du sein de ta mère Nouit ! Lève-toi, Râ-Harmakhis ! Tu te lèves, et te levant, culminant, tu prononces ta parole contre tes adversaires. Tu fais ouvrir ta cabine, tu repousses le méchant en son heure, afin qu’il n’avance pas, l’espace d’un moment ! Tu as anéanti la valeur de l’impie : l’adversaire de Râ tombe dans le feu ; Nouhibo[131] est repoussé en ses heures ; les enfants de la rébellion n’ont plus de force ; Râ prévaut contre ses adversaires. Les obstinés de coeur tombent sous les coups ; tu fais vomir à l’impie ce qu’il avait dévoré. Lève-toi, Râ, dans l’intérieur de ta cabine : Fort est Râ ; faible, l’impie ! Haut est Râ ; foulé, l’impie ! Vivant est Râ ; mort, l’impie ! Grand est Râ ; petit, l’impie ! Rassasié est Râ ; affamé, l’impie ! Abreuvé est Râ ; altéré, l’impie ! Lumineux est Râ ; terne, l’impie ! Bon est Râ ; mauvais, l’impie ! Puissant est Râ ; faible, l’impie ! Râ existe ;
Apôp est anéanti ! Oh ! Râ ! donne toute
vie au Pharaon ! Donne des pains à son ventre, de l’eau à son gosier,
des parfums à sa chevelure ! Oh ! bienfaisant Râ-Harmakhis, navigue
avec lui, en prière ! Ceux qui sont dans ta barque sont en
exultation ; troublés, confondus, sont les impies ! Un bruit de joie est dans le lieu grand ; la cabine de la barque est en exultation. Ils poussent des exclamations dans la barque des millions d’années les nautoniers de Râ ; leur coeur est joyeux quand ils voient Râ. Les dieux sont en exultation ; le grand cycle divin est comblé de joie en rendant gloire à la grande bari ; des réjouissances se font dans la chapelle mystérieuse. Oh lève-toi, Amon-Râ-Harmakhis, qui se Crée lui-même ! Tes deux soeurs[132] sont debout à l’Orient, elles sont accueillies, elles sont portées vers ta barque, cette bonne barque de toute procréation. Râ, qui as émis tous les biens, viens, Râ qui se crée lui-même ! Fais que le Pharaon reçoive les offrandes qui se font dans Hâbonben[133], sur les autels du Dieu dont secret est le nom ! Honneur à toi, vieillard qui se manifeste en son heure, seigneur aux faces nombreuses. Uræus qui produit les rayons destructeurs des ténèbres ! Tous les chemins sont pleins de tes rayons. C’est à toi que les cynocéphales donnent les offrandes qui sont dans leurs mains, à toi qu’ils adressent leurs chants, dansant pour toi, faisant pour toi leurs incantations et leurs prières[134]. Ils sont appelés dans le ciel et sur la terre ; ils sont conduits à tes gracieux levers ; ils t’ouvrent (variante, ils brisent pour toi) les portes de l’horizon occidental du ciel ; ils font aller Râ dans la paix, dans l’exaltation de ta mère Nouit. Ton âme examine ceux qui sont dans le ciel inférieur, et les âmes sont dans le ravissement matin et soir. Car tu fais le fléau qui tue et tu adoucis la souffrance d’Osiris, tu donnes les souffles à qui est dans la vallée funéraire. Tu as illuminé la terre plongée dans les ténèbres ; tu adoucis la douleur d’Osiris. Ceux qui sont goûtent les souffles de la vie, ils poussent des exclamations vers toi, ils s’agenouillent devant cette forme qui est tienne de Seigneur des formes ! Ils rendent honneur à ta force dans cette figure bienfaisante qui est tienne de Dieu Matin ! Les dieux tendent leurs bras vers toi, lorsqu’ils sont enfantés par ta mère Nouit. Viens au Pharaon, donne-lui ses mérites dans le ciel, sa puissance sur la terre, ô Râ ! qui as réjoui le ciel, ô Râ ! qui as frappé la terre de crainte. Ô bienfaisant Râ-Harmakhis ![135] Tu as soulevé le ciel d’en haut
pour élever ton âme ; tu as voilé le ciel inférieur pour y cacher tes
formes funéraires ! Tu as élevé le ciel d’en haut à la longueur de tes bras ; tu as élargi la terre à l’écartement de tes enjambées. Tu as réjoui le ciel d’en haut par la grandeur de ton âme ; la terre te craint, grâce à l’oracle de ta statue. Épervier saint, à l’aile
fulgurante ; Phénix aux multiples couleurs ; Grand lion qui est par soi-même et qui ouvre les voies de la barque Soktit[136], Ton rugissement abat tes
adversaires, tandis que tu fais avancer la grande barque ; Les hommes t’invoquent, les dieux
te craignent ; tu as abattu les ennemis sur leurs faces. Coureur du ciel, qu’on ne peut
atteindre au matin de ses naissances, élevé plus que les dieux et les hommes. Lève-toi pour nous, nous ne
connaissons pas ton image ; apparais à notre face, nous ne connaissons
pas ton corps ; Ô bienfaisant Râ-Harmakhis ! Tu te rues, mâle sur les
femelles. Taureau la nuit, chef en plein jour, beau disque bleu[137], Roi du ciel, souverain sur terre,
la grande image dans les deux horizons du ciel, Râ - créateur des êtres,
Totounen, vivificateur des êtres intelligents. Que le fils du Soleil, le Pharaon, soit vénéré pour tes mérites ; qu’il soit adoré quand tu te lèves bienfaisant à l’horizon oriental du ciel. C’est lui qui dirige ta course, renverse tes ennemis devant toi, repousse tous tes adversaires, examine pour l’oeil[138] en son lieu[139] Cependant le Dieu passe, enveloppé de cette lumière éblouissante qui ne permet pas à l’oeil humain de sonder les profondeurs de son être : Ô Dieu qui t’es ouvert les voies,
ô toi qui as percé à travers les murailles ! Oh ! Dieu qui se lève
en qualité de soleil ! Être qui devient sous la forme de Khopri dans le
double horizon ! Tu as éveillé ceux qui te font parcourir les chemins du
ciel ; approche-toi du Grand Chef pour faire le plan du temps durant le
cours de l’éternité ! Enfant qui nais chaque jour, Vieillard enfermé dans les bornes
du temps, Vieillard qui parcours l’éternité ! Si immobile, qu’il ouvre toutes
ses faces, Si élevé qu’on ne peut l’atteindre! Seigneur de la demeure
mystérieuse où il se tient caché. Être caché dont on ne connaît
point l’image ! Seigneur des années, qui donne la
vie à qui lui a plu ! ……………………….. Tu es venu, tu as ouvert les chemins, tu as parcouru les voies de l’éternité[140]. C’est ainsi, au milieu des acclamations et des prières, qu’il poursuit sa marche radieuse, jusqu’au moment où, poussé toujours par le courant irrésistible, il plonge à l’occident et s’éclipse pour un temps dans la nuit du ciel inférieur. Les pouvoirs malfaisants vaincus et contenus, l’oeuvre du Dieu n’est pas encore complète. Il a créé le sol, l’argent, l’or, - le lapis vrai à son bon plaisir[141]. - Il fait les herbages pour les bestiaux, les plantes dont se nourrissent les humains. - Il fait vivants le poisson dans le fleuve, - les oiseaux dans le ciel, - donnant les souffles à ceux qui sont dans un oeuf. - Il vivifie les reptiles, - fait ce dont vivent les oiseaux ; - reptiles et oiseaux sont égaux à ses yeux. - Il fait des provisions au rat dans son trou, - et nourrit l’oiseau sur la branche. - Sois béni pour tout cela, - Un unique, multiple de bras[142]. Enfin les hommes sortent de ses deux yeux[143], et se répandent à la surface de la terre, troupeau de Râ, divisé en quatre races, les Égyptiens, les hommes par excellence, et les Nègres (Nahsi) qui sont sous le patronage d’Horus, les Asiatiques (Amou) et les peuples du nord, à peau blanche, sur lesquels Sokhit, la déesse à tête de lionne, étend sa protection[144]. Salut à toi ! disent-ils tous, - louange à toi, parce que tu demeures parmi nous ! - Prosternations devant toi, parce que tu nous crées ! - Tu es béni de toutes créatures ; - tu as des adorateurs en toute région, - au plus haut des cieux, dans toute la largeur de la terre - au profond des mers. - Les dieux s’inclinent devant ta Sainteté ; - les âmes exaltent qui les a créées, - elles se réjouissent de se présenter devant leur générateur, - elles te disent : Va en paix, - père des pères de tous les dieux, - qui as suspendu le ciel, - étendu la terre ; - créateur des êtres, formateur des choses, - roi souverain, v. s. f., chef des dieux, - nous adorons tes esprits, parce que tu nous as faits ; - nous te faisons des offrandes, parce que tu nous as donné naissance ; - nous te faisons des bénédictions, parce que tu demeures parmi nous[145]. Ces idées élevées demeurèrent l’apanage d’un petit nombre de docteurs et de particuliers instruits : elles ne pénétrèrent pas la masse de la population. Loin de là, le culte des animaux, l’oie, l’hirondelle, le chat, le serpent, y recrutait plus de dévots qu’il n’en avait jamais eu[146] ; la croyance aux mauvais esprits et aux revenants était universelle[147] à la magie était pratiquée ouvertement, malgré les ordonnances les plus sévères[148]. Dans une société aussi religieuse que l’était la société égyptienne, l’influence du prêtre devait avoir rapidement le dessus sur toute autorité et même sur la puissance royale. Déjà, aux plus beaux temps de la dix-huitième dynastie, les Pharaons n’avaient rien entrepris avant de consulter dûment Amon, et toujours il avait daigné répondre à leur voix. Sous les Ramessides, il intervint dans les affaires publiques d’une façon de plus en plus directe et constante. D’après la théorie sacerdotale, les statues divines se composaient d’un corps en pierre, en métal ou en bois, et d’un double ou d’une âme détachée de la divinité, et que l’on enfermait dans le corps par des prières à l’instant de la consécration. Le roi, dans le sanctuaire, parfois même au dehors, s’adressait à ces figures animées et il leur expliquait les questions du moment : après chaque consultation royale, l’idole, Si elle goûtait la résolut ion suggérée, marquait son approbation par une lourde saccade de la tête[149]. On conçoit quelle suprématie exerçaient dans l’État le sacerdoce d’Amon et surtout le Premier Prophète, interprète légal du dieu : Ramsès III était mort depuis quelques années à peine, et déjà le Premier Prophète Ramsèsnakhouitou était sans rival auprès de Ramsès IV[150]. Le fils de Ramsèsnakhouitou, Amenôthès, était presque l’égal des Ramsès suivants, et il consacrait des monuments en son nom, comme s’il eût été déjà souverain[151]. Et il ne suffisait pas à leur ambition d’avoir lait d’Amon lui-même un instrument de domination. Amon, le maître des dieux, était trop éloigné de l’humanité pour entrer aisément en communication avec le vulgaire : on introduisit comme médiateur entre lui et l’homme le troisième membre de la triade, Khonsou. Ramsès III avait commencé la restauration du temple de ce dieu à quelque cent mètres au sud du sanctuaire de Karnak ses successeurs continuèrent le travail avec amour, et les prêtres, désireux d’avoir pour leur divinité favorite des titres de noblesse antique, ne craignirent pas de forger des pièces officielles constatant des miracles qu’il aurait opérés jadis. Ils fabriquèrent une grande stèle où ils racontaient que Ramsès II, après avoir reçu comme otage la fille d’un chef syrien, l’épousa et en fit sa première femme. Quelques années plus tard, la soeur de cette reine, Bintroshit, fut atteinte d’une maladie qu’on attribua à la malice d’un esprit possesseur, et dont Thotemhabi, chef des magiciens royaux, ne réussit pas à la guérir. Après de longues souffrances, le père de la princesse réclama un secours plus efficace. Ramsès II se prosterna devant Khonsou, le supplia d’intervenir, et fit porter devant la statue principale une seconde statue du dieu : Inspire-lui ta vertu divine et je l’enverrai pour qu’elle guérisse la fille du prince de Bahktan. Khonsou y consentit, et la statue partît pour Bakhtan, où elle arriva après un voyage solennel d’un an et cinq mois. Le prince sortit à sa rencontre avec ses soldats et ses généraux, et s’étant prosterné : Tu viens donc vers nous, tu descends chez nous par les ordres du roi d’Égypte, le soleil seigneur de justice, approuvé du dieu Râ. Voici que ce dieu se rendit chez Binstroshit ; lui ayant infusé sa vertu, elle fut soulagée à l’instant. L’esprit qui demeurait en elle dit, en présence de Khonsou, le conseiller de Thèbes Sois le bienvenu, grand dieu qui expulses les rebelles ; la ville de Bakhtan est à toi, ses peuples sont tes esclaves, moi-même je suis ton esclave. Je m’en retournerai vers les lieux d’où je suis venu, pour satisfaire ton coeur sur le sujet de ton voyage. Que Ta Majesté veuille ordonner seulement qu’une fête soit célébrée en mon honneur par le prince de Bakhtan ! Le Dieu daigna dire à son prophète : Il faut que le prince de Bakhtan apporte une riche offrande à cet esprit. Pendant que ces choses s’accomplissaient et que Khonsou, le conseiller de Thèbes conversait avec l’esprit, le prince de Bakhtan était là avec son armée, saisi d’une crainte profonde. Il prodigua les présents à Khonsou, le conseiller de Thèbes, ainsi qu’à l’esprit et il improvisa une fête en leur honneur ; après quoi l’esprit s’en alla paisiblement où il voulut, sur l’ordre de Khonsou, le conseiller de Thèbes. Le prince fut transporté de joie, ainsi que toute la population de Bakhtan ; puis il se dit en lui-même : Il faudrait que ce dieu pût séjourner à Bakhtan ; je ne le laisserai pas retourner en Égypte. Il y avait trois ans et neuf mois que le dieu Khonsou demeurait à Bakhtan, lorsque le prince, reposant sur son lit, crut le voir quitter son naos ; il avait la forme de l’épervier d’or et il planait au ciel dans la direction de l’Égypte. Le prince, s’étant éveillé, se trouva souffrant : il dit alors au prêtre de Khonsou, conseiller de Thèbes : Le dieu veut nous quitter et retourner en Égypte : faites partir son char pour ce pays. Khonsou rentra dans son temple de Thèbes chargé de présents[152]. Sous Ramsès XI, ces divers moyens avaient déjà produit
leur effet. Le roi était bien encore un Ramesside, mais le véritable maître
de l’Égypte était le Premier Prophète d’Amon thébain, Hrihorou. Vice-roi d’Éthiopie
après Pinahsi, fils de Ramsès XI, général en chef des troupes nationales et
étrangères[153],
Hrihorou avait tout du Pharaon, sauf la couronne et le protocole : sa
mère était d’ailleurs de sang royal et lui avait légué des droits à la couronne[154], qu’il fit
valoir aussitôt après la mort de Ramsès XI. Il semble que ce prince ne laissa
point d’héritier direct, car deux rivaux surgirent au Sud et au Nord pour
recueillir son héritage. Au Sud, Hrihorou se déclara souverain des deux pays,
et il adopta comme prénom le titre même de sa dignité, Premier Prophète d’Amon.
Au Nord, un Tanite du nom de Smendès se proclama roi, et, reconnu d’abord
dans le Delta ainsi que dans |