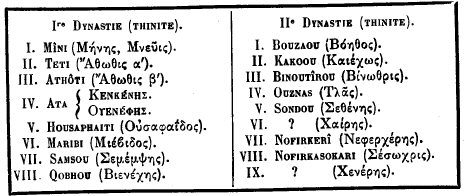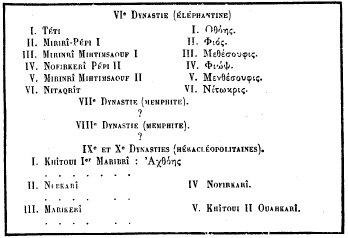HISTOIRE ANCIENNE DES PEUPLES DE L'ORIENT
L'ÉGYPTE JUSQU’A L’INVASION DES PASTEURS
CHAPITRE II : EMPIRE MEMPHITE - DE LA TROISIÈME A LA DIXIÈME DYNASTIE
(ANCIEN EMPIRE).
Les tombes memphites : la quatrième et la cinquième dynastie.La troisième dynastie était memphite, mais malgré cette origine elle dut au début ne faire autre chose que continuer la tradition des dynasties thinites. Les historiens de l'époque classique n'avaient donc conservé d'elle que des légendes analogues à celles que nous possédons sur les deux dynasties précédentes[1]. Le règne du premier de ses Pharaons fut marqué, nous dit-on, par des désordres sérieux. Les Libyens, tributaires depuis Ménès, se révoltèrent contre le roi Nékhérôphès et menacèrent l'intégrité de l'empire. Au moment décisif, la superstition vint en aide aux Égyptiens. Une nuit, tandis que les deux armées étaient en présence, le disque de la lune sembla s'accroître démesurément, au grand effroi des ennemis, qui prirent ce phénomène pour un signe de la colère céleste et qui se soumirent sans combat[2]. La paix ne fut plus troublée de longtemps, et sa durée favorisa le développement des sciences et des arts. Le successeur de Néchérôphès, Tosorthros, perfectionna l'écriture et la taille des blocs de pierre. Médecin comme Têti, il aurait composé des traités qui existaient encore aux premiers siècles de l'ère chrétienne : aussi les Grecs l'avaient-ils identifié avec leur dieu Asclépios, l'Imhotpou des Égyptiens[3]. Sous l'influence de ce roi et de ses descendants, la richesse du pays s'accrut, les monuments se multiplièrent ; par malheur, l’habitude qu'ils conservaient de se faire désigner officiellement par leurs noms d'Horus ne nous permet pas encore de déterminer quel est celui d'entre eux qui édifia un temple à Hieracônpolis en face d'El-Kab[4]. Encore quelques règnes, et les tombeaux vont nous livrer une telle masse de documents originaux que nous pourrons reconstituer d'une manière certaine, non seulement l'histoire des souverains, mais la vie des simples particuliers. Une lieue environ à l'ouest de Memphis, la chaîne Libyque se déploie en un vaste plateau, qui court, dans la même direction que le Nil, sur mie longueur de plusieurs lieues. A l'extrémité septentrionale, un prince demeuré inconnu, mais qu'il faut peut-être reporter jusqu'aux siècles antérieurs à Ménès, avait taillé en plein roc un sphinx gigantesque, symbole d'Harmakhis, le soleil levant. Plus tard un temple d'albâtre et de granit, le seul spécimen que nous possédions de l'architecture monumentale de l'Ancien Empire, fut construit à quelque distance de l'image du dieu; d'autres temples, aujourd'hui détruits, s'élevèrent çà et là et firent du plateau entier comme un vaste sanctuaire consacré aux divinités funéraires. Les habitants de Memphis vinrent y déposer leurs morts à l'abri de l'inondation. Les gens du vulgaire étaient enterrés dans le sable à un mètre de profondeur, le plus souvent nus et sans cercueils. D'autres étaient ensevelis dans de petites chambres rectangulaires, grossièrement bâties en briques jaunes, le tout surmonté d'un plafond en voûte, d'ordinaire ogivale. Aucun ornement, aucun objet précieux ne les accompagnait au tombeau : seulement des vases en poterie étaient placés à côté du cadavre et renfermaient les provisions qu'on lui assignait pour l'autre vie[5]. Les tombes monumentales sont, à proprement parler, la demeure du double. Lorsqu'elles sont complètes, elles se divisent en trois parties une chapelle extérieure, un puits et des caveaux souterrains. La chapelle est une construction quadrangulaire qu'on prendrait de loin pour une pyramide tronquée. Les faces, bâties en pierres ou en briques, sont symétriquement inclinées et le plus souvent unies : parfois cependant les assises sont en retrait l'une sur l'autre et forment presque gradins. La porte, qui s'ouvre d'ordinaire dans la paroi de l'est, est tantôt surmontée simplement d'un tambour cylindrique, tantôt ornée sur les côtés de bas-reliefs représentant l'image en pied du défunt, et couronnée par une large dalle couverte d'une inscription en lignes horizontales. C'est une prière et l'indication des jours consacrés au culte des ancêtres. Proscynème fait à Anubis, résidant dans le palais divin, pour que soit donnée une sépulture dans l'Amentit, la contrée de l'ouest, la très grande et très bonne, au féal selon le Dieu grand pour qu'il marche sur les voies où il est bon de marcher, le féal selon le dieu grand, pour qu'il ait des offrandes en pains, farines et liqueurs, à la fête du commencement de l'année, à la fête de Thot, au premier jour de l'an, à la fête de Ouagaît, à la grande fête du feu, à la procession du dieu Minou, à la fête des offrandes, aux fêtes du mois et du demi-mois, et chaque jour. D'habitude, l'intérieur de la chapelle ne renferme qu'une seule chambre. Au fond, à la place d'honneur, se dresse une stèle quadrangulaire de proportions colossales, au pied de laquelle on aperçoit une table d'offrandes en albâtre, granit ou pierre calcaire, posée à plat sur le sol, et quelquefois deux obélisques minuscules ou deux autels, évidés au sommet pour recevoir les dons en pains sacrés, en liqueurs et en victuailles dont il est parlé dans l'inscription extérieure. L'aspect de la stèle est celui d'une porte un peu étroite, un peu basse, dont la baie serait toujours close. L'inscription gravée sur le linteau nous apprend le nom du maître du tombeau. Les figures taillées dans les montants sont ses portraits et ceux des personnes de sa famille. La petite scène du fond le montre assis devant sa table, et l'on a poussé le soin jusqu'à graver auprès de lui le menu de son repas. La stèle était à proprement parler la façade extérieure de la maison éternelle où chacun allait s'enfermer à son tour. Rien d'étonnant qu'on l'ait faite à la semblance d'une porte : si la porte est fermée, c'est que nul ne devait pénétrer dans le caveau, ni voir te sarcophage, passé le jour de l'enterrement. La formule qu'on y inscrivait n'était pas seulement une épitaphe destinée à rappeler aux générations futures que tel ou telle avait existé jadis ; elle préservait le nom et la filiation de chacun, et elle attribuait au mort un état civil, sans lequel il n'aurait pas eu de personnalité dans sa vie nouvelle : un mort sans nom aurait été comme s'il n'existait pas. Ce n'était là toutefois que la moindre vertu de la stèle : la prière et les figures qui y étaient tracées avaient pour effet d'assurer des moyens d'existence au personnage auquel elle était consacrée. Comme les vivants ne sont pas en communication directe avec les morts et ne peuvent leur transmettre les offrandes de la main à la main, ils élisent un dieu pour intermédiaire et ils lui dédient le sacrifice, à la condition qu'il prélèvera la part de son féal sur toutes les bonnes choses qu'on lui voue et dont il vit. L'être invoqué est presque toujours le chacal Anubis ou le Dieu grand, c'est-à-dire Osiris. L'âme ou plutôt le double du pain, des boissons, de la viande, se rendait de la sorte dans l'autre monde et il y nourrissait le double de l'homme. Il n'y avait même pas besoin que cette offrande fût réelle pour être effective le premier venu, répétant avec la voix juste la formule de l'offrande, procurait par cela seul au double la possession de tous les objets dont il récitait l'énumération. Dans bien des cas, la stèle seule était gravée ; souvent aussi, les parois de la chambre étaient décorées de tableaux et de scènes sculptés avec soin. Un seul de ces tableaux a une signification funéraire bien marquée et représente la façon dont le mort exécutait son voyage d'outre-tombe. Les Égyptiens pensaient, comme la plupart des peuples, que le passage de cette terre-ci à l'autre terre ne peut pas s'opérer indifféremment à tous les endroits. Le point exact d'où leurs âmes partaient pour entrer dans le monde surnaturel se trouvait à l'ouest d'Abydos, et c'était une fente de la montagne. La barque du soleil, le soir, arrivée au terme de sa course diurne, se glissait avec son cortège de dieux par la bouche de la fente et pénétrait dans la nuit. Les âmes s'y insinuaient avec elle sous la protection d'Osiris. Il fallait donc qu'elles se rendissent à Abydos de tous les points de l'Égypte, et l'on supposait qu'elles faisaient le voyage par eau. Cette expédition est fréquemment représentée sur les peintures des tombeaux. D'ordinaire, le mort, habillé de ses vêtements civils, commande la manoeuvre comme s'il eût été encore en vie. D'autres fois, il était enfermé dans un catafalque entouré de pleureuses et de prêtres. Des canots et des chalands chargés d'offrandes escortent les barques principales. Les gens de l'équipage poussent des cris de bon augure : En paix, en paix, auprès d'Osiris ! ou causent et se disputent entre eux. On serait tenté de croire qu'il s'agit d'une véritable traversée, et les Grecs se sont laissé tromper aux apparences. Ils racontaient que les plus considérés et les plus riches des Égyptiens se font enterrer dans Abydos parce qu'ils estiment à honneur de reposer auprès d'Osiris. En fait, les personnages des tableaux d'hypogées ne vont pas réellement à Abydos. Ils reposent à Memphis, à Béni-Hassan, à Thèbes ou dans telle autre ville : leur âme seule partait en excursion après la mort[6]. Toutes les autres scènes nous font assister à la préparation et au transport des offrandes funéraires. De leur vivant, les grands seigneurs passaient avec les prêtres de véritables contrats, par lesquels ils donnaient à tel ou tel temple des terres et des revenus en échange de sacrifices aux époques réglées par la coutume. Ces terres constituaient les biens du tombeau et elles fournissaient les viandes, les légumes, les fruits, le linge, tout ce qu'il faut pour monter et pour entretenir une maison[7]. Les bas-reliefs sculptés sur les murs représentent donc les épisodes les plus notables de la vie agricole, industrielle et domestique. D'un côté, c'est le labourage, le semage, la récolte, la rentrée des blés, l'emmagasinement des grains, puis l'élevage des bestiaux, l'empâtement des volailles. Un peu plus loin, des escouades d'ouvriers vaquent chacun aux travaux de son métier : des cordonniers, des verriers, des fondeurs, des menuisiers sont rangés et groupés à la file ; des charpentiers abattent des arbres et mettent une barque en chantier ; des femmes tissent au métier, sous la surveillance d'un contremaître renfrogné qui paraît peu disposé à souffrir leur babil. Tout cela est accompagné de légendes explicatives où les paroles des personnages en scène sont reproduites. Tiens bon ; saisis fortement, commande à son aide le boucher prêt à tuer un bœuf. C'est prêt, agis à ton bon plaisir, lui répond celui-ci. Un batelier de bonne humeur crie de loin à un vieillard qui pêche sur la rive : Viens sur l'eau ; et le vieillard : Allons, pas tant de paroles, lui dit-il[8]. Scènes et légendes avaient une intention magique : qu'elles se référassent à la vie civile ou à l'enfer, elles devaient assurer au mort une existence heureuse ou le préserver des dangers d'outre-tombe. De même que la répétition de la formule des stèles : Proscynème à Osiris pour qu'il donne un revenu de pains, liqueurs, vêtements, provisions, au défunt procurait à ce défunt, sans offrande réelle, la jouissance des biens énumérés, de même la reproduction de certains actes sur les parois de la tombe lui en garantissait l'accomplissement véritable. Le double, retiré au fond de sa chapelle, se voyait sur la muraille allant à la chasse, et il allait à la chasse, mangeant et buvant avec sa femme, et il mangeait et buvait avec sa femme ; le labourage, la moisson, la grangée des parois se faisaient pour lui labourage, moisson et grangée réels. Les gens de toute sorte peints dans les registres cousaient des souliers et cuisinaient à son intention, le guidaient à la chasse dans le désert ou à la pêche dans les fourrés de papyrus. Après tout, ce monde de vassaux plaqué sur le mur n'était pas moins réel que le double dont il dépendait : la peinture d'un serviteur était bien ce qu'il fallait à l'ombre d'un maître. L'Égyptien croyait, en remplissant sa tombe de figures au travail, qu'il prolongeait au delà de la vie terrestre la jouissance de tous les objets qu'elles y fabriquaient et de toutes les richesses qu'elles lui apportaient[9]. C'est dans cette chambre ainsi ornée que les descendants du mort et les prêtres attachés à son culte se réunissaient aux jours indiqués afin de rendre hommage à l'ancêtre. Ils le revoyaient là tel qu'il avait été durant son existence, escorté de ses serviteurs et entouré de ce qui avait fait la joie de sa vie terrestre, partout présent et polir ainsi dire palpitant au milieu d'eux. Ils savaient que, derrière l'une des parois, dans un étroit réduit, dans un serdab ménagé au milieu de la maçonnerie, ses statues étaient entassées pêle-mêle. D'ordinaire, ce serdab ne communiquait pas avec la chambre et il restait perdu dans son mur ; quelquefois, il était relié avec le dehors par une sorte de conduit si resserré qu'on a peine à y glisser là main. A jours fixes, les parents venaient murmurer des prières et brûler des parfums à l'orifice[10] : c'était bien leur mort lui-même qui les recevait par là. En effet, pour persister dans l'autre monde, le double exigeait un corps tangible. La chair sur laquelle il s'était appuyé pendant l'existence terrestre lui servait encore de support principal, et c'est pour cela sans doute qu'on essayait d'en retarder la destruction par les pratiques de l'embaumement. Mais la momie défigurée ne rappelait plus que de loin l'aspect du vivant. Elle était, d'ailleurs, unique et facile à détruire : on pouvait la brûler, la démembrer, en disperser les morceaux. Elle disparue, que serait devenu le double ? On adjoignait pour suppléants au corps de chair des corps de pierre ou de bois qui reproduisaient exactement ses traits, des statues. Les statues étaient plus solides, et rien n'empêchait qu'on les fabriquât en la quantité qu'on voulait. Un seul corps était une seule chance de durée pour le double : vingt statues lui ajoutaient vingt chances. De là ce nombre vraiment étonnant de statues qu'on rencontre quelquefois dans une seule tombe. La prévoyance du mort et la piété des parents prodiguaient les images du corps terrestre, et par suite les supports, les corps impérissables du double, lui conférant par cela seul une presque immortalité. La même raison multipliait parfois, autour des statues du mort, les statues de ses serviteurs, immobilisés dans différents actes de domesticité, pétrissant la pâte, broyant le grain, poissant les jarres destinées à contenir le vin. On comprend quel caractère particulier cette conception de la vie de l'âme imprima à l'art égyptien. La première condition à remplir pour que le double pût s'adapter à son soutien de pierre, c'est que celui-ci reflétât jusque dans leurs moindres détails les traits et les portions du corps de chair. De là ce caractère réaliste et idéal à la fois qu'on remarque dans les statues. Le corps et la pose sont idéalisés presque toujours. Il est rare en effet qu'on observe un buste émacié de vieillard, le sein flétri et le ventre gonflé des femmes sur le retour : les hommes sont toujours, ou des adolescents aux membres élancés, ou des hommes faits dans la force de l'âge ; les femmes ont toujours le sein ferme et les hanches minces de la jeune fille. Le corps est, pour ainsi dire, un corps moyen, qui montre le personnage au meilleur de son développement, et qui le rend capable d'exercer dans l'autre monde la plénitude de ses fonctions physiques. C'est seulement dans le cas d'une difformité par trop accentuée, que l'artiste se départ de cet idéal : il laisse à la statue d'un nain toutes les laideurs du corps du nain. Il fallait bien qu'il en fût ainsi : si l'on avait placé dans l'hypogée d'un nain la statue d'un homme normal, le double, habitué ici-bas aux irrégularités de ses membres, n'aurait pu se plier à ce corps régulier et il n'aurait pas été dans les conditions nécessaires pour se plaire au monde des tombeaux[11]. Mais, une fois admise cette manière d'idéaliser ses modèles, le sculpteur devait traduire avec fidélité les traits de leur visage et les particularités de leur démarche. Il le faisait parfois avec brutalité, le plus souvent avec une fidélité naïve. Les statues sont de véritables portraits, et nous permettent de reconstituer la population de l'Égypte aux premières dynasties avec plus de facilité que nous ne reconstituons la population de l'Italie aux premiers temps de l'empire romain. Les poses sont celles de la classe à laquelle appartient l'original : la statue est accroupie, s'il s'agit d'un scribe ; debout dans l'attitude de commandement ou assise sur le siège d'apparat, s’il s'agit d'un roi ou d'un noble qui attend les offrandes de ses vassaux[12]. Le puits qui descend au caveau s’ouvre quelquefois dans un coin de la chambre ; mais souvent, pour en découvrir la bouche, il faut monter sur la plate-forme de la chapelle extérieure. Il est carré ou rectangulaire, bâti en grandes et belles pierres jusqu'à l'endroit où il s'enfonce dans le roc. Sa profondeur moyenne est de douze à quinze mètres, mais il peut aller jusqu'à trente et au delà. Au fond et dans la paroi du sud, se creuse un couloir où l'on ne pénètre que courbé et qui mène à la chambre funéraire proprement dite. Elle est taillée dans la pierre vive et dépourvue d'ornements au milieu s'allonge un grand sarcophage en calcaire fin, en granit rose ou en basalte noir, gravé quelquefois aux noms et titres du défunt. Après avoir scellé le corps, les ouvriers déposaient sur le sol les quartiers d'un boeuf qu'on venait de sacrifier dans la chambre du haut, de la vaisselle avec des fruits ou des légumes, des amphores de vin, des vases en poterie rouge pleins d'eau bourbeuse ; puis ils muraient avec soin l'entrée du couloir et ils remplissaient le puits jusqu'au sommet d'éclats de pierre mêlés de sable et de terre. Le tout, largement arrosé, finissait par constituer un ciment presque impénétrable dont la dureté mettait le mort à l'abri de toute profanation[13]. Ces tombes, véritables monuments dont l'aspect faisait dire aux Grecs qu'elles étaient les demeures éternelles des Égyptiens, auprès desquelles leurs palais ne paraissaient que des hôtelleries, formaient plusieurs villes funéraires plus étendues que la ville des vivants. A Gizeh, elles sont disposées sur un plan symétrique et rangées le long de véritables rues ; à Saqqarah, elles sont semées en désordre à la surface du plateau, espacées dans certains endroits, entassées pêle-mêle dans certains autres. Au plus pressé de leur foule, on rencontre des pyramides isolées ou assemblées en groupes inégaux[14]. Les unes ont sept à huit mètres de haut et dépassent à peine le niveau des tombes voisines ; les autres atteignent jusqu à cent cinquante mètres et comptent encore aujourd'hui parmi les masses les plus considérables que la main de l'homme ait jamais édifiées. Ce sont des tombes royales. Pour les préparer chaque Pharaon avait découpé le roc et remué la terre dès le début de son règne ; les personnages les plus importants de son entourage avaient parcouru le royaume à la recherche d'un bloc d'albâtre ou de granit digne de faire le sarcophage d'un roi ; la population de villes et de provinces entières avait été envoyée aux carrières et aux chantiers de construction. Un temple était joint à chaque pyramide, où le monarque défunt recevait les offrandes de ses sujets et les hommages d'un collège de prêtres attaché spécialement à son culte. En ce temps-là, voici que la majesté du roi Houni mourut, et que la majesté du roi Snofroui s'éleva en qualité de roi bienfaisant dans ce pays tout entier[15]. Snofroui, le Sôris de Manéthon[16], fit la guerre aux tribus nomades (Monatiou) qui harcelaient sans cesse la frontière orientale du Delta, et pénétra jusqu'au fond de la péninsule du Sinaï. Un bas-relief de l'Ouadi-Magharah, trophée de sa campagne, nous montre le roi des deux Égyptes, le seigneur des diadèmes, le maître de justice, l'Horus vainqueur, Snofroui, le dieu grand, écrasant de sa masse d'armes un barbare terrassé devant lui[17]. Il exploita à son profit les mines de cuivre et de turquoises du Sinaï ; et, afin de mettre désormais le Delta à l'abri des incursions, il garnit la frontière d'une série de forteresses, dont une au moins, Shè-Snofroui[18], existait encore sous les premiers rois de la douzième dynastie[19]. Sa religion, établie immédiatement après sa mort, se perpétua à travers les siècles et dura jusque sous les Ptolémées[20]. Mais son renom, si grand qu'il fût aux bords du Nil, s'efface devant celui de ses trois successeurs, Khoufoui (Kheops), Khâfrî (Khephren) et Menkaourî (Mykérinos), les constructeurs des pyramides. Kheops bâtit le vaste monument de sa gloire ou de sa folie dans un siècle si éloigné du temps où commencent les données certaines de l'histoire profane, que nous n'avons pas de mesure qui nous permette d'évaluer la largeur de l'abîme qui sépare les deux époques ; si étranger à toutes les sympathies et à tous les intérêts de la grande famille humaine qui peuple maintenant la terre, que même l'histoire sacrée ne sait rien des hommes de la génération de Kheops, rien, si ce n'est qu'ils vécurent, devinrent pères et moururent. Et pourtant, la pyramide de Kheops domine encore de haut le sable du désert : la blancheur sépulcrale de ses blocs de nummulite flamboie encore au soleil brûlant, son ombre immense s'allonge à travers les plaines stériles qui l'entourent et sur le déclin du jour vient assombrir les champs de maïs et de froment de Gizeh. Quand le spectateur, placé sur quelque point favorable, arrive à se faire une idée distincte de l'immensité du monument, aucune parole ne peut décrire le sentiment d'écrasement qui s'abat sur son esprit. Il se sent oppressé et chancelle comme sous un fardeau. Au contraire de bien d'autres grandes ruines, les pyramides, de quelque point qu'on les regarde, ne deviennent jamais des amas de débris ou des montagnes. Elles restent l'oeuvre des mains humaines. La marque de leur origine apparaît et ressort toujours ; et c'est de là sans doute que vient ce confus sentiment de crainte et de respect qui bouleverse l'esprit lorsqu'il reçoit pour la première fois l'impression distincte de leur immensité[21]. Ce qu'il fallut d'efforts pour élever ces masses gigantesques, le simple aspect des lieux nous le laisserait deviner, quand même l'histoire ne serait pas là pour nous le dire. Lorsque le règne de Kheops et de Khephren fut bien passé, longtemps après que les Pharaons de l'Ancien Empire et leurs sujets se furent perdus dans la nuit des âges, le souvenir des foules qu'avait coûtées l'érection des pyramides hanta l'esprit du peuple égyptien. Au temps d'Hérodote et de Diodore, Kheops avait acquis la réputation d'un tyran odieux. Il commença par fermer les temples et par détendre qu'on offrit des sacrifices ; puis il contraignit tous les Égyptiens à travailler pour lui. Aux uns, on assigna la tâche de traîner les blocs des carrières de la chaîne Arabique jusqu'au Nil ; les blocs une fois passés en barque, il prescrivit aux autres de les traîner jusqu'à la chaîne Libyque. Ils travaillaient par cent mille hommes, qu'on relevait chaque trimestre. Le temps que souffrit le peuple se répartit de la sorte : dix années pour construire la chaussée sur laquelle on tirait les blocs, oeuvre, à mon sembler, de fort peu inférieure à la pyramide (car sa longueur est de cinq stades, sa largeur de dix orgyies et sa plus grande hauteur de huit, le tout en pierres de taille et couvert de figures) ; on mit donc dix années à construire cette chaussée et les chambres souterraines creusées dans la colline où se dressent les pyramides… Quant à la pyramide elle-même, on mit vingt ans à la faire ; elle est quadrangulaire, et chacune de ses faces a huit plèthres de base, avec une hauteur égale ; le tout en blocs polis et parfaitement ajustés : aucun des blocs n'a moins de trente pieds[22]. – Les caractères égyptiens gravés sur la pyramide marquent la valeur des sommes dépensées en raves, oignons et aulx pour les ouvriers employés aux travaux ; si j'ai bon souvenir, l'interprète qui me déchiffrait l'inscription m'a dit que le total montait à seize cents talents d'argent. S'il en est ainsi, combien doit-on avoir dépensé en fer pour les outils, en vivres et en vêtements pour les ouvriers, puisqu'il a fallu pour bâtir tout le temps que j'ai dit, et le temps non moins considérable, ce me semble, qu'ont exigé la taille des pierres, leur transport et les excavations souterraines ?[23] La tradition conservée par Hérodote allait plus loin encore. Elle représentait Kheops, à bout de ressources et réduit à faire argent de tout, vendant sa fille à tout venant[24]. Une autre légende, recueillie par Manéthon, est moins cruelle pour le pauvre Pharaon : sur ses vieux jours, il se serait repenti de son impiété et il aurait écrit un livre sacré tenu en grande estime par ses concitoyens[25]. Les Egyptiens me dirent que ce Kheops régna cinquante ans et qu'après sa mort son frère Khephren hérita de la royauté. Khephren en usa de même que son frère en toutes choses et construisit une pyramide qui n'atteint pas aux dimensions de la première, car nous l'avons mesurée nous-mêmes… Les deux sont sur une colline haute d'environ cent pieds. On dit que Khephren régna cinquante-six ans. On compte donc cent six ans pendant lesquels les Égyptiens souffrirent toutes sortes de malheurs, et les temples furent fermés sans qu'on les ouvrit une seule fois. Par haine, les Égyptiens évitent de nommer ces princes ; ils vont jusqu'à donner aux pyramides le nom du berger Philitis, qui paissait alors ses troupeaux dans ces parages[26]. D'après la tradition, ni Kheops ni Khephren ne jouirent des tombeaux qu'ils s'étaient préparés au prix de tant de souffrances : le peuple exaspéré se révolta, arracha leurs corps des sarcophages et les mit en pièces[27]. A côté de ces deux tyrans, la tradition place un monarque débonnaire, Mykérinos, fils de Kheops, et constructeur de la troisième pyramide. Les actions de son père ne lui furent pas agréables : il rouvrit les temples et renvoya aux cérémonies religieuses et aux affaires le peuple réduit à l'extrême misère ; enfin il rendit la justice plus équitablement que tous les autres rois. Là-dessus on le loue plus que tous ceux qui ont jamais régné sur l'Égypte ; car non seulement il rendait bonne justice, mais à qui se plaignait de son arrêt il faisait quelque présent pour apaiser sa colère[28]. Ce pieux roi eut pourtant grandement à souffrir : il perdit sa fille unique, et peu de temps après, il connut par un oracle qu'il n'avait plus que six ans à vivre. Pour se consoler, il enferma le cadavre de son enfant dans une génisse de bois creux, qu'il déposa dans Saïs et à qui l'on rendit les honneurs divins. Le moyen qu'il employa pour éluder l'oracle est original et mérite d'être rapporté. Il envoya des reproches au dieu, se plaignant que son père et son oncle, après avoir fermé les temples, oublié les dieux, opprimé les hommes, eussent vécu longtemps, tandis que lui, si pieux, devait périr si vite. L'oracle lui répondit que pour cela même sa vie serait abrégée, car il n'avait pas fait ce qu'il fallait faire. L'Egypte aurait dû souffrir cent cinquante ans, et les deux rois, ses prédécesseurs l'avaient su, au contraire de lui. A cette réponse, Mykérinos, se jugeant condamné, fabriqua nombre de lampes, les alluma chaque soir, à la nuit, et se mit à boire et à se donner du bon temps, sans jamais cesser, nuit et jour, errant sur les étangs ou dans les bois, partout où il pensait trouver occasion de plaisir. Il avait machiné cela afin de convaincre l'oracle de faux et de vivre douze ans, les nuits comptant comme des jours[29]. Le récit des historiens grecs ne ressemble guère à ce que les monuments nous apprennent. Il est impossible que Khephren ait été le frère de Kheops : la durée des deux règnes s'y oppose absolument. Même Khephren ne fut pas le successeur immédiat de Kheops : les listes monumentales intercalent entre les deux un roi nommé Didoufri dont la pyramide a été découverte récemment, vers Abou-Roache[30], un peu au nord de celles de Gizeh. Le règne très court de ce prince, qui n'a d'ailleurs aucune importance historique, peut nous servir à expliquer l'un des points de la légende recueillie par les Grecs. Peut-être Didoufri était-il le fils de Kheops et le frère aîné de Khephren. De là cette notion que Khephren était le frère de son prédécesseur immédiat, et, comme Didoufri disparut sans laisser aucune trace dans la mémoire du peuple, cette notion que Kheops était le prédécesseur immédiat et par suite le frère aîné de Khephren. L'impiété traditionnelle des deux rois n'est pas moins problématique que leur parenté. Les titres qu'ils prennent et ceux que portent les personnes de leur famille ou de leur cour témoignent du respect qu'ils marquaient pour la religion. Khéphrên s'appelle l'Horus et le Sit, l'Horus, coeur puissant, le bon Horus, le dieu grand, seigneur des diadèmes ; sa femme, la reine Marisânkh, est prêtresse de Thot[31] ; un de ses parents, le prince Mînan, ètait grand-prêtre de Thot à Khmounou ou Hermopolis[32]. Enfin, une stèle, refaite à l'époque saïte et attribuée par les scribes du temps à sa fille Honîtsen, nous montre le Kheops historique édifiant et restaurant des temples à l'inverse du Kheops légendaire. L'Horus vivant, celui qui écrase ses ennemis, le roi d'Égypte Khoufoui vivificateur, a trouvé le temple d'Isis, rectrice de la pyramide, près du temple du Sphinx, au nord-ouest du temple d'Osiris, seigneur du tombeau ; il a construit sa pyramide prés du temple de cette déesse, et il a construit la pyramide de sa royale fille, Honîtsen, près de ce temple. - Il a fait ceci à sa mère Isis, mère divine, à Hathor, dame des eaux [d'en haut][33]. Inscrivant sa donation sur une stèle, il lui a donné de nouveau un apanage, il a reconstruit son sanctuaire en pierre, et il trouva ces dieux dans son temple. Suivent la liste et l'image de ces dieux : Horus et Isis, sous plusieurs de leurs formes, Nephthys, Selkit, Phtah, Sokhit, Osiris, Hapi. Derrière chaque image on lit l'indication des matières dont elle était fabriquée : la barque d'Isis, l'épervier d'Horus, l'ibis de Thot étaient en bois doré ; Isis était en or et en argent ; Nephthys en bronze doré ; Sokhit en bronze[34]. Ailleurs nous voyons que le même prince avait agrandi ou au moins réparé le temple d'Hathor, à Dendérah[35]. Nous voilà bien loin du Kheops d'Hèrodote qui fermait tous les sanctuaires de l'Égypte et qui proscrivait les dieux. On sait aujourd'hui d'où vient cette différence entre les récits des écrivains grecs et la réalité. Ce qu'Hérodote raconte n'est que la transcription d'un conte populaire. Les Égyptiens ont traité Kheops, Khephren et Mykérinos de la même manière que les poètes du moyen âge ont traité Charlemagne : après les avoir exaltés de toutes les manières, ils les ont rendus odieux et ridicules. Les romans égyptiens que nous possédons encore en original montrent que la fantaisie du vulgaire n'hésita jamais à imputer aux meilleurs des Pharaons les exploits les plus invraisemblables : les conteurs se plaisaient à choisir pour leurs héros des noms connus, Ramsès, Méneptah, et cela seul suffit à nous expliquer l'origine des fables que les Grecs nous ont transmises sur les rois de la quatrième dynastie. Le Kheops d'Hérodote et le Kheops des inscriptions portent le même nom, et tous deux ont construit la grande pyramide : à cela près, ce qu'on nous apprend d'eux diffère. Kheops et Khephren sont de simples héros de roman[36] ; Khoufoui et Khâfrî nous apparaissent comme des rois puissants, pieux envers la divinité, et redoutables à leurs ennemis non moins qu'à leurs sujets. Kheops guerroya contre les nomades d'Arabie, et défendit victorieusement contre leurs attaques les établissements miniers que Snofroui avait fondés dans la péninsule du Sinaï[37]. Les prisonniers ramassés dans ces campagnes furent sans doute employés, selon l'usage, à la construction des pyramides. Est-ce à dire pour cela que la conception populaire soit entièrement fausse et qu'il ait ménagé ses sujets ? Le nombre des prisonniers, si large qu'on le suppose, ne pouvait suffire à l'immensité de l’œuvre ; sans doute il fallut avoir recours aux Égyptiens de race pure et les réquisitionner, ainsi que le rapporte Hérodote. Il y eut une grande clameur d'un bout à l'autre de son empire ! Une clameur de l'oppressé contre l'oppresseur ; une clameur de tourment et d'amère angoisse ; une clameur telle qu'elle résonne encore dans sa mémoire tandis que j'écris ; une de ces clameurs qui, depuis les jours de Souphis, se sont souvent élevées de la terre d'Égypte et ont percé les oreilles du seigneur des armées. Et Souphis s'en inquiéta ? Pas plus que Mohammed-Ali ou Ibrahim-Pacha ! Le caprice égoïste du tyran, que ce soit la grande pyramide ou le barrage, avance : qu'importent au maître les souffrances de son peuple ?[38] L'Egypte peut changer de religion, de langue et de race; que le souverain s'appelle pharaon, sultan ou pacha, la destinée du fellah est toujours la même. Les historiens grecs ont recueilli, à quatre mille ans de distance, l'écho des malédictions dont les Égyptiens chargèrent la mémoire de Kheops. Rien n'empêche de croire que cette révolte dont parle Diodore[39] eut vraiment lieu : des statues de Khephren brisées ont été retrouvées prés du temple du Sphinx, dans un puits où elles avaient été jetées anciennement, peut-être un jour de révolution[40]. L'idée de piété que la tradition populaire attachait au règne de Menkaourî, le Mykérinos d'Hérodote, est confirmée par le témoignage des contemporains : non que ce prince ait, comme on le dit, rouvert les temples (nous avons vu qu'ils n'avaient jamais été fermés), mais il ordonna à l'un de ses fils, Didoufhorou, de parcourir les sanctuaires de l'Égypte, sans doute afin de restaurer ceux qui lui sembleraient en mauvais état, et de faire dans toutes les villes des fondations nouvelles. C'est au cours de cette inspection que le prince découvrit, suivant quelques documents, le chapitre LXIV du Rituel Funéraire, à Khmounou (Hermopolis), aux pieds du dieu Thot, écrit en bleu sur une dalle d'albâtre… Le prince l'apporta au roi comme un objet miraculeux[41]. Ces révélations de livres religieux ou scientifiques sont fréquemment mentionnées dans l'ancienne littérature égyptienne. Nous avons déjà vu que l'invention du chapitre LXIV est attribuée par quelques autorités au roi Ousaphaîs, et que le roi Têti passait pour avoir recueilli un livre de médecine, dont nous possédons encore la meilleure part. Un autre traité de médecine signalé récemment remonterait de la même manière au règne de Kheops. Il s'était manifesté à Coptos, une nuit, devant un ministre du dieu, qui était entré dans la grande salle du temple et avait pénétré jusqu'au fond du sanctuaire. Or la terre était plongée dans les ténèbres, mais la lune brillait sur ce livre de tous côtés. Il fut apporté, en grande merveille, à la sainteté du roi Khoufoui, le juste de voix[42]. Le chapitre LXIV, résumé de la doctrine égyptienne sur la vie future et la condition de l'âme, est une des sections les plus obscures du Livre des Morts : Tu viens à moi, dit un scribe de l'époque des Ramessides, bien muni de grands mystères, tu me dis au sujet des formules du prince Didoufhorou : Tu n'y as rien connu, ni bien, ni mal. Un mur d'enceinte est par devant que nul profane ne saurait forcer. Toi, tu es un scribe habile parmi ses compagnons, instruit dans les livres, châtié de coeur, parfait de langue, et quand tes paroles sortent, une seule phrase de ta bouche est trois fois importante ; tu m'as donc laissé muet de terreur[43]. Les modernes qui ne saisissent pas toujours le sens de ces morceaux mystiques peuvent se consoler : les anciens Egyptiens n'étaient pas beaucoup plus avancés qu'eux. Le sarcophage de Mykérinos, conservé longtemps dans la troisième pyramide, était l'une des oeuvres les plus admirables de l'art égyptien archaïque. Il a péri sur la côte du Portugal avec le navire qui le transportait en Angleterre. Nous n'avons plus aujourd'hui que le couvercle du cercueil en bois de sycomore dans lequel la momie du pharaon reposait. Ce cercueil est de forme humaine, et on y lit une inscription : Ô l'Osiris, le roi des deux Égyptes Menkaourî, vivant pour l'éternité, enfanté par le ciel, porté [dans le sein] de Nouît, germe de Gabou ! Ta mère Nouît s'étend sur toi en son nom d'abîme du ciel. Elle te divinise en mettant à néant tes ennemis, ô roi Menkaourî, vivant pour l'éternité ![44] La littérature de l'époque grecque associait à ces trois Pharaons un prince fabuleux nommé Asychis par Hérodote, et Sasychis par Diodore de Sicile. « Il éleva dans le temple de Phtah, à Memphis, le portique méridional, le plus beau et le plus grand de tous ; car, s'ils sont tous ornés de sculptures, si l’aspect de la construction y varie à l'infini, ce côté est plus varié et plus magnifique encore que les autres. Dans l'intention de surpasser ses prédécesseurs, il bâtit en briques une pyramide où se trouve l'inscription suivante gravée sur une pierre : Ne me méprise pas à cause des pyramides de pierre ; je l'emporte sur elles autant que Jupiter sur les autres dieux. Car, plongeant une pièce de bois dans un marais et réunissant ce qui s'y attachait d'argile, on a fait la brique dont j'ai été construite[45]. Au témoignage de Diodore, Sasychis aurait été l'un des cinq grands législateurs de l'Égypte : il aurait réglé avec le plus grand soin les cérémonies du culte, inventé la géométrie et l'art d'observer les astres[46]. Il promulgua aussi une loi sur le prêt, par laquelle il autorisait tout particulier à mettre en gage la momie de son père, avec faculté au prêteur de disposer du tombeau de l'emprunteur. Au cas où la dette n'était pas payée, le débiteur ne pouvait obtenir sépulture pour lui ou pour les siens, ni dans la tombe paternelle, ni dans une autre tombe[47]. La cinquième dynastie est en toute chose le prolongement
de la quatrième. Ses rois eurent à réprimer au dehors les razzias peu
dangereuses des nomades d'Asie, et ils exploitèrent les mines du Sinaï avec
une certaine activité[48]. Ils
entretinrent des relations vers le Sud avec les régions de La littérature égyptienne pendant la période memphite.Dans un des tombeaux de Gizeh, un grand fonctionnaire des
premiers temps de la sixième dynastie s'attribue le titre de Gouverneur de la maison des livres[53]. Cette simple
mention jetée incidemment entre deux titres plus ronflants suffirait, à
défaut d'autres, afin de nous prouver le développement extraordinaire que la
civilisation égyptienne avait pris dès lors. Non seulement il y avait déjà
une littérature, mais cette littérature était assez considérable pour remplir
des bibliothèques, et son importance assez forte pour qu'un des
fonctionnaires de la cour fût attaché spécialement à Dés les premiers jours, leurs astronomes constatèrent qu'un certain nombre des astres qui brillaient la nuit au-dessus de leurs têtes paraissaient animés d'un mouvement de translation à travers les espaces, tandis que les autres demeuraient immobiles. Cette observation, répétée maintes et maintes fois, les conduisit à établir la distinction des planètes et des étoiles ou, comme ils les appelaient, des indestructibles (akhimou-sokou). Ils comptèrent parmi les premières Horus, guide des espaces mystérieux (Hartapshitiou), notre Jupiter, que son éclat désigna comme le chef de la bande ; Horus, générateur d'en haut (Harkahri), Saturne, la plus éloignée de celles qu'oeil humain puisse apercevoir sans le secours des instruments ; Harmakhis, Mars, à qui sa couleur rougeâtre valut aussi le surnom d'Hardoshir, l'Horus rouge, et dont le mouvement rétrograde en apparence à divers moments de l'année ne leur échappa point ; Sovkou, Mercure ; Vénus enfin, qui dans son rôle d'étoile du matin s'appelle Douaou, et Bonon peut-être dans celui d'étoile du soir[56]. Le soleil lui-même, ce centre fixe de tous les systèmes anciens, subit chez eux la loi du mouvement universel et il voyagea dans le ciel en compagnie des étoiles errantes[57]. Pour les Égyptiens le ciel est une sorte de plafond
solide, en fer pensait-on, sur lequel roulent les eaux mystérieuses qui
enserrent la terre de toutes parts. Aux jours de la création, quand le chaos
se résolut en ses éléments, le dieu Shou souleva ce plafond : le Nil
d'en haut commença à couler au sommet des montagnes qui bornent notre monde,
et c’est sur ce fleuve céleste que flottent les planètes et généralement tous
les astres qui ont un lever et un coucher visibles dans la vallée : les
monuments nous les montrent figurés par des génies à formes humaines ou
animales qui naviguent chacun dans sa barque à la suite d'Orion. D'autre part,
on se représentait les étoiles fixes comme des lampes (khabisou) suspendues au plafond de fer et qu'une puissance divine
allumait chaque soir pour éclairer les nuits de la terre. Au premier rang de
ces astres-lampes, on mettait les décans, simples étoiles ou groupes
d'étoiles en rapport avec les trente-six ou trente-sept décades dont l'année
égyptienne se composait : Sopdit ou Sothis, sainte à Isis ;
Orion-Sahou, consacré à Osiris et considéré par quelques-uns comme le séjour
des âmes heureuses ; les Pléiades, les Hyades, et beaucoup d'autres dont
les noms anciens n'ont pas été encore identifiés d'une manière authentique
avec les noms modernes. Bref, toutes les étoiles qu'on peut apercevoir à
l'oeil nu avaient été relevées, enregistrées, cataloguées avec soin[58]. Les
observatoires de la haute et de De tous ces astres, le mieux connu et le plus important
était l'astre d'Isis, Sinus, que les Égyptiens nommaient Sopdit, d'où les
Grecs ont fait Sothis. Son lever héliaque, qui marquait le premier instant de
l'inondation, marquait aussi le début de l'année civile, si bien que tout le
système chronologique du pays reposait sur lui. L'année primitive des Égyptiens,
ou du moins la première année que nous leur connaissions historiquement, se
composait de douze mois de trente jours chacun, soit en tout trois cent
soixante jours. Ces douze mois étaient répartis entre trois saisons de quatre
mois : la saison du commencement
(Sha), qui répond au temps de
l'inondation ; la saison des
semailles (Pro), qui répond à
l'hiver ; la saison des moissons
(Shomou), qui répond à l'été.
Chaque mois se subdivisait en trois décades ; chaque jour et chaque nuit
se partageaient en douze heures : si bien que Ce système, pour simple qu'il parut, avait ses
inconvénients, qui ne tardèrent pas à se manifester brutalement. Entre
l'année telle qu'il la définissait et l'année tropique, il y avait une
différence de cinq jours un quart ; à chaque douze mois qui
s'écoulèrent, l'écart entre l'année courante et l'année fixe augmenta de cinq
jours un quart, et par suite les saisons cessèrent de marcher avec les phases
de la lune. Des observations nouvelles, opérées sur la marche du soleil,
décidèrent les astronomes à intercaler chaque année, après le douzième mois, et
avant le premier jour de l'année suivante, cinq jours complémentaires, qu'on
nomma les cinq jours en sus de l'année
ou jours épagomènes. L'époque de ce
changement était si ancienne que nous ne saurions lui assigner aucune date,
et que les Égyptiens eux-mêmes l'avaient reportée jusque dans les temps mythiques
antérieurs à l'avènement de Ménès. Rhéa (Nouît)
ayant eu un commerce secret avec Kronos (Gabou), le Soleil (Râ), qui s'en
aperçut, prononça contre elle un charme qui l'empêcha d'accoucher dans aucun mois
et dans aucune année ; mais Hermès (Thot), qui avait de l'amour pour la
déesse, joua aux dés avec De la littérature mathématique de l'époque, nous ne connaissons rien. Les monuments nous prouvent cependant que, dès le siècle des pyramides, la géométrie devait être fort avancée : sinon la géométrie théorique, au moins la géométrie pratique, celle qui sert à mesurer les surfaces et à calculer le volume des corps solides. Les architectes qui ont bâti les pyramides et les grands tombeaux de Saqqarah étaient nécessairement des géomètres fort estimables. Malheureusement nous n'avons plus rien des livres dans lesquels ils enregistraient leurs doctrines : le seul traité de mathématiques qui nous soit parvenu est postérieur de deux mille ans au moins à leur époque, et il nous enseigne l'état de la science dans les temps relativement modernes de la dix-neuvième dynastie[60]. Pour nous figurer ce que pouvait être la médecine égyptienne, nous n'en sommes pas réduits à de simples inductions. Outre un traité dont l'invention était attribuée au règne de Kheops et qui n'a pas encore été publié, nous possédons deux livres ; le premier renferme aussi des recettes attribuées à des savants étrangers[61] ; le second, trouvé sous Ousaphaïs, aurait été complété par Sondou[62]. Les manuscrits de ces deux ouvrages remontent à la dix-huitième et à la dix-neuvième dynastie : le texte avait dû s'en modifier à la longue, mais l'ancienneté de leur origine les maintenait dans les écoles. Ils faisaient sans doute partie de cette bibliothèque du temple d'Imouthès, à Memphis, qui existait encore aux temps romains et où les médecins grecs allaient puiser des recettes pour leurs clients[63]. L’Égypte est naturellement une contrée fort saine. Les Egyptiens, disait Hérodote, sont les mieux portants de tous les mortels. Ils n'en étaient que plus attentifs à soigner leur santé. Chaque mois, trois jours de suite, ils provoquent des évacuations au moyen de vomitifs et de clystères ; car ils pensent que toutes les maladies de l'homme viennent des aliments[64]. - La médecine chez eux est partagée : chaque médecin s'occupe d'une seule espèce de maladie et non de plusieurs. Les médecins en tous lieux abondent, les uns pour les yeux, les autres pour la tête, d'autres pour les dents, d'autres pour le ventre, d'autres pour les maux internes[65]. Il n'est pas certain que cette division dont parle Hérodote ait été aussi absolue que l'historien a bien voulu le prétendre. Le même individu pouvait traiter toutes les maladies en général; seulement, pour les maux d'yeux et pour quelques autres affections, il y avait comme chez nous des spécialistes que l'on consultait de préférence aux praticiens ordinaires. Si le nombre en paraissait considérable à l'historien grec, cela tient à la constitution médicale d'un pays où les ophtalmies et les maladies intestinales, par exemple, sont encore aujourd'hui plus fréquentes que partout en Europe. La médecine théorique ne semble pas avoir réalisé des progrès sérieux, bien que les manipulations de la momification eussent dû fournir aux médecins l'occasion d'étudier à loisir l'intérieur du corps humain. Une sorte de crainte religieuse ne leur permettait pas plus qu'aux médecins chrétiens du moyen âge de découper en morceaux, dans un but de pure science, le cadavre qui était destiné à revivre un jour. Leur horreur pour quiconque rompait l'intégrité des tissus humains était Si forte, que l'embaumeur chargé de pratiquer les incisions réglementaires était l'objet de l'exécration universelle. Toutes les fois qu'il venait d'exercer son métier, les assistants le poursuivaient à coups de pierres et l'auraient assommé sur place s'il ne s'était enfui à toutes jambes. De plus, les règlements médicaux n'étaient pas de nature à encourager les recherches scientifiques. Les médecins étaient obligés à traiter le malade d'après les règles posées dans certains livres d'origine réputée divine. S'ils s'écartaient des prescriptions sacrées, c'était à leurs risques et périls : en cas de mort du patient, ils étaient convaincus d'homicide volontaire et punis comme assassins[66]. Le seul point qui nous soit familier de leurs doctrines est la théorie de la circulation. Le corps renfermait un certain nombre de vaisseaux qui charriaient des esprits vivifiants. La tête a trente-deux vaisseaux qui amènent des souffles à son intérieur ; ils transmettent les souffles à toutes les parties du corps. Il y a deux vaisseaux aux seins qui conduisent la chaleur au fondement… Il y a deux vaisseaux de l'occiput, deux du sinciput, deux à la nuque, deux aux paupières, deux aux narines, deux à l'oreille droite par lesquels entrent les souffles de la vie ; il y en a deux de l'oreille gauche, par lesquels entrent les souffles[67]. Les souffles dont il est question dans ce passage sont appelés ailleurs les bons souffles, les souffles délicieux du Nord. Ils s'insinuaient dans les veines et les artères, se mêlaient au sang qui les entraînait par tout le corps, faisaient mouvoir l'animal et le portaient pour ainsi dire. Au moment de la mort, ils se retirent avec l'âme, le sang se coagule, les veines et les artères se vident et l'animal périt[68]. Les maladies dont il est question dans les traités égyptiens ne sont pas toujours faciles à déterminer. Ce sont, autant qu’on peut en juger, des ophtalmies, des varices ou des ulcères aux jambes, l'érysipèle, le ver, la maladie divine mortelle, le divinus morbus des Latins, l'épilepsie. Un chapitre spécial traite de quelques points relatifs à la conception et à l'accouchement. Le diagnostic est détaillé dans plusieurs cas et permettrait peut-être à un médecin de spécifier la nature de l'affection. Voici celui d'une fièvre typhoïde : Lourdeur au ventre ; le col du coeur, malade ; au coeur, inflammation, battements accélérés. Les vêtements pèsent sur le malade ; beaucoup de vêtements ne le réchauffent pas. Soifs nocturnes. Le goût pervers, comme celui d'un homme qui a mangé des fruits de sycomore. Chairs amorties comme celles d'un homme qui se trouve mal. S'il va à la selle, son ventre est enflammé et refuse de s'exonérer[69]. Les médicaments indiqués sont de quatre sortes : pommades, potions, cataplasmes et clystères. Ils sont composés chacun d'un assez grand nombre de matières empruntées à tous les règnes de la nature. On trouve citées plus de cinquante espèces de végétaux, depuis des herbes et des broussailles jusqu'à des arbres, tels que le cèdre, dont la sciure et les copeaux passaient pour avoir des propriétés lénitives, le sycomore et maints autres dont nous ne comprenons plus les noms antiques. Viennent ensuite des substances minérales, le sulfate de cuivre (?), le sel, le nitre, la pierre memphite (aner sopdou), qui, appliquée sur des parties malades ou lacérées, avait, dit-on, des vertus anesthésiques. La chair vive, le coeur, le foie, le fiel, le sang frais ou desséché de divers animaux, le poil et la corne du cerf, jouaient un grand rôle dans la confection de divers onguents souverains contre les inflammations. Nombre de recettes se recommandent par l'imprévu des substances préconisées : le lait d'une femme accouchée d'un enfant mâle, la fiente du lion, la cervelle d'une tortue, un vieux bouquin bouilli dans l'huile[70]. Les ingrédients constitutifs de chaque remède étaient pilés ensemble, bouillis et filtrés au linge. Ils avaient d'ordinaire pour véhicule l'eau pure ; mais souvent on les mélangeait avec des liquides d'espèces variées, la bière (haq), la bière douce (haq nozmou) ou tisane d'orge, le lait de vache ou de chèvre, l'huile d'olive verte et l'huile d'olive épurée (biq nozmou), ou même, comme dans la médecine de Molière, l'urine humaine ou animale. Le tout, sucré de miel, s'avalait chaud matin et soir[71]. Mais les maladies n'avaient pas toujours une origine
naturelle. Elles étaient produites par des spectres ou par des esprits
malfaisants qui entraient au corps de l'homme et qui y trahissaient leur
présence par des désordres plus ou moins graves. En combattant les effets
extérieurs, on parvenait tout au plus à soulager le patient. Pour arriver à
la guérison totale, il fallait supprimer la cause première en éloignant par
des prières le démon possesseur. Une bonne ordonnance de médecin se composait
donc d'au moins deux parties : d'une formule magique et d'une recette
médicale. Voici une conjuration destinée à corroborer l'action d'un
vomitif : Ô revenant démon qui loges dans le
ventre d'un tel fils d'une telle, ô toi dont le père est nommé Celui qui abat les têtes, dont le nom
est Mort, dont le nom est Mâle de La littérature philosophique était déjà en honneur. Un
papyrus de Berlin nous a conservé le fragment d'un dialogue entre un Egyptien
et son âme : l'âme essaye de démontrer que la mort n'a rien d'effrayant
pour qui la regarde en face[74]. Je me dis à moi-même chaque jour : Ainsi la
convalescence après la maladie, telle est la mort ! Je me dis à
moi-même : Ainsi que l'odeur d'un parfum de fleurs, ainsi que s'asseoir
dans un pays d'ivresse, telle est la mort ! Je me dis à moi-même, chaque
jour : Ainsi qu'au moment où le ciel s'éclaircit, un homme sort pour
aller prendre des oiseaux au filet, et soudain se trouve dans une contrée
inconnue, telle est la mort ! Un autre papyrus, donné par
Prisse à Ce Phtahhotpou était le fils d'un roi de la cinquième
dynastie. Il était sans doute assez âgé à l'époque où il prit la plume, car
il entre en matière par un portrait assez peu flatté de la vieillesse. Le monarque Phtahhotpou dit : Sire le roi, mon
maître, quand l'âge est là et que la vieillesse se produit, l'impuissance
arrive et la seconde enfance sur laquelle la misère s'appesantit de plus en
plus chaque jour ; les deux yeux se rapetissent, les deux oreilles
s'amoindrissent, la force s'use, tant que le coeur continue à battre. La
bouche se tait : elle ne parle plus. Le coeur s'obscurcit, il ne se
rappelle plus hier. Les os souffrent à leur tour, tout ce qui était bon
tourne au mauvais, le goût s'en va tout à fait. La vieillesse rend un homme
misérable en toutes choses, car son nez se bouche, il ne respire plus, qu'il
se tienne debout ou assis. Si l'humble serviteur qui est devant toi reçoit
l'ordre de tenir les discours qui conviennent à un vieillard, alors je te
dirai les paroles de ceux qui ont écouté l'histoire des temps antérieurs, de
ceux qui ont entendu les dieux eux-mêmes, car si tu agis selon elles, le
mécontentement disparaîtra d'entre les vivants et les deux terres
travailleront pour toi ! Il ne faut pas s'attendre à trouver dans cette oeuvre une grande profondeur de conception. Les analyses savantes, les distinctions raffinées, les abstractions métaphysiques n'étaient pas de mode à l'époque de Phtahhotpou. On négligeait les idées spéculatives pour les faits positifs, la théorie pour la pratique : on observait l'homme, ses passions, ses habitudes, ses tentations, ses défaillances, non pas afin de construire à ses dépens un système de philosophie nouveau, mais afin de réformer ce que sa nature a d'imparfait en soi, et de montrer à l'âme le chemin de l'éternité glorieuse. Aussi Phtahhotpou ne se met-il pas en frais d'inventions et de déductions. Il enregistre les réflexions et les conseils qui lui viennent à l'esprit, tels qu'ils lui viennent, sans les grouper et sans en tirer la moindre conclusion d'ensemble. La science est utile pour arriver à la connaissance du bien : il recommande la science. La douceur envers les subalternes est de bonne politique : il fait l'éloge de la douceur. Le tout est entremêlé d'avis sur la conduite à suivre dans les diverses circonstances de la vie, quand on comparaît devant un supérieur impérieux, quand on va dans le monde, quand on prend femme. Si tu es sage, tu t'enfermeras dans ta maison et tu aimeras ta femme chez toi ; tu la nourriras bien, tu la pareras, car les vêtements de ses membres et les parfums sont la joie de sa vie : aussi longtemps que tu observeras ce précepte, elle sera un champ qui profite à son maître[77]. Analyser en détail un tel ouvrage est impossible, le traduire entièrement plus impossible encore. La nature du sujet, l'étrangeté de certains préceptes, la qualité du style, tout concourt à dérouter l'étudiant et à l'égarer dans ses recherches. Dés les temps les plus reculés, la morale a été considérée comme une science bonne et louable en elle-même, mais tellement rebattue qu'on ne peut la rajeunir que par la forme. Phtahhotpou n'a pas échappé aux nécessités du genre qu'il avait choisi. D'autres avaient dit et bien dit avant lui les vérités qu'il prétendait exprimer de nouveau : il lui fallut, pour allécher le lecteur, inventer des formules imprévues et piquantes. Il n'y a pas manqué : dans certains cas il a su envelopper sa pensée d'un tour si ingénieux que le sens moral de la phrase nous échappe sous le déguisement des mots. De la sixième à la dixième dynastie.Il semble que le passage de la cinquième à la sixième dynastie ne se fit pas sans troubles. Deux rois sont mentionnés sur les monuments contemporains, Têti et Ousirkeri Ati, qui sans doute se disputèrent le trône. Ati est probablement l'Othoés de Manéthon, qui fut, dit-on, tué par ses gardes[78]. Têti, qui l'emporta, était-il apparenté à son prédécesseur ? La liste de Turin interrompt la série des noms royaux entre lui et Ounas, ce qui indique un changement de famille les listes grecques prétendent que la dynastie nouvelle était originaire de Memphis[79]. Pépi 1er Mirisî succéda à Têti. A partir de
Pépi 1er, l'autorité de Memphis sur le reste de l'Égypte commença
de décliner. Les princes de la dynastie nouvelle, sans abandonner l'ancienne
capitale, paraissent lui avoir préféré les villes de Ouni avait débuté tout enfant à la cour du roi Têti. D'abord simple page (porte couronne), il avait bientôt obtenu un emploi dans l'administration du Trésor, puis un titre d'inspecteur des bois de l'État. Pépi le prit en grande amitié dés le début de son règne et lui confia successivement les charges de surveillant des prophètes de la pyramide funéraire et d'auditeur, dont il s'acquitta mieux que personne avant lui ; aussi lui accorda-t-on comme récompense une garniture de tombeau et un sarcophage en belle pierre blanche de Troja. Il redoubla de zèle pour justifier cette distinction, et l'activité qu'il déploya lui valut des faveurs nouvelles : il fut promu à la dignité d'ami royal, nommé surintendant de la maison de la reine, et attira à lui la direction de toutes les affaires. « Je faisais, dit-il, toutes les écritures avec l'aide d'un seul secrétaire. » L'Égypte n'eut pas à se plaindre de son administration. Les mines du Sinaï, exploitées avec plus de suite et soumises à des inspections régulières, rendirent des revenus supérieurs à ce qu'on tirait d'elles auparavant[80]. Une route fut tracée à travers le désert de Coptos à la mer Rouge et ouvrit au commerce une voie commode. L'exploitation des carrières de Rohanou fut poussée avec vigueur[81], et, bien que les monuments édifiés alors aient disparu sans laisser presque aucun vestige, les inscriptions sont là pour témoigner de l'activité avec laquelle les travaux de construction furent menés. Une ville nouvelle fut fondée dans l'Heptanomide prés de l'endroit où végète aujourd'hui le bourg de Sheikh-Saïd[82]. Le temple d'Hathor à Dendérah, élevé par les serviteurs d'Horus aux temps fabuleux de l'histoire et ruiné depuis lors, fut rebâti en entier sur les plans primitifs qu'on retrouva par hasard[83]. Cette piété envers l'une des divinités les plus vénérées fut encouragée comme elle méritait de l'être par le titre de fils d'Hathor que Pépi désormais inséra dans son cartouche royal[84]. Au dehors, le ministère d'Ouni fut signalé par des
conquêtes. « Cette armée alla en paix : elle entra, comme
il lui plut, au pays des Hiroushaïtou. Cette armée alla en paix : elle
écrasa le pays des Hiroushaïtou. Cette armée alla en paix : elle fit
brèche dans toutes leurs enceintes fortifiées. Cette armée alla en
paix : elle coupa leurs figuiers et leurs vignes. Cette armée alla en
paix : elle incendia toutes leurs maisons. Cette armée alla en paix :
elle massacra leurs soldats myriades. Cette armée alla en paix : elle
emmena leurs hommes, leurs femmes et leurs enfants en grand nombre, comme
prisonniers vivants, ce dont Sa Sainteté se réjouit plus que de toute autre
chose. » Ces prisonniers, employés aux travaux publics ou vendus comme
esclaves à des particuliers, contribuèrent pour leur part à la prospérité du
règne de Pépi. Sa Sainteté m'envoya pour écraser ses
ennemis, et j'allai cinq fois frapper la terre des Hiroushaïtou pour aller
abattre leur rébellion avec cette armée ; et j'agis de telle sorte que
le roi fut satisfait de cela plus que de toute autre chose. Malgré
ces victoires répétées, la lutte n'était pas encore terminée : On vint dire que des barbares s'étaient assemblés au pays
de Tiba[87]. Je partis encore dans des navires avec cette armée, et
je pris terre aux extrémités reculées de cette région, au nord du pays des
Hiroushaïtou. Voici que cette armée se mit en chemin : elle les battit
tous, et détruisit tous ceux d'entre eux qui s'étaient assemblés. Cette
affaire décisive termina les opérations et entraîna la soumission complète
des ennemis. Au retour de ces expéditions, Ouni, déjà comblé d'honneurs, reçut
la faveur la plus insigne qu'un roi pût accorder à un sujet, l'autorisation
de garder ses sandales dans le palais et même en présence de Pharaon. La paix
régnait à l'intérieur : au dehors, Métésouphis était presque un enfant lorsqu'il monta sur le trône[88]. Il n'eut pas de guerres sérieuses à soutenir. Le souvenir des victoires de son père était encore trop présent à l'esprit des barbares pour qu'ils éprouvassent la tentation de se révolter. Ouni, qui avait tant fait pour la grandeur du roi précèdent, fut confirmé dans tous ses emplois et comblé de charges nouvelles. Il fut nommé prince gouverneur des pays du sud depuis Eléphantine jusqu'à Létopolis, vers la pointe du Delta : Jamais sujet n'avait eu cette dignité auparavant. Selon l'usage, il commença par suspendre les autres travaux, pour s'occuper sans retard du tombeau destiné au souverain. La construction de la pyramide funéraire le contraignit à entreprendre, dans les contrées rangées sous son autorité, plusieurs voyages longs et difficiles. Sa Sainteté m'envoya au pays d'Abhaît[89] pour y chercher le sarcophage royal avec son couvercle et le pyramidion précieux de la pyramide funéraire de Mirinri. Sa Sainteté m'envoya vers Eléphantine pour en rapporter le granit du naos et du seuil, le granit des jambages et des linteaux, pour ramener le granit des portes et des seuils de la chambre supérieure de la pyramide de Mirinri. Je partis pour la pyramide de Mirinri avec six chalands, trois bateaux de charge, trois radeaux et un navire de guerre : jamais dans le temps d'aucun ancêtre Abhaît ou Éléphantine n'avaient construit navires de guerre. Sa Sainteté m'envoya au pays de Hanoubou pour en rapporter une grande table à libations en albâtre du pays de Hanoubou. Je lui fis amener cette table à libations en dix-sept jours. Pour embarquer et pour convoyer ces blocs de pierre, il avait fallu entreprendre et mener à bonne fin quantité de travaux secondaires, mettre en chantier des bateaux, creuser des bassins et des canaux au sud d'Éléphantine, dans le pays nouvellement conquis des Ouaouaîtou. Ouni réquisitionna à cet effet les peuplades noires chez qui il avait déjà recruté une armée sous Pépi. Voici que le prince du pays de Irrithit, Ouaouaîtou, Amam, Maza fournirent le bois nécessaire aux navires. En un an, les différentes missions étaient achevées ; les vaisseaux construits en Nubie franchissaient la première cataracte à la faveur des hautes eaux et descendaient le Nil. Mirinri visita lui-même les travaux en l'an V : il reçut l'hommage des chefs nubiens, et, pour laisser à la postérité le souvenir de son séjour, il grava son image de plain-pied sur les rochers d'Assouan[90]. La préparation de cette pyramide fut le dernier grand acte administratif de la vie d'Ouni. Il mourut peu de temps après, et son souverain ne tarda pas à le suivre au tombeau[91]. Mirinri eut pour successeur son frère cadet Nofirkerî Pépi
II. Manéthon prêtait à ce prince cent années de règne, et son témoignage est
confirmé par le Papyrus de Turin, qui attribue à un Pharaon, dont le nom est
malheureusement détruit, un règne de quatre-vingt-dix ans au moins. Une
inscription d'Ouadi-Magharah, datée de la onzième année, montre qu'il fit
continuer l'exploitation des mines du Sinaï et qu'il repoussa de ce côté les
attaques des barbares[92]. D'autre part,
le nombre et la beauté des tombeaux qui portent son cartouche semblent
attester que, pendant une partie au moins de ce règne séculaire, l'Égypte ne
perdit rien de sa vigueur ni de sa prospérité. C'est au Midi surtout que la
vie se développa la plus intense, grâce à l'habileté des seigneurs
d'Éléphantine. Ces seigneurs, postés au danger, dans les marches
méridionales, entretenaient avec les peuples de la vallée au Sud de la
cataracte et avec ceux du désert des rapports tantôt d'amitié et de commerce,
tantôt de guerre ouverte ou d'inimitié sourde : leurs caravanes pénétraient
à l'Occident jusque par delà les Oasis thébaines, vers l'Orient aux rives de
la mer Rouge. L'un d'eux, Hirkhouf, se distingua par son adresse et par
l'heureux succès de ses entreprises : dans trois voyages successifs sous
Pépi 1er et sous Métésouphis 1er, non seulement il noua
des relations précieuses avec les tribus des Timihou, mais il amena plusieurs
d'entre elles à reconnaître la suzeraineté de l'Égypte. Pépi II ne régnait
que depuis deux ans lorsque Hirkhouf revint de son dernier voyage, et il
n'était encore qu'un enfant : ce qui lui plut dans cette affaire, ce fut
un danga, un nain habitué à danser
la danse sacrée, et qui venait du Pouanit. Il se le fit amener à Memphis avec
toute sorte de précautions, et il récompensa largement Hirkhouf[93]. Tous les
membres de la famille étaient imbus du même esprit d'aventures que celui-ci,
mais ils ne furent pas toujours aussi heureux. L'un d'eux, Papinakhîti, après
avoir visité plusieurs fois les contrées des Ouaouaîtou et de l'Iritit, au
profit de Pépi II, partit en reconnaissance aux mines du Sinaï ; mais,
tandis qu'il se construisait un navire afin de franchir la mer Rouge, les nomades
le surprirent et le tuèrent : c'est au plus si ses soldats sauvèrent son
corps et le ramenèrent à Éléphantine, où il fut enterré. Grâce à ces
expéditions continuelles, l'influence de l'Égypte se propagea au loin, et la
colonisation de Pendant les sept années de son règne. Nitokris avait terminé la troisième des grandes pyramides que Mykérinos n'avait pas achevée. Elle avait plus que doublé les dimensions du monument et elle lui avait ajouté ce coûteux revêtement de syénite qui excita plus tard, à juste titre, l'admiration des voyageurs grecs, romains et arabes. C'est au centre même de l'édifice, au-dessus de la chambre où le pieux Mykérinos reposait depuis plusieurs siècles, qu'elle fût ensevelie à son tour dans un magnifique sarcophage de basalte bleu, dont on a retrouvé les fragments[95]. Cela donna lieu plus tard de lui attribuer, au détriment du fondateur réel, la construction de la pyramide entière. Les voyageurs grecs, à qui leurs exégètes racontaient l'histoire de la belle aux joues de rose, changèrent la princesse en courtisane et substituèrent au nom de Nitaqrît le nom plus harmonieux de Rhodopis. Un jour qu'elle se baignait dans le fleuve, un aigle fondit sur une de ses sandales, l'emporta dans la direction de Memphis et la laissa tomber sur les genoux du roi qui rendait alors la justice en plein air. Le roi, émerveillé et par la singularité de l'aventure et par la beauté de la sandale, chercha par tout le pays la femme à qui elle avait appartenu, et c'est ainsi que Rhodopis devint reine d'Égypte. A sa mort, elle fut ensevelie dans le tombeau de Mykérinos[96]. Le christianisme et la conquête arabe modifièrent encore une fois le caractère de la légende sans effacer entièrement le souvenir de Nitokris. L'on dit que l'esprit de la pyramide méridionale ne paroist iamais dehors qu'en forme d'une femme nuë, belle au reste, et dont les manières d'agir sont telles que, quand elle veut donner de l'amour à quelqu'un et luy faire perdre l'esprit, elle luy rit, et, incontinent, il s'approche d'elle et elle l'attire à elle et l'affole d'amour ; de sorte qu'il perd l'esprit sur l'heure et court vagabond par le pays. Plusieurs personnes l'ont veue tournoyer autour de la pyramide sur le midy et environ soleil couchant[97]. C'est Nitokris qui hante ainsi le monument dont elle avait terminé la construction. Des découvertes récentes ont donné à la sixième dynastie une authenticité que n'ont pas plusieurs des dynasties postérieures. Ces pyramides qu'Ouni bâtissait pour ses maîtres, nous les avons ouvertes à Sakkarah, et les inscriptions qu'elles renferment nous ont rendu le nom du souverain qui y reposait jadis[98]. Ounas, le dernier roi de la cinquième dynastie, Têti, le premier de la sixième, Pépi 1er, Mirinri 1er, Pépi II sont devenus de la sorte des personnages aussi réels que Sétouî 1er ou Ramsès II : même la momie de Mirinri a été découverte à côté de son sarcophage, et elle est déposée aujourd'hui au Musée du Caire[99]. Toutes les pyramides de ce groupe sont ordonnées sur le même plan. Un long couloir incliné, bouché par d'énormes blocs de pierre, conduit à une sorte d'antichambre qui, tantôt est entièrement nue, tantôt est décorée d'interminables inscriptions hiéroglyphiques. Puis, c'est un second couloir horizontal, interrompu en son milieu par trois herses de pierre ; puis, une chambre oblongue, flanquée à gauche de trois petites pièces basses et sans ornements, à droite de la salle ou s'élève le sarcophage. Les inscriptions sont destinées, comme les tableaux des tombes privées, à fournir le mort des provisions et des amulettes nécessaires à le protéger contre les serpents et les dieux malfaisants, à empêcher son âme de mourir. Elles forment comme un livre immense dont les chapitres épars reparaissent par intervalles sur les monuments des temps postérieurs. Et ce n'est pas seulement la religion qu'elles nous restituent, c'est la langue la plus ancienne de l'Égypte : la plupart des formules qu'elles renferment ont été rédigées avant l'époque thinite, au temps de la prédominance Héliopolitainne. De la mort de Nitokris à l'avènement de la onzième dynastie, près de cinq siècles s'écoulèrent, sur lesquels l'histoire reste à peu près muette. Quatre dynasties surgirent, puis retombèrent rapidement pendant cet intervalle, sans qu'il nous soit possible encore de déterminer les noms et l'ordre de succession des Pharaons qui les composent. Manéthon indiquait en premier lieu une septième dynastie memphite, qui, d'après une version, aurait duré seulement soixante-dix jours et n'aurait pas compté moins de soixante-dix rois, d'après une autre, aurait consisté de cinq rois et aurait régné soixante-quinze ans. Il parlait ensuite d'une seconde dynastie memphite, la huitième, dont les vingt-sept souverains exercèrent l'autorité pendant cent quarante-six ans. Le Papyrus de Turin, tout mutilé qu'il est, contient en effet pour cette époque l'indication de règnes fort courts. Le roi Nofirka, successeur immédiat de Nitaqrît, garda le pouvoir deux ans, un mois, un jour ; le roi Nofrous (Snofroui II ?), quatre ans, deux mois, un jour ; le roi Abou, deux ans, un mois, un jour ; un autre roi, dont le nom est illisible, un an et huit jours. Il faut voir dans l'insignifiance de ces chiffres la preuve des intrigues incessantes et des guerres civiles qui ruinèrent l'Égypte et qui amenèrent probablement sa division en plusieurs États indépendants, sur lesquels les princes de la dynastie officielle, retirés à Memphis, n'exercèrent plus qu'un droit de suzeraineté purement nominal. Après un siècle et demi d'agitations et de luttes, la
lignée memphite s'éteignit et elle fut remplacée par une famille d'origine
héracléopolitaine. Hâkhninsouten[100],
l'Héracléopolis des géographes grecs, dont le nom, altéré successivement en
Khninsou et Hnés[101], est reconnaissable
encore aujourd'hui dans la forme arabe Ahnas-el-Médinéh, était l'une des
villes les plus anciennes et les plus riches de l'Égypte. Située au coeur
même de l'Heptanomide, à trente lieues environ au sud de Memphis, elle
s'élevait dans une île assez considérable resserrée entre le Nil à l'orient,
et le grand canal qui longe le pied de la montagne Libyque, à l'occident.
Fondée, aux temps antéhistoriques, autour de l'un des sanctuaires les plus
vénérés du pays, elle n'avait pas encore de rôle politique, lorsqu'un de ses
princes, Khitoui, dont le nom nous est arrivé, avec la prononciation de l'âge
grec, en Achtoès, la tira de son obscurité et parvint à lui transférer la
prééminence, qui avait appartenu si longtemps à Memphis. Un roman d'époque
tardive le représentait comme ayant été le plus
cruel de tous ceux qui avaient régné jusqu'alors après avoir commis beaucoup
de crimes, il fut enfin frappé soudain de démence et il fut dévoré par un
crocodile[102]. Il régna
pourtant sur l'Égypte entière : son nom a été trouvé sur les rochers de
la première cataracte[103], et nous savons
qu'il guerroya contre les nomades de la péninsule sinaïtique[104]. Ses premiers
successeurs continuèrent de commander un siècle au moins à toute la vallée[105], mais les
grandes familles féodales qui dominaient dans les nomes, à Hermopolis, à
Siout, à Thinis, à Koptos, à Thèbes, à Éléphantine, se lassèrent enfin de
leur obéir. Au bout de trois ou quatre générations, les barons de Thèbes,
ayant groupé autour d'eux tons les seigneurs du Midi, assumèrent la dignité
royale. Dès lors, l'empire fut divisé entre deux maisons rivales dont l'une,
siégeant à Héracléopolis, fut comptée par les chronologistes comme formant
une dixième dynastie, héracléopolitaine de même que |