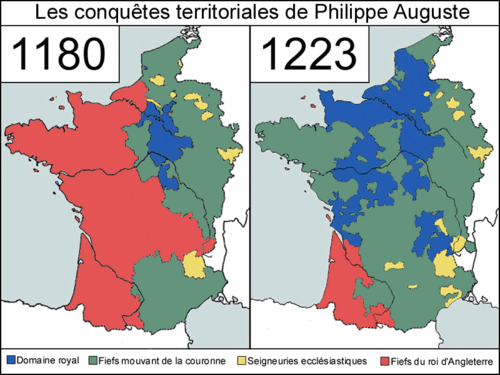Philippe Auguste et son temps — (1137-1226)
Livre II - Philippe Auguste et Louis VIII
V - Le gouvernement de Philippe Auguste
Texte mis en page par Marc Szwajcer
I. LES ACQUISITIONS TERRITORIALES. PHILIPPE AUGUSTE ET LA FÉODALITÉ.Philippe-Auguste est arrivé au point culminant. Par la politique et les armes, il a rendu la Royauté maîtresse de là France, et il a placé la France, en Europe, au premier plan. Nous avons vu le conquérant à l’œuvre : c’est le moment de faire connaître l’administrateur et l’homme de gouvernement. EXTENSION DU DOMAINE ROYAL.L’extension considérable, sous ce règne, du domaine royal
est le fait qui a le plus vivement frappé les contemporains. Presque tous les
chroniqueurs emploient la même formule : « Philippe a reculé les limites du
royaume », dilatavit ou
ampliavit
fines regni. Le
médecin Rigord, moine de Saint-Denis, lui attribue le surnom d’Auguste « parce que les auteurs anciens,
dit-il, appelaient Augustes les empereurs qui augmentaient (du verbe latin augeo) le domaine de l’État ; et
aussi parce que Philippe naquit au mois d’août ». Guillaume le Breton n’appelle
jamais son roi que le Grand, le Magnanime, ou encore « le fils de Charlemagne
», Karolides. Dans son
poème de la Philippide, il
le compare à Alexandre et à César, et il trouve que Philippe est bien
supérieur, « car le Macédonien n’a triomphé que pendant douze ans, Jules
César pendant dix-huit ans, tandis que Philippe a vaincu ses ennemis pendant
trente-deux ans sans interruption ». Un poète français du xive siècle, qui chanta ses hauts
faits, ne le désigne que sous le nom de « Philippe le Conquérant ». Il suffit en effet de comparer la France de Louis VII avec celle de Philippe Auguste, le petit domaine de l’Ile-de-France et du Berri, sans communication avec la mer, étouffé entre de puissants États féodaux, avec le vaste ensemble de fiefs ajoutés par Philippe Auguste au patrimoine primitif : l’Artois, l’Amiénois, le Valois, le Vermandois, une grande partie du Beauvaisis, la Normandie, le Maine, l’Anjou, la Touraine, un morceau important du Poitou et de la Saintonge. Le nombre des prévôtés est monté de trente-huit à quatre-vingt-quatorze. Le roi de Paris et d’Orléans est devenu le plus grand seigneur de la France du Nord et le maître d’un territoire étendu en Aquitaine ; la Royauté est établie à Dieppe, à Rouen, dans certains ports de Bretagne et de Saintonge, c’est-à-dire mise au rang des puissances commerçantes et maritimes. L’histoire n’offre pas beaucoup de changements plus rapides et plus complets dans la fortune d’un État.
LA SAUVEGARDE DU ROI.Mais aux conquêtes qui se voient et peuvent se marquer sur
les cartes, il faut joindre les annexions de détail, faites obscurément et
par milliers, aux époques de guerre comme en pleine paix, celles dont les
chroniques ne parlent pas. Les agents royaux travaillent dans les fiefs les
plus éloignés, les plus hostiles. Sous prétexte d’accorder la sauvegarde du Roi à une ville, à
un village, à une abbaye, à un groupe de marchands, à une corporation d’ouvriers,
ils prennent pied dans une foule de localités isolées où se créent peu à peu
des foyers de propagande monarchique. Avant l’avènement de Philippe Auguste, ces actes de
sauvegarde étaient exceptionnels ; sous son règne ils deviennent fréquents :
c’est que les villages et les bourgs avaient intérêt à se mettre sous la
protection d’un pouvoir fort. Saint-Satur en Berri (1182), Saint-André et
Couches en Bourgogne (1189 et 1186), les Mureaux près Mantes (1188),
Escurolles en Auvergne (1189), Boissi en Normandie (1205), Illier-l’Évêque,
au pays d’Évreux (1217), profitent de la sauvegarde royale. Ces localités dépendaient
surtout de seigneurs ecclésiastiques, qui demandaient eux-mêmes à opposer le
pouvoir bienfaisant du Roi à la tyrannie des châtelains. Il était plus rare
que la protection royale s’appliquât aux domaines des seigneurs laïques. Des
circonstances toutes spéciales ont pourtant permis à Philippe d’accorder sa
sauvegarde à Périgueux (1204), à Limoges (1213) et aux habitants de
Montpellier (1215). Même de simples particuliers pouvaient la recevoir : en
1211, Archambaud, bourgeois de Cahors, obtint pour dix ans la sauvegarde du
Roi. LES PARIAGES ROYAUX.Par un autre procédé, le pariage, c’est-à-dire l’association du Roi avec les petits
seigneurs ecclésiastiques ou laïques, en vue d’une administration commune,
les agents de Philippe Auguste introduisaient l’autorité de leur maître dans
des pays qui ne lui appartenaient pas. On ne trouve pas de pariages royaux
avant le règne de Louis VII, ce qui s’explique, la Royauté n’étant pas assez
puissante pour qu’il y eût avantage à la prendre comme associée. Il y en eut
quelques-uns sous Louis VII et un plus grand nombre sous Philippe Auguste. La
plupart des contrats de pariage sont conclus avec des seigneurs d’Église
(Cusset en 1184, Angi en 1186, Dimont en 1187, Wacquemoulin en 1190, Dizi et
Villeneuve d’Hénouville en 1196) ; deux ou trois avec des seigneurs laïques
(Concressault en 1182, Beaumont en 1204). Ces actes de pariage contiennent à peu près les mêmes clauses. Le seigneur déclare associer le roi de France à la moitié de ses propriétés et de ses revenus, et il énumère les objets partagés ainsi que ceux qui sont exceptés du partage. En général, les seigneurs paréagers, quand ils sont gens d’Église, gardent pour eux les revenus de caractère ecclésiastique, dîmes et produits des églises. Puis ils règlent l’administration de la localité mise en pariage ; elle est régie soit par un prévôt commun au Roi et au seigneur local, soit par deux prévôts représentant les deux associés. En retour des avantages qui sont faits au Roi, le seigneur a bien soin de stipuler que le Roi ne pourra pas aliéner la moitié qui lui est échue et qu’elle restera indissolublement liée à la couronne. Car l’objet du pariage serait manqué, si le Roi avait le droit de se substituer un autre seigneur. Dans la plupart des actes de pariage, la conséquence immédiate de l’association du Roi est l’abolition de la taille et l’introduction de coutumes bienfaisantes, telles que celle de Lorris. Le pariage est donc l’occasion d’un affranchissement partiel. On comprend tout l’avantage que la Royauté retirait de ces
contrats. Un associé tel que Philippe Auguste ne peut tarder à devenir un
maître. Possesseur de la moitié d’une localité, le Roi étend vite son
influence sur celle que s’est réservée le seigneur, et il finit, sinon par se l’approprier, au moins
par y exercer l’autorité entière. Tout pariage prépare une annexion. PHILIPPE ET LA PETITE FÉODALITÉ DU DOMAINE.Mise hors de pair, comme puissance territoriale, la Royauté possède donc, pour la première fois, les moyens d’agir en souveraine dans les fiefs. Philippe n’avait plus à redouter la féodalité de l’ancien domaine, celle qui avait donné tant de mal à Louis VI et inquiété encore Louis VII. Les châtelains de l’Ile-de-France, étroitement surveillés par les baillis royaux, n’osent même plus piller les terres d’Eglise. Les rébellions sont rares et vite réprimées. Le seigneur de Rozoi, après que le roi de France a fait mine, en 1201, de marcher contre lui, signe cet acte de soumission : « Moi, Roger de Rozoi, déclare m’être mis à la discrétion de mon seigneur Philippe, illustre roi de France, et lui avoir fait réparation pour ne lui avoir pas rendu mes services, comme je les lui dois. Et quant aux « entreprises » dont je me reconnais coupable envers les églises de Saint-Denis de Reims, de Saint-Médard de Soissons et d’autres encore, je donnerai telle satisfaction qu’il exigera. Quarante jours après qu’il aura fait connaître sa volonté, toutes les réparations seront ponctuellement accomplies. » En 1205, Gui, seigneur de La Roche-Guy on, qui a communiqué avec un ennemi particulier du Roi, signe l’acte suivant : « Pour avoir parlé avec Gautier de Mondreville, traître à mon seigneur le roi de France et voleur, j’ai donné satisfaction audit roi ; je lui ai cédé, ainsi qu’à ses héritiers, mes droits sur Beaumont-le-Roger (une ville de Normandie). En outre, j’ai fait serment à mon seigneur le Roi que je ne passerai pas l’Epte ou l’Eure, pour aller en Normandie, sans sa permission. Je lui livrerai de plus tous mes autres châteaux pour qu’il en fasse sa volonté, toutes les fois qu’il me le demandera. Enfin, j’ai fait jurer à tous mes vassaux, sur l’Evangile, que, dans le cas où ils apprendraient que je cherche à nuire, en quoi que ce soit, à mon seigneur le roi de France, ils l’en avertiraient aussitôt et prendraient son parti contre moi. » PHILIPPE ET LA GRANDE FÉODALITÉ.Les hauts barons eux-mêmes ne résistaient plus. Un comte
du Perche, en 1211, un seigneur de Montmorency, en 1218, un comte de Dreux,
en 1223, se soumettent à une obligation féodale que les vassaux ne
subissaient qu’à leur corps défendant. Ils jurent de livrer leurs châteaux à
leur suzerain, à toute réquisition, pour qu’il y mette garnison. « Je n’aurai
pas le droit, écrit Robert de Dreux, d’installer un châtelain dans mon château tant qu’il n’aura
pas prêté serment au Roi. Les hommes de ma commune de Dreux jureront de ne
jamais léser le Roi et de le servir au besoin. » Que devient, après un tel
accord, l’indépendance du comte de Dreux ? En vertu d’un droit de suzeraineté qu’il est le premier à exercer régulièrement, Philippe Auguste défend à ses vassales d’épouser les barons qui lui déplaisent et même les héritiers de certaines seigneuries, afin d’empêcher l’union de deux grands fiefs. Une comtesse d’Eu, une dame d’Amboise, une comtesse de Nevers, même une comtesse de Flandre se sont pliées à la volonté royale. Un puissant feudataire, le comte de Nevers, Hervé de Donzy, s’engage à ne donner sa fille ni à l’un des fils de Jean sans Terre, ni à Thibaut de Champagne, ni au fils du duc de Bourgogne, ni au seigneur de Coucy. PHILIPPE CONFIRME LES ACTES DES HAUTS BARONS.Sous les règnes précédents, les ducs et les comtes réglaient leurs rapports avec les clercs, les bourgeois et les nobles de leur ressort féodal, sans demander au roi la confirmation de leurs actes. Sous Philippe Auguste, le seigneur de Châteauroux, le seigneur de Bourbon, le comte de Nevers, le comte de Flandre, le duc de Bourgogne, demandent ou subissent la sanction du sceau royal pour les accords conclus avec leurs villes ou leur clergé. En 1194, Pierre de Courtenay, comte de Nevers, concède un privilège à ses manants d’Auxerre. Non seulement Philippe Auguste confirme l’acte, mais il fait insérer un article aux termes duquel il est chargé lui-même de veiller à l’exécution du contrat ; une autre clause stipule qu’il sera payé de sa peine : les bourgeois d’Auxerre verseront cent livres parisis au trésor royal. Philippe Auguste s’ingère dans la vie intérieure des nobles, et jusque dans leurs arrangements de famille. Il règle, en 1200, le partage de la succession d’Adam de Montfermeil. Il ne s’agit ici que d’un petit seigneur appartenant à la féodalité domaniale. Mais — ce que n’avaient pu faire ses prédécesseurs — il consacre aussi de son autorité les contrats d’intérêt privé, dans les baronnies les plus lointaines et dans les États féodaux de premier ordre. Le comte d’Auvergne, Guillaume, donne à sa femme, en 1212, trois localités du pays ; le comte de Saint-Pol cède à son fils pour dix ans la jouissance de son comté (1223) ; un échange de mariages a lieu, en 1205, entre les comtes de Forez et les seigneurs de Dampierre ; Aimar de Poitou revendique, en 1209, ses droits sur le Valentinois, etc. Tous ces actes reçoivent la confirmation royale. Il est probable que les intéressés eux-mêmes l’avaient demandée, croyant utile de faire valider leurs contrats par une puissance capable d’en assurer l’exécution. Mais ceci même prouve combien cette puissance avait grandi. Par l’exemple de la Champagne, on peut voir comment un grand fief perdait alors l’indépendance sans être en guerre avec le Roi. LE COMTÉ DE CHAMPAGNE SOUS PHILIPPE AUGUSTE.En 1201, Thibaut III, comte de Champagne, mourait, laissant une fille toute jeune, et sa veuve, Blanche, en état de grossesse. Immédiatement Philippe impose un traité à la comtesse. Blanche lui fait hommage, jure de ne pas se remarier sans son assentiment, s’engage à lui livrer sa fille et l’enfant dont elle est enceinte, et remet entre ses mains les châteaux de Brai et de Montereau. Peu après, lui naît un fils, Thibaut ; mais elle convient avec le Roi que son fils restera en minorité jusqu’à l’âge de vingt et un ans. Dès que l’enfant atteint sa douzième année, Philippe conclut avec la mère un nouveau traité qui confirme le premier et l’aggrave (21 novembre 1213) : Blanche et Thibaut jurent de servir fidèlement le roi de France ; ils s’interdisent, avant la majorité du comte, de fortifier Meaux, Lagni, Provins et Coulommiers, sans le consentement du Roi, aux mains de qui resteront les places de Brai et de Montereau. Cette convention est garantie par tous les seigneurs de Champagne, et la comtesse promet de payer 20.000 livres parisis si, avant un mois, elle n’en a pas exécuté toutes les clauses. Pour plus de sûreté, Philippe exige, l’année suivante, que le jeune Thibaut lui fasse hommage, et celui-ci s’engage par un acte spécial à ne pas sortir du « bail » de sa mère avant l’époque fixée pour sa majorité. Toutes les précautions sont bien prises pour que le comté de Champagne devienne une sorte d’annexé du domaine royal. Il faut que la comtesse demande au Roi l’autorisation de reconstruire un mur du château de Provins (1216) : encore Philippe lui défend-il d’y mettre des tourelles. Il lui envoie des mandements écrits du même ton que ceux qu’il adresse à ses baillis. En 1215, il lui annonce qu’il a modifié la législation relative au duel judiciaire : « Sachez que, sur le conseil d’hommes sages et dans l’intérêt général, nous avons décidé qu’à l’avenir les champions devront combattre avec des bâtons dont la longueur ne dépassera pas trois pieds. Nous vous mandons par la loi que vous nous devez, et vous requérons de faire publier et observer cette ordonnance dans toute l’étendue de votre État. » PROCÈS DE LA SUCCESSION DE CHAMPAGNE.La comtesse de Champagne obéit ; elle a, d’ailleurs, besoin de l’appui du Roi contre un compétiteur au comté, Érard de Brienne. Cet aventurier est allé jusqu’au fond de l’Orient chercher, pour en faire sa femme, une fille de l’ancien comte de Champagne Henri II, et il la ramène en France pour opposer ses droits à ceux du fils de Blanche (1216). Blanche le fait excommunier par le Pape, et des agents de Philippe Auguste l’arrêtent à son passage au Pui en Vêlai ; mais Érard s’échappe et entre en Champagne, où la guerre commence. Philippe refuse l’hommage du prétendant sous prétexte que la loi féodale lui défend d’écouter les réclamations qu’on peut faire valoir sur le comté avant que le jeune Thibaut soit majeur. Erard en appelle à sa justice ; la cour du Roi se réunit à Melun (juillet 1216) ; le procès est jugé et la sentence rendue en faveur de Blanche et de Thibaut. Plus que jamais la Champagne est entre les mains de Philippe Auguste. Thibaut devient majeur en 1222 ; mais le premier acte du jeune comte est un engagement de servir fidèlement le roi de France. En décembre 1222, les officiers du comte veulent saisir, suivant la coutume, les biens de l’évêque de Meaux décédé. Philippe Auguste écrit directement aux baillis, prévôts et sergents de son vassal, comme à ses propres agents, et leur fait défense d’occuper les domaines épiscopaux. LE DUCHÉ DE BOURGOGNE.Le duc de Bourgogne, Eude III (1193-1218), est un allié fidèle de Philippe Auguste, le docile exécuteur de ses volontés. Et quand il meurt, le roi de France a cette bonne fortune de voir la Bourgogne, comme la Champagne et la Flandre à la même époque, administrée par une femme qu’il est facile d’assujettir. Alix de Vergi, duchesse de Bourgogne comme tutrice de son fils mineur, Hugues IV, est obligée, pour entrer en possession du fief (août 1218), de s’engager à servir avec dévouement « son très cher seigneur Philippe », de lui promettre qu’elle ne se remarierait pas sans son consentement et de lui donner, comme garantie de sa promesse, les principaux seigneurs de Bourgogne. « S’il arrivait, écrit-elle, ce qu’à Dieu ne plaise, que je manque à mes engagements, mes vassaux aideront, de tout leur pouvoir et de toutes leurs ressources, le seigneur Roi, jusqu’à réparation complète du tort que je lui aurai causé. » LES HAUTS BARONS ACCEPTENT LA LÉGISLATION ROYALE.Le temps n’est plus où les États souverains de la France seigneuriale n’avaient, avec la Royauté, que les rapports superficiels d’un vasselage de théorie. Nous constaterons ailleurs que les grandes seigneuries se résignaient à être justiciables de la cour de Philippe Auguste ; elles en arrivent aussi à accepter ses décisions législatives et à leur donner, chez elles, force de loi. Les hauts barons contresignent les ordonnances générales du Capétien : en 1214, celle qui établit que la femme aura en douaire la moitié des biens de son mari ; en 1219, celle qui dispose que les parents de la femme décédée sans enfants n’hériteront pas des acquêts faits par elle et par son mari pendant la durée du mariage et n’auront droit qu’à son apport dotal. Ainsi la Féodalité accepte que le roi de France transforme la loi féodale : elle subit les innovations de ses légistes ! On ne voit pas qu’elle ait protesté contre l’établissement de 1209, la plus importante de toutes les modifications apportées par Philippe à la coutume. Lorsqu’un fief sera divisé entre plusieurs héritiers, ces feudataires multiples seront tous les vassaux directs, non pas de l’un d’entre eux, comme le voulait l’ancien usage, mais du suzerain du fief : disposition favorable à l’autorité des hauts seigneurs, mais surtout à celle du Roi, suzerain de tant de seigneuries. Supprimer des fiefs intermédiaires et certains degrés de la hiérarchie, c’était changer les bases du système féodal et préparer l’unité monarchique. LE ROI ET LA FÉODALITÉ DE L’EST ET DU MIDI.Pendant que Philippe Auguste entamait ainsi l’indépendance des hauts barons de la France capétienne proprement dite, il ne négligeait pas les moyens d’introduire son autorité dans ces pays de l’Est et du Midi, où son père avait surtout gagné les clercs. Sur la lisière du royaume d’Arles, il tâche d’attirer à lui et d’enlever à l’Empire les petits seigneurs et les grands barons. Dès 1188, il reçoit l’hommage du sire de Tournon. En 1198, il confirme à Guigues IV, fils du comte de Forez, Guigues III, les droits que Louis VII avait reconnus à son père sur ses terres et celles de ses vassaux, notamment la garde des routes. Il encourage ces comtes à s’allier, par des mariages, avec la famille de Gui de Dampierre, seigneur de Bourbon, serviteur zélé de la Royauté. En 1212, Bertran de la Tour reçoit de lui, après l’hommage, les châteaux d’Orcet, de Montpeyroux et de Coudes, en Auvergne. En 1219, un noble du Vêlai, Pons de Montlaur, se reconnaît son vassal pour les châteaux de Montbonnet, de Montauroux et de Chambon. La féodalité cévenole s’oblige à ne pas construire de nouveaux châteaux depuis le Rhône jusqu’à Alais, d’Alais à Montbrison et de Saint-Auban au Pui. Dans le Périgord, le Limousin et le Quercy, on commence à sentir l’action du roi de France, et parfois les féodaux sollicitent sa domination. Hélie de Périgord lui fait hommage pour son comté (1204), Bertran de Gourdon pour sa seigneurie, que Philippe s’engage à ne jamais séparer de son domaine (1211). En 1212, Philippe prend le même engagement envers Robert, vicomte de Turenne, qui est devenu son vassal. La même année, recevant l’hommage du comte Archambaud de Périgord et de Bertran de Born, seigneur d’Hautefort, le fils du troubadour, il promet de maintenir sous son vasselage et dans son domaine direct le château d’Hautefort et le comté de Périgueux. On verra comment la guerre des Albigeois, en substituant à
l’ancienne maison de Saint Gille celle d’un petit seigneur de la Francia, Simon de Montfort,
ouvrit le Languedoc à Philippe Auguste. Lorsqu’en 1216, Simon lui fit hommage
pour le duché de Narbonne, le comté de Toulouse et les vicomtes de Béziers et de
Carcassonne, ce fut un événement de grande importance. La suzeraineté du roi
de France sur le Midi, jusqu’alors vague et théorique, devenait directe et
réelle. PRÉPONDÉRANCE DE LA MONARCHIE.Ainsi beaucoup de seigneuries du royaume, que le domaine capétien n’englobait pas, tombaient peu à peu sous la domination du Conquérant. Flandre, Ponthieu, Auvergne sont devenus des fiefs assujettis et surveillés par les agents du Roi. La Bretagne est entre les mains d’un Capétien de la branche cadette, Pierre de Dreux. On a vu que le Roi exerçait une sorte de protectorat sur la Champagne et la Bourgogne. Grandes conquêtes ou petites acquisitions, progrès accomplis par absorption violente ou par infiltration pacifique, tout contribue à préparer et à établir un ordre de choses vraiment nouveau. A l’avènement de Philippe Auguste, l’aristocratie féodale était encore la grande puissance territoriale et politique de la région française. A sa mort, par un renversement absolu des situations, par le déplacement de la propriété et du pouvoir, c’est la Monarchie qui prévaut. II. LE ROI ET LE CLERGÉMonarque très chrétien, défenseur de la foi, protecteur de l’Église, Philippe Auguste était tenu d’enrichir et de privilégier les chapitres et les abbayes, où clercs et moines priaient pour le salut de son âme, mais il ne prodigua ni son argent ni sa terre ; il a surtout confirmé les donations de ses prédécesseurs. Il ne s’est montré généreux que pour les églises situées hors de l’ancien patrimoine capétien, celles de la Normandie, de l’Aquitaine, du Languedoc. Il fallait bien se concilier le Clergé dans les provinces conquises, ou convoitées, et renouer la tradition des temps carolingiens, qui voulait que le clergé de la France entière fût sous le patronage éminent du Roi. Quand Philippe Auguste accorde à l’évêque de Lodève le droit de se servir de la bannière capétienne, et aux moines de Sarlat la confirmation des bienfaits de Louis le Débonnaire, il prouve la supériorité de la puissance royale sur les pouvoirs féodaux et fait pénétrer au loin l’influence de la Royauté. PHILIPPE PROTÈGE L’ÉGLISE.Comme ses prédécesseurs, il fait campagne pour défendre
les évêques et les abbés contre les féodaux. En 1180, n’étant pas encore roi en titre, il allait
dans le Berri châtier le seigneur de Charenton, ennemi des moines, puis en
Bourgogne, où le comte de Chalon et le seigneur de Beaujeu persécutaient l’Eglise.
En 1186, sur la plainte des clercs, il mène contre le duc de Bourgogne l’expédition
importante dont nous avons parlé, et, quand le duc est vaincu, il l’oblige à
réparer les torts faits aux évêques. En 1210, ses soldats délivrent l’évêque
de Clermont des vexations du comte d’Auvergne. Dans cette dernière circonstance, en même temps qu’il
protégeait l’Église, le Roi trouvait l’occasion d’humilier un haut feudataire
qui s’était coalisé avec les maisons de Flandre et de Champagne. Philippe est moins pressé de se mettre au service du Clergé, quand son intérêt politique n’est pas en cause. Aux églises du pays de Reims, qui, après avoir refusé de se laisser taxer par lui, réclamaient en 1201 le secours de ses armes contre les comtes de Rethel et de Rouci, il fit cette réponse : « Vous ne m’avez aidé que de vos prières, je vous secourrai de la même façon. » La persécution devenant intolérable, les évêques insistent, avouent leur tort, supplient le Roi d’intervenir : « Voyant que la leçon a porté », dit Guillaume le Breton, « Philippe le Magnanime se décide enfin à se mettre en marche. » Il concentre ses troupes à Soissons, et cette démonstration suffit : les nobles pillards donnent satisfaction à leurs victimes. Quand le peuple et le Clergé, ces deux forces sur lesquelles il s’appuie, sont en querelle, il est fort embarrassé. S’il ne réussit pas à les réconcilier, et qu’il lui faille prendre parti, il soutient d’ordinaire les intérêts de l’Église. L’ÉGLISE DÉFENDUE PAR LE ROI CONTRE LES COMMUNES.En 1222, à Noyon, un serviteur des chanoines de Notre-Dame
ayant été arrêté par les magistrats municipaux dans le cimetière de la
cathédrale et mis en prison, le chapitre essaye de se faire remettre le
prisonnier, lance l’interdit sur la ville et excommunie le maire et les
jurés. Aussitôt les bourgeois se rassemblent aux cris de : Commune ! Commune ! et pénètrent
de force dans le cloître. Ils arrivent jusqu’à la cathédrale où l’on
célébrait les offices. Les portes de l’église sont forcées, le peuple y
pénètre en tumulte, maltraite tous les prêtres qu’il rencontre et notamment l’official,
le juge de l’évêque, dont la robe est déchirée. Le doyen du chapitre, lui-même,
est grièvement blessé. Philippe Auguste dut aller à Noyon et imposer la paix. Ce fut la commune qui en fit les frais. Par jugement du
Roi, le maire fut contraint de relâcher son prisonnier, de payer aux
chanoines une indemnité de 150 livres, de faire, avec six jurés, un dimanche,
amende honorable à
la procession. On condamna les bourgeois à dénoncer les coupables encore
inconnus ; leurs magistrats jurèrent qu’ils ne mettraient jamais la main sur
la personne des chanoines ou de leurs serviteurs. Enfin, le cri de : Commune !, considéré comme
séditieux, fut interdit. Les juges municipaux de Noyon se querellaient aussi avec l’évêché pour des questions de juridiction. Impatienté de ces démêlés perpétuels, Philippe Auguste rendit trois arrêts successifs et, trois fois, donna tort à la bourgeoisie. Il décida que la connaissance de toutes les querelles entre la commune et l’évêque appartiendrait, non aux échevins, juges communaux, mais au tribunal des francs-hommes de l’évêché. Il fut obligé de protéger ainsi, dans la plupart des autres communes, le pouvoir, la propriété et la justice des clercs, sans cesse menacés par les bourgeois. A Sens, il excepte de la commune les sujets de l’Église pour les maintenir dans la dépendance de l’archevêque. Au Pui, à Tournai, à Beauvais, il contraint les habitants à s’acquitter envers l’évêque du devoir féodal. Il s’engage à ne pas laisser les bourgeois de Soissons relever les fortifications qu’ils avaient construites pour narguer leur seigneur ecclésiastique. A Compiègne et à Laon, il force les gouvernements municipaux à payer ce qu’ils doivent aux églises. Il veut que la commune de Vailli, en Soissonnais, laisse en paix les moines de Hesdin et fasse, tous les ans, lecture publique de la charte royale qui garantit les possessions des religieux de Vaucelles. Défense aux échevins de Tournai, aux jurés d’Arras et de Soissons d’empiéter sur les droits de l’évêché ou des chapitres. A Châlons les bourgeois devront subir l’excommunication dont leur évêque les a frappés et lui donner satisfaction entière (1210). A Reims, Philippe enjoint aux échevins de rendre à l’archevêque les clefs de la ville et de ne pas recevoir les personnes qu’il a bannies. Enfin, il invite le maire et les jurés de Péronne, excommuniés par l’archevêque de Reims, à réparer leur faute et à payer au prélat une amende de cent livres, prix de leur absolution (1220). MOT DE PHILIPPE SUR SES RAPPORTS/VEC L’ÉGLISE.Le roi de France remplit donc ses obligations envers l’Église
; mais, en retour, il exige d’elle, avec rigueur, l’obéissance et tous les
services auxquels il la croit tenue. Aussi lit-on avec surprise ce passage de
Joinville où saint Louis adresse ses suprêmes recommandations à son fils et
lui donne Philippe Auguste en exemple : « On raconte du roi Philippe, mon
aïeul, qu’une fois un de ses conseillers lui dit que ceux de la Sainte Église
lui faisaient beaucoup de torts et d’excès, en ce qu’ils lui enlevaient ses
droits et diminuaient ses justices, et que c’était bien grande merveille qu’il
le souffrît. Et le bon Roi répondit en effet qu’il le croyait bien, mais il considérait les
bontés et les courtoisies que Dieu lui avait faites : alors, il aimait mieux
perdre de son droit qu’avoir débat avec les gens de la Sainte Église. » La vérité est que la politique ecclésiastique de ce bon roi ne fut le plus souvent
qu’une politique de conflits. Évêques traduits devant la justice royale,
chassés de leurs sièges, privés de leurs « régales », c’est-à-dire de leurs
revenus temporels ; diocèses occupés manu
militari et rançonnés par les officiers du Roi ; mesures
législatives prises expressément, avec solennité, pour arrêter les progrès de
la justice d’Église ; impôts extraordinaires prélevés de force sur les
évêchés et les abbayes ; obligation durement imposée aux membres du Clergé de
soutenir le Gouvernement royal dans ses luttes fréquentes avec le Pape : par
ces procédés, Philippe Auguste a fait comprendre à tous qu’il entendait être
le maître de ses évêques et de ses abbés, aussi bien que de ses barons. PHILIPPE ET LES ÉLECTIONS ECCLÉSIASTIQUES.On ne peut dire pourtant qu’il ait abusé de son pouvoir
pour vicier les élections ecclésiastiques et imposer ses créatures. Depuis
Louis le Gros, l’intervention du Roi dans les opérations électorales
consistait simplement à accorder aux électeurs l’autorisation d’élire, puis à
exiger que leur choix fût soumis à son consentement. Un souverain comme
Philippe Auguste, résolu et sans scrupule, pouvait trouver dans l’exercice de
ce droit un moyen de peser sur les électeurs et de pratiquer la candidature
officielle. Mais on ne le voit guère refuser la permission d’élire ou l’approbation
des élections faites. Il ne paraît même pas tenir beaucoup à cette
prérogative de la souveraineté. En 1203 et 1204, quand il accorde au clergé
de Langres et d’Arras l’abandon de la régale, il concède aux chanoines, par
la même occasion et pour le même prix, la liberté d’élire leur évêque sans
permission préalable. Devenu le maître de la Normandie, il renonce à
conserver sur le clergé normand le pouvoir presque absolu des Plantagenêts,
qui nommaient directement les évêques : il abandonne jusqu’au droit de
régale. L’auteur de la Philippide lui
fait dire : « A moi appartient le soin de tout ce qui touche le glaive
temporel : le gouvernement du royaume me suffit. Je laisse aux hommes de Dieu
à traiter les choses du service de Dieu. » INGÉRENCE DE LA PAPAUTÉ DANS LES ÉLECTIONS.Une autre puissance se permettait ce que Philippe ne
faisait pas lui-même. En 1199, à la mort de Michel, archevêque de Sens, le
chapitre élit Hugues, évêque d’Auxerre ; mais Innocent III donne l’archevêché
à Pierre de Corbeil, évêque de Cambrai, son ancien professeur à l’Université
de Paris. En 1204, à Reims, sous prétexte que les chanoines n’étaient pas d’accord,
il nomme archevêque un de ses cardinaux, Guillaume Paré. En 1220, le clergé
de Paris avait élu pour évêque, à une grande majorité, maître Gautier Cornu ; l’archevêque de
Sens l’avait confirmé ; le choix était excellent, de l’aveu même du pape Honorius
III ; mais celui-ci préférait l’évêque d’Auxerre, Guillaume de Seignelay,
connu par son opposition à Philippe Auguste, et le candidat du Pape fut
transféré sur le siège de Paris. Comment expliquer que le Roi, en ces
circonstances, ait laissé faire ? Il jugeait peut-être que les élections d’évêques
étaient, en soi, chose indifférente et que le pouvoir civil n’avait pas à
intervenir. LE SERVICE MILITAIRE EXIGÉ DES ÉVÊQUES.Au reste, ce protecteur de l’Église exerce sur elle son autorité. Il demande aux évêques et aux abbés, comme à ses barons, le serment de fidélité, le service d’ost, l’accomplissement de tout le devoir féodal. En 1193, Etienne, évêque de Tournai, reçoit l’ordre de comparaître avec son contingent la veille de l’Ascension et de la Pentecôte. L’évêque, un lettré, un pacifique, s’excuse : « Il ne connaît rien, dit-il, au service de la guerre ; depuis Chilpéric, les rois de France n’ont jamais demandé aux évêques de Tournai que la fidélité et l’assistance à la Cour. » Il implore la protection de l’archevêque de Reims, Guillaume de Champagne : « Mon père, lui écrit-il, il est bien difficile d’entrer en lutte avec le seigneur Roi, et pourtant il m’est impossible de faire ce qu’il demande. Je me trouve entre l’enclume et le marteau. Ou il faut que j’offense le Roi, ou il faut que je fasse un service que je ne dois pas. » RÉSISTANCE DES ÉVÊQUES D’ORLÉANS ET D’AUXERRE.Le refus de service pouvait coûter cher. Les deux frères de Seignelay, Manassès, évêque d’Orléans, et Guillaume, évêque d’Auxerre, n’ayant pas envoyé leurs hommes à l’armée royale de Bretagne (1210), sous prétexte qu’ils n’étaient pas tenus au service d’ost quand le Roi ne commandait pas en personne, Philippe fait saisir leur temporel. Les évêques mettent l’interdit sur leurs diocèses et vont se plaindre à Rome. Innocent III intervient en leur faveur, mais il est obligé, en 1212, d’inviter les deux évêques à accepter un compromis. Le Roi resta en possession des revenus qu’il avait touchés pendant la séquestration des diocèses ; mais il donna aux évêques une indemnité de 300 livres et les dispensa du service militaire personnel, à condition que, suivant la coutume, ils enverraient leurs contingents. S’il exigeait de son clergé l’observation de la loi
féodale, il ne jugeait pas qu’elle fût faite pour lui-même. En 1218, l’évêque
d’Orléans, Manassès, se plaignit qu’il eût fait bâtir une grosse tour à
Sulli, dans le château d’un feudataire de l’évêché. Le Roi répondit qu’il
avait désintéressé, sur son trésor, des marchands que le châtelain de Sulli
avait dévalisés, et que Inoccupation du château n’était qu’une manière de
remboursement. L’évêque va à Paris, offre au Roi de lui restituer ce qu’il a dépensé,
Philippe s’obstina à garder sa tour. Il fallut l’intervention presque
menaçante d’Honorius III pour qu’il consentît à une transaction. Manassès
rentra en possession de la forteresse construite dans son ressort féodal,
mais il fut tenu de la remettre au Roi à toute réquisition. Vassal de l’Église pour certaines terres, Philippe refusa l’hommage, disant que le roi de France ne le devait à personne. La Royauté, par là, se mettait hors de la loi commune. Les évêques d’Amiens, de Térouanne, d’Auxerre, de Noyon, de Beauvais se trouvèrent ainsi frustrés de leur droit de suzerains. Philippe leur donna, il est vrai, des compensations : l’abandon de son droit de gîte, des rentes en vin ou en blé, plus rarement des terres, quelquefois même simplement (comme à Amiens) de bonnes paroles, un certificat de dévouement au Roi. LES ÉVÊQUES ET LA JUSTICE ROYALE.Il entendait, comme ses prédécesseurs, que l’Église fût
soumise à sa justice. L’évêque d’Orléans, Manassès, était en procès avec lui
au sujet du gîte royal de Meung et de Pithiviers. L’affaire fut portée devant
la Cour, à Paris : mais l’évêque prétendit qu’il ne pouvait être jugé que par
les évêques (1210). Il n’ignorait pas cependant qu’au xiie siècle, des évêques et des abbés
avaient comparu devant la Cour du Roi, où se trouvaient toujours, d’ailleurs,
parmi les juges des gens d’Église. Le Roi confisqua une fois de plus le
temporel de Manassès. Six ans plus tard, lorsque la Cour de France, où se
trouvèrent réunis pour la circonstance les plus hauts barons et beaucoup de
prélats, eut jugé le procès d’Érard de Brienne, prétendant au comté de
Champagne, une voix s’éleva contre le jugement rendu, celle de Manassès. Il
nia la compétence du tribunal, ce qui fit scandale au point qu’il fut obligé
de désavouer ses paroles et de faire ses excuses au Roi et aux barons. Son frère Guillaume, devenu évêque de Paris, n’était pas mieux disposé pour Philippe Auguste. D’une mince question de propriété, l’affaire du Clos-Bruneau (1221), sortit un débat irritant entre le Roi et l’évêque. Guillaume fit traîner le procès en longueur, puis, un jour, déclara que la Cour du Roi n’était j>as qualifiée pour le juger, et que la cause ressortissait aux tribunaux d’Église. Le Roi répliqua que l’évêque n’avait pas le droit de récuser et de déprécier ses juges. Sur quoi Guillaume quitta la Cour. Nous ne savons, au reste, comment finit l’incident. LA JURIDICTION D’ÉGLISE.Précisément à la fin du xiie siècle et au commencement du xiiie, la juridiction des tribunaux
ecclésiastiques fortifiés par l’institution des officialités, devenait
envahissante. L’Église ne se contentait pas de connaître de toutes les causes
où étaient impliqués ses membres ; elle intervenait dans les démêlés des laïques, s’il
s’agissait de personnes placées sous sa protection spéciale : les croisés,
les orphelins, les veuves, les étudiants, les notaires, les sergents et les
autres employés des seigneuries religieuses. Elle prétendait étendre aussi sa
compétence à toutes les matières qui pouvaient, de près ou de loin,
intéresser la religion. Non seulement les affaires spirituelles proprement
dites, vœux, sacrements, dîmes, élections, délits commis dans les lieux saints,
sacrilège, hérésie, sorcellerie, simonie, mais le mariage, les fiançailles,
les séparations, l’adultère, la légitimation, étaient pour elle des cas
religieux. Que restait-il aux tribunaux de la Féodalité et du Roi. ? PHILIPPE VEUT LIMITER LA JURIDICTION D’ÉGLISE.Un mouvement de réaction très vive contre les abus de la juridiction ecclésiastique se produisit alors parmi les féodaux, et la Royauté s’y associa. « Philippe voulait », dit l’historien d’Auxerre, en 1180, à propos d’un conflit entre le gouvernement capétien et l’archevêque de Sens., « que les causes séculières fussent exclusivement jugées à sa cour et que l’archevêque se réservât seulement la connaissance des causes ecclésiastiques. » Mais distinguer les causes spirituelles des causes séculières, c’était à peu près impossible au Moyen Âge. L’archevêque de Sens protesta contre les prétentions de Philippe et lui reprocha bien d’autres « empiétements nouveaux » sur le domaine ecclésiastique. Le Roi le mit dans l’alternative de céder ou de quitter son diocèse. L’archevêque préféra l’exil. Un acte très significatif, la convention de 1205-1206,
appliquée en Normandie, et peut-être aussi dans d’autres régions, disposa que
les juges d’Église ne pourraient connaître des matières féodales ; qu’en
certains cas les juges laïques auraient la faculté d’arrêter et de justicier
les clercs coupables ; que le droit d’asile des édifices religieux serait
limité ; que l’Eglise ne pourrait excommunier ceux qui font le commerce le
dimanche ou qui négocient avec les Juifs ; qu’enfin, un bourgeois ayant
plusieurs enfants ne pourrait donner à celui de ses fils qui serait clerc qu’une
partie de ses terres inférieure à la moitié. La participation de la Royauté à
cet acte législatif est très probable ; car le document est daté de Paris et
porte en tête : Propositions du
Roi contre le Clergé, ou encore : Articles relatifs aux entreprises faites contre la juridiction du
seigneur Roi. Il s’agit bien d’une ordonnance rendue sous l’inspiration
de Philippe Auguste pour protéger ses droits contre les empiétements des
clercs, et la Monarchie y fait cause commune avec la Féodalité. En novembre 1206, le comte de Boulogne, le châtelain de
Beauvais et un grand nombre de seigneurs normands réunis à Rouen attestent
par serment les droits dont jouissaient le Roi et les seigneurs, dans leurs rapports avec le
Clergé, au temps d’Henri II et de Richard Cœur-de-Lion. Les signataires de
cette déclaration solennelle, scellée de vingt-deux sceaux, ont voulu,
disent-ils, « défendre leurs droits et ceux du Roi contre l’Église ». Un an
après, les évêques de Normandie acceptaient un règlement de procédure qui
déterminait les cas où la justice royale serait saisie (octobre 1207). Enfin,
en 1218, l’archevêque de Rouen reconnaissait le pouvoir des baillis royaux
dans les affaires de patronage des églises ; il consentait à restreindre l’abus
du droit d’asile et à promettre d’excommunier moins facilement les agents du
Roi. Par les paroles, les écrits, les actes, Philippe Auguste manifesta, en toute occasion, sa volonté arrêtée de subordonner la justice d’Église à la sienne et de tenir le Clergé en main. III. LE ROI ET LES PAYSANSPHILIPPE ET LA POPULATION SERVILE.Ce roi de France, qui s’éloigna, sur tant de points, de la tradition de Louis VII, n’a pas laissé entrevoir, dans les préambules de ses chartes, qu’il plaignît beaucoup les paysans de condition servile. Sans doute ces préambules n’étaient pas l’expression formelle des sentiments du souverain, et il faut se garder d’en exagérer la valeur historique. Mais les scribes qui les rédigeaient s’inspiraient souvent des dispositions du maître. Une seule fois, en confirmant une libération de trois cents serfs de l’abbaye de Saint-Aignan d’Orléans, Philippe a écrit par la plume de ses clercs : « Attendu que c’est faire un acte de piété que de délivrer du joug de la servitude l’homme formé à l’image de Dieu. » Cet acte pieux, il l’a fait rarement lui-même ; dans la plupart des cas, il s’est borné à approuver, moyennant finances, les affranchissements accordés par les seigneurs ecclésiastiques et laïques. On possède plus de 2.000 actes émanés de sa chancellerie :
il n’y a que deux ou trois chartes d’affranchissement qui procèdent de lui
directement. En 1220, il libère les hommes de Pierrefonds de la mainmorte et
du formariage. En 1221, il exempte ses hommes de La Ferté-Milon des mêmes
servitudes. Encore cette générosité n’est-elle pas gratuite. Les hommes de
Pierrefonds devront payer vingt livres parisis de plus qu’auparavant ; ceux
de La Ferté-Milon, quarante livres. Le Roi a soin d’ailleurs de stipuler qu’ils
resteront soumis à la chevauchée,
à la taille, à tous les services et à toutes les coutumes non serviles qu’il
exigeait d’eux avant la libération. Il leur défend expressément de se marier,
maintenant qu’ils sont affranchis, avec des personnes de condition serve
appartenant à d’autres seigneuries, car leurs biens et possessions auraient
été, en ce cas, perdus pour lui. PRÉCAUTIONS PRISES CONTRE LES SERFS ROYAUX.Il prend aussi toutes les précautions nécessaires pour que ses hommes et ses femmes de corps ne se libèrent pas d’eux-mêmes, en désertant son domaine. Ses chartes de franchise ou de commune (notamment celles de Voisines, Saint-Quentin, Athies et Beaumont-sur-Oise) contiennent une clause portant que les serfs et serves de sa terre n’auront pas le droit de s’établir dans la localité affranchie, ou de faire partie de la commune. « S’il arrive, dit-il dans l’acte relatif à Saint-Quentin (1195), qu’un homme de corps nous appartenant soit reçu par mégarde dans la commune, nous ferons savoir aussitôt à la commune que cet homme est dans notre servage et les gens de la commune ne pourront pas le retenir. » PHILIPPE ATTIRE CHEZ LUI LES SERFS SEIGNEURIAUX.Il trouve naturel, au contraire, que les domaines seigneuriaux soient désertés au profit du sien. « Seront reçus dans cette franchise, dit l’acte relatif à Beaumont-sur-Oise (1223), tous les hommes, à quelque seigneurie qu’ils appartiennent, qui voudront s’établir à Beaumont, à l’exception de mes hommes et de mes femmes de corps, de mes hôtes et de leurs fils. » Des seigneurs voisins du domaine royal se trouvant lésés et portant plainte, Philippe fait des concessions. En 1187, le seigneur de Sully-sur-Loire obtient, par faveur spéciale, que les hommes de Sulli ne soient pas reçus comme hôtes sur les terres du Roi. La comtesse de Champagne (1205), ayant représenté que les serfs champenois se réfugiaient en nombre dans la ville royale de Dimont (Yonne), le Roi déclare qu’il gardera tous les serfs qui y ont pris résidence depuis plus d’un an. Il accorde seulement que ceux qui s’y sont établis depuis ou s’y établiront à l’avenir abandonneront leurs propriétés au seigneur dont ils auront déserté la terre, ce qui, d’ailleurs, était de droit dans plusieurs coutumes. Quand l’évêque de Nevers se plaignit, lui aussi, en 1212,
du même dommage, Philippe voulut bien, dans la convention signée avec lui,
insérer cette clause : « Si un serf épiscopal vient à s’établir dans notre
domaine, nous le ferons saisir, et, après enquête sur sa condition, s’il est
prouvé qu’il appartient réellement à l’évêché, nous le ferons remettre à l’évêque.
» Mais il laisse à ce serf le droit de se racheter pour rester, libre, en
terre royale, et stipule que l’évêque ne touchera que la moitié du prix de
rachat ; l’autre moitié devra revenir au Roi. Non seulement il bénéficiait de la présence, dans
sa ville, d’un homme qui ne lui appartenait pas, mais il se faisait payer l’avantage
d’avoir un sujet de plus. Beaucoup des serfs déserteurs de l’évêché de Nevers
étaient allés se réfugier dans les villes royales de Bourges et d’Aubigni-sur-Cher.
L’évêque avait renoncé à les revendiquer, mais il demanda qu’on les
contraignît au rachat, et qu’il pût toucher, aux termes du traité, la moitié
des sommes données par les affranchis. « Non, répondit Philippe Auguste, pour
ceux-là la convention n’est pas valable : ils sont couverts par la
prescription. » CONFIRMATION D’AFFRANCHISSEMENTS.Lorsque le Roi confirmait les affranchissements faits par autrui, le plus souvent par des églises, il y trouvait un double profit : de l’argent et de la considération. La Royauté apparaissait comme la puissance bienfaisante qui validait l’acte libérateur et le rendait définitif. Les paysans réservaient leur gratitude, non pas au seigneur immédiat qu’ils payaient, mais au suzerain éloigné dont l’intervention leur semblait désintéressée. Ils gardaient comme une relique la charte signée du Roi et scellée de son sceau. Parfois, pour donner plus de solennité à l’acte d’émancipation, le seigneur qui affranchissait allait accomplir la cérémonie au palais du souverain. En 1202, un noble des environs de Paris, Ferri de Palaiseau, libéra, devant Philippe Auguste et sa cour, un certain nombre de serfs et de serves. L’intervention personnelle du Roi semblait donner à l’affranchissement un caractère spécial d’inviolabilité. LES HÔTES ROYAUX.Les privilèges accordés par Philippe Auguste à la classe
des hôtes, de condition
plus ou moins libre, sont peu nombreux, et encore ont-ils le plus souvent
pour objet, non d’améliorer la condition des hôtes royaux déjà établis, mais
d’attirer des cultivateurs dans une localité déserte du domaine ou d’exempter
de certaines charges les hôtes des lieux acquis en pariage. Il s’agit de
gagner l’affection de sujets nouveaux. Ainsi s’explique, par exemple, la
charte de coutumes accordée par le Roi, en 1196, aux manants du village de
Villeneuve-Saint-Mellon ou Villeneuve-le-Roi. Ces hôtes ne paieront, comme
impôt direct, qu’un cens de cinq sous et un setier d’avoine pour la maison qu’ils
habitent ; comme impôt indirect, qu’un tonlieu d’un denier pour chaque
tonneau de vin vendu. Les amendes judiciaires, qui sont fixées communément à
soixante sous, sont rabaissées pour eux à sept sous et demi. Leur service
militaire est très allégé : ils n’iront à l’ost et à la chevauchée que lorsqu’ils
pourront rentrer dans leurs foyers le soir même du jour où on les aura
convoqués. Enfin le Roi déclare que leur village restera à perpétuité dans le
domaine de la Couronne. Mais il faut noter que Philippe Auguste octroie ces
privilèges attrayants à une
localité qui n’est pas encore peuplée. Il fonde une ville neuve et il
y appelle les habitants. Le Roi est beaucoup moins généreux pour les hôtes
domaniaux déjà installés. Il leur défend expressément d’aller s’établir à
Villeneuve-Saint-Mellon ou à Chaumont-sur-Oise. Dans la charte de Voisines
(Yonne), accordée en 1187, il dit : « Quiconque aura séjourné dans ce village
un an et un jour, sans avoir été l’objet d’aucune plainte et d’aucune
revendication, restera libre et exempt de toute poursuite, à l’exception de
nos hommes de corps et de nos hôtes
taillables. On ne pourra les retenir que s’ils habitaient la
localité avant l’octroi de la présente charte. » II est clair que Philippe
tient à conserver la propriété de ses hôtes, comme celle de ses serfs. En somme, ce roi de France ne s’est intéressé à la libération du peuple rural que dans le domaine d’autrui, par exemple dans celui de l’évêque de Laon. PHILIPPE AUGUSTE ET LA COMMUNE DU LAONNAIS.En 1174, l’appui du roi Louis VII avait permis aux serfs du Laonnais de s’organiser en une commune fédérative de dix-sept villages dont le centre était Anisi-le-Château (Aisne). Il leur avait donné une charte communale, toute semblable à celle qui régissait les bourgeois de Laon. L’évêque de Laon, Roger de Rozoi, aidé des seigneurs de la région, prit sa revanche trois ans après : il cerna les serfs près de la localité de Comporté, et en fit une effroyable boucherie. Quand Philippe Auguste devint roi, en 1180, les malheureux paysans étaient retombés sous le joug de leur évêque. En 1185, les rigueurs et les exactions devinrent à ce point intolérables qu’ils se décidèrent à porter leurs réclamations au Roi. Philippe Auguste, qui avait à se plaindre de l’évêque de Laon, se fit médiateur ; il fixa le chiffre des tailles que l’évêque était autorisé à percevoir sur ses sujets et le taux des redevances auxquelles les serfs étaient assujettis envers deux officiers de l’évêque, le vidame et le prévôt. De plus, il institua douze échevins, pris parmi eux, chargés de répartir les tailles et de juger tous les différends qui pourraient s’élever entre eux ou avec l’évêque. On ne pouvait appeler des arrêts de ces magistrats nommés par le Roi que devant la justice royale. Les villageois du Laonnais demandaient davantage : la
commune. Entre 1185 et 1190, dans des circonstances que nous ignorons,
Philippe Auguste la leur rendit. Par contre, en 1190, partant pour la
croisade et désirant plaire au Clergé, il la supprima. Mais la ténacité du
paysan qui voulait s’affranchir égalait au moins celle du Clergé qui
entendait rester le maître. Au commencement du xiiie siècle, les dix-sept villages,
toujours cruellement opprimés, firent une tentative d’émigration en masse sur
la terre d’un seigneur voisin, Enguerran de Coucy. Elle ne réussit pas. Deux ans
après, en 1206, les serfs du Laonnais tirèrent parti d’une brouille survenue
entre l’évêque et le chapitre de Laon. Ils trouvèrent le moyen de se faire
protéger par les chanoines. Ceux-ci, devenus, contre l’évêque, les avocats de
la cause populaire, accusèrent en justice Roger de Rozoi de maltraiter ses
sujets et de les accabler de tailles "illégales. Ce procès fut débattu
devant le chapitre métropolitain de Reims, constitué en tribunal d’arbitrage.
Les juges rendirent un arrêt qui était un désastre pour l’évêque. Ils
donnaient raison aux villageois et remettaient les choses en l’état où elles
se trouvaient en 1185. Ils faisaient revivre la décision de Philippe Auguste
qui imposait à l’évêque un maximum de tailles à prélever, et décrétaient qu’en
cas de mésintelligence avec l’évêque et ses paysans, le jugement du démêlé
appartiendrait au chapitre de Laon. C’était soumettre l’évêque à la tutelle
de ses chanoines. Roger de Rozoi en fut si profondément humilié qu’il tomba
malade et mourut quelque temps après. La bienveillance, fort intermittente, que Philippe Auguste témoigna aux serfs du Laonnais s’explique surtout par l’intérêt qu’il avait à diminuer la puissance temporelle de l’évêque de Laon. En général, il n’a rien fait, d’intention généreuse et préméditée, pour soulager la condition misérable des paysans. Cet homme pratique a gardé toutes ses faveurs pour la partie de la classe populaire qui pouvait lui donner aide et secours, c’est-à-dire pour les bourgeois. IV. LES VILLES ASSUJETTIES. PRIVILÈGES ACCORDÉS PAR PHILIPPE AUGUSTE AUX MARCHANDS ET AUX ARTISANSPhilippe n’est pas le premier Capétien qui ait pris des bourgeois pour conseillers ou pour officiers, mais il a employé par système la bourgeoisie, surtout la bourgeoisie parisienne, comme organe de gouvernement, et ceci était nouveau. PROGRÈS DE LA BOURGEOISIE.Sous ce règne, les notables des villes participent à
toutes les solennités et à toutes les grandes assemblées où sont convoquées
la Féodalité et l’Église. Sans doute, ces bourgeois n’ont pas voix
délibérative, ni même consultative : leur droit se borne presque toujours à
acclamer, à témoigner par des cris leur approbation et leur joie. Toujours est-il qu’ils
sont présents et qu’ils comptent. On a même vu des assemblées exclusivement
bourgeoises, comme celle que Philippe réunit, en 1185, pour décider le pavage
de Paris. PARTICIPATION DES BOURGEOIS AU GOUVERNEMENT.Un événement d’une haute portée pour le développement politique de la classe bourgeoise fut l’organisation des pouvoirs publics comme Philippe Auguste la régla au moment de partir en croisade. Dans toutes les prévôtés du domaine royal, le prévôt ne pourra traiter les affaires de la ville, siège de sa juridiction, qu’avec le concours de quatre bourgeois. A Paris, il y en aura six. A ces six Parisiens est confiée, pendant l’absence du Roi, la garde du trésor et même celle du sceau royal. Chacun d’eux aura une clef des coffres déposés au Temple. Dans le cas où le Roi mourrait au cours de son pèlerinage, une certaine somme sera conservée pour les besoins de l’héritier, le prince Louis, et la garde de cette somme est remise non seulement aux six bourgeois mais à « tout le peuple de Paris ». Ainsi, dans toutes les villes, les représentants de la bourgeoisie sont associés aux fonctionnaires du Roi et, à Paris, ils ont la haute main sur les finances et sur l’administration générale du royaume. Les noms des six bourgeois : Thibaut le Riche, Othon de la Grève, Ébrouin le Changeur, Robert le Chartrain, Baudouin Bruneau et Nicolas Boisseau figurent, en effet, dans les chartes émanées, en 1190 et 1191, du conseil de régence. Aussitôt revenu en France, Philippe reprit son autorité pleine et entière, mais une telle marque de confiance donnée aux habitants des villes laissa dans leur mémoire un souvenir reconnaissant. Toute trace de leur passage au pouvoir ne disparut pas ; il y avait eu relations nouées et habitudes prises ; l’alliance conclue entre la Royauté et le peuple survécut à la circonstance qui l’avait fait naître. PHILIPPE PROTÈGE LES MARCHANDS.Le premier service que rendit Philippe Auguste à la
bourgeoisie de son domaine fut de poursuivre les châtelains péagers qui
augmentaient indûment leurs taxes, en établissaient de nouvelles ou
rançonnaient les trafiquants. En 1209, le fils d’un grand seigneur du Berri,
Eudes de Déols, est accusé devant la Cour du Roi d’avoir arrêté et dévalisé
des marchands. Philippe se transporte aussitôt à Châteaumeillant et oblige le
coupable à se soumettre d’avance aux conclusions d’une enquête. En 1216, il
impose au comte de Beaumont-sur-Oise un tarif des droits à percevoir sur les
marchands de la rivière d’Oise. En 1187, il avait pris sous sa garde un
accord commercial des armateurs parisiens avec le seigneur péager de
Maison-sur-Seine, Gazon de Poissi : si le receveur du péage exigeait des redevances
abusives, les marchands étaient autorisés par le Roi à passer outre sans
forfaire. PRIVILÈGES ACCORDÉS À LA HANSE DE PARIS.Les marchands que Philippe avait surtout à cœur de
satisfaire étaient ceux de sa ville de Paris. Il n’a donné aux Parisiens
aucune liberté d’ordre administratif ou politique, mais il a largement
privilégié leurs principaux commerçants réunis en corporation ou hanse. La hanse des « marchands
de l’eau » de Paris représentait déjà, moralement, la population parisienne
tout entière. Philippe l’a comblée de mesures protectrices, faites pour
garantir et accroître le monopole du commerce de la Seine qu’elle exerçait
avec une âpreté jalouse. Il semble même s’identifier avec elle. En 1213 le
chapitre d’Auxerre cède « à Philippe et aux marchands de l’eau » certains
domaines situés sur la rivière de l’Yonne. En 1192, Philippe Auguste, réglementant le commerce du
vin, confère aux seuls marchands de Paris le droit de faire mettre à terre,
pour les vendre, les vins amenés par eau. En 1200, le comte d’Auxerre, Pierre
de Courtenay, avait osé contester aux bourgeois de Paris le droit d’aller à
Auxerre décharger leurs cargaisons de sel. Philippe oblige ce grand seigneur
à reconnaître par charte solennelle qu’il a commis un abus de pouvoir, excessum. En 1204, le Roi
renouvelle le monopole de la hanse, déjà concédé par Louis, VII. En 1214, il
lui donne un nouveau port sur la Seine (au quai de l’École). Enfin, en 1220,
il lui cède les « criages » de Paris, jusque-là affermés au profit de la
Royauté. La hanse eut seule le privilège de nommer et révoquer les crieurs,
fixer les tarifs et le mode de perception, vérifier les poids et les mesures
; elle obtint même la basse justice, c’est-à-dire le droit de juger les
infractions faites à ses privilèges et les délits commis par ses membres,
pour tout ce qui n’était pas vol, blessure ou meurtre. Cette juridiction
accordée aux marchands de Paris et à leur prévôt fut le point de départ de l’autorité
que les échevins parisiens exercèrent plus tard sur toute la ville. LES MARCHANDS DE PARIS ET DE ROUEN.La difficulté, pour le Roi, était de concilier le monopole
des négociants de Paris avec les intérêts des autres corporations d’armateurs,
celle de Rouen, ou de la Basse-Seine, et celle des Bourguignons de la
Haute-Seine et de l’Yonne. En 1204, ces derniers se plaignirent des
empiétements de la hanse parisienne : Philippe leur accorda le droit de
commercer en amont de Sens, jusqu’à Villeneuve-Saint-Georges et en aval jusqu’à
Argenteuil : mais, pour dépasser ces limites, il leur fallait s’associer à un
marchand de Paris. Les Normands, de leur côté, faisaient concurrence aux
Parisiens. La vraie solution eût été de fondre en une les deux corporations
rivales, mais l’esprit du temps répugnait à ces procédés. Du moins Philippe Auguste
favorisa tous les accords qui s’établirent entre les marchands de Paris et de
Rouen, notamment ceux de 1210. Normands et Parisiens, associés pour le
commerce, durent se prêter un serment de fidélité mutuelle. Les marchands de
Rouen purent vendre leur sel dans un des ports de Paris, à condition de
prendre un des mesureurs patentés par la hanse. Mais, au total, Philippe se
montra toujours plus favorable à ses anciens sujets qu’aux nouveaux. Un rude
coup fut porté au commerce de Rouen, quand il eut défendu d’apporter par eau
en Normandie les vins du Midi et de l’Anjou, tandis qu’il permettait aux vins
de France et de. Bourgogne d’arriver à Rouen par la Seine. PROTECTION ACCORDÉE AUX MARCHANDS ÉTRANGERS.Protéger les marchands de son domaine, c’était pour Philippe Auguste obéir aux intérêts évidents du fisc royal ; mais il comprit aussi la nécessité d’attirer chez lui les marchands étrangers et de les retenir par d’habiles mesures. Cela était méritoire, car en ce temps l’usage féodal permettait, aussitôt la guerre déclarée, de se jeter sur les marchands de la seigneurie ou de la nation ennemie. Les trafiquants étrangers étaient même responsables, en temps de paix, des dettes que leur seigneur ou leurs compatriotes ne payaient pas. En 1185, au moment où Philippe est en guerre avec le comte de Flandre, il annonce aux marchands de la Flandre, du Ponthieu et du Vermandois, pays ennemis, qu’ils peuvent venir sans crainte à Compiègne pour la foire de carême et qu’en guerre comme en paix ils ne courront aucun risque. Il les prend sous sa protection, même pour les années suivantes. En 1193, il déclare aux marchands d’Ipres qu’ils n’ont rien à redouter dans ses États : on ne les arrêtera pas pour l’argent qui lui serait dû par le comte de Flandre ou par d’autres, et s’il survient une difficulté avec leur seigneur, ils auront quarante jours pour sortir du royaume avec tous leurs effets. Six ans plus tard, Philippe fait savoir que tous les marchands pourront naviguer sur la Somme, de Corbie à la mer, sans avoir à craindre aucune revendication, pourvu qu’ils acquittent les péages accoutumés. On ne pourra les saisir que pour leurs propres dettes ou pour celles qu’ils auront garanties. « Qui mettrait la main sur eux », ajoute le Roi, « s’en prendrait à notre personne. » Jamais un roi de France n’avait comblé de telles faveurs le commerce étranger. Philippe se rendait très bien compte de l’importance des
foires de Champagne, fréquentées par les commerçants de l’Europe entière. En
1209, il prend sous sa sauvegarde, à l’aller et au retour, tous les marchands
qui s’y rendent, « italiens ou autres ». Il veut qu’ils soient traités « comme
ceux de sa propre terre ». D’autre part, il défend les intérêts des marchands
français à l’étranger. Un billet de lui existe encore dans les archives de la Tour de Londres,
adressé à Hubert de Bourg, le grand justicier d’Angleterre, et rédigé d’un
ton assez impérieux. Les marchands d’Amiens avaient fait au gouvernement
anglais une livraison de blé et ne parvenaient pas à en obtenir le paiement. «
Nous vous mandons, écrit Philippe Auguste, de leur régler leur compte, et de
faire pour eux ce que vous voudriez que nous fissions pour les marchands d’Angleterre.
Il ne faut pas que nos gens d’Amiens aient à souffrir plus longtemps de ce
retard prolongé. » PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX CORPS DE MÉTIERS.Moins riches et moins en vue, les petits commerçants et les ouvriers formaient une sorte de démocratie au-dessous de l’aristocratie des changeurs, des armateurs et des grands industriels. Philippe Auguste semble s’être moins occupé de ces métiers inférieurs. A Paris, il a donné aux drapiers, en 1189, vingt-quatre
maisons confisquées sur les Juifs : les drapiers étaient déjà probablement
organisés en corps. Les bouchers lui doivent (1182) la première charte de
confirmation des statuts que Louis VII leur avait donnés, sans les faire
rédiger ; on voit par cette charte que les privilèges de la corporation
dataient au moins de Philippe Ier. Les bouchers peuvent vendre librement
bétail et viande moyennant un droit annuel payable au Roi et à celui qui
tient du Roi la boucherie en fief. En 1210, Philippe leur cède le monopole de
leur métier. Le Livre des métiers,
rédigé au temps de saint Louis, fait remonter jusqu’à lui certains
privilèges des couteliers, des boulangers, des ouvriers en laiton, des
marchands de toiles, des fripiers : mais le texte de ces concessions a
disparu. Philippe Auguste a exempté de tailles les tisserands d’Etampes (1204), moyennant le paiement d’une rente de vingt livres, et leur a permis d’élire quatre prud’hommes assermentés au Roi, chargés d’administrer les affaires du métier, de surveiller la fabrication et d’avoir soin que le travail commence et cesse aux heures réglementaires. Aux bouchers de Bourges, il a donné le monopole de la boucherie moyennant une rente de cent livres parisis (1211) ; aux bouchers d’Orléans, la permission d’exercer dans quarante « étaux » ou boutiques et le droit d’avoir deux maîtres de leur métier (1221). Enfin il a confirmé le monopole des boulangers de Pontoise, et protégé les tanneurs de Senlis contre un seigneur de la localité. En somme, malgré la rareté et l’insuffisance des documents, on entrevoit qu’avec son esprit d’ordre et son instinct d’autorité, il a voulu prendre part à la réglementation des corps de métiers, en témoignant un intérêt spécial à ceux de Paris. CONCESSION DE FRANCHISES AUX BOURGEOIS.Il ne s’est pas contenté de protéger les associations
restreintes formées par les marchands et les artisans. Il a aussi, dans les
villes sujettes
administrées par des prévôts, amélioré la condition de l’ensemble des
bourgeois en vue d’un intérêt immédiat ou lointain. Tantôt il a confirmé les
actes de ses prédécesseurs, les reproduisant à la lettre, ou avec très peu de
modifications. Tantôt il a développé les privilèges antérieurs : augmentant
les droits des bourgeois de Châteauneuf-de-Tours en 1181 ; achevant, en 1183,
d’émanciper les bourgeois d’Orléans et des villages voisins ; permettant, en
1197, à tous les citoyens de Bourges de désigner un de leurs amis pour gérer
leur fortune après leur mort et servir de tuteur à leurs enfants, etc. Enfin
il a privilégié des localités qui n’avaient encore obtenu aucune franchise.
Mais, en ce cas, il s’est borné, le plus souvent, à appliquer les
dispositions de la célèbre charte de Lorris en Gâtinais, œuvre de Louis le
Gros. Ferrières et Voisines en Gâtinais, Angi en Beauvaisis, Nonette en Auvergne, Saint-André-le-Désert près de Cluny, Dimont dans l’Yonne, Cléri près d’Orléans, Cinquoins en Berri ont été dotées par Philippe des franchises de Lorris. Ce n’étaient pas des villes, mais des villages ou de petits bourgs ; la plupart même ne lui appartenaient pas tout entiers ; il ne les possédait qu’à moitié, comme associé, en vertu de ces contrats de pariage dont il a été question plus haut. Quand il accorde une coutume autre que celle de Lorris (par exemple à Wacquemoulin et à Villeneuve-Saint-Mellon, en 1196, à Beaumont-sur-Oise, en 1223), il s’inspire toujours plus ou moins des dispositions de la charte type, ou bien il reproduit celles qu’avaient octroyées les seigneurs dont il a pris la place. On voit donc qu’il n’a guère fait, en cette matière, que suivre et imiter ses prédécesseurs. Cependant on trouve, dans les actes de franchise revêtus de son sceau, des innovations qui marquent un progrès sur la législation du passé. A Châteauneuf-de-Tours (1181) et à Orléans (1187), Philippe Auguste a permis aux bourgeois d’élire des notables chargés de répartir et de recueillir l’impôt royal. Dix prud’hommes (decem burgenses probi homines), élus pour un an, remplissaient cet office, conjointement avec les agents royaux de la ville et avec un représentant du pouvoir central envoyé spécialement à cet effet. Tous les autres bourgeois juraient d’obéir à leurs prescriptions. Les enfants et les étrangers domiciliés à Orléans ou à Tours prêtaient le même serment. On ne trouve pas d’exemples de cette institution dans les chartes royales antérieures. V. PHILIPPE AUGUSTE ET LES COMMUNESDans ses rapports avec les villes libres, les communes proprement dites, le gouvernement de Philippe Auguste n’est plus une imitation : il est original. Ge roi est le seul dont on puisse vraiment dire qu’il fut l’allié et le protecteur des communes. Avant lui, la monarchie les avait souvent combattues ou même détruites ; après lui, elle les a exploitées, jusqu’à l’abus, opprimées, et finalement supprimées. SUPPRESSION DE COMMUNES.Rares ont été les cas où Philippe a fait preuve d’hostilité à l’égard des institutions communales. Nous avons dit pourquoi il abolit, en 1190, la commune rurale du Laonnais constituée aux dépens de l’évêque de Laon et qu’il avait autorisée au début de son règne. S’il a détruit la commune d’Étampes en 1199, après lui avoir permis de subsister pendant quelques années, c’est qu’il était bien difficile qu’il laissât cette ville, très importante alors et située au milieu du domaine capétien, garder une municipalité indépendante. Les bourgeois de Châteauneuf-de-Tours, sujets du chapitre de Saint-Martin, supportaient avec peine la domination de leur abbé. Un mois avant la mort de Louis VII, alors que Philippe Auguste gouvernait en réalité le royaume, ils essayèrent de se confédérer secrètement. Les chanoines se plaignirent au Pape qui envoya un délégué pour juger ce procès. Les bourgeois produisirent une lettre de Louis VII qui les autorisait à former une commune ; mais cette lettre fut reconnue fausse, et ils perdirent leur cause. Pour les dédommager, Philippe leur donna, en 1181, cette organisation municipale des dix prud’hommes dont on a déjà parlé, et qui eut pour effet de les soustraire aux exigences financières des chanoines. Mais, peu satisfaits de cette demi-indépendance, ils instituèrent de nouveau la commune en 1184. Le chapitre les excommunia, les fit condamner une fois de plus par le Pape, et obtint de Philippe Auguste la suppression de la commune. Le Roi ne pouvait pas oublier qu’il était le chef honoraire des chanoines de Saint-Martin. Quand les bourgeois s’insurgèrent encore en 1212, il supprima même le gouvernement des dix élus. De telles rigueurs sont exceptionnelles. Philippe Auguste est, de tous nos rois, celui qui a confirmé ou créé le plus grand nombre de communes. RENOUVELLEMENT DES CHARTES COMMUNALES.Dans l’ancien domaine, Corbie, Soissons, Noyon, Beauvais, Vailli en Soissonnais, Compiègne, Bruyères en Laonnais, Saint-Riquier, Laon, Senlis, Mantes ont obtenu de lui le renouvellement des chartes communales octroyées par ses prédécesseurs. Ces confirmations contiennent, d’ordinaire, quelques articles nouveaux. Ils ont pour objet soit de mettre plus d’ordre et de régularité dans les rapports du Roi avec la commune, soit d’accroître les prérogatives administratives et judiciaires des bourgeois. Ainsi, à Soissons (1181) et à Vailli (1185), une disposition additionnelle supprime la mainmorte. A Senlis (1202), Philippe Auguste donne par surcroît à la commune le droit de faire justice de tous les crimes et délits commis dans la ville ou la banlieue. Auparavant, la justice communale n’intervenait que si la partie lésée était un habitant ayant juré la commune, ou un marchand venant à Senlis pour son négoce, et si plainte était portée aux juges municipaux. De personnelle et de conditionnelle qu’elle était, la juridiction de la commune de Senlis devient, par la charte de confirmation, territoriale et obligatoire. A Beauvais (1182) et à Saint-Riquier (1189), la clause ajoutée par Philippe Auguste donne aux bourgeois le droit, qu’ils n’avaient pas, d’élire un maire. Enfin, dans plusieurs de ces actes confirmatifs, le Roi supprime le droit de gîte que lui devait la commune, servitude toujours onéreuse et odieuse, et le remplace par une rente perpétuelle. Dans les pays annexés, Philippe s’est empressé de renouveler les chartes communales accordées par les comtes d’Amiens, les ducs de Normandie, les ducs d’Aquitaine et les comtes de Ponthieu. Il l’a fait en sa double qualité de seigneur et de roi, à Amiens, Saint-Quentin, Doullens, Abbeville, Rouen, Falaise, Caen, Pont-Audemer, Poitiers, Niort et Saint-Jean-d’Angély. En Normandie pourtant, il a réagi contre la prodigalité excessive avec laquelle les Plantagenêts, notamment Jean sans Terre, avaient multiplié les communes. Celles d’Évreux, d’Harfleur, de Bayeux, de Domfront, d’Alençon semblent avoir disparu après la conquête de 1204. CRÉATION DE COMMUNES.C’est de Philippe Auguste et non pas de Louis le Gros que
l’histoire peut dire qu’il a été un créateur de communes. Dans le domaine
ancien, Chaumont, Pontoise, Poissy, Sens, Villeneuve en Beauvaisis, Cerni et
Crépi en Laonnais ; dans le nouveau, Crépi en Valois, Hesdin, Bapaume,
Fillièvre en Artois, Montdidier, Athies, Cappi, Péronne, Chauny,
Brai-sur-Somme en Picardie, Andeli et Nonancourt en Normandie lui doivent le régime communal. Il
a fondé des communes jusque dans son domaine particulier, contrairement,
semble-t-il, à la politique traditionnelle des Capétiens. COMMUNE DE SENS.Les raisons de cette conduite de Philippe Auguste sont faciles à deviner. S’il a rétabli, en 1186, la commune de Sens, créée, puis abolie dans la première période du règne de Louis VII, c’est que l’institution de la commune renforçait, à Sens, le pouvoir du Roi, contrebalancé fortement par celui de l’archevêque et de l’abbé de Saint-Pierre-le-Vif. D’ailleurs, accorder une charte communale aux bourgeois de Sens parut le seul moyen de mettre fin à la guerre que les habitants et l’archevêque se faisaient depuis plus d’un demi-siècle. RAISON MILITAIRE.Une raison d’autre sorte a décidé le Roi à émanciper les populations de l’Artois, du Vermandois et du Vexin, parties du domaine les plus exposées aux attaques venues d’Angleterre, de Flandre et d’Allemagne. Philippe voyait dans les communes des postes fortifiés, défendus par une milice aguerrie. Il voulait qu’à côté des villes simplement privilégiées, fondées ou développées en vue de l’exploitation agricole et financière, et situées en général dans l’intérieur du domaine, il existât des villes de défense, où l’esprit militaire pût s’entretenir et se transmettre. La commune ainsi comprise devait être surtout placée dans les « marches », c’est-à-dire aux frontières de la France capétienne. Sous son règne, des communes fortifiées ont souvent arrêté l’ennemi. En 1188, Henri II d’Angleterre envahit le Vexin et essaye de surprendre Mantes, que Philippe Auguste, pressé de se rapprocher de Paris, avait laissée sans défense. Mais la milice de Mantes résista avec tant d’énergie que le Roi eut le temps d’accourir. RAISON POLITIQUE.Dans les pays annexés, c’est la raison politique qui le
poussa à complaire aux bourgeois, désireux d’avoir une commune. Il devait,
pour consolider sa conquête, se montrer aussi libéral que les seigneurs qui l’avaient
précédé. En Normandie — avec la réserve que nous avons faite tout à l’heure —
et en Aquitaine, les Plantagenêts avaient propagé la célèbre charte des Établissements de Rouen ; Philippe
n’eut qu’à sanctionner les générosités déjà faites. Mais ailleurs il prit l’initiative,
surtout en Artois, en Vermandois et en Valois. Après la mort du comte de
Flandre, Philippe d’Alsace (1191), quand il eut mis la main sur l’Artois et
une partie du Vermandois, il se hâta d’accorder la commune à Hesdin (1192), à
Montdidier (1195), à Roye (1197). Il l’octroya ensuite à Fillièvre (1205), à
Cappi et à Péronne (1207), à Athies (1211) et à Chauny (1213). Le Valois lui
échut en 1214, après la mort de la comtesse de Beaumont, à qui il en avait laissé l’usufruit
; dès 1215, il établissait une commune à Crépi, la capitale de ce petit État. RAISON FINANCIÈRE.Cette politique s’explique encore par l’intérêt fiscal : les chartes des communes que le Roi a créées se terminent presque toutes par une disposition sur la rente que la commune doit lui servir. A Cerni en Laonnais, les habitants doivent doubler, chaque année, tous les revenus du Roi ; à Crépi, doubler les redevances en grains, vins et deniers ; la commune, à Pontoise, doit fournir une rente de 500 livres ; à Sens, une rente de 600 livres parisis et de 120 muids de blé. Ces rentes compensaient les pertes que faisaient subir au Roi l’abandon d’un certain nombre de ses droits lucratifs — entre autres de la basse justice — et la suppression de la prévôté royale ou d’une partie de ses revenus. Tout compte fait, le trésor du Capétien n’y perdait pas et les bourgeois y gagnaient un surcroît de liberté. LA CHARTE DE PÉRONNE.D’ailleurs, les chartes communales de Philippe Auguste ne représentent pas des types nouveaux de constitutions libres. Presque toutes celles qu’il a octroyées ne sont que des reproductions ou des imitations des chartes de Mantes, de Laon, de Soissons, de Saint-Quentin et de Rouen, dont il n’était pas l’auteur. Seule, celle de Péronne, accordée en 1207, doit être considérée peut-être comme sa création propre. Elle institue, pour l’administration municipale, un maire, des échevins et un conseil de jurés. Elle règle minutieusement le mécanisme de l’élection des magistrats, les devoirs de leurs offices, le droit qu’ils ont d’imposer la cité sous le contrôle de six élus, et l’exercice de la justice par les échevins. Les corps de métiers servent de base à l’organisation municipale, car ce sont eux qui ont charge d’élire les vingt-quatre électeurs, lesquels nomment à leur tour les jurés. Rien n’indique que l’autorité royale ait le moyen d’intervenir dans les élections. La commune de Péronne semble posséder le maximum d’indépendance politique qui puisse être dévolue alors à une association de bourgeois. PHILIPPE INTERVIENT DANS LA VIE DES COMMUNES.Philippe Auguste a donné aux villes libres bien d’autres preuves de sympathie et d’intérêt par son intervention fréquente dans les affaires et la vie intime de leurs habitants. Il voulait maintenir chez eux la tranquillité et l’ordre et régler pacifiquement leurs rapports avec la Féodalité et avec l’Église. Quelquefois même, il s’est fait l’exécuteur des mesures de haute police prises par les municipalités communales, comme en 1202, quand il bannit du royaume deux individus reconnus coupables de parjure envers la commune de Laon. Il est bien entendu, au reste, que ce bienfaiteur des
communes tient à
exercer tous ses droits et conserve toutes ses prérogatives. Dans la charte
accordée aux bourgeois de Poitiers, en 1214, il fait mention expresse de ses
droits d’ost et de chevauchée, de taille et de justice. En 1220, il oblige le
maire et les jurés de Saint-Riquier à reconnaître qu’ils lui doivent l’ost et
la moitié d’un gîte, et il se réserve, à Caen, le service militaire et la
taille. PHILIPPE CONFIRME LES COMMUNES SEIGNEURIALES.Dans tout le royaume, le Roi apparaît comme le chef et le protecteur des villes libres. En 1183 et en 1187, il consacre de son autorité la commune de Dijon établie par le duc de Bourgogne. En 1221, il approuve les modifications apportées à la charte de Doullens par un comte de Ponthieu. En 1208, le seigneur de Poix en Picardie, Gautier Tirel V, venait de confirmer la charte communale accordée aux habitants de ce bourg par son père, Gautier Tirel IV. Non content d’avoir obtenu la confirmation du nouveau seigneur, de sa femme et de son fils, les bourgeois voulurent encore se procurer celle du roi de France. Une délégation de la commune se rendit à Paris, accompagnée du seigneur de Poix et fut admise avec lui dans le palais de la Cité. Gautier demanda au Roi, en son nom propre et au nom des bourgeois, de prendre la commune sous sa protection spéciale et perpétuelle. Le Roi fit droit à la requête et remit aux mains du seigneur la charte de garantie scellée de son sceau, mais il fut convenu que la commune paierait au Roi une rente ou cens perpétuel de dix livres, sans préjudice de ce qu’elle devait à son seigneur direct, pour le prix de la confirmation. A force de voir le Roi confirmer les octrois de communes et de privilèges émanés des grands vassaux, on finira par croire que les villes lui appartiennent tout autant qu’aux barons dont elles dépendent ; ce que plus tard les légistes exprimeront par cette formule « que le Roi est le seigneur naturel de toutes les communes du royaume ». On comprend que la commune d’Amiens ait demandé à Philippe Auguste, au moment où il renouvelait sa charte constitutive (1190), d’ajouter cet article final : « Nous voulons et nous octroyons à la commune que jamais il ne soit loisible, à nous et à nos successeurs, de mettre ladite commune hors de notre main. » Les bourgeois veulent que le Roi leur garantisse la perpétuité du régime sous lequel ils sont appelés à vivre. Avant tout, ils demandent à ne plus passer de main en main, au hasard des successions féodales et des mariages seigneuriaux. A leurs yeux, la Royauté n’est pas seulement la paix et la justice, mais encore la fixité des institutions et la sécurité de l’avenir. VI. L’ADMINISTRATION ROYALE. LES BAILLISPhilippe Auguste a donné à la dynastie capétienne les trois instruments de règne qui lui manquaient : des fonctionnaires dociles, de l’argent et des soldats. LA COUR DU ROI.L’organe principal du gouvernement est toujours la curia régis. Cette cour,
composée surtout de nobles et d’évêques, c’est-à-dire des « grands du royaume
», conservait le caractère qu’elle avait eu sous les rois précédents, tour à tour
concile, tribunal, conseil de guerre, assemblée électorale, administrative ou
politique. Elle se réunit partout où se trouve le Roi et quand il lui plaît,
sans périodicité aucune, sans droit d’initiative ni droit de suffrage
régulier. C’est un corps consultatif dont le Roi requiert l’approbation, mais
qui ne peut lui imposer sa volonté. Très nombreuses sous les premiers
Capétiens, les assemblées royales sont déjà moins fréquemment convoquées,
surtout à la fin du règne de Philippe Auguste, parce que la Royauté était
alors moins obligée d’emprunter aux évêques et aux comtes les forces dont
elle avait besoin. Les barons laïques y viennent en plus grand nombre, indice
de l’autorité croissante que prend la Monarchie sur la société féodale. Les
représentants des villes y tiennent, d’autre part, une place plus importante.
Enfin, dans ces assemblées plénières, les affaires de justice ne sont plus
traitées que par exception, comme ce grand procès de la succession du comté
de Champagne qui, en 1216, réunit à Melun les pairs du royaume avec une foule
nombreuse de prélats et de barons. LES PALATINS.C’est qu’en effet, l’évolution s’est accomplie qui
tendait, depuis un siècle, à concentrer les pouvoirs de la Cour du Roi entre
les mains des conseillers intimes du palais. Ce conseil étroit, cette curia regis au sens restreint,
était chargée par le souverain de préparer et de traiter les affaires
courantes, de juger les procès ordinaires, de prendre des mesures d’administration
quotidienne. Depuis Louis VII, la Royauté inclinait visiblement à choisir,
pour cette besogne, des hommes d’humble origine, instruments obscurs, mais
solides et maniables, d’une monarchie qui se concentre et se fortifie. Philippe Auguste a
fait de cette tendance un système. Les légistes de profession, qui n’apparaissent
que par exception à la cour de son prédécesseur, sont déjà, sous son règne,
mentionnés en plus grand nombre. PHILIPPE SUPPRIME DEUX GRANDS OFFICES.Plus que personne, il a réagi contre l’ingérence des hauts barons et même des grands officiers du palais dans le gouvernement effectif de l’État. Avant lui, sans doute, les rois se défiaient de l’autorité exercée par les titulaires des grands offices : le sénéchal, le chancelier, le connétable, le chambrier, le bouteiller. Louis VI et Louis VII étaient déjà entrés en lutte avec ces « domestiques » de haut parage, qui prétendaient se perpétuer dans leur fonction et en faire un fief indépendant. Philippe, plus hardi, a supprimé en fait les deux grands offices réputés les plus dangereux, celui du sénéchal, ou le « dapiférat », en 1191, et celui du chancelier à partir de 1185. Et s’il a beaucoup employé, dans ses négociations et dans ses guerres, le chambrier Barthélemy de Roye, les connétables Raoul de Clermont, Dreu de Mello et Mathieu de Montmorency, le chambellan Gautier de Nemours, les maréchaux Robert et Henri Clément, c’est que ces personnages, roturiers ou de petite noblesse, étaient en réalité dans sa main. PROGRÈS DE LA JUSTICE ROYALE.La plus lourde tâche de ces palatins est l’expédition des procès, qui abondent alors, la Royauté étant devenue plus puissante et le domaine s’étant étendu. La compétence des juges de Philippe Auguste se fortifie tous les jours : les barons et les prélats eux-mêmes obéissent plus docilement qu’autrefois à leurs sommations et à leurs arrêts. Nous avons parlé cependant des résistances qui se
produisirent en certains cas, surtout de la part de l’Église, qui ne pouvait
se résoudre à accepter les décisions d’une juridiction laïque. Mais Philippe
prit des mesures énergiques contre les récalcitrants et montra qu’il
entendait mettre hors de pair la souveraineté de sa justice. Son tribunal
commence à régler les affaires intérieures des grandes baronnies ; les
seigneurs qui ont assisté aux jugements se croient obligés de notifier
quelquefois, eux-mêmes, par lettres patentes, les sentences rendues et de les
consacrer ainsi de leur autorité. Quand ils veulent échapper aux juges royaux
en recourant à l’arbitrage, ils prennent soin d’obtenir au préalable l’agrément
du Roi ; enfin l’action de la justice royale se fortifie encore par un emploi
plus général de V enquête, décrétée
par mandement du Roi et poursuivie sur place par des commissaires de son
choix. La procédure d’enquête équivalait à une sorte de prolongement de la
cour, rendue ainsi
présente jusque dans les localités les plus éloignées. Elle devait faciliter
singulièrement l’appel au Roi qui
deviendra fréquent à l’époque de saint Louis. LES CHEFS DU PALAIS SOUS PHILIPPE AUGUSTE.De tous temps, les palatins avaient eu leurs chefs, personnages à qui la faveur royale donnait une influence prépondérante. Ces directeurs du conseil royal étaient en général des évêques ou des abbés, le corps ecclésiastique seul pouvant fournir aux souverains des hommes assez instruits, assez entendus aux affaires, assez haut placés dans l’opinion, pour servir utilement un gouvernement et une politique. Mais Philippe Auguste avait une personnalité trop accusée, et il était trop défiant, pour s’effacer devant ses ministres. Les clercs dont il s’est servi ne l’ont jamais dominé. Au début du règne, un moine de Grandmont, frère Bernard du Coudrai, correcteur du prieuré de Vincennes, paraît tout au moins l’inspirateur de sa politique religieuse ; il est l’auteur de la persécution contre les Juifs ; Philippe, partant pour la croisade, l’adjoignit aux régents. De 1184 à 1202, se place à la tête du conseil royal l’archevêque de Reims, Guillaume de Champagne, oncle maternel de Philippe, le plus haut personnage ecclésiastique du royaume, cardinal et légat permanent du Saint-Siège, un administrateur actif, en même temps qu’un lettré et un savant. Il est « l’œil et la main du Roi », ou « le Roi en second », disent les textes contemporains. C’est lui qui, pendant la croisade, est officiellement chargé de la régence, avec sa sœur, la reine mère Adèle ; mais on a vu que Philippe eut soin de ne lui laisser qu’un pouvoir limité et contrôlé par des conseillers intimes de petite naissance, clercs et bourgeois. Dans la dernière période du règne, l’homme de confiance fut un Hospitalier, frère Guérin, qui avait tous les talents, dirigeant à la fois le palais, les affaires ecclésiastiques, la chancellerie et l’armée. Philippe trouva en lui un ami sûr, un auxiliaire incomparable, mais il ne lui permit jamais de porter le titre de chancelier, quoiqu’il en remplît les fonctions. Les ecclésiastiques avec lesquels Philippe gouvernait ne furent jamais, pour lui, que des premiers commis. INSTITUTION DES BAILLIS.Dans l’administration du domaine, Philippe Auguste n’a pas
fait que développer ou amender les institutions déjà établies par les
premiers Capétiens : il a innové en créant les baillis. Nous savons par quels procédés rudimentaires les rois de
la troisième race, comme tous les hauts barons de leur époque, exploitaient
leurs possessions
directes. Louis VI et Louis VII avaient essayé de restreindre l’autorité de
leurs prévôts, fonctionnaires trop peu dociles, en distinguant le ressort
propre de la justice royale d’avec celui de la justice prévôtale, en donnant
à leurs bourgeois et à leurs paysans des franchises qui devaient les
soustraire aux exactions des officiers royaux, et en prenant soin de limiter
l’action de chaque prévôt à sa circonscription. Mais ces mesures n’avaient
pas suffi à diminuer sérieusement les inconvénients et les dangers de l’administration
prévôtale. Quand le domaine royal se fut accru et que les affaires locales eurent pris un caractère de multiplicité et de complexité qu’elles n’avaient jamais eu avant l’ère des conquêtes, la gestion domaniale par les prévôts devint insuffisante. La suppression de l’office du sénéchal de France, chargé autrefois de surveiller les prévôtés, rendit une réforme du système administratif encore plus nécessaire. Philippe Auguste, tout en conservant les prévôts, leur
superposa des agents faciles à déplacer, révocables et soumis, les baillis.
Le nom n’était pas nouveau, mais la chose l’était. Les baillis de Philippe
Auguste, en effet, sont, non plus des officiers affermant leurs charges,
comme les prévôts, mais de véritables fonctionnaires nommés et salariés par
le Roi. Ils ont une circonscription beaucoup plus étendue que la prévôté.
Sous Philippe Auguste, les circonscriptions des bailliages ne sont pas encore
permanentes comme elles le deviendront au cours du xiiie siècle. Les baillis sont des
lieutenants du Roi, détachés de la curia
régis pour administrer, juger et percevoir les revenus de la
couronne. Leur ressort n’est pas encore géographiquement bien délimité ; le
nombre des prévôtés soumises à leur contrôle est variable. Ils peuvent être
investis à plusieurs d’un même bailliage : bref, ce sont plutôt des agents de
l’administration centrale, des juges « itinérants », que des fonctionnaires
locaux établis à poste fixe. LES BAILLIS DANS LE TESTAMENT DE 1190.L’institution des baillis, dont la date d’origine ne peut être connue avec précision, précéda de quelques années le départ de Philippe Auguste pour la troisième croisade. C’est dans l’acte célèbre de 1190 que le Roi détermine clairement, pour la première fois, la subordination des baillis au pouvoir central et la supériorité hiérarchique des baillis sur les prévôts. Les baillis doivent aller rendre leurs comptes à Paris trois fois par an et tenir régulièrement des assises judiciaires dans les localités de leur ressort. LES BAILLIAGES SOUS PHILIPPE AUGUSTE.Au commencement du xiiie siècle, la correspondance
administrative de Philippe montre les baillis royaux, les « grands baillis »,
établis à Gisors, à Orléans, à Sens, à Bourges, à Senlis, en Vermandois, à
Arras, à Saint-Omer et Aire, à Amiens, et, quand la Normandie est annexée,
dans le pays de Caux et dans le Cotentin. Les prévôts de Paris, qui étaient
tantôt de petits seigneurs (Anseau de Garlande en 1192, Hugues de Meulan en
1196, Robert de Meulan en 1202), tantôt des bourgeois (Thomas en 1200,
Nicolas Arrode et Philippe Hamelin en 1217), avaient une importance
particulière et pouvaient être assimilés à des baillis. Investis de tous les
pouvoirs, à la fois administrateurs, juges, receveurs et officiers de police,
les baillis commencent déjà à faire une rude guerre aux seigneuries. Les
nobles, surtout, ne les aiment pas, et sans doute le chroniqueur artésien
connu sous le nom d’Anonyme de
Béthune s’est fait l’interprète des rancunes féodales quand il
dit, après avoir parlé de la victoire de Bouvines : « Toute la terre du roi
Philippe resta dès lors en grande paix, si ce n’est que ses baillis faisaient
beaucoup de tort, et aussi les baillis de son fils (le prince Louis, suzerain
de l’Artois). Un sien sergent, Nivelon le Maréchal, bailli d’Arras, mit en
tel servage toute la terre de Flandre, que tous ceux qui en entendirent
parler s’émerveillaient comment on le pouvait souffrir et endurer. » Ce
bailli d’Arras, Nivelon le Maréchal, qui resta en fonctions de 1202 à 1219 au
moins, avait l’autorité d’un vice-roi. LES SÉNÉCHAUX DANS L’ANJOU ET LE POITOU.Les pays de la Loire et de l’Aquitaine qui furent enlevés
aux Plantagenêts (l’Anjou, le Poitou et la Saintonge) ne furent pas, comme la
Normandie, annexés directement au domaine. Philippe n’y mit pas ses baillis :
il se contenta de donner à certains représentants de la noblesse locale, qui
eurent le titre de sénéchaux, le
caractère d’agents du Roi en leur laissant celui de feudataires héréditaires.
Guillaume des Roches, dont on connaît le rôle dans l’histoire de la réunion
de l’Anjou, de la Touraine et du Maine, fut investi de la direction politique
et administrative de ces trois pays. La sénéchaussée de Poitou, Saintonge et
Guyenne fut confiée à Aimeri, vicomte de Thouars. L’institution de ces
sénéchaux de grande noblesse était évidemment une mesure transitoire. On ne
pouvait songer à supprimer brusquement, du premier coup, l’indépendance des
Angevins et surtout des Poitevins. Tels furent les procédés administratifs par lesquels
Philippe Auguste élargit et en même temps concentra l’autorité dont il
disposait. Le premier des rois capétiens, il a eu la volonté et la force de
fonder un gouvernement. Le peuple semble lui en avoir su gré. Il se rappela
du moins qu’il aimait à faire bonne et exacte justice, et que, sous cette main ferme, les abus de
pouvoir des agents royaux ne restaient pas longtemps impunis. L’anecdote
suivante prouve que Philippe a laissé le renom d’un justicier. UN BAILLI DE PHILIPPE AUGUSTE.Un bailli du Roi avait grande envie d’une terre que possédait un chevalier, son voisin, mais il ne put le décider à la vendre. Le propriétaire mourut, laissant une veuve qui, elle aussi, refusa de se dessaisir de son bien. Le bailli alla chercher deux portefaix sur la place publique, les habilla convenablement, leur promit de l’argent, et, la nuit suivante, les mena au cimetière où le chevalier était enterré. Avec l’aide des deux hommes, il ouvre la tombe, met le mort sur ses pieds et l’adjure, devant ses deux témoins, de lui vendre le domaine en question. « Qui ne dit mot consent », dit l’un des témoins, le marché est conclu. On met de l’argent dans la main du cadavre ; la tombe est refermée, et, le lendemain, le bailli envoie ses ouvriers travailler sur la terre comme si elle lui appartenait. La veuve réclame : il affirme que la vente a eu lieu. L’affaire est portée devant Philippe Auguste. Le bailli produit ses deux témoins qui attestent la vente. Le Roi s’avise d’un stratagème. Il prend l’un des témoins à part, dans un coin et lui dit : « Sais-tu le Pater noster ? Récite-le. » Et pendant que l’homme murmure son oraison, Philippe s’écrie de temps à autre, de façon à être entendu de la galerie : « C’est bien cela, tu dis la vérité. » La récitation faite : « Tu ne m’as pas menti, dit le Roi : tu peux compter sur ta grâce », puis il le fait enfermer dans une chambre. Alors il se retourne vers le second témoin : « Voyons, ne mens pas non plus ; ton ami m’a révélé tout ce qui s’était passé, aussi vrai que s’il avait récité le Pater noster. » L’autre, croyant que tout est découvert, finit par avouer le stratagème. Le bailli se jette aux pieds du Roi : Philippe le condamne au bannissement perpétuel et donne à la pauvre veuve la maison et les domaines du coupable. « Ce jugement, conclut le chroniqueur, vaut bien celui de Salomon. » VII. LES FINANCESBUDGET DE PHILIPPE AUGUSTE.Il fut grand amasseur de trésors, disent de Philippe
Auguste les chroniques contemporaines. Il a, en effet, de toutes façons,
accru les revenus
de la Royauté. En 1223, un dignitaire de l’église de Lausanne se trouvait à
Paris au moment de la mort du roi de France. Les officiers de l’hôtel lui
assurèrent que, tandis que le père de Philippe, Louis VII, n’avait eu que 19.000
livres à dépenser par mois, son fils, Louis VIII, possédait un revenu quotidien de 1200 livres. REVENUS DOMANIAUX.Par le fait même de la conquête, les revenus ordinaires, c’est-à-dire les cens, les tailles et les autres perceptions domaniales, les produits de la justice et surtout les amendes, les coupes dans les forêts royales, les droits de chancellerie, les reliefs et les autres droits féodaux, l’argent provenant des successions dévolues au fisc, les droits d’amortissement payés par les églises qui acquéraient des terres, toutes ces ressources, dont vivaient les Capétiens comme les chefs d’États féodaux, étaient devenues naturellement plus fructueuses. Mais elles n’auraient pas suffi aux besoins toujours croissants d’une royauté qui se trouvait sans cesse en état de guerre et dont la diplomatie travaillait toute l’Europe. Pour se procurer l’argent nécessaire, Philippe Auguste eut recours à deux moyens principaux : la transformation des prestations et des corvées en taxes pécuniaires, ce qui facilitait et régularisait singulièrement la perception des droits domaniaux ; et, d’autre part, le développement de certains revenus extraordinaires, qui, sous les règnes précédents, produisaient peu ou ne produisaient rien. TRANSFORMATION DES SERVICES EN TAXES.En 1201, Philippe Auguste transforme en taxe le « hauban »,
perception en nature, vin fourni aux échansons royaux par certains
commerçants et industriels de Paris, d’Orléans et de Bourges. En 1215, il
décrète que les corvées dues par les hommes du Valois et de La Ferté-Milon
seront remplacées par une contribution en numéraire. Le fait le plus
caractéristique est la conversion en impôt du service militaire des
bourgeois, la perception, de plus en plus généralisée, de « l’aide de l’ost ».
Un document de 1194, appelé « prisée des sergents », prouve que déjà, à la
fin du xiie
siècle, un certain nombre de villes, surtout celles qui n’avaient pas l’organisation
communale, étaient abonnées au rachat du service d’ost et de chevauchée
moyennant une redevance fixe. Paris donnait ainsi 4.000 livres à Philippe
Auguste, Bourges 3.000, Orléans 1500, Étampes 1.000, etc. En droit, les villes étaient tenues de fournir au Roi,
selon ses besoins, des fantassins armés, des « sergents » ; elles pouvaient
envoyer, au lieu de leurs propres bourgeois, des soldats de profession
recrutés à leurs frais ; en fait, elles trouvaient plus simple de payer une
somme équivalente à la fourniture militaire qui leur était imposée. Le roi
préférait de beaucoup cette manière de faire qui lui permettait de recruter des sergents
mercenaires, des soldats de métier, qu’il adjoignait à ses chevaliers soldés.
Cette organisation du rachat de l’obligation militaire paraît bien être l’œuvre
de Philippe Auguste ; les rois du xiiie siècle ne feront que la
développer. Par là se révèle une fois de plus le sens pratique qui est le
trait essentiel de son gouvernement. RELIEF PRÉLEVÉ SUR LES BARONNIES.Jusqu’à lui, les Capétiens n’avaient joui du droit de « relief » (prélevé par le suzerain sur toute terre vassale qui change de propriétaire) que sur leur domaine propre. Philippe Ier, Louis VI, Louis VII n’y ont pas assujetti la grande féodalité. Cela se vit, pour la première fois, sous Philippe Auguste. En 1195, la comtesse de Flandre lui donne, en guise de relief, les tours de Douai, et, en 1199, le comte de Nevers lui abandonne, au même titre, la ville de Gien. En 1212, le nouveau comte de Blois et de Chartres paye 5.000 livres parisis au Roi, suzerain supérieur de son fief ; et, en 1219, la fille qui lui succède donne à son tour, pour le relief, la châtellenie de Nogent l’Erembert. Exploiter financièrement les. grands États féodaux, c’était une nouveauté hardie. Autre nouveauté, l’art de pressurer les Juifs devenu presque une institution, une ressource régulière de la Royauté. COMMENT PHILIPPE EXPLOITE LES JUIFS.On les avait généralement tolérés en France jusqu’à la fin
du xiie siècle, et
nous savons que Louis VII les protégea. Philippe commença par les déposséder
en partie (1180) ; mais, après les avoir fait emprisonner, il les mit en
liberté moyennant une rançon de 15.000 marcs. Bientôt il décréta contre eux l’expulsion
en masse et la confiscation totale (1182). Leurs débiteurs furent libérés de
leurs dettes, sauf un cinquième que le Roi s’adjugea. Plus tard, il trouva le
système le plus conforme aux intérêts de son trésor : il laissa revenir les
bannis (1198), et, suivant l’exemple de certains hauts barons, il organisa
une exploitation spéciale des Juifs. Il y eut désormais un produit des Juifs,
légalement établi : il consistait dans la taille ou cens annuel auquel ils
étaient soumis, dans les amendes judiciaires, et dans les droits de sceau qui
frappaient leurs transactions écrites. Mais les voisins de Philippe Auguste se plaignent que le
Roi accapare leurs Juifs, comme il attirait leurs serfs. Par un traité conclu
en 1198, le Roi et le comte de Champagne s’étaient garanti la pleine
propriété de leurs Juifs, et chacun des deux contractants avait promis de ne
pas garder les Juifs de l’autre. Il paraît que le Roi ne tint pas sa
promesse. En 1203, la comtesse de Champagne lui adresse des réclamations au
sujet du plus riche des Juifs champenois, Cresselin, qui s’était établi en
terre royale. Cresselin promit de ne plus quitter la Champagne et donna des otages. Le Roi
déclara qu’il ne l’aiderait pas à déserter, mais qu’il lui permettrait de
faire des prêts sur sa terre. Non seulement Philippe Auguste ne chasse plus les Juifs, mais, par les ordonnances de septembre 1206 et de février 1219, il facilite et développe leurs opérations de banque moyennant certaines garanties et restrictions. Aucun Juif ne pourra prêter à un intérêt supérieur à deux deniers pour livre et par semaine (43 pour 100 par an). Les Juifs devront faire sceller leurs contrats d’un sceau spécial. Ils ne pourront recevoir en gages ni les vases ou ornements d’église, ni les terres ecclésiastiques, ni les instruments de labour. Dans chaque ville, deux prud’hommes seront commis à la garde du sceau des Juifs. Ces mesures fiscales donnèrent au Roi de beaux profits. Le produit des Juifs, qui, dans le compte de 1202, ne monte qu’à 1200 livres, atteignit en 1217 le chiffre de 7550 livres. Aussi Philippe Auguste allait-il jusqu’à défendre ces contribuables productifs contre l’intolérance de l’Église et du peuple. En 1204, il interdit à des clercs d’excommunier les chrétiens qui entraient en rapports de commerce avec les usuriers israélites et travaillaient à leur service. EXPLOITATION FINANCIÈRE DU CLERGÉ.Quand le besoin d’argent se faisait impérieusement sentir, Philippe ne connaissait ni chrétiens ni Juifs. Il savait que les évêques, les chanoines, les abbés, grands propriétaires terriens, étaient aussi des capitalistes, et que le numéraire s’amassait dans les monastères et les cathédrales. Le clerc ne dépensait pas autant que le chevalier et il ne cessait de s’enrichir par des donations : il pouvait donc payer des contributions. Le Roi, patron et protecteur du Clergé, pensait que ce patronage lui donnait droit à des subsides. Souvent, il envoyait à Jérusalem, sur les instances du Pape ou des chrétiens de Syrie, des corps de troupes et de l’argent. N’était-il pas juste qu’on lui laissât prendre sa part des revenus ecclésiastiques du pays ? DROIT DE RÉGALE.En temps ordinaire, le « droit de régale » permettait au
suzerain de jouir du temporel des évêchés vacants. Aussitôt que la mort du
prélat était annoncée, les officiers royaux saisissaient les revenus
épiscopaux, s’installaient dans les villas et les châteaux du diocèse,
prélevaient des tailles sur les diocésains, nommaient même aux prébendes et
aux bénéfices ecclésiastiques : usage si utile à la Royauté qu’elle fut
souvent accusée de prolonger à dessein les vacances des sièges. Philippe
Auguste exerça avec la dernière rigueur ce droit lucratif. En 1206, à la mort
d’un évêque d’Auxerre, les forêts de l’évêché sont coupées et le bois mis en
vente ; on pêche le poisson de tous les étangs ; les gens du Roi se
saisissent des troupeaux, emportent le blé, le vin, le foin des granges épiscopales,
enlèvent jusqu’aux poutres et aux moellons que l’évêque avait fait préparer
pour la construction d’une chapelle. Les maisons qu’il habitait sont
entièrement démeublées : il n’en reste que le toit et les murs ; des sujets
de l’évêché sont arrêtés, torturés, mis en rançon. Et cependant Philippe
avait déclaré par deux fois (en 1182 et en 1190) qu’il renonçait à son droit
de régale en faveur du chapitre d’Auxerre. Les chanoines portèrent plainte :
on remit sous les yeux du Roi ses lettres de renonciation ; on lui en fit
lecture, mais il les arracha des mains du lecteur et prétendit n’avoir rien
concédé. Innocent III ordonne à l’archevêque de Tours et à l’évêque de Paris
de menacer le roi de France des censures ecclésiastiques, s’il ne réparait
pas les torts faits à l’Église d’Auxerre. Il fallut que le nouvel évêque
donnât une grosse somme d’argent, moyennant quoi Philippe, par une charte d’avril
1207, déclara se désister de la régale « par piété et pour le salut de son
âme et de celle de ses parents ». SUPPRESSION DE LA RÉGALE.Presque partout à cette époque, sous la pression d’une opinion que le Clergé inspirait, les souverains féodaux renonçaient à un usage aussi abusif. Philippe se vit obligé lui-même de céder au courant et d’affranchir certaines églises de la régale : Langres et Arras en 1203, Mâcon en 1207, Nevers et Rouen en 1208, Lodève en 1210. Mais ces concessions n’étaient pas gratuites : le Roi exigeait de l’évêque et des chanoines une rente ou un capital une fois payé : il en coûta mille livres aux clercs d’Arras pour n’être plus soumis à la régale. Philippe, en abandonnant son droit, faisait encore un sacrifice, car les comptes royaux nous apprennent qu’en 1202, la régale de Mâcon lui rapporta 2047 livres, et celle de Reims, pour dix-huit semaines de vacance, 2668 livres. Il se dédommagea par les impôts extraordinaires qu’il levait sans ménagement, et qui pesèrent surtout sur le Clergé. De son règne date l’habitude de soumettre les clercs de France à des taxes générales, à des décimes, autorisés ou non par la cour de Rome. Il n’a pas inventé « l’aide ecclésiastique pour le cas de croisade » — Louis VII l’avait levée en 1147 —, mais Philippe recommença l’expérience à plusieurs reprises. DÉCIMES PRÉLEVÉS SUR LE CLERGÉ.En 1188, il demande aux clercs du royaume, pour aider à la
délivrance de la Terre Sainte, le dixième de leurs revenus : c’est la dîme saladine.
L’Église proteste ; le célèbre archidiacre Pierre de Blois se refuse à payer
: il organise la résistance, écrit aux Églises d’Orléans, de Chartres, de
Coutances, pour les engager à ne pas céder. « Prenez garde, dit-il aux
évêques, la dîme deviendra peu à peu une habitude et, ce précédent une fois
établi, l’Église tombera en esclavage. Si votre Roi veut absolument s’en
aller en Terre Sainte, qu’il ne prenne pas l’argent de son voyage sur les dépouilles des
églises, sur la sueur des misérables ; qu’il paye ses dépenses et celles de
sa suite sur les revenus de son propre domaine, ou sur le butin qu’il
arrachera aux Infidèles. Ceux qui vont combattre pour l’Église ne doivent pas
commencer par la voler. Les entreprises entamées sous de pareils auspices tournent
mal. » Puis il soutient, à grands renforts de textes bibliques, la thèse de l’immunité
complète de la société ecclésiastique. « Sous le règne de Pharaon, dit-il, l’édit
qui établissait l’impôt général sur le cinquième des biens respecta le
privilège de la classe sacerdotale. Dans le livre des Nombres, Dieu exempte
la tribu de Lévi de toute charge publique et ne la soumet qu’à la juridiction
du grand pontife. Un prince n’a pas le droit d’exiger du prêtre autre chose
que le travail de l’oraison. Le roi Philippe a reçu de l’Église la puissance
souveraine, mais ce n’est pas pour l’opprimer ni pour ravir le bien des
pauvres. » Cette résistance des clercs n’explique pas seule l’insuccès de la dîme saladine : l’opération manqua encore pour d’autres raisons. Le taux de l’impôt était excessif, hors de proportion avec le numéraire existant, et les procédés d’évaluation et de perception étaient par trop défectueux ; si bien qu’en 1189 le Roi fut obligé d’annuler son ordonnance et de s’engager à ne renouveler jamais cette tentative. Il tint ce serment comme beaucoup d’autres ; il recommença en 1215 et en 1218, mais avec plus de succès. L’ère des décimes ecclésiastiques était ouverte et la charge, pour le clergé de France, deviendra écrasante sous les successeurs de saint Louis. EXACTIONS DE PHILIPPE AUGUSTE.Pour imposer son clergé, Philippe ne prenait pas toujours la peine de demander la permission du Pape, et quand les prélats tardaient à s’exécuter, il employait la force. En 1186, il exigeait de l’abbé de Saint-Denis, Guillaume de Gap, une contribution de mille marcs. Tout à coup on apprend que le Roi arrive à Saint-Denis. « Il descend dans l’abbaye, dit Rigord, comme dans sa propre chambre. » L’abbé, effrayé, réunit le chapitre et, plutôt que d’en passer par la volonté royale, déclare donner sa démission. Il est immédiatement remplacé. « En 1194, dit le même chroniqueur, Philippe, roi des
Français ayant appris que le roi d’Angleterre, Richard Cœur-de-Lion, avait
chassé et dépouillé de leurs biens les clercs de l’église Saint-Martin de
Tours, prit toutes les églises de sa terre appartenant aux évêques et aux
abbés qui étaient les sujets de son ennemi. Se laissant séduire par de
mauvais conseillers, il chassa les moines et les clercs qui s’y consacraient
au service de Dieu et s’appropria leurs revenus. Il accabla même, sans
ménagements, d’exactions odieuses et extraordinaires, les églises de son
propre royaume. » C’est ce que Rigord appelle les « persécutions exercées contre l’Église
», mais tout en blâmant son maître, il plaide en sa faveur les circonstances
atténuantes. « La véritable intention du Roi, dit-il, en amassant ainsi des
trésors, était de les faire servir à délivrer la terre de Jérusalem du joug
des païens, à la rendre aux chrétiens et à défendre vigoureusement le royaume
de France contre ses ennemis, quoi qu’en disent certains indiscrets qui, faute d’avoir
bien connu les projets et la volonté du Roi, l’ont accusé d’ambition et de
cupidité. » Un de ces indiscrets était certainement l’archevêque de Lyon, Jean de Belmeis, Dans un voyage en Angleterre, se trouvant à Londres, il causait avec quelques grands personnages du pays. Comme ces derniers se plaignaient beaucoup de la dureté du roi Richard, leur souverain : « Ne parlez donc pas ainsi, leur dit Jean, je vous assure que votre roi est un ermite en comparaison du roi de France. Celui-ci, l’an dernier, a osé extorquer aux églises, et surtout aux monastères, l’argent qui devait entretenir et payer ses soldats. » Voilà en effet la vraie raison de cette politique fiscale, et Philippe Auguste l’avouait : « Si j’ai amassé des trésors en différents lieux et me suis montré économe de mon argent, dit-il un jour, c’est que mes prédécesseurs, pour avoir été trop pauvres, et n’avoir pu, dans les temps de nécessité, donner une paie à leurs chevaliers, se sont vu enlever, par la guerre, une bonne partie de leurs États. » LE TRÉSOR DU ROI AU TEMPLE.Les Templiers, à cette époque, servaient de banquiers aux Capétiens aussi bien qu’aux Plantagenêts. Le compte des revenus du Roi en 1202 montre que l’argent envoyé par les prévôts et les baillis était déposé au Temple de Paris. Le chef du service de la trésorerie fut, depuis 1202, le Templier frère Aimard, un haut dignitaire de l’ordre, puisqu’il porta le titre de commandeur des maisons du Temple en France. Il figure, non seulement comme trésorier, mais comme administrateur, juge et même diplomate dans les actes de la chancellerie. On le voit présider les services de l’échiquier de Normandie (1213-1214), voyager en Italie pour le compte du Roi (1216), recevoir les engagements des vassaux et juger à titre d’arbitre d’importants procès. Il fut choisi par Philippe en septembre 1222 comme exécuteur de son testament ; la reine Ingeburge, en 1218, lui avait confié la même mission, ce qui montre en quelle estime on le tenait. FRÈRE AIMARD, TRÉSORIER DE PHILIPPE AUGUSTE.C’est lui qui fut chargé, en 1204, de la grande opération
monétaire qui suivit la conquête de la Normandie. Au nom du Roi, il s’entendit
avec les barons de cette province pour y régler le cours des monnaies. Le
résultat de cette conférence fut la substitution de la monnaie tournois à la
monnaie d’Angers. En 1214, Philippe ordonna que la monnaie parisis aurait cours
sur les terres de l’évêque et du chapitre de Beauvais. Le chapitre résista
pendant un an, mais l’évêque était Philippe de Dreux, le cousin germain du
Roi, et il ne s’associa que mollement à la protestation des gens de Beauvais.
La monnaie royale finit par l’emporter sur la monnaie seigneuriale ; vers
1220, les deniers beauvaisis semblent ne plus avoir cours. De même, en 1186,
Philippe avait introduit sur les terres de l’abbé de Corbie la monnaie
parisis. C’est un autre aspect de la conquête de la France par la Royauté14. Les bourgeois qui obtenaient de Philippe des privilèges avaient soin d’y faire insérer une clause qui les garantissait, moyennant une redevance spéciale, contre l’affaiblissement de la monnaie (chartes d’Orléans, 1183, et de Saint-Quentin, 1195). Les habitants des communes demandaient et recevaient l’assurance que la monnaie royale n’y serait pas changée sans le consentement du maire et des jurés. VIII. L’ARMÉEL’ARMÉE DE PHILIPPE AUGUSTE.L’armée de Philippe Auguste n’est pas la grande « ost » féodale, composée des troupes fournies, de par la loi des fiefs, par les vassaux de la couronne. Il n’a mis en branle la masse des contingents féodaux que dans les cas d’extrême nécessité, ou lorsqu’il n’était pas pressé d’agir, ce qui lui arriva rarement. On ne voit le plus souvent auprès de lui qu’un corps de chevaliers soldés, renforcé d’un nombre plus ou moins considérable de sergents à pied et à cheval, et de bandes de routiers de profession. C’est une troupe royale, qu’il peut mener où sa politique l’exige et garder aussi longtemps que la solde ne fait pas défaut. Il n’est pas le premier roi de France qui ait commencé à soudoyer régulièrement une cavalerie permanente ; Louis VII l’avait fait avant lui ; mais Philippe a donné à cette institution la fixité qui lui manquait. Les Plantagenêts d’ailleurs l’avaient précédé dans cette voie. Henri II, Richard et Jean sans Terre n’employaient à peu près que des mercenaires et confiaient les commandements aux chefs de bandes. LES CHEVALIERS DU ROI.Le noyau des forces militaires de Philippe Auguste se
compose de milites plus
ou moins nobles, servant sous les ordres du connétable et des maréchaux. Les
comptes du Trésor sont remplis de mentions relatives à la solde de cette cavalerie : on y
voit que la dépense faite pour cent chevaliers pendant dix jours montait à
trois cents livres. Philippe payait aussi en terres : il donnait de
véritables fiefs militaires, presque toujours à titre révocable ou viager. L’armement et le costume de ces soudoyer s est celui de
tous les cavaliers nobles à la fin du xiie siècle. Ils portent le haubert, tunique en mailles d’acier
descendant plus bas que le genou, avec les jambières de cuir couvertes
également de mailles. Sur le cou, et enveloppant toute la tête de façon à ne
laisser découverts que le nez et les yeux, ils ont le capuchon de mailles et,
sur la tête, le heaume, casque
pointu en acier, légèrement recourbé sur le devant, emboîtant bien l’occiput
et protégeant le nez par un nasal élargi
à la base. Leur arme principale est l’épée, très large, pendant sur la jambe
gauche et attachée à un ceinturon. De la main droite ils tiennent la lance,
munie d’un large fer en triangle et surmontée du gonfanon ou de l’enseigne à
plusieurs flammes. La main gauche porte Vécu, bouclier de bois léger, bordé de métal, long de 1
mètre 50 environ, en forme d’amande pointue. Le champ de l’écu est d’ordinaire
peint de couleurs voyantes : au milieu est une bosse en saillie, l’umbo
; à l’intérieur, un système de courroies permet à l’homme de suspendre son
bouclier à son cou et de le tenir ferme avec le bras. L’armure, relativement
légère et souple, lui laisse la liberté de ses mouvements. LES SERGENTS DU ROI.L’autre élément important de l’armée capétienne est la
troupe roturière des sergents, à
pied ou montés (pedites ou servientes ad equos). Moins couverts de mailles que
les chevaliers, ils portent, au lieu de heaume, le simple chapeau de fer ou
de cuir et se servent surtout d’armes qui ne sont pas réputées nobles, la
pique ou la massue hérissée de pointes. Beaucoup de ces sergents étaient
levés et entretenus par le Roi lui-même ; il tirait les autres des villes de
son domaine, surtout de celles qui, organisées en commune, possédaient une
milice déjà exercée. Sens, Laon, Tournai en fournissaient 300 ; Compiègne,
Pontoise et Mantes, 200, Beauvais, 500, l’abbaye de Saint Germain des Prés,
140, etc. Certaines villes, on l’a vu, donnaient, au lieu de sergents, une
somme tenue pour équivalente ; d’autres localités, comme Lorris et Corbeil, n’étaient
pas assujetties à une taxe fixe : elles payaient « à la volonté du Roi ». Pour
la paye de vingt et un sergents à cheval, pendant une semaine complète,
Philippe Auguste dépensait environ 4140 francs, c’est-à-dire à peu près
vingt-quatre francs par sergent et par jour. Quelques-uns de ces soldats,
peut-être ceux qui formaient sa garde permanente, recevaient de lui des dons
importants, en terres ou en revenus. L’un obtient la jouissance viagère de la
voierie de Paris ; l’autre,
une boutique devant le Châtelet ; d’autres, une porte de ville, un moulin,
les arches d’un pont, un four, des droits d’usage dans une forêt royale, des
vignes, des arpents de terre labourable. Il est clair que le corps des
sergents royaux était fort apprécié de Philippe. ARCHERS ET ARBALÉTRIERS.Les autres fantassins, plus légèrement équipés, ont la
spécialité des armes de trait : frondeurs, archers, arbalétriers. Dans les
engagements, ils sont disposés en tirailleurs sur le front de bataille ; ils
commencent le combat en criblant de pierres et de flèches les cavaliers
ennemis. Dans les sièges, ils facilitent l’approche des murailles à ceux qui
manœuvrent les machines de guerre et préparent les escalades et les assauts.
A la fin du xiie
siècle, l’archer commence à être remplacé par l’arbalétrier, dont l’arc est
plus pesant, muni d’un étrier où le pied tire sur la corde, et le trait— le
carreau — plus lourd que la flèche et plus meurtrier. C’est Richard
Cœur-de-Lion qui mit, dit-on, l’arbalète à la mode, et Philippe n’aurait fait
que l’imiter. Les arbalétriers du roi de France sont beaucoup plus souvent
mentionnés que ses archers. Le maître des arbalétriers (balistarius) est un personnage
très important, à qui le roi ne ménage pas les libéralités. INGÉNIEURS ET MACHINES DE GUERRE.L’armée capétienne est complétée par des services
auxiliaires, sapeurs, mineurs et ingénieurs, chargés de disposer les « engins
» (ingénia) ou machines
de siège. La guerre consistant alors surtout dans les opérations d’attaque
des fortifications, l’art de combler les fossés pour y appuyer les échelles d’escalade
ou les tours roulantes, de pratiquer les brèches dans les murailles, de
ruiner les remparts par la sape et le feu, était tenu en grand honneur.
Philippe y excellait et s’en faisait gloire. A chaque page de son histoire
militaire il est question de galeries de bois ou « chats » roulant sur
plancher mobile et s’appuyant aux remparts pour protéger les sapeurs ; de « beffrois
» à plusieurs étages, qui déversent les soldats sur le haut de la muraille
ennemie ; de machines à percussion, « béliers » ou « moutons » qui ébranlent
les murs, enfin de machines de jet, « pierrières et mangonneaux » qui lancent
sur l’assiégé d’énormes pierres ou des boîtes à feu. Tous ces engins, souvent
très coûteux et très compliqués, étaient construits par le corps des
charpentiers royaux, dirigés par un ingeniator. L’ARMÉE ROYALE EN MARCHE.Vient enfin la horde des valets de camp, des ribauds, et l’interminable charroi des bêtes de somme qui portent les provisions, les bagages, les tentes des combattants, souvent même l’argent et les archives du Roi. Arrivés au lieu du campement, les hommes installent leurs «
trefs » ou
pavillons, tentes coniques ou à deux pans, de toutes couleurs, au milieu
desquelles se dresse celle du Roi, surmontée d’un aigle ou d’une pomme dorée.
Pour un séjour un peu prolongé, on prend la précaution d’entourer le camp d’un
fossé que borde une palissade. Des veilleurs de nuit, les « gaîtes », donnent
l’éveil en cas d’alarme. Quand il faut lever le camp, les piquets (les « paissons
») sont retirés à la hâte, les tentes repliées autour du poteau central et
troussées sur les sommiers. Puis la colonne reprend sa marche, exposée à bien
des surprises, car les troupes en mouvement ne connaissent guère, à cette
époque, l’art de se dissimuler et de se garder. Dans sa lutte contre Richard
Cœur-de-Lion (notamment à Fréteval), Philippe fut plusieurs fois attaqué à l’improviste
par l’ennemi, qui se dérobait derrière un bois. LA STRATÉGIE.Il est rare que les armées belligérantes se concentrent de
propos délibéré en rase campagne, pour en venir aux mains. La vraie bataille,
comme à Bouvines, est un fait exceptionnel. Et quand elle a lieu, les princes
et les chefs de guerre ne se mettent pas en frais de stratégie. Rien de plus
élémentaire que la tactique de combat d’un roi de France, à la fin du xiie siècle. Le gros de l’armée est
précédé d’une avant-garde et appuyé sur un corps de réserve, minimum de
précautions. Les archers et les arbalétriers commencent par lancer des
projectiles ; puis les sergents se prennent corps à corps, enfin la cavalerie
noble s’ébranle et, au besoin, passe sur sa propre piétaille. Les chevaliers
les plus forts et les mieux armés sortent des rangs et défient les
adversaires qu’ils choisissent : ainsi s’engagent partout des duels qui
donnent au champ de bataille l’aspect d’un désordre inextricable. Les masses
qui sont aux prises par petits groupes ont cependant, dans l’ensemble, un
mouvement d’avancement ou de recul, dû aux résultats des engagements
partiels. L’objectif est de traverser l’armée ennemie de part en part, et d’aller
saisir, dans le groupe central où se tient le chef, l’enseigne brandie par le
porte-drapeau. Dans cette mêlée confuse, les fantassins, sergents et valets, interviennent pour aider les chevaliers de leur parti, remplacer les chevaux blessés ou tués, et surtout pour capturer les cavaliers désarçonnés. L’action finit avec le jour. Le lendemain, on enterre les morts, on procède aux opérations d’échange ou de rachat des prisonniers nobles ; on achève les blessés roturiers, non-valeur dont on ne peut rien tirer. Cette physionomie traditionnelle d’une bataille au temps de Philippe Auguste est à peine variée par l’emploi de certaines ruses de guerre qui n’ont rien d’une tactique supérieure, les embuscades ou « aguets » et les fausses retraites. LES CHATEAUX DU ROI.Le véritable progrès militaire (et Philippe lui-même y contribua) est dans l’art de construire, d’attaquer et de défendre les forteresses. Les châteaux, au temps des Capétiens et des Plantagenêts, sont déjà très différents de ceux du xf siècle. Au lieu de ces donjons isolés, de forme carrée ou rectangulaire, sans ouvertures ni créneaux, blocs énormes protégés par leur seule masse et l’épaisseur de leurs parois, apparaissent des fortifications d’ensemble ; le donjon n’est plus qu’un élément de la résistance, le dernier refuge des défenseurs. On continue sans doute à placer le fort principal sur un lieu élevé d’accès difficile, mais on l’enveloppe d’une double ou triple enceinte de remparts flanqués de tours ou de demi-tours arrondies, séparés par des fossés larges et profonds. Les murailles sont bâties autant que possible sur le roc vif, de manière à éviter les effets de la mine souterraine ; les remparts sont crénelés et garnis de chemins de ronde. Parfois même cette grande fortification centrale est protégée par une série de forts détachés, d’ouvrages avancés qui en interdisent les abords. C’est ainsi, on l’a vu, que se présentait le Château-Gaillard, le chef-d’œuvre de Richard Cœur-de-Lion. Les nombreux châteaux bâtis par Philippe Auguste se reconnaissent au plan rectangulaire de l’enceinte, aux tours semi-cylindriques qui la défendent, aux énormes donjons ronds qui les dominent. Le château du Louvre et sa grosse tour, où le Roi gardait (depuis 1202 tout au moins) son trésor et ses archives, ont disparu : mais à Dourdan, à Issoudun, à Gisors, les constructions de Philippe sont encore debout. De toutes ses villes, même les plus paisibles, il aurait voulu faire autant de places fortes. Rigord et Guillaume le Breton citent avec admiration les remparts qu’il a élevés, les murs qu’il a réparés, les châteaux qu’il a fait sortir de terre. LE MUR DE PHILIPPE AUGUSTE A PARIS.En 1190, au moment de partir pour la croisade, « il
ordonne d’entourer la partie de Paris située au nord de la Seine d’un mur
continu, bien garni de tourelles et de portes fortifiées, et d’en faire
autant dans les autres cités royales ». A partir de 1210, lorsque la
coalition commence à menacer la France, le Paris de la rive gauche est clos à
son tour. De cette grande enceinte de Philippe Auguste, quelques fragments
subsistent encore. Il suffit de les regarder pour se convaincre que les
maçons du Roi bâtissaient bien. La muraille avait une épaisseur de trois
mètres à fleur de sol, de deux mètres et demi à une hauteur de six mètres ; elle était
percée de portes et de poternes flanquées de tours rondes engagées dans le
rempart, 34 au sud de la Seine, 33 au nord. Philippe n’épargnait pas l’argent
et sa prévoyance entrait dans le plus menu détail, comme le prouvent les
devis (que nous possédons encore) de certains travaux de fortification. A
Corbeil, il veut que le mur ait sept toises de hauteur et six pieds d’épaisseur.
A Orléans, il faut quinze pieds d’épaisseur pour la muraille, quarante pieds
de large et vingt de profondeur pour le fossé, quatorze toises de haut pour
la tour. « Il fortifia de même, dit Guillaume le Breton, les autres cités,
bourgs et municipes du royaume, tous entourés de murs et de tours
inexpugnables. » LES MILICES COMMUNALES.Nous avons dit que, dans la pensée de ce roi guerrier, les communes devaient être avant tout des forteresses, et les milices communales des garnisons. Mais Philippe a rarement employé ces milices comme troupes d’offensive, à titre de contingents réguliers, destinés à donner dans les batailles. Il savait bien que cette infanterie bourgeoise n’avait, comme élément tactique, qu’une mince valeur. Il est vrai qu’on les voit à Bouvines, dans la
circonstance la plus critique de sa vie, et que, s’il faut en croire une
opinion encore trop répandue, les milices communales auraient alors décidé de
la victoire et scellé glorieusement de leur sang le pacte conclu entre le
Tiers État naissant et la Monarchie. Mais nous savons que les communiers de
Corbie, d’Amiens, de Beauvais, de Compiègne et d’Arras n’ont paru sur le
champ de bataille que pour être culbutés par la chevalerie allemande. Leur
présence a été si peu remarquée, elle a si peu contribué au succès final,
que, dans le onzième chant de sa Philippide
consacré tout entier à l’épisode de Bouvines, Guillaume le Breton
n’a pas jugé à propos de développer ou simplement de reproduire le court
passage de sa Chronique en prose où
il est question des communes. Ce qui explique peut-être la formation de la légende, c’est qu’un document d’archives énumère les prisonniers que les différentes communes du Nord remirent entre les mains du prévôt de Paris, peu de temps après la bataille. On en a conclu que ces prisonniers étaient ceux que les milices communales avaient eu elles-mêmes l’honneur de capturer. Il n’en est rien : ce sont ceux que le Roi avait simplement donnés à garder aux communes pour être dirigés postérieurement sur Paris et incarcérés soit au Louvre, soit au Châtelet. Dans cette conjoncture, ce ne sont pas les milices communales qui ont rendu service au Roi, mais les communes elles-mêmes, considérées comme places de sûreté. |