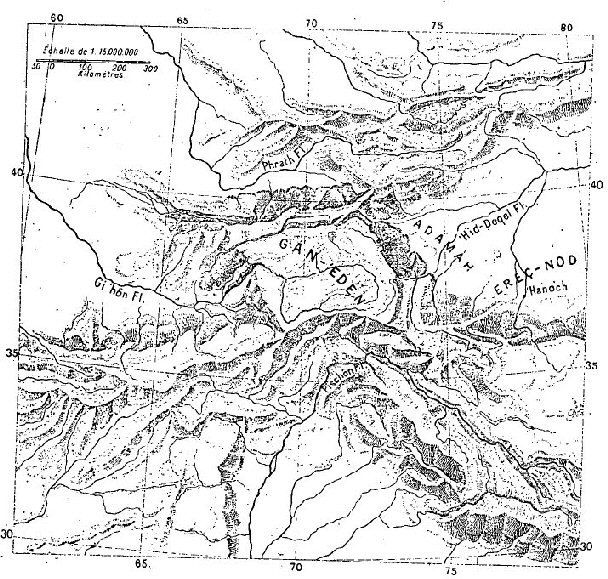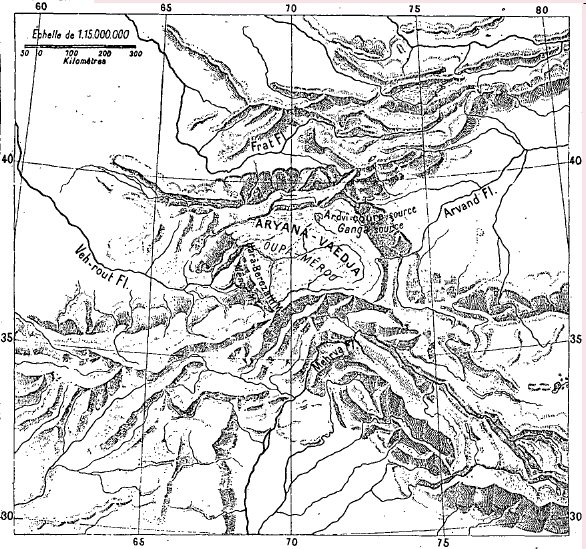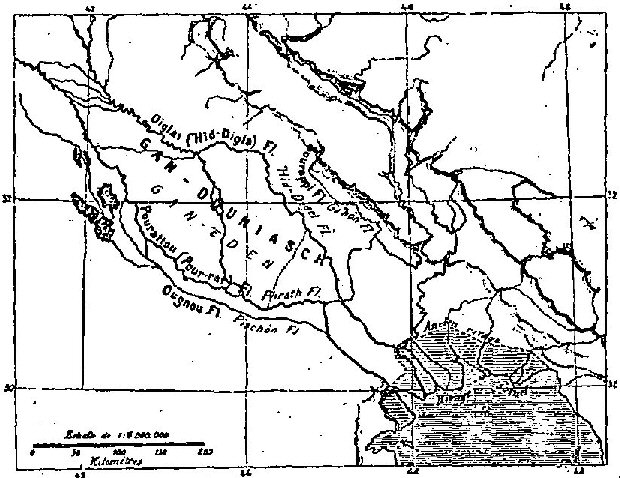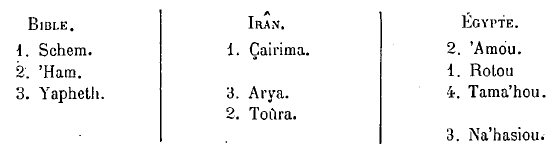Les origines, les races et les langues
LIVRE
PREMIER — LES ORIGINES
CHAPITRE II — TRADITIONS PARALLÈLES AU RÉCIT BIBLIQUE[1]
Texte numérisé par Marc Szwajcer
|
§ I. — LA CRÉATION DE L’HOMME. Le récit biblique, que nous avons résumé dans le chapitre précédent, n’est pas un récit isolé, sans rapports avec les souvenirs des autres peuples, et qui ne s’est produit que sous la plume de l’auteur de la Genèse. C’est au contraire, nous l’avons déjà dit, la forme la plus complète d’une grande tradition primitive, remontant aux âges les plus vieux de l’humanité, qui a été à l’origine commune à des races et à des peuples très divers, et qu’en se dispersant sur la surface de la terre ces races ont emportée avec elles. En racontant cette histoire, l’écrivain sacré a fidèlement reproduit les antiques souvenirs qui s’étaient conservés d’âge en âge chez les patriarches ; il a rempli ce rôle de rapporteur des traditions, éclairé par les lumières de l’inspiration, en rendant aux faits leur véritable caractère, trop souvent obscurci ailleurs par le polythéisme et l’idolâtrie, mais, comme l’a dit saint Augustin, sans se préoccuper de faire des Hébreux un peuple de savants, pas plus en histoire ancienne qu’en physique et en géologie. Nous allons maintenant rechercher chez les différents peuples de l’antiquité les débris épars de cette tradition primitive, dont la narration de la Bible nous a montré l’enchaînement. Nous en retrouverons ici et là tous les traits essentiels, même ceux où il est difficile de prendre la tradition au pied de la lettre et où l’on est autorisé à penser qu’elle avait revêtu un caractère allégorique et figuré. Mais cette recherche présente dés écueils ; il est nécessaire de s’y imposer des règles sévères de critique. Autrement on serait exposé à prendre, comme l’ont fait quelques défenseurs plus zélés qu’éclairés de l’autorité des Écritures, pour des narrations antiques et séparées, coïncidant d’une manière frappante avec le récit biblique, des légendes dues à une communication plus ou moins directe, à une sorte d’infiltration de ce récit. Il faut donc avant tout, et pour plus de sûreté ; laisser de côté tout ce qui appartient à des peuples sur les souvenirs desquels on puisse admettre une influence quelconque de prédications juives, chrétiennes ou même musulmanes. Il importe de s’attacher exclusivement aux traditions dont on peut établir l’antiquité et qui s’appuient sur de vieux monuments écrits d’origine indigène. Entre toutes ces traditions, celle qui offre avec les récits des premiers chapitres de la Genèse la ressemblance la plus étroite, le parallélisme le plus exact et le plus suivi, est celle que contenaient les livres sacrés de Babylone et de la Chaldée. L’affinité que nous signalons, et que l’on verra se développer dans les pages qui vont suivre, avait déjà frappé les Pères de l’Eglise, qui ne connaissaient la tradition chaldéenne que par l’ouvrage de Bérose, prêtre de Babylone, qui, sous les premiers Séleucides, écrivit en grec l’histoire de son pays depuis les origines du monde ; elle se caractérise encore plus, maintenant que la science moderne est parvenue à déchiffrer quelques lambeaux, conservés jusqu’à nous, des livres qui servaient de fondement à renseignement des écoles sacerdotales sur les rives de l’Euphrate et du Tigre. Mais il faut remarquer qu’au témoignage de la Bible elle-même, la famille d’où sortit Abraham vécut longtemps mêlée aux Chaldéens, que c’est de la ville d’Our en Chaldée qu’elle partit pour aller chercher une nouvelle patrie dans le pays de Kena’an. Bien donc de plus naturel et de plus vraisemblable que d’admettre que Téra’hites apportèrent avec eux de la contrée d’Our un récit traditionnel sur la création du monde et sur les premiers jours de l’humanité, étroitement apparenté à celui des Chaldéens eux-mêmes. De l’un comme de l’autre côté, la formation du monde est l’œuvre des sept jours, les diverses créations s’y succèdent dans le même ordre ; le déluge, la confusion des langues et la dispersion des peuples sont racontés d’une façon presque absolument identique. Et cependant un esprit tout opposé anime les deux récits. L’un respire un monothéisme rigoureux et absolu, l’autre un polythéisme exubérant. Un véritable abîme sépare les deux conceptions fondamentales de la cosmogonie babylonienne et de la cosmogonie biblique, malgré les plus frappantes ressemblances dans la forme extérieure. Chez les Chaldéens nous avons la matière éternelle organisée par un ou plusieurs démiurges qui émanent de son propre sein, dans la Bible l’univers créé du néant par la toute-puissance d’un Dieu purement spirituel. Pour donner au vieux récit que l’on faisait dans les sanctuaires de la Chaldée ce sens tout nouveau, pour le transporter des conceptions du panthéisme le plus matériel et le plus grossier dans la lumière de la vérité religieuse, il a suffi au rédacteur de la Genèse d’ajouter au début de tout, avant la peinture du chaos, par laquelle commençaient les cosmogonies de la Chaldée et de la Phénicie, ce simple verset : Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Dès lors l’acte libre du créateur spirituel est placé avant l’existence même du chaos, que le panthéisme païen croyait antérieur à tout ; ce chaos, premier principe pour les Chaldéens, et d’où les dieux eux-mêmes étaient sortis, devient une création que l’Eternel fait apparaître dans le temps. Dans l’état actuel des connaissances, maintenant que nous pouvons établir une comparaison entre le récit chaldéen et le récit biblique, il ne semble plus y avoir que deux opinions possibles pour expliquer leur relation réciproque, et ces deux opinions peuvent être acceptées l’une et l’autre sans s’écarter du respect dû à l’Écriture Sainte. Elles laissent encore à la révélation et à l’inspiration divine une part assez large pour satisfaire aux exigences de la plus rigoureuse orthodoxie, bien qu’elles écartent’ l’idée d’une sorte de dictée surnaturelle du texte sacré, qui n’a jamais, du reste, été enseignée dogmatiquement. Ou bien l’on, considérera la Genèse comme une édition expurgée de la tradition chaldéenne, où le rédacteur inspiré a fait pénétrer un esprit nouveau, tout en conservant les lignes essentielles,et d’où il a soigneusementbanni toutes les erreurs du panthéisme et du polythéisme. Ou bien l’on verra dans la narration de la Bible et dans celle du sacerdoce de la Chaldée deux formes divergentes du même rameau de la tradition primitive, qui, partant d’un fond commun, reflètent dans leurs différences le génie de deux peuples et de deux religions, une disposition spéciale de la Providence ayant permis que chez les Téra’hites ces vieux récits, en partie symboliques et figurés, se soient maintenus à l’abri du mélange impur qui les entachait chez les peuplés d’alentour. Nous ne nous reconnaissons pas autorité pour prononcer en faveur de l’une ou de l’autre de ces deux opinions, entre lesquelles nous laissons le choix au lecteur. En général, dans les idées des peuples anciens, l’homme est considéré comme autochtone ou né de la terre qui le porte. Et le plus souvent, dans les récits qui ont trait à sa première apparition, nous ne trouvons pas trace de la notion qui le fait créer par l’opération toute-puissante d’un dieu personnel et distinct de la matière primordiale. Les idées fondamentales de panthéisme et d’émanatisme, qui étaient la base des religions savantes et orgueilleuses de l’ancien monde, permettaient de laisser dans le vague l’origine et la production des hommes. On les regardait comme issus, ainsi que toutes les choses, de la substance même de la divinité, confondue avec le monde ; ils en sortaient spontanément, par le développement de la chaîne des émanations, non par un acte libre et déterminé de la volonté créatrice, et on s’inquiétait peu de définir autrement que sous une forme symbolique et mythologique le comment de l’émanation, qui avait lieu par un véritable fait de génération spontanée. Du vent Colpias et de son épouse Baau (le chaos), dit un des fragments de cosmogonie phénicienne, traduits en grec, qui nous sont parvenus sous le nom de Sanchoniathon, naquit le couple humain et mortel de Protogonos (Adam Qadmôn) et d’Æon (‘Havah), et Æon inventa de manger le fruit de l’arbre. Ils eurent pour enfants Génos et Généa, qui habitèrent la Phénicie, et, pressés par les chaleurs de l’été, commencèrent à élever leurs mains vers le Soleil, le considérant comme le seul dieu seigneur du ciel, ce que l’on exprime par le nom de Beelsamen. Dans un autre fragment des mêmes cosmogonies, il est question de la naissance de l’autochtone issu de la terre, d’où descendent les hommes. Les traditions de la Libye faisaient sortir des plaines échauffées par le soleil Iarbas, le premier des humains, qui se nourrit des glands doux du chêne. Dans les idées des Égyptiens, le limon fécondant abandonné parle Nil, sous l’action vivifiante de réchauffement des rayons solaires, avait fait germer les corps des hommes. La traduction de cette croyance sous une forme mythologique faisait émaner les humains de l’oeil du dieu Râ-Harmakhou, c’est-à-dire du soleil. L’émanation qui produit ainsi la substance matérielle des hommes n’empêche pas, du reste, une opération démiurgique postérieure pour achever de les former et pour leur communiquer l’âme et l’intelligence. Celle-ci est attribuée à la déesse Sekhet pour les races asiatiques et septentrionales, à Horus pour les nègres. Quant aux Égyptiens, qui se regardaient comme supérieurs à toutes les autres races, leur formateur était le démiurge suprême, Khnoum, et c’est de cette façon que certains monuments le montrent pétrissant l’argile pour en faire l’homme sur le même tour à potier, où il a formé l’œuf primordial de l’univers. Présentée ainsi, la donnée égyptienne se rapproche d’une manière frappante de celle de la Genèse, où Dieu forme l’homme, du limon de la terre. Au reste, l’opération du modeleur fournissait le moyen le plus naturel de représenter aux imaginations primitives l’action du créateur ou du démiurge sous une forme sensible. Et c’est ainsi que chez beaucoup de peuples encore sauvages on retrouve la même notion de l’homme façonné avec la terre par la main du créateur. Dans la cosmogonie du Pérou, le premier homme, créé par la toute-puissance divine, s’appelle Alpa camasca, terre animée. Parmi les tribus de l’Amérique du Nord, les Mandans racontaient que le Grand-Esprit forma deux figures d’argile, qu’il dessécha et anima du souffle de sa bouche, et dont l’un reçut le nom de premier homme, et l’autre celui de compagne. Le grand dieu de Tahiti, Taeroa, forme l’homme avec de la terre rouge ; et les Dayaks de Bornéo, rebelles à toutes les influences musulmanes, se racontent de génération en génération que l’homme, a été modelé avec de la terre. N’insistons pas trop, d’ailleurs, sur cette dernière catégorie de rapprochements, où il serait facile de s’égarer, et tenons-nous à ceux que nous offrent les traditions sacrées des grands peuples civilisés de l’antiquité. Le récit cosmogonique chaldéen, spécial à Babylone, que Bérose avait, mis en grec, se rapproche beaucoup de ce que nous lisons dans le chapitre II de la Genèse ; là encore l’homme est formé de limon à la manière d’une statue. Bélos (le démiurge Bel-Maroudouk), voyant que la terre était déserte, quoique fertile, se trancha sa propre tête, et les autres dieux, ayant pétri le sang qui en coulait avec la terre, formèrent les hommes, qui, pour cela, sont doués d’intelligence et participent de la pensée divine[2], et aussi les animaux qui peuvent vivre au contact de l’air. Avec la différence d’une mise en scène polythéiste d’une part, strictement monothéiste de l’autre, les faits suivent ici exactement le même ordre que dans la narration du chapitre II du premier livre du Pentateuque. La terre déserte[3] devient fertile[4] ; alors l’homme est pétri d’une argile dans laquelle l’âme spirituelle et le souffle vital sont communiqués[5]. Un jeune savant anglais, doué du génie le plus pénétrant et qui, dans une carrière bien courte, terminée brusquement par la mort, a marqué sa trace d’une manière ineffaçable parmi les assyriologues, George Smith, a reconnu parmi les tablettes d’argile couvertes d’écriture cunéiforme, et provenant delà bibliothèque palatine de Ninive, que possède le Musée Britannique, les débris d’une sorte d’épopée cosmogonique, de Genèse assyro-babylonienne, où était racontée l’œuvre des sept jours. Chacune des tablettes dont la réunion composait cette histoire, portait un des chants du poème, un des chapitres du récit, d’abord la génération des dieux issus du chaos primordial, puis les actes successifs de la création, dont la suite est la même que dans le chapitre Ier de la Genèse, mais dont chacun est attribué à un dieu différent. Cette narration paraît être de rédaction proprement assyrienne. Car chacune des grandes écoles sacerdotales, dont on nous signale l’existence dans le territoire de la religion chaldéo-assyrienne, semble avoir eu sa forme particulière de la tradition cosmogonique ; le fonds était partout le même, mais son expression mythologique variait sensiblement. Le récit de la formation de l’homme n’est malheureusement pas compris dans les fragments jusqu’ici reconnus de la Genèse assyrienne. Mais nous savons du moins d’une manière positive que celui des immortels qui y était représenté comme ayant formé de ses mains la race des hommes, comme ayant formé l’humanité pour être soumise aux dieux, était Êa, le dieu de l’intelligence suprême, le maître de toute sagesse, le dieu de la vie pure, directeur de la pureté, celui qui vivifie les morts, le miséricordieux avec qui existe la vie. C’est ce que nous apprend une sorte de litanie de reconnaissance, qui nous a été conservée sur le lambeau d’une tablette d’argile, laquelle faisait peut-être partie de la collection des poèmes cosmogoniques. Un des titres les plus habituels de Êa est celui de seigneur de l’espèce humaine ; il est aussi plus d’une fois question, dans les documents religieux et cosmogoniques, des rapports entre ce dieu et l’homme qui est sa chose. Chez les Grecs, une tradition raconte que Prométhée, remplissant l’office d’un véritable démiurge en sous-ordre, a formé l’homme en le modelant avec de l’argile, les uns disent à l’origine des choses, les autres après le déluge de Deucalion et la destruction d’une première humanité. Cette légende a joui d’une grande popularité à l’époque romaine, et elle a été alors plusieurs fois retracée sur les sarcophages. Mais elle semble être le produit d’une introduction d’idées étrangères, car on n’en trouve pas de trace aux époques plus anciennes. Dans la poésie grecque vraiment antique, Prométhée n’est pas celui qui a formé les hommes, mais celui qui les a animés et doués d’intelligence en leur communiquant le feu qu’il a dérobé au ciel, par un larcin dont le punit la vengeance de Zeus. Telle est là donnée du Prométhée d’Eschyle, et c’est ce que nous donne à lire encore, à une époque plus ancienne, le poème d’Hésiode : Les travaux et les jours. Quant à la naissance même des premiers humains, produits sans avoir eu de pères, les plus vieilles traditions grecques, qui trouvaient déjà des sceptiques au temps où furent composées les poésies décorées du nom d’Homère, les faisaient sortir spontanément, ou par une action volontaire des dieux, de la terre échauffée ou bien du tronc éclaté des chênes. Cette dernière origine était aussi celle que leur attribuaient les Italiotes. Dans la mythologie Scandinave, les dieux tirent les premiers humains du tronc des arbres, et la même croyance existait chez les Germains. On en observe des vestiges très formels dans les Védas ou recueils d’hymnes sacrés de l’Inde, et nous allons encore la trouver avec des particularités fort remarquables, chez les Iraniens de la Bactriane et de la Perse. La religion de Zarathoustra (Zoroastre) est la seule, parmi les religions savantes et orgueilleuses de l’ancien monde, qui rapporte la création à l’opération libre d’un dieu personnel, distinct de la matière primordiale. C’est Ahouramazda, le dieu bon et grand, qui a créé l’univers et l’homme en six périodes successives, lesquelles, au lieu d’embrasser seulement une semaine, comme dans la Genèse, forment par leur réunion une année de 365 jours ; l’homme est l’être par lequel il a terminé son œuvre. Le premier des humains, sorti sans tache des mains du créateur, est appelé Gayômaretan, vie mortelle ! Les Écritures les plus antiques, attribuées au prophète de l’Iran, bornent ici leurs indications ; mais nous trouvons une histoire plus développée des origines de l’espèce humaine dans le livre intitulé Boundehesch, consacré à l’exposition d’une cosmogonie complète. Ce livre est écrit en langue pehlevie, et non plus en zend comme ceux de Zarathoustra ; la rédaction que nous en possédons est postérieure à la conquête de la Perse par les Musulmans. Malgré cette date récente, il relate des traditions dont tous les savants compétents ont reconnu le caractère antique et nettement indigène. D’après le Boundehesch, Ahouramazda achève sa création en produisant à la fois Gayômaretan, l’homme type, et le taureau type, deux créatures d’une pureté parfaite, qui vivent d’abord 3.000 ans sur la terre, dans un état de béatitude et sans craindre de maux jusqu’au moment où Angrômainyous, le représentant du mauvais principe, commence à faire sentir sa puissance dans le monde. Celui-ci frappe d’abord de mort le taureau type ; mais du corps de sa victime naissent les plantes utiles et les animaux qui servent à l’homme. Trente ansaprès, c’est au tour de Gayômaretan de périr sous les coups d’Angrômainyous. Cependant le sang de l’homme type, répandu à terre au moment de sa mort, y germe au bout de quarante ans. Du sol s’élève une plante de reivas, sorte de rhubarbe employée à l’alimentation par les Iraniens. Au centre de cette plante se dresse une tige qui a la forme d’un double corps d’homme et de femme, soudés entre eux par leur partie postérieure. Ahouramazda les divise, leur donne le mouvement et l’activité, place en eux une âme intelligente et leur prescrit d’être humbles de cœur ; d’observer la loi ; d’être purs dans leurs pensées, purs dans leurs paroles, purs dans leurs actions. Ainsi naissent Maschya et Maschyâna, le couple d’où descendent tous les humains. La notion exprimée dans ce récit, que le premier couple humain a formé originairement un seul être androgyne à deux faces, séparé ensuite en deux personnages par la puissance créatrice, se trouve aussi chez les Indiens, dans la narration cosmogonique du Çatapatha Brâhmana. Ce dernier écrit est compris dans la collection du Rig-Véda, mais très postérieur à la composition des hymnes du recueil. Le récit tiré par Bérose des documents chaldéens place aussi des hommes à deux têtes, l’une d’homme et l’autre de femme, sur un seul corps, et avec les deux sexes en même temps, dans la création première, née au sein du chaos avant la production des êtres qui peuplent actuellement la terre. Platon, dans son Banquet, fait raconter par Aristophane l’histoire des androgynes primordiaux, séparés ensuite par les dieux en homme et femme, que les philosophes de l’école ionienne avaient empruntée à l’Asie et fait connaître à la Grèce. § 2. — LE PREMIER PÉCHÉ. L’idée de la félicité édénique des premiers humains constitue l’une des traditions universelles. Pour les Égyptiens, le règne terrestre du dieu Râ, qui avait inauguré l’existence du monde et de l’humanité, était un âge d’or auquel ils ne songeaient jamais sans regret et sans envie ; pour dire d’une chose qu’elle était supérieure à tout ce qu’on pouvait imaginer, ils affirmaient ne pas en avoir vu la pareille depuis les jours du dieu Râ. Cette croyance à un âge de bonheur et d’innocence par lequel débuta l’humanité se trouve aussi chez tous les peuples de race aryenne ou japhétique ; c’est une de celles qu’ils possédaient déjà antérieurement à leur séparation, et tous les érudits ont depuis longtemps remarqué que c’est là un des points où leurs traditions se rattachent le plus formellement à un fond commun avec celles des Sémites, avec celles dont nous avons l’expression dans la Genèse. Mais chez les nations aryennes, cette croyance se lie intimement à une conception qui leur est spéciale, celle des quatre âges successifs du monde. C’est dans l’Inde que nous trouvons cette conception à son état de plus complet développement. Les choses créées, et avec elles l’humanité, doivent durer 12.000 années divines, dont chacune comprend 360 années des hommes. Cette énorme période de temps se divise en quatre âges ou époques : l’âge de la perfection ou Kritayouga ; l’âge du triple sacrifice, c’est-à-dire du complet accomplissement de tous les devoirs religieux, ou Trêtayouga ; l’âge du doute et de l’obscurcissement des notions de la religion, le Dvaparayouga ; enfin l’âge de la perdition ou Raliyouga, qui est l’âge actuel et qui se terminera par la destruction du monde. Chez les Grecs, dans Les travaux et les jours d’Hésiode, nous avons exactement la même succession d’âges, mais sans que leur durée soit évaluée en années et en supposant au commencement de chacun d’eux la production d’une humanité nouvelle ; la dégénérescence graduelle qui marque cette succession d’âges est exprimée par les métaux dont on leur applique les noms, l’or, l’argent, l’airain et le fer. Notre humanité présente est celle de l’âge de fer, le pire de tous, bien qu’il ait commencé par les héros. Le mazdéisme zoroastrien admet aussi la théorie des quatre âges[6] et nous la voyons exprimée dans le Boundehesch, mais sous une forme moins rapprochée de celle des Indiens que chez Hésiode et sans le même esprit de désolante fatalité. La durée de l’univers y est de 12.000 ans, divisée en quatre périodes de 3.000. Dans la première tout est pur ; le dieu bon, Ahouramazda, règne seul sur sa création, où le mal n’a pas encore fait son apparition ; dans la seconde, Angrô-mainyous sort des ténèbres, où il était resté d’abord immobile, et déclare la guerre à Ahouramazda ; c’est alors que commence leur lutte de 9.000 ans, qui remplit trois âges du monde. Pendant 3.000 ans, Angrô-mainyous est sans force ; pendant 3.000 autres années, les succès des deux principes se balancent d’une manière égale ; enfin le mal l’emporte dans le dernier âge, qui est celui des temps historiques ; mais il doit se terminer par la défaite finale d’Angrômainyous, que suivra la résurrection des morts et la béatitude éternelle des justes rendus à la vie. Quelques savants se sont efforcés de retrouver dans l’économie générale de l’histoire biblique des traces de ce système des quatre âges du monde. Mais la critique impartiale doit reconnaître qu’ils n’y ont pas réussi ; les constructions sur lesquelles ils ont voulu étayer leur démonstration sont absolument artificielles, en contradiction avec l’esprit .du récit biblique, et s’écroulent d’elles-mêmes. L’un de ces savants, M. Maury, reconnaît, d’ailleurs, qu’il y a une opposition fondamentale entre la tradition biblique et la légende de l’Inde brahmanique ou d’Hésiode. Dans cette dernière, comme il le remarque, on ne voit aucune trace d’une prédisposition à pécher, transmise par un héritage du premier homme à ses descendants, aucun vestige du péché originel. Sans doute, comme l’a dit si éloquemment Pascal, le nœud de notre condition prend ses retours et ses replis dans cet abîme, de sorte que l’homme est plus inconcevable sans ce mystère que ce mystère n’est inconcevable à l’homme ; mais la vérité de la déchéance et de la tache originelle est une de celles contre lesquelles l’orgueil humain s’est le plus constamment révolté, celle à laquelle il a cherché tout d’abord à se soustraire. Aussi, de toutes les parties de la tradition primitive sur les débuts de l’humanité, est-ce celle qui s’est oblitérée le plus vite. Dès que les hommes ont senti naître le sentiment de superbe que leur inspiraient les progrès de leur civilisation, les conquêtes sur le monde matériel, ils l’ont répudiée. Les philosophies religieuses qui se sont fondées en dehors de la révélation, dont le dépôt se maintenait chez le peuple choisi, n’ont pas tenu compte de la déchéance. Et comment d’ailleurs cette doctrine eût-elle pu cadrer avec les rêveries du panthéisme et de l’émanation ? En repoussant la notion du péché originel et en substituant à la doctrine de la création celle de l’émanation, la plupart des peuples de l’antiquité païenne ont été conduits à la désolante conclusion qui est contenue dans la théorie des quatre âges, telle que l’admettent les livres des Indiens et la poésie d’Hésiode. C’est la loi de la décadence et de la péjoration continue, que le monde antique a cru sentir si lourdement peser sur lui. A mesure que le temps s’écoule et éloigne les choses de leur foyer d’émanation, elles se corrompent et deviennent pires. C’est l’effet d’une destinée inexorable et de la force même de leur développement. Dans cette évolution fatale vers le déclin, il n’y a plus place pour la liberté humaine ; tout tourne dans un cercle auquel il n’y a pas moyen d’échapper. Chez Hésiode, chaque âge marque une décadence sur celui qui précède, et, comme le poète l’indique formellement pour l’âge de fer commencé par les héros, chacun d’eux pris isolément suit la même pente descendante que leur ensemble. Dans l’Inde, la conception des quatre âges ou yougas,en se développant et en produisant ses conséquences naturelles, enfante celle des manvantaras. Dans cette nouvelle donnée, le monde après avoir accompli ses quatre âges toujours pires, est soumis à une dissolution, pralaya, quand les choses sont arrivées à un tel point de corruption qu’elles ne peuvent plus subsister ; puis recommence un nouvel univers, avec une nouvelle humanité, astreints au même cycle d’évolutions nécessaires et fatales, qui parcourent à leur tour leur quatre yougas jusqu’à une nouvelle dissolution ; et ainsi de suite à l’infini. C’est la fatalité du destin sous la forme la plus cruellement inexorable et en même temps la plus destructive de toute vraie morale. Car il n’y a plus de responsabilité là où il n’y a pas de liberté ; il n’y a plus en réalité ni bien ni mal là où la corruption est l’effet d’une loi d’évolution inéluctable. Combien plus consolante est la donnée biblique, qui au premier abord semble si dure pour l’orgueil humain, et quelles incomparables perspectives morales elle ouvre à l’esprit ! Elle admet que l’homme est déchu, presque aussitôt après sa création, de son état de pureté originaire et de sa félicité édénique. En vertu de la loi d’hérédité qui est partout empreinte dans la nature, c’est la faute commise par les premiers ancêtres de l’humanité, dans l’exercice de leur liberté morale, qui a condamné leur descendance à la peine, qui la prédispose au péché en lui léguant la tache originelle. Mais cette prédisposition au péché ne condamne pas fatalement l’homme à le commettre ; il peut y échapper parle choix de son libre arbitre ; de même, par ses efforts personnels, il se relève graduellement de l’état de déchéance matérielle et de misère où l’a fait descendre la faute de ses auteurs. Les quatre âges de la conception païenne déroulent le tableau d’une dégénérescence cons : tante. Toute l’économie de l’histoire biblique, depuis les premiers chapitres de la Genèse qui y servent de point de départ, nous offre le spectacle d’un relèvement continu de l’humanité à partir de sa déchéance originelle. D’un côté la marche est constamment descendante, de l’autre constamment ascendante. L’Ancien Testament, qu’il faut embrasser ici tout entier d’une vue générale, s’occupe peu de cette marche ascendante en ce qui est du développement de la civilisation matérielle, dont il indique cependant en passant les principales étapes d’une manière fort exacte. Ce qu’il retrace, c’est le tableau du progrès moral et du développement toujours plus net de la vérité religieuse, dont la notion va en se spiritualisant, s’épurant et s’élargissant toujours davantage, chez le peuple choisi, par une succession d’échelons que marquent la vocation d’Abraham, la promulgation de la loi mosaïque, enfin la mission des prophètes, lesquels annoncent à leur tour le dernier et suprême progrès. Celui-ci résulte de la venue du Messie ; et les conséquences de ce dernier fait providentiel iront toujours en se développant dans le monde en tendant à une perfection dont le terme est dans l’infini. Cette notion du relèvement après la déchéance, fruit des efforts libres de l’homme assisté par la grâce divine et travaillant dans la limite de ses forces à l’accomplissement du plan providentiel, l’Ancien Testament ne lé montrait que chez un seul peuple, celui d’Israël ; mais l’esprit chrétien en a étendu la vue à l’histoire universelle de l’humanité. El c’est ainsi qu’est née la conception de cette loi du progrès constant, que l’antiquité n’a pas’ connue, à laquelle nos sociétés modernes sont si invinciblement attachées, mais qui, nous ne devons jamais l’oublier, est fille du christianisme. Revenons aux traditions sur le premier péché, parallèles à celle de la Genèse. Le zoroastrisme ne pouvait manquer d’admettre cette donnée traditionnelle et de la conserver. Celte tradition cadrait, en effet, trop bien avec son système de dualisme à base spirituelle, bien qu’encore imparfaitement dégagé de la confusion entre le monde physique et le monde moral. Elle expliquait de la façon la plus naturelle comment l’homme, créature du dieu bon, et par suite parfaite à l’origine, était tombée eu partie sous la puissance du mauvais esprit, contractant ainsi la souillure qui le rendait dans l’ordre moral sujet au péché, dans l’ordre matériel soumis à la mort et à toutes les misères qui empoisonnent la vie terrestre. Aussi la notion du péché des premiers auteurs de l’humanité, dont l’héritage pèse constamment sur leur descendance, est-elle fondamentale dans les livres mazdéens. La modification des légendes relatives au premier homme finit même, dans les constructions mythiques des derniers temps du zoroastrisme, par amener une assez singulière répétition de ce souvenir de la première faute, à plusieurs générations successives dans les âges initiaux de l’humanité. Originairement — et ceci est maintenant un des points les plus solidement établis pour la science — originairement, dans les légendes communes aux Aryas orientaux antérieurement à leur séparation en deux branches, le premier homme était le personnage que les Iraniens appellent Yima et les Indiens Yâma. Fils du ciel et non de l’homme, Yima réunit sur lui les traits que la Genèse sépare en les appliquant à Adam et à Noa’h, les pères des deux humanités antédiluvienne et postdiluvienne. Plus lard, il est seulement le premier roi des Iraniens, mais un roi dont l’existence, comme celle de ses sujets, se passe au milieu de la béatitude édénique, dans le paradis de l’Airyana-Vaedja, séjour de, premiers hommes. Mais après un temps de vie pure et sans taches Yima commet le péché qui pèsera sur sa descendance ; et ce péché, lui faisant perdre la puissance et le rejetant hors de la terre paradisiaque, le livre au pouvoir du serpent, du mauvais esprit Angrômainyous, qui finit par le faire périr dans d’horribles tourments. Plus tard, Yima n’est plus le premier homme, ni même le premier roi. C’est le système adopté par le Boundehesch. L’histoire de la faute qui a fait perdre à Yima son bonheur édénique, en le mettant au pouvoir de l’ennemi, reste toujours attachée au nom de ce héros. Mais cette faute n’est plus le premier péché, et, pour pouvoir être attribué aux ancêtres- d’où descendent tous les hommes, celui-ci est raconté une première fois auparavant et rapporté à Maschya et Maschyàna. L’homme fut, le père du monde fut. Le ciel lui était destiné, à condition qu’il serait humble de cœur, qu’il ferait avec humilité l’œuvre delà loi, qu’il serait pur dans ses pensées, pur dans ses paroles, pur dans ses actions, et qu’il n’invoquerait pas les Daevas (les démons). Dans ces dispositions, l’homme et la femme devaient faire réciproquement le bonheur l’un de l’autre. Telles furent aussi au commencement leurs pensées ; telles furent leurs actions. Ils s’approchèrent et eurent commerce ensemble. D’abord ils dirent ces paroles : « C’est Ahouramazda qui a donné l’eau, la terre, les arbres, les bestiaux, les astres, la lune, le soleil, et tous les biens qui viennent d’une racine pure et d’un fruit pur. » Ensuite le mensonge courut sur leurs pensées ; il renversa leurs dispositions et leur dit : « C’est Angrômainyous qui a donné l’eau, la terre, « les arbres, les animaux et tout ce qui a été nommé ci-dessus. » Ce fut ainsi qu’au commencement Angrômainyous les trompa sur ce qui regardait les Deavas ; et jusqu’à la fin ce cruel n’a cherché qu’à les séduire. En croyant ce mensonge, tous deux devinrent pareils aux démons, et leurs âmes seront dans l’enfer jusqu’au renouvellement des corps. Ils mangèrent pendant trente jours, se couvrirent d’habits noirs. Après ces trente jours, ils allèrent à la chasse ; une chèvre blanche se présenta ; ils tirèrent avec leur bouche du lait de ses mamelles, et se nourrirent de ce lait qui leur fit beaucoup de plaisir.... Le Daeva qui dit le mensonge, devenu plus hardi, se présenta une seconde fois et leur apporta des fruits qu’ils mangèrent, et par là, de cent avantages dont ils jouissaient, il ne leur en resta qu’un. Après trente jours et trente nuits, un mouton gras et blanc se présenta ; ils lui coupèrent l’oreille gauche. Instruits par les Yazatas célestes, ils tirèrent le feu de l’arbre konar en le frottant avec un morceau de bois. Tous deux mirent le feu à l’arbre ; ils activèrent le feu avec leur bouche. Ils brûlèrent d’abord des morceaux de l’arbre konar, puis du dattier et du myrte. Ils firent rôtir ce mouton, qu’ils divisèrent en trois portions.... Ayant mangé de la chair de chien, ils se couvrirent de la peau de cet animal. Ils s’adonnèrent ensuite à la chasse et se firent des habits du poil des bêtes fauves. Remarquons ici qu’également dans la Genèse la nourriture végétale est la seule dont le premier homme use dans son état de béatitude et de pureté, la seule que Dieu lui ait permise[7] ; la nourriture animale ne devient licite qu’après le déluge[8]. C’est aussi après le péché que Adam et ‘Havah se couvrent de leur premier vêtement, que Yahveh leur façonne lui-même avec des peaux de bêtes[9]. Non moins frappant est le récit que nous rencontrons dans les traditions mythiques des Scandinaves, conservées par l’Edda de Snorre Sturluson, et qui appartient aussi au cycle des légendes germaniques. La scène ne se passe pas parmi les humains, mais entre des êtres de race divine, les Ases. L’immortelle Idhunna demeurait avec Bragi, le premier des skaldes ou chantres inspirés, à Asgard, dans le Midhgard, le milieu du monde, le paradis, dans un état de parfaite innocence. Les dieux avaient confié à sa garde les pommes de l’immortalité ; mais Loki le rusé, l’auteur de tout mal, le représentant du mauvais principe, la séduisit avec d’autres pommes qu’il avait découvertes, disait-il, dans un bois. Elle l’y suivit pour en cueillir ; mais soudain elle fut enlevée par un géant, et le bonheur ne fut plus dans Asgard. Nous n’avons pas de preuve formelle et directe de ce que la tradition du péché originel, telle que la racontent nos Livres Saints, ait fait partie du cycle des récits de Babylone et de la Chaldée sur les origines du mondé et de l’homme. On n’y trouve non plus aucune allusion dans les fragments de Bérose. Malgré ce silence, le parallélisme des traditions chaldéennes et hébraïques, sur ce point comme sur les autres, a en sa faveur une probabilité si grande, qu’elle équivaut presque à une certitude. Nous reviendrons un peu plus loin sur certains indices fort probants de l’existence de mythes relatifs au paradis terrestre dans les traditions sacrées du bassin inférieur de l’Euphrate et du Tigre. Mais il importe de nous arrêter quelques instants aux représentations de la plante mystérieuse et sacrée que les bas-reliefs assyriens nous font voir si souvent, gardée par des génies célestes. Aucun texte n’est venu jusqu’à présent éclairer le sens de ce symbole, et l’on doit déplorer une telle lacune, que combleront sans doute un jour des documents nouveaux. Mais par l’étude des seuls monuments figurés, il est impossible de se méprendre sur la haute importance de cette représentation de la plante sacrée. C’est incontestablement un des emblèmes les plus élevés delà religion ; et ce qui achève de lui assurer ce caractère, c’est que souvent au-dessus de la plante nous voyons planer l’image symbolique du dieu suprême, le disque ailé, surmonté ou non d’un buste humain. Les cylindres de travail babylonien ou assyrien ne présentent pas cet emblème moins fréquemment que les bas-reliefs des palais de l’Assyrie, toujours dans les mêmes conditions et en lui attribuant autant d’importance. Il est bien difficile de ne pas rapprocher cette plante mystérieuse, en qui tout fait voir un symbole religieux de premier ordre, des fameux arbres de la vie et de la science, qui jouent un rôle si considérable dans l’histoire du premier péché. Toutes les traditions paradisiaques les mentionnent : celle de la Genèse, qui semble admettre tantôt deux arbres, celui de la vie et celui de la science, tantôt un seulement, réunissant les deux attributions, dans le milieu du jardin de ‘Éden ; celle de l’Inde, qui en suppose quatre, plantés sur les quatre contreforts du mont Mêrou ; enfin celle des Iraniens, qui n’admet tantôt qu’un seul arbre, sortant du milieu même de la source sainte Ardvî-çoùra dans l’Airyana-vaedja, tantôt deux, correspondant exactement à ceux du ‘Éden biblique. Le plus ancien nom de Babylone, dans l’idiome de la population antésémitique,Tin-tir-kî,signifie le lieu de l’arbre de vie. Enfin la figure de la plante sacrée, que nous assimilons à celle des traditions édéniques, apparaît comme un symbole de vie éternelle sur les curieux sarcophages en terre émaillée, appartenant aux derniers temps de la civilisation chaldéenne, après Alexandre le Grand, que l’on a découverts à Warkah, l’ancienne Ourouk. L’image de cet arbre de vie était chez les Chaldéo-Assyriens l’objet d’un véritable culte divin. Dans les représentations du monument connu sous le nom de la Pierre noire de Lord Aberdeen, et qui se rapporte aux fondations religieuses du roi Asschour-a’h-iddin, à Babylone, nous voyons ce simulacre placé, à l’état d’idole, dans un naos que surmonte une cidaris ou tiare droite, garnie de plusieurs paires de cornés. On l’avait donc identifié à une divinité. Ici doit trouver place la très ingénieuse observation de M. Georges Rawlinson sur la relation que les œuvres de l’art symbolique assyrien établissent entre cette image et le dieu Asschour. Celui-ci plane au-dessus en sa qualité de dieu céleste, et l’arbre de vie au-dessous de lui semble être l’emblème d’une divinité féminine chthonienne, présidant à la vie et à la fécondité terrestre, qui lui aurait été associée. Nous aurions ainsi, dans cette association du dieu et de l’arbre paradisiaque sur lequel il plane, une expression plastique du couple cosmogonique, rappelant celui d’Ouranos et de Gê chez les Grecs, personnifiant le firmament et le sol terrestre chargé de sa végétation. Nous retrouvons ainsi le prototype de l’ascherah, ce pieu plus ou moins enrichi d’ornements, qui constituait le simulacre consacré de la déesse chthonienne de la fécondité et de la vie dans le culte kanânéen de la Palestine, et dont il est si souvent parlé dans la Bible. Qu’en outre de ce culte il existât dans les traditions cosmogoniques des Chaldéens et des Babyloniens, au sujet de l’arbre de vie et du fruit paradisiaque, un mythe en action se rapprochant étroitement dans sa forme du récit biblique sur la tentation, c’est ce que paraît établir d’une façon positive, en l’absence de textes écrits, la représentation d’un cylindre de pierre dure conservé au Musée Britannique. Nous y voyons, en effet, un homme et une femme, le premier portant sur sa tète la sorte de turban qui était propre aux Babyloniens, assis face à face aux deux côtés d’un arbre aux rameaux étendus horizontalement, d’où pendent deux gros fruits, chacun devant l’un des personnages, lesquels étendent la main pour les cueillir. Derrière la femme se dresse un serpent. Cette représentation peut servir d’illustration directe à la narration de la Genèse et ne se prête à aucune autre explication. M. Renan n’hésite pas à retrouver un vestige de la même tradition chez les Phéniciens, dans les fragments du livre de Sanchoniathon, traduit en grec par Philon de Biblos. En effet, il y est dit, à propos du premier couple humain et de Æon, qui semble la traduction de ‘Havah et en tient la place dans le couple, que ce personnage inventa de se nourrir des fruits de l’arbre. Le savant académicien croit même trouver ici l’écho de quelque type de représentation figurée phénicienne, qui aura retracé une scène pareille à celle que raconte la Genèse, pareille à celle que l’on voit sur le cylindre babylonien. Il est certain qu’à l’époque du grand afflux des traditions orientales dans le monde classique, on voit apparaître une représentation de ce genre sur plusieurs sarcophages romains, où elle indique positivement l’introduction d’une légende analogue au récit de la Genèse, et liée au mythe de la formation de l’homme par Prométhée. Un fameux sarcophage du Musée du Capitole montre auprès du Titan, fils de Iapétos, qui accomplit son œuvre de modeleur, le couple d’un homme et d’une femme dans la nudité des premiers jours, debout au pied d’un arbre dont l’homme fait le geste de cueillir le fruit. La présence, à côté de Prométhée, d’une Parque tirant l’horoscope de l’homme que le Titan est en train de formel", est de nature à faire soupçonner dans les sujets figurés par le sculpteur une influence des doctrines de ces astrologues chaldéens, qui s’étaient répandus dans le monde gréco-romain dans les derniers siècles avant l’ère chrétienne et avaient acquis en particulier un grand crédit à Rome. Cependant, la date des monuments que nous venons de signaler rend possible de considérer la donnée du premier couple humain, auprès de l’arbre paradisiaque dont il va manger le fruit, comme y provenant directement de l’Ancien Testament lui-même, aussi bien que des mythes cosmogoniques de la Chaldée ou de la Phénicie. Mais l’existence de cette tradition dans le cycle des légendes indigènes du peuple de Kena’an ne me semble plus contestable en présence d’un curieux vase peint de travail phénicien, du VIIe ou du VIe siècle avant Jésus-Christ, découvert par M. le général de Cesnola dans une des plus anciennes sépultures d’Idalion, dans l’île de Cypre. Nous y voyons, en effet, un arbre feuillu, du bas des rameaux du quel pendent, de chaque côté, deux grosses grappes de fruits ; un grand serpent s’avance par ondulations vers cet arbre et se dresse pour saisir un des fruits avec sa gueule. Maintenant on est en droit de douter qu’en Chaldée, et à plus forte raison en Phénicie, la tradition parallèle au récit biblique de la déchéance ait revêtu une signification aussi exclusivement spirituelle que dans la Genèse, qu’elle y ait contenu la même leçon morale, qui se retrouve aussi dans la narration des livres du zoroastrisme. L’esprit de panthéisme grossièrement matérialiste de la religion de ces contrées y mettait un obstacle invincible. Pourtant il est à remarquer que chez les Chaldéens et les Assyriens leurs disciples, au moins à partir d’une certaine époque, la notion de la nature du péché et de la nécessité de la pénitence se retrouve d’une manière plus précise que chez la plupart des autres peuples antiques ; et par suite il est difficile de croire que le sacerdoce de la Chaldée, dans ses profondes spéculations de philosophie religieuse, n’ait pas cherché une solution du problème de l’origine du mal et du péché. Sous la réserve de cette dernière remarque, il est vraisemblable que, dans son esprit, la légende chaldéenne et phénicienne sur le fruit de l’arbre paradisiaque devait se rapprocher beaucoup du cycle des vieux mythes communs à toutes les branches de la race aryenne, à l’étude desquels M. Adalbert Kuhn a consacré un livre du plus grand intérêt[10]. Ce sont ceux qui ont trait à l’invention du feu et au breuvage de vie ; on les trouve à leur état le plus ancien dans les Védas, et ils ont passé, plus ou moins modifiés par le cours du temps, chez les Grecs, les Germains et les Slaves, comme chez les Iraniens et les Indiens. La donnée fondamentale de ces mythes, qui ne se montrent complets que sous leurs plus vieilles formes, représente l’univers comme un arbre immense dont les racines embrassent la terre et dont les branches forment la voûte du ciel. Le fruit de cet arbre est le feu, indispensable a l’existence de l’homme et symbole matériel de l’intelligence ; ses feuilles distillent le breuvage de vie. Les dieux se sont réservé la possession du feu, qui descend quelquefois sur la terre dans la foudre, mais que les hommes ne doivent pas produire eux-mêmes. Celui qui, comme le Prométhée des Grecs, découvre le procédé qui permet d’allumer artificiellement la flamme et le communique aux autres hommes est un impie, qui a dérobé à l’arbre sacré le fruit défendu ; il est maudit, et le courroux des dieux le poursuit, lui et sa race. L’analogie de forme entre ces mythes et le récit de la Bible est saisissante. C’est bien la même tradition, mais prise dans un tout autre sens, symbolisant une invention de l’ordre matériel au lieu de s’appliquer au fait fondamental de l’ordre moral, défigurée de plus par cette monstrueuse conception, trop fréquente dans le paganisme, qui se représente la divinité comme une puissance redoutable et ennemie, jalouse du bonheur et du progrès des hommes. L’esprit d’erreur avait altéré chez les Gentils ce mystérieux souvenir symbolique de l’événement qui décida du sort de l’humanité. L’auteur inspiré de la Genèse le reprit sous la forme même qu’il avait revêtue avec un sens matériel ; mais il lui rendit sa véritable signification, et il en fit ressortir l’enseignement solennel. Quelques remarques sont encore nécessaires sur la forme animale que revêt le tentateur dans le récit biblique, sur ce serpent qui jouait un rôle analogue, les monuments figurés viennent de nous le montrer, dans les légendes de la Chaldée et de la Phénicie. Le serpent, ou, pour parler plus exactement, les diverses espèces de serpent tiennent une place très considérable dans la symbolique religieuse des peuples de l’antiquité. Ces animaux y sont employés avec les significations les plus opposées, et il serait contraire à tout esprit de critique de grouper ensemble et confusément, comme l’ont fait quelques érudits d’autrefois, les notions si contradictoires qui s’attachent ainsi aux différents serpents dans les anciens mythes, de manière à en former un vaste système ophiolâtrique, rattaché à une seule source et mis en rapport avec la narration de la Genèse. Mais à côté de serpents divins d’un caractère essentiellement favorable et protecteur, fatidiques ou mis en rapport avec les dieux de la santé, de la vie et de la guérison, nous voyons dans toutes les mythologies un serpent gigantesque personnifier la puissance nocturne, hostile, le mauvais principe, les ténèbres matérielles et le mal moral. Chez les Égyptiens, c’est le serpent Apap, qui lutte contre le Soleil et que Horus perce de son arme. On nous dit formellement que c’est à la mythologie phénicienne que Phérécyde de Syros emprunta son récit sur le Titan Ophion, le vieux serpent, précipité avec ses compagnons dans le Tartare par le dieu Cronos (El), qui triomphe de lui à l’origine des choses, récit dont l’analogie est frappante avec l’histoire de la défaite du serpent antique, qui est le calomniateur et Satan, rejeté et enfermé dans l’abîme, laquelle ne figure pas dans l’Ancien Testament, mais existait dans les traditions orales des Hébreux et a trouvé place dans les chapitres XII et XX de l’Apocalypse de saint Jean. Le mazdéisme est la seule religion dans la symbolique de laquelle le serpent ne soit jamais pris qu’en mauvais part, car dans celle de la Bible elle-même il se présente quelquefois avec une signification favorable, par exemple dans l’histoire du Serpent d’airain. C’est que, dans la conception du dualisme zoorastrien, l’animal lui-même appartenait à la création impure et funeste du mauvais principe. Aussi est-ce sous la forme d’un grand serpent qu’Angrômainyous, après avoir tenté de corrompre le ciel, a sauté sur la terre ; c est sous cette forme que le combat Mithra, le dieu du ciel pur ; c’est sous cette forme enfin qu’il sera un jour vaincu, enchaîné pendant trois mille ans, et à la fin du monde brûlé dans les métaux fondus. Dans ces récits du zoroastrisme, Angrômainyous, sous la forme du serpent, est l’emblème du mal, la personnification de l’esprit méchant, aussi nettement que l’est le serpent de la Genèse, et cela dans un sens presque aussi complètement spirituel. Au contraire, dans les Védas, le même mythe de la lutte contre le serpent se présente à nous avec un caractère purement naturaliste, peignant de la façon la plus transparente un phénomène de l’atmosphère. La donnée qui revient le plus fréquemment clans les vieux hymnes des Aryas de l’Inde à leur époque primitive, est celle du combat d’Indra, le dieu du ciel lumineux et de l’azur, contre Ahi, le serpent, ou Vritra, personnifications du nuage orageux qui s’allonge en rampant dans les airs. Indra terrasse Ahi, le frappe de sa foudre, et en le déchirant donne un libre cours aux eaux fécondantes qu’il retenait enfermées dans ses flancs. Jamais dans les Védas le mythe ne s’élève au-dessus de cette réalité purement physique, et ne passe de la représentation de la lutte des éléments de l’atmosphère à celle de la lutte morale du bien et du mal, dont il est devenu l’expression clans le mazdéisme. Ma foi de chrétien n’éprouve, du reste, aucun embarras à admettre qu’ici le rédacteur inspiré de la Genèse a employé, pour raconter la chute du premier couple humain, une narration qui, chez les peuples voisins, avait pris un caractère entièrement mythique, et que la forme du serpent qu’y revêt le tentateur a pu avoir pour point de départ, un symbole essentiellement naturaliste. Rien n’oblige à prendre au pied de la lettre le récit du chapitre III de la Genèse. On est en droit, sans sortir de l’orthodoxie, de le considérer comme une figure destinée à rendre sensible un fait de l’ordre purement moral. Ce n’est donc pas la forme du récit qui importe ici ; c’est le dogme qu’elle exprime, et ce dogme de la déchéance de la race des hommes, par le mauvais usage que ses premiers auteurs ont fait de leur libre arbitre, est une vérité éternelle qui nulle part ailleurs n’éclate avec la même netteté. Elle fournit la seule solution du redoutable problème qui revient toujours se dresser devant l’esprit de l’homme, et qu’aucune philosophie religieuse n’est parvenue à résoudre en dehors de la révélation. § 3. — LES GÉNÉRATIONS ANTÉDILUVIENNES. Un remarquable rapport entre les traditions clés peuples les plus divers se manifeste ici et ne permet pas de clouter de l’antique communauté des récits sur les premiers jours de l’humanité chez toutes les grandes races civilisées de l’ancien monde. Les patriarches antédiluviens, de Scheth à Noa’h, sont dix dans le récit de la Genèse, et une persistance bien digne de la plus sérieuse attention fait reproduire ce chiffre de dix dans les légendes d’un très grand nombre de nations, pour leurs ancêtres primitifs encore enveloppés clans le brouillard des fables. A quelque époque qu’elles fassent remonter ces ancêtres, avant ou après le déluge, que le côté mythique ou historique prédomine dans leur physionomie, ils offrent ce nombre sacramentel de dix. Les noms des dix rois antédiluviens qu’admettait la tradition chaldéenne nous ont été transmis dans les fragments de Bérose, malheureusement sous une forme très altérée par les copistes successifs du texte. On en trouvera le tableau dans la page en regard de celle-ci, parallèlement à celui des patriarches correspondants de la Genèse. Une tradition assyrienne recueillie par Abydène plaçait à l’origine de la nation, antérieurement à la fondation de Ninive, dix générations de héros, éponymes d’autant de cités successivement érigées. Le même Abydène, l’un des polygraphes grecs qui pendant la période des successeurs d’Alexandre s’efforcèrent sans succès de vulgariser auprès de leurs compatriotes les traditions et l’histoire des peuples de l’Asie, paraît avoir déjà enregistré la donnée arménienne d’une succession de dix héros ancêtres précédant Aram, celui qui constitua définitivement la nation et lui donna son nom, donnée qui fut ensuite adoptée par Mar-Abas Katina et les écrivains de l’école d’Edesse, et d’après eux par Moïse de Khorène, l’historien national de l’Arménie. Les livres sacrés des Iraniens, attribués à Zarathoustra (Zoroastre), comptent au début de l’humanité neuf héros d’un caractère absolument, mythique, succédant à Gayômaretan, l’homme type, héros’autour desquels se groupent toutes les traditions sur les premiers âges, jusqu’au moment où elles prennent un caractère plus humain et presque semi-historique. Ainsi se présentent les Paradhâtas de l’antique tradition, devenus les dix rois Peschdâdiens de la légende iranienne postérieure, mise en épopée par Firdousi, les premiers monarques terrestres les hommes de l’ancienne loi, qui se nourrissaient du pur breuvage du haoma et qui gardaient la sainteté. Dans les légendes cosmogoniques des Indiens, nous rencontrons les neuf Brahmâdikas, qui sont dix avec Brahmâ, leur auteur, et qu’on appelle les dix Pîtris ou pères. Les Chinois comptent dix empereurs participant à la nature divine entre Fou-hi et le souverain qui inaugure les temps historiques, Hoang-ti, et l’avènement de celui-ci marque la dixième des périodes, ki, qui se sont succédées depuis la création de l’homme et le commencement de la souveraineté humaine sur la terre, Jin-hoang. Enfin, pour ne pas multiplier les exemples outre mesure, les Germains et les Scandinaves croyaient aux dix ancêtres de Wodan ou Odin, comme les Arabes aux dix rois mythiques de ‘Ad, le peuple primordial de leur péninsule, dont le nom signifie antique. En Égypte, les premiers temps de l’existence de l’humanité sont marqués par les règnes des dieux sur la terre. Les fragments de Manéthon, relatifs à ces premières époques, nous sont parvenus dans un tel état d’altération qu’il est difficile d’établir d’une manière certaine combien cet auteur admettait au juste de règnes divins. Mais les lambeaux parvenus jusqu’à nous du célèbre Papyrus historique de Turin, qui contenait une liste des dynasties égyptiennes tracée en écriture hiératique, semblent indiquer formellement que le rédacteur de ce canon portait à dix les dieux qui au commencement avaient gouverné les hommes. Cette répétition constante, chez tant de peuples divers, du même nombre dix est on ne saurait plus frappante. Et cela d’autant plus qu’il s’agit incontestablement d’un nombre rond et systématiquement choisi. Nous en avons la preuve quand nous voyons dans la Genèse, au chapitre XI, ce même chiffre de dix se répéter pour les générations postdiluviennes de Schem à Abraham, ou plutôt, car la donnée de la version des Septante, qui compte ici un nom de plus que l’hébreu, paraît mieux représenter le plus ancien texte, pour les générations de Schem à Tera’h, père de trois fils, chefs de races[11] de la même façon que Noa’h, le dixième patriarche à partir d’Adam. Et il paraît que dans le livre où Bérose exposait les traditions chaldéennes, les dix premières générations après le déluge formaient un cycle, une époque sans doute encore entièrement mythique, faisant pendant aux dix règnes antédiluviens. Cependant on chercherait vainement ta rattacher le choix de ce nombre dix à quelqu’une des spéculations raffinées des philosophies religieuses du paganisme sur la valeur mystérieuse des nombres. Ce n’est pas dans ce stage postérieur, et déjà bien avancé, du développement humain que la tradition des dix patriarches antédiluviens prend sa racine. Elle nous reporte bien plus haut, à une époque réellement primitive, où les ancêtres de toutes les races chez lesquelles nous l’avons retrouvée vivaient encore rapprochés les uns des autres, assez en contact pour expliquer cette communauté de traditions, et ne s’étaient pas éloignés en se dispersant. Cette époque, dans la marche progressive des connaissances, est celle où dix était le nombre le plus haut auquel on sût atteindre, par suite le nombre indéterminé, celui qui servait pour dire « beaucoup, » pour exprimer la notion générale de pluralité. C’est le stage où de la numération quinaire primitive, donnée par les doigts de la main, on passa à la numération décimale, basée sur le calcul digital des deux mains, laquelle est demeurée, pour presque tous les peuples, le point de départ des computs plus complets et plus perfectionnés qui arrivent à ne plus connaître de limite à la multiplication infinie ni à la division infinie. Or, il importe de remarquer que c’est précisément jusqu’à dix qu’existent les affinités incontestables des noms de nombres égyptiens et sémitiques, et qu’également, s’il y a une parenté entre les mêmes noms dans les langages des Aryens et dans ceux des Sémites, elle est aussi restreinte dans cette limite. On voit à quelle énorme antiquité dans le passé primitif de l’humanité nous replace la tradition biblique sur les patriarches antérieurs au déluge, comparée aux traditions parallèles qui dérivent incontestablement de la même source. Maintenant la généalogie des Qaïnites nous offre sept noms depuis Adam jusqu’à Lemech, père de trois chefs de races comme Noa’h, et nous avons constaté plus haut que la généalogie de la descendance d’Adam par Scheth présente des traces manifestes d’un travail systématique, qui, de sept noms parallèles à ceux de la lignée qaïnite, l’a portée à dix[12]. De même, les Paradhâtas de la tradition iranienne sont sept à partir de Yima, qui était originairement le premier homme ; ils sont devenus dix seulement quand avant Yima l’on a placé Gayômarétan, par un doublement analogue à celui que la généalogie biblique nous offre avec Adam et Enosch. En Égypte, si le système du rédacteur du Papyrus de Turin a admis dix rois divins, ceux qui étaient le plus généralement adoptés dans les grands centrés sacerdotaux comme Thèbes et Memphis, en comptaient sept. Dans la tradition chaldéenne, la donnée de six révélations divines successives avant le déluge mérite une sérieuse attention, car ce nombre et la manière dont elles se produisent est de nature à faire fortement soupçonner que primitivement on devait en compter une par règne ou par génération jusqu’au patriarche du vivant duquel se produisait le cataclysme. Tous ces faits sont autant d’indices de ce qu’a déjà entrevu Ewald, que l’on a varié entre les chiffres sept et dix, comme nombre rond des ancêtres antédiluviens. Les Indiens aussi substituent quelquefois dans ce cas le nombre sept au nombre dix, et c’est ainsi que nous les voyons admettre à l’origine sept Maharschis ou grands saints ancêtres, et sept Pradjàpatis, maîtres des créatures ou pères primordiaux[13]. De ces deux nombres entre lesquels la tradition flottait, l’influence des Chakléo-Babyloniens a puissamment contribué à faire définitivement prédominer celui de dix. Ils s’y étaient, en effet, attachés d’une façon toute particulière en vertu d’un système calendaire dont l’étude ne saurait trouver ici sa place, mais sur lequel nous reviendrons dans le livre de cette histoire qui traitera spécialement, de la Chaldée et de l’Assyrie. Nous devons aussi, pour éviter des développements exagérés, laisser de côté ce qui a trait aux rapprochements que pourrait provoquer, avec les traditions d’autres peuples de l’antiquité, le récit biblique qui lie la construction de la première ville au premier meurtre, perpétré par un frère sur son frère. Car c’est encore une notion qui se retrouve presque partout, une de ces notions primitives, antérieures à la dispersion des grandes races civilisées et qu’elles ont conservées après leur séparation, que la tradition qui rattache une fondation de ville à un fratricide. Et on pourrait en suivre la trace depuis Qaïn bâtissant la première ville, ‘Hanoch, après avoir assassiné Habel, jusqu’à Romulus fondant Rome dans le sang de son fils Remus. On le verrait même s’élargir et donner naissance à une superstition d’un caractère plus général, qui à sa place dans les traditions populaires de toutes les nations et que le paganisme a trop souvent traduite en une pratique d’une révoltante barbarie, celle que l’établissement d’une ville doit être accompagnée d’une immolation humaine, que ses fondations réclament d’être arrosées d’un sang pur. Une autre croyance universellement admise de l’antiquité était celle que les hommes des premiers âges dépassaient énormément par leur taille ceux qui leur ont succédé, de même que leur vie était infiniment plus longue. Chez les Grecs, la notion de la taille gigantesque des premiers hommes était intimement liée à celle de leur atochthonie. L’Arcadieu était quelquefois appelée Gigantis et la Lycie Gigantia, d’après le caractère attribué à leurs habitants primitifs. Des traditions sur une population de géants, nés de la terre, s’attachent à la partie méridionale de l’île de Rhodes et à Cos. Cyzique montrait sur son territoire une digue qu’elle prétendait construite par ces mêmes géants. Cette idée que les héros des origines étaient d’une taille gigantesque devient un lieu commun dans la poésie classique, et elle paraissait confirmée parles découvertes de débris de grands mammifères fossiles, que l’on prenait pour les ossements de héros. Bérose, d’après la tradition chaldéo-babylonienne, disait que les premiers hommes avaient été d’une stature et d’une force prodigieuses, et les représentait comme demeurant encore tels dans les premières générations après le déluge. C’est dans les récits de l’historien de la Chaldée et aussi dans les traditions nationales de l’Arménie, que Mar Abas Katina puisa sa narration sur les antiques géants de cette contrée et de la Mésopotamie, leurs violences et la guerre des deux plus terribles d’entre eux, Bel le Babylonien et Haïgh l’Arménien. Toutes les légendes arabes sont unanimes à représenter comme des géants les peuples primitifs et, antésémitiques de la Péninsule arabique, les fils de ‘Amliq et de ‘Ad, nations éteintes dès une très haute antiquité, dont l’origine se perd dans la nuit des temps et qui ont laissé derrière elles un souvenir d’impiété et de violence. On n’a donc pas lieu d’être surpris de trouver dans les récits antédiluviens de la Genèse (VI, 4) cette croyance populaire, dont la généralité atteste l’origine très ancienne, et que l’on peut hardiment ranger au nombre de celles qui s’étaient formées au temps où les grands peuples civilisés de la haute antiquité, encore voisins de leur berceau primitif, demeuraient dans un contact assez étroit pour avoir des traditions communes. Il est aujourd’hui scientifiquement prouvé qu’elle n’a pas de fondement réel, qu’elle est un simple produit de l’imagination, et ce ne sont pas les fables populaires ou les faits tératologiques individuels amassés confusément et sans critique par Sennert, par Dom Calmet et par quelques autres, qui peuvent aller à l’encontre de ce fait positif. Aussi haut que l’on remonte dans les vestiges de l’humanité, jusqu’aux races qui vivaient dans la période géologique quaternaire à côté des grands mammifères d’espèces éteintes, on constate que la taille moyenne de notre espèce ne s’est pas modifiée avec le cours des siècles et qu’elle n’a jamais excédé ses limites actuelles. Mais c’est ici le cas de se souvenir des paroles si sages et si profondes, que nous citions un peu plus haut, d’un des premiers théologiens catholiques de l’Allemagne contemporaine, proclamant que la lumière surnaturelle donnée, par Dieu aux écrivains bibliques n’avait pour but, comme la révélation en général, que la manifestation des vérités religieuses, non la communication d’une science profane, et que sur ce terrain de la science les écrivains inspirés ne se sont point élevés au-dessus de leurs contemporains, que même ils ont partagé les erreurs de leur époque et de leur nation. A la tradition des géants primordiaux se lie toujours une idée de violence, d’abus de la force et de révolte contre le ciel. C’était, a dit M. Maury[14], une ancienne tradition que des hommes forts et puissants, dépeints par l’imagination populaire comme des géants, avaient attiré sur eux, par leur impiété, leur orgueil et leur arrogance, le courroux céleste. Les prétendus géants n’étaient probablement que les premiers humains qui abusèrent de la supériorité de leurs lumières et de leur force pour opprimer leurs semblables. Les connaissances dont ils étaient dépositaires parurent à des peuplades ignorantes et crédules une révélation qu’ils tenaient des dieux, des secrets qu’ils avaient ravis au ciel. Soit que ces géants se donnassent pour issus des divinités, soit que la superstition des peuples enfants les crût fils de celles-ci, ils passèrent pour être nés du commerce des immortels avec les femmes de la terre. Les prêtres, dépositaires exclusifs et jaloux des connaissances, enseignèrent par la suite que ces géants impies avaient été foudroyés par les dieux dont ils voulaient égaler la puissance. Sans doute que quelques grandes catastrophes qui mirent fin à la domination de ces tyrans, peut-être la révolution qui livra aux mains des prêtres le pouvoir qui appartenait auparavant aux chefs militaires, furent présentés comme des actes de la colère divine ; quoi qu’il en soit, cette légende se répandit de bonne heure en Chaldée, et de là en Grèce. Il y a plus d’une réserve à faire sur cette explication,qui suppose la généralité d’un fait spécial, les luttes des Kchatryas et des Brahmanes dans l’Inde[15] et le triomphe d’une caste sacerdotale puissamment organisée sur les guerriers, qu’elle finit par plier à sa domination. Les choses ne se sont certainement point passées de même chez la plupart des nations, et l’on a dû renoncer aujourd’hui au mirage d’une puissance mystérieuse et primitive des prêtres, dépositaires de toutes les connaissances, qui avait tant de crédit au temps où les idées systématiques de Creuzer régnaient dans la science des religions. Mais M. Maury à eu parfaitement raison de né pas voir uniquement un mythe physique dans cette tradition si générale des géants primitifs, de leurs violences et de leurs impiétés. Il y a certainement là une part de souvenirs historiques, comme un écho et une représentation expressive du déchaînement de corruption et de brutalité sans frein, que la tradition biblique nous fait voir chez les dernières générations antédiluviennes, oublieuses de Dieu, au temps où les géants étaient sur la terre, état de choses hideux qui exista dans la réalité, puisque la conscience des hommes, en conservant la mémoire, fut unanime à en voir le châtiment divin dans le cataclysme qui frappa les populations chez lesquelles il s’était développé. Pour tous les peuples où existe la tradition du déluge, cette catastrophe terrible est l’effet de la colère céleste provoquée par les crimes des premiers hommes, lesquels, nous venons de le dire, sont généralement regardés comme des géants. Cette impiété des antédiluviens envers les dieux, aussi bien que la violence de leurs mœurs, sont en particulier très nettement indiqués dans la narration chaldéenne du cataclysme, parvenue jusqu’à nous dans un texte original, et qui offre une si étroite affinité avec celle de la Bible. La même notion de violence et d’impiété s’attache aussi aux générations gigantesques qui se produisent encore dans les premiers temps après le déluge. Bérose disait que les premiers hommes (d’après le cataclysme), enorgueillis outre mesure par leur force et leur taille gigantesque, en vinrent à mépriser les dieux et à se croire supérieurs à eux, et c’est à cette, violente impiété qu’il rattachait la tradition de la Tour de Babel et de la confusion des langues. Mar Abas Katina, qui combina dans son livre les récits populaires des Arméniens sur leurs origines et les données historiques delà littérature gréco-babylonienne, racontait à son tour : Quand la race des hommes se fut répandue sur toute la surface de la terre, des géants d’une force extraordinaire vivaient au milieu d’elle. Ceux-ci, toujours agités de fureur, tiraient le glaive chacun contre son voisin et luttaient continuellement pour s’emparer de la domination. La tradition, non seulement de l’existence des géants primitifs, mais aussi de leur violence désordonnée, de leur rébellion contre le ciel et de leur châtiment, est une de celles qui sont communes aux Aryas comme aux Sémites et aux Kouschites. Mais dans l’exubérance de végétation mythologique à laquelle s’est laissé aller, par une pente naturelle, le génie des nations aryennes, cette tradition d’histoire primitive se combine et se confond d’une manière souvent inextricable avec les mythes purement naturalistes qui dépeignent les luttes dé l’organisation de l’univers, entre les dieux célestes et les personnifications des forces telluriques. Aussi serait-il imprudent de suivre l’historien juif JOsèphe, et un certain nombre d’interprètes modernes, en établissant un rapprochement entre les indications de la Genèse sur les géants antédiluviens et sur la violence dont toute la terre était remplie avant le déluge, d’une part, et la Gigantomachie des Hellènes, d’autre part. Ce dernier mythe, en effet, est exclusivement naturaliste ; le génie plastique de la Grèce a beau étendre aux personnages des Géants, nés de la Terre, son anthropomorphisme habituel[16], ils demeurent absolument étrangers à l’humanité, ne cessent pas d’être uniquement des représentants de forces de la nature, et aucun mythologue sérieux n’a jamais eu l’idée de rapporter la Gigantomachie au cycle des traditions sur les origines de l’histoire humaine. Il en est de même de la lutte des Asouras contre les Dêvas ou dieux célestes, mythe qui est dans l’Inde le pendant de celui de la Gigantomachie chez les Hellènes ; la lutte y est également toute physique ; c’est au sein de la nature qu’elle se produit, et si l’on devait y chercher une certaine part de souvenir d’un événement historique de l’antiquité primitive, ce ne pourrait être que le triomphe des dieux célestes et lumineux des Aryas, sur les dieux sombres et chthoniens d’une population antérieure, lesquels, vaincus, passent à l’état de démons. La même idée de la victoire de nouveaux dieux qui supplantent les anciens se combine aussi manifestement avec le mythe cosmogonique fondamental dans les récits poétiques de la Titanomachie, bien distincte de la Gigantomachie, c’est-à-dire de la lutte que les dieux Olympiens soutiennent contre les Titans, auxiliaires de Cronos, et à la suite de laquelle ce dernier est détrôné, en même temps que les fils d’Ouranos et de Gaia sont précipités dans le Tartare. La localisation et la forme épique que ce récit revêt chez Hésiode ont été influencés par le souvenir d’une grande convulsion de l’écorce terrestre, produite par l’effort des feux souterrains, qui eut les contrées grecques pour théâtre et déjà les hommes pour témoins, sans doute celle que les géologues appellent le Soulèvement du Ténare, la dernière des crises plutoniennes qui ont bouleversé l’ancien monde et qui fit sentir ses effets du centre de la France jusqu’aux côtes de la Syrie. L’Italie, en effet, en fut brisée dans toute sa longueur, la Toscane éclata en volcans, les Champs Phlégréens s’enflammèrent, le Stromboli et l’Etna s’ouvrirent dans une première éruption. En Grèce, le Taygète se souleva au centre du Péloponnèse, de nouvelles îles, Mélos, Cimolos, Siphnos, Thermia, Délos, Théra, sortirent des flots bouillonnants de la mer Egée. Les hommes qui assistèrent à cette effroyable convulsion de la nature se crurent naturellement pris au milieu d’un combat des Titans issus de la mère chthonienne contre les puissances célestes, assistées d’autres forces terrestres en conflit avec les Titans, les Hécatonchires, et leur imagination se représenta ces adversaires tout puissants, les uns postés sur le sommet de l’Othrys, les autres sur le sommet de l’Olympe, cherchant réciproquement à s’écraser en se lançant des roches enflammées. Mais dans le mythe de la Titanomachie, à la différence de la Gigantomachie, il y a aussi autre chose qu’une lutte des forces de la nature. Il faut également tenir compte de la donnée que les hommes sont issus du sang des Titans. La conception des fils d’Ouranos et de Gaia, précédant les dieux Olympiens, telle que nous la trouvons exprimée avec son complet développement dans la Théogonie d’Hésiode, a ceci de particulier, qu’à côté des personnifications des forces de la nature dans les quatre éléments, forces envisagées comme encore violentes, exubérantes et mal assujetties à un ordre régulier, nous y rencontrons les prototypes, non moins exagérés et imparfaitement réglés, comme énergie et comme stature, de l’humanité primitive, véritables représentants des géants des premiers âges, tels que les admettait la tradition chaldéenne. Je veux parler de Iapétos et de ses fils, Atlas, Ménoitios, Prométhée et Epiméthée, ancêtres et types symboliques de la race humaine, qui sont qualifiés de Titans comme leur père. La tradition qui se rapporte à eux est d’autant plus remarquable que la Bible accepte le Titan Iapétos de la légende grecque,en lui conservant son nom d’origine aryenne sous la forme Yapheth, comme un des fils de Noa’h et le père d’une des grandes races humaines, celle des Aryas. C’est spécialement au rameau de ce Iapétos que s’attache l’idée d’antagonisme avec les dieux Olympiens. Ménoitios, que son nom caractérise comme un parallèle du Manou des Indiens, un représentant de l’homme en général, est un contempteur des dieux, que Zeus foudroie et précipite dans le Tartare pour le punir de sa violence et de son impiété. Prométhée, avec son frère Epiméthée, est le protagoniste d’une série de mythes qui correspondent à l’histoire du premier, péché dans la Genèse et qui : attirent sur lui le châtiment de la colère de Zeus. Dans les récits arméniens de Mar Abas Katina et de Moïse de Khorène, Yapedosthô, le correspondant du Iapétos grec et du Yapheth biblique, est un géant, père dé la race de géants à laquelle appartient le héros national Haïgh. Tous ces faits, dont il est impossible de méconnaître l’enchaînement, amènent à cette conclusion que la tradition qui liait une idée de violence, d’impiété, de révolte contre le ciel et de punition divine à la croyance que les premiers hommes avaient été démesurés de taille et de force, a eu sa part, autant que la notion des luttes primordiales des forces physiques, dans la naissance de la conception fondamentale de la Titanomachie, bien que la description épique d’Hésiode en efface complètement le côté humain. Ce côté reste encore bien plus accentué dans une troisième fable de la même famille, que nous offre la tradition grecque, la fable des Aloades. Ici le caractère des antagonistes des dieux est absolument humain, quoique prodigieux ; et Preller a été complètement dans le vrai quand il a rangé ce récit, non dans la classe des mythes naturalistes, mais dans celle des mythes qui ont trait aux origines de l’histoire des hommes. Les Aloades, représentés comme d’une taille gigantesque, sont fils d’Alôeus, le héros de l’aire à battre le blé, et d’Iphimédée, la terre féconde dont les productions donnent la force ; on doit donc reconnaîtra en eux une personnification des premiers agriculteurs, et en même temps, enorgueillis de leur vigueur prodigieuse, de leur puissance et de leur richesse, ils se croient capables de tout, défient les dieux et se préparent à les détrôner[17]. Leur légende porte ainsi une empreinte qui conduit à en rechercher les origines dans le temps où les ancêtres de la race hellénique, vivant encore de la vie pastorale, regardaient avec inquiétude et hostilité les populations déjà fixées au sol, cultivant la terre et habitant des villes ; c’est le même esprit qui fait que dans la Genèse le premier meurtrier, Qaïn, est agriculteur et constructeur de ville, tandis que sa victime, l’innocent Habel, mène l’existence de pasteur. Les Aloades sont, d’ailleurs, des constructeurs et des ingénieurs en même temps que des agriculteurs. Ils ne visent rien moins qu’à changer par leurs travaux la surface terrestre, faisant du continent la mer et de la mer un continent. On raconte même qu’ils ont commencé à élever une tour dont le sommet, dans leur projet, doit atteindre jusqu’au ciel, variante manifeste, et la seule que nous connaissions en Grèce, delà tradition de la Tour de Babel, telle que nous la lisons dans la Genèse et qu’elle existait dans le cycle chaldéo-babylonien des légendes sur les origines. C’est au milieu de ces entreprises insensées d’orgueil qu’ils sont foudroyés par les dieux et précipités dans le Tartare. § 4. — LE DÉLUGE. La tradition universelle par excellence, entre toutes celles qui ont trait à l’histoire de l’humanité primitive, est la tradition du Déluge. Ce serait trop que dé dire qu’on la retrouve chez tous les peuples, mais elle se reproduit dans toutes les grandes races de l’humanité, sauf pourtant une, — il importe de le remarquer, —la race noire, chez laquelle on en a vainement cherché la trace, soit parmi les tribus africaines, soit parmi les populations noires de l’Océanie. Ce silence absolu d’une race sur le souvenir d’un événement aussi capital, au milieu de l’accord dé toutes les autres, est un fait que la science doit soigneusement noter, car il peut en découler des conséquences importantes[18]. Nous allons passer en revue les principales traditions sur le déluge éparses dans les divers rameaux de l’humanité. Leur concordance avec le récit biblique en fera nettement ressortir l’unité première, et nous reconnaîtrons ainsi que cette tradition est bien une de celles qui datent d’avant la dispersion des peuples, qu’elle remonte à l’aurore même du monde civilisé et qu’elle ne peut se rapporter qu’à un fait réel et précis. Mais nous devrons d’abord écarter certains souvenirs légendaires que l’on a rapprochés à tort du déluge biblique et que leurs traits essentiels ne permettent pas d’y assimiler en bonne critique. Ce sont ceux qui se rapportent à quelques phénomènes locaux et d’une date historique relativement assez voisine de nous. Sans doute la tradition du grand cataclysme primitif a pu s’y confondre, amener à en exagérer l’importance ; mais les points caractéristiques du récit admis dans la Genèse ne s’y retrouvent pas, et le fait garde nettement, même sous la forme légendaire qu’il a revêtue, sa physionomie restreinte et spéciale. Commettre la faute de grouper les souvenirs dé cette nature avec ceux qui ont trait au déluge, serait infirmer la valeur des conséquences que Ton est en droit de tirer de l’accord des derniers, au lieu de la fortifier. Tel est le caractère de la grande inondation placée par les livres historiques de la Chine sous le règne de Yao. Elle n’a aucune parenté réelle, ni même aucune ressemblance avec le déluge biblique ; c’est un événement purement local et dont on peut parvenir, dans la limite de l’incertitude que présente encore la chronologie chinoise, quand on remonte au-delà du VIIIe siècle avant l’ère chrétienne, à déterminer la date, bien postérieure au début des temps pleinement historiques en Égypte et à Babylone[19]. Les écrivains chinois, nous montrent alors Yu, ministre et ingénieur, rétablissant le cours des eaux, élevant des digues, creusant des canaux et réglant les impôts de chaque province dans toute la Chine. Un savant sinologue, Edouard Biot, a prouvé, dans un mémoire sur les changements du cours inférieur du Hoang-ho, que c’est aux inondations fréquentes de ce fleuve que fut due la catastrophe ainsi relatée ; la société chinoise primitive, établie sur les bords du fleuve, eut beaucoup à souffrir de ses débordements. Les travaux de Yu ne furent autre chose que le commencement des endiguements nécessaires pour contenir les eaux, lesquels furent continués dans les âges suivants. Une célèbre inscription, gravée sur le rocher d’un des pics des montagnes du Hou-nan, serait, dit-on, un monument contemporain de ces travaux et par suite le plus antique spécimen de l’épigraphie chinoise, si elle était authentique, ce qui demeure encore douteux. Le caractère d’événement local n’est pas moins clair dans la légende de Botchica, telle que la rapportaient les Muyscas, anciens habitants de la province de Cundinamarca dans l’Amérique méridionale, bien que la fable s’y soit mêlée dans une beaucoup plus forte proportion à l’élément historique fondamental. Qu’y voyons-nous, en effet ? L’épouse d’un homme divin ou plutôt d’un dieu nommé Botchica, laquelle s’appelait Huythaca, se livrant à d’abominables sortilèges pour faire sortir de son lit la rivière Funzha ; toute la plaine de Bogota bouleversée par les eaux ; les hommes et les animaux périssant dans cette catastrophe, quelques-uns seulement échappent à la destruction en gagnant les plus hautes montagnes. La tradition ajoute que Botchica brisa les rochers qui fermaient la vallée de Canoas et de Tequendama, pour faciliter l’écoulement des’ eaux ; puis il rassembla les restes dispersés de la nation des Muysicàs, leur enseigna le culte du Soleil et monta au ciel après avoir vécu 500 ans dans le Cundinamarca. Des traditions relatives au grand cataclysme, la plus curieuse sans contredit est celle des Chaldéens. Elle a marqué d’une manière incontestable l’empreinte de son influence sur la tradition de l’Inde, et de toutes les narrations du déluge c’est celle qui se rapproche le plus exactement de la narration de la Genèse. Il est bien évident pour quiconque compare les deux récits, qu’ils ont dû n’en faire qu’un jusqu’au moment où les Téra’hites sortirent d’Our pour gagner la Palestine. Nous possédons du récit chaldéen du Déluge deux versions inégalement développées, mais qui offrent entre elles un remarquable accord. La plus anciennement connue, et aussi la plus abrégée, est celle que Bérose avait tirée des livres sacrés de Babylone et comprise dans l’histoire qu’il écrivait à l’usage des Grecs. Après avoir parlé des neuf premiers rois antédiluviens, le prêtre chaldéen continuait ainsi : Obartès (Oubaratoutou) étant mort, son fils Xisouthros (‘Hasisadra) régna dix-huit sares (64.800 ans). C’est sous lui qu’arriva le grand déluge, dont l’histoire est racontée de la manière suivante dans les documents sacrés. Cronos (Êa) lui apparut dans son sommeil et lui annonça que le 15 du mois de daisios (le mois assyrien de sivan, un peu avant le solstice d’été) tous les hommes périraient par un déluge. Il lui ordonna donc de prendre le commencement, le milieu et-la fin de tout ce qui était consigné par écrit et de l’enfouir dans la ville du Soleil, à Sippara, puis de construire un navire et d’y monter avec sa famille et ses amis les plus chers ; de déposer dans le navire des provisions pour la nourriture et la boisson, et d’y faire entrer les animaux, volatiles et quadrupèdes ; enfin de tout préparer pour la navigation. Et quand Xisouthros demanda de quel côté il devait tourner la marche de son navire, il lui fut répondu « vers les dieux, » et de prier pour qu’il en arrivât du bien aux hommes. Xisouthros obéit et construisit un navire long de cinq stades et large de deux ; il réunit tout ce qui lui avait été prescrit et embarqua sa femme, ses enfants et ses amis intimes. Le déluge étant survenu et bientôt décroissant, Xisouthros lâcha quelques-uns des oiseaux. Ceux-ci n’ayant trouvé ni nourriture, ni lieu pour se poser, revinrent au vaisseau. Quelques jours après Xisouthros leur donna de nouveau la liberté ; mais ils revinrent encore au navire avec les pieds pleins de boue. Enfin, lâchés une troisième fois, les oiseaux ne retournèrent plus. Alors Xisouthros comprit que la terre était découverte ; il fit une ouverture au toit du navire et vit que celui-ci était arrêté sur une montagne. Il descendit donc avec sa femme, sa fille et son pilote, adora la Terre, éleva un autel et y sacrifia aux dieux ; à ce moment il disparut avec ceux qui l’accompagnaient. Cependant ceux qui étaient restés dans le navire, ne voyant pas revenir Xisouthros, descendirent à terre à leur tour et se mirent aie chercher en l’appelant par son nom. Ils ne revirent plus Xisouthros, mais une voix du ciel se fit entendre, leur prescrivant d’être pieux envers les dieux ; qu’en effet il recevait la récompense de sa piété en étant enlevé pour habiter désormais au milieu des dieux, et que sa femme, sa fille et le pilote du navire partageaient un tel honneur. La voix dit en outre à ceux qui restaient qu’ils devaient retourner à Babylone et, conformément aux décrets du destin, déterrer les écrits enfouis à Sippara pour les transmettre aux hommes. Elle ajouta que le pays où ils se trouvaient était l’Arménie. Ceux-ci, après avoir entendu la voix, sacrifièrent aux dieux et revinrent à pied à Babylone. Du vaisseau de Xisoutliros, qui s’était enfin arrêté en Arménie, une partie subsiste encore dans les monts Gordyéens, en Arménie, et les pèlerins en rapportent l’asphalte qu’ils ont raclé sur les débris ; on s’en sert pour repousser l’influence des maléfices. Quant aux compagnons de Xisoutliros, ils vinrent à Babylone, déterrèrent les écrits déposés à Sippara, fondèrent des villes nombreuses, bâtirent des temples et reconstituèrent Babylone[20]. A côté de cette version qui, tout intéressante qu’elle soit, n’est cependant que de seconde main, nous pouvons maintenant placer une rédaction chaldéo-babylonienne originale, celle que le regretté George Smith a déchiffrée le premier sur des tablettes cunéiformes exhumées à Ninive et transportées au Musée Britannique. La narration du déluge y intervient comme épisode dans la onzième tablette ou onzième chant d’une grande épopée héroïque de la ville d’Ourouk dans la Basse-Chaldée, dont nous donnerons l’analyse détaillée dans le livre de cette histoire qui traitera des Chaldéens et des Assyriens. Cette narration y est placée dans la bouche même de ‘Hasisadrà, le patriarche sauvé du déluge et transporté par les dieux dans un lieu reculé, où il jouit d’une éternelle félicité. On a pu en rétablir le récit presque sans lacunes par la comparaison des débris de trois exemplaires du poème, que renfermait la bibliothèque du palais de Ninive. Ces trois copies furent faites au VIIe siècle avant notre ère, par l’ordre du roi d’Assyrie Asschour-bani-abal, d’après un exemplaire très ancien que possédait la bibliothèque sacerdotale de la cité d’Ourouk, fondée par les monarques. du premier Empire de Chaldée. Il est difficile de préciser, la date de l’original ainsi transcrit par les scribes assyriens ; mais il est certain qu’il remontait à l’époque de cet Ancien Empire, dix-sept siècles au moins avant notre ère, et même probablement plus ; il était donc fort antérieur à Moscheh (Moïse) et presque contemporain d’Abraham. Les variantes que les trois copies existantes présentent entre elles prouvent que l’exemplaire type était tracé au moyen de la forme primitive d’écriture désignée sous le nom d’hiératique, caractère qui était déjà devenu difficile à lire au VIIe siècle, puisque les copistes ont varié sur l’interprétation à donner à certains signes et dans d’autres cas ont purement et simplement reproduit les formes de ceux qu’ils ne comprenaient plus. Il résulte enfin de la comparaison des mêmes variantes, que l’exemplaire transcrit par ordre d’Asschour-bani-abal était lui-même la copie d’un manuscrit plus ancien, sur laquelle on avait déjà joint au texte original quelques gloses interlinéaires. Certains des copistes les ont introduites dans le texte ; les autres les ont omises. Je veux te révéler, ô Izdhubar (?), l’histoire de ma conservation — et te dire la décision des dieux. La ville de Schourippak[21], une ville que tu connais, est située sur l’Euphrate ; — elle était antique et en elle [on n’honorait pas] les dieux. — [Moi seul, j’étais] leur serviteur, aux grands dieux. — [Les dieux tinrent conseil sur l’appel d’]Anou. — [Un déluge fut proposé par] Bel — [et approuvé par Nabou, Nergal et] Ninib. Et le dieu [Êa], le seigneur immuable, — répéta leur commandement dans un songe. — J’écoutais l’arrêt du destin qu’il annonçait, et il me dit : — Homme de Schourippak, fils d’Oubaratoutou, — toi, fais un vaisseau et achève-le [vite]. — [Par un déluge] je détruirai la semence et la vie. — Fais (donc) monter dans le vaisseau la semence de tout ce qui a vie. — Le vaisseau que tu construiras, — 600 coudées le montant de sa largeur et de sa hauteur. — [Lance-le] aussi sur l’Océan et couvre-le d’un toit. — Je compris et je dis à Êa, monseigneur : — [Le vaisseau] que tu me commandés de construire ainsi, — [quand] je le ferai —jeunes et vieux [se riront de moi]. — [Êa ouvrit sa bouche et] parla ; — il dit à moi, son serviteur : — [S’ils se rient de toi,] tu leur diras : — [Sera puni] celui qui m’a injurié, — [car la protection des dieux] existe sur moi[22]. — .... comme des cavernes .... — .... j’exercerai mon jugement sur ce qui est en haut et ce qui est en bas .... — .... Ferme le vaisseau .... — .... Au moment venu, que je te ferai connaître, — entre dedans et amène à toi la porte du navire. — A l’intérieur, ton grain, tes meubles, tes provisions, — tes richesses, tes serviteurs mâles et femelles, et les jeunes gens, — le bétail des champs et les animaux sauvages des campagnes que je rassemblerai — et que je t’enverrai, seront gardés derrière ta porte. — ‘Hasisadra ouvrit sa bouche et parla ; — il dit à Éa, son seigneur : — Personne n’a fait [un tel] vaisseau. — Sur la carène je fixerai .... — je verrai .... et le vaisseau .... — le vaisseau que tu me commandes de construire [ainsi,] — qui dans .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[23] Au cinquième jour [ses deux flancs[24]] étaient élevés. — Dans sa couverture quatorze en tout étaient ses fermes, — quatorze en tout on en comptait en dessus. — Je plaçai son toit et je le couvris. — Je naviguai dedans au sixième (jour) ; je divisai ses étages au septième ; — je divisai les compartiments intérieurs au huitième. — Je bouchai les fentes par où l’eau entrait dedans ; — je visitai les fissures et j’ajoutai ce qui manquait. — Je versai sur l’extérieur trois fois 3600 (mesures) de bitume, — et trois fois 3600 (mesures) de bitume à l’intérieur. — Trois fois 3600 hommes porte-faix apportèrent sur leurs têtes les caisses (de provisions). — Je gardai 3600 caisses pour la nourriture de ma famille — et les mariniers se partagèrent deux fois 3600 caisses. — Pour [l’approvisionnement] je fis tuer des bœufs ; — j’instituai [des distributions] pour chaque jour. — En [prévision des besoins de] boissons, des tonneaux et du vin — [je rassemblai en quantité] comme les eaux d’un fleuve et — [des provisions] en quantité pareille à la poussière de la terre ; — [à les arranger dans] les caisses je mis la main. — .... du soleil .... le vaisseau était achevé. — .... fort, et — je fis porter en haut et en bas les apparaux du navire. — [Ce chargement] en remplit les deux tiers. Tout ce que je possédais, je le réunis ; tout ce que je possédais d’argent, je le réunis ; — tout ce que je possédais d’or, je le réunis ; — tout ce que je possédais de semences de vie de toute nature, je le réunis. — Je fis tout monter dans le vaisseau ; mes serviteurs mâles et femelles, — le bétail des champs, les animaux sauvages des campagnes et les fils du peuple, je les fis tous monter. Schamasch (le Soleil) fit le moment déterminé, et — il l’annonça en ces termes : Au soir je ferai pleuvoir abondamment du ciel ; — entre dans le vaisseau et ferme ta porte. — Le moment fixé était arrivé, — qu’il annonçait en ces termes : Au soir je ferai pleuvoir abondamment du ciel. — Quand j’arrivai au soir de ce jour, — du jour où je devais me tenir sur mes gardes, j’eus peur ; — j’entrai dans le vaisseau et je fermai ma porte. — En fermant le vaisseau, à Bouzour-schadi-rabi, le pilote, — je confiai (cette) demeure avec tout ce qu’elle comportait. Mou-scheri-ina-namari[25] — s’éleva des fondements du ciel en un nuage noir ; — Raman[26] tonnait au milieu de ce nuage, — et Nabou et Scharrou marchaient devant ; — ils marchaient dévastant la montagne et la plaine ; — Nergal[27] le puissant traîna (après lui) les châtiments ; — Ninib[28] s’avança en renversant devant lui ; — les Archanges de l’abîme apportèrent la destruction, — dans leurs épouvantements ils agitèrent la terre. — L’inondation de Raman se gonfla jusqu’au ciel, — et [la terre,] devenue sans éclat, fut changée en désert. Ils brisèrent les .... de la surface de la terre comme .... ; — [ils détruisirent] les êtres vivants de la surface de la terre. — Le terrible [déluge] sur les hommes se gonfla jusqu’au [ciel.] — Le frère ne vit plus son frère ; les hommes ne se reconnurent plus. Dans le ciel — les dieux prirent peur de la trombe et — cherchèrent un refuge ; ils montèrent jusqu’au ciel d’Anou[29]. — Les dieux étaient étendus immobiles, serrés les uns contre les autres, comme des chiens. — Ischtar parla comme un petit enfant, — la grande déesse prononça son discours : — Voici que l’humanité est retournée en limon, et — c’est le malheur que j’ai annoncé en présence des dieux. — Tel que j’ai annoncé le malheur en présence des dieux, — pour le mal j’ai annoncé le .... terrible des hommes qui sont à moi. — Je suis la mère qui a enfanté les hommes, et — comme la race des poissons les voilà qui remplissent la mer ; et — les dieux, à cause de (ce que font) les Archanges de l’abîme, sont pleurant avec moi. — Les dieux sur leurs sièges étaient assis en larmes, — et ils tenaient leurs lèvres fermées, [méditant] les choses futures. Six jours et autant de nuits — se passèrent ; le vent, la trombe et la pluie diluvienne étaient dans toute leur force. — A l’approche du septième jour, la pluie diluvienne s’affaiblit, la trombe terrible — qui avait assailli à la façon d’un tremblement de terre — se calma. La mer tendit à se dessécher, et le vent et la trombe prirent fin. — Je regardai la mer en observant attentivement. — Et toute l’humanité était retournée en limon ; — comme des algues les cadavres flottaient. — J’ouvris la fenêtre, et la lumière vint frapper ma face. — Je fus saisi de tristesse, je m’assis et je pleurai ; — et mes larmes vinrent sur ma face. Je regardai les régions qui bornaient la mer ; — vers les douze points de l’horizon, pas de continent. — Le vaisseau fut porté au-dessus du pays de Nizir. — La montagne de Nizir arrêta le vaisseau et ne lui permit pas de passer par-dessus. — Un jour et un second jour, la montagne de Nizir arrêta le vaisseau et ne lui permit pas de passer par-dessus ; — le troisième et le quatrième jour, la montagne de Nizir arrêta le vaisseau et ne lui permit pas de passer par-dessus ; — le cinquième et le sixième jour, la montagne de Nizir arrêta le vaisseau et ne lui permit pas de passer par-dessus. — A l’approche du septième jour, — je fis sortir et lâchai une colombe. La colombe alla, tourna et — ne trouva pas d’endroit où se poser et elle revint. — Je fis sortir et je lâchai une hirondelle. L’hirondelle alla, tourna et — ne trouva pas d’endroit où se poser, et elle revint. — Je fis sortir et je lâchai un corbeau. — Le corbeau alla et vit les charognes sur les eaux ; — il mangea, se posa, tourna et ne revint pas. Je fis sortir alors (ce qui était dans le vaisseau) vers les quatre vents, et j’offris un sacrifice. — J’élevai le bûcher de l’holocauste sur le pic de la montagne ; — sept par sept je disposai les vases mesurés[30], — et en dessous j’étendis des roseaux, du bois de cèdre et de genévrier. — Les dieux sentirent l’odeur ; les dieux sentirent la bonne odeur ; — et les dieux se rassemblèrent comme des mouches au-dessus du maître du sacrifice. — De loin, en s’approchant, la Grande Déesse — éleva les grandes zones que Anou a faites comme leur gloire (des dieux)[31]. — Ces dieux, cristal lumineux devant moi, je ne les quitterai jamais ; — en ce jour je priai pour qu’à toujours je pusse ne jamais les quitter : — Que les dieux viennent à mon bûcher d’holocauste ! — mais que jamais Bel ne vienne à mon bûcher d’holocauste ! — car il ne s’est pas maîtrisé et il a fait la trombe (du déluge), — et il a compté mes hommes pour le gouffre. De loin, en s’approchant, Bel — vit le vaisseau ; et Bel s’arrêta ; il fut rempli de colère contre les dieux et les Archanges célestes. — Personne ne doit sortir vivant ! aucun homme ne sera préservé de l’abîme ! — Ninib ouvrit sa bouche et parla ; il dit au guerrier Bel : — Quel autre que Êa en aurait formé la résolution ? — car Êa possède la science et [il prévoit] tout. — Êa ouvrit sa bouche et parla ; il dit au guerrier Bel : — Ô toi, héraut des dieux, guerrier, — comme tu ne t’es pas maîtrisé, tu as fait la trombe (du déluge). — Laisse le pécheur porter le poids de son péché, le blasphémateur le poids de son blasphème. — Complais-toi dans ce bon plaisir et jamais il ne sera enfreint ; la foi jamais [n’en sera violée.] — Au lieu que tu fasses un (nouveau) déluge, que les lions surviennent et qu’ils réduisent le nombre des hommes ; — au lieu que tu fasses un (nouveau) déluge, que les hyènes surviennent et qu’elles réduisent le nombre des hommes ; — au lieu que tu fasses, un (nouveau) déluge, qu’il y ait famine et que la terre soit [dévastée ;] — au lieu que tu fasses un (nouveau) déluge, que Dibbarra (le dieu des épidémies) survienne et que les hommes soient [moissonnés][32]. — Je n’ai pas révélé la décision des grands dieux ; — c’est ‘Hasisadra qui a interprété un songe et compris ce que les dieux avaient décidé. Alors quand sa résolution fut arrêtée, Bel entra dans le vaisseau, — il prit ma main et me fit lever. — Il fit lever aussi ma femme et la fit se placer à mon côté. — Il tourna autour de nous et s’arrêta fixe ; il s’approcha de notre groupe. — Jusqu’à présent ‘Hasisadra a fait partie de l’humanité périssable ; — mais voici que ‘Hasisadra et sa femme vont être enlevés pour vivre comme les dieux, — et ‘Hasisadra résidera au loin, à l’embouchure des fleuves. — Ils m’emportèrent et m’établirent dans !un lieu reculé, à l’embouchure des fleuves. Ce récit suit très exactement la même marche que celui de la Genèse, et d’un côté à l’autre les analogies sont frappantes. Pourtant il faut aussi noter des divergences d’une certaine valeur, qui prouvent que les deux traditions ont bifurqué dès une époque fort antique, et que celle dont nous avons l’expression dans la Bible n’est pas seulement une édition de celle du sacerdoce chaldéen, expurgée au point de vue d’un sévère monothéisme. Le récit biblique porte l’empreinte d’un peuple qui vit au milieu des terres et ignore les choses de la navigation. Dans la Genèse le nom de l’arche, tebah, signifie coffre et non vaisseau ; il n’y est pas question de la mise à l’eau de l’arche ; aucune mention ni de la mer, ni de la navigation ; point de pilote. Au contraire, dans l’épopée d’Ourouk, tout indique qu’elle a été composée chez un peuple maritime ; chaque circonstance porte le reflet des mœurs et des coutumes des riverains du Golfe Persique. ‘Hasisadra monte sur un navire formellement désigné par le mot propre ; ce navire est mis à l’eau et éprouvé par une navigation d’essai ; toutes ses fentes sont calfatées avec du bitume ; il est confié à un pilote. La narration chaldéo-babylonienne représente ‘Hasisadra comme un roi qui monte dans le vaisseau entouré de tout un peuple de serviteurs et de compagnons ; dans la Bible il n’y a que la famille de Noa’h qui soit sauvée[33] ; la nouvelle humanité n’a pas d’autre souche que les trois fils du patriarche. Pas de trace dans le poème chaldéen de la distinction des animaux purs et impurs, et du nombre de sept couples pour chaque espèce des premiers, bien qu’en Babylonie le nombre sept eût un caractère tout à fait sacramentel. L’auteur du traité Sur la Déesse Syrienne, indûment attribué à Lucien, nous fait connaître la tradition diluvienne des Araméens, issue directement de celle de la Chaldée, telle qu’on la racontait dans le fameux sanctuaire d’Hiérapolis ou Bambyce. La plupart des gens, dit-il, racontent que le fondateur du temple fut Deucalion-Sisythès, ce Deucalion sous lequel eut lieu la grande inondation. J’ai aussi entendu le récit que les Grecs font de leur côté sur Deucalion ; le mythe est ainsi conçu : La race actuelle des hommes n’est pas la première ; car il y en a eu une auparavant, dont tous les hommes ont péri. Nous sommes d’une deuxième race, qui descend de Deucalion et s’est multipliée avec la suite des temps. Quant aux premiers hommes, on dit qu’ils étaient pleins d’orgueil et d’insolence et qu’ils commettaient beaucoup de crimes, ne gardant pas leurs serments, n’exerçant pas les lois de l’hospitalité, n’épargnant pas les suppliants ; aussi furent-ils châtiés par un immense désastre. Subitement d’énormes masses d’eau jaillirent de la terre et des pluies d’une abondance extraordinaire se mirent à tomber, les fleuves sortirent de leur lit et la mer franchit ses rivages ; tout fut couvert d’eau, et tous les hommes périrent. Deucalion seul fut conservé vivant, pour donner naissance à une nouvelle race, à cause de sa vertu et de sa piété. Voici comment il se sauva. Il se mit avec ses enfants et ses femmes dans un grand coffre, qu’il avait, et où vinrent se réfugier auprès de lui des porcs, des chevaux, des lions, des serpents et de tous, les animaux terrestres. Il les reçut tous avec lui, et tout le temps qu’ils furent dans le coffre Zeus inspira à ces animaux une amitié réciproque, qui les empêcha de s’entredévorer. De cette façon, enfermés dans un seul coffre, ils flottèrent tant que les eaux furent dans leur force. Tel est le récit des Grecs sur Deucalion. Mais à ceci qu’ils racontent également, les gens d’Hiérapolis ajoutent une narration merveilleuse : que dans leur pays s’ouvrit un vaste gouffre, où toute l’eau du déluge s’engloutit. Alors Deucalion éleva un hôtel et consacra un temple à Héra (‘Athar-’athê = Atargatis) près du gouffre même. J’ai vu ce gouffre, qui est très étroit et situé sous le temple. S’il était plus grand autrefois et s’est maintenant rétréci, je ne sais ; mais je l’ai vu, il est tout petit. En souvenir de l’événement que l’on raconte, voici le rite que l’on accomplit. Deux fois par an l’on amène de l’eau de la mer au temple. Ce ne sont pas les prêtres seuls qui en font venir, mais de nombreux pèlerins viennent de toute la Syrie, de l’Arabie et même d’au-delà de l’Euphrate, apportant de l’eau. On la verse dans le temple,.et elle descend dans le gouffre, qui malgré son étroitesse en engloutit ainsi une quantité très considérable. On dit que cela se fait en vertu d’une loi religieuse instituée par Deucalion, pour conserver le souvenir de la catastrophe et du bienfait qu’il reçut des dieux. Tel est l’antique tradition du temple. L’Inde nous offre à son tour un récit du déluge, dont la parenté avec celui de la Bible et celui des Chaldéens est grande. La forme la plus ancienne et la plus simple s’en trouve dans le Çatapata Brâhmana, dont nous avons essayé plus haut d’indiquer la date approximative. Ce morceau a été traduit pour la première fois par M. Max Müller. Un matin, l’on apporta à Manou[34] de l’eau pour se laver ; et, quand il se fut lavé, un poisson lui resta dans les mains. Et il lui adressa ces mots : Protège-moi et je te sauverai. — De quoi me sauveras-tu ? — Un déluge emportera toutes les créatures ; c’est là ce dont je te sauverai. — Comment te protégerai-je ? Le poisson répondit : Tant que nous sommes petits, nous restons en grand péril ; car le poisson avale le poisson. Garde-moi d’abord dans un vase. Quand je serai trop gros, creuse un bassin pour m’y mettre. Quand j’aurai grandi encore, porte-moi dans l’Océan. Alors je serai préservé de la destruction. Bientôt il devint un gros poisson. Il dit à Manou : Dans l’année même où j’aurai atteint ma pleine croissance, le déluge surviendra. Construis alors un vaisseau et adore-moi. Quand les eaux s’élèveront, entre dans ce vaisseau et je te sauverai. Après l’avoir ainsi gardé, Manou porta le poisson dans l’Océan. Dans l’année qu’il avait indiquée, Manou construisit un vaisseau et adora le poisson. Et quand le déluge fut arrivé, il entra dans le vaisseau. Alors le poisson vint à lui en nageant, et Manou attacha le câble du vaisseau à la corne du poisson, et, par ce moyen, celui-ci le fit passer par-dessus la montagne du Nord. Le poisson dit : Je t’ai sauvé ; attache le vaisseau à un arbre, pour que l’eau ne l’entraîne pas pendant que tu es sur la montagne ; à mesure que les eaux baisseront, tu descendras. Manou descendit avec les eaux, et c’est ce qu’on appelle la descente de Manou sur la montagne du Nord. Le déluge avait emporté toutes les créatures, et Manou resta seul. Vient ensuite par ordre de date et de complication du récit, qui va toujours en se surchargeant de traits fantastiques et parasites, la version de l’énorme épopée du Mahâbhârata. Celle du poème intitulé Bhâgavata-Pourâna est encore plus récente et plus fabuleuse. Enfin la même tradition faille sujet d’un poème entier, de date fort basse, le Matsya-Pourâna, dont le grand indianiste anglais Wilson a donné l’analyse. Dans la préface du troisième volume de son édition du Bhâgavata-Pourâna ; notre illustre Eugène Burnouf a comparé avec soin les trois récits connus quand il écrivait (celui du Çatapatha-Brâhmana a été découvert depuis) pour éclairer là question de l’origine de la tradition indienne du déluge. Il y montre, par une discussion qui mérite de rester un modèle d’érudition, de finesse et de critique, que cette tradition fait totalement défaut dans les hymnes des Védas, où on ne trouve que des allusions lointaines à la donnée, du déluge, et des allusions qui paraissent se rapporter à une forme de légende assez différente, et aussi que cette tradition a été primitivement étrangère au système, essentiellement indien, des manvantaras ou destructions périodiques du monde. Il en conclut qu’elle doit avoir, été importée dans l’Inde postérieurement à l’adoption de ce dernier système, fort ancien cependant, puisqu’il est commun au brahmanisme et au bouddhisme. Il incline dès lors à y voir une importation sémitique, opérée dans les temps déjà historiques, non pas de la Genèse, dont il est difficile d’admettre l’action dans l’Inde à une époque aussi ancienne, mais plus probablement de la tradition babylonienne. La découverte d’une rédaction originale de celle-ci confirme l’opinion du grand sanscritiste dont le nom restera l’une des plus hautes gloires scientifiques de notre pays. Le trait dominant du récit indien, celui qui y tient une place essentielle et en fait le caractère distinctif, est le rôle attribué à un dieu qui revêt la forme d’un poisson pour avertir Manou, guider son navire et le sauver du déluge. La nature de la métamorphose est le seul point fondamental et primitif, car les diverses versions varient sur la personne du dieu qui prend cette forme : le Brâhmana ne précise rien ; le Mahâbhârata en fait Brâhma, et pour les rédacteurs des Pourânas c’est Vischnou. Ceci est d’autant pins remarquable que la métamorphose en poisson, matsyavdtara, demeure isolée dans la mythologie indienne, étrangère à sa symbolique habituelle, et n’y donne naissance à aucun développement ultérieur ; on ne trouve pas dans l’Inde d’autre trace du culte des poissons, qui avait pris tant d’importance et d’étendue chez d’autres peuples de l’antiquité. Burnouf y voyait avec raison une des marques d’importation de l’extérieur et le principal indice d’origine babylonienne, car les témoignages classiques, confirmés depuis par les monuments indigènes, faisaient entrevoir dans la religion de Babylone un rôle plus capital que partout ailleurs, attribué à la conception des dieux ichtyomorphes ou en forme de poissons. Le rôle que la légende conservée dans l’Inde fait tenir par le poisson divin auprès de Manou, est, en effet, rempli près de ‘Hasisadra, dans la narration de l’épopée d’Ourouk, et dans celle de Bérose, par le dieu Êa, qualifié aussi de Schalman, le sauveur. Or, ce dieu, dont on connaît maintenant avec certitude le type de représentation sur les monuments assyriens et babyloniens, y est le dieu ichtyomorphe par essence ; presque constamment son image consacrée combine les formes du poisson et celle de l’homme. Quand on trouve chez deux peuples différant entre eux une même légende, avec une circonstance aussi spéciale, et qui ne ressort pas nécessairement et naturellement de la donnée fondamentale du récit ; quand, de plus, cette circonstance tient étroitement à l’ensemble des conceptions religieuses d’un des deux peuples, et chez l’autre reste isolée, en dehors des habitudes de sa symbolique, une règle absolue de critique impose de conclure que la légende a été transmise de l’un à l’autre avec une rédaction déjà fixée, et constitue une importation étrangère qui s’est superposée, sans s’y confondre, aux traditions vraiment nationales, et pour ainsi dire générales, du peuple qui l’a reçue sans l’avoir créée. Il est encore à remarquer que dans les Pourânas ce n’est plus Manou Vâivasvata que le poisson divin sauve du déluge ; c’est un personnage différent, roi des Dâsas, c’est-à-dire des pêcheurs, Satyavrata, l’homme qui aime la justice et la vérité, ressemblant d’une manière frappante au ‘Hasisadra de la tradition chaldéenne. Et la version pourânique de la légende du déluge n’est pas à dédaigner, malgré la date récente de sa rédaction, malgré les détails fantastiques et souvent presque enfantins dont elle surcharge le récit. Par certains côtés, elle est moins aryanisée que la version du Brâhmana et que celle du Mahâbhârata ; elle offre surtout quelques circonstances omises dans les rédactions antérieures et qui pourtant doivent appartenir au fonds primitifs, puisqu’elles se retrouvent dans la légende babylonienne, circonstances qui sans doute s’étaient conservées dans la tradition orale, populaire et non brahmanique, dont les Pourânas se montrent si profondément pénétrés. C’est ce qu’a remarqué déjà Pictet, qui insiste avec raison sur le trait suivant de la rédaction du Bhâgavata-Pourâna : Dans sept jours, dit Yischnou à Satyavatra, les trois mondes seront submergés par l’océan de la destruction. Il n’y a rien de semblable dans le Brâhmana ni dans le Mahâbhârata ; mais nous voyons dans la Genèse (VII, 4) que l’Éternel dit à Noa’h : Dans sept jours je ferai pleuvoir sur toute la terre ; et un peu plus loin nous y voyons encore : Au bout de sept jours, les eaux du déluge furent sur toute la terre[35]. Il ne faut pas accorder moins d’attention à ce que dit le Bhâgavata-Pourâna des recommandations faites à Satyavrata par le dieu incarné en poisson, pour qu’il dépose les écritures sacrées en un lieu sûr, afin de le mettre à l’abri du Hayagrîva, cheval marin qui réside dans les abîmes, et de la lutte du dieu contre cet Hayagrîva qui a dérobé les Védas et produit ainsi le cataclysme en troublant l’ordre du monde. C’est encore une circonstance qui manque aux rédactions plus anciennes, même au Mahâbhârata ; mais elle est capitale et ne peut être considérée comme un produit spontané du sol de l’Inde, car il est difficile d’y méconnaître, sous un vêtement indien, le pendant exact de la tradition de l’enfouissement des écritures sacrées à Sippara par ‘Hasisadra, telle qu’elle apparaît dans la version des fragments de Bérose. C’est donc la forme chaldéenne de la tradition du déluge que les Indiens ont adoptée, à la suite d’une communication que les rapports de commerce entre les deux contrées rendent historiquement toute naturelle, et qu’ils ont ensuite développée avec l’exubérance propre à leur imagination. Mais ils ont dû adopter d’autant plus facilement ce récit de la Chaldée qu’il s’accordait avec une tradition que, sous une forme un peu différente, leurs ancêtres avaient apportées du berceau primitif de la race aryenne. Que le souvenir du déluge ait fait partie du fond premier des légendes de cette grande race sur les origines du monde, c’est, en effet, ce dont il n’est pas possible de douter. Car si les Indiens ont accepté la forme du récit de la Chaldée, si voisine de celle du récit de la Genèse, tous les autres rameaux de la race aryenne se montrent à nous en possession de versions pleinement originales de l’histoire du cataclysme, que l’on ne saurait tenir pour empruntées à Babylone ou aux Hébreux. Chez les Iraniens, nous rencontrons dans les livres sacrés qui constituent le fondement de la doctrine du zoroastrisme et remontent à une très haute antiquité ; une tradition dans laquelle il faut reconnaître bien certainement une variante de celle du déluge, mais qui prend un caractère bien spécial et s’écarte par certains traits essentiels de celles que nous avons jusqu’ici examinées. On y raconte comment Yima, qui dans sa conception originaire et primitive était le père de l’humanité, fut averti, par Ahouramazda, le dieu bon, de ce que la terre allait être dévastée par une inondation destructrice. Le dieu lui ordonna de construire un refuge, un jardin de forme carrée, vara, défendu par une enceinte, et d’y faire entrer les germes des hommes, des animaux et des plantes pour les préserver de l’anéantissement. En effet, quand l’inondation- survint, le jardin de Yima fut seul épargné, avec tout ce qu’il contenait ; et l’annonce du salut y fut apportée par l’oiseau Karschipta, envoyé d’Ahouramazda. Les Grecs avaient deux légendes principales et différentes, sur le cataclysme qui détruisit l’humanité primitive. La première se rattachait au nom d’Ogygès, le plus ancien roi de Béotie ou de l’Attique, personnage tout a fait mythique et qui se perd dans la nuit des âges ; son nom paraît dérivé de celui qui désignait primitivement le déluge dans les idiomes aryens, en sanscrit âugha. On racontait que, de son temps, tout le pays fut envahi par le déluge dont les eaux s’élevèrent jusqu’au ciel, et auquel il échappa dans un vaisseau avec quelques compagnons. La seconde tradition est la légende thessalienne de Deucalion. Zeus ayant résolu de détruire les hommes de l’âge de bronze, dont les crimes avaient excité sa colère, Deucalion, sur le conseil de Prométhée, son père, construit un coffre dans lequel il se réfugie avec sa femme Pyrrha. Le déluge arrive ; le coffre flotte au gré des flots pendant neuf .jours et neuf nuits, et est enfin déposé par les eaux au sommet du Parnasse. Deucalion et Pyrrha en sortent, offrent un sacrifice et repeuplent le monde, suivant l’ordre de Zeus, en jetant derrière eux les os de la terre, c’est-à-dire des pierres, qui se changent en hommes. Ce déluge de Deucalion est, dans la tradition grecque, celui qui a le plus le caractère de déluge universel. Beaucoup d’auteurs disent qu’il s’étendit à toute la terre et que l’humanité entière y périt. A Athènes, on célébrait en mémoire de cet événement, et pour apaiser les mânes des morts du cataclysme, une cérémonie appelé Hydrophoria, laquelle avait, une analogie si étroite avec celle qui était en usage à Hiérapolis de Syrie, qu’il est difficile de ne pas voir ici une importation syro-phénicienne et le résultat d’une assimilation établie dès une haute antiquité entre le déluge de Deucalion et le déluge de ‘Hasisadra, comme l’établit aussi l’auteur du traité Sur la Déesse syrienne[36]. Auprès du temple de Zeus Olympien, l’on montrait une fissure dans le sol, longue d’une coudée seulement, par laquelle on disait que les eaux du déluge avaient été englouties dans la terre. Là, chaque année, dans le troisième jour de la fête des Anthestéries, jour de deuil, consacré aux morts, c’est-à-dire le 13 du mois d’anthestérion, vers le commencement de mars, on venait verser dans le gouffre de l’eau, comme à Bambyce, et de la farine mêlée de miel, ainsi qu’on faisait dans la fosse que l’on creusait à l’occident du tombeau, dans les sacrifices funèbres des Athéniens. D’autres, au contraire, limitaient l’étendue du déluge de Deucalion à la Grèce. Ils disaient même que cette catastrophe n’avait détruit que la majeure partie de la population de la contrée, mais que beaucoup d’hommes avaient pu se sauver sur les plus hautes montagnes. Ainsi la légende de Delphes racontait que les habitants de cette ville, suivant les loups dans leur fuite, s’étaient réfugiés dans une grotte au sommet du Parnasse, où ils avaient bâti la ville de Lycorée. Cette idée qu’il y avait eu simultanément des sauvetages sur un certain nombre de points, fut inspirée nécessairement aux mythographes postérieurs par le désir de concilier entre elles les légendes locales de bon nombre d’endroits de la Grèce, qui nommaient comme le héros sauvé du déluge un autre que Deucalion. Tel était à Mégare l’éponyme de la ville, Mégaros, fils de Zeus et d’une des Nymphes Sithnides, qui, averti de l’imminence du déluge par les cris des grues, avait cherché un refuge sur le Mont Géranien. Tels étaient le Thessalien Cérambos, qui avait pu, disait-on, échapper au déluge en s’élevant dans les airs au moyen d’ailes que les Nymphes lui avaient données, ou bien Perirrhoos, fils d’Aiolos, que Zeus Naïos avait préservé du cataclysme à Dodone. Pour les gens de l’île de Cos, le héros sauvé du déluge était Mérops, fils d’Hyas, qui avait rassemblé sous sa loi dans leur île les débris de l’humanité, préservés avec lui. Les traditions de Rhodes faisaient échapper au cataclysme les seuls Telchines, celles de la Crète Jasion. A Samothrace, ce rôle de héros sauvé du déluge était attribué à Saon, que l’on disait fils de Zeus ou d’Hermès. Dardanos, que l’on fait arriver à Samothrace immédiatement après ces événements, vient de l’Arcadie, d’où il a été chassé par le déluge. Dans tous ces récits diluviens de la Grèce, on ne saurait douter qu’à l’antique tradition du cataclysme qui avait fait périr l’humanité, tradition commune à tous les peuples aryens, se mêlent le souvenir plus ou moins précis de catastrophes locales, produites par des débordements extraordinaires des lacs ou des rivières, par la rupture des digues naturelles de certains lacs, par des affaissements de portions de rivages de la mer, par des ras de marée à la suite de tremblements de terre ou de soulèvements partiels du fond de la mer. Les Grecs racontaient que dans les âges primitifs leur pays avait été le théâtre de plusieurs de ces catastrophes ; Istros en comptait quatre principales, dont une avait ouvert les détroits du Bosphore et de l’Hellespont, précipitant les eaux du Pont-Euxin dans la Mer Egée et submergeant les îles et les côtes voisines. C’est là manifestement le déluge de Samothrace, où les habitants qui parvinrent à se sauver ne le firent qu’en gagnant le plus haut sommet de la montagne qui s’y élève, puis, en reconnaissance de leur préservation, consacrèrent l’île toute entière, en entourant ses rivages d’une ceinture d’autels dédiés aux dieux. De même, la tradition du déluge d’Ogygès paraît bien se rapporter au souvenir d’une crue extraordinaire du lac Copaïs, inondant toute la grande vallée béotienne, souvenir que la légende a ensuite amplifiée, comme elle fait toujours, et qu’elle a surtout grossi par ce qu’elle a appliqué à ce désastre local les traits qui couraient dans les dires populaires sur le déluge primitif, qui s’était produit avant la dispersion et la séparation des ancêtres des deux races, sémitique et aryenne. U est probable aussi que quelque événement survenu dans la Thessalie ou plutôt dans la région du Parnasse, a déterminé la localisation de la légende de Deucalion. Cependant celle-ci, comme nous l’avons déjà remarqué, garde toujours un caractère plus général que les autres, soit qu’on étende le déluge à toute la terre, soit qu’on ne parle que delà totalité de la Grèce. Quoiqu’il en soit, on concilia les différents récits en admettant trois déluges successifs, celui d’Ogygès, celui de Deucalion et celui de Dardanos. L’opinion générale faisait du déluge d’Ogygès le plus ancien de tous, et les chronographes le placèrent 600 ans ou 250 environ avant celui de Deucalion. Mais cette chronologie était loin d’être universellement admise, et les habitants de Samothrace soutenaient que leur déluge avait précédé tous les autres. Les chronographes chrétiens du IIIe et du IVe siècle, comme Jules l’Africain et Eusèbe, adoptèrent les dates des chronographes hellènes pour les déluges d’Ogygès et de Deucalion, et les inscrivirent dans leurs tableaux comme des événements différents du déluge mosaïque, antérieur pour eux de mille ans à celui d’Ogygès. En Phrygie, la tradition diluvienne était nationale comme en Grèce. La ville d’Apamée en tirait son surnom de Kibôtos ou arche, prétendant être le lieu où l’arche s’était arrêtée. Iconion, de son côté, avait la même prétention. C’est ainsi que les gens du pays de Milyas, en Arménie, montraient sur le sommet de la montagne appelée Baris les débris de l’arche, que l’on faisait aussi voir aux pèlerins sur l’Ararat, dans les premiers siècles du christianisme, comme Bérose raconte que sur les monts Gordyéens on visitait de son temps les restes du vaisseau de ‘Hasisadra. Dans le IIe et le IIIe siècle de l’ère chrétienne, par suite de l’infiltration syncrétique de traditions juives et chrétiennes, qui pénétrait jusque dans les esprit encore attachés au paganisme, les autorités sacerdotales d’Apamée de Phrygie firent frapper des monnaies qui ont pour type l’arche ouverte, dans laquelle sont le patriarche sauvé du déluge et sa femme, recevant la colombe qui apporte le rameau d’olivier, puis, à côté, les deux mêmes personnages sortis du coffre pour reprendre possession de la ferre. Sur l’arche est écrit le nom ΝΏΕ, c’est-à-dire la forme même que revêt l’appellation de Noa’h dans la version grecque de la Bible, dite des Septante. Ainsi, à cette époque, le sacerdoce païen de la cité phrygienne avait adopté le récit biblique avec ses noms mêmes, et l’avait greffé sur l’ancienne tradition indigène. Il racontait aussi qu’un peu avant le déluge avait régné un saint homme, nommé Annacos, qui l’avait prédit et avait occupé le trône plus de 300 ans, reproduction manifeste du ‘Hanoch de la Bible, avec ses 365 ans de vie dans les voies du Seigneur. Pour le rameau des peuples celtiques, nous trouvons dans les poésies bardiques des Cymris du pays de Galles, une tradition du déluge qui, malgré la date récente de sa rédaction, résumée sous la forme concise de ce que l’on appelle les Triades, mérite à son tour d’attirer l’attention. Comme toujours, la légende est localisée dans le pays même, et le déluge est compté au nombre des trois catastrophes terribles de l’île de Prydain ou de Bretagne, les deux autres consistant en une dévastation par le feu et une sécheresse désastreuse. Le premier de ces événements, est-il dit, fut l’éruption du Llyri-llion ou lac des flots, et la venue, sur toute la surface du pays, d’une inondation, par laquelle tous les hommes furent noyés, à l’exception de Dwyfan et Dwyfach, qui se sauvèrent dans un vaisseau sans agrès ; et c’est par eux que l’île de Prydain fut repeuplée. Bien que les Triades, sous leur, forme actuelle, ne datent guère que du XIIIe ou XIVe siècle, remarque ici Pictet[37], quelques-unes se rattachent sûrement à de très anciennes traditions, et, dans celle-ci, rien n’indique un emprunt fait à la Genèse. Il n’en est peut-être pas de même d’une autre Triade, où il est parlé du vaisseau Nefydd-Naf-Neifion, qui portait un couple de toutes les créatures vivantes quand le lac Llyn-Ilion fit éruption, et qui ressemble un peu trop à l’arche de Noé. Le nom même du patriarche peut avoir suggéré cette triple épithète d’un sens obscur, mais formée évidemment sur le principe de l’allitération cymrique. Dans la même Triade figure l’histoire fort énigmatique des bœufs à cornes de Hu le puissant, qui ont tiré du Llyn-llion l’Avanc (castor ou crocodile ?), pour que le lac ne fit plus éruption. La solution de ces énigmes ne peut s’espérer que si l’on parvient à débrouiller le chaos des monuments bardiques du moyen âge gallois ; mais on ne saurait douter, en attendant, que les Cymris n’aient possédé une tradition indigène du déluge. Les Lithuaniens sont, parmi les peuples de l’Europe, celui qui a le dernier embrassé le christianisme et en même temps celui dont la langue est restée le plus près de l’origine aryaque. Ils possèdent une légende du déluge dont le fond paraît ancien, bien qu’elle ait pris le caractère naïf d’un .conte populaire, et que certains détails puissent avoir été empruntés à la Genèse lors des premières prédications des missionnaires du christianisme. Suivant cette légende, le dieu Pramzimas, voyant la terre pleine de désordres, envoie deux géants Wandou et Wêjas, l’eau et le vent, pour la ravager. Ceux-ci bouleversent tout dans leur fureur, et quelques hommes seulement se sauvent sur une montagne. Alors, pris de compassion, Pramzimas, qui était en train de manger des noix célestes, en laisse tomber près de la montagne une coquille, dans laquelle les hommes se réfugient et que les géants respectent. Echappés au désastre, ils se dispersent ensuite, et un seul couple, très âgé, reste dans le pays, se désolant de ne pas avoir d’enfants. Pramzimas, pour les consoler, leur envoie son arc-en-ciel et leur prescrit de sauter sur les os de la terre, ce qui rappelle singulièrement l’oracle que reçoit Deucalion. Les deux vieux époux font neuf sauts, et il en résulte neuf couples qui deviennent les aïeux des neuf tribus lithuaniennes. Tandis que la tradition du déluge tient une si grande place dans les souvenirs légendaires de tous les rameaux de la race aryenne, les monuments et les textes originaux de l’Égypte, au milieu de leurs spéculations cosmogoniques, n’ont pas offert une seule allusion, même lointaine, à un souvenir de ce cataclysme. Quand les Grecs racontaient aux prêtres de l’Égypte le déluge de Deucalion, ceux-ci leur répondaient que. la vallée du Nil en avait été préservée, aussi bien que de la conflagration produite par Phaéthou ; ils ajoutaient même que les Hellènes étaient des enfants d’attacher tant d’importance à cet événement, car il y avait eu bien d’autres catastrophes locales analogues. Cependant les Égyptiens admettaient une destruction des hommes primitifs par les dieux, à cause de leur rébellion et de leurs péchés. Cet événement était raconté dans un chapitre des livres sacrés de Tahout, des fameux Livres Hermétiques du sacerdoce égyptien, lequel a été gravé sur les parois d’une des salles les plus reculées de l’hypogée funéraire du roi Séti Ier, à Thèbes. Le texte en a été publié et traduit par M. Edouard Naville, de Genève. La scène se passe à la fin dû règne du dieu Râ, le premier règne terrestre suivant le système des prêtres de Thèbes, second suivant le système des prêtres de Memphis, suivis par Manéthon, qui plaçaient à l’origine des choses le règne de Phta’h, avant celui de Râ. Irrité de l’impiété et des crimes des hommes qu’il a produits, le dieu rassemble les autres dieux pour tenir conseil avec eux, dans le plus grand secret, afin que les hommes ne le voient point et que leur cœur ne s’effraie point. Dit par Râ à Noun[38] : Toi, l’aîné des dieux, de qui je suis né, et vous, dieux antiques, voici les hommes qui sont nés de moi-même ; ils prononcent des paroles contre moi ; dites-moi ce que vous ferez à ce propos ; voici, j’ai attendu et je ne les ai point tués avant d’avoir entendu vos paroles. Dit par la majesté de Noun : Mon fils Râ, dieu plus grand que celui qui l’a fait et qui l’a créé, je demeure en grande crainte devant toi ; que toi-même délibères en toi-même. Dit par la majesté de Râ : Voici, ils s’enfuient dans le pays, et leurs cœurs sont effrayés.... Dit par les dieux : Que ta face le permette, et qu’on frappe ces hommes qui trament des choses mauvaises, tes ennemis, et que personne [ne subsiste parmi eux.] Une déesse, dont malheureusement le nom a disparu, mais qui paraît être Tefnout, identifiée à Hat’hor et à Sekhet, est alors envoyée pour accomplir la sentence de destruction. Cette déesse partit, et elle tua les hommes sur la terre. — Dit par la majesté de ce dieu : Viens en paix, Hat’hor, tu as fait [ce qui t’était ordonné.] — Dit par cette déesse : Tu es vivant, car j’ai été plus forte que les hommes, et mon cœur est content. — Dit par la majesté de Râ : Je suis vivant, car je dominerai sur eux [et j’achèverai] leur ruine. — Et voici que Sekhet, pendant plusieurs nuits, foula aux pieds leur sang jusqu’à la ville de Hâ-khnen-sou (Héracléopolis). Mais le massacre achevé, la colère de Râ s’appaise ; il commence à se repentir de ce qu’il a fait. Un grand sacrifice expiatoire achève de le calmer. On recueille des fruits dans toute l’Égypte, on les broie et on les mêle au sang des hommes, dont on remplit 7000 cruches, que l’on présente devant le dieu. Voici que la majesté de Râ, le roi de la Haute et de la Basse-Égypte, vint avec les dieux en trois jours de navigation, pour voir ces vases de boisson, après qu’il eut ordonné à la déesse de tuer les hommes. — Dit par la majesté de Râ : C’est bien, cela ; je vais protéger les hommes à cause de cela. Dit par Râ : J’élève ma main à ce sujet, pour jurer que je ne « tuerai plus les hommes. La majesté de Râ, le roi de la Haute et Basse-Égypte, ordonna au milieu de la nuit de verser le liquide des vases, et les champs furent complètement remplis d’eau, par la volonté de ce dieu. La déesse arriva au matin et trouva les champs pleins d’eau ; son visage en fut joyeux, et elle but en abondance et elle s’en alla rassasiée. Elle n’aperçut plus d’hommes. Dit par la majesté de Râ à cette déesse : Viens en paix, gracieuse déesse. — Et il fit naître les jeunes prêtresses d’Amou (le nome Libyque). — Dit par la majesté de Râ à la déesse : On lui fera des libations à chacune des fêtes de la nouvelle année, sous l’intendance de mes prêtresses. — De là vient que des libations sont faites sous l’intendance des prêtresses de Hat’hor par tous les hommes depuis les jours anciens. Cependant quelques hommes ont échappé à la destruction qui avait été ordonnée par Râ ; ils renouvellent la population de la surface terrestre. Pour le dieu solaire qui règne sur le monde, il se sent vieux, malade, fatigué ; il en a assez de vivre au milieu des hommes, qu’il regrette de ne pas avoir complètement anéantis, mais qu’il a juré d’épargner désormais. Dit par la majesté de Râ : Il y a une douleur cuisante qui me tourmente ; qu’est-ce donc qui me fait mal ? Dit par la majesté de Râ : Je suis vivant, mais mon cœur est lassé d’être avec eux (les hommes), et je ne les ai nullement détruits. Ce n’est pas là une destruction que j’aie faite moi-même. Dit par les dieux qui l’accompagnent : Arrière avec ta lassitude, tu as obtenu tout ce que tu désirais. Le dieu Râ se décide pourtant à accepter le secours des hommes de la nouvelle humanité, qui s’offrent à lui pour combattre ses ennemis et livrent une grande bataille, d’où ils sortent vainqueurs. Mais malgré ce succès, le dieu, dégoûté de la vie terrestre, se résout à la quitter pour toujours et se fait porter au ciel par la déesse Nout, qui prend la forme d’une vache. Là il crée un lieu de délices, les champs d’Aalou, l’Elysée de la mythologie égyptienne, qu’il peuple d’étoiles. Entrant dans le repos, il attribue aux différents dieux le gouvernement des différentes parties du monde. Schou, qui va lui succéder comme roi, administrera les choses célestes avec Nout ; Seb et Noun reçoivent la garde des êtres de la terre et de l’eau. Enfin Râ, souverain descendu volontairement du pouvoir par une véritable abdication, s’en va faire sa demeure avec Tahout, son fils préféré, auquel il a donné l’intendance du monde inférieur. Tel est cet étrange récit, dans lequel, a très bien dit M. Naville, au milieu d’inventions fantastiques et souvent puériles, nous trouvons cependant les deux termes de l’existence telle que la comprenaient les anciens Égyptiens. Râ commence par la terre, et, passant par le ciel, s’arrête dans la région de la profondeur, l’Ament, dans laquelle il paraît vouloir séjourner. C’est donc une représentation symbolique et religieuse de la vie, qui, pour chaque Égyptien, et surtout pour un roi conquérant, devait commencer et finir comme le soleil. Voilà ce qui explique que ce chapitre ait pu être inscrit dans un tombeau. C’est donc la dernière partie du récit, que nous nous sommes borné à analyser très brièvement, l’histoire de l’abdication de Râ’ et de sa retraite, d’abord dans le ciel, puis dans l’Ament, symbole de la mort, qui doit être suivie d’une résurrection comme le soleil ressortira des ténèbres, c’est cette conclusion du récit qui en faisait tout l’intérêt dans la conception d’enseignement religieux sur la vie future, qui se déroulait dans la décoration des parois intérieures du tombeau de Séti Ier. Pournous, au contraire, l’importance du morceau réside dans l’épisode qui en forme le début, dans cette destruction des premiers hommes par les dieux, dont on n’a jusqu’à présent trouvé la mention nulle part ailleurs. Bien que le moyen de destruction employé par Râ contre les hommes soit tout différent, bien qu’il ne procède pas par une submersion mais par un massacre dont la déesse Tefnout ou Sekhet, à tête de lionne, la forme terrible de Hàt’hor, est l’exécutrice, ce récit offre par tous les autres côtés une analogie assez frappante avec celui du déluge mosaïque ou chaldéen, pour qu’il soit, difficile de ne pas l’en rapprocher, de ne pas y voir la forme spéciale, et très individuelle, que la même tradition avait revêtue en Égypte. Dès deux côtés, en effet, nous avons la même corruption des hommes, qui excite le courroux divin ; cette corruption, de part et d’autre, est châtiée par un anéantissement de l’humanité, décidé dans le ciel, anéantissement dont le mode seul diffère, mais auquel n’échappent, dans une forme et dans l’autre de la tradition, qu’un très petit nombre d’individus, destinés à devenir la souche d’une humanité nouvelle. Enfin, la destruction des hommes accomplie, un sacrifice expiatoire achève de calmer le courroux céleste, et un pacte solennel est conclu entré la divinité et la nouvelle race des hommes, qu’elle fait serment de ne plus anéantir. La concordance de tous ces traits essentiels me paraît primer ici la divergence au sujet de la manière dont la première humanité créée a été détruite. Et il faut encore observer ici la singulière parenté du rôle et du caractère que le narrateur égyptien prête à Râ, avec le rôle et le caractère que l’épopée d’Ourouk assigne au dieu Bel, dans le déluge de ‘Hasisadra. Les Égyptiens, dit M. l’abbé Vigouroux, avaient conservé la mémoire de la destruction des hommes, mais comme l’inondation était pour eux la richesse et la vie, ils altérèrent la tradition primitive ; le genre humain, au lieu de périr dans l’eau, fut exterminé d’une autre manière, et l’inondation, ce bienfait de la vallée du Nil, devint à leurs yeux la marqué que la colère de Râ était apaisée. C’est un fait très digne de remarque, a dit M. Maury[39], de rencontrer en Amérique des traditions relatives au déluge infiniment plus rapprochées de celle de la Bible et de la religion chaldéenne, que chez aucun peuple de l’ancien monde. On conçoit difficilement que les émigrations qui eurent lieu très certainement de l’Asie dans l’Amérique septentrionale par les îles Kouriles et Aléoutiennes, et qui s’accomplissent encore de nos jours, aient apporté de semblables souvenirs, puisqu’on n’en trouve aucune trace chez les populations mongoles ou sibériennes[40], qui furent celles qui se mêlèrent aux races autochtones du Nouveau Monde. Sans doute, certaines nations américaines, les Mexicains et les Péruviens, avaient atteint, au moment delà conquête espagnole, un état social fort avancé ; mais cette civilisation porte un caractère qui lui est propre, et elle paraît s’être développée sur le sol où elle florissait. Plusieurs inventions très simples, telles que la pesée par exemple[41], étaient inconnues à ces peuples, et cette circonstance nous montre que ce n’était pas de l’Inde ou du Japon qu’ils tenaient leurs connaissances. Les tentatives que l’on a faites pour retrouver en Asie, dans la société bouddhique, les origines de la civilisation mexicaine, n’ont pu amener encore à un fait suffisamment concluant. D’ailleurs le Bouddhisme eut-il, ce qui nous paraît douteux, pénétré en Amérique, il n’eût pu y apporter un mythe qu’on ne rencontre pas dans ses livres[42]. La cause de ces ressemblances des traditions diluviennes des indigènes du Nouveau Monde avec celle de la. Bible, demeure donc un fait inexpliqué. Je me plais à citer ces paroles d’un homme dont l’érudition est immense, précisément parce qu’il n’appartient pas aux écrivains catholiques et que, par conséquent, il ne saurait être suspect de se laisser aller dans son jugement à une opinion préconçue. D’autres, d’ailleurs, non moins rationalistes que lui, ont signalé de même cette parenté des traditions américaines, au sujet du déluge avec celles de la Bible et des Chaldéens. Les plus importantes de ces légendes diluviennes de l’Amérique sont celles du Mexique, parce qu’elles paraissent avoir eu une forme définitivement fixée en peintures symboliques et mnémoniques avant tout contact des indigènes avec les Européens. D’après ces documents, le Noa’h du cataclysme mexicain serait Coxcox, appelé par certaines populations Teocipactli ou Tezpi. Il se serait sauvé, conjointement avec sa femme Xochiquetzal, dans une barque, ou, suivant d’autres traditions, sur un radeau de bois de cyprès chauve (cupressus disticha). Des peintures retraçant le déluge de Coxcox ont été retrouvées chez les Aztèques, les Miztèques, les Zapotèques, les Tlascaltèques et les Méchoacanèses. La tradition de ces derniers, en particulier, offrirait une conformité plus frappante encore que chez les autres avec les récits delà Genèse et des sources chaldéennes. Il y serait dit que Tezpi s’embarqua dans un vaisseau spacieux avec sa femme, ses enfants, plusieurs animaux et des graines dont la conservation était nécessaire à la substance du genre humain. Lorsque le grand dieu Tezcatlipoca ordonna que les eaux se retirassent, Tezpi fit sortir de la barque un vautour. L’oiseau, qui se nourrit de chair morte, ne revint pas à cause du grand nombre de cadavres dont était jonchée la terre récemment desséchée. Tezpi envoya d’autres oiseaux, parmi lesquels le colibri seul revint, en tenant dans son bec une rameau de feuilles. Alors Tezpi, voyant que le sol commençait à se couvrir d’une verdure nouvelle, quitta son navire sur la montagne de Colhuacan. Le plus précieux document pour la connaissance du système cosmogonique des Mexicains est celui que l’on désigne sous le nom de Codex Vaticanus, d’après la Bibliothèque du Vatican, où il est conservé. Ce sont quatre tableaux symboliques, résumant les quatre âges du monde qui ont précédé l’âge actuel. Le premier y est appelé Tlatonatiuh, soleil de terre. C’est celui des géants ou Quinamés, premiers habitants de l’Anahuac, qui finissent par être détruits par une famine. Le second, nommé Tlétonatiuh, soleil de feu, se termine par la descente sur la terre de Xiuhteuctli, le dieu de l’élément igné. Les hommes sont tous transformés en oiseaux et n’échappent qu’ainsi à l’incendie. Toutefois un couple humain trouve asile dans une caverne et repeuple l’univers après cette destruction. Pour le troisième âge, Ehécatonatiuh, soleil de vent, la catastrophe qui le termine est un ouragan terrible suscité par Quetzalcohuatl, le dieu de l’air. A de rares exceptions près, les hommes, au milieu de cet ouragan, sont métamorphosés en singes. Vient ensuite, comme quatrième âge, celui qu’on appelle Atonatiuh, soleil d’eau. Il se termine par une grande inondation, un véritable déluge. Tous les hommes sont changés en poissons, sauf un individu et sa femme, qui se sauvent dans un bateau fait du tronc d’un cyprès chauve. Le tableau figuratif représente Matlalcuéyé, déesse des eaux, et compagne de Tlaloc, le dieu de la pluie, s’élançant vers la terre. Coxcox et Xochiquetzal, les deux êtres humains préservés du désastre, apparaissent assis sur un tronc d’arbre et flottant au milieu des eaux. Ce déluge est représenté comme le dernier cataclysme qui ait bouleversé la face de la terre. La conception que nous venons de résumer offre, avec celle des quatre Ages ou yougas de l’Inde, et celle des manvantaras, où alternent les destructions du monde et les renouvellements de l’humanité, une analogie singulière. Celle-ci est dételle nature qu’on est en droit de se demander si les Mexicains ont pu trouver de leur côté, et d’une manière tout à fait indépendante, une conception aussi, exactement pareille à celle des Indiens, ou s’ils ont dû la recevoir de l’Inde par une voie plus ou moins directe. La tradition diluvienne et le système des quatre âges, dont cette tradition est inséparable au Mexique, nous placent donc en face du problème auquel on revient toujours forcément quand il s’agit des civilisations américaines, le problème de l’originalité plus ou moins absolue, plus ou moins spontanée, de ces civilisations, et des apports qu’elles ont pu recevoir dé l’Asie, par des missionnaires bouddhistes ou d’autres, à une certaine époque. Dans l’état actuel des connaissances il est aussi impossible de résoudre ce problème négativement qu’affirmativement, et toutes les tentatives que l’on fait aujourd’hui pour le pénétrer sont beaucoup trop prématurées, ne peuvent conduire à aucun résultat solide. Quoi qu’il en soit, la doctrine des âges successifs et la destruction de l’humanité du premier de ces âges par un déluge, se retrouvent dans le singulier livre du Popol-vuh, ce recueil des traditions mythologiques des indigènes du Guatemala, rédigé en langue quiche, postérieurement à la conquête, par un adepte secret de l’ancienne religion, découvert, copié et traduit en espagnol au commencement du siècle dernier par le dominicain Francisco Ximenez, curé de Saint-Thomas de Chuila. On y lit qu’après la création, les dieux, ayant vu que les animaux n’étaient capables ni de parler ni de les adorer, voulurent former les hommes à leur propre image. Ils en façonnèrent d’abord en argile. Mais ces hommes étaient sans consistance ; ils ne pouvaient tourner la tête ; ils parlaient, mais ne comprenaient rien. Les dieux détruisirent alors par un déluge leur œuvre imparfaite. S’y reprenant une deuxième fois, ils firent un homme de bois et une femme de résine. Ces créatures étaient bien supérieures aux précédentes ; elles remuaient et vivaient, mais comme des animaux ; elles parlaient, mais d’une façon inintelligible, et elles ne pensaient pas aux dieux. Alors Hourakan, « le cœur duciel’, » dieu de l’orage, fit pleuvoir sur la terre une résine enflammée, en même temps que le sol était secoué par un épouvantable tremblement de terre. Tous les hommes descendus du couple dé bois et de résine périrent, à l’exception de quelques-uns, qui devinrent les singes des forêts. Enfin les dieux firent, avec du maïs blanc et du maïs jaune quatre hommes parfaits : Balam-Quitzé, le jaguar qui sourit, Balam-Agab, le jaguar de la nuit, Mahuentah, le nom distingué, et Iqi-Balam, le jaguar de la lune. Ils étaient grands et forts, ils voyaient tout et connaissaient tout, et ils remercièrent les dieux. Mais ceux-ci furent effrayés du succès définitif de leur œuvre et eurent peur pour leur suprématie ; aussi jetèrent-ils un léger voile, comme un brouillard, sur la vue des quatre hommes, qui devint semblable à celle des hommes d’aujourd’hui. Pendant qu’ils dormaient les dieux leur créèrent quatre épouses d’une grande beauté, et de trois naquirent les Quicliés, Iqi-Balam et sa femme Cakixaha n’ayant pas eu d’enfants. Avec cette série d’essais maladroits des dieux pour créer les hommes, ce à quoi ils ne réussissent qu’après avoir été deux fois obligés de détruire leur œuvre imparfaite, nous voici bien loin du récit biblique, assez loin pour écarter tout soupçon d’influence des prédications des missionnaires chrétiens sur cette narration indigène guatémalienne, où nous retrouvons toujours la croyance qu’une première race d’hommes a été détruite dans le commencement des temps par une grande inondation. De nombreuses légendes sur la grande inondation des premiers âges ont été aussi relevées chez les tribus américaines demeurées à l’état sauvage. Mais par leur nature même ces récits peuvent laisser une certaine place au doute. Ce ne sont pas les indigènes eux-mêmes qui les ont fixés par écrit ; nous ne les connaissons que par des intermédiaires qui ont pu, de très bonne foi, leur faire subir des altérations considérables en les rapportant, forcer presque inconsciemment leur ressemblance avec les données bibliques. D’ailleurs, ils n’ont été recueillis qu’à des époques tardives, quand les tribus avaient eu déjà des contacts prolongés avec les Européens et avaient vu vivre au milieu d’elles plus d’un aventurier qui avait pu faire pénétrer des éléments nouveaux dans leurs traditions. Ces récits ne devraient donc avoir qu’une bien faible valeur sans les faits, autrement positifs, que nous avons constatés au Mexique, au Guatemala et au Nicaragua, et qui prouvent l’existence de la tradition diluvienne chez les populations de l’Amérique avant l’arrivée des conquérants européens. Appuyées sur ces faits, les narrations diluviennes des tribus illettrées du Nouveau Monde méritent d’être mentionnées, mais avec la réserve que nous venons d’indiquer. La plus remarquable comme excluant, par sa forme même, l’idée d’une communication de la tradition par les Européens, est celle des Chéroquis. Elle semble une traduction enfantine du récit de l’Inde, avec cette différence, que c’est un chien qui s’y substitue au poisson, dans le rôle de sauveur de l’homme qui échappe au cataclysme. Le chien ne cessait pas pendant plusieurs jours de parcourir avec une persistance singulière les bords de la rivière, regardant l’eau fixement et hurlant comme en détresse. Son maître s’étant irrité de ces manœuvres, lui ordonna d’un ton rude de rentrer à la maison ; alors il se mit à parler et révéla le malheur qui le menaçait. Il termina sa prédiction en disant que son maître, et la famille de celui-ci, ne pourrait échapper à la submersion qu’en le jetant immédiatement à l’eau, lui chien, car il deviendrait alors leur sauveur. Qu’il s’en irait en nageant chercher un bateau pour se mettre à l’abri, avec ceux qu’il voulait faire échapper, mais qu’il n’y avait pas à perdre un moment, car il allait survenir une pluie terrible qui produirait une inondation générale, où tout périrait. L’homme obéit à ce que lui disait son chien ; il fut ainsi sauvé avec sa famille, et ce furent eux qui repeuplèrent la terre. On prétend que les Tamanakis, tribus caraïbes des bords de l’Orénoque, ont une légende diluvienne, d’après laquelle un homme et une femme auraient seuls échappés au cataclysme en gagnant le sommet du mont Tapanacu. Là, ils auraient jeté derrière eux par-dessus leurs têtes des fruits de cocotier, d’où serait sortie une nouvelle race d’hommes et de femmes. Si le rapport est exact, ce que nous n’oserions affirmer, il y aurait là un bien curieux accord avec un des traits essentiels de l’histoire hellénique de Deucalion et Pyrrha. Les explorateurs russes ont signalé l’existence d’une narration enfantine du déluge dans les îles Aléoutiennes, qui forment le chaînon géographique entre l’Asie et l’Amérique septentrionale, et à l’extrémité de la côte nord-ouest américaine, chez les Kolosches. Le voyageur Henry raconte cette tradition, qu’il avait recueillie chez les Indiens des grands lacs : Autrefois le père des tribus indiennes habitait vers le soleil levant. Ayant été averti en songe qu’un déluge allait désoler la terre, il construisit un radeau, sur lequel il se sauva avec sa famille et tous les animaux. Il flotta ainsi plusieurs mois sur les eaux. Les animaux, qui parlaient alors, se plaignaient hautement et murmuraient contre lui. Une nouvelle terre apparut enfin ; il y descendit avec toutes les créatures, qui perdirent dès lors l’usage de la parole, en punition de leurs murmures contre leur libérateur. Selon le P. Charlevoix, les tribus du Canada et de la vallée du Mississipi rapportaient, dans leurs grossières légendes, que tous les humains avaient été détruits par un déluge, et qu’alors le Grand-Esprit, pour repeupler la terre, avait changé des animaux en hommes. Nous devons à J.-G. Kohi la connaissance de la version des Chippeways, pleine de traits bizarres et difficiles à expliquer, où l’homme sauvé du cataclysme est appelé Ménaboschu[43]. Pour savoir si la terre se dessèche, il envoie de son embarcation un oiseau, le plongeon ; puis, une fois revenu sur le sol débarrassé des eaux, il devient le restaurateur du genre humain et le fondateur de la société. Il était question, dans les chants des habitants de la Nouvelle Californie, d’une époque très reculée où la mer sortit de son lit et couvrit la terre. Tous les hommes et tous les animaux périrent à la suite de ce déluge, envoyé par le dieu suprême Chinigchinig, à l’exception de quelques-uns, qui s’étaient réfugiés sur une haute montagne où l’eau ne parvint pas. Les commissaires des États-Unis, chargés de l’exploration des territoires du Nouveau-Mexique, lors de leur prise de possession par la grande République américaine, ont constaté l’existence d’une tradition pareille chez diverses tribus des indigènes de cette vaste contrée. D’autres récits du même genre sont encore signalés par d’autres voyageurs en diverses parties de l’Amérique du nord, avec des ressemblances plus ou moins accusées avec la narration biblique. Mais ils sont généralement indiqués d’une manière trop vague pour que l’on puisse se fier absolument aux détails dont ceux qui les rapportent, les ont accompagnés. Il n’est pas jusqu’à l’Océanie où l’on n’ait pensé retrouver, non dans la race des nègres pélagiens ou Papous[44], mais dans la race polynésienne, originaire des archipels de l’Australasie, la tradition diluvienne, mêlée à des traits empruntés aux ras de marée, qui sont un des fléaux les plus habituels de ces îles. Le récit le plus célèbre en ce genre est celui de Tahiti, que l’on a plus spécialement que les autres rattaché à la tradition des premiers âges. Mais ce récit, comme tous ceux de la même partie du monde où l’on a vu le souvenir du déluge, a revêtu le caractère enfantin qui est le propre des légendes des populations polynésiennes ou canaques, et d’ailleurs, comme l’a justement remarqué M. Maury, la narration de Tahiti pourrait s’expliquer très naturellement par le souvenir d’un de ces ras de marée si fréquents dans la Polynésie. Le trait le plus essentiel de tous les récits proprement diluviens fait défaut. L’île de Toa-Marama, dans laquelle, suivant le récit de Tahiti, se réfugièrent les pêcheurs qui avaient excité la colère du dieu des eaux, Rouahatou, en jetant leur hameçon dans sa chevelure, n’a pas, dit M. Maury, de ressemblance avec l’arche[45]. Il est vrai qu’une des versions de la légende tahitienne ajoute que les deux pêcheurs se rendirent à Toa-Marama, non seulement avec leurs familles, mais avec un cochon, un chien et un couple de poules, circonstance qui se rapproche fort de l’entrée des animaux dans l’arche. D’un autre côté, certains traits du récit des Fidjiens, surtout celui, que pendant de longues années après l’événement on tint constamment des pirogues toutes prêtes pour le cas où il se reproduirait, se rapportent bien plus à un phénomène, local, à un ras de marée, qu’au déluge universel. Cependant, si ces légendes se rattachaient exclusivement à des catastrophes locales, il serait singulier qu’elles se reproduisissent presque pareilles dans un certain nombre de localités fort éloignées les unes des autres, et que parmi les populations de l’Océanie elles n’existassent que là où se rencontre, où du moins a pris pied pour quelque temps et laissé des vestiges incontestables de son passage, une seule race, la race polynésienne, originaire de l’archipel Malais, d’où ses premiers ancêtres n’émigrèrent que vers le IVe siècle de l’ère chrétienne, c’est-à-dire à une époque à laquelle, de proche en proche, par suite des rapports entre l’Inde et une partie de la Malaisie, la narration du déluge, sous sa forme indienne plus ou moins altérée, avait pu y pénétrer. Sans oser donc trancher d’une manière affirmative dans un sens ou dans l’autre cette question difficile, et peut-être à toujours insoluble, nous ne croyons pas que l’on puisse absolument rejeter l’opinion de ceux qui, dans les récits polynésiens, dont nous avons cité deux échantillons, veulent trouver un écho de la tradition du déluge, très affaibli, très altéré, plus inextricablement confondu que partout ailleurs avec le souvenir de désastres locaux d’une date peu éloignée. La longue revue à laquelle nous venons de nous livrer, nous permet d’affirmer que le récit du déluge est une tradition universelle dans tous les rameaux de l’humanité, à l’exception toutefois de la race noire. Mais un souvenir partout aussi précis et aussi concordant ne saurait être celui d’un mythe inventé à plaisir. Aucun mythe religieux ou cosmogonique ne présente ce caractère d’universalité. C’est nécessairement le souvenir d’un événement réel et terrible, qui frappa assez puissamment l’imagination des premiers ancêtres de notre espèce, pour n’être jamais oublié de leur descendance. Ce cataclysme se produisit près du berceau premier de l’humanité, et avant que les familles souches, d’où devaient descendre les principales races, ne fussent encore séparées ; car il serait tout à fait contraire à la vraisemblance et aux saines lois de la critique d’admettre que, sur autant de points différents du globe qu’il faudrait le supposer, pour expliquer ces traditions partout répandues, des phénomènes locaux exactement semblables se seraient reproduits et que leur souvenir aurait toujours pris une forme identique, avec des circonstances qui ne devaient pas nécessairement se présenter à l’esprit en pareil cas. Notons cependant que la tradition diluvienne n’est peut-être pas primitive, mais importée, en Amérique, qu’elle a sûrement ce caractère d’importation chez les rares populations de race jaune où on la retrouve ; enfin que son existence réelle en Océanie, chez les Polynésiens, est encore douteuse. Restent trois grandes races auxquelles elle appartient sûrement en propre, qui ne se la sont pas empruntées les unes aux autres, mais chez lesquelles, cette tradition est incontestablement primitive, remonte aux plus anciens souvenirs des ancêtres. Et ces trois races sont précisément les seules dont la Bible parle pour les rattacher à la descendance de Noa’h, celles dont elle donne la filiation ethnique dans le chapitre X de la Genèse. Cette observation, qu’il ne me paraît pas possible de révoquer en doute, donne une valeur singulièrement historique, et précise à la tradition qu’enregistre le livre sacré, et telle qu’il la présente, si d’un autre côté elle doit peut-être conduire à lui donner une signification plus resserrée géographiquement et ethnologiquement. Et l’on ne saurait hésiter à reconnaître que le déluge biblique, loin d’être un mythe, a été un fait historique et réel, qui a frappé à tout le moins les ancêtres des trois races aryenne ou indo-européenne, sémitique ou syro-arabe, chamitique ou kouschite, c’est-à-dire des trois grandes races civilisées du monde ancien, de celles qui constituent l’humanité vraiment supérieure, avant que les ancêtres de ces trois races ne se fussent encore séparés et dans la contrée de l’Asie qu’ils habitaient ensemble. § 5. — LE BERCEAU DE L’HUMANITÉ POSTDILUVIENNE[46]. Le lieu où le récit biblique montre l’arche s’arrêtant après le déluge, le point de départ qu’elle assigne aux Noa’hides est les montagnes d’Ararat. A dater d’une certaine époque ce souvenir s’est appliqués à la plus haute montagne de la chaîne de l’Arménie, qui, dans le cours des migrations diverses dont ce pays a été le théâtre, a reçu en effet le nom d’Ararat, plus anciennement que le ixe siècle avant l’ère chrétienne, après avoir été désigné sous celui de Masis par les premiers habitants indigènes. La plupart des interprètes de l’Écriture Sainte ont adopté cette manière de voir, bien que d’autres, dans les premiers siècles du christianisme, préférassent suivre les données de la tradition chaldéenne rapportée par Bérose, laquelle mettait le lieu de la descente de Xisouthros (‘Hasisadra) dans une partie plus méridionale de la même chaîne, aux monts Gordyéens, les montagnes du Kurdistan actuel au nord-est de l’Assyrie. La montagne de Nizir, où la tradition de la sortie du vaisseau du patriarche sauvé du cataclysme est localisée par le récit déchiffré sur les tablettes cunéiformes de Ninive, que nous avons rapporté tout à l’heure, constituait la portion sud de ce massif. Sa situation par 36° de latitude est, en effet, déterminée formellement par les indications que fournit, dans ses inscriptions historiques, le monarque assyrien Asschour-naçir-abal au sujet d’une expédition militaire qu’il conduisit dans cette contrée. Il s’y rendit en partant d’une localité voisine d’Arbèles, en passant la rivière du Zab inférieur et en marchant toujours vers l’Orient. Si l’on examine attentivement le texte sacré, il est impossible d’admettre que dans la pensée de l’écrivain de la Genèse l’Ararat du déluge fût celui de l’Arménie. En effet, quelques versets plus loin[47], il est dit formellement que ce fut en marchant toujours de l’est à l’ouest que la postérité de Noa’h parvint dans les plaines de Schine’ar. Ceci s’accorde beaucoup mieux avec la donnée de la tradition chaldéo-babylonienne sur la montagne de Nizir comme point de départ de l’humanité renouvelée après le cataclysme. Mais il faut remarquer que si l’on prolonge davantage dans la direction de l’Orient, par delà les monts Gordyéens, la recherche d’un très haut sommet, comme celui où l’arche se fixe, on arrive à la chaîne de l’Hndou-Kousch, ou plutôt, encore aux montagnes où l’Indus prend sa course. Or, c’est exactement sur ce dernier point que convergent les traditions sur le berceau de l’humanité chez deux des grands peuples du monde antique, qui ont conservé les souvenirs les plus nets et les plus circonstanciés des âges primitifs, les récits les plus analogues à ceux de la Bible et des livres sacrés de la Chaldée, je veux dire les Indiens et les Iraniens. Dans, toutes les légendes de l’Inde, l’origine des humains est placée au mont Mêrou, résidence des dieux, colonne qui unit le ciel à la terre. Ce mont Mêrou a plus tard été déplacé à plusieurs reprises, par suite du progrès de la marche des Aryas dans l’Inde ; les Brahmanes de l’Inde centrale ont voulu avoir dans leur voisinage la montagne sacrée, et ils en ont transporté le nom d’abord au Kailâsa, puis au Mahâpantha (surnommé Soumôrou), et plus tardivement encore la propagation des doctrines bouddhiques chez les Birmans, les Chinois et les Singhalais, fit revendiquer par chacun de ces peuples le Mêrou pour leur propre pays. C’est exactement de même que nous voyons l’Ararat diluvien se déplacer graduellement, en étant fixé d’abord dans les monts Gordyéens, puis à l’Ararat d’Arménie. Mais le Mêrou primitif était situé au nord, par rapport même à la première habitation des tribus aryennes sur le sol indien, dans le Pendjab et sur le haut Indus. Et ce n’est pas là une montagne fabuleuse, étrangère à la géographie terrestre ; le baron d’Eckstein a complètement démontré son existence réelle, sa situation vers la Sérique des anciens, c’est-à-dire la partie sud-est du Thibet. Mais les indications des Iraniens sont encore plus précises, encore plus concordantes avec celles qui résultent de la Bible, parce qu’ils se sont moins éloignés du berceau primitif, qui n’a pas pris par conséquent pour eux un caractère aussi nuageux. Les souvenirs si précieux sur les stations successives de la race, qui sont contenus dans un des plus antiques chapitres des livres attribués à Zoroastre[48], caractérisent l’Airyana Vaedja, point de départ originaire des hommes et particulièrement des Iraniens, comme une contrée septentrionale, froide et alpestre, d’où la race des Perses descendit au sud vers la Sogdiane[49]. Là s’élève l’ombilic des eaux, la montagne sainte, le Harâ Berezaiti du Zend-Avesta, l’Albordj des Persans modernes, du flanc duquel découle le fleuve non moins sacré de l’Arvand, dont les premiers hommes burent les eaux. Notre illustre Eugène Burnouf a démontré, d’une manière qui ne laisse pas place au doute, que le Harâ Berezaiti est le Bolor, ou Belourtagh, et que l’Arvand est l’Iaxarte ou plutôt le Tarim[50]. Il est vrai, remarque M. Renan, que les noms de Berezaiti et d’Arvand ont servi plus tard à désigner des montagnes et des fleuves fort éloignés de la Bactriane : on les trouve successivement appliqués à des montagnes et à des fleuves de la Perse, de la Média, de la Mésopotamie, de la Syrie, de l’Asie-Mineure, et ce n’est pas sans surprise qu’on les reconnaît dans les noms classiques du Bérécynthe de Phrygie et de l’Oronte de Syrie. Ce dernier est particulièrement curieux, car nous le lisons déjà dans les inscriptions égyptiennes de la XVIIIe et de la XIXe dynastie, et il n’a certainement pas été apporté clans la Syrie septentrionale par des populations aryennes, mais par les Sémites. Les faits que nous venons de citer sont le produit du déplacement que subissent toutes les localités de la géographie légendaire des premiers âges. Les races, dit encore M. Renan, portent avec elles dans leurs migrations les noms antiques auxquels se rattachent leurs souvenirs, et les appliquent aux montagnes et aux fleuves nouveaux qu’elles trouvent dans les pays où elles s’établissent. C’est ce qui est arrivé aussi au nom d’Ararat. M. Obry a fait voir que la montagne que les tribus aryennes regardaient comme le berceau sacré de l’humanité, avait originairement porté dans leurs souvenirs le nom d’Aryâratha, char des vénérables, parce qu’à sa cime était censé tourner le char des sept Mahârschis brahmaniques, des sept Amescha-Çpentas perses et des sept Kakkabi chaldéens, c’est-à-dire le char des sept astres de la Grande Ourse. Ce nom d’Aryâratha est la source de celui d’Ararat, et c’est seulement plus tard que les premières tribus aryennes, qui vinrent en Arménie, le transportèrent au mont appelé aussi Masis. Ainsi la donnée biblique d’un Ararat primitif, situé très à l’est du pays de Schine’ar, coïncide exactement avec les traditions des peuples aryens. Nous voici donc reportés, par l’accord de la tradition sacrée et des plus respectables parmi les traditions profanes, au massif montueux de la Petite-Boukharie et du Thibet occidental, comme au lieu d’où sortirent les races humaines. C’est là que quatre des plus grands fleuves de l’Asie, l’Indus, le Tarîm, l’Oxus et l’Iaxarte prennent leur source. Les points culminants en sont le Beloustagh et le vaste plateau de Pamir, si propre à nourrir des populations primitives encore à l’état pastoral, et dont le nom, sous sa forme première, était Oupa-Mêrou, le pays sous le Mêrou, ou peut-être Oupa-mîra, le pays auprès du lac, qui lui-même avait motivé l’appellation du Mêrou. C’est encore là que certains souvenirs des Grecs nous forcent à tourner nos regards, particulièrement l’expression sacrée μέροπες άνθρωποι, qui ne peut avoir voulu dire originairement que les hommes issus du Mêrou. Les souvenirs d’autres peuples sur la patrie d’origine de leurs ancêtres convergent aussi dans la même direction, mais sans atteindre le point central, oblitérés qu’ils sont en partie par l’éloignement. Les Chinois se disent issus du Kouen-Iun. Les tribus mongoles, remarque M. Renan, rattachent leurs légendes les plus anciennes au Thian-Chan et à l’Altaï, les tribus finnoises à l’Oural, parce que ces deux chaînes leur dérobent la vue d’un plan de montagnes plus reculé. Mais prolongez les deux lignes de migration qu’indiquent ces souvenirs vers un berceau moins voisin, vous les verrez se rencontrer dans la Petite-Boukharie. Ces lieux ayant été le berceau de l’humanité postdiluvienne, les peuples qui en avaient’ gardé le souvenir furent amenés par une pente assez naturelle à y placer le berceau de l’humanité antédiluvienne. Chez les Indiens, les hommes d’avant le déluge, comme ceux d’après le déluge, descendent du mont Mêrou. C’est là que se trouve l’Outtara-Kourou, véritable paradis terrestre. C’est là aussi que nous ramène, chez les Grecs, le mythe paradisiaque des Méropes, les gens du Mêrou, mythe qui, transporté jusque dans la Grèce, s’y localisa dans l’île de Cos. Les Perses dépeignent l’Airyana Vaedja, situé sur le mont Harâ Berezaiti, comme un paradis exactement semblable à celui de la Genèse, jusqu’au jour où la déchéance des premiers pères et la méchanceté d’Angrômainyous le transforme en un séjour que le froid rend inhabitable. La croyance à un âge de bonheur et d’innocence par lequel débuta l’humanité, est en effet, nous l’avons déjà dit, une des plus positives et des plus importantes parmi les traditions communes aux Aryas et aux Sémites. Il n’est pas jusqu’au nom même de ‘Eden qui n’ait été à une certaine époque appliqué à cette région, car il se retrouve clairement dans le nom du royaume d’Oudyâna ou du jardin près de Kaschmyr, arrosé précisément par quatre fleuves comme le ‘Eden biblique. Il est vrai qu’étymologiquement et au point de vue de la rigueur philologique, ‘Eden et Oudyâna sont parfaitement distincts ; de ces deux noms l’un a revêtu une forme purement sémitique et significative dans cette famille de langues, l’autre une forme purement sanscrite et également significative. Mais c’est le propre de ces quelques noms de la géographie tout à fait primitive des traditions communes aux Aryas et aux Sémites, dont l’origine remonte à une époque bien antérieure à celle où les deux familles d’idiomes se constituèrent telles que nous pouvons les étudier, et dont l’étymologie réelle serait actuellement impossible à restituer, de se retrouver à la fois chez les Aryas et chez les Sémites sous des formes assez voisines pour que le rapprochement s’en fasse avec toute vraisemblance, bien que ces formes aient été combinées de manière à avoir un sens dans les langues des uns et des autres. Les plus anciennes traditions religieuses et les vieilles légendes du brahmanisme se rattachent au pays d’Oudyâna, qui certainement a été un des points où se sont localisées les traditions paradisiaques de l’Inde. Mais ce n’a été que par un déplacement vers le sud de la position du ‘Eden primitif, qui était d’abord plus au nord, quand les habitants de cette région prétendirent posséder le Mêrou dans leurs monts Nischadhas, d’où les compagnons d’Alexandre-le-Grand conclurent que c’était là le Mèros (μηρός, cuisse) de Zeus, où Dionysos avait été recueilli après le foudroiement de sa mère Sémélé. Il est à remarquer que Josèphe et les plus anciens Pères de l’Église furent conduits, par des raisons fort différentes de celles qui amènent la science moderne au même résultat, à placer le paradis terrestre du récit biblique à l’est des possessions sémitiques et même au delà, dans les environs de la chaîne de l’Imaüs ou Himalaya. La description du jardin de ‘Eden dans la Genèse est bien certainement un de ces documents primitifs, antérieurs à la migration des Hébreux vers la Syrie, que la famille d’Abraham apporta avec elle en quittant les bords de l’Euphrate, et que le rédacteur du Pentateuque inséra dans son texte, tels que la tradition les avait conservés. Il a trait à des pays dont il n’est plus question dans le reste de la Bible, et tout, comme dans d’autres morceaux placés également au début de la Genèse, y est empreint de la couleur symbolique propre à l’esprit des premiers âges. Dans le pays de ‘Eden est un jardin qui sert au premier couple humain de séjour ; la tradition se le représente sur le modèle d’un de ces paradis des monarques asiatiques, ayant au centre le cyprès pyramidal. Mais on ne saurait voir dans cette analogie un argument en faveur de l’opinion qui regarderait les récits relatifs au jardin de ‘Eden comme empruntés par les Juifs aux Perses, vers le temps de la captivité. En effet, si le nom des paradis des rois de l’Asie est purement iranien, zend paradâeçô, le type de ces jardins, comme la plupart des détails de civilisation matérielle des empires de Médie et de Perse, tire son origine des usages des antiques monarchies de Babylone et de Ninive, aussi bien que la relation de ces paradis artificiels avec les données des traditions édéniques. Ce qui prouve, du reste, d’une manière à notre avis tout à fait définitive, la haute antiquité du récit de la Genèse sur le jardin de ‘Eden et la connaissance qu’en avaient les Hébreux bien avant la captivité, c’est l’intention manifeste d’imiter les quatre fleuves édéniques, qui présida aux travaux de Schelomoh (Salomon) et de ‘Hizqiahou (Ezéchias) pour la distribution des eaux de Yerouschalaïm, considérée à son tour comme le nombril de la terre[51], au double sens de centre du globe et de source des fleuves. Les quatre ruisseaux qui arrosaient la ville et le pied de ses remparts, et dont l’un s’appelait Gi’hon comme un des fleuves paradisiaques, étaient réputés sortir de la source d’eau vive qu’on supposait placée sous le temple. Et en présence de cette dernière circonstance nous n’hésitons pas à mettre, avec Wilford, le nom de la montagne sur laquelle avait été construit le temple, Moriah, nom qui n’a aucune étymologie naturelle dans les langues sémitiques, en rapprochement avec celui du Mêrou, le mont paradisiaque des Indiens, regardé aussi comme le point de départ de quatre fleuves. En effet, suivant la Genèse, du pays de ‘Eden sort un fleuve qui arrose le jardin, puis se divise en quatre fleuves. Le nom du premier est Pischon ; il entoure toute la terre de ‘Havilah, où se trouve l’or ; l’or de ce pays est excellent ; là aussi se trouve le bedola’h, le budil’hu des textes cunéiformes, c’est-à-dire l’escarboucle, et la pierre schoham, dont les documents assyriens nous ont fait connaître la véritable nature et qui est le lapis-lazuli. Le nom du second fleuve est Gi’hon : il entoure toute la terre de Kousch. Le nom du troisième fleuve est ‘Hid-Deqel ; il coule devant le pays d’Asschour. Le quatrième fleuve est le Phrath[52]. Le Boundehesch pehlevi contient une description toute pareille ; et pourtant on ne saurait admettre ici un emprunt, ni de la Genèse aux traditions du zoroastrisme, ni du livre mazdéen à la Genèse ; d’où il faut bien conclure que l’un et l’autre ont également puisé à une vieille tradition qui remontait réellement aux âges voisins de la naissance de l’humanité. En combinant les données du Boundehesch avec celles des livres zends, d’une rédaction beaucoup plus ancienne, on arrive à compléter les noms des quatre fleuves que les Iraniens admettaient comme sortant à la fois de l’Airyana Vaedja : l’Arang-roût, primitivement Rangha (l’Iaxarte), fleuve appelé aussi Frât ; le Veh-roût, primitivement Vangouhi (l’Oxus) ; le Dei-roût ou antérieurement Arvand (le Tarîm) enfin le Mehrva ou Mehra-roût (l’Indus supérieur).
Localisation des données géographique de la Genèse sur le ‘Eden et les contrées environnantes, dans la région du Pamir[53]. Que la description biblique du jardin de ‘Eden se rapporte originairement à la même contrée que les autres traditions passées par nous en revue, la grande majorité des savants sont aujourd’hui d’accord sur ce point, et en effet bien des preuves l’établissent. C’est le lieu du monde où l’on peut dire avec le plus de vérité que quatre grands fleuves sortent d’une même source. Là se trouvent, comme autour du paradis de la Genèse, l’or et les pierres précieuses. Il est certain, d’ailleurs, que deux des fleuves paradisiaques sont les plus- grands fleuves qui prennent leur source dans le massif du Belourtagh et de Pamir, l’un vers le nord et l’autre au sud. Le Gi’hon est l’Oxus, appelé encore aujourd’hui Dji’houn par ses riverains ; la plupart des commentateurs modernes sont unanimes à cet égard. Le nom de Gi’hon présente, du reste, la même particularité que presque tous ceux de la géographie des traditions primitives ; sans que la forme s’en altère essentiellement, il prend un sens pour les peuples sémitiques et pour les peuples aryens. Pour les premiers il signifie le fleuve impétueux, pour les seconds le fleuve sinueux, tortueux. Le pays de Kousch, que baigne ce fleuve, semblerait être ainsi le séjour primitif de la race Kouschite, dont le berceau apparaîtrait à côté de celui des Aryas et des Sémites. Dans le Pischon, où la tradition a toujours vu un fleuve de l’Inde, il est difficile de méconnaître le haut Indus, et. le pays de ‘Havilah, qu’il longe, paraît bien être le pays de Darada,vers Kaschmyr, célèbre dans la tradition grecque et indienne par sa richesse, et où l’on trouve une foule de noms géographiques apparentés à celui de ‘Havilah.
Géographie des traditions paradisiaques des peuples iraniens[54]. Mais, d’un autre côté, les deux derniers fleuves paradisiaques de la Genèse, le ‘Hid-Deqel et le Phrath sont non moins positivement les deux grands fleuves de la Mésopotamie, le Tigre et l’Euphrate. Le nom du premier se présente dans le texte biblique avec sa forme de la langue non sémitique de Schoumer et d’Accad, telle que nous la lisons dans les documents cunéiformes, Hid-Diqla, le fleuve Tigre ; et l’indication qu’il coule devant le pays d’Asschour ne laisse pas de doute possible sur son identification. Quelques érudits, comme Bunsen et le baron d’Eckstein, en ont conclu que le ‘Eden biblique avait une bien plus grande étendue que le paradis des Indiens et des Iraniens, qu’il comprenait toute la vaste région qui va des montagnes d’où sortent l’Oxus et l’Indus, à l’est, aux montagnes d’où descendent le Tigre et l’Euphrate, à l’ouest, région fertile, tempérée, véritable séjour de délices situé entre des pays brûlés du soleil ou désolés par le froid. A ceci doit être objecté qu’en donnant une pareille étendue au sens géographique du nom de ‘Eden, on ne comprendrait plus comment il a été possible de regarder quatre fleuves, formant deux groupes aussi distants l’un de l’autre, comme sortant de la même source. D’ailleurs, il est encore une des indications du texte biblique sur un troisième des fleuves paradisiaques qui peut parfaitement s’entendre comme se rapportant à la Mésopotamie. C’est la mention de la terre de Kousch, qu’entoure le Gi’hon ; car on est en droit d’y voir le pays des Cosséens ou des Cissiens de la géographie classique, des Kasschi des textes cunéiformes, c’est-à-dire la contrée de ‘Elam.
Localisation des fleuves paradisiaques, dans la Mésopotamie[55]. Il est positif que, comme nous l’avons déjà signalé tout à l’heure, qu’un des noms religieux les plus antiques de Babylone est Tin-tir-kî, appellation accadienne qui veut dire le lieu de l’arbre de la vie. En même temps, le nom de Gan-Dounyasch, le jardin du dieu Dounyasch, donné à partir d’une certaine époque au district admirable de fertilité dont Babylone est le centre, offre une remarquable assonance avec le biblique Gan-’Eden ou jardin de ‘Eden. C’est en se fondant sur ces faits, et sur quelques autres qui viennent les confirmer, que sir Henry Rawlinson et M. Friedrich Delitzsch ont cherché à prouver que les Babyloniens avaient localisé là tradition édénique dans leur propre contrée, et que la narration biblique a aussi en vue la même donnée de situation. Et, en effet, il est facile de retrouver dans la Babylonie et la Chaldée quatre cours d’eau à qui l’on appliquera très bien les caractéristiques fournies par la Genèse pour ceux qui sortent du jardin de ‘Eden : d’abord les cours principaux de l’Euphrate et du Tigre, qui seront le Phrath et le ‘Hid-Deqel ; puis le Choaspès (appelé Sourappi dans les textes cunéiformes), qui coule le long da la contrée de ‘Elam où sont les Cosséens, et qui sera, par conséquent, le Gi’hon ; enfin le bras occidental de l’Euphrate (l’Ougni des documents indigènes), que l’on identifiera au Pischon, d’autant plus qu’il longe le désert de l’Arabie, auquel le nom de ’Havilah a pu être appliqué, en le prenant pour un terme sémitique signifiant un pays de sables, et qu’il est un fleuve qui dort au milieu des roseaux (en assyrien pisanni). Tout ceci est très vraisemblable. J’admets pleinement cette localisation de la tradition du ‘Eden dans la Babylonie et dans la Chaldée, et je reconnais qu’elle explique seule certains traits du texte de la Genèse. Mais elle n’a été sûrement que le résultat d’un transport de la donnée consacrée par de bien plus antiques souvenirs, qui avait pris naissance dans une contrée beaucoup plus reculée vers l’est. La conception du ‘Eden et de ses quatre fleuves a pu être appliquée aux plaines voisines du golfe Persique ; elle n’y a pas pris naissance, pas plus que dans le massif des montagnes de l’Arménie, où on l’a aussi naturalisée, trouvant les fleuves paradisiaques dans les quatre grands fleuves qui en sortent vers différentes directions, le Tigre et l’Euphrate (‘Hid-Deqel et Phrath), l’Araxe, auquel on a quelquefois appliqué le nom de Gi’hon, et le Kour ou bien le Phase, dont l’appellation paraît reproduire celle de Pischon. Il suffit de lire attentivement le texte biblique pour y discerner, sous les données qui ont trait aux fleuves de la Babylonie, d’autres plus anciennes qui ne peuvent s’appliquer à cette contrée et qui reportent forcément au même point de départ que les traditions de l’Inde et de l’Iran. C’est avant tout la donnée fondamentale de la conception géographique du Gan-’Eden, le cours d’eau unique qui entre dans le jardin pour l’arroser, et qui s’y divise de façon à sortir en quatre fleuves dans des directions divergentes. En Babylonie, nous avons exactement l’inverse, deux fleuves divisés en quatre rameaux qui entrent séparés dans le Gan-Dounyasch pour s’y réunir et en sortir en formant un seul cours d’eau. C’est ensuite l’indication des produits minéraux, métaux et pierres précieuses, du pays arrosé par le Pischon, qui sont bien plus ceux de la contrée de ‘Havilah du haut Indus que ceux de l’Arabie. Nous ne croyons pas cependant que l’on doive supposer, avec Ewald, que les noms de ‘Hid-Deqel et de Phrath, de Tigre et d’Euphrate, aient été, à une époque postérieure au déplacement de la tradition des fleuves paradisiaques, substitués à deux noms plus anciens, que l’on ne comprenait plus. Nous pensons au contraire, avec M. Obry, que ces noms, aussi bien que ceux de Gi’hon et de Pischon, sont du nombre des appellations qui, appartenant à la géographie traditionnelle des âges primitifs, ont été plus tard transportés dans l’ouest avec les migrations des peuples. Il nous semble probable qu’à l’origine il y a eu un Tigre et un Euphrate primitifs, parmi les fleuves sortant du plateau de Pamir. Remarquons que, dans la tradition des Persans, l’Arvand s’est confondu avec le Tigre, ce qui donne lieu de soupçonner l’existence antique, chez les Iraniens, d’un nom analogue à celui de ’Hid-Deqel parallèlement du nom de Arvand. Plus positive est la présence du nom de Frât dans les livres mazdéens parmi les désignations des fleuves paradisiaques. Pour le rédacteur de basse époque du Boundehesch, peut-être influencé ici par la donnée biblique, ce Frât est l’Euphrate de la Mésopotamie. Mais des preuves nombreuses établissent que plus anciennement la même appellation a été attachée à l’Helmend, l’Etymander des Grecs, lorsque la notion de la montagne sainte avec ses quatre fleuves se fut localisée dans la partie méridionale de l’Hindou-Kousch, au massif de l’Ouçadarena des livres zends, fameux comme le théâtre des révélations divines reçues par Zarathoustra (Zoroastre). Et, ceci étant, on peut encore avec certitude reporter le nom de Frât au point primitif où convergent toutes les traditions iraniennes sur le berceau de l’humanité. Une dernière circonstance achève de fixer le site originaire du ‘Eden biblique dans la région que nous avons indiquée, d’accord avec tant de savants illustres. C’est le voisinage de la terre de Nod ou d’exil, de nécessité, située à l’orient de ‘Eden, où Qaïn se retire après son crime et bâtit la première ville, la ville de ‘Hanoch[56], car elle paraît bien correspondre à la lisière du désert central de l’Asie, du désert de Gobi. C’est là que se trouve cette ville de Khotan, dont les traditions, enregistrées dans des chroniques indigènes, qui ont été connues des historiens chinois, remontaient beaucoup plus haut que celles d’aucune autre cité de l’Asie intérieure. Abel Rémusat, qui avait bien compris toute l’importance de ce que les Chinois racontent de cette ville et de ses souvenirs, y a consacré un travail spécial, auquel nous renverrons le lecteur[57]. Le savant baron d’Eckstein a fait ressortir tout ce qu’ont de précieux pour l’histoire primitive les renseignements qui y sont contenus ; il a montré dans Khotan le centre d’un commerce métallurgique qui doit être regardé comme un des plus antiques du monde, et il ne serait pas éloigné de rapporter à cette ville les récits de là Genèse sur la ‘Hanoch qaïnite. C’est donc bien au plateau de Pamir qu’a trait originairement le récit biblique sur le jardin de ‘Eden, aussi bien que la tradition iranienne de l’Airyanà Vaedja. Et l’assimilation des fleuves paradisiaques à ceux de cette contrée doit être faite de la manière suivante : Gi’hon=Oxus ; Pischon=Indus ; ’Hid-Deqel=Tarîm ; Phrath=Iaxarte. Mais dans la forme ou nous possédons ce récit, au premier fond de la description traditionnelle, qui avait en vue cette région lointaine, se sont superposés certains traits empruntés à la Chaldée, lesquels se rattachent à une localisation postérieure de la donnée du paradis terrestre sur le cours inférieur du Tigre et de l’Euphrate. Du reste, les Chaldéens, s’ils paraissent bien avoir transplanté dans leur propre pays, comme beaucoup d’autres peuples, l’antique tradition édénique, n’en avaient pas moins conservé, eux aussi, bien des restes de la forme plus ancienne de ces souvenirs, de celle qui les reportait à leur véritable berceau. La conception de la montagne sainte et paradisiaque située au nord, plus haute que toutes • les autres montagnes de la terre, colonne du monde autour de laquelle tournent les sept étoiles de la Grande-Ourse, assimilées aux, sept corps planétaires, cette conception qui est celle du Mêrou, du Harâ-Berezaiti et de l’Aryâratha primitif, a été certainement connue et admise, des Chaldéens. C’est ce que prouve surabondamment l’admirable et si poétique morceau du prophète Yescha’yahou (Isaïe [XIV, 4-20]) sur la chute de l’orgueilleux monarque de Babylone, de cet astre du matin, fils de l’aurore, de cet oppresseur des nations qui s’était vanté de ne pas descendre, à l’exemple des autres rois, dans les profondeurs du schéôl[58], mais d’aller s’asseoir au-dessus des étoiles du Dieu fort et de prendre place à côté du Très-Haut sur la montagne de l’Assemblée (har môad) dans le Septentrion. Théodoret, natif de Syrie et profondément imbu de traditions orientales, dit à cette occasion : On rapporte qu’il y a au nord des Assyriens et des Mèdes une haute montagne qui sépare ces peuples des nations scythiques, et que cette chaîne est la plus haute de toutes les montagnes de la terre. Il applique donc la notion de la montagne à laquelle le prophète fait allusion, précisément au sommet sur lequel les Iraniens de la Médie avaient transporté et localisé leurs souvenirs bien antérieurs sur la montagne sainte, le Harâ Berezaiti ; car Théodoret a eu certainement en vue l’Elbourz du sud de la Mer Caspienne, si important par ses traditions mythiques, qui avait été connu des Assyriens dès le IXe siècle av. J.-C. sous son nom perse de Hâra-Barjat, altéré en Hâla-Barjat par la prononciation particulière aux Mèdes[59]. La donnée dont nous parlons a été conservée, comme tant d’autres débris des croyances religieuses de la Chaldée et de la Babylonie, par les Sabiens ou Mendaïtes, qui mariaient le culte des sept planètes à l’adoration des sept astres de la Grande-Ourse, dans leur célébration des mystères du Nord sur la haute montagne du Septentrion, réputée le séjour du Seigneur des lumières, du père des génies célestes. Il est bien souvent question, dans les textes cunéiformes, de cette montagne sainte où se rassemblent les dieux, où est la source des eaux terrestres et qui sert de pivot aux mouvements célestes. On qualifie ce mont de père des pays (en assyrien abu matâti), preuve certaine de ce qu’on y rattachait les origines de l’humanité. C’est le point culminant de la convexité de la surface de la terre, d’où son appellation de montagne de la terre (en accadien gharsak kalama). Par rapport à la Chaldée et à l’Assyrie, on la considère comme située dans le nord-est, à côté du pays mystérieux d’Arali, célèbre par la quantité d’or qu’il produit, et où est placée la résidence des morts. Aussi la désigne-t-on encore comme la Montagne de l’Orient (en accadien gharsak kurra, en assyrien sémitiques chad schadî). C’est à l’imitation de cette montagne sainte que les Chaldéens des plus anciennes époques, dans les plaines absolument sans une ondulation où l’Euphrate et le Tigre terminent leurs cours, faisaient de leurs temples de véritables montagnes artificielles, leur donnant typiquement et rituellement la forme d’une haute pyramide à degrés, que surmontait un petit sanctuaire. Les paradis des monarques perses, parcs ombreux, plantés d’arbres, ornés de viviers, et placés en général au sommet de hauteurs, dont le nom signifiait lieu élevé, endroit délicieux (sanscrit paradêças, zend paradâeço), et était déjà connu des populations de la Syrie et de la Palestine au temps où fut écrit le Cantique des cantiques (IV, 13), ces paradis étaient pour les rois iraniens,qui en entouraient leurs palais, une image et une imitation du céleste paradis d’Ahouramazda, planté sur le Harâ Berezaiti. Mais ce type particulier et symbolique de jardins, avec l’idée qui s’y attachait, n’était pas exclusivement propre aux monarques iraniens de la Médie et de la Perse ; avant eux les rois d’Assyrie et de Babylone, dont ils copiaient presque tous les usages, avaient eu des « paradis » semblables. Il est même à remarquer que le type le plus parfait et le plus paradisiaque, dans le sens de l’imitation du jardin légendaire de la montagne sainte, berceau des hommes, en avait été donné à Babylone, dans les fameux jardins suspendus, que tous les auteurs décrivent comme une montagne artificielle, élevée jusqu’à une très grande hauteur sur des étages voûtés, couverte d’arbres de la plus forte dimension sur son sommet et sur ses terrasses latérales, et où des machines hydrauliques, placées aux quatre angles et puisant l’eau de l’Euphrate, entretenaient sur la plate-forme culminante des viviers et des courants d’eau, destinés bien évidemment à reproduire, les courants d’eau du paradis traditionnel. Cependant du fait seul des jardins suspendus il n’y aurait pas de conséquence à tirer, car Bérose, Diodore de Sicile et Quinte-Curce racontent tous les trois une historiette d’après laquelle ce serait pour complaire à sa femme, princesse mède de naissance, et lui rappeler son pays, natal, que Nabou-koudourri-ouçour (Nabuchodonosor) aurait créé ces jardins fameux, regardés depuis comme une des merveilles du monde. On serait donc en droit de supposer par là que ce prince avait transporté à Babylone un usage purement iranien, inconnu jusqu’alors à la civilisation chaldéo-assyrienne. Mais un monument assyrien d’époque antérieure vient répondre à cette objection. C’est un bas-relief du palais du roi Asschour-bani-abal, à Koyoundjik (première moitié du VIIe siècle av. J.-C.) ; on y voit un paradis royal attenant à un palais, planté de grands arbres, situé au sommet d’une éminence prolongée par un jardin suspendu que soutiennent des arcades, et arrosé par un cours d’eau unique, qui se divise en plusieurs canaux sur le flanc de. la montagne, comme le fleuve du ’Eden biblique, la fontaine divine Ghe-tim-kour-koû de la Montagne de la Terre des Chaldéens, la source Arvanda ou Ardvî-çourâ du Harâ-Berezaiti iranien, et la Gangâ du Mêrou des Indiens. § 6. — LE PATRIARCHE SAUVÉ DU DÉLUGE ET SES TROIS FILS. Nous avons déjà fait remarquer plus haut que les narrations chaldéennes, telles que nous les connaissons par les fragments de Bérose et par le texte original déchiffré sur les tablettes cunéiformes du Musée Britannique, réunissaient, sur le personnage du juste sauvé du déluge, ce que la Bible raconte de Noa’h et de ‘Hanoch. Après être sorti de son vaisseau et avoir offert le sacrifice de la nouvelle alliance, ‘Hasis-Adra est enlevé par les dieux et transporté dans un lieu retiré, où il jouit du privilège de l’immortalité, de même qu’après 365 ans de vie où il marcha avec Dieu, ‘Hanoch ne fut plus vu, car Dieu l’avait pris[60]. Le rénovateur de l’humanité après le cataclysme tient une place considérable dans les souvenirs traditionnels delà race aryenne[61], et le plus souvent il s’y confond avec le premier père du genre humain. La distinction des auteurs des deux humanités successives n’y apparaît un peu nettement que dans la formation du nom du Deucalion des Grecs, qui, étymologiquement, paraît avoir signifié le second excellent, béni. Dans le récit indien du déluge, le héros sauvé par la protection du poisson divin est Manou, dont le nom a été d’abord un terme désignant l’homme en général, en tant que l’être intelligent, pensant, avant de devenir l’appellation spéciale d’un personnage mythique. Ce Manou s’est modifié et multiplié plus tard sous diverses formes dans la mythologie indienne. Déjà le Rig-Vêda en distingue plusieurs, et, dans la suite, on en a compté jusqu’à sept, dont chacun présidé à un manvantara ou période du monde. Le principal, et le seul qui doive nous occuper ici, est le Manou, surnommé Vâivasvata, parce qu’on en fait le fils de Vivasvat, c’est-à-dire du Soleil, et le frère de Yama, le dieu des morts, qualifié aussi de Vâivasvata. Le Rig-Véda parle plusieurs fois de ce Manou comme du père des hommes, qui sont appelés Manôr apatya, la descendance de Manou, et lui-même y reçoit le titre de père par excellence, Manouschpitar. Il a donné aux humains la prospérité et le salut, et il leur a indiqué de bienfaisants remèdes. Le premier il a sacrifié aux dieux, et son sacrifice est devenu le prototype de tous ceux des générations postérieures. On a souvent signalé la remarquable coïncidence de cette tradition indienne avec celle des anciens Germains, qui,- au témoignage de Tacite, se disaient issus de Mannus, fils de Tuiscon ou Tuiston, dieu issu de la Terre. Si de la Germanie nous passons à la Grèce, nous trouverons dans le personnage mythique de Minos un autre représentant du Manou indien, mais considérablement modifié par les traditions helléniques. Il ne s’agit plus ici, en effet, du premier homme ni du juste sauvé du déluge, mais d’un roi fabuleux des anciens âges, fils de Zeus, qui régnait sur l’île de Crète, et qui le premier donna de sages lois aux Hellènes. A ces divers égards, et sauf la localisation postérieure de sa légende, il rappelle certainement le Manou roi et législateur. Cela ne suffirait pas, toutefois, à autoriser un rapprochement, si Minos, comme juge des morts ne touchait pas par d’autres points aux traditions indo-iraniennes. Chez les Indiens, c’est Yama qui règne survies morts, tandis que son corrélatif iranien Yima, fils de Vivanghvat (le Vivasvat indien), est comme Manou le premier roi législateur, l’ordonnateur de la société humaine. Les rôles se sont ainsi intervertis de plusieurs manières entre les deux frères Manou et Yama, ce qui s’explique par leur identité primitive, que la science a établie d’une manière irréfragable. Tous deux représentent le premier homme, car il est dit de Yama que le premier il a passé par la mort pour entrer dans le royaume des Mânes. Minos aussi ne devient juge aux enfers qu’après sa mort, et il partage cet office avec Rhadamanthe, dont le nom signifie celui qui brandit la verge, épithète caractéristique du rôle de juge, que la poésie indienne donne à Yama. Il réunit ainsi dans sa personne les traits propres à ce dernier, et ceux du Manou de l’Inde et du Yima de l’Iran, rois et législateurs. En même temps, la transformation, que nous venons de saisir sur le fait, du premier homme qui a passé par la mort en un dieu qui règne sur le royaume des ombres, nous explique comment les Gaulois, au rapport de César, prétendaient tirer leur origine d’un dieu funèbre, que le Romain a traduit par Dis Pater ou Pluton. Windischmann a encore retrouvé dans les traditions de l’Inde un autre personnage qui, par certains points, présente un remarquable parallélisme avec le Noa’h de la Bible. C’est Nahouscha qui, comme Manou, est une sorte de personnification symbolique de l’homme, idée exprimée par son nom même, et un ancêtre de l’humanité, que le Rig-Véda appelle souvent race de Nahouscha. On le représente comme fils de Manou, comme spécialement adonné au culte de Soma, le dieu de la boisson enivrante qui, pour les Aryas primitifs, était le succédané du vin ; ses biens deviennent la conquête de ce dieu. Ceci rappelle bien étroitement Noa’h plantant la vigne et s’enivrant du jus de son fruit[62] ; et il semble que dans la Bible le patriarche Noa’h réunisse sur sa tête deux traditions qui dans l’Inde se divisent entre Manou et Nahouscha. Quant cà l’assonance entre les noms de Noa’h et de Nahouscha, elle n’est peut-être pas seulement fortuite, bien que ces deux appellations aient, l’une en hébreu, l’autre en sanscrit, dés significations parfaitement déterminées et absolument différentes, il est, au contraire, probable, que nous avons ici un nouvel exemple de la façon dont les noms des traditions primitives, en étant adoptés par des peuples de race différente, gardent le même son, la même physionomie extérieure, mais se différencient pourtant de façon à prendre un sens dans la langue de chacun de ces peuples, un sens qui s’éloigne du tout au tout d’une nation à l’autre, et qui n’est peut-être nulle part celui qu’avait réellement à l’origine le nom qui subit ces métamorphoses. Je réserve pour le livre suivant l’étude du tableau des personnifications de peuples que la Genèse énumère comme descendues des trois fils de Noa’h, ‘Ham, Schem et Yapheth, ainsi que de la signification ethnique qui en résulte pour chacun d’eux. Les trois fils de Noa’h sont, en effet, les ancêtres et les représentants des trois grandes races entre lesquelles se divise l’humanité postdiluvienne, la descendance du rénovateur de l’espèce humaine après le cataclysme. Mais sans entrer encore dans l’examen de cette question ethnographique, qui trouvera mieux sa place lorsque nous parlerons des principales races des hommes, de celles particulièrement qui ont leur place dans l’histoire ancienne de l’Orient, il importe de remarquer ici le parallélisme frappant qu’offrent, dans la façon dont elles se terminent, les deux généalogies bibliques des Schethites et des Qaïnites. Après Lemech, la lignée de Qaïn se divise entre trois chefs de races ; celle de Scheth présente le même fait après Noa’h ; et il est difficile de ne pas en voir encore un reflet dans la façon dont la généalogie biblique des descendants de Scheth par Arphakschad, à la fin de la période qui s’étend du déluge à Abraham, nous offre aussi la triple division des fils de Tera’h[63], chefs et pères des nations s’ils ne le sont phis de grandes races. La donnée fondamentale, plus nette que partout ailleurs dans les fils de Noa’h, est celle d’une répartition de l’humanité en trois familles ethniques. C’est aussi celle qu’admettaient les Égyptiens, pour qui les hommes formaient trois races, les ‘Amou et les Tama’hou ou Ta’hennou, correspondant exactement aux familles, de Schem et de Yapheth dans le récit biblique, et les Na’hasiou, c’est-à-dire les nègres. Il est vrai que les Égyptiens se mettaient à part de ces trois divisions de l’humanité, sous le nom de Rot, la race par excellence, s’attribuant une origine plus relevée que celle des autres hommes. Dans les antiques traditions iraniennes nous trouvons aussi la division tripartite des races humaines, personnifiées dans trois ancêtres issus d’un même père. Ce sont les fils de Thraetaona, l’un des premiers Paradhâtas, des héros des premiers jours de l’humanité, celui qui succède à la domination impie de Azhi-Dahâka, personnification terrestre du principe mauvais. Les anciens livres zends nomment ces trois frères, chefs de races, Çairima, Toûra et Arya, qui deviennent Selm, Tour et Eradj dans l’épopée traditionnelle de la Perse moderne. Çairima correspond au Schem de la Bible, dont son nom n’est qu’une variante ; celui d’Arya s’applique à la même famille ethnique que Yapheth dans la Genèse. Mais à ‘Ham, père d’une race avec laquelle les Iraniens n’avaient plus depuis longtemps de contact direct à l’époque où furent composés les livres sacrés du mazdéisme, ces livres substituent Toûra, personnification des peuples turcs, qui n’ont pas de représentant dans le tableau ethnographique du chapitre X de la Genèse, non plus que les nègres, l’une des races essentielles du système égyptien. Nous sommes ainsi amenés à mettre en regard des trois fils de Noa’h les trois fils de Thraetaona, qui leur correspondent dans les traditions religieuses de l’Iran, et les grandes races humaines telles que les reconnaissaient les Égyptiens[64].
Les Sabiens ou Mendaïtes, dans leurs livres sacrés, parlent des trois frères Schoum, Yamin et Yaphet, mais on ne saurait dire si la tradition leur en vient de source babylonienne ou bien est chez eux le résultat d’une infiltration juive ou chrétienne. En revanche, dans les fragments de Bérose, qui, eux, représentent exactement les récits qui se lisaient dans les livres des Chaldéens, il est question de trois frères à demi divins, qui ont régné presque aussitôt après le déluge, et que dès les premiers siècles chrétiens les Pères de l’Église comparaient à Schem, ‘Ham et Yapheth. Ce sont Cronos, Titan et Prométhée, que l’auteur des Chaldaïques représentait comme trois frères ennemis se faisant la guerre. Malheureusement on n’a pas encore jusqu’à présent retrouvé de rédaction cunéiforme originale de cette histoire, qui fasse connaître quels étaient les noms assyriens que Bérose a ainsi traduits en grec, s’ils étaient identiques à ceux de la Genèse ou s’ils en différaient. Moïse de Khorène, l’historien national de l’Arménie, développe un peu davantage le récit de l’hostilité des trois frères, en disant qu’il l’emprunte à Bérose ; mais en employant pour désigner ses personnages des noms différents de ceux que nous lisons dans les fragments grecs de l’historien de Babylone. Avant la construction de la tour et la confusion du langage des hommes, dit-il, mais après la navigation de Xisouthros jusqu’à l’Ararat, les trois frères Zéro van, Titan et Yapedosthê se partagèrent la domination de la terre. Et ils me semblent les mêmes que Schem, ‘Ham et Yapheth. Quand ils se furent partagés l’empire de toute la surface terrestre, Zérovan, enflammé d’orgueil, voulut dominer sur les deux autres. Titan et Yapedosthê résistèrent à sa violence et lui firent la guerre, parce qu’il voulait instituer ses fils comme rois sur tous les hommes. Et pendant cette guerre, Titan occupa une partie des limites héréditaires de Zerovan. Alors leur sœur Astlik[65] s’interposa entre eux, calma par ses séductions leur querelle et les amena à convenir que Zerovan aurait la primauté. Mais les deux autres frères arrêtèrent, en se liant par des serments, qu’ils tueraient désormais tous les enfants mâles de Zerovan, pour éviter que sa postérité ne continuât sa domination. Pour réaliser ce projet, ils chargèrent quelques-uns des plus actifs parmi les compagnons de Titan de surveiller les accouchements des femmes. C’est ainsi qu’ils mirent à mort, conformément à leur serment, deux des enfants de Zerovan. Mais enfin Astlik, après s’être concertée avec les femmes de Zerovan, parvint à persuader à quelques-uns des serviteurs de Titan de laisser vivre les autres enfants et de les transporter dans l’Orient, sur la montagne de l’assemblée des dieux. Moïse de Khorène n’a certainement pas pris ceci dans un texte écrit en grec, dans les extraits directs de l’ouvrage de Bérose. Sa source était déjà arménienne, et les noms grecs qui désignaient les personnages du mythe dans le livre du prêtre chaldéen contemporain des Séleucides, y étaient traduits et déguisés sous une forme tout, iranienne. Zerovan est bien évidemment le zend zarvan, temps, et cette appellation s’est formée sur le modèle du Zrvâna-akarana, le Temps incréé, infini, des livres mazdéens. Yapedosthê est un superlatif (sanscrit djâpatista) du nom arien de Djâpati, le chef de la race, qui a été la source du biblique Yapheth ; c’est donc le chef de la race par excellence. Cette formation confirme l’opinion d’Ewald et de Pictet, attribuant une origine aryenne au nom du personnage dont la Bible fait l’ancêtre des Aryas, nom connu du reste aussi dans la tradition grecque, tandis que ceux de Schem et de ‘Ham sont purement sémitiques. Tout ceci doit être le résultat d’un travail, en partie basé sur des traditions encore existantes,que le récit traduit d’abord des tablettes chaldéennes en grec par Bérose aura subi à une certaine époque pour reprendre une forme orientale, en passant de nouveau du grec dans une dés langues de l’Asie. Nous n’hésitons pas à rapporter un tel travail aux deux premiers siècles de l’ère chrétienne et aux savants de l’école d’Édesse, à laquelle appartenait certainement — bien qu’il ait prétendu attribuer une antiquité apocryphe à son livre — le Mar-Abas Katina dont Moïse de Khorène a fait son guide pour les époques antiques de l’histoire d’Arménie. Des noms grecs que Bérose avait employés, Titan n’a pas été changé ;Cronos, par suite des idées d’antiquité prodigieusement reculée qui s’attachent toujours à ce nom, a été très naturellement remplacé par Zerovan ; quant à Prométhée, l’échange de son nom avec celui de Yapedosthê est tout naturel, si l’on se souvient des mythes helléniques qui font de Prométhée le fils de Iapétos. Eh traduisant sous une forme grecque les noms de la tradition ethnologique que lui offraient les documents babyloniens, Bérose la rapprochait de la très antique tradition hellénique d’après laquelle Cronos et Iapétos étaient également deux Titans, fils d’Ouranos et de Gaia, et Iapétos devenait le père d’Atlas, de Menoitios (Manou), de Prométhée et d’Épiméthée, c’est-à-dire la souche de l’humanité primitive. L’emploi du nom de Prométhée par Bérose semble indiquer positivement que celui de Yapheth existait dans les traditions chaldéennes comme dans la Bible. Et, d’un autre côté, l’importance du cycle des fables relatives à Iapétos a été depuis longtemps reconnue par la science comme un des points de contact les plus frappants entre les mythes helléniques relatifs aux premiers âges et la narration de la Genèse. Au reste, il faut remarquer que chez les Grecs les Titans, en général, sont représentés comme les premiers éducateurs du genre humain, ou que, suivant d’autres légendes, les hommes sont issus du sang des Titans. § 7. — LA TOUR DES LANGUES. Les traditions parallèles à celles de la Bible, que nous avons jusqu’à présent examinées, avaient un caractère véritablement universel ; elles se retrouvaient dans tous les rameaux supérieurs de l’humanité Noa’hide ; chez les peuples des races et des contrées les plus diverses. Il n’en est plus de même pour celle de la confusion des langues et de la Tour de Babel. Celle-ci a pour théâtre, dans la Bible, les plaines de Schine’ar ou de la Chaldée, et elle est particulière aux habitants de cette contrée ou aux peuples qui en sortirent à une époque historiquement appréciable. Le récit de la Tour des langues existait dans les plus anciens souvenirs des Chaldéens, et il faisait aussi partie des traditions nationales de l’Arménie, où. il était venu des nations civilisées du bassin de l’Euphrate et du Tigre. Mais nous ne trouvons rien de semblable ni dans l’Inde, ni dans l’Iran. Chez les Grées seuls, nous constatons un trait manifestement parallèle, venu on ne sait par quelle voie, dans la légende des Aloades, que nous avons déjà racontée plus haut (p. 55), en parlant des traditions relatives aux géants. On prétend, en effet, qu’ils ont commencé à élever une tour dont le sommet, dans leur projet, doit atteindre jusqu’au ciel, lorsque les dieux, enfin las de leur arrogance et de leur audace, les foudroient et les précipitent dans le Tartare. Les extraits de Bérose offrent deux versions, très exactement concordantes entre elles, de l’histoire de la construction de la Tour et de la confusion des langues. Voici d’abord celle d’Abydène : On raconté que les premiers hommes, enorgueillis outre mesure par leur force et leur haute taille, en vinrent à mépriser les dieux et à se croire supérieurs à eux ; c’est dans cette pensée qu’ils élevèrent une tour d’une prodigieuse hauteur, qui est maintenant Babylone. Déjà elle approchait du ciel, quand les vents vinrent au secours des dieux et bouleversèrent tout l’échafaudage, en le renversant sur les constructeurs. Les ruines en sont appelées Babylone, et les hommes, qui avaient jusqu’alors une seule langue, commencèrent, depuis lors à parler, par l’ordre des dieux, des idiomes différents. La rédaction d’Alexandre Polyhistor dit : Lorsque les hommes avaient encore une seule langue, quelques-uns d’entre eux entreprirent de construire une tour immense, afin de monter jusqu’au ciel. Mais la divinité, ayant fait souffler les vents, renversa la tour, bouleversa ces hommes et donna à chacun une langue propre ; d’où la ville fut appelée Babylone. Parmi les fragments des tablettes cunéiformes provenant de Ninive et conservées au Musée Britannique, on a reconnu un lambeau d’une rédaction originale de ce récit. Il est déplorablement mutilé, mais cependant il en reste encore assez pour qu’on soit bien assuré du sujet, et même pour que l’on puisse constater que cette narration, dans les circonstances les plus essentielles, était en parfaite conformité avec les extraits de Bérose. Au reste, dans la Genèse, le récit relatif h la Tour de Babel n’a pas seulement la Chaldée pour théâtre ; il porte dans sa rédaction même l’empreinte incontestable et manifeste d’une origine chaldéenne. On y trouve jusqu’à un jeu de mots qui ne peut s’expliquer que par l’analogie des mots zikru, souvenir, nom, et zikurat, tour, pyramide à étages, dans la langue assyrienne, et dont l’idiome hébraïque né rendrait compté en aucune façon. Le déchiffrement des inscriptions cunéiformes, en nous faisant connaître le nom indigène de Babel ou Babylone sous sa forme authentique, lui assigne une toute autre étymologie que celle qui semblerait ressortir du texte de la Bible ; c’est Bab-Ilou, la porte du dieu Ilou. L’explication par babel, confusion, est donc le résultat d’une allitération inspirée par les récits qui s’attachaient à ce lieu. Mais cette explication factice est d’origine chaldée-babylonienne et non juive ; car le mot babel, sur lequel elle repose, n’appartient pas à l’hébreu ; c’est un vocable de l’idiome sémitique qui se parlait à Babylone et à Ninive. La tradition de la Tour et de la confusion des langues est, du reste, indépendante : de cette étymologie et même de toute localisation de ce souvenir à Babylone. L’opinion des Chaldéens paraît avoir varié sur le lieu où les premiers habitants de leur pays avaient élevé ce monument fameux de leur orgueil. Il résulte d’une précieuse glose introduite dans le. texte du prophète Yescha’yahou (Isaïe [IX, 10]) par la version des Septante et de nombreux passages des anciens Pères de l’Église, qu’une, des formés du récit plaçait la Tour des langues dans la ville de la Chaldée méridionale, que la Bible appel Kalneh ou Kalno, et les documents cunéiformes Koul-ounou ; c’était un souvenir dés âges reculés où la civilisation de l’Euphrate et du Tigre avait eu pour foyer principal les provinces les plus voisines du golfe Persique, le pays auquel appartient en propre le nom de Schoumer ou Schine’ar. Cette incertitude sur le site de-la tour ou de la pyramide à étages, à la construction de laquelle était lié le châtiment divin de la confusion du langage des hommes, prouve que l’on considérait ce monument légendaire comme ayant été totalement renversé par la colère céleste, comme ayant disparu sans laisser de vestiges appréciables. Jusqu’aux premiers siècles chrétiens, en effet, on ne voit nulle part que l’on prétendît, ni à Babylone, ni dans aucune autre ville de la Chaldée, montrer les ruines de la Tour de Babel. Ce sont seulement les docteurs juifs des écoles mésopotamiennes où se forma le Talmud de Babylone, qui eurent l’idée d’en retrouver les restes dans les gigantesques ruines de la pyramide de Borsippa, appelées aujourd’hui Birs-Nimroud. Ce qui les y induisit fut seulement l’impression de désolation et de majestueuse grandeur qu’éveille la vue de cette énorme montagne de décombres, la plus imposante ruine de la contrée de Babylone. Mais en réalité aucune tradition ancienne ne justifiait le nom glorieux dont lés docteurs juifs gratifièrent la pyramide de Borsippa. C’était un édifice religieux de date fort ancienne, consacré au dieu Nabou, que Nabou-koudourri-ouçour (Nabuchodonosor), au VIe siècle avant notre ère, trouva en ruines, qu’il restaura et rebâtit en grande partie. Il a consacré des inscriptions pompeuses à léguer à la postérité le souvenir de cette reconstruction ; il y parle des traditions qui se rattachaient h l’origine du monument, mais il ne souffle pas mot de celle de la confusion des langues, dont il n’aurait pas manqué de faire mention si elle y avait été appliquée. C’est donc à tort que beaucoup de modernes ont attaché foi à une prétendue tradition, qui est toute artificielle, de date récente, et ne repose sur rien de sérieux. Le vrai est qu’il faut renoncer à voir dans le Birs-Nimroud ou dans toute autre ruine subsistant aujourd’hui le long du cours inférieur de l’Euphrate, les restes de la Tour de Babel. |