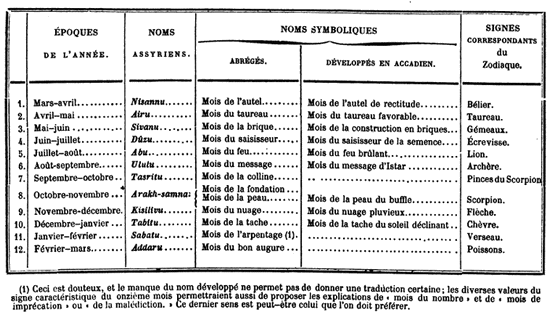LES PREMIÈRES CIVILISATIONS
TOME SECOND. — CHALDÉE & ASSYRIE. - PHÉNICIE
III. — CHALDÉE ET ASSYRIE
LE DÉLUGE ET L'ÉPOPÉE BABYLONIENNE[1].
|
Peu de découvertes scientifiques ont eu plus de retentissement que celle du récit babylonien du déluge, qui vient d'être faite par un jeune employé du Musée Britannique, M. Georges Smith, parmi les documents si précieux et si variés en écriture cunéiforme que possède le riche dépôt à la garde duquel il est attaché, et qui proviennent des fouilles de M. Austen-Henri Layard, actuellement ambassadeur d'Angleterre à Madrid. Avec l'intérêt passionné qu'ils apportent à tout ce qui touche à la Bible, les Anglais s'en sont émus comme d'un véritable événement. En quelques jours, M. Smith, qui n'était connu que des savants spéciaux pour des travaux assyriologiques, a conquis une renommée populaire dans les Trois Royaumes. Il a été le lion du jour, et un grand journal anglais, le Daily Telegraph, lui a confié la mission d'aller, à ses frais, exécuter de nouvelles fouilles, sur une vaste échelle, en Assyrie et en Chaldée[2]. Le journal anglais a été jaloux de surpasser ce qu'a fait dernièrement le New-York Herald, quand il a envoyé M. Stanley dans le centre de l'Afrique, à la recherche du docteur Livingstone, et ce sera certainement un des faits les plus extraordinaires de l'histoire de la presse anglo-saxonne dans notre siècle, que ce rôle nouveau qu'elle tend à prendre également en Angleterre et aux États-Unis, substituant son initiative à celle des gouvernements dans les grandes entreprises qui intéressent le progrès de la science. Rien ne pouvait honorer davantage le journalisme anglais et américain, et pareil spectacle est de nature à nous faire faire de tristes retours sur l'esprit de notée propre presse. Le retentissement de la découverte de M. Smith ne s'est pas borné, du reste, à l'Angleterre. Tous les organes de la publicité, en Europe et au delà de l'Atlantique, s'en sont occupés avec plus ou moins de compétence. En France, spécialement, le Journal officiel a traduit en entier l'article dans lequel le savant anglais a fait connaître sa découverte en analysant une partie du document trouvé par lui et en donnant la traduction intégrale de la portion directement relative au déluge. M. Oppert y a consacré la première leçon de son cours au Collège de France. L'importance de la découverte justifie cet éclat de renommée : non pas, à dire le vrai, qu'elle apporte aucune preuve ou aucun argument nouveau pour ou contre l'authenticité de la tradition biblique. A ce point de vue, le public anglais, sous l'empire de ses préoccupations habituelles, s'en est fort exagéré la valeur. Mais ce qui y donne un prix extrême, ce sont les lumières inattendues qu'elle jette sur les idées religieuses des Babyloniens et leurs traditions relativement aux âges primitifs de l'humanité ; c'est le fait qu'elle révèle de l'existence, à Babylone, d'une grande légende épique comparable à celle de l'Inde ; ce sont les aperçus absolument nouveaux qu'elle ouvre sur une des plus vieilles littératures poétiques du monde, dont l'existence n'était même pas soupçonnée, et dont elle nous rend un morceau capital. Sous ce triple aspect, on peut dire que M. Smith a eu l'heureuse fortune d'attacher son nom à l'une des plus belles et des plus fécondes trouvailles qui aient illustré la carrière de la science de création nouvelle à laquelle on a donné le nom d'assyriologie. Le déchiffrement de l'écriture cunéiforme de Ninive et de Babylone, dû aux patients efforts et au génie pénétrant de Hincks, de sir Henri Rawlinson et de M. Oppert, n'avait pas encore amené de plus précieuse conquête sur les ténèbres d'un passé avec lequel l'Égypte seule peut rivaliser d'antiquité. Les documents étudiés par le jeune assyriologue de Londres ne sont encore que très-incomplètement publiés. M. Smith a seulement fait paraître, avec sa traduction et quelques brèves remarques, deux planches photographiques exécutées d'après les fragments des tablettes d'argile où il a déchiffré le récit du déluge[3]. Pour y distinguer quelque chose, il faut une grande pratique de la paléographie particulière à ce genre de documents, où l'écriture a un aspect très-différent de celui des inscriptions monumentales. La connaissance du caractère des inscriptions, adopté par la typographie et dont on s'est rapproché le plus possible, avec raison, dans les grandes publications lithographiques exécutées jusqu'à ce jour par les ordres des Trustees du Musée Britannique, ne suffit pas pour être en mesure de lire ces photographies ; il faut y joindre une habitude de l'écriture cursive, impossible à acquérir pour ceux qui se trouvent obligés de travailler exclusivement sur les livres, sans avoir l'occasion d'étudier les monuments originaux. Aussi les photographies ne peuvent être considérées que comme une sorte de demi-publication, dont ne pourront profiter qu'imparfaitement ceux qui sont plus philologues que paléographes. Sans compter que dans toutes les parties du texte en mauvais état, les accidents de la surface de l'argile prennent avec ce mode de reproduction une importance égale à celle du sillon des traits de l'écriture, de telle façon qu'on arrive à ne plus rien distinguer. On ne pourra donc considérer le récit babylonien du déluge comme définitivement mis entre les mains des érudits-compétents que lorsqu'on en aura publié une copie exécutée dans le même système que les planches du splendide ouvrage des Cuneiform inscriptions of Western Asia, et une copie qui soit une édition critique, combinant dans les portions mutilées les leçons des trois exemplaires parallèles parvenus jusqu'à nous, car en beaucoup d'endroits tel de ces exemplaires, dont il ne reste plus que des débris informes, fournit un mot ou un membre de phrase effacé sur l'exemplaire dont il reste le morceau le plus étendu. Dans l'état actuel, on n'est pas encore en mesure de vérifier mot à mot la traduction de M. Smith. Mais il a fourni, par d'autres publications, la preuve de son aptitude à un pareil travail. Après les maîtres' et les fondateurs de la science, comme sir Henry Rawlinson et M. Oppert, M. Smith est actuellement, en Europe, l'homme le plus capable de bien lire un texte cunéiforme et d'en donner une version satisfaisante. Pour quiconque a pratiqué les documents épigraphiques assyriens et en a fait une étude approfondie, sa traduction porte en elle-même le cachet le plus évident d'exactitude. On peut et on doit la tenir pour généralement bonne, sauf un certain nombre d'erreurs de détails, inévitables dans l'état actuel de la science, quand on interprète pour la première fois un texte d'une grande étendue dans une langue qui présente encore tant d'obscurités, même pour les plus habiles et les plus compétents. Il m'est permis d'être encore plus affirmatif sur la valeur de la traduction de M. Smith. J'ai dû personnellement à la libéralité de la direction du grand établissement scientifique d'Outre-Manche un moulage du fragment le plus étendu et le mieux conservé des tablettes du déluge, d'un fragment qui contient dans un état parfait de préservation plus de la moitié du texte[4]. J'ai donc pu sur ce moulage, pour toute la partie qu'il embrasse, comparer pas à pas la version de M. Smith à l'original. Cette comparaison m'a mis à même de reconnaître quelques corrections faciles à apporter au travail de l'érudit anglais[5], et de noter un certain nombre de passages douteux, qui devront fournir matière à discussion entre les assyriologues. Mais en même temps le contrôle partiel qu'il m'a été donné d'exercer ainsi sur le travail de M.-Smith m'en a fait constater la très-haute valeur. Pièces en main, j'affirme l'exactitude générale de sa traduction, qui ne devra être modifiée dans rien d'essentiel et n'a besoin d'être révisée que sur quelques points secondaires. Dès à présent elle fournit un excellent et solide terrain à l'étude de ceux qui s'occupent de comparer les traditions des différents peuples de l'antiquité ; elle permet d'apprécier d'une manière déjà très-sûre la valeur de la découverte de l'habile attaché au Musée Britannique, et d'en mettre en lumière les principales conséquences. C'est ce que je voudrais faire aujourd'hui, en m'aidant des secours encore incomplets dont je dispose. Un peu plus tard, quand M. Smith nous aura donné l'édition critique dont le monde savant attend et réclame de lui la publication, quand l'administration du Musée Britannique y aura consacré l'un de ces beaux et utiles volumes de textes dont elle fait si généreusement les frais, viendra l'œuvre minutieuse et patiente des philologues, qui reprendront la traduction mot à mot, l'éplucheront, la rectifieront dans ses parties douteuses, en effaceront toutes les taches et l'amèneront enfin à un degré de certitude absolue jusque dans les moindres détails. I Que les Babyloniens possédassent une tradition sur le déluge, offrant les plus étroites et les plus curieuses ressemblances avec le récit biblique, c'est ce que l'on savait depuis longtemps par les fragments de Bérose, le prêtre chaldéen qui, sous Séleucus Nicator, rédigea en grec, pour l'usage des nouveaux conquérants, les annales et les légendes de sa patrie. Eusèbe de Césarée, qui nous a conservé presque tous les débris que nous possédons de Bérose comme de Sanchoniathon, dans l'intention de corroborer les récits des Livres Saints par le témoignage de la tradition orientale païenne, inséra ce morceau dans ses ouvrages, et depuis la Renaissance, il a été l'objet des études et des commentaires de nombreux érudits. Je crois utile de le replacer tout d'abord sous les yeux des lecteurs, afin de les mettre à même de le comparer au récit original découvert par M. Smith. On pourra juger par là plus exactement la mesure de ce que cette trouvaille apporte de nouveau pour la science ; en même temps, on y aura la preuve de l'exactitude vraiment admirable avec laquelle l'auteur des Antiquités chaldéennes avait rapporté les traditions de son pays, de l'autorité qui doit s'attacher à ses dires et de la confiance entière avec laquelle la critique doit accepter désormais son témoignage sur les points où les documents originaux ne sont pas encore venus en apporter la confirmation directe, comme par exemple en ce qui touche à la légende de la Tour des langues. J'avais essayé déjà de montrer, dans un ouvrage spécial, par le contrôle des textes cunéiformes, l'exactitude et le prix inestimable des fragments de Bérose ; mais je dois confesser que je n'avais pas eu la chance d'en rencontrer une aussi éclatante et aussi directe confirmation. Le livre même de Bérose n'existait plus, paraît-il, au temps d'Eusèbe ; on en possédait seulement deux abrégés dus à des polygraphes postérieurs, Abydène et Alexandre Polyhistor. L'évêque de Césarée rapporte successivement, au sujet du déluge, la rédaction de chacun de ses abréviateurs, et il faut faire comme lui, car, tout en concordant sur les données essentielles, elles se complètent réciproquement. Voici d'abord la plus développée. L'auteur vient de parler des neuf premiers rois antédiluviens, auxquels la tradition babylonienne attribuait des périodes fabuleuses de dizaines de milliers d'années : Otiartès étant mort, son fils Xisuthrus
régna dix-huit sares (64.800 ans). C'est sous lui qu'arriva le grand déluge, dont
l'histoire est ainsi rapportée dans les documents sacrés. Cronos lui apparut
dans son sommeil et lui annonça que le 15 du mois de dæsius (au solstice d'été)
tous les hommes périraient par un déluge. Il lui ordonna donc de prendre le
commencement, le milieu et la fin de tout ce qui était consigné par écrit et
de l'enfouir dans la ville du Soleil à Sippara, puis de construire un navire
et d'y monter avec sa famille et ses amis les plus chers ; de déposer dans le
navire des provisions pour la nourriture et la boisson, et d'y faire entrer
les animaux, volatiles et quadrupèdes ; enfin de tout préparer pour la
navigation. Et quand Xisuthrus demanda de quel côté il devait tourner la
marche de son navire, il lui fut répondu vers les dieux, et de prier
pour qu'il en arrivât du bien aux hommes. Xisuthrus obéit et construisit un navire long de cinq stades et large de deux ; il réunit tout ce qui lui avait été prescrit et embarqua sa femme, ses enfants et ses amis intimes. Le déluge étant survenu et bientôt décroissant, Xisuthrus lâcha quelques-uns des oiseaux. Ceux-ci n'ayant trouvé ni nourriture ni lieu pour se poser, revinrent au vaisseau. Quelques jours après, Xisuthrus leur donna de nouveau la liberté ; mais ils revinrent encore au navire avec les pieds pleins de boue. Enfin, lâchés une troisième fois, les oiseaux ne retournèrent plus. Alors Xisuthrus comprit que la terre était découverte ; il fit une ouverture au toit du navire et vit que celui-ci était arrêté sur une montagne. Il descendit donc avec sa femme, sa fille et son pilote, adora la Terre, éleva un autel et y sacrifia aux dieux ; à ce moment il disparut avec ceux qui l'accompagnaient. Cependant ceux qui étaient restés
dans le navire, ne voyant pas revenir Xisuthrus, descendirent à terre à leur
tour et se mirent à le chercher en l'appelant par son nom. Ils ne revirent
plus Xisuthrus ; mais une voix du ciel se fit entendre, leur prescrivant
d'être pieux envers les dieux ; qu'en effet il recevait la récompense de sa
piété en étant enlevé pour habiter désormais au milieu des dieux, et que sa
femme, sa fille, et le pilote du navire partageaient un tel honneur. La voix
dit en outre à ceux qui restaient qu'ils devaient retourner à Babylone et,
conformément aux décrets du destin, déterrer les écrits enfouis à Sippara
pour les transmettre aux hommes. Elle ajouta que le pays où ils se trouvaient
était l'Arménie. Ceux-ci, après avoir entendu la voix, sacrifièrent aux dieux
et revinrent à pied à Babylone. Du vaisseau de Xisuthrus, qui s'était enfin
arrêté en Arménie, une partie subsiste encore dans les monts Gordyéens, en
Arménie, et les pèlerins en rapportent l'asphalte qu'ils ont raclé sur les
débris ; on s'en sert pour repousser l'influence des maléfices. -Quant aux
compagnons de Xisuthrus, ils vinrent à Babylone, déterrèrent les écrits
déposés à Sippara, fondèrent des villes nombreuses, bâtirent des temples et
restituèrent Babylone. Cette rédaction est celle d'Alexandre Polyhistor. Le récit d'Abydène est plus abrégé, mais précise davantage les circonstances relatives à l'envoi des oiseaux. Après Évedoreschus, il y eut
plusieurs rois, et enfin Sisithrus, à qui Cronos annonça que le 15 du mois de
dæsius il y aurait une grande abondance de pluies. Le dieu lui ordonna donc
de cacher tout ce qui composait les écritures dans la ville du Soleil à
Sippara. Sisithrus, ayant accompli ces prescriptions, navigua bientôt vers
l'Arménie, car aussitôt la prédiction du dieu se réalisa. Le troisième jour
après que la pluie eut cessé, il lâcha plusieurs oiseaux pour voir s'ils découvriraient
quelque terre déjà sortie des eaux. Mais ces oiseaux, n'ayant trouvé partout
qu'une mer prête à les engloutir, et ne pouvant se poser nulle part,
revinrent auprès de Sisithrus ; il en renvoya d'autres. Ayant enfin réussi à
la troisième fois dans son dessein, car les oiseaux étaient revenus avec les
pieds couverts de limon, les dieux l'enlevèrent à la vue des hommes. Et du
bois de son navire, qui s'était arrêté en Arménie, les habitants du pays font
des amulettes qu'ils suspendent à leur col contre les maléfices. En rééditant, l'année dernière, les Fragments cosmogoniques de Bérose, avec un long commentaire, je me suis efforcé de grouper toutes les indications fugitives de cette tradition du déluge que l'on pouvait relever dans les textes cunéiformes connus et étudiés à cette date. Mais elles se réduisaient à peu de chose, même, en général, à des allusions dont l'application pouvait largement prêter au doute. Encore ces allusions avait-elles surtout trait à l'enfouissement des tablettes Contenant les Écritures sacrées, à Sippara. Elles prouvaient seulement que la fameuse légende juive des bas temps sur les colonnes inscrites élevées par le patriarche Seth dans la Terre Sériadique, en prévision du cataclysme, n'était qu'un écho altéré de la tradition babylonienne, et que le patriarche, fils d'Adam, y avait, par suite d'une assonance de nom, pris la place d'un dieu de l'antique religion des riverains de l'Euphrate et du Tigre. Quant au récit lui-même, il fallait l'accepter sur la foi de Bérose et remarquer seulement que, son exactitude étant établie sur d'autres points d'une manière satisfaisante, toutes les présomptions militaient pour la faire accepter encore ici. Mais j'étais obligé d'ajouter : Les textes cunéiformes n'ont pas encore fourni de récit du déluge où nous trouvions la forme originale des données que Bérose a mises en grec. C'est cette grave lacune qui est heureusement comblée aujourd'hui. II On sait que M. Layard a retrouvé dans la partie du palais royal de Ninive appelée des habitants actuels Koyoundijk, qui fut bâtie sous le règne d'Assourbanipal, le dernier des conquérants assyriens, la salle des archives et de la bibliothèque. Cette bibliothèque, bien singulière pour nos idées et nos habitudes, se composait exclusivement de tablettes plates et carrées, en terre cuite, portant sur l'une et l'autre de leurs deux faces une page d'écriture cunéiforme cursive, très-fine et très-serrée, tracée sur l'argile encore fraîche, avant sa cuisson. Chacune était numérotée, et formait le feuillet d'un livre dont l'ensemble était constitué par la réunion d'une série de tablettes pareilles, sans doute empilées les unes sur les autres dans une même case de la bibliothèque. Les Babyloniens et les Assyriens n'avaient pas, du reste, d'autres livres que ces coctiles laterculi, comme les appelle Pline. Ils ne traçaient les signes de leur écriture, ni à l'encre, ni avec le calame ou le pinceau, sur le papyrus, des peaux préparées ou des bandelettes de toile, ni à la pointe sèche, sur des planchettes, des feuilles de palmier ou des écorces d'arbres. Faute d'autres ressources facilement à leur portée, ils les dessinaient en creux sur des tablettes d'argile molle qu'ils faisaient cuire après, pour les conserver. De là l'apparence de leur écriture ; car l'élément tout particulier qui produit l'aspect original des écritures cunéiformes et y devient le générateur de toutes les figures, le trait en forme de coin ou de clou, n'est autre que le sillon tracé dans l'argile par le style en biseau dont on se servait peur cet usage, et dont on a trouvé de nombreux échantillons dans les ruines de Ninive. Les fragments de tablettes recueillis par les ouvriers de M. Layard, dans la salle où Assourbanipal avait établi sa bibliothèque, montent à près de dix mille, provenant d'ouvrages qui traitaient des sujets les plus différents, grammaire, histoire, droit, mythologie, histoire naturelle, astronomie et astrologie. Ils ont été transportés au Musée Britannique, à part un petit nombre qui ont été dérobés par l'infidélité des ouvriers, et se sont répandus dans les diverses collections publiques ou privées de l'Europe. Malheureusement, ces fragments ont été ramassés sans ordre et entassés pêle-mêle dans les caisses où ils ont été envoyés en Angleterre. Aussi n'est-ce qu'avec beaucoup de lenteur, par des efforts suivis et opiniâtres, et en surmontant mille difficultés, que l'on parvient à reconstituer plus ou moins complètement une partie des tablettes. M. G. Smith a succédé à un autre jeune savant d'un vrai mérite, M. Coxe, dans ce travail délicat, qui demande autant d'intelligence des textes que de minutieuse patience, aussi bien qu'une attitude très-spéciale, et il y a rendu de grands services. C'est par le rapprochement de quatre-vingts fragments provenant de trois exemplaires différents car la bibliothèque palatine de Ninive possédait souvent plusieurs copies du même ouvrage — que M. Smith est parvenu à reconstituer en grande partie le texte du document dont il vient de faire connaître le contenu. Ce document se composait de douze tablettes, portant chacune plus de deux cent quatre-vingts lignes d'écriture. Le récit du déluge, introduit comme épisode dans le cours d'une autre histoire, y remplit la onzième tablette ; car la division des feuillets du document primitif a été soigneusement notée par les scribes qui l'ont transcrit plus tard. Les copies que l'on possède à Londres ont été faites par ordre d'Assourbanipal, dans le septième siècle avant notre ère, d'après un exemplaire très-ancien qui existait dans la ville d'Ourouk, en Chaldée, l'Érech du chapitre X de la Genèse, l'Orchoé des géographes grecs, siège d'une grande école sacerdotale encore florissante au temps de Strabon. Érech avait été, avec Sippara, la ville des livres, la cité dans laquelle les rois chaldéens de l'Ancien Empire avaient fondé la plus antique bibliothèque, et la plupart des textes qu'Assourbanipal fit copier pour les déposer à Ninive sont dits également avoir été reproduits d'après les livres de la bibliothèque d'Érech. Ce prince entretenait, en effet, avec le sacerdoce d'Érech des relations particulièrement bienveillantes. Lors de la grande révolte de la Babylonie et de la Chaldée, provoquée par Samoulsoumoukin, la ville d'Érech lui était seule demeurée inébranlablement fidèle. Et plus tard il l'en avait récompensée en y ramenant triomphalement de Suse, après le sac de cette dernière cité, la statue de la grande déesse Nana, enlevée du temple pyramidal d'Érech 1635 ans auparavant par le conquérant élamite Koudour-Nankhounda Il était donc naturel que, voulant placer dans son palais de Ninive une collection de copies des grands ouvrages sacrés de la Chaldée, il les fit demander à Érech plutôt qu'à toute autre cité possédant des bibliothèques et des écoles sacerdotales. Il est difficile de préciser la date de l'original ainsi transcrit par les scribes assyriens sur l'ordre de leur maitre ; mais il est certain qu'il remontait à l'époque du premier empire de Chaldée, dix-sept siècles au moins avant notre ère, et même probablement plus ; il était donc fort antérieur à Moïse. Qu'il ait été rédigé originairement dans la langue sémitique commune à Ninive et à Babylone, ou qu'il ait été — ce que des indices assez sérieux me semblent rendre moins probable — traduit, à cette époque reculée, d'un document antérieur en accadien, c'est-à-dire dans l'idiome touranien des plus anciens habitants de la Chaldée, il ressort, des observations de M. Smith et de quelques faits grammaticaux sur lesquels il a judicieusement insisté, que la langue en porte des marques incontestables d'archaïsme. Une des plus saillantes est dans l'expression constante du pronom de la première personne, qui dans l'état de l'idiome qu'on peut appeler classique est d'ordinaire indiqué par la forme verbale, mais non exprimé. Si l'on compare la langue du document qui comprend le récit du déluge avec celle des textes datés du règne de Sargon Ier et de son successeur Naram-Sin, elle a un cachet incontestable d'antiquité supérieure. Il résulte aussi des variantes que les trois copies existantes présentent entre elles, que l'exemplaire d'après lequel elles ont été faites était tracé au moyen du type primitif d'écriture désigné sous le d'hiératique, type qui était déjà devenu difficile à lire au VIIe siècle, puisque les scribes ont varié sur l'interprétation de certains caractères ; dans d'autres cas ils ont purement et simplement reproduit dans leur copie les caractères hiératiques qu'ils ne comprenaient plus. Il résulte aussi de la comparaison des mêmes variantes que l'exemplaire transcrit par ordre d'Assourbanipal était lui-même la copie d'un manuscrit plus ancien, sur laquelle on avait déjà joint au texte original quelques gloses interlinéaires. Certains des copistes les ont introduites dans le texte ; les autres les ont omises. Le texte, où le récit du déluge n'intervient, nous l'avons déjà dit, que comme un épisode, est une grande histoire épique sur la vie et les aventures d'un personnage fabuleux dont, malheureusement, le nom est toujours écrit en caractères idéographiques, ce qui en laisse encore la véritable prononciation inconnue. Comme on ne peut pas l'appeler X ou ***, il faut provisoirement lui donner, comme a fait M. Smith, l'appellation d'Izdubar, prononciation phonétique des caractères employés comme idéogrammes à écrire son nom. Mais certainement les Assyriens et les Babyloniens le lisaient autrement. Des trouvailles ultérieures nous fixeront sans doute à ce sujet ; mais il est probable que la lecture définitive du nom de ce héros devra correspondre à la forme dont Bérose a fait Evéchoüs, nom de son premier roi postdiluvien, dont la vie et le règne ont encore une durée fabuleuse de milliers d'années, ou peut-être à celle du Nemrod de la Bible. En effet, nous savons aujourd'hui d'une manière positive que la légende de Nemrod, le fort chasseur, que la Genèse cite comme un dicton populaire antique, appartenait au cycle des légendes assyro-babyloniennes. Assourbanipal, dans ses inscriptions historiques, y fait une allusion manifeste, quand il applique à Resen, une des cités d'Assyrie dont la construction est formellement attribuée par la Bible à Nemrod, l'épithète de la ville du chasseur. Ceci donné, il est très frappant de voir le document babylonien faire régner Izdubar sur quatre villes : Babylone, Érech, Sourippak (?) et Nipour, dont trois se retrouvent certainement dans les quatre villes que la Genèse dit avoir été l'origine de l'empire de Nemrod, Babel, Érech, Accad et Calneh. Babel et Érech sont nommés de même dans les deux sources ; les talmudistes s'accordent à dire que Calneh est Nipour. En voyant deux énumérations parallèles de quatre termes chacune en donner trois identiques, et dans le même ordre, il est bien difficile de ne pas rapprocher le quatrième dans l'une et dans l'autre, d'autant plus qu'Accad est dans les textes assyriens un nom de peuple, et non de la ville[6]. Il est donc probable que le rédacteur de la Genèse l'aura substitué à celui de Sourippak, lequel paraît avoir été complètement oublié dès le temps où il écrivait, puisqu'il disparaît dans la géographie postérieure des textes cunéiformes eux-mêmes. Peut-être l'a-t-il fait d'après quelque tradition qui lui signalait Sourippak comme la capitale primitive du peuple d'Accad[7]. En tous cas, on est conduit, par les arguments que je viens d'indiquer, à rapprocher étroitement la tétrapole sur laquelle règne Izdubar, dans le récit des tablettes cunéiformes, de la tétrapole nemrodite citée par la Bible, et ceci me semble un argument très-fort pour l'assimilation des deux personnages. Izdubar est formellement donné comme un dieu dans d'autres textes, et nous essaierons un peu plus loin de déterminer son caractère précis. Mais la légende épique, ainsi qu'il est arrivé chez tous les peuples, en fait un héros ; elle lui attribue une vie humaine, lui prête des exploits et des aventures terrestres ; elle le présente comme un conquérant et un chef d'empire qui parvient, au travers de nombreuses épreuves, à l'immortalité. C'est la transformation qu'ont subie chez les Iraniens les personnages de Yima et, de Thraêtaona, qui étaient certainement des dieux dans leur conception première. Elle constitue précisément ce qui fait passer le mythe religieux à l'état d'épopée. Au reste, les dix rois antédiluviens de Bérose, qu'il représente comme ayant régné sur la terre, sont aussi incontestablement des personnifications divines, d'un caractère avant tout zodiacal. Je crois l'avoir établi ailleurs. M. Smith n'a jusqu'à présent retrouvé qu'un très-petit nombre de fragments détachés qu'on puisse attribuer avec certitude aux cinq premières tablettes qui commençaient l'histoire épique. L'un d'entre eux raconte la conquête du taureau ailé, qu'Izdubar parvint à capturer vivant avec l'aide de son serviteur Nouahbani, qui l'accompagne fidèlement dans toutes ses aventures. Un autre parle d'un monstre marin appelé Boul (le dévorant), qui sortait périodiquement des flots pour ravager le pays, et dévorait les jeunes filles exposées à sa fureur. Izdubar parvient à en délivrer le pays, comme on le voit par ce passage dont nous empruntons la traduction à M. Smith : Izdubar en ces termes parla à son veneur : — Va, mon veneur, avec la femme Hakirtou et la femme Oupasamrou, et quand le monstre passera sortant de ses confins, que chaque femme dépose son vêtement ; ainsi leur beauté sera en vue et lui, le monstre, se précipitera vers elles. Alors toi, immole-le se livrant ainsi. — Le veneur Ssaïd (chasseur) partit, avec lui partirent Hakirtou et Oupasamrou. Ils prirent la route et se dirigèrent là bas le long du chemin. Le troisième jour dans un pays désert ils arrivèrent, le veneur et la femme Hakirtou et la femme Oupasamrou. Ils s'assirent là un jour et le second jour, en face des confins du monstre, du . . . . . Le monstre passa et . . . . . il se précipita sur elle Il le détruisit, lui, le monstre . . . . . suivant l'ordre de son père . . . . . . . . . . le veneur Ssaïd Il alla . . . . . il prit la route . . . . . il vint au milieu de la ville d'Érech. C'est le prototype de l'histoire de Persée et d'Andromède, la principale de ces fables céphéniennes que le baron d'Eckstein a étudiées avec une érudition si ingénieuse, et dont il a indiqué la source comme devant avoir été à Babylone. La tablette qui suivait immédiatement celle dont je viens de citer un passage représente Izdubar comme devenu le chef d'une armée d'envahisseurs, et faisant la guerre à Bélésou, roi d'Érech. II défait ce prince, s'empare de la couronne, et établit ses soldats dans le pays. La violence de la conquête est décrite en termes très-saisissants par le poète, qui montre les dieux et les esprits habitants des sanctuaires d'Érech prenant la forme d'animaux pour échapper aux atteintes du vainqueur. Il y a là certainement, mêlé aux conceptions mythologiques, comme dans presque toutes les épopées primitives, un lointain souvenir de l'histoire, un écho des luttes de races, qui eurent la Chaldée et la Babylonie pour théâtre aux âges primitifs, lors du premier contact entre les Accads et les Soumirs, les Touraniens et les Kouschites, qui se superposèrent les uns aux autres sur ce territoire et formèrent les deux éléments constitutifs de sa population. Ce sont les mêmes luttes de race dont nous trouvons un autre écho dans le mythe de la lutte des Trois Frères divins que Bérose racontait après la confusion des langues, aussi bien que la notion de violence qui s'attache au nom du Nemrod biblique. Pour la Genèse, Nemrod appartient à la race de Kousch. Ce sont donc les Kouschites que l'écrivain sacré représente comme les envahisseurs, qui établissent l'origine de leur empire dans quatre villes existant antérieurement, fondées en conséquence par une population précédemment établie dans le pays et conquise. De même, dans l'histoire des Trois Frères telle que nous la donnent les fragments de Bérose, Cronos ou Zerovan paraît personnifier la population touranienne, et Titan la population kouschite ; là encore l'idée d'antiquité et de priorité s'attache au représentant du peuple d'Accad. Il faudrait avoir le texte entier de l'épopée d'Érech, pour savoir si dans le récit de la conquête Izdubar se présentait également avec un caractère ethnique bien déterminé. Mais ce qui me frappe surtout dans ce qu'en a fait connaître M. Smith, c'est qu'Izdubar, le conquérant d'Érech, est donné comme habitant Érech au commencement de sa vie et comme originaire de cette cité. C'est le pendant exact de ce qui est arrivé pour les Héraclides dans les traditions de la Grèce, et pour les Pandavas dans l'épopée indienne ; après la fusion des deux races d'abord en lutte, l'amour-propre des vaincus, redevenus les égaux des vainqueurs, s'est plu à se représenter le chef de la conquête, non comme un étranger, mais comme un exilé revendiquant son héritage légitime. Le texte de la sixième tablette s'ouvre ainsi : . . . . . Bélésou, il avilit Bélésou. Comme un taureau il foula son pays à sa suite ; il le détruisit, et sa mémoire périt. Le pays fut subjugué, et après il prit la tiare ; Izdubar se ceignit de la tiare, et après il prit la tiare. Avec complaisance la reine Istar tourna ses yeux vers Izdubar, et elle parla ainsi : — Izdubar, tu seras mon mari ; ta parole me liera dans des liens ; tu seras mon mari, et je serai ta femme. Tu seras porté dans un char de pierres précieuses et d'or, dont le corps est d'or et le timon magnifique ; tu monteras dans les jours de grande gloire au Bit-Ani[8], dont l'enceinte renferme le bois sacré de pins ; le Bit-Ani à son entrée du côté de l'Euphrate baisera tes pieds. Là te seront soumis rois, seigneurs et princes ; ils t'apporteront les tributs des montagnes et des plaines, des présents d'hommage ils te donneront. Tes troupeaux de bœufs et de moutons produiront de doubles portées. . . . . . . . . . . Le mulet sera obéissant . . . . . . . . . . au char il sera fort et sans faiblesse . . . . . . . . . . au joug. Tu n'auras pas de rival. C'est ainsi qu'Izdubar épouse la déesse Istar, la Vénus chaldéo-assyrienne, veuve d'un premier époux divin dont le nom, écrit idéographiquement, signifie le Fils de la vie ou le Fils de l'esprit. Je ferai voir un peu plus loin que ce premier époux n'est autre que Tammuz, l'Adonis babylonien, dont le culte s'était introduit à Jérusalem au temps d'Ezéchiel, qui-aperçut dans ses visions les femmes assises, pleurant Tammuz jusque dans le temple de Jéhovah. Le mariage d'Izdubar avec Istar le ramène dans le cycle des dieux, et établit clairement son caractère essentiel et originaire de divinité. Autant qu'on en peut juger par les indications qu'a données M. Smith, il semble y avoir dans les débris jusqu'à présent retrouvés de l'épopée une lacune de plusieurs tablettes après le mariage d'Izdubar. Quand le texte reprend avec une certaine continuité, le héros règne depuis longtemps déjà ; il est tombé malade et craint la mort, le dernier ennemi de l'homme. Dans cette inquiétude, il résout d'aller chercher Sisithrus, à qui les dieux, en le sauvant du déluge, avaient accordé le privilège de l'immortalité sans passer par la mort, afin de savoir de lui comment il était devenu immortel, et par quels moyens lui-même pourrait parvenir à la même faveur. Je me sers intentionnellement de la forme hellénisée du nom de ce personnage, car le texte n'en donne pas la prononciation en caractères phonétiques ; il l'exprime par des idéogrammes signifiant Soleil de vie ou Lumière de vie. Nous restons donc dans l'ignorance de la forme exacte du nom qu'Alexandre Polyhistor a écrit Xisuthrus et Abydène Sisithrus ; mais des raisons d'une nature trop spéciale pour être exposées ici m'induisent à penser qu'elle devait être Sousrou. Izdubar à son serviteur Nouahbani se lamentait amèrement, et demeurait étendu à terre — J'ai reçu la nouvelle de Nouahbani et la faiblesse est entrée dans mon âme ; j'ai craint la mort et je gis à terre. Pour trouver Sisithrus, fils d'Oubaratoutou, je me suis mis en route et joyeusement je suis arrivé à l'ombre des montagnes, que j'ai atteintes à la nuit. J'ai vu les dieux et j'ai été saisi de crainte. . . . . . j'ai prié Sin[9], et en présence des dieux ma prière a monté ; ils ont accordé la paix sur moi et m'ont envoyé un songe. Malheureusement, à ce que nous apprend M. Smith, le récit du songe qui guide Izdubar dans la recherche de Sisithrus est très-mutilé, et il n'en reste que peu de fragments. L'histoire fort développée du voyage n'est pas en meilleur état, et il n'est pas possible d'en déterminer toutes les aventures. Dans un passage on voit en scène trois hommes qui se racontent les uns aux autres quelques épisodes de ce voyage. Après avoir erré longtemps, Izdubar finit par rencontrer un personnage expert dans les choses de la navigation. M. Smith en a lu le nom Ourkhamsi, sous l'empire d'une préoccupation de le rapprocher de celui d'Orchamus, qui se trouve seulement dans les Métamorphoses d'Ovide, comme le roi babylonien père de Leucothée, et qui, par conséquent, n'a en réalité aucune valeur sérieuse de tradition asiatique. Sur l'orthographe originale du nom, je crois devoir proposer une tout autre lecture. Il se compose de deux éléments : le mot our, lumière, et un nom de divinité ; celui-ci est écrit idéographiquement par le signe dieu et le chiffre 50 ; M. Smith l'a lu khamsi, parce que c'est de cette façon que se disait cinquante en assyrien. Mais nous savons par d'autres sources qu'en vertus d'idées mystiques sur la valeur des nombres, assez analogues à celles qu'adoptèrent les Pythagoriciens, les prêtres de Babylone faisaient correspondre à chaque nom de dieu un chiffre déterminé. Une tablette que possède le Musée Britannique en donne l'échelle complète. D'un autre côté, des exemples formels fournis paf l'orthographe de noms propres dont on a la lecture positive, comme celui de Sennachérib, prouvent que lorsqu'on écrivait dans les textes cunéiformes la mention d'un dieu par le chiffre qui lui était affecté, on la lisait par son nom habituel. Il est certain que le dieu 30 se lisait Sin, la déesse 45 Istar, le dieu 60 Anou. Le dieu 50 doit se lire de même, par le nom auquel correspond le chiffre 50 dans la tablette du Musée Britannique, et ce nom est celui de Bel. Je déchiffre donc comme Our-Bel, lumière du dieu Bel, l'appellation du compagnon qui, à partir de ce point du récit, s'attache aux pas d'Izdubar. Les deux héros construisent un vaisseau pour continuer leurs recherches, et s'embarquent sur l'Euphrate. Il était déjà question, dans des textes antérieurement connus, du vaisseau du dieu Izdubar, flottant sur les eaux de l'Euphrate. La navigation d'Izdubar et d'Our-Bel dure un mois et quinze jours, au terme desquels ils arrivent dans un pays situé près de l'embouchure du fleuve, au milieu des marais, où résidait Sisithrus. Elle est marquée par diverses aventures, au cours desquelles Our-Bel parle à Izdubar des eaux de la mort, en lui disant : Les eaux de la mort ne laveront pas tes mains. Au moment où Izdubar et Our-Bel s'approchent de lui, Sisithrus est endormi. La tablette, suivant ce que nous apprend M. Smith, est à cet endroit trop mutilée pour apprendre comment ils arrivèrent à se rencontrer ; mais il semble résulter de ce qu'on y distingue que Sisithrus se trouvait avec sa femme à une certaine distance des deux héros qui le cherchaient, au delà d'un cours d'eau[10]. Ne pouvant traverser le fleuve qui sépare les mortels de l'immortel, et qu'une puissance supérieure rend infranchissable, Izdubar appelle Sisithrus et lui adresse la redoutable question sur la vie et la mort. Il ne reste plus que la fin de la réponse de Sisithrus, qui proclame l'universalité de la mort pour les hommes : La déesse Mamit (déesse de la destinée dont la mention apparaît ici pour la première fois —, la déesse Mamit, la créatrice du destin, leur a fixé leur sort fatal ; elle a déterminé la mort et la vie, mais le jour de la mort est inconnu. Ces mots, qui terminent le discours de Sisithrus, conduisent à la fin de la dixième tablette. La onzième commence par une nouvelle question d'Izdubar, qui demande à Sisithrus comment il est devenu immortel ; Sisithrus, dans sa réponse, raconte l'histoire du déluge et donne sa piété comme la cause qui l'a préservé dans le cataclysme. C'est cette tablette que M. Smith a traduite intégralement. Nous reproduisons sa version, en y introduisant seulement un petit nombre de corrections qui nous ont paru s'imposer d'une manière évidente dans la partie du texte que nous avons pu vérifier sur l'original[11] ; mais nous n'avons pas cru que ce fût ici le lieu d'essayer de modifier le travail du savant anglais sur les points de détail tout à fait secondaires, et ne touchant pas au sens fondamental et à la marche du récit, où sa traduction peut être discutée et amendée. Nous avons aussi changé la forme donnée à quelques noms de dieux, qui s'écrivent au moyen d'idéogrammes et dont la prononciation est par conséquent encore douteuse. Les assyriologues français, suivis par les Allemands et les Italiens, les lisent un peu différemment des savants de l'école anglaise, et d'une manière que je crois plus exacte. Le texte présente encore dans cette partie, comme on va le voir, de nombreuses lacunes ; mais elles n'empêchent pas de suivre le sens général et de saisir les traits principaux. 1. — Izdubar de cette manière parla à Sisithrus de loin : 2. — . . . . . . . . . . Sisithrus, 3. raconte-moi le récit, 4. raconte-moi le récit, 5. . . . . . . . . . . jusqu'au milieu pour faire la guerre. 6. . . . . . . . . . . je monte vers toi. 7. Dis comment tu as fait et au milieu de tous les dieux as acquis la vie. 8. — Sisithrus de cette manière parla à Izdubar : 9. — Je te révélerai, ô Izdubar, l'histoire cachée, 10. et la sagesse des dieux je te la ferai connaître. 11. La ville de Sourippak, la ville que tu as établie placée, 12. était ancienne et les dieux en elle 13. habitaient. Une tempête . . . . . leur dieu, les grands dieux, 14. . . . . . . . . . . Anou[12], 15. . . . . . . . . . . Bel[13], 16. . . . . . . . . . . Adar[14], 17. . . . . . . . . . . seigneur du Pays immuable[15], 18. révélèrent leur volonté au milieu de [la nuit ; 19. je fus] entendant [Nouah][16], et il me parla ainsi : 20. Homme de Sourippak, fils d'Oubaratoutou[17], 21. fais un grand vaisseau pour toi . . . . . 22. Je détruirai les pécheurs et la vie . . . . . 23. Fais entrer la semence de vie de la totalité des êtres pour les conserver. 24. Le vaisseau que tu fabriqueras, 25. . . . . . coudées seront la mesure de sa longueur, 26. . . . . . coudées la mesure de sa largeur et de sa hauteur. 27. Lance-le sur l'abîme. 28. Je compris, et je dis à Nouah, mon seigneur : 29. Nouah, mon seigneur, ce que tu m'a commandé 30. je l'accomplirai ; cela sera fait. 31. . . . . . . . . . . armée et troupes (?) 33. Nouah ouvrit sa bouche et parla et dit à moi, son serviteur : 34. . . . . . . . . . . tu leur diras. 35. . . . . . . . . . . il se détourna de moi, et 36. . . . . . . . . . . fixé . . . . . Ici se trouvent environ quinze lignes entièrement perdues. Le passage qui a disparu, et dont M. Smith, dit-on, a retrouvé plus récemment quelques débris, contenait le récit de la construction de l'arche. 51. Il . . . . . . . . . . 52. qui dans . . . . . 53. fort . . . . . . j'apportai. 54. Au cinquième jour . . . . . . son . . . . . 55. Dans son circuit quatorze mesures . . . . . sur ses côtés 56. quatorze mesures il avait de dimensions . . . . . par dessus 57. je plaçai son toit par-dessus ; de . . . . . je l'entourai. 58. Je naviguai dedans ; pour la sixième fois je . . . . . pour la septième fois, 59. sur l'abîme sans repos à la [huitième] fois, 60. ses planches à l'intérieur laissaient entrer les eaux ; 61. je vis des fissures et des trous . . . . . ma main plaça. 62. Trois mesures de bitume je répandis sur le dehors ; 63. trois mesures de bitume je répandis à l'intérieur ; 64. trois mesures prirent les hommes chargés des baquets . . . . . Ils posèrent un autel ; 65. j'entourai l'autel . . . . . l'autel pour le sacrifice ; 66. deux mesures l'autel Pazzir le pilote. 67. Pour . . . . . immola des bœufs 68. de . . . . . dans ce jour aussi 69. . . . . . autel et raisins 70. . . . . . . . . . . comme les eaux d'un fleuve et 71. . . . . . comme le jour je couvris et 72. . . . . . quand . . . . . ma main plaça la couverture. 73. . . . . . et Samas[18] . . . . . compléta les matériaux du vaisseau. 74. . . . . . . . . . . fort et 75. des roseaux j'étendis dessus et dessous. 76. . . . . . . . . . . allèrent aux deux tiers. 77. Tout ce que je possédais, je le réunis, tout ce que je possédais d'argent je le réunis, 78. tout ce que je possédais d'or je le réunis, 79. tout ce que je possédais de la semence de vie je le réunis, le tout 80. je le fis entrer dans le vaisseau ; tous mes serviteurs mâles et femelles, 81. les animaux domestiques des champs, les animaux sauvages des champs, et les jeunes hommes de l'armée, eux tous, je les fis entrer. 82. Samas fit une inondation et 83. il parla, disant dans la nuit : Je ferai pleuvoir du ciel abondamment ; 84. Entre au milieu du vaisseau, et ferme ta porte. 85. Il suscita l'inondation et 86. il parla, disant dans la nuit : Je ferai pleuvoir du ciel abondamment. 87. Dans le jour où je célébrai sa fête, 88. le jour qu'il avait déterminé, j'eus peur, 89. j'entrai à l'intérieur du navire et je fermai ma porte. 90. Pour guider le vaisseau vers les lieux inaccessibles des grandes montagnes, au pilote 91. je confiai la demeure à sa main. 92. La fureur d'une tempête au matin 93. s'éleva, de l'horizon du ciel s'étendant et large. 94. Bin[19] au milieu du ciel tonna et 95. Nébo[20] et Sarou[21] s'avancèrent en face ; 96. les Dévastateurs[22] marchèrent sur les montagnes et les plaines ; 97. le destructeur Nergal[23] bouleversa ; 98. Adar marcha en avant et terrassa ; 99. les Esprits[24] portèrent la destruction ; 100. Dans leur gloire ils balayèrent la terre. 101. L'inondation de Bin atteignit jusqu'au ciel ; 102. la terre brillante fut changée en un désert[25] ; 103. [l'inondation] balaya la surface de la terre comme 104. elle détruisit toute vie de la face de la terre ; 105. la forte tempête sur le peuple atteignit jusqu'au ciel[26]. 106. Le frère ne vit plus son frère. Elle n'épargna pas le peuple. Dans le ciel 107. les dieux craignirent la tempête et 108. cherchèrent un refuge ; ils montèrent jusqu'au ciel d'Anou[27]. 109. Les dieux, comme des chiens cachant leurs queues, se blottirent. 110. Istar prononça un discours, 111. la plus grande des déesses parla sa parole : 112. Le monde a tourné au péché, et 113. alors, en la présence des dieux, j'ai prophétisé le malheur. 114. Quand en présence des dieux j'ai prophétisé le malheur 115. au malheur fut dévoué tout mon peuple, et j'ai, prophétisé 116. ainsi : J'ai donné naissance à l'homme ; qu'il ne soit plus 117. comme les petits des poissons qui remplissent la mer. 118. Les dieux ainsi que les Esprits pleuraient avec elle ; 119. les dieux sur leurs sièges étaient assis en lamentation ; 120. leurs lèvres étaient closes à cause du mal qui venait. 121. Six jours et [six] nuits 122. passèrent ; le tonnerre, la tempête et l'ouragan dominaient. 123. Dans le cours du septième jour l'ouragan se calma, et toute la tempête 124. qui avait détruit comme un tremblement de terre 125. s'apaisa. La mer se dessécha ; le vent et la tempête prirent fin. 126. Je fus porté à travers la mer. Celui qui avait fait le mal 127. et toute la race humaine qui avait tourné au péché, 128. comme des roseaux leurs corps flottaient. 129. J'ouvris la fenêtre, et la lumière entra sur mon refuge 130. elle passa ; je m'assis tranquille et 131. sur mon refuge vint la paix, 132. Je fus porté par-dessus le rivage à la limite de la mer ; 133. jusqu'à douze coudées en tout il (le vaisseau) monta au-dessus de la terre. 134. Au pays de Nizir[28] alla le vaisseau ; 135. la montagne de Nizir arrêta le vaisseau, et il ne put passer par-dessus. 136 : Le premier et le second jour la montagne de Nizir, la même ; 137. le troisième et le quatrième jour la montagne de Nizir, la même ; 138. le cinquième et le sixième jour la montagne de Nizir, la même. 139. Dans le cours du septième jour 140. je lâchai dehors une colombe, et elle partit. La colombe partit et chercha, et 141. de place de repos elle ne trouva point, et elle revint. 142. Je lâchai dehors une hirondelle, et elle partit. L'hirondelle partit et chercha, et 143. de place de repos elle ne trouva point, et elle revint. 144. Je lâchai dehors un corbeau, et il partit. 145. Le corbeau partit, et il vit les cadavres sur les eaux, et 146. il les mangea ; il nagea et il erra au loin, et il ne revint pas. 147. Je lâchai dehors les animaux aux quatre vents. Je versai une libation ; 148. je bâtis un autel sur le pic de la montagne ; 149. sept par sept je coupai des herbes ; 150. à la base je plaçai des roseaux, des pins et des arbres simgar[29]. 151. Les dieux se réunirent à sa conflagration ; les dieux se réunirent à sa bonne conflagration. 152. Les dieux comme des bancs de poissons se réunirent au-dessus du sacrifice. 153. De loin en même temps le Dieu suprême dans son approche 154. produisit la grande lumière d'Anou[30] ; alors la gloire 155. de ces dieux, pareille à une gemme brillante, je ne pouvais la supporter. 156. En ces jours je priai que pour toujours je n'eusse pas à souffrir : 157. Que les dieux viennent à mon autel ! 158. Que Bel ne vienne pas à mon autel ! 159. car il n'a pas eu de considération et il a fait un orage, 160. et il a voué mon peuple à l'abîme. 161. De loin en même temps Bel dans sa course 162. vit le vaisseau, et Bel alla plein de colère vers les dieux et les Esprits : 163. Que pas un ne sorte vivant, qu'aucun homme ne soit sauvé de l'abîme ! 164. Adar ouvrit sa bouche et parla, et dit au guerrier Bel : 165. Qui alors sera sauvé ? Nouah exprima sa volonté, 166. et Nouah savait toutes choses ; 167. Nouah ouvrit sa bouche et parla, et dit au guerrier Bel : 168. Toi, prince des dieux, guerrier, 169. quand tu as été irrité, tu as fait un orage. 170. Le pécheur a fait son péché, le malfaiteur a fait le mal ; 171. que celui qui est élevé ne soit pas brisé, que le captif ne soit pas délivré (?) 172. Au lieu que tu fasses [désormais] une tempête, que les lions s'accroissent et que les hommes soient réduits ; 173. au lieu que tu fasses une tempête, que les panthères s'accroissent et que les hommes soient réduits ; 174. au lieu que tu fasses une tempête, que la famine survienne et que le pays soit détruit ; 175. au lieu que tu fasses une tempête, que la peste s'accroisse et que les hommes soient détruits. 176. Je ne scrutai pas la sagesse des dieux 177. dans mon respect et mon attention ; ils envoyèrent un songe, et il entendit la sagesse des dieux. 178. Quand sa sentence fut décidée, Bel entra au milieu du vaisseau. 179. il prit ma main et me conduisit dehors, moi 180. il me conduisit dehors et fit amener ma femme à mon côté. 181. Il purifia le pays, il établit un pacte et prit [en main] le peuple 182. en présence de Sisithrus et du peuple. 183. Alors Sisithrus et le peuple pour être semblables aux dieux furent emmenés ; 184. alors Sisithrus habita dans un lieu écarté à l'embouchure des fleuves. 185. Ils me prirent et m'établirent dans un lieu écarté à l'embouchure des fleuves. 186. Quant à toi que les dieux ont choisi, toi et 187. la vie que tu as cherchée, tu la gagneras ; 188. fais ceci pendant six jours et six nuits 189. comme je dis ; liez-le dans des liens ; 190. la route (de la vie) comme une tempête s'élargira pour lui. 191. — Sisithrus de cette manière parla à sa femme : 192. — J'annonce que le chef qui s'attache à la vie 193. la route comme une tempête s'élargira pour lui. 194. — Sa femme en ces termes parla à Sisithus, de loin : 195. — Purifie-le et que l'homme soit renvoyé ; 196. par le chemin où il est venu qu'il retourne en paix ; 197. ouvre la grande porte et qu'il retourne en son pays. 198. — Sisithrus en ces termes parla à sa femme : 199. — Le cri d'un homme t'alarme. 200. Fais ceci ; pose sur sa tête ton vêtement de pourpre. 201. — Et le jour qu'il monta sur le flanc du vaisseau 202. elle le fit, et posa sur sa tête son vêtement de pourpre ; 203. et le jour qu'il monta sur le flanc du vaisseau... Ici s'arrête le texte continu et intact de l'exemplaire le mieux conservé ; il faut chercher la suite dans des fragments en fort mauvais état, présentant à chaque pas des lacunes qui ne contribuent pas médiocrement à l'obscurité du texte. On discerne seulement que les quatre lignes qui venaient immédiatement après décrivaient sept actes purificatoires accomplis par Izdubar. 208. Izdubar de cette manière parla à Sisithrus de loin : 209. — Par cette voie, elle a agi, je viens 210. joyeusement ; tu m'as donné ma force. 214. — Sisithrus en ces termes parla à Izdubar : 212. — . . . . . . . . . . ton vêtement de pourpre 213. . . . . . . . . . . je l'ai placé. 214. . . . . . . . . . . Les cinq lignes suivantes ont largement souffert ; elles continuent à se rapporter à la purification d'Izdubar. 219. Izdubar en ces termes parla à Sisithrus de loin : 220. — . . . . . Sisithrus, ne pouvons-nous aller à toi ? Vient une partie du texte extrêmement mutilée et dont il n'est possible de présenter qu'une analyse sommaire. Aux lignes 221 et 222 il est question d'un personnage qui a été pris par la mort et a habité avec elle. Les lignes 224 à 235 contiennent un discours de Sisithrus au nautonier Our-Bel ; il lui donne des indications pour guérir Izdubar, qui, d'après quelques passages fragmentaires, paraît avoir été atteint d'une maladie de la peau. H doit être plongé dans la mer, et son corps reviendra à sa beauté première. Dans les lignes 236 à 241, on rapporte l'effet de ce remède et la guérison complète d'Izdubar. 242. Izdubar et Our-Bel remontèrent dans le vaisseau ; 243. Là oh ils étaient placés ils naviguèrent. 244. Sa femme parla en ces termes à Sisithrus de loin : 245. — Izdubar s'en va, il est satisfait, il a accompli 246. ce que tu lui as ordonné, et il retourne dans son pays. 247. — Et il entendit, et à la suite d'Izdubar 248. il alla sur le rivage. 249. Sisithrus parla en ces termes à Izdubar 250. — Izdubar, tu t'en vas, tu es satisfait, tu as accompli 254. ce que je t'ai ordonné, et tu retournes dans ton pays. 252. Je t'ai révélé, ô Izdubar, l'histoire cachée. Les lignes 253 à 262, en très-mauvais état, contenaient la fin du discours de Sisithrus. Elles ajoutent ensuite qu'après l'avoir entendu, Izdubar prit de grandes pierres et en fit un monticule en mémoire de ces événements. Les lignes 263 à 289, également fort mutilées, rapportent encore des discours et des actions d'Izdubar et d'Our-Bel, pendant leur retour. Il y est question de longs voyages par terre, dont on précise l'étendue. On y parle aussi d'une lutte avec un lion. Ainsi se termine la tablette. M. Smith ne dit pas s'il a trouvé des fragments de la douzième, qui complétait le document et portait la fin de l'histoire d'Izdubar ou, comme nous l'avons conjecturé, de Nemrod. III Ce grand morceau de style poétique babylonien, aussi curieux par sa forme littéraire que par son sujet, méritait bien d'être cité en entier. Sauf que la circonstance des tablettes des écritures sacrées enfouies à Sippara y est passée sous silence, il offre jusque dans les détails les plus secondaires et les plus minutieux une concordance absolue avec le récit que Bérose présenta aux Grecs comme extrait des monuments indigènes. Celui-ci en est pour ainsi dire le squelette, le sec abrégé, dépouillé de toute couleur de poésie, mais extrait avec une fidélité merveilleuse. Nous saisissons ainsi sur le fait la manière dont le cadre fondamental des antiques légendes de Babylone a été résumé par Bérose d'abord, puis par ses abréviateurs, mais aussi le degré d'exactitude qu'il faut reconnaître à ses rapports. Un point capital a cependant été complètement laissé dans l'ombre dans les fragments que nous possédons des Antiquités chaldéennes, et sur la tablette cunéiforme met la tradition babylonienne dans une connexité encore plus étroite avec le récit biblique ; c'est que cette tradition présentait aussi le déluge comme un châtiment des péchés des hommes. Sur les seuls fragments de Bérose, on pouvait se demander si la traduction diluvienne était vraiment très-antique et indigène à Babylone, ou si elle n'était pas d'introduction assez récente et due à une influence des idées juives. Aujourd'hui le doute n'est plus possible ; la tradition était véritablement nationale et remontait à une extrême antiquité. Si les copies que l'on en possède ne datent que du VIIe siècle avant notre ère, le récit tracé sur les tablettes trouvées à Ninive avait certainement, d'après les raisons que nous avons indiquées plus haut, sa rédaction arrêtée plusieurs centaines d'années avant la naissance de Moïse. C'est donc le plus ancien de tous les récits subsistants du déluge. Mais il ne faut pas donner à la découverte de M. Smith plus d'importance qu'elle n'en a réellement au point de vue de la science sacrée. Car on ne saurait trouver dans cette narration toute mythique, et qui d'ailleurs n'ajoute rien d'essentiel à celle de Bérose, aucune preuve nouvelle de l'authenticité historique du cataclysme raconté par la Bible comme par la tradition babylonienne. La comparaison du récit de la tablette provenant originairement d'Érech et du récit biblique est, d'ailleurs, fort intéressante à faire. Les deux narrations suivent exactement la même marche dans le développement des faits, avec une conformité saisissante. C'est ce que le lecteur constatera tout de suite, s'il prend la peine d'établir le parallèle des deux textes de la manière que nous indiquons.
Aucun des autres récits du déluge, conservés chez tant de peuples divers, n'est aussi voisin que la narration babylonienne de celle de la Bible et ne pourrait se prêter à un parallèle aussi exact et aussi continu. Et ce parallélisme de la tradition biblique et de la tradition babylonienne ne se borne pas au récit du déluge. Il est aussi frappant lorsque l'on prend dans Bérose l'histoire de la création du monde ou celle de la Tour des langues et qu'on les met en regard du texte de la Genèse. Semblable parenté entre ce que les Babyloniens et les Hébreux racontaient des origines est, du reste, historiquement très-naturelle ; car le rédacteur de la Genèse, dans toute cette partie de son œuvre, a manifestement rassemblé les récits qui se conservaient d'âge en âge par la tradition orale parmi les descendants d'Abraham, dont quelques-uns même devaient avoir une rédaction écrite extrêmement antique ; et les Abrahamides étaient sortis de la ville d'Our, du cœur de la Chaldée, où leurs ancêtres avaient vécu longtemps avant la vocation du patriarche. Cependant, en ce qui est de la narration du déluge — la seule pour laquelle la comparaison puisse se faire d'une manière rigoureuse et probante, puisque c'est encore la seule dont nous possédions la rédaction babylonienne originale, les histoires de la création et de la Tour des langues n'étant connues que par le récit abrégé, et de seconde main de Bérose — en ce qui est de la narration du déluge, il est difficile maintenant de soutenir, ce que j'étais disposé à croire d'après les seuls fragments de Bérose, que le récit biblique est une sorte d'édition corrigée et épurée du récit babylonien, faite systématiquement sur un texte dont la rédaction fondamentale était arrêtée déjà dans ses points essentiels et faite de manière à effacer tout l'appareil mythologique et polythéiste, pour donner à la tradition l'empreinte d'un rigoureux et irréprochable monothéisme. Nous n'avons pas là deux récits dont l'un découle de l'autre, mais deux courants parallèles sortis de la même source, d'une tradition bien antérieure, qui suivent sans doute la même marche et présentent une très-remarquable conformité, mais qui ont pris malgré cela un caractère d'individualité distincte et ont certainement bifurqué avant l'époque où se fixa la rédaction que nous lisons sur les tablettes découvertes à Ninive. Je laisse à d'autres plus hardis le soin de se prononcer sur la question de savoir laquelle des deux versions doit être considérée comme la plus conforme à la tradition plus antique dont elles descendent également, la question de juger si les Chaldéens ont altéré cette première tradition ou si les Abrahamides l'ont épurée à la lumière de la révélation religieuse. Dans l'état actuel, c'est un problème où l'on ne peut guère se décider que par des raisons de sentiment et de foi ; la science pure et la critique ne donnent pas encore de moyens de le résoudre. Mais après avoir fait ressortir les analogies et le parallélisme des deux récits du déluge, nous ne serions pas complet si nous n'indiquions pas les différences principales qui établissent leur caractère individuel et leur dérivation indépendante d'une source commune. Je laisse de côté tout ce qui tient au caractère absolument monothéiste d'une des versions et à l'exubérant développement polythéiste de l'autre, car ceci s'accorderait aussi bien avec l'idée d'une simple édition expurgée de la tradition babylonienne dans la Bible. C'est précisément la nature de différences qui devrait se manifester seule dans cette hypothèse. Je m'attache à celles d'un autre ordre. Et d'abord voici l'une des plus frappantes et des plus essentielles. La narration biblique porte l'empreinte d'un peuple qui vit au milieu des terres et ignore les choses de la navigation. Dans la Genèse le nom de l'arche, tébâh, signifie coffre, et non vaisseau ; il n'y est pas question de la mise à l'eau de l'arche ; aucune mention ni de la mer, ni de la navigation ; point de pilote. Au contraire, dans la rédaction d'Érech, tout indique qu'elle a été composée chez un peuple maritime ; chaque circonstance porte le reflet ses mœurs et des coutumes des riverains du golfe Persique. Sisithrus monte sur un navire formellement désigné par le mot propre ; ce navire est mis à l'eau ; il est éprouvé par une navigation d'essai ; toutes ses fentes sont calfatées avec du bitume ; il est confié à un pilote. Et comme l'a judicieusement remarqué le savant ecclésiastique qui déguise modestement son nom dans la Revue des questions historiques sous le pseudonyme de F. Grégoire, la couleur particulière que le rédacteur de la Genèse a laissée empreinte de cette manière dans le récit du déluge est un exemple frappant de la fidélité avec laquelle il reproduisait la forme même des traditions et des documents antérieurs qu'il mettait en œuvre ; car la Genèse n'ignore pas ailleurs à ce degré les termes propres aux choses maritimes ; on y trouve des mentions de la mer, yam, des ports, hhôph, et des navires, onyyôth[31]. D'accord avec Bérose, la tablette assyro-babylonienne représente Sisithrus comme un roi qui monte dans le vaisseau entouré de compagnons et de soldats ; dans la Bible il n'y a que la famille de Noé qui soit sauvée avec lui ; la nouvelle humanité n'a pas d'autre souche que les trois fils du patriarche. Pas de trace aussi dans le poème chaldéen de la distinction biblique des animaux purs et impurs et du nombre de sept couples pour chaque espèce des premiers, bien qu'en Babylonie le nombre sept eût un caractère tout à fait sacramentel. Pour les dimensions de l'arche nous trouvons un désaccord, non seulement entre la Bible et la tablette copiée par ordre d'Assourbanipal, mais entre celle-ci et Bérose. La Genèse et le document cunéiforme évaluent en coudées la dimension de l'arche ; Bérose la compte en stades. Les chiffres de la longueur et de la largeur sont perdus dans le texte retrouvé par M. Smith ; mais la Genèse les met entre eux dans le rapport de 6 à 1 et Bérose de 5 à 2. En revanche, les fragments de Bérose ne parlent pas du rapport des dimensions de hauteur et de largeur, et l'inscription dit que ces dimensions étaient égales, tandis que la Bible parle de 30 coudées de hauteur et de 50 de largeur. Autre divergence sur la hauteur de l'inondation ; dans la Bible elle dépasse de 15 coudées les plus hautes montagnes ; dans la version babylonienne il est question d'un niveau de 12 coudées, et s'il n'est pas sûr que le poète se représentât la montagne de Nizir comme constamment émergeant des eaux du déluge, il est certain du moins que d'après lui le vaisseau de Sisithrus ne put passer par dessus. Mais ces différences de chiffres n'ont qu'une importance secondaire ; c'est la chose où il s'introduit le plus vite des altérations et des variantes entre les éditions diverses d'un même récit. Il ne faut pas non plus attacher une valeur bien grande aux divergences légères qui se montrent entre les deux textes au sujet de l'envoi des oiseaux, car la tablette cunéiforme ajoute l'hirondelle à la colombe et au corbeau, et intervertit le rôle de ces deux animaux par rapport à ce qu'il est dans la Genèse. Ici la concordance sur le point essentiel l'emporte de beaucoup sur les variantes. Mais ce qui est tout à fait sérieux et décisif pour l'indépendance des deux versions dans les rédactions que nous en possédons, c'est qu'elles ne s'accordent pas sur la durée du déluge et l'époque de l'année où il se produit. Le récit biblique et celui du vieux poème d'Érech portent ici la trace manifeste de l'application d'idées calendaires différentes à l'antique tradition. Et cette divergence est d'autant plus remarquable que les diverses phases du déluge dans la Genèse sont incontestablement en rapport avec l'ordre habituel des saisons et les phénomènes atmosphériques dans la Babylonie et la Chaldée ; d'où il faut conclure que le système de la tradition des Abrahamides s'était formé pendant le séjour de leurs ancêtres Our des Chaldéens. Dans la narration biblique, les époques du déluge sont indiquées par les numéros d'ordre des mois ; mais ces numéros d'ordre se rapportent à une année commençant le 1er tischri, à l'équinoxe d'automne ; c'est ce qu'avait déjà reconnu Josèphe et ce que, parmi les modernes, Michaëlis a établi d'un manière définitive. La pluie commence à tomber, et Noé entre dans l'arche le dix-septième jour du second mois, c'est-à-dire de marchesvan ; quarante jours après, au solstice d'hiver, quand le soleil entre dans le signe de Capricorne, l'inondation est dans son plein, et l'arche commence à flotter. Ceci s'accorde avec une théorie astrologique d'origine chaldéenne, que Sénèque[32] attribue à Bérose et qui, nous le verrons plus loin, n'a pas eu d'influence sur le rédacteur d'Érech, théorie d'après laquelle les déluges reviendraient périodiquement toutes les fois que les cinq planètes, le soleil et la lune se trouvent en conjonction dans le signe du Capricorne[33]. La grande force des eaux dure encore cent cinquante jours, et le 17 du septième mois, c'est-à-dire de nisan, l'arche s'arrête sur le mont Ararat. Le premier jour du dixième mois ou de tammuz, vers le solstice d'été, les montagnes sont découvertes. C'est précisément le moment où les eaux de l'Euphrate et du Tigre abandonnent les terres qu'elles ont inondées ; aussi est-ce le dernier jour de sivan que les prescriptions de la religion chaldéo-assyrienne ordonnaient de placer la cérémonie du moulage des briques pour les édifices sacrés et royaux, cérémonie dont les conditions du climat avaient déterminé l'époque. Quarante jours après, dans le mois d'ab, que les Babyloniens appelaient le mois du feu, au moment de la plus grande chaleur des jours caniculaires, Noé, comprenant que la terre doit commencer à être séchée, envoie les oiseaux à la découverte. Enfin c'est le premier jour du premier mois de l'année suivante, c'est-à-dire de tischri, à l'équinoxe d'automne, que Noé sort de l'arche. La délivrance du père de la nouvelle humanité et le pacte de Dieu avec lui et sa race se placent donc précisément au jour où une opinion très-ancienne, qui s'est maintenue parmi les Juifs, fixait la création du monde. La durée du cataclysme est bien plus courte dans le récit découvert par M. Smith. La fureur du déluge, de son commencement à son point culminant, dure seulement sept jours, et sept autres s'écoulent depuis la fin de la tempête et l'arrêt du vaisseau de Sisithrus sur la montage de Nizir jusqu'à l'envoi des oiseaux. Cette version est manifestement dominée par l'idée de la heptade planétaire, qui a aussi servi de point de départ à l'invention de la semaine. Quant à l'époque de l'année où commence le déluge, la tablette cunéiforme n'est pas plus d'accord avec Bérose qu'avec la Bible. Pour l'auteur des Antiquités chaldaïques, le déluge a commencé le 15 du mois macédonien de dæsius, c'est-à-dire du mois babylonien de sivan, aux environs du solstice d'été. Même si l'on admet une erreur dans son texte, si l'on suppose, comme je l'ai fait ailleurs, qu'il a pris le troisième mois dans le comput partant du 1er tischri, pour le troisième mois du comput partant du 1er nisan, c'est du 15 kislev, un peu avant le solstice d'hiver et l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne, que les documents suivis par lui plaçaient le cataclysme. Dans la tablette, sans doute, la date n'est pas exprimée formellement, mais l'économie générale de l'épopée d'Izdubar ne permet guère de douter, comme nous le montrerons un peu plus loin, que le récit du déluge n'y fût mis originairement en rapport avec le mois de schebat. Et ce système, comme nous le montrerons aussi, a été celui des inventeurs chaldéens du zodiaque, puisque le signe du mois de schebat y est celui du Verseau. Il me paraît donc extrêmement probable que sur ce point il y avait des opinions diverses, suivant les localités de la Chaldée et les écoles sacerdotales. Enfin là où le récit épique babylonien et le récit de la
Bible s'écartent d'une manière absolue, c'est quand il s'agit de ce que devient
le juste sauvé du déluge après le cataclysme. Noé vit encore trois cent
cinquante ans au milieu de ses descendants et meurt âgé de neuf cent
cinquante ans. Sisithrus reçoit le privilège de l'immortalité ; il est enlevé
pour être semblable aux dieux et transporté dans un lieu écarté, où Izdubar va le visiter pour apprendre les
secrets de la vie et de la mort. Mais la Bible raconte quelque chose
d'analogue de l'arrière-grand-père de Noé. Tous les
jours d'Enoch furent trois cent soixante-cinq ans ; — Enoch marchait dans la voie de Dieu, et il ne fut plus,
car Dieu l'enleva. Or il me semble qu'on ne peut regarder en bonne
critique comme une coïncidence purement fortuite le fait signalé par M. Sayce[34] ; c'est que le
nom du père de Sisithrus dans le document cunéiforme, Oubaratoutou, nom
emprunté à la langue accadienne, signifie dans cet idiome splendeur rutilante du soleil couchant ubara-tutu[35], et que le nom
du père d'Enoch dans la Bible, Yirad (Jared dans la Vulgate), veut dire en hébreu descente, couchant. La tradition babylonienne
réunissait donc sur le personnage de Sisithrus les faits que la Bible
distingue entre ceux d'Enoch et de Noé, et le nom du père d'Enoch correspond
en hébreu, pour sa signification, à celui du père de Sisithrus en accadien. Il reste un dernier point de vue, et qui n'est pas le moins curieux, à signaler avant de terminer cette comparaison minutieuse du récit babylonien et du récit biblique du déluge. Les chapitres relatifs au déluge sont une des parties de la Genèse où l'on constate le plus manifestement et où l'on peut le mieux saisir sur le fait l'emploi de documents originairement détachés ou la combinaison de plusieurs récits suivis, distincts avant la rédaction définitive du livre, et plus tard fondus en un seul. Car ces deux hypothèses entre lesquelles se sont partagés les critiques peuvent faire valoir des arguments sérieux en leur faveur, et de plus, l'une ou l'autre sont admissibles pour les savants mêmes qui tiennent le plus à rester dans l'orthodoxie ; en effet, elles n'entraînent aucune conséquence absolue sur la date de la rédaction finale, question où l'autorité des Pères de l'Église ; de saint Jérôme entre autres[36], laisse à l'exégèse une latitude beaucoup plus grande qu'on ne se l'imagine généralement. Quoi qu'il en soit, il est impossible de lire la narration du déluge dans le texte hébreu sans y discerner deux récits distincts, dont des différences caractéristiques de style font faire aisément le départ, récits dont chacun est complet en soi-même et qui relatent exactement les mêmes faits ; l'un de ces récits me paraît incontestablement anté-mosaïque. Le dernier rédacteur les a combinés avec un art remarquable, mais qui n'empêche pas que tous les incidents du commencement et de la fin de l'histoire sont répétés deux fois avec les mêmes circonstances et presque les mêmes termes. C'est ce que montre la comparaison des versets parallèles empruntés aux deux rédactions originaires et fondus en seul tout, mais qu'on distingue ainsi :
Le parallélisme est moins exact entre VIII, 21 et 22, style du premier document, et IX, 8-11, style du second, et il n'y aurait vraiment pas à y chercher des morceaux provenant de deux rédactions distinctes à l'origine, si l'existence de ces deux rédactions premières n'était pas attestée par les parallélismes que nous venons d'indiquer, trop nombreux et trop suivis pour qu'on y voie seulement de ces retours de pensée qui se produisent souvent sous la plume d'un écrivain qui compose une rédaction complètement originale. Eh bien le récit poétique babylonien tracé sur les tablettes qu'Assourbanipal fit copier à Érech porte aussi l'empreinte manifeste et incontestable de la compilation des fragments de compositions antérieures, compilation faite avec bien moins d'art que dans le récit de la Genèse, car elle n'amène pas seulement des retours de pensée, des répétitions, mais des contradictions graves. Ainsi, après le premier récit de la sortie de Sisithrus de son vaisseau, dans les lignes 147-155, à la ligne 156 nous en voyons commencer un autre qui va jusqu'à la ligne 182, et qui, non seulement fait double emploi avec ce qui précède et reprend les faits de plus haut, mais encore tranche absolument avec le reste de la narration et porte la marque d'une autre origine. En effet, c'est Bel qui y est donné comme le dieu vengeur dont la colère suscite le déluge, tandis que dans les autres parties ce rôle est attribué à Samas (l. 82-86), qui a Bin pour principal exécuteur de ses volontés. Ailleurs la combinaison de fragments d'origines diverses se reconnaît encore, bien qu'elle ne donne pas naissance à des contradictions de la même nature. Ainsi, après un premier récit de l'entrée dans le vaisseau (l. 77-81), qui finit en disant : Samas fit une inondation (l. 82), vient un second récit de la même entrée (87-91), après quoi reprend : La fureur d'une tempête au matin s'éleva (l. 92). La combinaison des deux documents que nous distinguons après tant d'autres critiques fait aussi que dans la Genèse, après une première narration de l'entrée dans l'arche (VII, 6-9) et une première mention de la rupture des sources du grand abîme et de l'ouverture des écluses du ciel, ainsi que des quarante jours et quarante nuits de pluie (VII, 10-12), on voit revenir un second récit de l'entrée dans l'arche, en termes presque semblables à ceux du premier (VII, 13-16), à la suite de quoi reprend l'indication de la pluie de quarante jours et quarante nuits (VII, 17). IV Mais la narration du déluge n'est qu'un épisode dans la grande épopée d'Izdubar. Il importe d'étudier maintenant celle-ci dans son ensemble et d'essayer d'en pénétrer l'intention et l'économie. Et d'abord quel en est le héros ? Nous l'avons déjà dit, Izdubar est formellement donné comme un dieu dans d'autres textes ; c'est un personnage de l'Olympe chaldéo-assyrien transformé en héros dans le cycle épique. Ainsi que l'ont reconnu sir Henry Rawlinson, M. Sayce et M. Oppert, il n'est autre que l'antique dieu accadien du Feu, dont le culte paraît avoir eu beaucoup d'importance aux époques primitives et qui joue un rôle de premier ordre dans les vieux hymnes magiques en langue accadienne, réunis en collection, avec une traduction assyrienne, par les hiérogrammates d'Assourbanipal. Ce dieu passa ensuite au second plan quand le système savant et hiérarchisé de la religion babylonienne se fut définitivement constitué vers le temps de Sargon Ier, à la suite d'un grand travail sacerdotal comparable à celui des Brahmanes dans l'Inde. Dans les documents de la période assyrienne, nous ne le trouvons cité qu'une fois, comme un des Dii minores. On pourrait citer chez plus d'un peuple de l'antiquité d'autres exemples de dieux jadis au premier rang auxquels la tradition poétique assure un refuge parmi les héros de l'épopée quand ils ont perdu leur importance divine prépondérante. Le nom du dieu accadien du feu s'écrit idéographiquement en faisant suivre le déterminatif de l'idée de dieu des deux signes iz-bar, dont la réunion s'emploie fréquemment dans les textes pour exprimer, à titre d'idéogramme complexe, la notion de feu, ou des deux signes ne-gi dont la réunion est usitée au même titre pour dire flamme. La différence entre J'orthographe par les signes iz-bar et celle par les signes iz-dhu-bar consiste dans l'introduction du caractère dhu, qui a la valeur de masse ; nous avons là deux expressions accadiennes, bar, feu, et dhu-bar, masse de feu, précédées l'une et l'autre du signe iz employé comme déterminatif aphone. Si nous ignorons donc comment ce dieu igné s'appelait en assyrien, nous discernons que les Accadiens lui donnaient trois noms différents, susceptibles de s'échanger et signifiant l'un flamme, l'autre feu, le troisième masse de feu. C'est ce dernier qui lui appartient spécialement dans l'épopée, et en effet ses aventures, comme nous allons le voir, montrent qu'il n'y était envisagé que sous un aspect solaire. Ces remarques sur la nature d'Izdubar comme dieu ne portent pas atteinte au rapprochement que nous avons fait entre ses exploits héroïques, sa tétrapole, son rôle de conquérant et de dompteur de monstres, et la légende de Nemrod rappelée par la Bible. Sir Henri Rawlinson l'a parfaitement reconnu. Feu, dit-il[37], est l'élément principal du nom. De là l'application, faite par les Grecs, au sage antique de Babylone du titre de Zoroastre, qu'on dit avoir non seulement enseigné aux Babyloniens l'astronomie et l'astrologie, mais aussi avoir introduit le culte du feu. Les Juifs et les premiers chrétiens comparèrent ce Zoroastre avec le Nemrod de la Bible, et c'est de là que naquirent les traditions qui, par la Babylonie, rapprochèrent Nemrod du feu. Qui ne connaît en effet le cycle des légendes judéo-musulmanes sur la fournaise de Nemrod, légendes qui se rattachent évidemment à des idées et à des traditions antiques ? Le point où je m'écarte de l'illustre assyriologue anglais, c'est en ce que je tiens pour appartenant à l'essence primitive de la tradition le rapprochement où il voit l'œuvre postérieure des Juifs. Quand la Genèse parle de Nemrod, elle fait directement et en termes formels allusion à une légende populaire ; mais de cette légende elle ne pouvait accepter que le côté qui faisait de Nemrod une personnification ethnique de la conquête kouschite en Chaldée et en Babylonie, et de la fondation de son empire. Et c'est ce qu'a fait l'écrivain sacré, tandis que toutes les vraisemblances tendent à faire croire que dans la légende babylonienne originale à laquelle il se réfère la personnification de la conquête s'identifiait avec le dieu du feu, comme nous le voyons dans l'épopée d'Izdubar, que nous croyons n'être qu'une rédaction de cette légende. Une observation féconde de sir Henry Rawlinsoft, à laquelle on regrette seulement que ce savant n'ait pas donné plus de développements, jette la lumière sur le plan et l'intention de l'épopée d'Érech, de la forme qu'y a reçue la tradition d'Izdubar. C'est que le dieu du feu y est envisagé sous un aspect calendaire et confondu avec le soleil ; que la division du texte original en douze tablettes formant autant de chants distincts, dont chacun est consacré à un épisode principal, a une importance fondamentale dans le plan du poème, de telle façon qu'elle a été scrupuleusement conservée dans toutes les copies ; enfin que les épisodes qui forment la matière de ces douze tablettes sont en rapport avec les douze mois de l'année et les signes du zodiaque. Ici quelques explications préliminaires sont indispensables. L'origine chaldéenne du zodiaque est un fait désormais incontestable et qui ne fait plus question dans la science ; j'ai essayé ailleurs[38] d'en rassembler toutes les preuves fournies par les monuments écrits ou figurés de Babylone et de l'Assyrie, et je pourrais aujourd'hui grossir encore notablement le faisceau de ces preuves par de nouveaux passages empruntés aux textes cunéiformes. La nomenclature des signes, telle qu'elle s'est conservée jusqu'à nos jours, ne diffère en rien d'essentiel de celle qu'avaient établie les prêtres astronomes de la Chaldée et de Babylone. Eu effet, d'après les passages écrits des documents astrologiques et d'après les figures zodiacales qui se rencontrent sur un grand nombre de monuments, particulièrement sur les cylindres, on est en mesure de rétablir ainsi la série des signes telle que l'admettaient les Chaldéens : 1. Le bélier ou l'ibex ; 2. Le taureau ; quelquefois il est représenté ailé ou avec une face humaine ; 3. Les gémeaux, exprimés par deux petites figures viriles superposées ; 4. L'écrevisse ou le homard ; 5. Le lion, remplacé quelquefois par le groupe du lion dévorant le taureau ; 6. L'archère, mentionnée par les textes, mais dont on n'a pas encore observé la figure ; 7. Les pinces du scorpion ; 8. Le scorpion ; il résulte formellement d'une tablette encore inédite sur les mouvements de la planète Vénus, que j'ai eu l'occasion d'étudier à Londres, qu'on réunissait quelquefois ce signe avec le précédent sous le nom commun du scorpion, qui était alors compté comme un signe double des autres en étendue ; 9. La flèche, que remplace aussi, mais très-rarement, le sagittaire tirant de l'arc ; 10. La chèvre, dont le corps se termine souvent en queue de poisson ; 11. Le verseau, dont la figure se réduit le plus habituellement à celle d'un vase d'où coule de l'eau ; 12. Le poisson ou les poissons. Ce sont évidemment des raisons mythologiques qui ont fait assigner ces noms et ces figures aux constellations de la bande zodiacale, car on y chercherait vainement une relation directe avec les travaux de l'agriculture et les phases des saisons envisagées à ce point de vue. On sait à quelles conjectures sans fondements l'école de Dupuis recourait pour trouver une relation de ce genre, puisqu'elle était obligée de reporter l'invention du zodiaque à une époque fabuleusement reculée, afin d'atteindre un temps où, grâce à la précession des équinoxes, la présence du soleil dans le taureau coïncidât avec le moment du labourage, et ainsi de suite. Quelques éclaircissements sur les mythes qui ont déterminé les noms des signes du zodiaque sont fournis par la double nomenclature des mois dans les textes cunéiformes. A Babylone et à Ninive, à l'époque où la langue improprement appelée assyrienne — et qu'il serait plus exact, je crois, de dire sumérienne — dominait presque exclusivement, on désignait les douze mois de l'année par les noms d'origine sémitique, très-difficiles à expliquer, du reste, qu'ont ensuite adoptés les Juifs et la majorité des Sémites ; mais dans les textes cunéiformes on n'écrivait que rarement ces noms en caractères phonétiques. Le plus souvent on les remplaçait par l'emploi d'un signe idéographique affecté à la désignation de chaque mois. Le sens de ces signes idéographiques n'a aucun rapport avec le sens que l'on peut parvenir à discerner sous le nom sémitique correspondant. Ils constituent donc une seconde nomenclature symbolique et religieuse, tout à fait distincte, et une précieuse tablette du Musée Britannique révèle que cette désignation de chaque mois par un idéogramme simple n'est qu'une abréviation d'une antique nomenclature accadienne, où les appellations des mois, plus développées, se référaient toutes à des mythes. Or, il suffit de jeter un coup d'œil sur la vieille nomenclature mythique des Accadiens, qui malheureusement n'est parvenue à nous qu'incomplète, pour y apercevoir une parenté entre la fable à laquelle font allusion plusieurs de ces noms et l'appellation du signe correspondant au même mois dans le zodiaque. Je réunis dans un tableau le double système d'indication des mois dans les textes assyriens avec la nomenclature accadienne plus développée, et de plus avec l'indication de l'époque de notre année où se place chaque mois et du signe zodiacal qui y répond.
Ce sont ces mythes relatifs aux mois et ayant produit leur nomenclature accadienne qui, comme l'a reconnu sir Henry Rawlinson, formaient le sujet de chacune des douze tablettes ou de chacun des douze chants du poème épique dont M. Smith a retrouvé les débris. L'histoire héroïque d'Izdubar leur servait de lien commun et de cadre, et ils y étaient tous introduits successivement et dans leur ordre calendaire, les uns comme aventures du héros, les autres sous la forme d'incidences et de récits épisodiques, comme celui du déluge. En effet, l'aventure culminante de la seconde tablette était la capture du bœuf ailé par Izdubar, et le second mois de l'année est le mois du taureau favorable (ab gut s'idi en accadien), de même que le signe qui y correspond celui du taureau. C'est la quatrième tablette qui comprenait l'histoire du monstre marin Boul, de ses ravages et de sa défaite ; or, le quatrième mois est celui du saisisseur de la semence (ab su muna), qualification qui s'applique d'une manière tout à fait exacte au monstre mythique. Le signe qui répond à ce mois est l'écrevisse ou le homard, devenu dans notre zodiaque le cancer ; c'est donc probablement sous cette forme qu'on se figurait l'être malfaisant sorti de la mer dont la légende plaçait la destruction par un héros solaire au moment du solstice d'été. Le dieu présidant à ce mois est Adar, un dieu guerrier et destructeur de monstres par excellence. Le sixième mois s'appelle le mois du message d'Istar (ab kin Tiskhuna), et un passage du prisme d'Assourbanipal atteste formellement que l'archère, devenue pour nous la vierge, qui répond à ce mois dans le zodiaque, n'est autre que la déesse Istar, la déesse présidant au même mois d'après les calendriers des fêtes religieuses. Il le qualifie en effet de mois de la constellation lumineuse de l'archère, fille de Sin, et ailleurs, quand il raconte une apparition d'Istar, donnée toujours comme fille de Sin, il décrit cette déesse en archère : à droite et à gauche elle était entourée d'une auréole flamboyante ; elle portait un arc dans sa main, prête à décocher une flèche puissante pour combattre[39]. Si nous nous reportons maintenant à l'épopée que le même roi avait fait copier à Érech, nous y constaterons que c'est précisément la sixième tablette qui s'ouvrait par le message d'amour d'Istar à Izdubar, que nous avons cité plus haut, et qui racontait le mariage de la déesse et du héros. Des concordances aussi exactes, et qui se répètent ainsi sans manquer pour toutes les tablettes dont nous connaissons le sujet, ne peuvent être l'effet du hasard. Sir Henry Rawlinson a signalé les trois précédentes ; mais il a négligé celle-ci, qui ne me paraît pas moins significative. La cinquième tablette a pour sujet la conquête d'Érech par Izdubar, et le cinquième mois, coïncidant avec les jours caniculaires, a pour signe zodiacal le lion et pour nom celui de mois du feu brûlant (ab bilbilna). Cette dernière expression est très-clairement expliquée, et le phénomène atmosphérique de la saison présenté sous la forme d'un mythe en action dans une des inscriptions de Sargon : c le mois d'ab, qui est le mois de la descente du dieu du feu, chassant les nuées humides[40]. Cette victoire du soleil brûlant de l'été, considéré à ce titre sous son aspect le plus spécialement igné, sur les nuages pluvieux, n'est pas moins clairement indiquée lorsque — et nous avons déjà remarqué que c'était le plus souvent — le simple lion est remplacé comme figure du zodiaque par le groupe du lion terrassant le taureau ; car dans la symbolique de toutes les religions de l'Asie, ce groupe exprime le triomphe du principe igné, personnifié par le lion, sur le principe humide, auquel appartient le taureau. La manière dont une semblable notion devait naturellement se présenter dans l'épopée était comme une conquête guerrière accomplie par le dieu du feu, dont Izdubar, nous l'avons dit, est la forme héroïque, et la conquête épique d'Érech à ce point de vue est d'autant plus remarquable qu'Érech était la grande nécropole de la Chaldée, la cité des morts et des dieux infernaux. Non moins probante est la coïncidence qui met le récit du déluge dans la onzième tablette, qui fait de cet épisode le sujet principal du onzième chant du poème ; et sir Henry Rawlinson a justement insisté sur ce point. Nous avons vu plus haut qu'il parait y avoir eu entre les différentes écoles sacerdotales de la Chaldée des divergences d'opinion sur l'époque de l'année où aurait eu lieu le déluge. Un système le plaçait au solstice d'hiver. Mais une autre opinion, plus ancienne peut-être ou du moins très-répandue aux époques les plus anciennes, rapportait le déluge au mois suivant, au onzième mois de l'année, à l'époque des grandes pluies qui dans le bassin de l'Euphrate et du Tigre marquent la fin de l'hiver ; et c'est indubitablement cette opinion qui a déterminé la figure donnée par les Chaldéens au signe correspondant au onzième mois, au signe du verseau ou du vase laissant échapper les eaux. En effet, des témoignages antiques formels disent que le verseau est Deucalion-Sisithrus[41]. Dans les calendriers des fêtes sacrées, par suite de la même tradition, le onzième mois est consacré à Bin, l'inondateur, le dieu qui répand les pluies, le dieu qui dans le récit épique (l. 94), obéissant aux ordres de Sauras, est le principal agent de la production du déluge. Le nom accadien développé du onzième mois n'est malheureusement pas connu jusqu'à présent ; et l'idéogramme affecté à la désignation de ce mois est susceptible de plusieurs sens fort divers, entre lesquels le manque du nom plus développé ne permet pas de choisir avec certitude. Il peut vouloir dire le mois de l'arpentage, ce qui se rapporterait à une opération agraire que la religion aurait fixée à cette époque, peut-être en souvenir de la nouvelle distribution des terres entre les compagnons de Sisithrus quand ils restituèrent Babylone, suivant les expressions de Bérose ; on pourrait même invoquer en faveur de cette interprétation la présence constante des figures des quatre signes des mois de la saison pluvieuse, le scorpion, la flèche, la chèvre et le verseau, parmi les symboles astronomiques sculptés sur les bornes de fonds de terre, comme le fameux Caillon Michaux de notre Bibliothèque nationale[42]. Mais il peut également signifier, d'après une autre acception de l'idéogramme dont les textes magiques nous offrent de fréquents exemples, le mois de la malédiction, et ceci semblerait plutôt nous ramener au souvenir du cataclysme. La onzième tablette de l'épopée d'Érech ne contient pas seulement, du reste, le récit épisodique du déluge ; toute la fin en est occupée par un autre fait appartenant directement à l'histoire d'Izdubar et méritant aussi d'être pris en sérieuse considération, si l'on veut se rendre un compte exact de l'intention générale et de la signification du poème. C'est la guérison d'Izdubar, qui, sur les indications de Sisithrus, est plongé dans la mer et en ressort délivré de la maladie de peau qui lui a fait craindre la mort. C'est le mythe védique d'Indra, remarque très-judicieusement M. Angelo de Gubernatis[43] ; c'est aussi le mythe hellénique de Tithon. La maladie des rois héroïques est la lèpre ; la lèpre est la vieillesse, dont on se guérit seulement, suivant la croyance populaire, ou par l'eau de jeunesse ou par le sang d'un enfant ; le vieux héros solaire, le soleil moribond, se rajeunit au matin après avoir traversé la mer de la nuit. Ajoutons que tous les peuples antiques ont constamment assimilé la course annuelle du soleil à sa course diurne ; si le soleil se rajeunit chaque jour au matin après s'être baigné dans les eaux de la nuit, il vieillit aussi chaque année et semble moribond pour prendre une nouvelle vigueur et une nouvelle jeunesse après avoir traversé l'hiver. Le mythe trouve aussi bien son application dans ce phénomène périodique, qui présente la même alternance de déclin et de rajeunissement que le phénomène quotidien. Or, le moment où le soleil commence à retrouver sa force et à reprendre une marche ascendante, le moment où il est guéri de sa maladie annuelle et cesse de craindre la mort, est précisément le onzième mois de l'année chaldéo-assyrienne, le mois qui suit celui du solstice d'hiver. Mais s'il en est ainsi, l'époque culminante de la décadence et de la lèpre du dieu solaire et igné doit être dans le mois précédent, au solstice. C'est en effet ce que nous observons dans le poème. La maladie symbolique d'Izdubar, qui décide son voyagé à la recherche de Sisithrus, y ouvre la dixième tablette ; et en même temps, dans la nomenclature accadienne des mois, le dixième s'appelle e le mois de la tache du soleil déclinant (ab abna ud di), nom dans lequel il est difficile de ne pas reconnaître une allusion à la même fable. Ici encore la signification calendaire de la légende d'Izdubar, et le rapport de ses épisodes successifs avec les mois de l'année et les phases de la révolution du soleil, se dessine avec une grande netteté. Les observations qui précèdent nous amènent, comme on le voit, à élargir le point de vue ouvert si heureusement par sir Henry Rawlinson, et à poser deux ordres de conclusions : 1° Les Chaldéens et les Babyloniens avaient sur les douze mois de l'année des mythes appartenant pour la plupart à la série des traditions antérieures à la séparation des grandes races de l'humanité descendues du plateau de Pamir, car ils ont leurs analogues chez les Sémites purs et chez les nations aryennes ; ces mythes ont été localisés par eux dans les différentes époques de l'année, quand ils habitaient déjà les plaines de l'Euphrate et du Tigre, non au point de vue des occupations agricoles, mais en rapport avec les grands phénomènes périodiques de l'atmosphère et les phases de la marche annuelle du soleil, telle qu'elle se manifestait dans cette région ; de là sont venues les figures attribuées aux douze mansions solaires dans le zodiaque et les noms symboliques donnés aux mois par les Accadiens. 2° Ce sont ces mythes dont la succession et l'enchainement servaient de fondement à l'histoire épique d'Izdubar, le héros igné et solaire, et dans le poème qu'Assourbanipal fit copier à Érech chacun d'eux faisait l'objet d'une des douze tablettes, répondant comme douze chants distincts aux douze mois de l'année. Malheureusement l'état de mutilation de l'épopée d'Izdubar n'a laissé parvenir jusqu'à nous qu'une partie des épisodes auxquels elle servait de cadre ; six des tablettes, celles qui correspondaient aux 1er, 3e, 7e, 8e, 9e et 12e mois, ont disparu, ou du moins il n'en reste pas de vestiges suffisants pour qu'on puisse en déterminer les sujets. Mais il n'est pas absolument impossible de chercher, par la comparaison de la désignation du signe zodiacal et de l'appellation du mois dans la nomenclature symbolique accadienne, à retrouver ce que pouvaient être les mythes se rapportant à quelques-uns de ces mois. Il est du moins en ce genre une coïncidence qui me frappe et qui a cela de curieux qu'elle nous conduit à entrevoir encore un point de contact entre les traditions babyloniennes et les souvenirs primitifs de la Bible. Le troisième mois de l'année, sivan, s'appelle le mois de la construction en briques (ab munga), et c'est dans ce mois, comme je l'ai déjà remarqué plus haut, qu'une prescription rituelle fixait la cérémonie liturgique du moulage des briques pour les constructions sacrées et les édifices royaux. La religion consacrait ici un usage résultant des conditions physiques du climat. En Chaldée et en Babylonie, on bâtissait la masse des édifices en briques simplement séchées au soleil. Le mois de sivan, mai-juin, coïncide avec le moment où les eaux de l'Euphrate et du Tigre, accrues pendant mars et avril, commencent à baisser ; l'état de la terre, abandonnée par les fleuves, permet alors de mouler facilement des briques que l'on fait ensuite sécher par le soleil, ardent déjà à cette époque ; mais il ne fait pas encore assez chaud pour que la brique crue se fendille, ce qui arriverait inévitablement si on la faisait sécher en juillet ou en août. En voyant attestée par les inscriptions royales l'importance solennelle qu'avait au point de vue religieux la cérémonie de la fabrication des briques, et en constatant qu'elle est rappelée par le nom symbolique du mois, il est difficile de ne pas croire que le mythe s'y rapportait aussi, qu'il avait trait à une fondation de ville, sans doute de la première ville. Or, le signe du troisième mois dans le zodiaque était pour les Chaldéens, comme pour nous encore, te signe des gémeaux. Comment, dès lors, ne pas se souvenir du récit biblique qui lie la construction de la première ville au premier meurtre, perpétré par un frère sur son frère ? C'est en effet une des notions communes au plus grand nombre de peuples, une de ces notions tout à fait primitives antérieures à la dispersion des grandes races civilisées et qui se retrouvent chez presque toutes, que la tradition qui rattache une fondation de ville à un fratricide ; et il y aurait une étude curieuse à faire pour en suivre toutes les formes depuis Caïn bâtissant la première ville, Hanoch, après avoir assassiné Abel, jusqu'à Romulus fondant Rome dans le sang de son frère Remus. Quelque hardie qu'une telle hypothèse puisse paraître, j'ai la conviction que si l'on retrouve les fragments de la troisième tablette de l'épopée d'Izdubar, on y lira une histoire analogue à celle de Caïn et d'Abel, comme on a lu dans la onzième un récit du déluge. V Pour la connaissance de l'antiquité asiatique, et même pour l'histoire générale de l'esprit humain, c'est un fait capital que la révélation de l'existence, à Babylone et en Chaldée, d'un vieux cycle de légendes épiques où les mythes religieux se mêlaient aux souvenirs des âges primitifs, ainsi qu'à l'écho des premiers développements de la civilisation nationale et des conflits de races dont le bassin de l'Euphrate et du Tigre avait été le théâtre, cycle de légendes qui, dès une époque fort reculée, avaient été rédigées sous la forme de compositions poétiques ayant dans leur conception et dans leur marche quelque chose de très-analogue aux épopées de l'Inde. C'étaient de même, ainsi qu'on vient de le voir, des histoires de héros divins, de dieux transformés en rois primitifs, dont on racontait les actions, l'existence terrestre, les exploits guerriers, les aventures fabuleuses, les fondations de villes et d'empires, histoires qui servaient d'occasion et de prétexte pour amener, au cours des événements, les légendes cosmogoniques, sous la forme de récits épisodiques susceptibles d'un long développement. Il est évident, en effet, que l'histoire d'Izdubar n'était pas une exception isolée dans la littérature babylonienne, et devait appartenir à un vaste ensemble de rhapsodies de même nature, embrassant toutes les parties de la tradition, mais demeurées, suivant toutes les vraisemblances, à l'état de morceaux séparés, n'ayant pas subi le travail de raccordement et de suture qui dans l'Inde a donné naissance au Mahâbhârata. Par la mention qui y est faite d'Istar comme veuve d'un dieu appelés Fils de la vie, quand elle épouse Izdubar, cette histoire se relie à un autre récit poétique, qui devait la précéder dans le cycle légendaire et dont nous possédons un curieux fragment. C'est le récit de la descente d'Istar dans le Pays immuable, c'est-à-dire dans la région des morts, dans la contrée mythique qui pour les Assyriens et les Babyloniens correspondait l'Hadès des plus anciens poètes grecs, un enfer où n'apparaît pas — du moins dans ce que nous en connaissons — de trace d'une distinction de récompenses et de peines. J'ai tenté ailleurs un premier essai de traduction de ce morceau très-important pour la mythologie ; mais il était encore fort incomplet et renfermait plusieurs erreurs considérables ; depuis j'en ai publié le texte[44]. La traduction que je donne aujourd'hui est intégrale, et je crois être en droit de la considérer comme définitive, sauf en quelques détails. C'est au milieu du deuil du Fils de la vie qu'Istar descend dans les sombres régions du Pays immuable, que les Babyloniens et les Assyriens se représentaient divisé en sept cercles, sur le modèle des sphères célestes. Elle franchit l'enceinte extérieure, puis les portes des sept cercles, et à chacune le gardien infernal la dépouille d'une des pièces de son costume, de telle façon qu'elle est entièrement nue quand elle pénètre en présence de la reine de ces demeures souterraines. Celle-ci n'est autre que Belit sous sa forme chthonienne et funèbre ; elle est appelée la Dame de la terre, et à cette qualification une tablette mythologique fait correspondre le nom d'Allat, qui se retrouve plus tard dans le paganisme arabe, et qu'Hérodote, en le citant comme Alilat et Alitta, dit formellement avoir été une des appellations principales de la divinité du principe féminin dans les régions de l'Asie. Allat, qui semble figurer ici comme une rivale jalouse d'Istar, la frappe, par l'organe de son ministre Namtar (la Peste personnifiée), de maux sur toutes les parties de son corps, et veut la retenir captive dans ses domaines. Les dieux du ciel s'émeuvent de ne pas le voir revenir ; Nouah, appelé par Samas, envoie pour la faire sortir un fantôme qu'il a formé et qui impose à Allat la puissance mystérieuse du nom des grands dieux. Alors Istar, avant de remonter, entre dans le palais éternel où siège Anounnaki, le maitre de l'empire des morts. Elle y reçoit les eaux de la vie, puis sort du Pays immuable en passant de nouveau par les sept portes, à chacune desquelles elle reprend la parure qu'elle y a déposée. Le texte est entremêlé de récits, de strophes dialoguées et d'invocations ; diverses circonstances porteraient même à croire qu'il se récitait dans les phases successives d'une cérémonie symbolique et commémorative, du même genre que les Plyntéries athéniennes, ou qu'il se jouait dans les temples comme une sorte de mystère. 1. Vers le Pays immuable, la région [d'où l'on ne revient pas], Istar, fille de Sin, son oreille a tourné ; la fille de Sin [a tourné] son oreille, vers la demeure des morts, le siège du dieu Ir . . . . . 5. Vers la demeure où il est entré sans en sorti, vers le chemin de sa propre descente par où l'on ne revient pas, vers la demeure où il est entré, la prison, le lieu où ils[45] n'ont que de la poussière pour [apaiser] leur faim, de la boue pour aliment, où l'on ne voit pas la lumière, et dans les ténèbres [ils demeurent, 10. où les ombres comme des oiseaux [remplissent] la voûte ; au-dessus des montants et du linteau de la porte s'amoncelle la terre. Istar à la porte du Pays immuable, en approchant, au gardien de la porte a exprimé sa volonté. Gardien des eaux, ouvre ta porte[46] ; 15. ouvre ta porte, que moi j'entre ; si tu n'ouvres pas ta porte et que, moi, je ne puisse pas entrer, j'assaillirai la porte, j'en briserai les ferrures, j'assaillirai l'enceinte, je franchirai de force la clôture, je ferai relever les morts pour dévorer les vivants[47], 20. je donnerai puissance aux morts sur les vivants. — Le gardien a ouvert sa bouche et a parlé, il a dit à la grande Istar : — Contiens-toi, ô Dame, ne fais point cela. Que je puisse aller, messager de cette nouvelle, vers la reine des grands dieux. 25. — Il est entré, gardien, et il a annoncé [à la Grande Dame de la terre : — Ces eaux, Istar, ta sœur [veut les franchir ; la révélation des grands cercles . . . . . La Grande Dame de la terre ces eaux a . . . . . comme la moisson des herbes elle a . . . . . 30. comme la lèvre de le livre de ses décrets . . . . . la décision de son cœur elle m'a imposée, la résolution vénérée . . . . . — Ces eaux, moi, avec . . . . . . . . . . comme des aliments que l'on mange, comme des breuvages . . . . . Qu'elle pleure sur les vaillants qui sont restés . . . . . 35. qu'elle pleure sur les femmes esclaves qui . . . . . fiancées . . . . . qu'elle pleure sur le jeune fils unique qui avant le terme de ses jours [a été ravi. Va, gardien, ouvre-lui les portes. — Il lui a été ouvert comme dans les temps antiques ; le gardien a été et lui a ouvert les portes. 40. — Entre, ô Dame de Tiggaba[48]. Que . . . . . Que le palais du Pays immuable se réjouisse devant ta face. I — A la première porte, je l'ai fait entrer, je l'ai dépouillée ; a été enlevée la grande tiare de sa tête. — Sers-moi, gardien ; tu as enlevé la grande tiare de ma tête. — Entre dans l'empire de la Dame de la terre, à ce degré de ses cercles. II 45. — A la seconde porte, je l'ai fait entrer, je l'ai dépouillée ; ont été enlevés les pendants de ses oreilles. — Sers-moi, gardien ; tu as enlevé les pendants de mes oreilles. — Entre dans l'empire de la Dame de la terre, à ce degré de ses cercles. III — A la troisième porte, je l'ai fait entrer, je l'ai dépouillée ; ont été enlevées les pierres précieuses de son col. — Sers-moi, gardien ; tu as enlevé les pierres précieuses de mon col. 50. — Entre dans l'empire de la Dame de la terre, à ce degré de ses cercles. IV — A la quatrième porte, je l'ai fait entrer, je l'ai dépouillée ; ont été enlevées les parures de sa poitrine. — Sers-moi, gardien ; tu as enlevé les parures de ma poitrine. — Entre dans l'empire de la Dame de la terre, à ce degré de ses cercles. V — A la cinquième porte, je l'ai fait entrer, je l'ai dépouillée ; a été enlevée la ceinture garnie de pierreries de sa taille. 55. — Sers-moi, gardien ; tu as enlevé la ceinture garnie de pierreries de ma taille. — Entre dans l'empire de la Dame de la terre, à ce degré de ses cercles. VI — A la sixième porte, je l'ai fait entrer, je l'ai dépouillée ; ont été enlevés les bracelets de ses pieds et de ses mains. — Sers-moi, gardien ; tu as enlevé les bracelets de mes pieds et de mes mains. — Entre dans l'empiré de la Dame de la terre, à ce degré de ses cercles. VII 60. — A la septième porte, je l'ai fait entrer, je l'ai dépouillée ; a été enlevé le voile de sa pudeur[49]. — Sers-moi, gardien ; tu as enlevé le voile de ma pudeur. — Entre dans l'empire de la Dame de la terre, à ce degré de ses cercles. De loin de cette façon Istar est descendue dans le Pays immuable ; la grande Dame de la terre l'a vue, et en sa présence elle s'est irritée. 65. Istar n'a plus été reine, sur soi-même elle s'est assise. La grande Dame de la terre a ouvert sa bouche et parlé ; à Namtar[50], son ministre, elle a exprimé sa volonté : — Va, Namtar . . . . . . . . . . fais-lui apparaître sur sa main . . . . . Istar, 70. un mal sur les yeux . . . . . un mal sur les flancs . . . . . un mal sur les pieds . . . . . un mal sur le cœur . . . . . un mal sur la tête . . . . . 75. A cause de cela je lui fais dire et pour . . . . . Ensuite Istar, la dame . . . . . Le taureau n'a plus voulu saillir pour l'accouplement [les animaux mâles et femelles ne se sont plus unis ;] l'esclave [a refusé son devoir[51] ; le maître a retiré [son . . . . . dans son . . . . . ; 80. [l'esclave a retiré son dans son flanc. *** Le dieu Frère de l'intelligence, ministre des grands dieux . . . . . — Pars, Samas, accomplis . . . . . — Samas est allé, devant la face de Sin, son père[52], il a . . . . . il est allé devant la face de Nouah, du sauveur. 85. — Istar est descendue vers la terre ; elle n'est pas remontée. De loin en même temps Istar est descendue vers le Pays immuable ; le taureau ne veut plus saillir pour l'accouplement ; les animaux mâles et femelles ne s'unissent plus ; l'esclave refuse son devoir ; le maître retire son . . . . . dans son . . . . . 90. l'esclave retire son . . . . . dans son flanc. — Nouah dans la sublimité mystérieuse de son cœur a pris une résolution, il a formé pour sa sortie le fantôme d'un homme noir. — Va pour sa sortie, fantôme, à la porte du Pays immuable présente ta face. Que les sept portes du Pays immuable s'ouvrent devant ta face ! 95. Que la grande Dame de la terre te voie et se réjouisse devant ta face ! Dans le fond de son cœur elle se calmera, et sa colère se dissipera ; prononce-lui le nom des grands dieux. Tenant haut ta tête, par des miracles fixe son attention ; comme principal miracle produis les poissons des eaux au milieu de la sécheresse. 100. La grande Dame de la terre, en entendant cela, trembla sur sa base et arracha sa couronne ; elle se tourna et ne voulut pas se calmer. — Va (maintenant) pour sa sortie, fantôme ! Que le grand geôlier te garde[53]. Les aliments que rejette la ville seront ta nourriture ; 105. ce qui coule des égouts de la ville sera ta boisson ; les ténèbres de la forteresse seront ton lieu d'exaltation ; le conduit des eaux sera ta demeure. Que l'esclavage et la misère frappent ta postérité ! *** La grande Dame de la terre a ouvert sa bouche et a parlé ; 110. à Namtar, son serviteur, elle a exprimé sa volonté : — Va, Mamit, nettoie le Sanctuaire éternel[54] ; orne les frises des chapiteaux ; fais sortir le dieu Anounnaki[55] ; assieds-le sur le trône d'or. Istar, prends et reçois de lui les eaux de la vie. 115. — Namtar a été, a nettoyé le Sanctuaire éternel ; il a orné les frises des chapiteaux. il a fait sortir le dieu Anounnaki et l'a fait asseoir sur le trône d'or. Istar a pris et reçu de lui les eaux de la vie. *** — A la première porte, je l'ai fait sortir ; je lui ai rendu le voile de sa pudeur. 120. A la seconde porte, je l'ai fait sortir ; je lui ai rendu les pierreries de ses mains et de ses pieds. A la troisième porte, je l'ai fait sortir ; je lui ai rendu la ceinture ornée de pierres de sa taille. A la quatrième porte, je l'ai fait sortir ; je lui ai rendu les parures de sa poitrine. A la cinquième porte, je l'ai fait sortir ; je lui ai rendu les pierres précieuses de son col. A la sixième porte, je l'ai fait sortir ; je lui ai rendu les pendants de ses oreilles. 125. A la septième porte, je l'ai fait sortir ; je lui ai rendu la grande tiare de sa tète. — Ainsi sa libération tu n'as pas opéré secrètement et à cause de cela . . . . . La tablette finit par quelques lignes très-obscures où il est de nouveau question du Fils de la vie, sa jeune passion, à qui l'on présente les eaux sublimes, et du jour de la fête du Fils de la vie. Dans le livre des Philosophumena, rempli de si précieux renseignements sur les religions du paganisme, qu'on attribue maintenant assez généralement à saint Hippolyte après l'avoir d'abord donné à Origène, il est dit qu'Isis, lorsqu'elle mène le deuil d'Osiris, et Vénus, lorsqu'elle pleure Adonis, est couverte d'une septuple parure, car la nature a un septuple vêtement et est revêtue de sept stolas éthérées, qui sont les orbites des planètes. Ce passage donne, je crois, la clé de tout le morceau que je viens de traduire. Le dieu Fils de la vie, dont Istar est en deuil quand elle descend dans les enfers, ce jeune homme, fils unique[56], enlevé avant le terme de ses jours, sur lequel on prononce des lamentations funèbres, n'est autre que le dieu lumineux, moissonné dans la fleur de la jeunesse, qu'on appelait Adonis à Byblos et en Cypre, et que de nombreux témoignages disent avoir été Tammuz à Babylone. Ce dernier nom n'est certainement pas sémitique, et par conséquent on est induit à en chercher l'origine et l'étymologie dans la langue accadienne. Or, dans les documents babyloniens et assyriens, le mois qui tire son nom du jeune dieu ne se présente pas précisément sous la forme tammuz, mais sous celle de dûzu ou desvazu. En même temps un des mots par lesquels s'exprime l'idée de fils en accadien et par lesquels se lit dans cette langue, d'après le témoignage formel des syllabaires d'Assourbanipal, le premier signe du nom du Fils de la vie, est dû ou duv. Ce dieu s'appelait donc Du-zi ou Duv-zi. Un des faits les mieux constatés de la phonétique accadienne est la confusion des articulations V et tu, que l'écriture ne distinguait pas plus que l'organe ; cette confusion s'est toujours maintenue dans l'orthographe des textes cunéiformes et a persisté dans la prononciation locale de l'assyrien à Babylone jusqu'à l'époque grecque ; d'où Hésychius transcrit Samas en Σαώς, et Bérose tahamti en Θαυάτθ. On comprend dès lors comment, dans le nom d'origine accadienne du Fils de la vie, DVZ (Duvzi) s'est transformé pour les peuples de la Syrie et de la Palestine en TMZ, que les Hébreux et les Phéniciens ont vocalisé ensuite laminais, tandis que les Syriens, disant teste, restaient plus près de la prononciation originaire. L'identification que je propose pour le Fils de la vie est encore confirmée par le fragment d'hymne bilingue, en accadien avec traduction assyrienne, contenu dans la tablette K 4950 du Musée Britannique et qui commence ainsi ; Gouffre où descend le seigneur Fils de la vie, passion brûlante d'lstar, seigneur de la demeure des morts, seigneur de la colline du gouffre, et continue par une série de comparaisons peignant la stérilité de la fosse qui sert d'entrée aux enfers, de l'empire qui reçoit le dieu jeune et lumineux enlevé à l'amour de la déesse céleste. En même temps, dans un document mythologique[57], Dûzi, le Fils de la vie, est assimilé au Soleil et donné, non plus comme l'objet de la passion amoureuse d'Istar, mais comme son fils. Et dans un travail en grande partie consacré au mythe d'Adonis ou Tammuz[58] j'ai essayé, bien avant d'avoir constaté ces faits, d'établir que la conception du dieu mari ou amant de sa mère, si capitale dans les religions de l'Asie, y tenait une place essentielle. Le morceau que nous a conservé la tablette K 162 du Musée Britannique provient donc d'un poème sur la légende religieuse de Tammuz, et la mention du veuvage d'Istar dans l'histoire d'Izdubar fournit un point d'attache entre ces deux débris du cycle épique de Babylone. Il est plus que probable qu'avant la descente d'Istar dans le Pays immuable, le poème racontait la mort de Dûzi ou Tammuz, et je crois retrouver une trace de la manière dont elle était présentée, une sorte de traduction de cette partie du récit — abrégée et dépouillée de ses ornements de poésie, comme le récit du déluge dans les fragments de Bérose dans un morceau d'un caractère très-particulier que le célèbre philosophe juif Moïse Maïmonide rapporte d'après le livre de l'Agriculture nabatéenne[59]. On raconte au sujet d'un personnage d'entre les prophètes de l'idolâtrie, qui s'appelait Tammuz, qu'il invita un certain roi à adorer les sept planètes et les douze signes du zodiaque. Ce roi le fit mourir d'une manière cruelle ; et on rapporte que, la nuit de sa mort, toutes les idoles de différentes contrées de la terre se réunirent dans le temple de Babylone, auprès de la grande statue d'or, qui est celle du Soleil. Cette statue, qui était suspendue entre le ciel et la terre, vint se placer au milieu du temple, et toutes les autres statues se placèrent autour d'elle. Elle se mit à faire l'oraison funèbre de Tammuz et à raconter ce qui lui était arrivé ; toutes les idoles pleurèrent et gémirent pendant toute cette nuit, et au matin elles s'envolèrent et retournèrent à leurs temples dans les différentes contrées de la terre. De là vient cette coutume perpétuelle de gémir et de pleurer sur Tammuz. En tenant compte du langage spécial à un auteur juif, qui ne peut parler des dieux du paganisme qu'en les qualifiant d'idoles, je ne doute pas que tout le monde ne soit frappé de la parenté saisissante d'accent, de couleur et de manière de présenter le récit entre ce passage et l'histoire d'Izdubar. L'assemblée des dieux en deuil rappelle en particulier, de la façon la plu étroite, celle qui est décrite aux lignes 118-120 de la tablette traduite en entier par M. Smith. On peut donc encore ici reconnaître, comme dans certains passages de Déroge, un fragment de l'épopée babylonienne, conservé de troisième ou de quatrième main dans une traduction abrégée, et il me semble qu'on est en droit de le compter comme élément de restitution de la première partie de l'histoire de Tammuz. D'autant plus que le texte arabe ajoute ce fait, que nous reconnaissons aujourd'hui comme très-exact, que les prêtres babyloniens possédaient un recueil de poésies sur Tammuz. Les érudits ont beaucoup discuté sur la nature, l'origine et la valeur de t'étrange livre de l'Agriculture nabatéenne. Entre la confiance dépourvue de toute critique de M. Chwolsohn, qui acceptait cette compilation de très-basse époque comme une œuvre prodigieusement antique de la littérature originale babylonienne, et l'hypercritisme de M. Gutschmidt, qui le regardait comme inventé de toutes pièces au neuvième siècle après Jésus-Christ et ne contenant rien que de méprisable, il y a un moyen terme à tenir, et il me paraît que la plus juste appréciation a été celle de M. Renan. L'Agriculture nabatéenne a été rédigée en très-grande partie à l'aide de documents araméens composés dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Ces documents pouvaient renfermer un certain nombre de débris, plus ou moins altérés par les versions successives, mais remontant véritablement à la source babylonienne et en ayant même conservé la couleur dans une certaine mesure. La chose est d'autant plus vraisemblable que les écoles sacerdotales de Borsippa et d'Orchoé étaient encore debout au temps de Strabon et de Pline, et que la langue assyrienne était demeurée vivante, avec -l'usage de l'écriture cunéiforme, au moins jusqu'au règne de Domitien ; M. Oppert vient de le prouver par un document formel qui mentionne le roi parthe Pacorus. L'exemple de Bérose avait eu sans doute des imitateurs, et bien des indices donnent à penser que du sein des écoles de Borsippa et d'Orchoé il avait dû sortir plus d'une version, surtout de textes religieux, soit en grec, soit en araméen. C'est ainsi que je m'explique l'origine du morceau sur Tammuz qui porte en lui-même l'empreinte si manifeste de sa provenance première. Tout n'est donc pas à mépriser dans l'Agriculture nabatéenne, et les assyriologues feront bien d'en étudier soigneusement le texte, car il doit renfermer, au milieu d'un fatras de choses sans valeur, plus d'un morceau de la même nature. VI Mais ce sont les fragments de Bérose qui nous ont conservé le plus d'indications sur les sujets qu'embrassait le cycle de la poésie mythologique et épique de Babylone, au moins sur les récits cosmogoniques qui s'y introduisaient à la façon de celui du déluge dans l'histoire d'Izdubar, sous la forme d'épisodes racontés au milieu des aventures des héros. Toutes les traditions provenant du premier et du second livre des Antiquités chaldéennes, contenues dans les morceaux qu'Eusèbe et Georges le Syncelle nous ont conservés à cause de leur ressemblance avec les récits bibliques, sur la création ou plutôt l'organisation de l'univers par Bel coupant en deux Omoroca (Belit Um-Uruk), la matière passive et incréée, sur les dix rois antédiluviens, sur la Tour des langues et la guerre des trois frères ennemis personnifiant les trois races primitives admises par la légende, tout cela devait y avoir trouvé successivement sa place' dans des compositions différentes, aussi bien que l'histoire du déluge. Les tablettes cunéiformes découvertes par M. Smith sont même de nature à jeter un jour très-neuf et très-précieux sur ce que devait être le plan du livre de Bérose dans ses portions relatives aux premiers âges et aux temps mythiques. Nous n'avons de ce livre que des fragments détachés et sans lien entre aux, dont l'enchaînement est fort difficile à saisir. On n'entrevoit cet enchaînement qu'entre l'histoire des rois antédiluviens et le déluge lui-même. Mais aujourd'hui qu'un texte original nous met à même de connaître ce qu'était le cadre de quelques-uns des morceaux du cycle épique, on est induit à attacher une grande importance à des indices jusqu'à présent négligés, d'où il résulterait que Bérose avait, dans une certaine mesure, conservé dans les récits qu'il offrait aux Grecs ce cadre d'épopée avec ses épisodes. Tout mutilés qu'ils sont, les fragments parvenus jusqu'à nous montrent que plusieurs des narrations cosmogoniques les plus importantes de son livre étaient présentées sous la forme de récits placés dans la bouche de personnages divins ou héroïques mis en action, sous la forme de discours, de révélations épisodiques intervenant au cours d'une histoire continue qui y servait de lien. Les abréviateurs eux-mêmes y avaient laissé ce caractère. Le récit de la naissance et de l'organisation du monde céleste et terrestre, par lequel s'ouvrait le livre, est donné comme une révélation du dieu Oannès, dont la mise en scène semble l'écho du début d'une composition d'épopée mythologique. Il y eut à l'origine, à Babylone,
une multitude d'hommes de diverses nations, qui avaient colonisé la Chaldée,
et ils vivaient sans règle, à la manière des animaux. Mais dans la première
année [du monde], apparut, sortant de la mer Érythrée, dans la partie où elle
touche à la Babylonie, un animal doué de raison, qu'on appelle Oannès. Ce
monstre avait tout le corps d'un poisson, mais au-dessous de sa tête de
poisson une seconde tête qui était celle d'un homme, des pieds d'homme sortant
de sa queue et une parole humaine ; son image se conserve jusqu'à ce jour[60]. L'animal en question passait toute la journée au milieu
des hommes, sans prendre aucune nourriture, leur enseignant les lettres, les
sciences et les principes de tous les arts, les règles de la fondation des
villes, de la construction des temples, de la mesure et de la délimitation
des terres, les semailles et les moissons, enfin l'ensemble de ce qui adoucit
les mœurs et constitue la civilisation, de telle façon que depuis lors personne
n'a plus rien inventé de nouveau. Puis, au coucher du soleil, ce monstrueux
Oannès rentrait dans la mer et passait la nuit au milieu de l'immensité des
flots, car il était amphibie. Par la suite, il parut encore d'autres animaux
semblables, dont l'auteur annonce qu'il parlera dans l'histoire des rois. Il
ajoute que Oannès écrivit sur l'origine des choses et les règles de la
civilisation un livre qu'il remit aux hommes. [Voici ce que disait ce livre.] Il y eut un temps où tout était ténèbres et eau,
etc. Le récit de la construction de la Tour et de la confusion des langues était aussi placé dans la bouche d'un personnage désigné sous le nom de la Sibylle, ainsi que l'atteste le langage formel d'un fragment de l'abrégé d'Alexandre Polyhistor. Nombre d'écrivains, d'ailleurs, parlent également du discours de la Sibylle dans le livre de Bérose, et il était même tellement célèbre, cent cinquante ans seulement après la composition de l'ouvrage du prêtre chaldéen, qu'il servit de texte à un Juif alexandrin pour forger, sous Ptolémée Philométor, vers 165 avant Jésus-Christ, le plus ancien morceau que renferme la collection des vers sibyllins. Ce fut le point de départ de la légende judéo-chrétienne qui fit ensuite enregistrer au nombre des Sibylles une Sibylle babylonienne à laquelle on donna le nom de Sambéthé ou Sabbé. Voici le passage d'Alexandre, conservé par Eusèbe : La Sibylle dit que lorsque les hommes avaient encore une seule langue, quelques-uns d'entre eux entreprirent de construire une tour immense, afin de monter jusqu'au ciel. Mais la divinité, ayant fait souffler les vents, les bouleversa et donna à chacun une langue propre ; d'où la ville fut appelée Babylone. Et après le déluge naquirent Titan et Prométhée. Abydène mentionne en une seule ligne, immédiatement après la Tour des langues, la guerre des trois frères ennemis, chefs de races dont les noms avaient été rendus en grec Cronos, Titan et Iapétos (ou Prométhée). L'historien arménien Moïse de Khorène en donne un récit plus développé, qu'il affirmé avoir emprunté à Bérose, ou plutôt à ses abréviateurs, récit offrant des traits d'une nature fort spéciale, des circonstances en rapport avec certaines expressions allusives des textes cunéiformes, et dans lequel le déesse Istar joue un rôle digne d'une grande attention. Or il précise que ce récit était la continuation du discours de la Sibylle. Et ceci est confirmé par le morceau des poésies pseudo-sibyllines dont je parlais tout à l'heure. L'auteur, qui avait certainement l'Ouvrage même de Bérose sous les yeux, puisqu'il écrivait quatre-vingts ans avant Alexandre Polyhistor, et qui tenait à donner un caractère bérosien au langage de sa Sibylle, a inséré dans ses vers l'histoire de la guerre des trois frères en la paraphrasant, en la mêlant d'éléments étrangers, empruntés à la mythologie grecque et principalement à la Théogonie d'Hésiode, de manière à y greffer le mythe hellénique de la Titanomachie. Mais s'il l'a ainsi dénaturé, son œuvre de faussaire ne contribue pas moins à prouver que le récit en question faisait chez Bérose partie du discours de la Sibylle et devait avoir un certain caractère poétique, où se conservait quelque chose de l'accent des vieilles compositions auxquelles il avait été originairement emprunté. VII L'épopée babylonienne n'était même pas exclusivement mythologique ; son domaine se prolongeait jusque dans les temps de l'histoire. L'instinct particulier et la faculté de l'esprit qui donne naissance à cette forme de légendes était si naturel, si bien inné chez les Babyloniens, qu'à côté des documents d'un caractère sèchement positif conservés avec soin dans les archives des palais et des temples, la tradition populaire avait transformé en héros épiques, à la vie entourée de circonstances légendaires, des monarques d'un caractère tout réel, ayant vécu dans les siècles pleinement historiques et dont on possédait les annales officielles, sans trace d'aucune de ces circonstances. Il n'y a pas dans toute la période de l'ancien empire chaldéen de figure plus historique que celle de Sargon Ier, qui régnait environ 2000 ans avant l'ère chrétienne. Continuant la série des rois aux noms sémitiques qui depuis plusieurs siècles dominaient dans la ville d'Aganê[61], au nord de Babylone, il étendit sa puissance bien au-delà des limites de celle de ses prédécesseurs. Détruisant la plus grande partie des petits royaumes entre lesquels ces contrées étaient alors divisées, il conquit toute la Babylonie et la Chaldée, sauf Larsa et Apirak, et en fit un seul État. Il vainquit les Élamites et soumit la Syrie à son sceptre, préparant les voies à son fils Naram-Sin, qui atteignit jusqu'aux frontières de l'Égypte. Il fut aussi un législateur fameux, et le roi qui dans ces temps reculés s'occupa le plus activement du progrès des sciences sacerdotales. C'est lui qui créa la grande bibliothèque d'Érech, à l'imitation de celle qui avait valu à Sippara son nom de ville des livres ; il parait même avoir renouvelé et beaucoup accru celle de cette dernière cité. Il rebâtit magnifiquement le palais d'Aganê et la pyramide sacrée de la déesse Anounit, fameuse sous le nom d'Ulbar. Nous possédons dans les copies qu'en fit faire Assourbanipal une partie notable des grands ouvrages d'astronomie et d'astrologie, de magie, de grammaire et de législation qu'il avait fait composer, et qui résumaient les travaux comme les traditions du sacerdoce chaldéen. Ses exploits guerriers et les principaux événements de son règne nous sont connus année par année, grâce aux tables astrologiques contemporaines qui les enregistrent eu face des augures tirés des apparences de la lune dont l'observation avait coïncidé avec ces événements. Ce roi devint plus tard l'objet d'un culte héroïque ; et c'est même le seul exemple d'un fait de ce genre que nous puissions jusqu'à présent constater en Babylonie. Alors autour de son nom, resté justement grand dans le souvenir des peuples et grandi encore par l'ancienneté, se forma une légende à demi-mythique, ayant trait spécialement à son enfance et à son élévation au trône. Nous trouvons l'écho de cette légende dans le texte d'une curieuse petite tablette qui provient de la bibliothèque de Ninive. Sargon l'Ancien y est censé prendre la parole et raconter sa vie en défiant aucun roi postérieur d'être aussi grand que lui[62]. Quand même le caractère fabuleux du récit n'éclaterait pas aux regards autant qu'il le fait, il suffirait de la langue de ce document, où l'on ne voit plus une seule marque d'archaïsme, pour établir qu'il n'a été composé que bien des siècles après le monarque dans la bouche duquel est placé le discours. Il y avait à Agate une statue de Sargon, roi de justice, méditateur des lois, méditateur des choses heureuses, comme il est appelé dans quelques documents[63], et cette image y recevait les honneurs divins. Il est probable que c'est l'inscription de la base dont nous possédons ici la copie. 1. Sargon, le roi puissant, le roi d'Aganê, c'est moi. Ma mère fut enceinte sans connaître mon père. Le frère de mon père opprimait le pays. Dans la ville d'Azoupirani[64], qui est située sur la rive de l'Euphrate, elle me conçut. Ma mère enceinte me mit au monde dans un lieu caché. 5. Elle me déposa dans une corbeille de joncs dont elle ferma le couvercle avec de l'asphalte ; elle me confia au fleuve, dont l'eau ne pouvait pas venir sur moi. Le fleuve me reçut ; il me porta jusque vers Akki l'ouvrier irrigateur[65]. Akki l'ouvrier irrigateur, dans la bonté [de son cœur], me recueillit. Akki l'ouvrier irrigateur m'éleva comme [son] fils. 10. Akki l'ouvrier irrigateur m'établit comme jardinier, et Istar dans ma profession de jardinier me fit prospérer. Au bout de] cinq ans je m'emparai du pouvoir royal. J'ai gouverné [les hommes] à la face brune[66], j'ai . . . . . Sur les pays les plus difficiles d'accès j'ai fait rouler mes chars de guerre en bronze. 15. J'ai dominé les contrées supérieures, j'ai commandé] aux rois des contrées inférieures. J'ai pris trois fois . . . . . ; j'ai soumis Dilmoun[67] ; j'ai fait plier la grande Douban[68] ; j'ai détruit . . . . .[69] Quand un roi qui me succédera dans l'avenir [comme moi 20. gouvernera les hommes à face brune, sur les pays les plus difficiles d'accès [fera rouler] ses chars de guerre [en bronze, dominera les contrées supérieures et commandera] aux rois des contrés inférieures, prendra trois fois . . . . . . [soumettra Dilmoun, 25. fera plier la grande Douban [détruira . . . . . mon image sera enlevée ?] de ma ville d'Aganê. Le début de ce récit semble comme une sorte de contre-épreuve de l'histoire biblique de l'enfance de Moïse. La légende de Sargon l'Ancien est peut-être encore plus voisine dans tous ses détails des traditions populaires romaines sur Romulus, né secrètement d'une fille de roi, exposé dans son berceau sur le fleuve qui le porte au pied du figuier Ruminai, où le découvre le berger Faustulus, élevé par ce berger comme son propre fils, grandissant dans la vie des champs et devenant tout d'abord le chef d'une troupe d'aventuriers, puis le fondateur de la Ville Éternelle. Dans la mythologie grecque nous trouvons encore des histoires analogues, comme celle du coffre dans lequel Acrisius enferme Danaé et son fils Persée pour les jeter à la mer, et celle de Dionysus enfant transporté sur les flots dans un coffre jusqu'à la côte de Brasite en Laconie. Et quand on lit dans Hérodote la légende qui s'était formée sur l'enfance de Cyrus, légende où il n'est pas question, sans doute, de la corbeille flottant sur les eaux d'un fleuve, mais où le fondateur de la monarchie des Perses est représenté comme un enfant de race royale exposé par l'ordre de son grand-père, recueilli par un berger qui l'élève en le faisant passer pour son fils, et arrivant jusqu'à l'adolescence au milieu de ses rustiques compagnons, il est difficile de ne pas la rapprocher des récits que nons venons de rappeler. Chez toutes les races de l'antiquité, l'imagination populaire s'est complue à entourer de ces circonstances, qui roulent dans le même cercle, l'enfance des grands chefs de peuples, les fondateurs d'empires, de ceux qui ont appelé des nations nouvelles à la puissance et les ont fait sortir de l'obscurité. La tradition du chef d'une dynastie des rives de l'Euphrate, qui aurait été jardinier avant de devenir roi, a été connue des Grecs. Un écrivain de l'époque byzantine, Agathias, la raconte d'après des auteurs plus anciens aujourd'hui perdus, mais sous des noms de pure fantaisie. Ce n'est plus qu'une altération lointaine de la légende originale d'Aganê, mais elle n'en est pas moins curieuse à mettre en regard du récit de la tablette cunéiforme. Les premiers, parmi ceux dont nous avons ouï parler, les Assyriens sont dits avoir soumis toute l'Asie, à l'exception de l'Inde au-delà du Gange. Ninus parait avoir été le premier à fonder parmi eux une royauté puissante ; après lui vint Sémiramis et ensuite leurs descendants jusqu'à Béléus, fils de Delcétade. En effet, la race de Sémiramis s'étant éteinte avec ce Béléus, un certain Bélétaras, jardinier, intendant et inspecteur des jardins royaux, parvint à cueillir contre toute attente le fruit de la royauté, et greffa le pouvoir suprême dans sa famille, comme le racontent Bion et Alexandre Polyhistor. Les légendes de ce genre se formaient vite, et l'on en vit naître à Babylone jusqu'à la fin de sa splendeur. Abydène, évidemment d'après Bérose, en racontait une fort curieuse et fort saisissante sur la fin de Nabuchodorossor. Les Chaldéens disent que, monté
sur les terrasses de son palais, il fut tout à coup possédé d'un dieu et
prononça cet oracle : Moi, Nabuchodorossor, je vous prophétise, ô
Babyloniens, le malheur qui va fondre et que ni Bélus, mon auteur, ni la
reine Beltis, n'ont eu la puissance de persuader aux déesses du destin de
détourner. Un mulet perse viendra, ayant pour auxiliaires vos propres dieux,
et il vous imposera la servitude. Son complice sera un Mède, dont l'Assyrie
se glorifiait. Plût aux dieux qu'il eût pu, avant de trahir ses concitoyens,
périr englouti dans un gouffre ou dans la mer, ou se tournant vers d'autres
voies errer dans les déserts où il n'y a ni villes ni sentiers foulés par le
pied des hommes, où les bêtes fauves habitent librement et où volent les oiseaux,
et seul être perdu dans les rochers stériles et les ravins ! Quant à moi,
puissé-je atteindre un terme meilleur avant que cette pensée n'entre dans son
esprit ! En disant ces mots il disparut aux yeux des hommes. Dans l'allusion que font les paroles attribuées à Nabuchodorossor à un personnage d'origine médique, occupant une grande situation dans l'empire de. Babylone, qui aurait contribué à livrer la ville aux Perses, il y a peut-être une indication. de nature à guider pour trouver la clé de l'énigme du fameux Darius le Mède, qui a inspiré déjà tant de conjectures démenties par les faits. Mais ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans cette recherche. Je me bornerai donc à faire remarquer quelle étroite parenté cette légende sur Nabuchodorossor, dont l'origine réellement babylonienne ne peut guère être contestée, offre avec le chapitre IV du livre de Daniel. Je ne doute pas, pour ma part, qu'en présence des résultats du déchiffrement des textes cunéiformes, on ne doive réviser la condamnation, portée beaucoup trop vite par l'école qui prétend dans l'étude des Livres Saints être en possession du privilège exclusif de la critique, contre le livre auquel est attaché le nom du grand prophète de la Captivité. Le texte que nous en possédons porte dans sa langue la marque d'une rédaction récente, mais le fond est beaucoup plus ancien que les exégètes d'aujourd'hui ne le prétendent. La couleur en est très-exactement babylonienne, et les détails de mœurs sur la cour de Babylone, confirmés déjà par presque tous les monuments, sont d'une exactitude à laquelle n'aurait pas pu atteindre un écrivain de la Palestine au troisième ou au second siècle avant l'ère chrétienne. VIII Depuis une vingtaine d'années on a prodigieusement abusé de la théorie des races en histoire ; ce sont surtout les aryanistes qui s'en sont faits les apôtres et qui, l'exagérant au delà de la juste mesure, se sont efforcés de tout ramener à l'objet de leurs études. A entendre certains d'entre eux, dont les idées ont été acceptées docilement par une notable portion du public et se répètent à satiété sans qu'on prenne la peine de les contrôler, l'épopée aurait été dans le monde une chose exclusivement propre à la race aryenne, une création spéciale à son génie, et rien de pareil ne se serait développé dans une autre race. On peut s'étonner du succès d'une pareille affirmation, quand l'existence chez les peuples ougro-finnois d'une épopée aussi développée et aussi remarquable que le Kalevala suffisait à la réfuter. Sans aller jusqu'à cette exagération, M. Renan a soutenu à plusieurs reprises — et c'est même une de ses idées favorites — la thèse de l'inaptitude absolue de la race sémitique à la conception de la poésie épique. C'est dans la préface de sa traduction de Job qu'il l'a exposée avec le plus d'éclat et de séduction. L'imagination des peuples sémitiques n'est jamais sortie du cercle étroit que traçait autour d'elle la préoccupation exclusive de la grandeur divine. Dieu et l'homme en présence l'un de l'autre, au sein du désert, voilà l'abrégé, et, comme l'on dit aujourd'hui, la formule de toute leur poétique. Les Sémites ont ignoré les genres de poésie fondés sur le développement d'une action, l'épopée, le drame et tous les genres de spéculation fondés sur la méthode expérimentale ou rationnelle, la philosophie, la science[70]. M. Renan, quelques pages plus loin, refuse complètement aux Sémites le développement mythologique et la faculté d'imagination qui l'a produit. Il parle d'une des images les plus poétiques et les plus saisissantes du livre de Job. On croit lire les Védas en voyant l'Aurore saisir les coins de la terre pour en chasser les méchants et changer la face du monde comme le sceau change la terre sigillée. Mais tout cela reste infécond. Chez les Ariens, ces attributions de l'Aurore fussent devenues un acte ou une aventure d'une déesse ; puis, avec le temps, cessant d'être comprises, elles eussent produit des contes bizarres où le caprice des poètes se fût donné carrière... Puis on eût cherché dans ce récit, interprété avec une latitude indéfinie, une matière pour des drames, des allégories, des compositions littéraires de toute espèce. Et il ajoute que chez les Sémites ces hardies images ne dépassent jamais la métaphore. La fameuse doctrine de M. Renan sur les caractères essentiels du génie de la race sémitique, qui généralisait à toute la race, comme une disposition commune, le génie particulier du peuple hébreu et l'esprit de son monothéisme, où il faut pourtant bien voir au moins un fait historiquement exceptionnel au milieu de toutes les populations voisines, quand on se refuse à y reconnaître un privilège d'origine surnaturelle, cette doctrine, dis-je, a été réfutée d'une manière complète par les savants les plus compétents, et son auteur lui-même ne la soutient plus qu'avec de grandes atténuations. On a prouvé en effet l'inanité de ce prétendu monothéisme fondamental des Sémites. On a rassemblé les preuves innombrables qui montrent à Babylone, en Assyrie, en Phénicie, en Syrie, chez les Arabes jusqu'à Mahomet, en un mot chez tous les Sémites, sauf les Hébreux, l'existence d'un polythéisme aussi caractérisé que celui des peuples aryens, un polythéisme comptant autant de dieux divers, si ses conceptions sont d'une autre nature et si l'origine de ses personnages divins est plus métaphysique, en rapport moins direct avec des phénomènes déterminés de la nature. La démonstration a été si péremptoire que la polémique anti-biblique a depuis lors changé de terrain, et qu'à la théorie de M. Renan s'en est substituée une autre, non moins facile à réfuter, celle qui veut que les Hébreux aient été, jusqu'à une époque très-tardive, polythéistes comme les peuples qui les entouraient, et que le monothéisme mosaïque soit une invention des prophètes contemporains de la fin du royaume de Juda. Mais si le fait du polythéisme sémitique est incontestable, on pouvait se demander s'il s'était borné à peupler le ciel d'une hiérarchie de dieux gardant un certain caractère abstrait, gouvernant le monde sans sortir d'un rôle immuablement fixé, manquant en un mot de toute vie poétique, si jamais les peuples appartenant au grand rameau de l'humanité qui a couvert la Syrie et l'Arabie, avec le bassin de l'Euphrate et du Tigre, avaient possédé ce genre particulier d'imagination qui transforme les formules religieuses en mythes en action et ouvre à la fantaisie des poètes le riche domaine de l'épopée mythologique. Tout ce côté de la théorie de M. Renan restait donc intact, puisqu'on ne pouvait y opposer aucune preuve directe. La découverte de M. Smith et les faits qu'elle permet de grouper autour d'elle, pour en confirmer les conséquences, doivent désormais lever les doutes qui subsistaient sur ce point, et modifier, par la révélation du cycle épique de Babylone, les idées qui prévalaient encore dans beaucoup d'esprits. La forme particulière d'imagination que l'on tendait à refuser aux Sémites, nous la voyons maintenant se manifester par des preuves incontestables chez un des principaux peuples de langue sémitique, et son existence se traduit dès les temps les plus reculés, au sein de la plus grande cité de l'Asie antérieure, dans le foyer de culture intellectuelle, scientifique et religieuse dont l'influence a rayonné en souveraine sur toute la race sémitique, par un large développement de la branche de littérature que M. Renan regardait comme faisant absolument défaut chez cette race. Car l'ingénieux écrivain semble avoir précisément décrit les caractères qu'il faut maintenant reconnaître aux épopées babyloniennes du genre de l'histoire d'Izdubar, quand il indiquait les particularités de la forme de développement poétique qu'il s'efforçait de montrer comme étrangères aux Sémites. Il y a là tout un ordre de données que rien ne permettait de pressentir, et dont la constatation est une véritable conquête pour l'histoire des premières civilisations humaines. Que si, l'existence de l'épopée babylonienne une fois établie, on essayait de déterminer en quoi son génie différait de celui de l'épopée aryenne, il serait peut-être dès à présent permis de conclure des fragments originaux qui en ont été retrouvés — quoiqu'ils soient encore bien peu nombreux pour permettre d'asseoir un jugement définitif — qu'elle avait un caractère moins héroïque. Elle tournait plus naturellement au conte merveilleux, et dans ce qu'on en a traduit nous n'apercevons rien de cette expression si vivante et si émue des sentiments humains que les poètes de la Grèce et de l'Inde savent introduire dans leurs œuvres, et qui fera leur éternelle gloire. En même temps, et c'est ce qui m'y frappe davantage, elle a dans son esprit et dans son aspect quelque chose de plus évhémériste. Chez les Indiens, comme chez les Grecs, les héros sont bien, à l'origine, des conceptions divines, des formes terrestres des dieux ; mais dans la poésie ils s'en distinguent et ne se confondent point avec eux : ils forment une classe de personnages à part. Ce ne sont point généralement les dieux eux-mêmes, gardant le nom sous lequel on les adore, qui sont transformés en rois antiques, vivant d'une vie terrestre et sujets aux infirmités des mortels, comme Izdubar dans les documents étudiés par M. Smith. Il est difficile de croire, du reste, que le cycle épique de Babylone et de la Chaldée ait constitué une exception isolée, sans avoir produit rien d'analogue chez les peuples de même race, de même langue et de même civilisation. Les Assyriens, eux aussi, avaient une légende poétique, une épopée nationale, d'un caractère sans doute plus guerrier et plus héroïque que celle des Babyloniens, comme leur peuple était lui-même plus guerrier, mais ayant de même pour fondement des mythes religieux. Les documents qui viennent d'être mis en lumière éclairent, en effet, sous un aspect tout nouveau les récits que Ctésias rapporta du fond de l'Asie et présenta aux Grecs comme l'histoire véritable de la monarchie assyrienne. Depuis qu'on a eu, par le déchiffrement de l'écriture cunéiforme, accès dans les sources indigènes et contemporaines des annales de l'Assyrie, on sait positivement que ces narrations brillantes et poétiques, auxquelles on avait trop longtemps attaché une foi qu'elles ne méritent pas, n'ont absolument rien à voir avec l'histoire réelle. Dans les récits sur Ninus et Sémiramis, l'Hercule androgyne et la Vénus guerrière dont les noms les plus habituels sont Adar et Istar[71] ; sur la querelle de Nannarus et de Parsondas, deux personnages à l'aspect ambigu, dont le premier est certainement le dieu de la lune, Sin, bien des fois désigné dans les textes cunéiformes sous le surnom de Nannarou, le lumineux, et le second encore une fois l'Hercule androgyne, dont le nom dans cette circonstance est composé de la réunion des deux formes, accadienne et assyrienne, de sa qualification la plus importante, celle du Puissant, Bar-Samdan ; enfin sur le bûcher de Sardanaple, donnée dont Ottfried Müller et Raoul Rochette ont montré depuis longtemps la nature toute religieuse, attestée par la cérémonie du bûcher de l'Hercule asiatique qui se célébrait solennellement chaque année en Assyrie, en Phénicie et en Syrie ; dans tous ces récits, qui portent une empreinte commune si nettement déterminée, on a reconnu des mythes sacrés, des histoires symboliques de dieux transportées sur la terre et transformées en événements humains. Ceci n'est plus contestable ; mais on se demandait encore d'où la connaissance avait pu en venir au médecin d'Artaxerxés Mnémon, et qui leur avait donné cette forme. Il devient probable aujourd'hui, quand on compare ces récits à ceux de même nature dont Assourbanipal avait fait recueillir les copies en Chaldée, que ce sont les Assyriens eux-mêmes qui avaient tiré des mythes en question, et d'autres sans doute, — car nous sommes loin de connaître tous les récits que faisait Ctésias sur les rois qu'il énumérait, — les éléments d'une épopée nationale, présentant les mythes comme une histoire primitive, et grandissant ainsi démesurément l'antiquité de leur peuple. Et en effet le roi Sargon, le vainqueur de Samarie et le constructeur du palais de Khorsabad, atteste l'existence de ce cycle de légendes, plaçant avant l'histoire réelle de longues dynasties fabuleuses, quand il parle de trois cent cinquante rois qui l'ont précédé sur le trône ; d'après ce que l'on. sait aujourd'hui de la naissance relativement récente de la monarchie et de la nation même des Assyriens, il y avait au moins deux cent soixante, sur ces trois cent cinquante rois, qui appartenaient au pur domaine de la fable. Ctésias dut connaître par des traductions plus ou moins fidèles, à la cour de Suse, les récits de l'épopée héroïque assyrienne, et son imagination de Grec fut sensible à ce qu'ils avaient précisément d'éclatant et d'épique ; en les recueillant comme les véritables annales de cet empire, qui dans sa chute même avait laissé derrière lui un tel renom de grandeur guerrière, et en les offrant à ce titre à ses compatriotes, il fit exactement la même chose que ceux des modernes qui ont été chercher une tradition nationale sur l'histoire antique de la Perse dans le Schah-Namèh de Firdouçi, et qui ont enregistré dans leurs livres historiques les exploits de Djemschid et de Féridoun, dernières transformations héroïques de dieux dont les ancêtres des Aryas orientaux avaient conçu les mythes sur les bords de l'Oxus, antérieurement à la séparation des Iraniens et des Indiens. Le plus développé des fragments sur la religion et la cosmogonie des Phéniciens, provenant du livre fameux de Sanchoniathon, que les compilateurs d'extraits auxquels Eusèbe les a empruntés avaient si maladroitement cousus les uns au bout des autres, et que la critique contemporaine est parvenue à distinguer, le plus développé de ces fragments est comme le sommaire d'une épopée théogonique, dont le plan aurait eu quelque analogie avec celle d'Hésiode. Tous les dieux de la Phénicie, distribués par générations successives, y entrent en scène les uns après les autres dans le développement d'un même récit en action. La disposition de ce cadre épique et l'esprit evhémériste qui s'y manifeste ont paru aux derniers critiques qui se sont occupés du texte de Sanchoniathon, comme M. Ewald et M. Renan, l'indice d'une composition récente. Ils en ont tiré un de leurs principaux arguments pour penser que le livre phénicien que Philon de Byblos traduisit en grec avait dû être rédigé postérieurement à Alexandre, et sous une influence des idées comme de la littérature hellénique. N'y aurait-il pas lieu à réviser ce jugement, sinon pour ce qui concerne la date de la rédaction du livre lui-même, qui s'appuie encore sur d'autres preuves, mais pour ce qui est de l'antiquité du morceau en question, qui pourrait bien, avec sa forme épique et sa tournure générale, remonter beaucoup plus haut et avoir été emprunté à des sources vraiment antiques, comme d'autres récits cosmogoniques qui avaient également trouvé place dans le même ouvrage, et dont l'ancienneté n'est pas mise en doute ? N'a-t-il pas pu exister une épopée religieuse phénicienne, vraiment nationale, indépendante de toute influence grecque, parallèle à l'épopée babylonienne, et remontant aussi à un âge plus reculé qu'on ne croit, — épopée dont un débris nous aurait été conservé par Sanchoniathon d'abord, puis par Philon de Byblos, réduit à son simple canevas, comme les morceaux de la légende épique de Babylone dans le livre de Bérose ? Je n'ose rien affirmer, rien préciser à ce sujet, car l'examen de la question demanderait une étude longue et approfondie. Mais ce qu'il est du moins permis de dire, c'est qu'elle doit être maintenant reprise, et que la connaissance des compositions babyloniennes apporte au problème des éléments tout à fait nouveaux. IX Ce qui me parait enfin ressortir comme dernière conclusion des documents cunéiformes signalés par M. Smith à l'attention du public savant, et qui nous ramène à la tradition spéciale du déluge, c'est le caractère d'importation étrangère, et non de tradition véritablement indigène du récit indien du cataclysme, et la manière dont ces documents permettent d'en restituer la filiation avec une vraisemblance qui touche presque à la certitude. La forme la plus ancienne et la plus simple du récit indien du déluge se trouve dans le Çatapatha Brâhmana compris dans la collection du Rig-Véda, mais très-postérieur à la composition des hymnes de ce recueil, dont la rédaction flotte par conséquent entre le quatorzième siècle avant notre ère, date approximative des hymnes les plus récents, et le neuvième siècle, où la collection du Rig parait avoir été définitivement constituée. Ce morceau a été traduit pour la première fois par M. Max Müller. Un matin, on apporta à Manou de
l'eau pour se laver ; et quand il se fut lavé, un poisson lui resta dans les
mains. Et il lui adressa ces mots : Protège-moi, et je te sauverai. — De
quoi me sauveras-tu ? — Un déluge emportera toutes les créatures ;
c'est là ce dont je te sauverai. — Comment te protégerai-je ? Le
poisson répondit : — Tant que nous sommes petits, nous restons en grand
péril ; car le poisson avale le poisson. Garde-moi d'abord dans un vase.
Quand je serai trop gros, creuse un bassin pour m'y mettre. Quand j'aurai
grandi encore, porte-moi dans l'Océan. Alors je serai préservé de la
destruction. — Bientôt il devint un gros poisson. Il dit à Manou : Dans
l'année même où j'aurai atteint ma pleine croissance, le déluge surviendra.
Construis alors un vaisseau et adore-moi. Quand les eaux s'élèveront, entre
dans ce vaisseau, et je te sauverai. Après l'avoir ainsi gardé, Manou porta le poisson dans l'Océan. Dans l'année qu'il avait indiquée, Manou construisit un vaisseau et adora le poisson. Et quand le déluge fut arrivé, il entra dans le vaisseau. Alors le poisson vint à lui en nageant, et Manou attacha le câble du vaisseau à la corne du poisson, et, par ce moyen, celui le fit passer par dessus la montagne du nord. Le poisson dit : Je t'ai sauvé ; attache le vaisseau à un arbre, pour que l'eau ne l'entraîne pas pendant que tu es sur la montagne ; à mesure que les eaux baisseront, tu descendras. Manou descendit avec les eaux, et c'est ce qu'on appelle la descente de Manou sur la montagne du nord. Le déluge avait emporté toutes les créatures, et Manou resta seul. Vient ensuite, par ordre de date et de complication du récit, qui va toujours en se surchargeant de traits fantastiques et parasites, sur quelques-uns desquels nous reviendrons tout à l'heure, la version du Mahâbhârata. Celle du Bhâgavata-Pourâna est encore plus récente et plus fabuleuse. Enfin, la même tradition fait le sujet d'un poème entier, de date fort basse, le Matsya-Pourâna, dont Wilson a donné l'analyse. Dans la préface du troisième volume de la traduction du Bhâgavata-Pourâna, notre illustre Eugène Burnouf a comparé avec soin les trois récits connus quand il écrivait (celui du Çatapatha-Brâhmana a été découvert depuis) pour éclairer la question de l'origine de la tradition indienne du déluge. Il y montre, par une discussion qui mérite de rester un modèle d'érudition, de finesse et de critique, que cette tradition fait totalement défaut dans les hymnes des Védas, où on ne trouve que des allusions lointaines à la donnée du déluge, et des allusions qui paraissent se rapporter à une forme de légende assez différente, puisqu'elle a dû être primitivement étrangère au système essentiellement indien des manvantaras ou destructions périodiques du monde. Il en conclut qu'elle doit avoir été importée dans l'Inde postérieurement à l'adoption de ce système, très-ancien cependant, puisqu'il est commun au brahmanisme et au bouddhisme. Il incline dès alors à y voir une importation sémitique, opérée dans les temps déjà historiques, non pas directement de la Genèse, dont il est difficile d'admettre l'action dans l'Inde à une époque aussi ancienne, mais plus probablement de la tradition babylonienne. Les documents nouveaux me paraissent confirmer l'opinion du grand indianiste, dont le nom restera l'une des plus hautes gloires scientifiques de notre pays. Le trait dominant du récit indien, celui qui y tient une place essentielle et en fait le caractère distinctif, est le rôle attribué à un dieu qui revêt la forme d'un poisson pour avertir Manou, guider son navire et le sauver du déluge. La nature de la métamorphose est le seul point fondamental et primitif, car les diverses versions varient sur la personne du dieu qui prend cette forme ; le Brahmane ne précise rien ; le Nahabharata en fait 13rahme, et pour les Pouranistes c'est Vichnou. Ceci est d'autant plus remarquable que la métamorphose en poisson, matsyavatara, demeure isolée dans la mythologie indienne, étrangère à sa symbolique habituelle, et n'y donne naissance à aucun développement ultérieur[72] ; on ne trouve pas dans l'Inde d'autre trace du culte des poissons, qui avait pris tant d'importance et d'étendue chez d'autres peuples de l'antiquité. Burnouf y voyait avec raison une des marques d'importation de l'extérieur et le principal indice d'origine babylonienne, car les témoignages classiques, confirmés depuis par les monuments indigènes, faisaient entrevoir dans la religion de Babylone un rôle plus capital que partout ailleurs, attribué à la conception des dieux ichtyomorphes ou en forme de poissons. On pouvait déjà discerner que cette donnée étrange de symbolisme religieux, fondée sur l'idée d'une part prépondérante de l'élément humide dans la formation de l'univers, avait dû prendre naissance à Babylone et dans la Chaldée. Reportons-nous maintenant au récit babylonien du déluge, dont nous avons désormais une version originale. Le rôle que la légende conservée dans l'Inde fait tenir par le poisson divin près de Manou y est rempli près de Sisithrus par le troisième dieu de la triade suprême de la religion chaldéo-assyrienne, celui qui s'appelait en accadien Éa, l'Ao de Damascius[73]. C'est ce dieu qui avertit Sisithrus de l'imminence du déluge, qui le conseille dans la- construction de son navire, qui dirige celui-ci sur les eaux, et qui, parvenant à fléchir la colère de Bel, préserve de la destruction le héros à qui sa piété vaut le privilège d'échapper au cataclysme. Telle est, nous le comprenons maintenant, l'origine de la qualification de Salman, le sauveur, sous laquelle le dieu est aussi souvent désigné que sous son nom propre. Mais quel est ce nom ? Car si l'on continuait dans les textes en langue assyrienne, pour le troisième dieu de la triade suprême comme pour presque tous les autres dieux de l'Olympe chaldéo-assyrien, à écrire son nom avec l'ancienne orthographe accadienne, employée désormais comme un groupe idéographique ou allophone, on ne prononçait évidemment pas Éa, et il y avait, comme pour les autres personnages divins, une appellation assyrienne. La leçon Nisrouk, proposée par M. Oppert et que j'ai longtemps suivie, me paraît maintenant devoir être écartée, en ce qu'elle prend les éléments qui composent l'orthographe du nom pour leur valeur phonétique, ce qui ne se produit jamais en pareil cas. Il faut plutôt chercher un équivalent du sens d'Éa dans la langue assyrienne. Or, éa veut dire en accadien maison, demeure, siège, et c'est pour cela que quelquefois nous lisons dans les incantations magiques Éa, dieu de la maison, bien qu'il n'ait aucunement le caractère spécial d'un dieu pénate. Qu'un dieu ait été appelé maison, demeure, cela peut paraître au premier abord un peu étrange ; pourtant nous voyons aussi les Égyptiens donner aux dieux, et aux rois envisagés comme dieux, le titre de pir-aa, grande maison, d'où l'on a fait Pharaon ; et si l'on voulait creuser la raison symbolique qui a donné lieu à ces appellations, on verrait que dans les deux cas elle a été la même. La traduction assyrienne habituelle de l'accadien éa, dans les documents bilingues, est bit, maison ; mais ce n'est certainement pas ainsi que doit être lu le nom du dieu. Dès lors il faut, je crois, chercher pour cette lecture un dérivé de la racine navah, demeurer, résider, c'est-à-dire le mot nuah, nua, demeure, résidence, qui dans quelques traductions assyriennes correspond aussi à l'accadien éa. A la même racine appartient aussi le nom Ninua, signifiant également demeure, qui n'est pas seulement l'appellation de la ville de Ninive, mais aussi celle d'une déesse, fille du dieu dont nous cherchons à déterminer le nom[74]. Tout bien pesé, je crois donc qu'il faut en revenir à la lecture Nouah, proposée jadis par Hincks, mais sans qu'il pût encore en donner de preuves suffisantes. Ce qui achève de me déterminer en faveur de cette lecture Nouah — qui est comme sens l'équivalent exacte de éa — est le rôle du dieu en question dans le récit du déluge et l'analogie de Nouah avec le Noé biblique. Avec la parenté si étroite qui existe entre les deux versions du cataclysme, il serait étrange que le nom de Noé ne se retrouvât pas également dans toutes les deux ; il est, au contraire, assez naturel que, tout en le connaissant également, elles lui aient donné une place différente, que le nom qui désigne dans la légende babylonienne le dieu sauveur et protecteur spécial de Sisithrus soit dans la Bible l'appellation du patriarche sauvé. Sans doute dans Noahh (Noé) la gutturale qui termine le mot est plus forte que dans Nouah ; c'est un hheth au lieu d'un hé. Mais ce renforcement de la gutturale n'a qu'une importance philologique secondaire, d'autant plus qu'à côté de la racine navah les langues sémitiques nous offrent la racine parallèle, et identique à l'origine, navahh, se reposer. Quand les Septante, au verset 29 du chapitre V de la Genèse, expliquent le nom de Noé par οΰτος διαναπαύσει ήμάς, il nous reposera, ils indiquent que le texte hébreu qu'ils avaient sous les yeux, un peu différent en cet endroit de celui que nous possédons, rapprochait Noé du radical navahh. C'est une idée de repos, qui concorde très-bien avec le sens de l'accadien Éa. Et à côté du biblique Noé nous trouvons dans la tradition diluvienne de la Phrygie le nom de Nannachus[75], comme nous avons en assyrien Nouah et Ninouah, dérivés parallèlement de la racine navah. Un dernier ordre de considérations me parait donner une sérieuse valeur à ces rapprochements. Si le groupe de caractères qui représentait la prononciation accadienne primitive Éa ne peut pas être lu phonétiquement en assyrien nis'-ruk, mais doit correspondre dans cette dernière langue à une appellation telle que Nouah, le nom divin Nisroch (celui qui relie, qui unit) parait appartenir pourtant au même dieu. De même que Nouah s'appelle Salman, comme sauveur du déluge, il paraît avoir été appelé Nisroch lorsqu'on le considérait comme le dieu protecteur des mariages, rôle qui lui est en effet attribué par un grand nombre de textes. Quand il est invoqué à ce titre, on le désigne le plus habituellement par un groupe particulier d'idéogrammes ; et je crois qu'il est possible de démontrer que le groupe en question doit être lu Nisroch, de même qu'il y a une forme idéographique qui appelle la lecture Nouah et une autre qui appelle la lecture Salman. Or la tradition juive a toujours mêlé le nom de Noé à celui de Nisroch d'une façon jusqu'ici inexplicable, mais dont nous comprendrons actuellement l'origine. Nisroch, dit le célèbre Baschi, est une planche de l'arche de Noé. Maintenant Nouah, le maître des eaux, le seigneur des rivières, le souverain de la mer, le roi, le chef, le seigneur, le gouverneur de l'abîme, est dans la théologie babylonienne un des dieux le plus essentiellement ichtyomorphes. En tant que l'esprit qui se meut sur les eaux, les monuments de l'art assyrien et babylonien le représentent souvent, porté sur les flots de la mer primordiale, avec un corps de poisson, que surmonte un buste humain, coiffé de la tiare royale. Et en effet, dans le long catalogue de ses titres que fournit une des tablettes mythologiques du Musée Britannique, nous lisons ceux de poisson de l'abîme, poisson bienfaisant, poisson sauveur ; dans le même document et dans d'autres encore, la déesse Davkina, sa compagne, est appelée la grande épouse du poisson. Aussi dans les tablettes astrologiques est-il, à plusieurs reprises, fait mention d'une constellation appelée le poisson de Nouah. Il n'y a pas à douter que ce ne soit le signe entier des poissons, ou du moins celui des deux poissons qui est situé le plus exactement dans la bande zodiacale[76] ; car, dans la curieuse tablette qui enregistre les douze noms donnés à la planète Mercure pendant chacun des mois de l'année, nous voyons cet astre prendre le nom de poisson de Nouah dans le mois d'adar, le dernier de l'année (février), c'est-à-dire précisément à l'époque où Mercure, accompagnant toujours de très-près le soleil, se trouve avec lui dans le signe des poissons, autrement dit, pour les astronomes babyloniens, dans la constellation du poisson de Nouah. On notera, de plus, comme très-significatif, après les observations faites plus haut sur l'origine chaldéenne des signes du zodiaque, le rapprochement d'idées qui a fait placer le signe des poissons, primitivement du poisson de Nouah, à côté de celui du verseau, dont nous avons constaté le rapport avec la tradition du déluge. Il y a là une allusion manifeste au rôle de sauveur, que le peuple inventeur du zodiaque attribuait au dieu Nouah dans le déluge, et à la notion de nature ichtyomorphe, plus spécialement inhérente à cette face de son personnage. Quand on trouve chez deux peuples différant entre eux par la race et par les idées une même légende, avec une circonstance aussi spéciale, et qui ne ressort pas nécessairement et naturellement de la donnée fondamentale du récit ; quand, de plus, cette circonstance tient étroitement à l'ensemble des conceptions religieuses d'un des deux peuples, et chez l'autre demeure isolée, en dehors des habitudes de sa symbolique, une règle fondamentale et absolue de critique impose de conclure que la légende a été transmise de l'une à l'autre avec une rédaction déjà fixée, et constitue une importation étrangère qui s'est superposée, sans s'y confondre, aux traditions vraiment nationales, et pour ainsi dire géniales, du peuple qui l'a reçue sans l'avoir inventée. Sous ce rapport, la tradition du déluge a dans l'Inde un tout autre caractère que celle de la félicité édénique des premiers humains. Celle-ci est véritablement indigène chez les Aryas de l'Inde comme chez ceux de la Perse ; elle occupe une place fondamentale dans leurs conceptions cosmogoniques, et il n'y a pas moyen de douter qu'elle n'ait tenu le rang le plus important parmi les traditions sur les premiers âges, communes, dès l'origine, aux Aryas et aux Sémites, qui les emportèrent également en quittant le berceau où ils avaient commencé à grandir côte à côte dans les pâturages du plateau central de l'Asie. Au contraire, le récit du déluge est absent des parties les plus anciennes du Zend-Avesta, et n'apparaît chez les Iraniens que dans un livre de fort basse époque, déjà pénétré d'idées étrangères, le Boundéhesch. Dans l'Inde, il reste isolé, et conserve des traits de physionomie qui y font reconnaître une importation de la tradition de Babylone faite dans des temps déjà historiques. Chez les Aryas occidentaux, grecs, celtes et lithuaniens, la tradition du cataclysme paraît certainement indigène, et, par suite, a pris des formes vraiment originales, qui peut-être ont été primitivement connues des tribus qui se sont établies dans l'Inde ; mais elles y ont été supplantées plus tard par des légendes d'une autre source, car chez les Aryas orientaux, les récits qu'on possède du déluge sont des récits venus du dehors avec une forme arrêtée déjà, dont on retrouve la source à Babylone. Qu'un récit babylonien ait passé dans l'Inde, c'est un fait qui, en lui-même, n'a rien d'invraisemblable ni de surprenant. Il faut lire dans Heeren et dans les Antiquités indiennes de M. Lassen le tableau qu'ils ont tracé du très-antique commerce maritime de Babylone avec l'Inde, et les preuves qu'ils en ont rassemblées. Les textes cunéiformes en apportent de nouveaux témoignages. Quand Teglathphalasar II, l'un des rois assyriens mentionnés par la Bible, raconte l'expédition qui porta ses armes jusque dans la vallée de l'Indus, après avoir traversé l'Arachosie, ses inscriptions mentionnent des villes situées le long des rives du fleuve, auxquelles les Babyloniens donnaient des noms particuliers, preuve qu'ils les fréquentaient habituellement. Sennachérib parle de bois précieux de Sinda, c'est-à-dire des pays de l'Indus, qu'il tirait de Babylone, et les fouilles du colonel Taylor ont fait retrouver des débris de poutres de bois de teck dans les ruines des édifices de Mougheir, l'antique Our en Chaldée, d'où partit Abraham. Le récit du déluge est-il d'ailleurs le seul qui ait passé de Babylone dans l'Inde, et qui, étranger aux Védas, apparaisse plus tard dans le cycle épique indien ? Pour répondre à cette question, il faudrait connaître un plus grand nombre de morceaux de l'épopée babylonienne. Cependant j'appellerai dès aujourd'hui l'attention des érudits sur une phrase très-curieuse que je lis dans un fragment d'hymne en langue accadienne, qu'une tablette du Musée Britannique donne avec traduction interlinéaire en assyrien[77] : Comme le serpent énorme à sept têtes... comme le grand serpent qui bat les flots de la mer... Cette comparaison fait certainement allusion à une légende mythologique. Or, il est difficile de ne pas y trouver une saisissante analogie avec la célèbre légende du manthanam, ou du barattement des eaux de la mer par les Dêvas et les Asouras, au moyen du gigantesque serpent Vâsouki, enroulé autour du mont Mérou, légende qui forme un épisode du Mahâbhârata, et dont l'importance cosmogonique a été si bien mise en lumière par le baron d'Eckstein. Il est vrai que le Mahâbhârata ne parle pas en cet endroit de la pluralité des têtes du serpent Vâsouki ; mais les plus anciens monuments figurés représentant la scène du manthanam lui en donnent précisément sept, comme à l'autre serpent symbolique de la légende indienne, Çêcha ou Ananta, dont il ne se distingue pas foncièrement à l'origine. Entre autres exemples, je citerai l'admirable bas-relief du temple d'Angcôr, dont nous possédons à Paris un moulage dû aux soins du regrettable commandant de Lagrée. Mais les points de contact que l'on peut ainsi constater entre les légendes poétiques des bords de l'Euphrate et celles des bords de l'Indus et du Gange, entre l'épopée babylonienne et l'épopée indienne, sont-ils vraiment le résultat d'une communication opérée par de simples rapports commerciaux ? J'ai quelque peine à le croire, et je dois dire que je serais plutôt enclin à penser que les faits de ce genre sont le produit d'une communauté originelle de croyances et de souvenirs, comme de race, entre les habitants anté-aryens d'une portion de l'Inde et l'un des deux éléments fondamentaux de la population de la Babylonie et de la Chaldée. Les récits tels que celui du déluge, étrangers au vieux fonds aryen et védique, qui apparaissent dans les épopées, seraient ainsi des débris des traditions de cette Inde antérieure à l'établissement des Aryas, dont il me semble impossible de méconnaître la civilisation et dont les idées, conservées dans les couches populaires et pénétrant graduellement les castes aryennes elles-mêmes, commencent à s'infiltrer dans le Mahâbhârata et dans le Râmayâna pour devenir prédominantes dans les Pourânas, où elles altèrent les croyances brahmaniques autant que le brahmanisme lui-même, avec ses conceptions savantes et quelquefois d'origine non aryenne, s'éloigne du système primitif de la religion védique. Ceci laisserait intactes les observations d'Eugène Burnouf, que nous venons de voir si bien confirmées par les découvertes cunéiformes, sur le caractère étranger de la légende du déluge telle qu'elle se lit dans les épopées de l'Inde et sa parenté avec la légende chaldéenne ; on assignerait seulement une voie différente à son importation : au lieu de venir directement de Babylone, elle aurait été apportée dans le bassin du Gange par un peuple allié par le sang aux Babyloniens. Nous ne pouvons pas traiter ici en passant et à la d'une étude déjà trop longue l'un des problèmes les plus capitaux, mais aussi les plus difficiles, de l'ethnographie antique de l'Asie, celui de l'existence primitive, dans la plus grande partie de l'Inde septentrionale, d'une population à la peau brune, kouschite ou céphénienne, issue de la même race que les Kouschites de la Babylonie, de l'Arabie méridionale et de l'Éthiopie, population subjuguée ensuite par les Aryas et reléguée dans les castes inférieures, à laquelle appartiennent en propre les noms de Kâuçikas, de Çoùdras et de Kadraveyâs. Ceci demanderait des développements qui nous entraîneraient trop loin et mériteraient de fournir à eux seuls la matière d'une étude spéciale. Nous nous bornerons donc à renvoyer le lecteur aux travaux, si ingénieux et si originaux dans leur hardiesse, du baron d'Eckstein, ainsi qu'à ce que nous avons dit nous-même de cette question dans le troisième volume de notre Manuel d'histoire ancienne de l'Orient. Mais il est pourtant impossible de ne pas rappeler du moins ici que l'un des peuples qui paraissent le plus positivement se rattacher à la souche kouschite, dans les souvenirs de l'Inde mythique et antéaryenne, est le peuple des Matsyas ou poissons, auxquels se rattache tout un cycle de légendes où le poisson joue un caractère symbolique et sacré, et auxquels pourtant il me semble, comme à beaucoup d'autres érudits, qu'on ne saurait méconnaître un certain caractère historique, déguisé sous le voile des légendes. Ce peuple porte le nom des dieux-Matsyas ou des dieux-poissons ; il est gouverné par des rois-Matsyas ou des rois-poissons ; il offre à ses dieux des poissons en holocauste, par les mains des pontifes Matsyas ou pontifes-poissons, qui livrent aussi aux dieux-poissons des victimes humaines. Les Matsyas figurent dans plusieurs localités de l'Inde, sur les bords de la Yamounâ, qu'ils ont canalisée, dans l'Inde centrale et à l'occident sur les rives de l'Indus, offrant partout le caractère d'un peuple navigateur, agricole et commerçant. Ses rois se présentent aussi comme des pécheurs ou Dâsas, ou comme des Çoûdras que l'on identifie aux Dâsas, aux pêcheurs, marins, navigateurs, autre peuple déchu qui fournit, depuis une antiquité bien des fois séculaire, les temples de la vieille Inde non brahmanique, mais sectaire ou populaire, de bayadères appelées Dêva-dâsîs, esclaves des dieux et de leurs pontifes, danseuses et courtisanes attachées au service de certains sanctuaires. Appartenant à la caste des pêcheurs, si elles ne sont pas arrivées de l'étranger par le commerce maritime, remarque le baron d'Eckstein, elles témoignent par leur présence de ces grands marchés d'esclaves femelles, vouées au service des temples, qui donnent l'hospitalité aux commerçants de toutes les nations arrivés par la voie des caravanes ou la route des mers. Ces établissements, à la fois sacrés et profanes, pullulent spécialement sur les côtes de la Gédrosie, dans la Babylonie, l'Arabie sabéenne et l'Éthiopie, où sont les grands emporia des antiques Céphènes. Le père mythique de la plus vieille astronomie mythique de l'Inde, notamment du cycle de soixante ans — dont l'origine ne s'explique complètement qu'à Babylone par son lien avec le système fondamental de la numération —, des quatre yougas et des manvantaras — calculs des temps qui ont pris une forme spécialement indigène, mais dont la conception première se retrouve aussi en Babylonie et en Chaldée —, le père de cette astronomie, Parâsara, est un Matsya ou du moins l'époux d'une Matsyâ, d'une Dâsî, fille du roi des marins, des pêcheurs, des navigateurs, nymphe de la Yamounâ, dont la mère avait eu la forme d'un poisson. Le savoir de ce dépositaire mythique du plus ancien système scientifique de l'Inde a passé des Matsyas aux Brahmanes. La nymphe dont il est le mari opère la traversée d'une rive de la Yamounâ à l'autre, et commence son œuvre par faire passer le fleuve à Parâsara, son futur époux. Or, la Yamounâ possède une signification mythique comme le Styx ou l'Achéron, comme le fleuve de la mort qui sépare Izdubar de Sisithrus dans la légende babylonienne. Le symbole de sa traversée et les rites initiatoires qui l'accompagnent se rattachent à une théorie que l'on peut regarder comme céphénienne ou kouschite sur la navigation de la vie et le passage de la mort, qui conduit à un lieu de débarquement majeur, à un tîrtha suprême, séjour de la renaissance sur une nouvelle rive terrestre, comme le lieu où Sisithrus est conduit pour vivre immortel au sortir du vaisseau qui l'a porté sur les eaux du déluge, théorie qui n'est pas étrangère à la conception de la navigation d'où Izdubar rapporte l'immortalité. Les sages ou les pontifes du peuple des Matsyas sont donc avant tout des astronomes, pareils à ceux de la Chaldée primitive ; ils président à l'enseignement de son labour et de son industrie, accompagné de rites sacrés et initiatoires. Les livres scientifiques qu'on leur attribue n'ont rien de commun avec les Védas existants, avec ceux des purs Aryas ; mais ils se rapportent à des Védas perdus, aux Védas des Çoûdras, aux Cîlpa-çâstras, Védas des astrologues et des astronomes, dont le système renouvelé de Parâsara est un débris. C'est toujours cette vieille littérature à la fois sacrée et technique que la tradition attribue aux castes brunes subjuguées par les castes aryennes, et qui offre tant d'analogie avec les livres astronomiques, astrologiques et scientifiques de l'antique Chaldée, que Sargon Ier faisait colliger dans ses bibliothèques et dont nous commençons à posséder, dans les copies exécutées par ordre d'Assourbanipal, des fragments importants. Toutes les indications qui ont trait à cette science mythique des Matsyas, à leurs enseignements, à leur développement technique, sont de nature à faire entrevoir dans les populations brunes et anté-aryennes des bassins de l'Indus et du Gange, probablement kouschites, une notion symbolique analogue à celle qui dans la Babylonie et dans la Chaldée, pays où les Kouschites se mêlent aux Touraniens et ont une part importante à la naissance de la civilisation, faisait révéler les lois de la religion, des sciences et de la société par les théophanies successives du dieu-poisson Oannès, sorties de la mer Érythrée et apportant chacune un livre sacré dans les récits que Bérose a conservés. C'est la notion qui ne fait pas seulement du dieu Anou un être ichtyomorphe dans son rôle spécial de révélateur des secrets divins, de législateur et d'instituteur des hommes, mais qui conduit aussi à le représenter également sous la forme d'un dieu-poisson Nouah, l'esprit porté sur les eaux, l'intelligence suprême qui pénètre et anime la nature. Cette conception symbolique est d'une nature trop particulière, trop isolée, trop peu conforme aux idées des autres peuples du monde antique pour qu'on ne soit pas frappé de la voir se reproduire à la fois dans le bassin de l'Euphrate et du Tigre et dans une partie de l'Inde, s'y rattachant à une des populations qui ont précédé les Aryas, et pour qu'on ne donne pas à un tel fait une sérieuse importance. Autour du nom du peuple fabuleux des Matsyas se groupe donc dans les souvenirs de la poésie indienne tout un cycle spécial de mythes, à demi-religieux, à demi-historiques, où l'emblème du poisson prédomine et tient une place caractéristique, sans analogues dans les autres traditions de la même partie du inonde. Mais comment n'en pas rapprocher la légende du Matsys par excellence, du poisson sauveur du déluge, dont on a fait postérieurement un avatar de Brâhmâ ou de Vichnou, combinant l'adoration des dieux Aryas avec celle du dieu-poisson ou Matsya, comme avec celle du dieu-serpent ou Çêcha, tandis que la version plus antique du Çatapatha Brâhmana n'offre encore aucune identification de ce genre ? Si elle est isolée du reste de la mythologie indienne et étrangère à sa symbolique habituelle[78], elle cadre, au contraire, admirablement avec ce cycle et s'y relie de la façon la plus naturelle. Aussi peut-on chercher de ce côté des indices sur la race qui introduisit dans l'Inde cette forme spéciale de la tradition diluvienne et la communiqua ensuite aux Aryas. Il est à remarquer que dans les Pourânas ce n'est plus Manou Vâivasvata que le poisson divin sauve du déluge ; c'est un personnage différent, roi des pêcheurs, des Dâsas, nommé Satyavrata, l'homme qui aime la justice et la vérité, ressemblant d'une manière frappante au Sisithrus de la tradition chaldéenne. Et la version pourânique de la légende du déluge n'est pas à dédaigner, malgré la date récente de sa rédaction, malgré les détails fantastiques et souvent presque enfantins dont elle surcharge le récit. Par certains côtés elle est moins aryanisée que la version du Brâhmana et du Mahâbhârata ; elle offre surtout quelques circonstances omises dans les rédactions antérieures et qui pourtant doivent appartenir au fonds primitif, puisqu'elles se retrouvent dans le mythe babylonien, circonstances qui sans doute s'étaient conservées dans la tradition orale, populaire et non brahmanique, dont les Pourânas se montrent si profondément pénétrés. C'est ce qu'a remarqué déjà M. Pictet, qui insiste avec raison sur le trait suivant de la rédaction du Bhâgavata-Pourâna : Dans sept jours, dit Bhâgavat à Satyavrata, les trois mondes seront submergés par l'océan de la destruction. Il n'y a rien de semblable dans le Brâhmana ni dans le Mahâbhârata ; mais nous voyous dans la Genèse que l'Éternel dit à Noé : Dans sept jours je ferai pleuvoir sur toute la terre (VII, 4) ; et un peu plus loin nous y lisons encore : Au septième jour, les eaux du déluge furent sur toute la terre (VII, 11). Le poème d'Érech ne précise pas le nombre de jours écoulés entre l'annonce du déluge par Samas et le cataclysme lui-même ; mais la construction du vaisseau de Sisithrus y dure sept jours, la force du déluge sept autres jours, et enfin sa décroissance sept jours encore. Il ne faut pas accorder moins d'attention à ce que dit le Bhâgavata-Pourâna des recommandations faites à Satyavrata par le dieu incarné en poisson pour qu'il dépose les écritures sacrées en un lieu sûr, afin de les mettre à l'abri du Ilayagriva, cheval marin qui réside dans les abîmes, et de la lutte du dieu contre cet Ilayagriva qui a dérobé les Védas et produit ainsi le cataclysme en troublant l'ordre du monde. C'est encore une circonstance qui manque aux rédactions plus anciennes, même au Mahâbhârata ; mais elle est capitale et ne peut être considérée comme un produit spontané du sol de l'Inde, car il est difficile d'y méconnaître, sous un vêtement indien, le pendant exact de la tradition de l'enfouissement des écritures sacrées à Sippara par Sisithrus, telle qu'elle apparaît dans la version des fragments de Bérose. Je m'arrête ici, sans oser me prononcer d'une manière absolument décidée entre les deux hypothèses par lesquelles on peut expliquer l'existence dans l'Inde d'un récit du déluge qui n'est pas védique et tient d'aussi près à celui de Babylone. Il faut attendre des découvertes nouvelles pour donner plus de corps et de certitude aux rapprochements que je n'ai fait qu'indiquer. Aussi bien me suis-je déjà laissé entraîner trop loin par la nouveauté du sujet de cette étude et par l'importance des aperçus qu'ouvre la découverte de M. Smith. La littérature babylonienne nous tient en réserve encore bien d'autres révélations. C'est d'peine si on a commencé à entamer l'étude de quelques-unes de ses pages, et déjà l'on reconnaît que d'après elle il faudra refaire sur des documents positifs, et non plus sur des théories moins solides que brillantes, toute l'histoire des premières civilisations de l'Asie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||