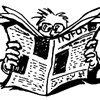DES JOURNAUX CHEZ LES ROMAINS
DES ANNALES DES PONTIFES OU GRANDES ANNALES
TROISIÈME PARTIE. — DE LA VALEUR HISTORIQUE DES GRANDES ANNALES.
|
L'EXAMEN d'une dernière objection, la plus spécieuse de toutes, va compléter cette discussion. A supposer même, a-t-on dit, que des fragments historiques de l'annuaire des pontifes eussent survécu à tant de vicissitudes, ces courtes indications chronologiques de magistrats, de guerres, de famines, d'éclipses, de prodiges, et, si l'on admet des récits plus étendus, toutes ces légendes superstitieuses ou mensongères des nobles familles pontificales donnaient-elles beaucoup de lumières, méritaient-elles beaucoup de foi ? L'histoire romaine, enfin, écrite sur de tels matériaux, était-ce réellement une histoire ? On pourrait d'abord répondre que des tables chronologiques, courtes, mais simples et claires, où se perpétuaient année par année, comme nous l'avons vu, les noms des chefs de l'État et la suite des principaux événements militaires, civils, religieux, étaient cependant de quelque secours, et fournissaient, malgré leurs lacunes, des documents plus complets qu'il ne nous en est resté pour l'ancienne histoire de la plupart des nations. Il est vrai qu'elles n'offraient rien sans doute qui pût favoriser les illusions et les fantaisies de l'esprit de système ; rien qui autorisât à faire de Rome, selon le caprice du moment, tantôt une ville étrusque, tantôt une ville latine ; rien qui ressemblât à ces trois ou quatre grandes épopées qu'une imagination poétique dessine et colore d'après Tite-Live et d'après Homère ; il est vrai surtout qu'on y aurait vainement cherché les prétendues villes de Lucerum, de Quirium, villes toutes germaniques, et qui n'ont été fondées que de notre temps[1]. Le mur blanchi du pontife n'avait point de place pour de telles découvertes qui auraient demandé de longues preuves ; mais quelques extraits des Annales, comme les antiques narrations sur la statue d'Horatius Coclès, sur celle de la Fortune des femmes, ont fait voir que des chroniques sacrées n'étaient point aussi sèches, aussi stériles, ni, pour me servir de l'expression qu'on emploie, aussi monosyllabiques[2] que le pensent ceux qui ne veulent absolument pas qu'on trouve quelque part l'histoire romaine, parce qu'ils aiment mieux l'inventer. Mais enfin ces traditions, courtes ou développées, n'étaient-elles pas en général fabuleuses ? Ici reparaît la question, tant de fois renouvelée, sur le degré de certitude des premiers temps de Rome. Bien qu'on l'ait de nos jours proclamée comme neuve, il y aurait quelque chose de plus étonnant et de plus incroyable que toutes les fables accréditées longtemps par l'autorité Sainte des pontifes : ce serait qu'il eût fallu attendre jusqu'à notre siècle peur découvrir que les merveilles de Romulus et de Numa ne sont pas entièrement dignes de foi ; qu'il n'est pas tout à fait sûr qu'un bouclier soit tombé du ciel ; qu'il n'est pas impossible que le caillou de Tarquin ait résisté au rasoir de l'augure ; que peut-être les dieux n sont point venus, comme au lac Régille, combattre parmi les hommes. On savait avant nous qu'il y avait, dans tout cela, quelque lieu de douter. La critique historique, du moins dans Rome, est aussi antienne) non que les annalistes ou chroniqueurs, mais que les historiens. Dès le siècle de Caton l'ancien, les Annales finissent, l'histoire commence : Prima enim Annales fuerunt, post historiæ factæ sunt, dit le grammairien Marius Victorinus[3] ; du moment que l'histoire naît, l'esprit de doute et de recherche naît avec elle. Je ne voudrais pas rentrer dans une controverse que cette Compagnie elle-même a souvent agitée ; mais il est de mon sujet de montrer que les Annales pontificales purent être utiles, malgré leurs fables, aux premiers historiens romains, et que lorsqu'ils en rédigèrent les récits en corps d'histoire, ils étaient déjà capables d'y faire un choix. A qui les critiques d'Allemagne ont-ils dû, non pas l'idée, qui a pu leur venir de plusieurs faits analogues dans les temps modernes, mais la preuve de ces chants nationaux dont ils font le germe de l'histoire de Rome ? A Caton qui, dans ses Origines, rappelait ces chansons où, à table, au son de la flûte, on célébrait les actions des grands hommes[4]. C'est des Romains aussi que nous savons que leurs éloges funèbres, autre fondement de leur histoire, pour mieux honorer les descendants, prêtaient aux aïeux de fausses généalogies, de faux consulats, de faux triomphes[5]. Les auteurs de ces éloges, même dans les temps les moins crédules, n'y épargnaient point le merveilleux[6] ; car l'orgueil des familles n'en était pas moins avide que celui des peuples, et les Jules étaient fils de Vénus, comme les Romains étaient fils de Mars. Si j'ai dit qu'il n'était pas besoin d'anciens textes pour bâtir un système sur cette idée de traditions poétiques, c'est qu'elle s'offre d'elle-même à tous ceux qui étudient les origines des nations. L'Inde n'a pour histoire que des poèmes. Les Hébreux se transmettaient le passé dans leurs cantiques. La Grèce place Homère à la tête de ses historiens. Au siècle de Tacite, les Germains continuaient de chanter Arminius ou Hermann ; plus tard, l'épopée des Nibelungen a immortalisé Ermenrich et Siegfried. Les bardes racontaient à l'avenir les belles actions de la Gaule. Charlemagne avait fait recueillir les chants historiques des Francs, seules annales de son peuple. Celles du Nord se transmettaient dans les poésies des scaldes. En Espagne, en Écosse, on retrouve le même usage. Les Romains seraient-ils exceptés de cette loi commune, qui fait naître partout l'histoire chantée avant l'histoire écrite, les contes populaires avant les récits authentiques, les miracles avant les faits ? En vain M. W. Schlegel doute que ce peuple grave, occupé de lois et de conquêtes, ait jamais eu l'exaltation poétique de l'Orient, ou même du Nord. Cette objection ; qui paraît s'appliquer assez mal aux anciens habitants d'un pays comme l'Italie, tombe devant le témoignage de Caton. Pourquoi nier ces poésies nationales des Romains, qu'ils nous attestent eux-mêmes ? Ce qui est important, c'est de savoir jusqu'à quel point ces traditions, ou poétiques, ou, puisqu'on le veut, symboliques, conservées par les chansons de table, les mémoires des familles, les inscriptions des pontifes, ont envahi l'histoire ; et si les premiers historiens romains n'avaient pas eux-mêmes assez de discernement pour les reconnaître et les juger. Or, nous l'avons vu, Caton, fort peu indulgent pour les Annales patriciennes du souverain pontificat, dut les contrôler par les autres annales italiennes qu'il avait toutes rassemblées. Pison fut si loin d'être dupe de ce mélange de vérités et dé fictions que, dans son histoire qui jouissait d'une assez grande estime, il cherchait déjà pour les fables des interprétations naturelles et n'admettait comme vrais que les faits vraisemblables. Mais il y a surtout un mémorable fragment d'un autre contemporain de Caton, d'un des plus anciens historiens de Rome, P. Sempronius Asellio, que l'auteur du système des épopées romaines ; soit à dessein, soit par oubli, ne cite nulle part et qui prouve que, dès ces premiers temps littéraires, on avait assez de critique pour faire un sage emploi ; dans l'histoire, des registres chronologiques des pontifes. Voici la différence, dit-il, entre un annaliste et un historien. L'annaliste fait un simple journal des événements ; l'historien de plus, en recherche les causes. Les Annales ne suffisent pas pour exciter à la défense de la patrie ; pour détourner de mal faire. Dire sous quel consulat telle guerre a commencé, le succès des combats, le nom du triomphateur, et négliger les décrets du sénat, les lois proposes au peuple, des motifs de tontes ces actions, c'est faire des contes pour les enfants, ce n'est pas écrire l'histoire[7]. On trouve dans ce texte précieux de Sempronius la lenteur et l'inexpérience de style que Cicéron lui reproche[8], mais une vue pénétrante, une haute raison. Un tel homme ne croyait pas plus sans doute que les modernes compilateurs d'histoire romaine aux aventures merveilleuses de la prêtresse Silvia, ou aux entretiens de la nymphe Égérie. Polybe, le judicieux Polybe ne parlait pas autrement dans
ce nouveau texte publié seulement en 1827 d'après les manuscrits du Vatican :
Que sert-il aux lecteurs de parcourir des guerres,
des combats, des prises et des soumissions de villes, s'ils ne pénètrent les
causes pour lesquelles les uns ont réussi et les autres ont échoué ? L'issue
des événements peut amuser l'esprit ; mais l'étude des plans et des
combinaisons est seule instructive, et l'explication de tous les détails d'un
fait dirige surtout ceux qui marchent vers le même but[9]. L'historien
grec, qui put se trouver avec P. Sempronius au siège de Numance, dans la
tente de Scipion Émilien[10], ne se doutait
pas que parmi ces Romains qui l'entouraient et qui n'avaient pas encore eu de
Thucydide, il y avait un homme capable de le comprendre, et d'enseigner aussi
bien que lui quel doit être le vrai caractère de l'histoire. Plus tard, les prodiges et les autres mensonges politiques répandus dans les Annales, mais qu'il était aisé de distinguer des renseignements utiles, n'empêchèrent pas Cicéron de juger, d'après leur autorité, l'ancien gouvernement romain, et de préparer une nouvelle histoire de sa patrie ; Denys d'Halicarnasse, de combiner ce qu'il connaissait de ces tables sabrées avec les ouvragés de Caton, de Cincius, de Valerius Antias, de Macer, de Varron, et avec les historiens grecs de Rome, guides pour la plupart moins sûrs et moins fidèles Verrius Flaccus, de former de ces débris (tout porte du moins à le croire) un recueil assez dut parfait encore de documents historiques ; Pline, Tacite et Suétone, de Se fonder mil ces antiques témoignages, plus complètement rassemblés de leur temps dans le nouveau Capitole, pour centre dire quelquefois les traditions imaginées ou exagérées par l'orgueil national ou par la vanité des fendîtes. Depuis là renaissance des lettres, cette question de l'incertitude des cinq premiers siècles de Rome a été débattue fort souvent ; et même dès l'abord, malgré le respect qui protégea longtemps tout ce qui restait de l'antiquité. Les uns s'eut, pressèrent de dire que le bon sens ne pouvait accepter cet héritage de fables ; les autres crurent que des pages douteuses, ou même fausses, n'étaient pas un prétexte suffisant pour effacer la moitié de l'histoire d'un peuple. Déjà les plus anciens interprètes de Tite-Live, Laurent Valla Glaréanus, Sigonius, osent douter de quelques-uns de ses récits. Le géographe Cluvier, un des premiers qui aient attribué aux Grecs l'histoire romaine ; avance que les annalistes latins n'ont fait que copier Dioclès de Péparèthe et ses fables grecques sur Rome[11] ; il est combattu par Nardini[12], par Jules Minutoli[13] ; et par Jac. Périzonius, comme superficiel et téméraire. Celui-ci, dès 1685, fonde véritablement ce système, que l'on à cru nouveau, de l'histoire faite avec des chants populaires : Ces chants dont Caton l'ancien avait gardé la mémoire, ces hymnes en l'honneur des grands hommes et lorsqu'on avait pas d'autres Monuments littéraires, où qu'on n'en avait que d'insuffisants, comme les Annales des pontifes, sauvèrent quelques faits de l'oubli ; mais ils durent, aussi bien épié les éloges funèbres, altérer l'histoire. C'était aux gens sages, qui connaissaient l'esprit à se prémunir contre des récits enfantés par l'amour du merveilleux ou par la vanité. Ainsi parlait Périzonius[14], et Bayle à peu près comme lui[15]. Vers la fin du même siècle, tandis que Bochart nie l'arrivée d'Énée en Italie, à cause des vers où Homère dit que les descendants d'Énée régneront sur les Troyens[16], et parce qu'il croit reconnaître fort peu de mots phrygiens dans la langue latine[17] ; tandis que Ryckius essaie de lui répondre[18], Jacques Gronovius, non moins hardi que ce chanoine de Lille ; Jacques Hugo, qui avait prétendu découvrir dans la Judée et dans la bible la vraie histoire romaine[19], s'amuse à faire de Romulus un phénicien[20] ; Floriano de Zamora, un espagnol ; Emmanuel de Faria y Sousa, un portugais[21]. La dixième dissertation d'Henri Dodwell, sur les anciens cycles romains[22], malgré l'embarras de trouver des chiffres pour toute cette chronologie, se renferme dans un doute plus circonspect et plus grave. M. de Pouilly, en 1722, lit à l'Académie des Belles-lettres, en faveur de l'incertitude, son ingénieux mémoire[23], réfuté alors vivement par son confrère l'abbé Sallier[24], et même par l'autorité imposante de Fréret[25] ; comme bientôt l'ouvrage de Beaufort[26] le fut par l'anglais Hooke dans son Histoire romaine[27], et par Christophe Sax dans les Nouveaux mélanges de Leipzig[28] ; comme, de nos jours, le mémoire par lequel Lévesque préluda, dans cette Compagnie, au scepticisme de son Histoire romaine, le fut par Larcher[29] ; comme, en Allemagne, l'illustre successeur de Pouilly, de Beaufort, de Lévesque, l'a été par deux ou trois critiques qui, s'ils trouvent des auxiliaires, ne tarderont pas à convaincre les juges les plus prévenus que leur docte compatriote, outre les défauts incontestables de son livre, a eu le tort de donner comme neuves, comme de lui, plusieurs rêveries brillantes du napolitain Vico, plusieurs observations délicates des savants français. Un des plus courts et certainement le plus gai des
ouvrages nés de la controverse sur les origines de Rome, est cette
plaisanterie que fit l'abbé Barthélemy à la fin du dernier siècle, sans doute
pour la société de madame de Choiseul, et qu'il intitula : Essai d'une
nouvelle histoire romaine[30]. Il remonte,
sans pitié, jusqu'aux âges mythologiques, où paraissent s'être complu les
premiers rédacteurs des Annales sacrées : Dans ce
temps-là, dit-il, vivait un homme qui
s'appelait Énée ; il était bâtard, dévot et poltron : ces qualités lui
attirèrent l'estime du roi Priam qui, ne sachant que lui donnera lui donna
une de ses filles en mariage. Son histoire commence à la nuit, de la prise de
Troie.... Après de longs malheurs, il parvint
en Italie, vers l'embouchure du Tibre, où le premier objet qui frappa ses
regards fut une truie qui venait de mettre bas trente cochons blancs[31]. Là devaient se terminer ses voyages ; les oracles
l'avaient prédit. Il prit possession de la mitrée, et commença par tracer
l'enceinte d'une ville. Il voulut ensuite savoir à qui ces lieux
appartenaient avant son arrivée.... Latinus
était très-vieux, et n'avait qu'une fille très-jeune, nommée Lavinie...
Énée l'épouse.... Il
est attaque par les Étrusques et les Rutules. Le combat se donne sur les
bords du Numicus, petit ruisseau dont les eaux étaient employées par préférence
au culte de Vesta, et qui s'épuisa dit-on, un jour que les libations
devinrent plus fréquentes[32]. Énée au milieu de l'action, fut poussé dans le ruisseau,
et s'y établit si bien qu'il s'y noya[33]..... Telle fut sa gloire, que des îles, des promontoires
quittèrent leurs anciens noms, et prirent ceux de ses cousines et de ses
nourrices, de son pilote, de son trompette ; enfin, quoique, suivant la remarque
d'un écrivain judicieux, on ne puisse être enterré que dans un endroit[34], plusieurs villes se félicitent de conserver son tombeau. Ces épigrammes sont justes, et je dois les accepter pour les chroniques pontificales, qui n'avaient pu manquer assurément de consacrer l'origine troyenne de Rome, la truie et ses trente petits, les rapports d'Énée avec Évandre et Latinus, toute cette mythologie nationale dont Virgile est le poêle. Mais les pontifes étaient excusables sans doute : ils adoptaient une tradition née avant eux, et l'écrivaient comme sous la dictée du peuple. On ne saurait dire assez combien les préjugés de cette origine troyenne étaient profondément enracinés, et le sent peut-être encore, du nord au midi de l'Italie, dans les croyances populaires. Si l'on montrait jadis avec orgueil, à Circéi, la coupe d'Ulysse[35], Padoue n'a point cessé d'être fière de son fondateur Anténor, dont elle a cru longtemps posséder la tombe ; et j'ai entendu en Sicile les villageois du petit bourg de Palomba, sans avoir lu Virgile ou Homère, s'appeler encore discendenti di Troia, tandis que leurs voisins, qui certes ne connaissent pas plus qu'eux la truie miraculeuse de l'Énéide, ajoutaient en plaisantant : Onde sono tanti porci. Rome elle-même encourageait de telles idées par son exemple. C'est ainsi qu'elle avait proclamé les habitants de la ville sicilienne de Ségeste, que l'on disait troyenne, parents du peuple romain[36]. Les inscriptions laissées par T. Quinctius Flamininus à Delphes, après la première guerre de Macédoine, nommaient aussi les Romains les fils d'Énée[37] : expression qui ne pouvait être nouvelle, puisqu'on osait l'inscrire sur un monument à la fois politique et religieux. Fabius Pictor et les autres annalistes qui parurent croire à l'arrivée d'Énée en Italie, lurent donc les échos fidèles, non d'une invention des Grecs italiotes, ou d'une idée inspirée aux Romains par leurs études grecques, mais d'une opinion que l'on voit devenir vulgaire avant de l'avoir vue commencer. Elle dure encore, et au milieu dés querelles du peuple de Rome moderne, il n'est pas rare d'entendre les Transtéverins s'écrier dans leur dialecte : Sema Romani, per Dio ! sema sangue troiano ![38] Je n'ai pu me refuser, dans un tel sujet, à tette digression sur l'avant- scène mythologique de l'histoire de Rome : je reviens, avec Barthélemy, à l'histoire même. Cet écrivain de sens et d'esprit, qui a le droit d'être sévère sur la vraisemblance, parce qu'il ne prétend pas, en ne tolérant qu'à peine l'histoire des rois et des consuls, posséder parfaitement celle des Opiques et des Pélasges, arrive de fable en fable aux mystères de la fondation de Rome ; et là, il ne respecte pas plus la nourrice des deux fondateurs, Acca Larentia, que les Annales elles-mêmes, il faut en convenir, ne l'avaient respectée ; car les fastes prénestins de Verrius Flaccus, où doivent se trouver des fragments' des Annales, traitent fort mal la femme du berger Faustulus[39]. Faustulus, dit à son tour l'abbé Barthélemy, était un homme vertueux, que ses services avaient élevé au rang de premier berger du roi ; Acca n'avait pas de grandes vertus, mais elle avait de grandes faiblesses qui lui valurent beaucoup de douceurs pendant sa vie, et les honneurs divins après sa mort[40]. L'enlèvement des Sabines aux fêtes de Consus, jour
mémorable consacré aussi par les fastes[41], ne pouvait échapper
à l'ironie : Romulus prescrivit à ses soldats
d'enlever les filles de ces étrangers, mais de respecter leurs femmes. Ce
serait un beau sujet de prix à proposer que de demander comment, dans ce
tumulte épouvantable, les ravisseurs purent exécuter les ordres de leur
maître. Cependant ils mirent tant de discernement dans leur choix, que de
trente ou six cent quatre-vingt-trois prisonnières — car les auteurs
anciens[42]
varient un peu sur le nombre —, il ne se trouva
qu'une femme mariée : on l'avait enlevée par mégarde, et Romulus l'épousa
pour la rareté du fait[43]. Voici selon le parodiste, l'origine de la clientèle, que les monuments de tout genre nous représentent comme une institution fondamentale de la société romaine : Romulus n'avait cessé de s'occuper du gouvernement et des lois. Un jour, ayant rassemblé tous les habitants de Rome, il dit aux uns : Soyez patriciens et protecteurs ; il dit aux autres : Soyez plébéiens et protégés. Et cela se fit ainsi[44]. Enfin, la raillerie n'épargne pas la mort de Romulus. L'éclipse dont parlait la tradition[45], et le nom divin de Quirinus inscrit dans tous les fastes, n'empêchent pas le critique de dire : Le peuple épouvanté prend la fuite ; il revient après l'orage, il voit les patriciens immobiles dans leur plage ; et, n'apercevant point Romulus, il les soupçonne et bientôt les accuse de l'avoir mis en pièces et d'en avoir caché les morceaux dans leurs poches[46]. On allait les fouiller, lorsqu'un sénateur, nommé Proculus, etc. Je m'arrête : il est aussi inutile de transcrire d'un bout à l'autre que de discuter ici les satires de l'ingénieux abbé contre l'histoire écrite par les prêtres de Rome. On voit seulement que sur ce point comme sur beaucoup d'autres, nous nous faisons trop complaisamment les humbles admirateurs des réputations étrangères, et que depuis longtemps les doutes, vraiment nécessaires lorsqu'ils sont raisonnables, de Bochart, Pouilly, Beaufort, Barthélemy, Lévesque, avaient commencé ce qu'un docte Allemand n'a point fini. Il me semble même que c'est à nos compatriotes qu'est resté l'avantage ; car on ne peut du moins leur reprocher la prétention d'avoir voulu réunir deux choses qui s'excluent, mais que de certains critiques qui se croient novateurs réunissent avec une singulière facilité : l'esprit de doute, toujours défiant ; et l'esprit de système, toujours confiant et orgueilleux ; en un mot, le dogmatisme dans le doute. Le chef moderne de cette école qu'il n'est pas aisé de rafler parce qu'on arrive toujours trop tard et qu'elle s'est déjà réfutée elle-même ; qui vêtit qu'on la croie, et qui veut prouver qu'il ne faut rien croire parmi tant d'incertitudes ; qui dédaigne fort le témoignage des anciens ; et qui prétend qu'elle ne dit rien que d'après eux ; cet homme d'imagination autant que de savoir, si persuasif dans quelques détails, si peu satisfaisant dans l'ensemble, avec sa Rome tour à tour étrusque bu latine, avec ses Prisci, ses Casci, avec ses histoires de peuples qu'il établit sur un mot et quelquefois sur moins encore, avec ses nouvelles cités de Lucerum et de Quirium, a paru faire dé grandes découvertes ; mais il n'a guère inventé que de merveilleux suppléments aux merveilles consacrées par les Annales pontificales. Conjectures pour conjectures, fables pour fables, j'aime autant celles de Tite-Live. Est-ce à dire que les railleries des tins, les systèmes des autres, doivent nous faire prononcer que Rome, jusqu'au temps de Caton, n'avait point gardé de souvenirs historiques ? Non ; proscrire l'histoire d'un siècle, parce qu'il s'y mêle des fables, c'est proscrire l'histoire de tous les siècles. Les premiers siècles de Rome vous sont suspects à cause de la louve de Romulus, des boucliers de Numa, du rasoir de l'augure, de l'apparition de Castor et Pollux ; des récits ornés ou défigurés ainsi ne peuvent être, selon vous, que des récits tout à fait mensongers. Effacez donc alors de l'histoire romaine toute l'époque de César, à cause de l'astre qui parut à sa mort, dont Auguste avait fait placer l'image au-dessus de la statue de son père adoptif dans le temple de Vénus, et que plusieurs monuments de numismatique et de glyptique nous montrent encore ; celle d'Auguste lui-même, puisqu'on le disait fils d'Apollon métamorphosé en serpent[47] ; et jusqu'au siècle de Tacite, qui ne dédaigne pas de faire entrer dans la fortune de Vespasien ses miracles d'Alexandrie. Les Prodiges compilés par Julius Obséquens, peut-être au temps même de Tacite, ne commencent maintenant qu'à l'an 563 de Rome : en sont-ils pour cela moins nombreux ? Que l'on songe à tout ce qui pouvait alors encore se dire et se croire ; qu'on se souvienne aussi que plus les temps sont reculés, plus le merveilleux dans l'histoire est fréquent et facile : on cessera sans doute d'être plus rigoureux pour les vieilles aima-les des Romains que pour celles de tous les peuples du monde. Nous-mêmes gardons-nous, pour notre gloire, de traiter avec trop de rigueur les histoires pontificales. Les nations qui ont fait de grandes chop ses ne consentent jamais à une origine vulgaire : elles se plaisent à consacrer leur berceau par des événements surnaturels, par des interventions divines, ou seulement par de vagues souvenirs de vertu et d'héroïsme, qui semblent agrandir avant le temps les destinées de la patrie. Le mo. ment vient ensuite où la critique impitoyable, 4 force de remonter dans le passé, ne recule pas même devant ces mystérieuses ténèbres : moment fatal, arrivé pour Rome longtemps avant que l'érudition des trois derniers siècles entreprît d'arracher le figuier ruminal et de renverser l'autel d'Aïus Locutius. On l'avait fait avant elle ; qui osera lui décerner le trophée de cette victoire ? C'est comme si l'on félicitait Mézeray de n'avoir pas donné Francus, fils d'Hector, pour fondateur au royaume de France, ou le bon Pasquier, de n'avoir jamais voulu croire sans quelque restriction à la sainte Ampoule, ni à l'étendard divin de l'Oriflamme. Il est, dit-il[48], bienséant à tout bon citoyen d'admettre telles choses pour la majesté de l'Empire. C'est ainsi qu'on raisonnait à Rome au temps de César, et même avant lui. César, grand pontife, faisait rédiger des livres auguraux, des prières à Quirinus : sait-ou s'il croyait seulement à Jupiter ? Ces antiques récits que l'on admet pour la majesté de l'Empire sortent d'abord du sanctuaire. Tous les grands peuples ont commencé de même : leurs prêtres ont été leurs premiers historiens. Après l'évêque de Tours Grégoire, le père de notre histoire nationale, nous voyons se succéder à travers les figes, et surtout depuis le neuvième siècle sens interruption, les chroniques des églises, écrites dans les chapitres des cathédrales, et les chroniques des monastères, comme les Annales de Saint-Bertin, mais principalement les chroniques de Saint-Denys, ou grandes Chroniques de France, qui sont en quelque sorte nos grandes Annales ; qui ont aussi leurs traditions merveilleuses, leurs pieuses fables ; qui font aussi remonter la généalogie des rois jusqu'à la famille de Priam, et que nos anciens conteurs en vers et en prose, au treizième et au quatorzième siècle, regardaient comme la plus pure source de l'histoire On sait toutefois combien ces Chroniques sacrées, souvent fort incomplètes, souvent aussi dictées par d'étroits intérêts d'ordre ou de parti, ont besoin d'être contrôlées et par d'autres monuments et par une critique attentive. S'il y a des lacunes et des incertitudes dans les cinq premiers siècles de l'histoire de Rome, n'en trouve-t-on pas dans les cinq premiers Siècles de la nôtre ? Tous les historiens sont venus tard ; l'éducation des peuples est difficile et lente. Celle des Romains dut être longtemps arrêtée par l'ardeur guerrière qui leur fit mépriser les arts de la paix, par les catastrophes de tout genre qui les obligèrent à recommencer plusieurs fois leur fortune, par la politique défiante de l'oligarchie patricienne, amie du silence, et qui ne cessa de l'imposer au génie romain que lorsqu'il fallut combattre Pyrrhus et Carthage. L'homme qui fut le premier chez eux un orateur digne d'être cité[49], qui écrivit le premier sur l'agriculture[50], qui fut aussi le premier un véritable historien, ou qui avait pu voir du moins Fabius Pictor et Cincius, les premiers annalistes réguliers, Caton l'ancien, mourut l'an 605 de Rome, cinquante ans seulement avant la naissance de César : Tant nous sommes encore voisins, dit Pline, du commencement de toutes choses ![51] Mais en Grèce même, Hérodote ne parut que plus de six cents ans après la fondation d'Athènes ; et rien ne nous engage à croire que les autres peuples anciens, malgré les prétentions de quelques-uns, aient eu beaucoup plus tôt des historiens dignes de ce nom. Chez les nations de l'Europe moderne, quoique le souvenir puissant des deux antiquités, de Rome surtout, qui avait porté au loin sa littérature avec ses armes, ait laissé moins d'intervalle entre l'établissement des nouvelles sociétés et leurs historiens, cependant Grégoire de Tours est postérieur de près de deux siècles aux premières conquêtes des Francs dans les Gaules ; Isidore de Séville, de deux siècles aussi à l'invasion des Visigoths en Espagne ; le vénérable Bède, de près de trois siècles aux Saxons conquérants de l'Angleterre. Il est juste de ne voir en cela qu'un motif de comparer les grandes Annales de Rome à nos grandes Chroniques, et non pas un prétexte pour dédaigner les unes et les autres. Le dédain nous est en quelque sorte interdit par le respect des deux peuples pour cet héritage de leurs aïeux. Les registres de l'abbaye de Saint-Denys, rédigés par un moine chroniqueur d'office, furent longtemps comme les archives historiques de la nation, écrites au nom de l'État, véritables Annales publiques[52] ; et lorsque Philippe-Auguste ordonna qu'on y fit entrer les récits de son historiographe Rigord, qui en effet y sont traduits, le roi voulut, dit Rigord lui-même dans sa préface, qu'ils fussent joints aux monuments publics, ut in publica venirent monumenta. Scipion dit aussi, dans les nouveaux textes de Cicéron, en donnant au même mot le même sens, lorsqu'il parle des lois de Numa : Quas in monumentis habemus[53]. Dans les contestations et les procès, on s'en tenait à l'autorité des grandes Chroniques, comme à Rome on consultait les grandes Annales. Ces Chroniques étaient alors l'histoire par excellence, la véritable, la seule histoire ; et M. de la Curne, dans nos Mémoires, citant un passage où le moine de Saint-Denys raconte que Charles VI, indigné contre le patriarche d'Alexandrie, ordonna que les perfidies qu'il lui reprochait fussent notées dans les Annales, croit qu'il faut entendre par là les Chroniques de Saint-Denys[54]. Ainsi j'ai cru reconnaître que plus d'une fois, lorsque Varron, Pline, Tite7Live, indiquent les anciennes Annales, ou simplement les Annales, ils veulent parler de celles des pontifes. Les Annales de Rome et nos Chroniques de France ont atteint leur but : elles sont également parvenues, à force d'environner de merveilles l'enfance d'un grand peuple, à rendre sa maturité féconde en merveilles nouvelles, et à faire de quelques traditions douteuses, de quelques fables même, comme l'image anticipée, comme l'oracle de deux brillantes destinées, dé deux gloires immortelles, Rome et la France ; car c'est ici surtout, c'est dans l'histoire que, par une secrète sympathie, les illusions de l'idéal et du fantastique s'accordent avec les vertus d'un peuple les plus natives et les plus vraies, et les caprices de la fiction avec les grandeurs de la réalité. Une nation faible et réservée à une vie passagère ne se serait jamais créé de tels aïeux. Lorsque les pontifes mêlaient, dans leurs généalogies comme dans leurs récits de combats, les dieux et les héros, c'est qu'il leur était facile, accoutumés qu'ils étaient à tant de gloire, de confondre Romulus et Mars, et que cette foi dans une parenté divine ne devait pas être perdue pour l'enthousiasme d'un peuple conquérant. Lorsque Grégoire de Tours disait, dans la préface de son second livre, qu'il se proposait de raconter et les vertus des saints et les désastres des peuples[55] ; lorsqu'il transcrivait avec le même zèle les fastes des palais et ceux des temples, les exploits des ambitieux et ceux des martyrs, les guerres et les miracles, c'est qu'il lui semblait déjà, dans le chaos où se reformaient sous ses yeux les Gaules romaines, que de ce mélange de vertus martiales, de splendeurs pacifiques et pures, se composerait un jour le caractère de sa nation. On le voit, les analogies sont quelquefois frappantes dans
la carrière des sociétés. Notre savant Confrère, M. Guizot, dans son jugement
sur Grégoire de Tours[56], parle ainsi de
ces temps où les chefs spirituels d'un peuple écrivaient seuls son histoire :
Du cinquième au douzième siècle, le clergé presque
seul a écrit l'histoire. C'est que seul il savait écrire, a-t-on dit. Il y en
a encore une autre raison, et plus puissante peut-être. L'idée même de
l'histoire ne subsistait à cette époque que dans l'esprit des ecclésiastiques
; eux seuls s'inquiétaient du passé et de l'avenir. Pour les barbares brutaux
et ignorants, pour l'ancienne population désolée et avilie, le présent était
tout ; de grossiers plaisirs ou d'affreuses misères absorbaient le temps et
les pensées : comment ces hommes auraient-ils songé à recueillir les
souvenirs de leurs ancêtres, à transmettre les leurs à leurs descendants ?
Leur vue ne se portait point au delà de leur existence personnelle ; ils
vivaient concentrés dans la passion, l'intérêt, la souffrance ou le péril du
moment. La civilisation romaine n'avait pas disparu tout entière : il
restait, dans les cités, des laïques naguère riches, puissants, lettrés,
d'illustres sénateurs, comme les appelle l'historien. Mais, à l'aspect de
leur pays ravagé, de leurs monuments détruits, de leurs propriétés enlevées,
au milieu de cette instabilité violente et de cette dévastation sauvage, tout
sentiment un peu élevé, toute idée un peu étendue s'évanouit ; tout intérêt
pour le passé ou l'avenir cessa : ceux qui étaient vieux et usés crurent à la
fin du monde ; ceux qui étaient jeunes et actifs prirent parti, les uns dans
l'Église, les autres parmi les barbares eux-mêmes. Le clergé seul, confiant
dans ses croyances, et investi de quelque force, continua de mettre un grand
prix à ses souvenirs, à ses espérances ; et comme seul il avait des pensées
qui ne se renfermaient pas dans le présent, seul il prit plaisir à raconter à
d'autres générations ce qui se passait sous ses yeux. A ces graves réflexions oserai-je ajouter que les grands pontifes de Rome profane, en conservant par l'écriture les traditions d'un peuple qui ne savait encore que vaincre, et conquérir, eurent surtout l'intention de donner à leur culte, c'est-à-dire à leur puissance, l'autorité de l'histoire et la sanction du passé, tandis que ceux de la Gaule chrétienne voulurent surtout, en se faisant les annalistes de leur nation, créer un avenir pour les barbares qu'ils civilisaient, et qu'ils forcèrent d'y travailler eux-mêmes par toutes les vertus nouvelles que la religion pouvait leur donner ? Les Annales du pontificat romain, qui n'était qu'une magistrature patricienne de plus, devaient avoir pour étude d'enchaîner les esprits par un frein nouveau, celui des usages, des exemples de l'antiquité, more majorum, exemplo parentum, mots qui tous se rapportent au passé ; tandis que les Chroniques des humbles religieux, souvent sortis des rangs du peuple, jettent à travers leurs récits d'intrigues et de batailles les mots de conversion, (le pénitence, de dépouillement du vieil homme, d'abomination des mœurs anciennes, mots qui tous expriment l'innovation, le progrès, l'avenir. C'est en avoir assez dit sur ce parallèle, nécessaire peut-être pour relever la question des grandes Annales, mais qui, si nous le poursuivions, nous conduirait à des considérations d'un autre ordre ; il vaut mieux résumer, en finissant, les principaux points de ce mémoire : I. Les Annales des pontifes étaient des espèces de tables chronologiques tracées d'abord sur des planches de bois peintes en blanc, et où le grand pontife, peut-être depuis le premier siècle de Rome, mais au moins depuis l'an 35o jusqu'à l'an 623, ou peu de temps après, indiquait année par année, d'un style bref et simple, les événements publics les plus mémorables. II. Ces tables, soit qu'on les eût laissées sur bois, soit qu'on les eût transportées sur pierre ou sur bronze, ne périrent pas toutes dans l'invasion des Gaulois ; et, conservées avec le soin que Rome donna toujours aux anciens monuments écrits, elles furent consultées, pour des temps antérieurs, par Caton, Polybe, Varron, Cicéron, Verrius Flaccus, et par d'autres écrivains, que Denys d'Halicarnasse, Tite-Live, Quintilien, le premier Pline, Aulu-Gelle, Vopiscus, ont eus entre les mains. Il est probable même, d'après Aulu-Gelle et Servius, qu'elles furent recueillies en corps d'ouvrage, quoiqu'il ne faille pas les confondre avec beaucoup d'autres recueils qui portaient le nom des pontifes. Convenir qu'elles ont pu être diminuées par le temps, interpolées, divisées en livres, rajeunies pour le style, comme les vieux textes l'ont été souvent, ce n'est pas en détruire entièrement l'existence, comme plusieurs critiques l'ont essayé. III. Quant à l'autorité de ces Annales, les fables religieuses ou politiques qu'elles devaient contenir, si l'on en juge par les traces qui en restent, n'ont rien de plus merveilleux que tant d'autres fables dans les anciennes chroniques de tous les peuples. |