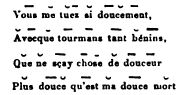HISTOIRE DE FRANCE
TOME CINQUIÈME — LA LUTTE CONTRE LA MAISON D'AUTRICHE (1519-1559).
LIVRE XI. — LES HOMMES ET LES ŒUVRES.
CHAPITRE II. — LES BEAUX-ARTS.
|
I. — GÉNÉRALITÉS SUR L'ARCHITECTURE, LA SCULPTURE ET LA PEINTURE. NOUS avons suivi la marche progressive de la Renaissance artistique[1], parallèle à celle de la Renaissance littéraire, et constaté que le classicisme se constituait dans les arts à la même époque et de la même façon que dans la littérature. Il nous reste à examiner sommairement la production artistique à partir du règne d'Henri II. Nous devrons nous borner à en indiquer les traits caractéristiques. Dans la seconde partie du XVIe siècle, la pratique de l'apprentissage disparaît de plus en plus, puisque beaucoup d'artistes échappent au régime des corporations ; d'autre part, il n'y a pas encore d'écoles d'enseignement : il en résulte que la direction artistique vient du Livre, — y compris l'estampe — qui est le maitre par excellence des hommes de ce temps. On a vu combien s'étaient multipliées les traductions d'auteurs anciens ou italiens, Vitruve, Alberti, Serlio, vulgarisant les doctrines qui allaient devenir classiques. Mais l'homme qui représenta le mieux cette pédagogie par le livre fut certainement Jacques Androuet du Cerceau, dessinateur, graveur et architecte, né avant 1511, mort après 1584. Dans un séjour qu'il fit en Italie et surtout à Rome, entre 1530 et 1540, il avait pris des dessins des édifices antiques ou contemporains, il avait connu les nombreux recueils d'architecture qui paraissaient alors dans la Péninsule. C'est tout cela qu'il reproduisit et imita ou dont il s'inspira pour créer de nouvelles formes. Avec l'année 1545 commence son œuvre énorme et dispersé, dont les principaux recueils sont : Quinque et viginti exempla arcuum (vingt-cinq modèles d'arcs de triomphe) ; Les Grotesques et les Petites Arabesques ; le Livre d'architecture de Jacques Androuet du Cerceau contenant les plans et desseings de cinquante bastiments tous différents, pour instruire ceux qui désirent bastir ; Le second livre d'architecture de Jacques Androuet du Cerceau, contenant plusieurs et diverses ordonnances de cheminées, lucarnes, portes[2]. On y voyait l'Arc de Titus, celui d'Auguste à Suse, le Colisée, le Panthéon, le Temple de la Paix, des portiques, des colonnes, des églises et des palais d'Italie ; des faunes, des satyres, des divinités mythologiques, et tout le fonds inépuisable de la décoration italo-antique. On y voyait aussi des plans et des dessins tout composés pour maisons, châteaux, palais.... pour seigneurs, gentilshommes et autres qui voudront bâtir aux champs. C'était un vade-mecum très portatif et commode, qui fournissait des formes toutes prêtes, au moins autant aux artistes qu'à leurs clients. Si l'on joint aux planches de du Cerceau celles de Serlio et celles que publia à Rome par centaines l'Italien Lafreri[3], véritable directeur d'un atelier de gravure artistique, on aura l'idée des modèles qui inspirèrent une grande partie des architectes, des ornemanistes, des émailleurs, des tapissiers : tout l'art décoratif depuis Henri II jusqu'à Henri IV. Les traités de Jean Bullant et de Philibert de l'Orme, qui parurent seulement en 1564 et 1567, s'adressaient plus spécialement aux architectes, et ils préparèrent surtout l'art d'Henri III et même d'Henri IV. Étant donné que tous les ouvrages de pédagogie artistique excluaient absolument tout le style du moyen âge, il n'est pas étonnant qu'on n'ait plus construit de monuments gothiques et que l'architecture française soit devenue exclusivement classique, sur le mode romain ou quelquefois italien, — car on continuait à ignorer la Grèce. Les éléments de toute construction furent : la colonne ou le pilastre, suivant les ordres ionique, corinthien, toscan, composite ; l'entablement, les métopes, les triglyphes, les frontons ; la voûte ornée de caissons ; les oves, la grecque, les bucranes. La différence avec la première moitié du siècle consista surtout dans le souci des artistes de copier très exactement les modèles antiques. Philibert de l'Orme et Jean Bullant s'appliquèrent, avec un soin poussé jusqu'à la minutie. à reproduire les moindres détails de la feuille d'acanthe, à retrouver la courbe si compliquée de la volute ionique. En outre, les artistes de la nouvelle école observèrent très rigoureusement les proportions établies par les anciens. Il y a sur ce point un passage bien significatif chez Philibert de l'Orme : J'ay veu plusieurs fois qu'aucuns qui veulent faire profession d'architecture se sont abusez grandement, quand ils ont voulu mettre en œuvre les ordres des colonnes, en enssuivant celles mesurées à Rome ou ailleurs, pour autant que leurs œuvres estoient beaucoup plus petites. Nul architecte ne peut faire une belle œuvre en prenant ses mesures proportionnéement à celles des anciens, s'il n'accommode la dite œuvre à la même grandeur, largeur, mesure, ordres. Observation capitale, et qui suffit presque à distinguer la seconde Renaissance de la première, où l'on croyait qu'il suffisait de copier des dessins de chapiteaux ou d'employer la colonne romaine, pour être classique[4]. Mais les architectes s'inspirèrent aussi de l'art italien. Les œuvres de Michel-Ange, surtout Saint-Pierre de Rome, furent très étudiées. ainsi que nous l'avons dit, et le Louvre n'est pas sans quelque analogie avec certains palais de Rome. Il est certain que le principe fondamental de la composition de la façade française classique : baies à plein cintre ou à fronton triangulaire, encadrées chacune entre deux colonnes ou deux pilastres, se retrouve non seulement dans la plupart des monuments italiens, mais dans toutes les figures schématiques des traités qui passèrent en France. A vrai dire, c'est un thème d'architecture romaine que les Italiens avaient emprunté surtout au Colisée. Ce qui sauva les Français de l'imitation par trop servile, c'est qu'ils prirent encore plus pour guides les monuments anciens que les modernes. Or, ces monuments n'étant qu'à l'état de ruines et ayant été construits pour des besoins très différents de ceux du XVIe siècle, il fallait bien les adapter, et par là faire œuvre d'invention. Il fallait aussi employer les toits, les corps de cheminées, absolument nécessaires dans les pays du Nord. L'architecture de la seconde moitié du siècle est donc originale, avec des éléments qui ne le sont pas. Cette architecture s'appliqua fort peu à des édifices religieux. On se borna à continuer quelques églises et à introduire dans leur décoration les pilastres, les colonnes, les entablements, les décorations à l'antique, à reprendre quelquefois les voûtes et les piliers pour les accommoder à la forme nouvelle, à ajouter des portails, des tours en style classique. Au contraire, pendant vingt-cinq ans au moins, à partir de l'avènement d'Henri II, les châteaux, les hôtels de ville, les maisons particulières, déjà si nombreux au temps de François Ier, se multiplièrent encore. Le livre des Plus excellents bastiments de France montre l'essor de cette architecture laïque et l'ampleur, quelquefois exubérante, de ses conceptions. Comme l'architecture, la sculpture devint de plus en plus classique, et les statues antiques furent des modèles très étudiés de nos artistes. Les célèbres moulages rapportés de Rome par Primatice en 1541 mettaient à leur disposition des œuvres très admirées, que presque tous connurent. Palissy écrit : Vois-tu pas aussi combien la moulerie a fait de dommage à plusieurs sculpteurs savans ?... J'ay veu un tel mespris en la sculpture, à cause de ladite moulerie, que tout le pays de la Gascongne et autres lieux circonvoisins estoyent tous pleins de figures moulées de terre cuite, lesquelles on portoit vendre par les foyres et marchez, et les donnoit-on pour deux liards chascune. Mais, à la différence des architectes, les statuaires imitèrent plus les Italiens que les anciens ; Michel-Ange, Cellini, même les peintres Parmesan et Primatice furent les maîtres entre qui ils se partagèrent. Leurs œuvres furent essentiellement profanes, soit dans les sujets, toujours mythologiques ou allégoriques, soit dans l'expression, soit dans la recherche d'une beauté païenne et plastique. Et pourtant les rois, les princes, les riches particuliers leur commandaient surtout des monuments funéraires : tombeaux de François Ier, d'Henri II, du chancelier de Birague, de Saint-Mégrin : plus encore que sous François Ier, ce devint une véritable mode. Mais rien dans ces sépulcres ne fut chrétien ; on n'y vit que symboles classiques, divinités de la Fable. Les arts du dessin, peinture, gravure, et les arts somptuaires s'inspirèrent des mêmes modèles et se conformèrent aussi au goût du jour. Tout au plus quelques peintres et graveurs retrouvèrent-ils dans le portrait et dans la représentation des scènes contemporaines la veine de réalisme, que le flot du classicisme italo-antique menaçait de submerger ; mais, dans l'émaillerie, dans le meuble, dans la tapisserie, la mythologie et les formes de la décoration à la mode s'étalèrent sans mesure. II. — PRIMATICE ET LES DERNIERS ITALIENS[5]. PRIMATICE resta sous Henri II le grand maitre de la peinture, seulement, le groupe d'artistes italiens dont Fontainebleau avait été le centre commença à se désagréger ; Bagnacavallo, Luca Penni, l'architecte Serlio quittèrent la cour entre 1546 et 1550. Les peintres Salviati et Bordone, l'architecte Prospero Fontana ne firent que passer en France. Seul le peintre Niccolo dell' Abbate, qui arriva à Fontainebleau à la fin de 1551, devait y rester et être le collaborateur le plus remarquable de Primatice. Primatice continua la Galerie d'Ulysse et fut chargé, entre 1551 et 1536, de décorer la vaste salle de bal, dite aujourd'hui Galerie d'Henri II. Il y peignit une fois de plus les mêmes grands sujets et à peu près les mêmes figures mythologiques : Cérès, Bacchus, Ariane, Apollon et les Muses, Vénus et Vulcain, des banquets ou des concerts divins. Ce fut le triomphe de l'art italo-classique. Il fut aussi très en faveur auprès des Guise : le cardinal de Lorraine l'employa aux travaux de son château de Meudon. Antoinette de Bourbon, veuve de Claude de Guise, lui commanda en 1550 le tombeau de son mari, qu'elle faisait élever de concert avec ses fils[6]. Le monument, qui était adossé au mur de l'église, se composait de deux parties distinctes : le sépulcre et le décor architectural qui l'entourait. Le sépulcre consistait en un sarcophage orné de bas-reliefs et recouvert d'une dalle portant les deux gisants nus (Claude et Antoinette). Par trois côtés, il était entouré des murs de l'église. En avant, quatre cariatides, représentant les vertus cardinales, supportaient un portique, partagé en trois arcatures qui laissaient voir le sépulcre, et une plate-forme, sur laquelle le duc et la duchesse étaient figurés à genoux[7]. Pour la sculpture, Primatice s'adressa à un Italien, Dominique Florentin (Domenico del Barbiere), établi à Troyes depuis 1540 environ, et dont la vie et l'œuvre peuvent servir à montrer comment l'italianisme se répandit dans les provinces en même temps qu'à la Cour. Florentin était à la fois sculpteur, dessinateur, graveur : il reçut de la municipalité et du clergé troyen un grand nombre de commandes, et les artistes de la région cherchèrent peu à peu à imiter son style, qui était à la mode. Pourtant, Primatice, en même temps qu'il prenait Florentin pour collaborateur, prit aussi un Français, Picard, dit Le Roux. Ainsi se maintenait cette espèce d'équilibre entre les ultramontains et les nationaux. La mort d'Henri II, qui bouleversa tant de situations, mit Primatice au premier rang, grâce aux Guise devenus tout-puissants. Il remplaça dans la charge de surintendant des bâtiments royaux Philibert de l'Orme disgracié ; Catherine de Médicis lui confia, en 1550, la conduite de ses bâtiments à elle. De la sorte, l'art français fut pendant quelques années sous la suprématie de Primatice, puisque le surintendant était chargé de tout ce qui regardait la construction et la décoration des édifices. Cependant Pierre Lescot garda la direction exclusive des travaux du Louvre ; en 1564, Catherine elle-même, voulant faire construire un palais aux Tuileries, s'adressa à Philibert de l'Orme et à Jean Bullant et, depuis cette date jusqu'à sa mort en 1510, Primatice apparaît de moins en moins. Il ne faut donc ni exagérer, ni amoindrir son importance. On sait assez peu ce qu'il a fait au juste sous les règnes de François II et de Charles IX. Mais, comme il avait le choix des architectes, des statuaires ou des décorateurs, il pouvait exercer une certaine influence sur l'art ; en outre, il indiquait évidemment aux artistes qu'il employait les sujets à traiter, révisait leurs projets, très souvent leur fournissait des dessins. On voit, par exemple, que Germain Pilon a fait un Mars, un Mercure, une Junon et une Vénus de l'ordonnance (c'est-à-dire de la composition) de Primatice. Il donna le plan et le dessin de la chapelle, que Catherine entreprit de faire élever à Saint-Denis ; le projet du tombeau d'Henri II parait bien avoir été de lui. Mais, lorsqu'il fut mort, les Italiens disparurent avec lui. Della Robbia était mort en 1566, Dominique Florentin et Laurent Regnauldin, peu après sans doute. C'était d'ailleurs le moment où commençait la réaction contre les ultramontains, de sorte que fort peu se décidèrent à venir chercher fortune en France. Dès lors, on ne voit plus que des Français pourvus des grandes charges artistiques ou appelés à exécuter les grandes commandes. Même depuis les débuts du règne d'Henri II, la production artistique de Primatice et des quelques compatriotes restés auprès de lui ne saurait se comparer à celle de Pierre Lescot, de Philibert de l'Orme dans l'architecture, de Jean Goujon, de Pierre Bontemps, de Germain Pilon dans la statuaire, des Pénicaud, des Limosin, des Pinaigrier, de Palissy dans les arts somptuaires. Il reste uniquement à se demander jusqu'à quel point ce fut Primatice ou l'antiquité qui leur servit de modèle et de guide, et aussi quelle fut la part de leur génie personnel. III. — LES PURS CLASSIQUES : LESCOT, GOUJON[8]. C'EST 1546 seulement, le 2 août, que François Ier se décida à transformer complètement le Louvre de Charles V[9] et commit Pierre Lescot à la direction des travaux. Nous avons délibéré, disait-il, de faire bastir et construire en notre chasteau du Louvre... un grand corps d'hostel, ou lieu où est de présent la grande salle (la salle des gardes de Charles V), dont nous avons fait faire les dessins et ordonnances par vous (Lescot), auquel nous avons advisé d'en bailler la totale charge, conduicte et superintendance.... Pierre Lescot (né vers 1510) était fils de Lescot, procureur du Roi à la Cour des aides et prévôt des marchands de la Ville de Paris. Il avait pour mère Anne Dauvet, fille de Guillaume Dauvet, second président de la Cour des aides. Sa famille possédait la seigneurie de Lissy et celle de Clagny, dont il prit officiellement le titre. Il exerça les fonctions de conseiller et aumônier ordinaire du Roi, obtint l'abbaye de Clermont au diocèse de Laval et fut chanoine de Notre-Dame de Paris. Il avait dû recevoir l'éducation très complète qu'on donnait aux jeunes gens de la noblesse de robe, et il appartenait à la génération formée déjà par la pédagogie nouvelle. Ronsard indique qu'il fut entraîné vers les arts par une vocation marquée : Car bien que tu sois noble et de mœurs et de race, Bien que dès le berceau l'abondance te face, Sans en chercher ailleurs, riche en bien temporel, Si as-tu franchement suivi ton naturel. Henri II confirma Lescot dans sa charge et fit continuer l'ouvrage, selon les desseins et devis qui avaient été présentés, sauf une légère modification en 1549 (probablement le déplacement de l'escalier). Lescot garda ses fonctions d'architecte en chef du Louvre, jusqu'à sa mort en 1578, malgré les révolutions de palais, les troubles et les guerres, et sa charge, déclarée à plusieurs reprises indépendante de la surintendance des bâtiments royaux, forma une administration tout à fait à part. Il avait ainsi sous sa direction tout un nombreux personnel de sculpteurs, d'entrepreneurs, d'ouvriers. Cette situation exceptionnelle peut s'expliquer par l'importance que les rois attachèrent à la construction du Louvre et par le talent reconnu de Lescot. Mais, sans doute, elle était due aussi à la haute position de sa famille, à sa fortune personnelle, à ses alliances, à ses amitiés. Il réunissait autour de lui une sorte de cénacle artistique et littéraire ; Ronsard ne cesse pas de le louer hyperboliquement : Toi, Lescot, dont le nom jusques aux astres vole... La construction du Louvre, poussée activement jusque vers 1568, se ralentit entre 1568 et 1578, puis reprit en 1580-1581. A ce moment Baptiste Androuet du Cerceau avait succédé à Lescot. Au règne d'Henri II appartiennent la moitié de l'aile occidentale du Louvre d'aujourd'hui (c'est-à-dire le corps de logis au sud du Pavillon de l'Horloge élevé sous Louis XIII) et un avant-corps de l'aile méridionale en équerre (corps de logis entre l'aile occidentale et le Guichet dit du Pont des Arts, dont le pavillon fut élevé sous Louis XIV) ; au temps de Charles IX, le reste de cette aile (achevée peut-être seulement sous Henri IV). Sous Charles IX aussi, on avait commencé la Petite Galerie[10], qui prolongeait jusqu'à la Seine, mais en faisant retraite, l'aile occidentale du Louvre, à laquelle elle était rattachée par un passage fermé. Mais ici, la construction parait bien avoir été confiée à l'architecte Pierre Chambiges II, et elle est d'un style très particulier. Pierre Lescot donna presque tous les travaux de sculpture à Jean Goujon, qui eut pour collaborateurs ou successeurs les frères Lheureux, Cramoy, et le très énigmatique Ponzio (Paul Ponce). On n'a sur la vie de Jean Goujon que peu de données et il ne reste de lui que quelques œuvres authentiques[11]. Il était probablement Normand d'origine et il a chi naître au plus tard vers 4515, car, en 1540 et 1541, il se trouvait à Rouen et y était chargé de travaux importants par les fabriques de la cathédrale et de l'église Saint-Maclou (les portes de cette dernière église). Il vint à Paris vers 1543 et exécuta les sculptures du jubé de Saint-Germain-l'Auxerrois, sous la direction de Pierre Lescot. Puis, de 1548 à 1550, seul ou avec Lescot, il édifia et décora la Fontaine dite des Innocents, toute entaillée à l'anticque. En 1550, il commença les sculptures du Louvre. Il était déjà en grande réputation ; Ronsard parlait de lui dans une de ses Épures. Dans un Épitomé de Vitruve, publié à Toulouse en 1556, on le qualifiait de sculpteur et architecte de grand bruit. Et cependant on trouve dans un document authentique qu'il fut arrêté et emprisonné à Étampes, en 1555[12]. Était-ce en qualité de protestant, comme il arriva à tant de suspects au temps d'Henri II ? Les termes de l'arrêt ne permettent guère de le croire[13]. Il faut voir là sans doute un trait à ajouter, soit aux vices de la procédure, dont il est si souvent question chez les écrivains, soit aux mœurs d'un temps, où Étienne Dolet, Marot furent arrêtés pour des délits de droit commun. Goujon fut d'ailleurs relâché et reprit ses travaux au Louvre. Puis, à partir de 1562, on ne voit plus qu'il soit fait mention de lui, alors cependant que les travaux du Louvre se continuaient et que son ami Lescot en demeurait chargé. Sa trace a été découverte en Italie, à propos d'un procès d'hérésie intenté par le :siège inquisiteur de Modène, et où il était témoin. Il dut mourir entre 1564 et 1568. Pourquoi avait-il quitté la France ? La situation des réformés y devenait plus difficile ; pourtant plus d'un artiste ou d'un écrivain coreligionnaire de Goujon y resta par une sorte de grâce d'état. Goujon avait-il donc manifesté plus ouvertement et activement sa foi ? Voulait-il tout simplement visiter l'Italie, qu'il ne connaissait pas et qui attirait tous les hommes de la Renaissance ? En tout cas, il faut supprimer de sa biographie la légende de sa mort pendant le massacre de la Saint-Barthélemy. Mais n'y a-t-il pas quelque chose d'extraordinaire à voir un pareil artiste, si célèbre déjà de son temps, mourir aussi obscurément ? Goujon avait des connaissances en architecture, car dans la traduction de Vitruve, où il fut le collaborateur de Jean Martin, il commente et discute des passages de son auteur, les éclaire à l'aide d'illustrations, se montre informé sur les ordres, sur les proportions et les chapiteaux. Mais c'est dans ses œuvres de sculpture qu'éclate sa personnalité ; on s'est efforcé d'en multiplier le nombre par des attributions souvent hasardées ; il suffit, pour comprendre son génie et marquer sa place dans la Renaissance, d'examiner quelques-unes de celles qui sont incontestablement de lui ; les fragments du jubé de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui représentent une Déposition et les Évangélistes, la Diane du Château d'Anet, les Nymphes de la Fontaine des Innocents, la décoration du palais du Louvre. Au rez-de-chaussée de la façade, il sculpta en bas-relief des figures allégoriques : la Gloire, la Renommée, la Victoire ; à l'attique, d'autres figures allégoriques[14] ; dans le grand escalier, il décora la voûte de caissons, très ornementés à la façon classique et encadrant des Faunes et Faunesses, des Satyres ; dans la grande salle du rez-de-chaussée, il sculpta les Cariatides de la Tribune. Goujon est peut-être l'artiste du XVIe siècle le plus familier avec l'antiquité. A-t-il à décorer la Fontaine des Innocents, il y place des Nymphes des Eaux, celles que chantaient les poètes de la Pléiade, des Tritons, des Dauphins, des Amours. Au château d'Anet, il élève sur une fontaine la Diane mythologique. Au Louvre, l'idée de ses Cariatides est directement prise de Vitruve, qui a tout un chapitre sur ce motif architectural, et l'on a noté souvent leur extraordinaire ressemblance de style avec celles de l'Érechtéion d'Athènes, alors ignoré. Mais il eut aussi d'autres modèles évidents : les Italiens Primatice et Parmesan. Il fut original par un sentiment très personnel de la grâce féminine, par la délicatesse peut-être un peu maniérée de son style, par l'élégance presque aristocratique de ses figures et par un naturalisme assez vibrant, car il n'y a rien de plus vivant, de plus souple que quelques-uns de ses corps de femmes. Il a créé des types et un style. En somme, un génie admirable dans des limites assez resserrées, et un génie qui est bien de son temps, car son art est en accord parfait avec celui de la Pléiade. On le comparerait volontiers à Ronsard ou à du Bellay, dans leurs Odes ou leurs Élégies les plus exquises, mais il n'a pas la même envergure que ces deux poètes, surtout que Ronsard : il n'a exprimé que les parties féminines et délicates de leur inspiration. Le Louvre est bien l'expression la plus parfaite de cet idéal d'humanistes classiques. Tel que le conçut Lescot, c'était un édifice de proportions restreintes[15]. Il se composait d'une cour carrée, sur laquelle devaient s'élever trois corps de bâtiments identiques, le quatrième côté fermé sans doute par une galerie à hauteur de rez-de-chaussée. Chaque corps de bâtiment comprenait deux étages surmontés d'un attique, surmonté lui-même d'un toit couronné de hautes cheminées de pierre. Les façades extérieures, très simples, donnaient sur un fossé et présentaient des toits nettement aigus. Ainsi le Louvre reproduisait dans son plan et dans son élévation l'aspect des châteaux encore construits à la mode française. Avec la décoration commençaient les nouveautés : au rez-de-chaussée de la façade, des colonnes corinthiennes engagées, formant des travées symétriques occupées par des arcades en plein cintre à la mode antique. Au premier, c'est la répétition des mêmes dispositions, avec des fenêtres carrées à frontons. A l'attique, assez bas à la façon italienne, d'autres frontons arrondis. Nulle part n'apparaît autant le souci des proportions établies d'après les règles des anciens, de la pureté des profils dans les chapiteaux ou les moulures, la recherche de l'harmonie. Non seulement la sculpture n'empiète jamais sur l'architecture, non seulement elle s'inspire comme elle de l'antiquité, mais elle est d'accord par la simplification de ses lignes avec les lignes architecturales ; elle est vraiment ainsi une statuaire monumentale. Dans l'apparente unité de la Renaissance française, l'École de Lescot et de Goujon s'opposerait ainsi à celle de de l'Orme et de Germain Pilon. IV. — LES DEMI-CLASSIQUES : DE L'ORME, BULLANT, PILON. PHILIBERT de l'Orme[16] naquit vers 1515, à Lyon. Il était fils d'un maitre d'œuvre. De 1533 à 1536, il séjourna à Rome, où il fit des relevés de monuments antiques, puis il revint à Lyon et enfin se rendit à Paris, entre 1540 et 1544. C'était le moment où Jean Goujon y arrivait de Rouen, la centralisation artistique tendait à se faire partout. Protégé par le cardinal du Bellay, de l'Orme commença pour lui le château de Saint-Maur (près de Paris). En 1548 déjà, il était cité comme un des architectes en renom, avec Pierre Lescot, et il élevait le château d'Anet pour Diane de Poitiers. Il était en même temps maistre-architecteur et constructeur des bastiments et édifices, ouvraiges et fortifications du Roi, au pays et duché de Bretagne, et il fut nommé, le 3 avril 1548, commissaire député sur le fait des bastiments royaux, conseiller et architecteur du Roy, inspecteur des bastiments royaux de Fontainebleau, Saint-Germain, directeur de la manufacture de tapisseries de Fontainebleau, conseiller et aumônier du Roi. Il reçut successivement ou concurremment les abbayes de Saint-Barthélemy, près Noyon, d'Ivry, près Évreux ; il est très souvent cité sous le nom d'abbé d'Ivry. Enfin il fut nommé, en 1556, Maître des comptes. Henri II lui avait confié la construction du tombeau de son père. Cette faveur extraordinaire avait suscité contre lui bien des inimitiés, à une époque ou tout était occasion de convoitises, de querelles, de luttes ardentes. Du reste, il était rude, passionné, agressif, plein de lui-même, très préoccupé de se pousser. La catastrophe de la mort d'Henri Il brisa un moment sa fortune, et toutes ses charges passèrent à Primatice. Mais il revint en faveur auprès de Catherine de Médicis, qui le chargea en 1564 de la construction des Tuileries, en collaboration avec Jean Bullant. Il mourut en 1570. C'est pendant sa disgrâce qu'il publia les Nouvelles Inventions et commença son Traité d'Architecture. Il s'est mis tout entier dans ces ouvrages, qui sont presque autant une autobiographie que des écrits didactiques[17] : trait commun à presque tant d'auteurs du xvi siècle, qui aiment à se raconter. Ainsi, au milieu de la description technique d'un système de charpente, il s'interrompra pour parler de ses ennuicts et traverses depuis le trespas du feu Roy Henry. Il introduira dans un chapitre sur les ordres antiques une anecdote de sa jeunesse : Estant à Rome, je mesurais les édifices et antiquitez. Advint un jour que, mesurant l'arc de Sainte-Marie Nove, comme plusieurs cardinaux et seigneurs se pourmenants visitoient les vestiges des antiquités et passoient par ce lieu où j'estois, le Cardinal de Sainte-Foix dit qu'il me vouloit congnoistre, pour au tant qu'il m'avoit veu et trouvé plusieurs fois mesurant divers édifices antiques, ainsi que je faisois ordinairement avec grands labeurs, frais et dépens, selon ma petite portée. Ailleurs, il rappellera qu'il a fait construire temples, chasteaux, palais et maisons, par vray art d'architecture, en divers lieux, tant pour Roys, Princes, Cardinaux, que pour autres. De l'Orme est à la fois un théoricien et un praticien, un érudit et un technicien, un adepte passionné des anciens et un esprit indépendant. Ainsi il attache le plus grand prix à la science de la construction ; il veut que l'architecte ait la connaissance de la technique ; il se félicite d'avoir construit, avec des coupes de pierre ingénieuses, un escalier en croissant à Anet et un escalier à vis à Fontainebleau, un autre, à double révolution, aux Tuileries. Il ne dédaigne pas le secours que l'architecture peut recevoir des mathématiques ou de la géométrie, et il n'ignore pas les lectures publiques faites sur Euclide au Collège de France par Ramus. L'importance qu'il attache à l'art de bâtir l'amène à
rendre justice, sur un point, aux architectes du moyen âge. Les maistres maçons de ce royaume et aussi d'austres pays
ont accoustumé de faire les voûtes des églises avec une croisée qu'ils
appellent la croisée d'ogives.... ces façons
de voûtes ont été trouvées fort belles et s'en voit de bien exécutées et
mises en œuvre n, et il déclare qu'il ne veut pas déprécier cette façon
appelée entre les ouvriers la mode française. Ayant à restaurer la
chapelle gothique de Vincennes, il y conserve la croisée d'ogives. Il s'élève
fréquemment contre les architectes qui ne sont que des dessinateurs : De sorte qu'il vaudroit trop mieux à l'architecte, selon
mon advis, faillir aux ornements des colonnes, aux mesures et fassades (où tous qui font profession de bastir
s'estudient le plus) qu'en les belles reigles
de nature qui concernent la commodité, l'usaige et profit des habitants. Il avait un tempérament d'inventeur et il s'en glorifiait. Il faut voir comme il insiste sur son nouveau système de charpente, où l'emploi de poutrelles de bois (au lieu des grosses poutres uniques), emboîtées les unes dans les autres et reliées par des chevilles, fait penser à nos constructions en fer boulonnées[18]. Dans toutes ces idées, on ne voit pas ce que de l'Orme doit à l'éducation de la Renaissance ou à son séjour à Rome. Mais les doctrines de l'humanisme sont chez lui très sensibles, par ailleurs. Il demande que l'architecte sache les mathématiques, un peu de sciences naturelles, d'histoire, de musique et acoustique, etc., traçant ainsi un de ces programmes encyclopédiques, tels que les aimait le XVIe siècle. Comme tant de ses contemporains, il se plan aux classifications. Il distingue le genre Palais, le genre Château, le genre Église (qu'il appelle Temple), chacun ayant ses règles propres. Il ramène presque toujours son art à une sorte de raisonnement philosophique : appelé à construire les Tuileries, il dissertera sur ce fait que le palais est destiné non pas à un particulier, mais à un souverain, non pas à un roi, mais à une reine. Puis, après s'être occupé presque exclusivement de la technique dans la première partie de l'Architecture, voici que, à la fin du cinquième livre, il écrit : Il me semble que cy après, il sera fort à propos de montrer comment il faut orner les murailles des temples, palais... doncques, nous commencerons à parler de l'ordre et parties des colonnes, desquelles les Anciens avoient coustume orner et. enrichir leurs bastiments, ainsi que les historiens en font mention. Et alors il analyse minutieusement les ordres gréco-romains et illustre sa description à l'aide des nombreuses figures rapportées de Rome ; il insiste sur les proportions. Il prend donc, lui aussi, l'antiquité pour guide, et il a pour elle cette vénération presque craintive que professaient les hommes de son temps. S'il ose imaginer une colonne française[19], il s'empresse de se couvrir des Latins, qui imaginèrent les ordres toscan et composite. Cependant, ainsi que du Bellay et tant d'autres, il mêle à son respect pour les anciens un désir patriotique de rivaliser avec eux. Il a des accents de triomphe quand il pense les surpasser : Certes, si Jules César, empereur si docte, si sage et si heureux en toutes ses entreprises, eust sçeu telle invention (celle des poutrelles), il luy eust esté fort aysé et facile à faire les ponts qu'il descrit en ses Commentaires. Comme celle de Ronsard ou de du Bartas, son imagination était large, exubérante, aventureuse ; il rêvait grand : une salle qui aurait 40 toises (80 mètres) de longueur et 25 de large ; un pont de 200 à 300 toises de long, à toute une arche seulement, sur une grande et furieuse rivière... ce qu'à plusieurs semblera estre chose monstrueuse et quasi incroyable. Ces différents caractères se retrouvent dans les œuvres construites par lui, dont il reste malheureusement peu de chose[20]. C'est vers 1550 que Philibert de l'Orme reçut la commande du tombeau de François In. Il le composa sur le modèle d'un arc de triomphe romain. Sur les deux façades antérieure et postérieure s'ouvrent trois arcades, celle du milieu plus haute que les deux autres, qui se prolongent par une voûte dans le sens de la profondeur de l'arc. Elles portent une plate-forme destinée à recevoir les priants, les gisants devant être placés au-dessous de la voûte centrale. Le monument est en marbre blanc, incrusté de plaques de marbre noir. La sculpture comportait les statues agenouillées de François Ier, de sa première femme Claude, d'une de leurs filles et de deux fils, morts avant 1547, puis les statues gisantes du roi et de la reine, et, en bas-relief, le long des soubassements, des épisodes des guerres en Italie. Pour cette partie de son œuvre, les collaborateurs de de l'Orme furent Pierre Bontemps, Marchand[21], Perret et Chantrel. Pierre Bontemps avait été employé à partir de 1536 aux travaux de décoration de Fontainebleau ; en 1556, il fit pour le Palais de Justice une grande statue en bois de François Ier, malheureusement perdue, et l'urne destinée à recevoir le cœur du roi, qui avait été déposé à l'abbaye des Hautes-Bruyères[22]. D'après les actes où il figure, il était peintre et imagier. Le tombeau de François Ier, remarquable à tous égards, offre un intérêt particulier par la combinaison de données classiques et d'éléments réalistes. L'architecture, toute empruntée à l'antiquité, est d'une grande harmonie de composition ; l'ornementation, les moulures, sont très pures et très délicates ; les proportions très rigoureusement observées : c'est une pleine œuvre de style. La statuaire est plus complexe. Non pas qu'il soit surprenant de trouver dans les priants et dans les gisants des portraits tout à fait sincères. Cela était de règle. Mais il est notable que ni les allégories, ni les modèles à l'antique n'apparaissent dans les bas-reliefs. Les batailles de Marignan et de Cérisoles, qui en forment les deux thèmes principaux, sont des batailles à la moderne, avec gendarmes couverts de fer, montés sur des chevaux caparaçonnés, avec des canons, des affûts, des boulets ; sur les autres parties du soubassement sont répandus des motifs anecdotiques, chariots, convois de vivres, mulets portant des bagages, vivandiers et vivandières. Pierre Bontemps, qui est l'auteur des bas-reliefs et de la plupart des figures royales[23], peut être mis, après Goujon et Pilon, presque au premier rang des sculpteurs du XVIe siècle. Le château d'Anet[24] fut commencé en 1548 pour Diane de Poitiers, alors au comble de la faveur, puisque son amant, Henri II, venait de monter sur le trône. Bâti en plaine, à quelque distance de la rivière d'Eure, il se composait d'un vaste quadrilatère entouré de fossés et divisé en deux parties. Le château proprement dit formait un carré régulier, bordé de corps de logis sur trois faces, fermé sur la quatrième par des galeries et par une porte monumentale, ouvrant sur le dehors par un pont-levis. A droite et à gauche, deux cours découpées en parterres. Au delà du château et des deux cours, mais encore dans l'enceinte des fossés, venait un jardin, avec des galeries et des portiques latéraux, des petits carrés de fleurs et des arbustes taillés à la mode du temps, des fontaines, des berceaux. Au delà, les bois pour la chasse, les prairies, les héronnières, une ménagerie, une orangerie ; enfin le domaine. Ce lieu, dit du Cerceau, est assez recognu pour une des plus belles places de France. Philibert de l'Orme considérait si bien le château d'Anet comme son œuvre capitale qu'il s'est comme complu à en parler dans son Architecture. Il y avait pratiqué quelques-unes de ses inventions ou des combinaisons techniques auxquelles il attachait tant de prix : son plancher en poutrelles, une trompe en saillie sur un des corps de bâtiments. Aux corps de logis principaux, il appliqua les formes alors à la mode et que lui-même avait trouvées dans les modèles antiques : deux étages à travées régulières, avec des fenêtres ou des portes encadrées entre des pilastres et surmontées de frontons ; au-dessus, les grands toits et les cheminées à la française. Au centre de la façade principale, il éleva un avant-corps de trois étages, avec le rez-de-chaussée d'ordre dorique, le premier étage, d'ordre ionique, le troisième, d'ordre corinthien, sous prétexte de passer graduellement et logiquement, de l'ordre qui donne l'impression de la force et de la solidité à celui qui présente plus de délicatesse et de légèreté : combinaison qui pendant longtemps resta classique. Quatre autres parties du château avaient été traitées par de l'Orme comme des chefs-d'œuvre destinés à affirmer sa maîtrise. La grande porte se composait d'un bâtiment assez massif, orné d'un bas-relief de Cellini et couronné d'une sorte de grande vasque sur laquelle était sculpté en ronde bosse un cerf accosté de deux chiens. Une chapelle, au centre du corps de logis de droite, était une imitation en raccourci des églises italiennes contemporaines, avec une coupole, une très riche décoration en caissons, un dallage de marbres blancs et noirs. Derrière le château, sur le jardin, de l'Orme avait ménagé une galerie, portant sur un crypto-portique, dont les voûtes étaient soutenues sur des piliers massifs. Enfin la fontaine de la cour de gauche était ornée de la Diane au cerf, œuvre de Jean Goujon, en l'honneur de la maîtresse du lieu[25]. De tous les monuments construits par de l'Orme, c'est peut-être Anet qui donne l'idée la plus complète de son talent, et qui montre le mieux comment la riche aristocratie de l'époque concevait une demeure de plaisance. Dans la construction du château des Tuileries, Philibert de l'Orme eut un collaborateur, Jean Bullant. Né à Écouen, vers 1310, Jean Bullant[26] avait vu, lui aussi, Rome et l'Italie. Au retour, il fut architecte du connétable de Montmorency. En 1557, il obtint la charge de contrôleur des bâtiments royaux, la perdit en 1559, la recouvra en 1570. En 1572, Catherine lui confiera la conduite du palais qu'elle destinait à remplacer les Tuileries[27]. A partir de cette date, il sera très mêlé à l'administration artistique, jusqu'à sa mort en 1578. Alors que la plus part du temps luy restait sans autre occupation, il avait composé un Recueil d'horlogiographie[28] et la Reigle générale d'architecture des cinq manières de colonnes, à l'exemple de l'antique, suivant les règles et la doctrine de Vitruve[29]. On lui faisait dire dans une des pièces de vers servant de préface : Gentilz ouvriers qui, d'un soing curieux, Alez cherchant és plus vieilles reliques, Les vrays pourtraits des bastiments antiques, Venez ici.... Si qu'or avant on voye emmi la France Maintz beaux pallais d'orgueilleuse apparence Ne céder point aux Babyloniens, Comme or' Bullant, en diverse manière, Vous en prescrit la forme singulière, Sur le patron des ouvriers anciens. Bullant avait donc été, ainsi que Philibert de l'Orme, élevé à l'école de l'antiquité et l'on s'en aperçoit dans quelques-unes de ses œuvres. Au château d'Écouen, il plaça sur trois des façades des portiques romains. L'un d'eux se composait de colonnes d'énormes proportions, s'élevant du sol jusqu'à la hauteur du toit, et supportant un large entablement classique. Ce n'était pas autre chose que la reproduction d'un motif du temple de Jupiter Stator à Rome. Or, dans la Reigle d'architecture de Bullant, est dessinée une des trois colonnes, qu'on rencontre en allant du Capitole au Colisée, c'est-à-dire une partie du temple de Jupiter Stator. On saisit là sur le vif un des procédés du classicisme architectural ; on saisit aussi l'une des origines en France de l'ordre dit colossal, qui consiste à rompre la distribution normale en étages par l'apposition sur la façade, dans toute sa hauteur, de pilastres ou de colonnes d'un seul tenant. Cet ordre devait faire une singulière fortune jusqu'à nos jours. On voit également cette préoccupation de l'architecture antique dans une haute galerie jetée sur un ravin dans le parc du château de Fère-en-Tardenois, et qui est attribuée à Bullant avec vraisemblance. On y a vraiment la sensation de quelque chose de romain[30]. A la différence du Louvre lui-même, qui avait encore par ses dehors une allure de château fort, les Tuileries devaient être, dans la pensée de Catherine de Médicis, un palais et même un palais à l'italienne. Ici, plus de fossés, plus de murs nus à l'extérieur. C'est à l'extérieur, au contraire, qu'est reportée toute la décoration et que sont les façades principales. En avant du palais s'étendra un vaste parc avec parterres, labyrinthes, grotte rustique, bosquets. Pour le palais même, de l'Orme et Bullant avaient imaginé un plan très ample : un grand quadrilatère de 190 mètres de long sur 120 de large, encadré de quatre corps de logis ; à l'intérieur, une cour bordée de portiques, et des corps de bâtiments entre lesquels s'élevaient des espèces d'amphithéâtres à l'antique. Une petite partie seulement du monument projeté fut élevée par Philibert de l'Orme, qui mourut en 1570 ; après sa mort, Jean Bullant ne continua la construction que jusqu'en 1572, Catherine ayant renoncé à achever les Tuileries, sur la prédiction menaçante d'un astrologue, prétend-on. La façade sur le jardin présentait un rez-de-chaussée, avec un étage en retraite, surmonté de lucarnes, de frontons et d'un toit assez bas. Le rez-de-chaussée était orné de colonnes à la française. Ainsi de l'Orme et Bullant, — qui est comme un de l'Orme un peu amoindri, — après avoir pris pour point de départ l'architecture antique, firent un continuel effort pour l'adapter aux besoins de leur temps et : aux conditions pratiques de l'habitation. Ils n'y réussirent pas toujours ; il y eut dans leurs monuments des disparates et même des maladresses. Leur style fut loin de la pureté de celui de Lescot, mais il fut aussi plus varié, plus vigoureux, plus moderne, même dans son décor antique. Germain Pilon[31] naquit en 1535, à Paris très probablement ; il y passa toute sa vie, s'y maria trois fois, s'alliant à des familles de petits possesseurs d'offices, un prévôt de Poissy, un sergent fieffé au Châtelet. Il fut donc, par excellence, un bourgeois parisien, et commença par être un homme de métier. En 1558, il exécuta un autel pour la chapelle de la riche corporation des orfèvres. Puis, à partir de 1560, Primatice se l'attacha, Pilon était sculpteur du roi Charles IX, de qui il reçut un logement à l'Hôtel de Nesle et un atelier à l'Hôtel des Étuves, situé à la pointe occidentale de la Cité. En 1572, il fut nommé Contrôleur général de l'art de Sculture sur le faict des monnoyes et revers d'icelles, charge très importante, qui le désignait pour fournir les modèles des monnaies et des médailles royales et le classait parmi les hauts fonctionnaires[32]. Il fut dès lors l'artiste à la mode, très employé par le Roi, par des seigneurs, par des bourgeois riches et amis des arts. Il n'aurait certainement pu suffire seul aux commandes très nombreuses qui lui venaient de tous côtés, mais il dirigeait un atelier, où travaillèrent ses fils, reprenant ainsi les traditions corporatives ; fait qui n'est pas exceptionnel, au XVIe siècle, sans doute, mais qu'on a l'avantage de constater plus nettement chez lui. La plupart de ses œuvres furent exécutées sur un devis préalable, passé presque toujours par-devant notaires. On a retrouvé le projet dessiné par Pilon pour le tombeau du cardinal de Birague, et il porte au verso cette mention : Le présent dessing a esté signé et parraphé par les notaires soubssignez, suivant le contract et marché faict par Germain Pilon avec Madame la marquise de Nesle et M. le commandeur de Birague (héritiers du Cardinal), à ce présents. Fait et passé par devant les notaires soubssignez, ne varietur[33]... Catherine de Médicis, en même temps qu'elle commandait le tombeau d'Henri II, avait conçu le projet grandiose, inspiré sans doute par le souvenir de la Chapelle des Médicis à Florence, de faire édifier une chapelle funéraire, qui devait être adossée au transept septentrional de l'église abbatiale de Saint-Denis, et serait réservée aux sépultures de tous les membres de la famille des Valois[34]. Primatice avait été nommé directeur des travaux, qui ne commencèrent cependant qu'après sa mort, en 1570, et furent confiés à Lescot, puis à Jean Bullant et, en dernier lieu, à Jean-Baptiste du Cerceau. Un grand chantier avait été créé à Saint-Denis, où finirent par se centraliser presque tous les travaux d'art exécutés pour le Roi, car ils se rattachaient au projet de la sépulture des Valois. Cette histoire du tombeau et de la chapelle est bien caractéristique de la prodigieuse désorganisation administrative du temps. Déjà en 1572 les travaux étaient presque subitement suspendus, et Bullant se mettait en possession du monument inachevé, sous prétexte d'une créance de 6.000 livres, dont il ne pouvait obtenir le paiement. En 1580, l'état des choses était déplorable, la pluie tombait dans les bâtiments. On reprit quelques travaux, de 1582 à 1588. Ils furent définitivement abandonnés après que la royauté eut été chassée de Paris, à la journée des Barricades. Cependant la chapelle avait été élevée en partie[35]. Les gravures qui en ont été conservées montrent un édifice en forme de rotonde, à deux étages de colonnes surmontés d'une coupole, tout cela inspiré en partie par le Panthéon de Rome et par l'art italien des Médicis. Le tombeau d'Henri II fut lui-même l'objet de projets successifs et de remaniements nombreux. Germain Pilon, après avoir, sous la direction de Primatice, collaboré avec plusieurs statuaires : Girolamo della Robbia, Frémyn Roussel, Regnaudin, Le Roux, finit par être chargé seul de toute la sculpture[36]. Il y travailla de 1565 à 1583 au moins. La partie architecturale comprenait un soubassement orné de bas-reliefs, sur lequel s'élevaient des arcades très ouvertes, supportant un entablement recouvert d'une dalle horizontale. Sous les arcades étaient étendus le roi et la reine gisant ; sur la plate-forme horizontale étaient agenouillés le roi et la reine priant. Aux quatre angles du monument se dressaient des statues allégoriques de grandeur nature. C'est la répétition du tombeau de Louis XII, mais dans un style architectural plus décidément classique. Pilon est l'auteur certain des deux priants, des deux gisants et des quatre figures de bronze placées aux quatre angles[37]. Il apparaît dans cette œuvre considérable avec le double caractère de son génie. Les figures allégoriques : la Foi, la Prudence, la Tempérance, la Justice, sont inspirées de l'antiquité et peut-être un peu de Primatice. Au contraire, les statues d'Henri II et de Catherine sont des œuvres d'un très puissant réalisme et, dans les deux gisants, Pilon a représenté le roi et la reine nus, la reine dans toute la vitalité de la jeunesse. Les deux priants portent le costume royal, dont les moindres détails sont rendus avec une exactitude et une précision scrupuleuses, et les visages ont une intensité de vérité admirable. Ce mélange d'originalité et de classicisme quelquefois conventionnel se retrouve dans tout l'œuvre de Pilon. Ses Grâces, trop vantées, sont un pastiche italo-antique ; il en est de même des figures de la châsse de Sainte Geneviève. Le Jésus-Christ, qui devait faire partie de la décoration de la Chapelle des Valois, semble une médiocre copie de Michel-Ange. Au contraire, le chancelier de Birague est le portrait peut-être le plus vigoureux et le plus naturaliste qu'ait produit la sculpture du XVIe siècle. Et puis Germain Pilon a une maîtrise prodigieuse de technique ; on sent qu'il aime le beau bronze, d'un ton vigoureux, et qu'il le travaille en ouvrier presque autant qu'en artiste. Ses médailles, ses bustes sont également d'un réalisme très ferme et très simple. Enfin, dans la Vierge de Pitié, destinée à Saint-Denis, et qui avait été commandée par Catherine de Médicis en 1585 ou 1586, Germain Pilon semble avoir voulu reprendre la tradition du XVe siècle. La Vierge est enveloppée plutôt que vêtue d'une étoffe très ample, aux plis très profonds. Le visage est celui d'une femme âgée, il est amaigri, émacié ; c'est une physionomie sans beauté, où Pilon a surtout cherché à exprimer la douleur à la fois humaine et divine, seule œuvre peut-être où l'art ait réussi à traduire quelque chose du sentiment religieux démocratique du temps[38]. Ainsi, au dernier terme de sa vie, Pilon recréait presque les éléments d'un art national et rompait avec l'esthétique de la Renaissance, mais il ne fut suivi qu'à moitié. Pourtant quelques statuaires d'Henri IV procèdent bien de lui. V. — LES ARTS DU DESSIN ET LES ARTS SOMPTUAIRES. ON n'est pas encore beaucoup mieux informé sur l'histoire de la peinture française, pour la seconde moitié du ange siècle que pour la première ; un nombre incalculable d'œuvres ont péri par l'incurie des hommes ; les tableaux ou les grandes décorations murales, qu'on retrouve çà et là, dans des châteaux, dans quelques églises, n'ont presque jamais de nom d'auteur. C'est le cas, par exemple, de peintures très importantes au château d'Écouen, à ceux d'Oiron, de Tanlay[39]. D'ailleurs, il faut reconnaître que la peinture décorative fut presque exclusivement pratiquée par les Italiens, surtout à partir du moment où Primatice fut devenu le grand-maître des arts du dessin et où l'École de Fontainebleau prit toute son extension : fresques ou tableaux, les grands sujets furent rarement abordés par les Français. Quand ils les traitèrent, ils s'inspirèrent du style italo-antique à un tel point que leurs œuvres n'ajoutent presque rien à l'histoire de l'art national. Il y eut ainsi un véritable recul par comparaison avec la seconde moitié du XVe siècle, où les fresques du Puy, de la chapelle de l'Hôtel de Jacques Cœur à Bourges, le triptyque de Moulins, les tableaux de Nicolas Froment et d'autres qu'on découvre peu à peu montraient de façon très probante l'aptitude de nos artistes aux grandes compositions[40]. Aucun nom peut-être n'a été plus populaire que celui de Jean Cousin, célébré comme sculpteur, peintre, dessinateur, graveur. Mais, il faut l'avouer, presque tout ce qu'on voudrait connaître à son sujet est encore hypothétique[41]. Né à Soucy, dans la banlieue de Sens, vers le commencement du XVIe siècle, il fut d'abord occupé comme peintre ou géomètre à des travaux de métier, en même temps qu'à quelques travaux d'art. Entre 1540 et 1550, son nom figure sur les comptes royaux, en qualité d'imagier travaillant à Paris ou à Fontainebleau, à 14 livres par mois, ce qui le classe parmi les artistes de second ordre. On le suit à des dates intermittentes, déterminées surtout par la publication de ses œuvres, et on pense qu'il mourut après 1583, peut-être en 1595. Il avait publié en 1560 le Livre de perspective, en 1571, le Livre de pourtraicture, véritables manuels d'enseignement du dessin, qui eurent un succès tout à fait exceptionnel et durable (car on en fit des éditions au XVIIe au XVIIIe et même au XIXe siècle), et qui furent très consultés par les artistes, encore plus par les artisans, ce qui explique sans doute pourquoi sa renommée a été si grande. Il avait également fait les dessins d'un Livre de la lingerie, dont une édition nouvelle parut en 1584[42]. Il a gravé des estampes, il a donné des cartons pour des vitraux et peut-être exécuté des vitraux, mais on ne peut, là encore, lui attribuer beaucoup d'œuvres certaines. On voudrait surtout savoir ce qu'il fut comme peintre et sculpteur. Un de ses compatriotes, Jean Taveau, écrivait : Il a fait de beaux tableaux de peinture fort ingénieuse et artiste qui sont admirez par tous les ouvriers expers en cest art ; et il ajoute : Outre ce, il estoit entendu à la sculpture de marbre, comme le tesmoigne assez le tombeau de feu amiral Chabot, en la Chapelle des Célestins, qu'il a faict et dressé, et monstre l'excellence de l'ouvraige et de l'ouvrier. A coup sûr, Cousin serait un des grands statuaires français, si on pouvait lui attribuer la statue de l'amiral Chabot. Mais, nonobstant le témoignage de Taveau, si précis à ce qu'il semble, il subsiste encore bien des doutes à cet égard, et beaucoup d'historiens de l'art ont peine à croire que cette œuvre si ferme, si expressive, soit d'un artiste dont les productions connues dénotent plutôt une facilité banale et un style ultramontain très marqué. Ils supposent que Taveau n'aurait songé qu'au tombeau proprement dit, dont la décoration était bien dans le genre des gravures de Cousin. On ne peut pas davantage mettre sous son nom, avec certitude, les vitraux de la Chapelle de Vincennes, qui sont une œuvre de grand ordre. On n'a encore que quelques tableaux authentiques de lui, par exemple le Jugement dernier[43], qui a été si longtemps donné pour un chef-d'œuvre : peinture correcte, inspirée des Italiens et de Michel-Ange, sans grande originalité dans la composition, dans le dessin, dans la couleur. D'autres tableaux sont douteux et d'ailleurs semblent de valeur secondaire. Ainsi, jusqu'à de nouvelles découvertes, on est obligé de douter et de laisser dans l'effacement la figure de cet artiste tant cité ; actuellement son nom est certainement plus grand que ses œuvres connues. François Clouet, dit Janet[44], a dû naître avant 1522, il mourut en 1572. Il était fils de Jean Clouet, peintre de François Ier, succéda à son père en 1540, et fut successivement peintre et valet de chambre des rois François Ier, Henri II, François II et Charles IX. En cette qualité, il fit les portraits des membres de la famille royale et fut très à la mode dans la haute aristocratie, pendant plus de trente ans. Mais, pour lui aussi, on est obligé presque toujours de s'en tenir à des attributions, et les Clouet absolument authentiques sont encore aujourd'hui bien rares. Mêmes conclusions sur Guillaume Boutelou[45], sur Corneille, dit de Lyon, sur Foullon, gendre de Clouet, sur Antoine Caron, de Beauvais. Brantôme a parlé de Corneille, mais à vrai dire pour parler de Catherine de Médicis : Sur quoy, il me souvient qu'elle estant ung jour allée voir à Lyon un peintre qui s'appelait Corneille, qui avoit peint en une grant'chambre tous les grands seigneurs, princes, cavalliers et grandes reynes, princesses, dames, filles de la Court de France, estant donc en la dicte chambre de ces paintures, nous y vismes ceste reyne parestre painte très bien en sa beauté et perfection, habillée à la francèse d'un chapperon avec ses grosses perles, et une robe à grandes manches de toiles d'argent fourrées de loups cerviers ; le tout si bien représenté au vif avec son beau visage, qu'il n'y falloit rien plus que la parolle, aiant ses trois belles filles auprès d'elle. De Caron, qui fut célébré en vers et en prose et qu'un écrivain du temps mettait au-dessus de Cousin : Couzin aura toujours un éternel renon, Et toi, par-dessus lui, tu l'auras mon Caron, que reste-t-il aujourd'hui ? Il avait peint les volets de trois chapelles dans l'église de Saint-Laurent à Beauvais, donné le dessin d'une Cène pour un vitrail des Cordeliers de la même ville, peint une Annonciation, les Métamorphoses d'Ovide. Ce n'était là qu'une partie de ses travaux ; elle est entièrement perdue, et le reste a subi le même sort ou n'est conservé que par quelques gravures[46]. Tout ce qu'on peut faire c'est de distinguer certaines manières, une manière de Clouet, une manière de Corneille, qui permettent de classer les œuvres et de trouver là une École française (c'est ce qui importe), très remarquable dans un certain genre, surtout si l'on y ajoute les Crayons. Tableaux ou crayons, les portraits du XVIe siècle sont extrêmement nombreux, nous l'avons dit ; ils sont d'un art très original et très vigoureux, qui ne doit rien à des influences classiques ou italiennes. La simplicité, la précision, la sobriété, une naïveté savante, une exécution très ferme et très large, voilà les mérites de ces portraits. Ils n'ont rien de commun avec les portraits italiens, plus décoratifs, plus pompeux, plus en dehors. Mais si l'on admet qu'ils soient bien à l'image de leurs modèles, on ne peut s'empêcher de constater comme un air de ressemblance entre toutes les physionomies, et la vision que l'on conserve des hommes et des femmes du temps, tels que les peignirent Clouet, Corneille ou Foullon, est très différente de celle qu'on s'en fait d'après l'histoire et la chronique. Les hommes sont graves, sérieux, posés ; les femmes délicates, fines, chastes, modestes. Nous voilà bien loin de ces personnages aux passions ardentes, violentes, exaspérées, de ces héros terribles ou de ces héroïnes passionnées des guerres de religion. Et, d'autre part, quel contraste avec le type de beauté féminine ou masculine, aux formes amples et vigoureuses, toutes débordantes de sensualité, que créèrent les peintres classiques de la mythologie ! C'est presque un problème historique posé à propos d'un problème d'art. Comme tant d'autres, les graveurs de la seconde moitié du XVIe siècle furent entraînés vers l'italianisme, et la plupart d'entre eux. même lorsqu'ils ne sont pas Italiens, se rattachent à l'École de Fontainebleau[47], dont les caractères esthétiques se retrouvent dans les trois œuvres les plus authentiques de Jean Cousin : Saint Paul sur le chemin de Damas, l'Annonciation, la Mise au tombeau. Des graveurs très féconds, Boyvin (1530-1598), Étienne Delaune (1519-1583)[48], reproduisirent un grand nombre de sujets religieux ou allégoriques, empruntés à Primatice et à d'autres Italiens. Mais la partie la plus intéressante de leur œuvre est certainement dans les nombreux ornements qu'ils dessinèrent. Un recueil de Boyvin porte ce titre : Aiguières, coupes, salières, plateaux, brasiers, nefs, flambeaux... propres aux orfèvres, bijoutiers, émailleurs et autres metteurs en œuvre. Delaune a gravé de même des modèles de miroirs, des anses de vases, des fonds de coupes, des grotesques, également propres à tous metteurs en œuvre. Le réalisme apparaît dans certains portraits de Delaune, et il aura des représentants très décidés, comme Thomas de Leu et Léonard Gaultier qui, dans les dernières années du XVIe siècle et dans les premières années du XVIIe, représenteront, d'un burin très ferme, précis, un peu sec, presque tous leurs contemporains notables. Quant aux estampes célèbres de Tortorel et Perrissin, qui reproduisent les scènes militaires et les massacres des guerres religieuses, elles ne valent que par leur intérêt historique. Rien ne donne peut-être mieux l'idée de la richesse et des goûts fastueux des hommes du 'une siècle que l'étude des arts somptuaires : tapisserie, vitrail, émail, joaillerie, meuble, céramique. Les inventaires fournissent sur ce point des renseignements, qui ont la précision de la statistique. Lorsque Catherine de Médicis mourut, en 1589, elle laissait de grosses dettes impayées, et ses créanciers firent dresser l'inventaire du mobilier[49] qui garnissait à Paris l'Hôtel de Soissons, qu'elle avait abandonné précipitamment après la journée des Barricades. On y trouva 133 pièces de tapisserie (sans compter les tapis de Turquie et de Perse), 341 portraits de personnages français ou étrangers, 70 émaux de Limoges, 119 miroirs de Venise, des vases façon de jaspe (très probablement des faïences de Palissy), des meubles de toute sorte. Il est probable que la reine-mère avait emporté ses bijoux, dont il n'est pas question. A côté d'un inventaire royal, celui d'une femme riche de noblesse provinciale[50]. Après les robes de velours, de soie, de brocard, viennent les joyaux : des chaînes d'or, des bracelets faisant deux et quatre fois le tour du bras, des médaillons, des bagues, des perles, 25 à 30 gros bijoux. Quelques chaînes portent jusqu'à 15 chatons, ornés chacun de diamants et de grosses perles. Une de ces chaînes, qu'on entremêlait dans les cheveux, avait 7 émeraudes et 16 grosses perles. Dans un inventaire annexe sont signalées 45 pièces de tapisseries : Histoire de Judith, Histoire de David, descendant depuis le haut, c'est-à-dire garnissant du plafond au plancher les murs d'une chambre. Au château de Joinville, appartenant aux Guise, on inventoria, en 1583, 17 tapisseries à grands sujets, de 8 pièces chacune en moyenne. Il y avait en outre 60 pièces de tapisseries à verdures. Les portraits de l'époque, si exacts jusque dans le détail, confirment ces renseignements : les hommes et les femmes sont couverts littéralement de bijoux. Dans un de ses portraits, Élisabeth d'Autriche, femme de Charles IX, est vêtue d'une robe de satin blanc, sous un grand manteau de brocard à fourrure d'hermine. Sur le devant de la robe court une bande de grosses perles, deux autres sur les manches ; une massive chaîne d'or très ornementée descend sur la poitrine et porte de gros joyaux très richement ciselés. Le haut du corsage est attaché d'une grosse broche ; la coiffure, semée de perles et de bijoux. Ainsi s'explique le développement des arts industriels, au moins pendant les soixante-quinze premières années du siècle. Ces arts ne furent originaux que d'une certaine façon. En effet, les industriels empruntèrent presque toujours leurs sujets et leurs modèles aux artistes, peintres, graveurs, sculpteurs ou architectes. Primatice fournit des dessins pour des tapisseries, Jean Cousin pour des vitraux, les graveurs de l'École de Fontainebleau pour des émaux, les architectes pour un grand nombre de meubles. Quand les dessins ne furent pas demandés directement aux artistes, ils furent pris dans les recueils de modèles dont nous avons parlé. Presque toute la décoration ornementale, cadres des vitraux, bordures des tapisseries, des émaux, dessin des bijoux, vient de du Cerceau, de Delaune, de Jean Cousin, de Boyvin. Ainsi le style des arts industriels n'est bien souvent que le reflet de l'esthétique du temps, et il est très fortement marqué d'italianisme. Seulement les émailleurs, les tapissiers, les artisans du meuble eurent le mérite d'adapter aux conditions particulières de leur art spécial les modèles qu'ils avaient sous les yeux : ils s'en inspirèrent autant qu'ils s'en servirent, et il y eut ainsi chez eux une part d'interprétation personnelle. Et puis ils pratiquèrent et ils développèrent une technique admirable. Ce qui est séduisant dans la tapisserie, dans l'émail, dans les vitraux, ce n'est pas le modèle primitif, si souvent banal, c'est la richesse ou l'harmonie des couleurs, la vibration des tons, l'instinct décoratif très juste ; dans le meuble, la perfection, la fermeté ou la délicatesse du travail de l'ouvrier. Les plus belles tapisseries[51] du XVIe siècle furent fabriquées dans les Pays-Bas, où les ateliers de Bruxelles, de Bruges, de Gand, de Valenciennes, de Tournai, étaient les fournisseurs de tous les princes de l'Europe. C'est là que François Ier acheta les plus belles pièces de son garde-meuble : la Grande Histoire de Scipion, en 22 pièces, qui avait coûté 40.000 livres, et qui fut si admirée, lorsque Catherine de Médicis la fit porter à Bayonne, lors de l'entrevue de 1565. C'est de là que vinrent la plupart des tapisseries des châteaux royaux ou seigneuriaux et des églises. Mais, à partir du XVIe siècle, presque tous les cartons furent italiens : Raphaël avait dessiné ceux des fameux Actes des Apôtres, tissés par Van Aelst à Bruxelles, de 1515 à 1519 ; Jules Romain fut peut-être, après Raphaël, l'artiste auquel les tapissiers flamands demandèrent le plus de modèles. Ainsi domina le style classique, et il domina même lorsque les dessins furent composés par des artistes flamands, puisque ceux-ci à leur tour étaient italianisés. Mais le goût des amateurs, même princiers, revint aussi aux scènes plus familières ou aux représentations d'événements contemporains. C'est ainsi que furent composées aux Pays-Bas les célèbres Chasses de Maximilien, la Bataille de Pavie, et la Conquête de Tunis, dont l'auteur était un Hollandais, Jean Vermeyen, et où l'on voyait une carte du littoral de la Méditerranée, la revue des troupes de l'Empereur, la prise de la Goulette. Les cartes et les plans furent d'ailleurs très à la mode pour les tapisseries, et aussi les paysages rustiques et les verdures. François Ier avait entrepris de restaurer en France l'art de la tapisserie, qui avait été très florissant au XIV et au XVe siècle ; il établit un atelier à Fontainebleau ; Henri II en créa un autre à Paris ; il y en avait un à Tours vers 1541. Catherine de Médicis fit exécuter par l'atelier de Paris la grande tapisserie dite d'Artémise, entre 1565 et 1570, dont les dessins avaient été faits, dit-on, par le peintre Henri Lerambert ou par Antoine Caron. Le style en était tout italien : triomphes de Dieux à l'antique, chars attelés de lions ou de licornes ; la Reine-mère entrant dans le temple de Jupiter ; Minerve, Apollon. Les bordures étaient ornées d'arabesques à la façon de Du Cerceau. L'art du vitrail[52] est essentiellement français et, pendant le XVIe siècle, il a produit chez nous des œuvres admirables. Les peintres verriers furent très nombreux et répandus partout : Pinaigrier, Le Prince, Fauconnier, Lécuyer, se transmettant généralement le métier et les traditions artistiques de génération en génération. Au XVIe siècle, les verriers disposaient d'une gamme de couleurs très riches et variées, ils avaient toutes sortes de procédés pour nuancer le verre ; ils arrivèrent ainsi à obtenir des modelés plus souples, des tons nouveaux ; ils se rapprochèrent de plus en plus des conditions de la peinture, et ils conçurent les verrières à la façon des grands tableaux. Ils furent entraînés quelquefois vers le style italien (quoi qu'on trouve dans plusieurs vitraux des influences allemandes), mais préservés de l'imitation servile par la multiplicité des sujets qu'ils traitèrent et par la supériorité de leur technique. De sorte que, si leur dessin n'est pas toujours original, leur couleur vibrante et harmonieuse, où ils adaptent si bien de beaux jaunes, des violets, des bleus, à la translucidité du vitrail, est à eux seuls. Comme au moyen âge, comme dans la première partie du XVe siècle, des églises innombrables reçurent des vitraux. Les plus beaux ou les plus connus sont à Montfort-l'Amaury, à Bourges, à Couches, à Champigny-sur-Veude, à Écouen, à Montmorency, à Rouen, à Vincennes, etc. Toutes ces verrières représentaient naturellement des scènes religieuses. Mais il y avait au château d'Écouen une suite de vitraux en grisaille figurant les épisodes de la fable antique de Psyché ; les dessins en avaient été donnés par Michel Coxcie ; en tout cas l'influence des maîtres ultramontains y est très sensible. Les plus remarquables et les plus caractéristiques des vitraux dans la seconde moitié du XVIe siècle sont peut-être ceux de la Chapelle de Vincennes, attribués souvent à Jean Cousin, et qui peuvent être datés de 1557 environ. Ils sont malheureusement très restaurés, mais la conception de leur art subsiste. Les sujets en sont tirés de l'Apocalypse ; il y a des scènes calmes dans leur gravité : l'Ange marquant au front des justes dévotement agenouillés ; il y en a de terribles : les sonneries des sept trompettes vengeresses annonçant la destruction du monde visible ; les mers bouleversées par la tempête, les navires submergés, des cadavres flottants, des ciels parsemés d'éclairs ou obscurcis de nuages épais. C'était pour l'artiste l'occasion de faire jouer des belles oppositions de couleurs et des tonalités vibrantes, de figurer des horizons lointains, des décors d'architecture somptueux. Son imagination vraiment puissante a été presque égale à la poésie grandiose de l'Apocalypse. S'il n'y a pas de grande peinture française au XVIe siècle, l'étude du vitrail montre du moins qu'il y avait tous les éléments d'un art très puissant et très original. Les grands émailleurs du XVIe siècle furent limousins, et ils formèrent presque tous de véritables dynasties, qui se prolongèrent de la fin du XVe au milieu du XVIe : les Pénicaud, les Reymond, les Limosin, les Courteys[53]. Eux aussi travaillèrent presque toujours sur des dessins d'artistes ou d'après des estampes. Ils prirent leur bien un peu partout, en Italie d'abord, mais aussi en Flandre et même quelquefois en Allemagne. Ainsi Nardon Pénicaud et Léonard Limosin s'inspirèrent de dessins de Dürer. Somme toute, une grande partie, la plus grande partie de leur œuvre est classique, mais ils traitèrent presque autant des sujets religieux que des sujets mythologiques. Seulement ils ne cherchaient, dans les uns comme dans les autres, que le motif décoratif. On a une vie de Jésus, de Léonard Limosin, datée de 1557, qui se compose d'une dizaine de pièces, depuis l'Annonciation, jusqu'à l'Ascension. Les personnages y ont le type des dieux et des héros de Jules Romain ou de Primatice ; la Cène ne se distingue guère d'un banquet mythologique, et partout apparaissent, dans un paysage de convention, des ruines et des édifices romains. Dans les célèbres émaux de la Sainte-Chapelle, le Crucifiement et la Résurrection sont représentés dans un cadre somptueux, où se voient les portraits de François Ier, d'Henri II, de Catherine de Médicis. Les dessins venaient de Niccolo dell'Abbate. Mais les émailleurs se plurent surtout aux nudités païennes ; ils reprirent les Assemblées de dieux, dont les Italiens, depuis Raphaël, avaient répété le thème à l'infini ; ils interprétèrent les légendes de Vénus, de Vulcain, de l'Amour. Ils firent aussi de très nombreux portraits, pour lesquels, presque toujours, ils se servaient des crayons d'artistes ; le fait est constaté dans les détails de quelques devis. Léonard Ier Limosin, né vers 1505, mort entre 1575 et 1577, est le plus célèbre des émailleurs : peintre, graveur, chimiste, miniaturiste, émailleur, il eut les titres de valet de chambre, peintre ordinaire et émailleur du Roi ; il fut très à la mode : on connaît encore de lui 130 portraits des grands personnages du temps, et on est loin d'avoir tous ceux qu'il a faits. Le style est celui de Clouet et de Corneille, réaliste par conséquent, mais Limosin les entourait d'un cadre très ornementé, où il figurait des masques, des bustes, des femmes et des satyres à l'antique. Une suite d'émaux représentait les Apôtres, parmi lesquels saint Thomas, sous la figure de François Ier, nimbé et vêtu d'une draperie aux larges plis. Les artisans du meuble[54] travaillèrent surtout sur les dessins des graveurs et encore bien plus des architectes, et les styles qu'ils appliquèrent successivement furent exactement conformes à l'évolution de l'art au cours du XVIe siècle. Pendant la première moitié, les meubles, comme tant de monuments de l'époque, gardèrent la forme gothique et se modifièrent seulement dans leur décoration, où se mélangeaient l'ornementation flamboyante du XVe siècle et les arabesques. A partir de 1550 (la coïncidence est intéressante), apparurent les formes classiques, dont les dessins furent empruntés à du Cerceau, un peu plus tard à Étienne Delaune. De même que dans l'architecture, il y eut des nuances dans le style ; ici plus correct et plus équilibré, là plus vibrant et plus chargé d'ornements. Le beau meuble de pur style classique, une armoire par exemple, se compose d'un corps inférieur, avec deux pieds-droits en pilastres et, au centre, deux panneaux décorés en très bas relief de figures à l'antique ; le corps supérieur, un peu plus étroit, est flanqué de deux colonnettes assez menues, avec un léger chapiteau en volutes, et il supporte un fronton brisé, avec, au milieu, un couronnement en forme de cadre. Les deux panneaux centraux du corps supérieur de l'armoire sont également décorés de bas-reliefs presque plutôt ciselés que sculptés. La beauté de ces meubles est dans la très harmonieuse proportion de leurs parties, dans la sobriété de la décoration et dans la perfection du travail de l'ouvrier. Une autre école, représentée surtout par le Dijonnais Hugues Sambin, architecte et dessinateur[55], rechercha plutôt les formes massives et les décorations exubérantes. Les meubles qu'elle fabriqua sont soutenus dans leurs parties inférieure et supérieure par des Satyres en haut relief formant cariatides, par des Termes en forte saillie ; l'ornementation se replie en volutes très contournées ; les ornements en grotesques sont surabondants. VI. — LA MUSIQUE[56]. LES historiens les plus récents de la musique française déclarent volontiers que le XVIe siècle fut encore plus le siècle de l'art musical que des arts plastiques, et ils affirment l'existence d'une grande école nationale. Il y a là, suivant nous, quelques exagérations, que l'histoire générale doit remettre au point, en gardant la part de vérité qui s'y trouve. On ne niera pas que les hommes du XVIe siècle aient beaucoup aimé la musique et qu'on trouve dans le goût passionné qu'ils eurent pour elle une révélation de plus de leur esprit et de leurs mœurs. A commencer par les poètes, Mellin de Saint-Gelais chantait, en s'accompagnant du luth, les mélodies qu'il avait composées sur ses vers ; Marot traduisit les Psaumes avec l'idée qu'ils fussent chantés ; Jodelle, Daurat, Ronsard allaient jusqu'à faire une théorie de l'union de la musique et de la poésie, que Baïf essaya de réaliser par son système de prosodie métrifiée à l'antique. Charles IX était un dilettante de chant et de danse. Brissac entretenait dans son gouvernement de Piémont une bande de violons italiens, qu'il consentit à céder à Henri II et à Catherine de Médicis, sur le rapport qui avait été fait de leur talent. Leur chef, Baldassarini, plus connu en France sous le nom de Beaujoyeux, exerça pendant de longues années une espèce de surintendance sur la musique et les ballets, et était admis dans la familiarité des courtisans et des seigneurs. Les jeunes gentilshommes étaient presque tous assez instruits dans l'art vocal pour chanter entre eux les pièces du temps, composées à quatre voix, avec une harmonie assez compliquée. On citait Strozzi comme un joueur de luth aussi habile qu'un professionnel. Le fait que les Réformés se préoccupèrent beaucoup du concours que le chant pouvait apporter à la propagande religieuse contribua à développer la musique, et aussi à en modifier le caractère. Après Luther qui, d'instinct, avait deviné cette puissance de la musique sur les Ames, Calvin vit le problème en psychologue et en homme d'état moraliste[57]. Il reconnaissait que la musique récrée l'homme et lui donne volupté ; que c'est un art, plus que tous les autres, propre à tourner ou fléchir çà et là les mœurs des hommes. Cela étant, il importait de le diriger, on dirait presque de l'endiguer, pour en éviter les écarts redoutables. En effet, les paroles mauvaises pervertissent les mœurs, et quand la mélodie est avec, cela transperce beaucoup plus fort le cueur.... ainsi le venin est distillé jusques au fond du cueur par la mélodie. Mais aussi, dès qu'on le purifie, le chant a grand force et vigueur d'esmouvoir et enflamber le cueur des hommes, pour invoquer et louer Dieu d'un zèle plus ardent et plus véhément. Ce qui était doctrine chez Calvin, fut entraînement chez les calvinistes, et c'est pourquoi ils créèrent et eurent un grand art musical. Ainsi apparaît une double tendance profane et religieuse dans l'art. Les formes principales de la musique furent la musique de danse, la chanson, la musique religieuse réformée, la musique catholique, et une ébauche d'opéra. La musique fut très étroitement unie à la danse qui, pour les gens du XVIe siècle, était un art véritable, où les grands seigneurs et les dames mettaient quelque amour-propre à exceller. Brantôme dit que Charles IX dansait souvent avec sa sœur Marguerite : Je l'ay veu la mener danser la pavanne d'Hespaigne, danse où la belle grâce et majesté font une belle représentation, mais les gens de toute la salle ne se pouvoient saouller ny assez se ravir par une si agréable veue. Je leur ay veu pareillement fort bien danser le pazzemezzo d'Italie, ores en marchant et aveq'ung port et geste grave, en conduisant si bien et si gravement leurs pas, ores les coullant seullement, et ores en y faisant de fort beaux, gentils et graves passages, que nul autre ou prince ou autre y pouvoit approcher, ny dame. C'est exactement la même impression que laisse le tableau du Bal[58] où l'on voit, devant des dames et des courtisans en costume somptueux, un couple évoluer avec grâce et dignité, avec cette aisance de mouvements et cette élégance d'attitudes, qui caractérisent l'aristocratie du XVIe siècle, comme celle du XVIIe. La musique de danse était souvent composée sur un motif emprunté à un air déjà connu, souvent à un air de chanson, autour duquel le musicien établissait une harmonie et une instrumentation savantes. Et comme les danses étaient tantôt sentimentales et graves, tantôt vives et alertes[59], elles offraient au musicien des éléments d'inspiration très variés, d'où serait venue, dit-on, la première ébauche des futures symphonies[60], avec leurs parties d'andante, d'allegro, de menuet. La chanson, qui en réalité comprenait tous les genres
poétiques lyriques : odes, élégies, aussi bien que chansons proprement dites,
fut, avec la danse, la grande source d'inspiration de la musique profane.
Elle atteignit son point de perfection avec les
recueils de Costeley (1370) et de R. de Lassus (1576)...
une noblesse, une distinction sans égale, et
l'on y trouve parfois comme le pressentiment de l'harmonie moderne[61]. Mais le vrai renouvellement de la conception musicale vint de la rénovation de la musique catholique — la Messe du Pape Marcel fut écrite par Palestrina en 1565 — et, avant cela même, de la création de la musique protestante. Dans la musique s'introduisirent peu à peu l'éloquence et. la haute pensée. Et puis, il se fit en Italie une première ébauche d'opéra. Au XVIe siècle, on y représenta un grand nombre de tragédies, ensuite des pastorales, où des morceaux de chant et des intermèdes d'orchestre étaient intercalés dans le texte déclamé, et où le décor tenait une grande place[62]. Il en passa quelque chose en France : les Enchantements de Circé, mis en scène par le fameux Balthazar de Beaujoyeux[63] en 1581, sont presque un opéra moderne, avec plus de musique et de chant que de ballet, et des soli, des duos, des chœurs. Il faut bien reconnaître que la plupart des musiciens célèbres, dans la seconde moitié du XVIe siècle, ne furent pas originaires de France. Le grand musicien français ou francisé, Jannequin, mourut en 1559 ; ses œuvres appartiennent à la première moitié du siècle. Palestrina était Italien ; Willaert, Orlando de Lassus, Arkadelt étaient Flamands, Goudimel, Franc-Comtois. Willaërt vécut à Venise ; Lassus, après un séjour en Italie, devint maître de chapelle du duc de Bavière. Mais Arkadelt, qui faisait partie de la chapelle pontificale romaine, fut attiré à la cour par les Guise et reçut d'Henri II le titre de musicus regius ; Costeley fut organiste du roi Charles IX ; Goudimel, né en 1505, vint à Paris en 1555 et y passa une partie de sa vie ; il fut assassiné à Lyon, au moment de la Saint-Barthélemy, comme suspect de protestantisme. Les œuvres de tous ces artistes furent d'ailleurs connues et même imprimées chez nous en même temps qu'à l'étranger. Goudimel doit être placé, avec Lassus et Palestrina, au premier rang des musiciens de la Renaissance, et il fut le plus puissant interprète du sentiment religieux chez les réformés[64]. Bien qu'il ait composé un certain nombre d'œuvres profanes — il mit en musique les odes d'Horace —, il déplorait que l'art fût corrompu par lascives, sales et impudiques chansons, et voulait chanter les louanges du Créateur. Il a écrit des motets, des messes et la musique de Psaumes de Marot, où s'échauffa l'enthousiasme des réformés. Lejeune est un artiste remarquable, mais la plupart de ses œuvres ont été composées vers l'extrême fin du siècle ; il a écrit de la musique sacrée et de la musique profane : Le Dodécacorde (psaumes mis en musique), et une suite de chansons sous le titre de Le Printemps. Dans la préface du Dodécacorde, il disserte sur les modes anciens, dorien, phrygien, lydien, et déclare qu'il veut faire une musique pesante et grave, à la place des modulations légères, dont les Français, selon lui, sont lassés. C'est toujours l'esprit théoricien de la Renaissance qui reparaît, et Lejeune l'appliqua d'une autre façon, en conformant quelques-unes de ses mélodies à la poésie métrifiée de Baïf ou de Ronsard ; il y a trouvé d'ailleurs des inspirations charmantes. Un autre musicien, Mauduit, s'était aussi donné presque tout entier à cette conception nouvelle[65]. Nous disions plus haut, à propos des architectes : l'architecture française de la seconde moitié du XVIe siècle est originale, avec des éléments qui ne le sont pas. On pourrait appliquer ce jugement à l'art tout entier de ce temps. La connaissance trop complète de l'antiquité, la trop grande préoccupation des modèles italiens firent dévier le style français, et les arts décoratifs surtout furent quelquefois trop entraînés dans la voie de l'imitation. Mais les artistes vraiment grands — et il y en eut plus d'un — se ressaisirent, tout comme les écrivains, et leur personnalité l'emporta sur leurs doctrines. Pas plus qu'au temps de François Ier, un château, un palais du temps d'Henri II et de Charles IX ne ressemble à un palais italien, et on ne confondra jamais ni Lescot (pourtant si classique), ni de l'Orme, ni Goujon, ni Pilon, avec un artiste contemporain de la Péninsule. LA FRANGE DU XVIe SIÈCLE. DANS la période qui s'ouvre avec les guerres d'Italie et se termine au traité du Cateau-Cambrésis, le territoire national s'est légèrement agrandi. François Ier et Henri II ont renoncé à la suzeraineté, d'ailleurs plus nominale que réelle, de la Flandre et de l'Artois, mais Henri II a reconquis Calais et acquis Metz, Toul et Verdun. A l'intérieur, l'extension du domaine royal a continué ; presque toutes les possessions de la Maison de Bourbon, et la Bretagne, les comtés ou duchés d'Alençon, d'Orléans, de Blois, d'Angoulême, de Valois, ont fait retour à la Couronne. Beaucoup de fiefs ont disparu par extinction. Ainsi le progrès dans l'unification du royaume a été considérable de 1492 à 1559. Ce qui reste de la féodalité se transforme en noblesse de Cour. Les seigneurs que l'habitude et aussi leurs fonctions, charges et pensions retiennent à la Cour, dépendent entièrement du Roi. Des princes du sang, il ne reste plus que les Bourbons, mais qui ne se sont pas encore relevés du coup que leur avait porté la révolte du connétable Charles. Haute et moyenne noblesse, très renouvelées depuis un demi-siècle de guerres, n'ont plus grande attache dans le pays. Montmorency n'est devenu riche et n'est sorti de l'obscurité que par la faveur royale. Les Guise, cadets de Lorraine, ont tout au plus une clientèle, pas encore un parti à la mort d'Henri II. Ces personnages ont si bien le sentiment de tenir du roi seul leur fortune que toute leur ambition s'est tendue à se ménager des alliances dans sa famille ; François de Guise a épousé une petite-fille de Louis XII, et François de Montmorency, une fille bâtarde d'Henri II. Le Concordat, en donnant au Roi la disposition des plus grands bénéfices, a mis le clergé dans sa main. Ce premier ordre du royaume n'est plus capable d'indépendance. Le Tiers État perd, s'il l'a jamais eue, la conscience d'être un ordre : le Tiers, ce sont des bourgeois disséminés dans les villes. Très puissant en fait, le pouvoir royal a pour lui les
théoriciens : les humanistes lui prodiguent toutes sortes de complaisances,
les calvinistes eux-mêmes proclament sa légitimité[66]. Calvin reste ce
qu'il était lors de la première édition de l'Institution chrétienne,
respectueux des pouvoirs établis : Si ceux qui, par
la volonté de Dieu, vivent sous des princes et sont leurs sujets naturels,
transfèrent cela à eux (c'est-à-dire le
système de gouvernement libre qui existe dans certains pays), pour être tentés de faire quelque révolte ou changement,
ce sera non seulement une folle spéculation et inutile, mais aussi, méchante
et pernicieuse. Il ajoute : Ce que je répète
par plusieurs fois, afin que nous apprenions à ne point éplucher quelles sont
les personnes auxquelles nous avons à obéir, mais que nous nous contentions
de connaître que, par la volonté du Seigneur, elles sont constituées en un
état auquel il a donné une majesté inviolable. Du Moulin, qui n'avait certainement pas l'esprit de soumission, fait un livre sur L'excellence du royaume et monarchie des Françoys. Il y dit bien que le roi n'est pas propriétaire ni maître absolu (dominus) du royaume, mais il lui reconnaît les pouvoirs d'administration les plus étendus, et surtout il met en sa main toute la justice. Il va jusqu'à cette parole, explicable en un temps où l'on avait beaucoup à souffrir de ce qui restait des pouvoirs locaux : Vivre sous un roi souverain, c'est la suprême liberté. Avant lui, le jurisconsulte Grassaille, dans un traité publié en 1538, attribuait au monarque vingt privilèges ou droits généraux et vingt autres particuliers à l'égard de l'Église. Brèche, un autre jurisconsulte, avait composé le Manuel Royal en 1544, et le Premier livre de l'honneste exercice du Prince, deux ouvrages inspirés d'un très pur loyalisme. Et du Bellay disait : Car rien n'est après Dieu si grand qu'un roi de France. L'ambassadeur vénitien, Michel Suriano[67], insiste sur cette situation privilégiée des rois de France : Quant à l'autorité de celui qui gouverne, je dis que ce vaste et puissant royaume, si peuplé, si abondant en commodités et en richesses, dépend tout entier du suprême pouvoir du roi, qui en est le chef naturel, aimé et obéi du peuple, et disposant d'une autorité absolue. Le roi de France est roi par nature, puisqu'il est ancien et non récent, et depuis mille ans et plus, aucune autre forme de gouvernement n'a été connue dans ce royaume. Il succède à la Couronne, non par élection, aussi n'a-t-il pas à briguer la faveur du peuple ; non par force, et par suite il n'a pas à être cruel et tyrannique, mais par l'ordre même que fixe la nature, de père à fils ou au parent le plus proche, avec exclusion des bâtards ou des femmes. Et, dit-il encore, ce sont toutes ces raisons, la longue habitude d'être gouvernés par des rois, la conscience qu'ils ont d'être nés pour leur obéir, qui expliquent l'attachement des Français à leurs souverains. Deux circonstances contribuèrent à cette grandeur et à cette puissance de la royauté : d'abord la lutte contre Charles-Quint et le rôle hégémonique que celui-ci réclama plus d'une fois, en vertu de son titre d'Empereur. Les théoriciens furent conduits par le sentiment de l'intérêt national à grandir le roi de France. Tous répètent avec insistance qu'il n'a pas de supérieur sur terre, qu'il est égal à l'Empereur. Un autre pouvoir prétendait également à une suprématie sur les princes : celui du Pape. Les jurisconsultes eurent la préoccupation constante de l'affaiblir, ils proclamèrent l'indépendance absolue du pouvoir temporel ; c'est là le sens du gallicanisme laïque. Il est certain qu'en élevant le roi si haut en face de l'étranger, on aboutissait à le mettre très au-dessus de ses sujets. La féodalité est anéantie, mais il existe une aristocratie dans cette France monarchique. La noblesse garde des immunités, des privilèges, des droits féodaux. Puis est apparue la classe ou caste des officiers, très nombreuse, qui se recrute dans le Tiers État : le Tiers participe de plusieurs honneurs et émoluments communs avec les nobles, à sçavoir de bénéfices grands, petits et moyens, offices de judicature, finances, comptes, secrétaireries : qui lui est grand avantage tant pour l'autorité que pour le profit. Encore peuvent-ils parvenir à l'estat de noblesse (auquel ils aspirent toujours) par grâce et privilège, en faisant quelque recommandable service à la république[68]. Il existe encore des forces de résistance à la royauté. Les parlements n'ont pas oublié leurs droits ni leurs prétentions. L'esprit provincial reste vivace, et, par endroits, l'esprit municipal. Les nobles ont gardé des ambitions et des espérances. La moyenne et la petite noblesse peuvent fournir des recrues et des chefs ambitieux et factieux, — on le verra pendant les troubles des guerres de religion ; — mais, au point où la royauté est montée, ces troubles ne seront que des accidents qui retarderont son progrès, pour le précipiter ensuite. D'ailleurs l'individualisme, qui est un des traits les plus caractéristiques du XVIe siècle, et qui a produit de grandes personnalités dans tous les genres, affaiblissait la nation en face de la monarchie en disséminant les éléments d'une opposition possible. Ce n'est donc point par la force d'institutions ou par l'effet de doctrines en contradiction avec ses prétentions que la royauté fut menacée. Sans les passions religieuses déchaînées, son progrès aurait été aussi régulier pendant la seconde moitié du siècle que durant la première. Bref, si l'on considère les conditions générales de la vie politique et sociale, au cours de cette période, on voit seulement se continuer l'œuvre depuis longtemps commencée : de la France du XVe à celle du XVIe, il n'y a pas rupture. Il n'y a pas non plus de révolution religieuse, puisque la France ne s'est pas convertie à la Réforme. Mais il y eut une vraie révolution, que les Français rapportèrent d'Italie, au lieu des conquêtes qu'ils y cherchaient : ce fut la Renaissance. Elle suscita tout d'abord un grand mouvement d'idées, un élargissement d'horizon pour les esprits, de nobles curiosités, la passion de savoir. On connut bien plus de choses du passé, on prit le sentiment de l'histoire, c'est-à-dire de l'activité humaine toujours en transformation ; on apprit que le monde était plus varié et plus vaste dans le temps, de même qu'il venait de se révéler plus étendu dans l'espace. On fut ainsi préparé à comparer, à raisonner, à juger ; et l'une des grandes nouveautés fut que la pensée devint surtout laïque, ou du moins que les domaines de la pensée laïque et de la conception religieuse furent séparés. C'est à coup sûr un grand siècle dans l'histoire de notre littérature et de notre art que celui de Rabelais, de Ronsard, de Montaigne, de Lescot, de Goujon ; leurs œuvres furent belles et sont durables. Mais bientôt la tendance exagérée à chercher dans l'Antiquité ou dans l'Italie la direction unique des intelligences a rétréci l'horizon, qu'avait élargi la Renaissance primitive ; le classicisme n'allait à rien moins qu'à supprimer tout ce qui n'était pas Rome ou la Grèce. La conception d'un beau idéal, placé en dehors des réalités, a jeté et retiendra pendant plus de deux siècles les esprits dans l'abstraction d'une doctrine immobile : le classicisme d'Henri II, celui de Louis XIV, celui du Premier Empire sont identiques dans leurs théories[69], et le Louvre pourra être continué dans le même esprit, à travers des générations séparées par des siècles. Puis la part énorme faite à la littérature et à l'art amenait à négliger ou à dédaigner toutes les autres préoccupations ; un dilettantisme naquit, d'autant plus hautain que les œuvres n'étaient faites et accessibles que pour une partie de la nation, celle qui se considérait comme une élite et voulait s'isoler de la foule. Ainsi se prépara l'honnête homme du XVIIe siècle, nourri dans le culte des anciens, formé par une éducation tout intellectuelle, propre à concevoir un certain idéal de beauté littéraire et artistique, mais fermé à toute conception qui n'était pas classique, peu curieux le plus souvent de connaissances scientifiques, aussi incapable de comprendre Shakespeare que de s'intéresser à Newton, indifférent aux problèmes politiques ou sociaux, dédaigneux des questions économiques et industrielles, isolé dans la sphère de la pensée pure et dans le monde antique où il s'enferme. Pour lui, l'Europe reste toujours celle des Grecs et des Romains, et l'Amérique n'a pas été découverte. Sans doute, pour juger cet élégant monde intellectuel, sur lequel, encore aujourd'hui, notre éducation concentre notre attention, il faut tenir compte des circonstances générales et, par exemple, du progrès de l'autorité royale, qui accapara toute la vie publique. Il reste vrai que le classicisme a formé des esprits dociles à cette autorité et les a prédisposés à de fâcheuses indifférences. Enfin, le latinisme dont toute la doctrine était pénétrée fit de Rome la grande école sociale et politique aussi bien qu'esthétique, et la France moderne méconnut pendant longtemps une partie de ses origines, oublia que ses institutions nationales venaient presque toutes du moyen âge, où se trouvaient peut-être quelques principes de liberté étrangers à l'impérialisme romain. La Renaissance, qui parait n'intéresser d'abord que l'éducation purement intellectuelle, aboutit donc à changer quelque chose dans notre histoire. Mais, dans ce XVIe siècle même, nous avons trouvé des œuvres qui ne contenaient point de beauté, qui n'étaient point pour satisfaire les intelligences éprises d'un idéal esthétique élevé, et qui pourtant ont contribué à rattacher la France du passé à celle de l'avenir ou à préparer obscurément l'esprit moderne. Le meilleur de Rabelais ou de Montaigne est dans le sens des réalités, qu'ils conservèrent, malgré leur éducation classique. Du Moulin est bien autrement voisin des rénovateurs du droit que Cujas ; Ramus est parent de quelques libres esprits du XVIIe siècle et des philosophes du XVIIIe ; les études d'histoire nationale de Pasquier, de Bodin, d'Hotman, annoncent Montesquieu et Rousseau. FIN DU TOME V-2 |