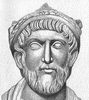JULIEN L'APOSTAT
PRÉCÉDÉ D'UNE ÉTUDE SUR LA FORMATION DU CHRISTIANISME
VI. — JULIEN PAPE. - OPPORTUNITÉ ET SUCCÈS POSSIBLE DE SA TENTATIVE. - ANALOGIE DE SON ÉGLISE AVEC CELLE DU MOYEN ÂGE.
|
Réformes tentées par Julien dans la religion, le clergé et le culte helléniques : s'il parait souvent avoir imité les chrétiens, c'est que ceux-ci ont imité les hellènes. — Différents moyens qu'il emploie pour détruire le christianisme : écrits, défense d'enseigner les auteurs classiques, charité, disputes entre les sectes, reconstruction du temple de Jérusalem. — Enthousiasme de l'empire pour Julien. En arrivant à l'empire, Julien se proposait deux buts, presque confondus dans son esprit, mais que la connaissance que nous avons des événements postérieurs nous permet de concevoir comme bien distincts : l'unité temporelle et l'unité spirituelle de l'empire. Au temporel, il voulait en finir avec les Perses comme il croyait en avoir fini avec les Germains, moitié par les victoires remportées sur eux, moitié par leur incorporation dans les troupes romaines ; il espérait ainsi assurer à l'empire une paix éternelle, et, tournant alors ses soins vers l'intérieur, centre d'une administration à la fois militaire, judiciaire, financière et même commerciale, il devait établir des impôts proportionnels, supprimer toutes les exemptions dont jouissaient les familles nobles, régler le prix des grains et des subsistances au profit du peuple, établir une loi et une procédure égales et uniformes pour tous, sans distinction de rang, de langue ni de climat, depuis l'Océan jusqu'à l'Euphrate. Au spirituel, il voulait, centre et souverain pontife d'un clergé hiérarchisé, achever l'assimilation déjà presque accomplie des dieux gréco-italiens avec ceux de tous les autres pays de l'empire ; bientôt après, commencer leur assimilation avec ceux de la Germanie, de la Perse et de tous les pays du monde, et, fondant une église vraiment catholique, faire de tous les dieux des nations les anges et les ministres du Soleil-Roi, dieu suprême en trois personnes ; principe des autres dieux et de tous les êtres, maître et gouverneur du monde idéal et du monde sensible. En poursuivant le premier de ces deux buts, Julien continuait à peu de chose près les idées de Trajan, de Marc-Aurèle et des plus célèbres empereurs romains ; ce rêve de monarchie universelle et d'unité politique et administrative a été aussi le rêve de plusieurs souverains, des plus grands parmi les modernes. Aussi convient-on généralement que ce projet, bien qu'il n'ait jamais pu s'exécuter, ne manque pas de grandeur ; plusieurs, encore aujourd'hui, pensent même que c'est le plus sublime qui puisse entrer dans la tête d'un homme, celui dont l'exécution serait le plus désirable. Ce côté de la vie de Julien est celui qui lui attire des éloges. Au contraire, on est convenu de trouver ridicule, ou au moins chimérique et bizarre, la tentative de Julien de fonder une église catholique et monothéiste, en continuant à vénérer les innombrables dieux des nations, en les transformant en anges et en bons génies, au lieu d'en faire des diables et de méchants démons, comme l'ont voulu les chrétiens. Je crois que le temps n'est pas loin où l'on changera entièrement d'avis sur son compte : en projetant d'établir au profit des empereurs et des dieux helléniques l'unité spirituelle qui s'est établie plus tard au profit des papes et des dieux chaldéo-juifs, il s'est élevé à une conception unique, qui fait de lui une figure unique dans l'histoire. Il nous conservait ainsi, cachées sous les broussailles de la théologie, la sagesse et la beauté antiques dont il a fallu, après tant de siècles, recueillir à grand'peine les restes à moitié défigurés par les chrétiens. Mais il était trop tard, la tradition était perdue ; ces restes précieux, les modernes n'ont su jusqu'à ce jour que les adorer sans les comprendre, ou les imiter platement, substituant une fausse inspiration antique à celle que le cours des âges nous aurait naturellement amenée si nous n'avions pas renié les dieux primitifs de notre race. Mais cette conception si haute et si opportune, Julien l'a rendue vaine en associant la cause de son église à la cause perdue de l'unité de l'empire. L'infériorité de Julien sur les coryphées du christianisme ne touche ni à la morale ni à la théologie, identiques chez lui et chez eux ; c'est une infériorité de position : général victorieux des barbares, il ne pouvait voir autrement qu'il a vu, tandis que les chrétiens ont toujours su séparer la cause de leurs dieux de celle de l'empire, prêts à se servir de la protection des rois barbares comme de celle des empereurs. Si le grand Hermès, qu'il évoquait dans ses nuits fiévreuses, au lieu de lui dévoiler les secrets des nombres, au lieu fie le ravir au ciel et de lui montrer que le mal n'est pas un principe réel incarné dans le diable, mais une dissonance qui concourt à l'harmonie générale, avait daigné le conduire comme un autre Énée dans les limbes de l'avenir ; s'il lui avait montré les barbares occupant l'empire malgré tant d'héroïques efforts et le coupant en morceaux, installant leurs grafions pillards et leur justice arbitraire là où il avait tenu son prétoire ; puis bientôt adorant ce qu'ils avaient brisé, à genoux devant la civilisation et le clergé des vaincus, prenant les Romains pour ministres et pour précepteurs, faisant apprendre à leurs enfants Horace et Virgile, regardant la pourpre consulaire, envoyée par le prince de Constantinople, comme la récompense suprême d'une vie de lutte ; enfin essayant vainement de sauver le monde de la barbarie qu'ils avaient faite ; sans doute Julien, comprenant que l'épée de Rome était brisée, subordonnant son titre d'imperator à celui de souverain pontife, se contentant de régner directement sur Constantinople et sur la Grèce, sa terre sainte à lui, aurait fait de son plein gré, avec dignité, ordre, profit, et sur une grande échelle, ce que ses successeurs furent forcés de faire sans dignité, mesquinement et trop tard. Il aurait établi par traité les barbares sur les terres incultes, et aurait fait de leurs rois ses préfets et ses ducs ; il les aurait placés non-seulement en Gaule, en Italie, en Espagne, pour raviver le sang des vieux peuples, comme cela a eu lieu sans lui, mais aussi en Asie, pour l'empêcher de mourir de consomption, dans ce Pont et cette Cappadoce, où les ermites seuls ont su fonder des colonies, en Mésopotamie, où ils auraient été un rempart indestructible contre les Perses et les Sarrasins. Délivrant ainsi l'Asie de l'islamisme, l'Europe de la nuit mérovingienne, il aurait d'emblée constitué le moyen âge et établi une unité spirituelle bien plus étendue que celle des papes, un arbitrage bien autrement puissant et bien autrement utile que le leur. Nul doute alors que le christianisme n'eût disparu de la terre. Quelques jours après son entrée à Constantinople, Julien ayant demandé un homme qui lui coupât les cheveux, on introduisit dans sa chambre un personnage en habit brodé. Julien le regarda avec étonnement. — Ce n'est pas un financier, dit-il, que j'ai demandé, mais un barbier. Puis il lui demanda ce que valait sa charge. Le coiffeur répondit qu'il avait vingt rations de table et vingt rations de fourrage, plus un bon traitement annuel, sans compter les gratifications. Julien, par ce seul exemple, jugea les dépenses de la maison impériale ; en regardant de plus près, il vit que tout était au pillage. Il congédia donc tous les maîtres coiffeurs, tailleurs, cuisiniers, dont il n'avait que faire ; un tondeur et un cuisinier de régiment, c'était tout ce qu'il lui fallait ; il pria les autres d'aller chercher fortune ailleurs. Pour les eunuques, il n'en voulut point un seul dans son palais. Il ne devait pas se remarier, disait-il, et il préférait des hommes complets, tels que Salluste et Oribase, pour lui servir de conseillers. Il ferma les yeux sur la vénalité des chambellans et sur les pots-de-vin qui les avaient enrichis, mais il fut inflexible pour le pillage des temples et fit rendre aux vils favoris d'Eusèbe les trésors sacrés avec les intérêts. Une fois la maison nette, Julien la repeupla à sa manière, et rendit l'aspect du palais plus somptueux et plus bruyant que jamais, mais d'une autre façon et pour d'autres motifs que Constance. Le palais était plein de colonnes précieuses, de statues d'or et d'ivoire enlevées à l'univers ; toutes ces dépouilles servaient à l'ornement des bains et des salles d'apparat. Julien transforma tout en chapelles ; il en bâtit partout dans ses vastes jardins étagés. Il rendit aux statues des dieux leur signification et leur importance en les plaçant sur des autels. Il remplaça les coûteux et délicats festins de Constance par des repas moins délicats, mais plus 'coûteux encore, où figuraient les vases et les tapis précieux, par d'immenses sacrifices où les bœufs, les oiseaux rares amenés à grands frais, étaient égorgés par centaine. Il ordonna des sacrifices extraordinaires dans tout l'empire : il était juste d'apaiser les dieux irrités par deux règnes d'athéisme. Il fallait conjurer leur colère prête à fondre sur les Romains. Pour lui, renonçant à la simplicité qui lui était chère pour faire honneur aux dieux, on le voyait couvert de soie et de perles, la tiare en tête, allant prier d'un temple à l'autre, égorgeant les victimes, interrogeant les entrailles, donnant au peuple et à farinée la communion de ses immenses sacrifices. Les cuisiniers, les coiffeurs, les eunuques, étaient remplacés par des prêtres et des prêtresses hellènes non moins richement vêtus. C'était son cortège habituel. Il marchait au milieu des danses sacrées et des hymnes. Il manda auprès de lui ses anciens camarades d'Athènes, tout ce qu'il y avait de rhéteurs et de théurges distingués, pour en faire les évêques de son église : Libanius, Écébole, Arsace, Théodore, Salluste, Priscus, Évémère, et surtout les deux hommes qui l'avaient initié, Maxime et Chrysanthe. Julien envoya une escorte magnifique pour amener Maxime et Chrysanthe de Sardes, où ils se trouvaient alors. Les deux théurges consultèrent immédiatement les dieux sur l'issue de ce voyage. Les signes qu'ils obtinrent étaient si effrayants, que Chrysanthe s'écria : Je n'irai pas, il faut plutôt m'aller cacher dans les entrailles de la terre. Mais Maxime, souriant de pitié, lui dit qu'il fallait faire violence aux dieux. C'est en effet la règle de la théurgie qu'on peut, en recommençant les opérations plusieurs fois, imposer sa volonté à l'avenir. Maxime, après plusieurs signes défavorables, en obtint de conformes à ses désirs, et partit plein de joie sans avoir pu décider Chrysanthe à le suivre. Son voyage de Sardes à Constantinople fut celui d'un prince ou d'un grand pontife ; les villes sortaient à sa rencontre ; on lui faisait habiter les édifices sacrés, où il était assiégé par les solliciteurs. Sa femme, aussi distinguée que lui, aussi experte dans les sciences divines, avait une cour de femmes et de prêtresses. Julien, qui avait repris vis-à-vis des curies l'attitude modeste des Antonins, était occupé à discuter dans le sénat de Constantinople, quand il apprit l'arrivée de Maxime. Il se mit à sauter de la façon la moins majestueuse, puis il sortit de la salle en courant. Il embrassa Maxime dans le vestibule à plusieurs reprises, puis il l'introduisit dans l'assemblée et le présenta officiellement aux sénateurs comme l'envoyé des dieux, sollicitant pour lui des respects qu'il n'avait jamais exigés pour lui-même. Maxime et Julien se mirent alors à exécuter le plan de réforme religieuse qu'ils méditaient depuis si longtemps, et à fonder l'Église qui devait être éternelle. Julien ne pouvait choisir un aide qui le complétât mieux. Maxime représentait l'hellénisme par son côté extérieur. Beau, séduisant, aimant le luxe, la parure, peu austère dans ses mœurs, il devait exceller à diriger des prêtres et des femmes, à rendre pompeuses et dignes les cérémonies du culte ; il devait frapper le peuple d'admiration ou de crainte par l'à-propos de ses miracles, il devait plaire surtout aux pays orientaux. Julien représentait l'hellénisme par son côté intérieur et nouveau. Théologien profond, interprète ingénieux et infatigable des anciennes légendes, moraliste austère, homme actif et chaste, toujours tourné vers la cité céleste, il devait plaire surtout à l'Occident et frapper de respect les Gaulois, les Espagnols et les Germains. Je vais m'étendre sur cette partie de la vie de Julien qui me parait de beaucoup la plus intéressante et la plus remarquable. Si les documents directs nous manquent souvent pour savoir au juste quel fut sous son règne l'état du clergé et du culte helléniques, trois genres de renseignements indirects nous permettent néanmoins d'arriver à la certitude. 1° Nous connaissons très-clairement par le discours sur le Soleil-Roi et par celui sur la Mère des dieux, comment Julien concevait le dogme hellénique. 2° Nous possédons des renseignements nombreux sur l'ancien culte des Grecs[1]. 3° Nous savons que Julien tenta d'établir au profit de l'hellénisme une hiérarchie ecclésiastique analogue à celle des chrétiens, et même de resserrer davantage les liens du clergé, en en soumettant les différents degrés à un véritable pape. La question se réduit donc à savoir comment, étant donné l'ancien culte hellénique, il put le transformer de façon à le lier à une théologie et à une église identiques à celles du moyen âge. Julien semble dans sa hiérarchie ecclésiastique avoir imité les galiléens ; cela est certainement vrai pour quelques détails, mais dans la plupart des cas il n'a eu qu'à suivre tes précédents de la religion hellénique. C'est parce que le clergé chrétien a puisé à la même source, l'Égypte, que l'église de Julien montre de si grandes analogies avec l'église chrétienne. Sa tentative est parallèle à celle des chrétiens et n'en procède pas. Les Grecs du beau temps n'avaient point à proprement parler de clergé. Comme tout citoyen était soldat, tout citoyen pouvait être prêtre. L'assemblée du peuple nommait les pontifes généralement pour un an, quelquefois pour un jour, pour une seule solennité. Ces hommes libres n'avaient pas besoin qu'une caste spéciale leur expliquât les mythes, car ils s'en souciaient peu, et préféraient à leur sens véritable les admirables broderies poétiques dont ils les avaient défigurés. Ils n'avaient pas besoin, comme les Égyptiens, de nourrir des prêtres qui s'occupassent exclusivement d'astronomie et de philosophie, car il y avait parmi eux assez d'hommes qui trouvaient le temps de s'en occuper, sans négliger pour cela la défense de la patrie, leurs devoirs de citoyen et de père de famille. Toutefois, si c'est là le caractère dominant de la civilisation grecque au temps de Périclès, que tout citoyen se croyait propre à tout, et était propre à tout, ce n'est pas le seul. En regardant d'un peu près, on ne tarde pas à remarquer un clergé que ses intérêts et sa vie propre séparent des autres citoyens, un véritable pouvoir spirituel avec lequel les magistrats doivent compter partout où se tiennent des oracles et des mystères célèbres. Or, ce qui était l'exception au temps de Périclès devint la règle générale dans tous les pays conquis par les Grecs, à partir des successeurs d'Alexandre. Toutes les villes importantes de l'Égypte, de la Syrie, de l'Asie Mineure comme de la Grèce, ont des oracles, célèbrent des mystères. En même temps s'établit partout une hiérarchie ecclésiastique à peu près uniforme, et que les chrétiens ont imitée. A la tête de l'église d'une ville, d'une province, est le hiérarque ou hiérophante, nommé à vie par la cité ou par le roi, quelquefois voué au célibat comme l'hiérophante d'Athènes ; véritable évêque[2] dont le pouvoir est moitié temporel, moitié spirituel, trait d'union entre le clergé et les principaux citoyens avec lesquels il dirige les biens ecclésiastiques ; c'est lui qui fait les sacrifices, qui invoque et remercie les dieux dans les cérémonies officielles. Quand le temps d'un mystère est venu, c'est lui qui en lit solennellement le règlement ; c'est lui qui y mène le peuple et qui en dirige souverainement la célébration. Au-dessous de l'évêque sont les prêtres, nommés également à vie ; chacun est attaché à un temple spécial, en habite l'enceinte, y. remplit les cérémonies journalières. Sauf quelques privilèges réservés au hiérarque, ces prêtres ont le droit de faire tout ce qu'il fait : ils offrent les sacrifices, communiquent les réponses des oracles, dirigent les fidèles dans l'accomplissement des diverses purifications, célèbrent les naissances, les mariages, les retours, les obsèques, soit dans le temple, soit dans les chapelles domestiques des simples particuliers. C'est parmi les principaux d'entre eux que l'hiérophante choisit ceux qui célébreront avec lui les mystères et représenteront les différents personnages divins qui y paraissent. Au troisième degré de cette hiérarchie sont des personnages sacrés désignés sous divers noms (liturges, diacres, curotrophes, hydranes), attachés spécialement aux basiliques où se célèbrent les mystères. Ils remplissent exactement les mêmes fonctions que les diacres dans la primitive Église, où ces personnages avaient une importance beaucoup plus grande que dans l'Église actuelle, et souvent plus grande que celle des prêtres, bien qu'ils n'eussent pas le droit d'accomplir toutes les cérémonies du culte. Ces diacres hellènes sont chargés de l'éducation préparatoire de tous ceux qui veulent se faire initier, nous dirions aujourd'hui qui veulent recevoir les sacrements. Ils les mettent en état de comprendre les faveurs célestes qu'ils vont être appelés à recevoir par l'entremise des prêtres. Les hellènes comme les galiléens, avaient aussi emprunté à l'Égypte : les moines. Parmi ces moines hellènes, les uns formaient des couvents annexés à un temple ; entièrement reclus, vivant saris travail manuel des biens ecclésiastiques, comme nos chanoines, ils passaient leur vie dans les exercices de piété, la méditation et l'étude des diverses sciences sacrées. D'autres, aussi bien que les moines de Saint-Antoine, avaient peuplé les déserts et formé des colonies où ils subvenaient eux-mêmes à leurs besoins. Enfin, une institution qui se répandit dans tous les pays de l'Orient depuis les successeurs d'Alexandre, et plus tard dans tout le monde romain, fut celle des synodes ou églises. Les hellènes appelaient ainsi des associations de fidèles des deux sexes réunis sous l'invocation d'une divinité particulière. Ils célébraient en l'honneur de leur patron des fêtes à frais communs, ils essayaient de propager son culte ; outre les cérémonies publiques, ils se livraient à des pratiques secrètes où les membres de l'église étaient seuls admis. Les différentes églises dont il est parlé dans les épîtres sont des associations de cette sorte en l'honneur du Christ. Julien, trouvant le clergé hellénique ainsi établi de temps immémorial, n'eut pas à le créer, mais à le réformer et à le régulariser. Il mit les hiérarques sous l'autorité de hiérarques provinciaux dont il se réserva la nomination[3]. Il généralisa l'institution des moines et en annexa à tous les temples ; voulant en faire des docteurs ès-sciences sacrées, il leur fit dépouiller les archives du temple, et exigea d'eux des manuels de divination, de théurgie et d'astrologie qui pussent servir de règle aux prêtres. Enfin il encouragea par des dons et des privilèges la fondation de nouvelles églises : encourager les hellènes dans des cultes spéciaux et secrets, c'était neutraliser l'action des prêtres chrétiens sur les femmes. S'il s'éloignait de l'esprit des galiléens par le rôle qu'il donnait aux moines, il s'en éloignait encore plus par celui qu'il donnait aux femmes. A mesure que l'influence de la femme sur les sens de l'homme, et par conséquent son influence réelle dans la société, s'était accrue dans le monde grec, elle avait été moins estimée et on l'avait jugée moins digne de remplir des fonctions religieuses. Les prêtres galiléens de toute secte avaient obéi à l'esprit nouveau. Quoiqu'ils s'appuyassent partout sur les femmes, qu'ils commençaient par convertir afin qu'elles obtinssent au moins la neutralité de leurs maris, et qu'elles élevassent chrétiennement leurs enfants ; quoiqu'ils se servissent d'elles plus particulièrement pour accomplir les miracles sur les tombeaux des martyrs, qu'ils les montrassent au peuple agitées de saintes convulsions où la présence de la divinité était visible, racontant des songes merveilleux, rendant des oracles qui annonçaient le triomphe du Christ et la chute prochaine de ses ennemis, il les avaient jugées indignes, par la faute dive, de recevoir les saints ordres et ne leur donnaient pas de rôles dans la célébration des mystères. Julien, malgré son peu d'estime pour la femme en général, fut forcé par la tradition hellénique de maintenir la prêtresse à côté du prêtre. Il choisit des femmes instruites et d'un caractère ferme, qui sous Constance avaient résisté aux sollicitations et aux flatteries, puis plus tard aux menaces de mort des prêtres chrétiens. Il leur recommande le célibat sans le leur ordonner. Pénélope, leur dit-il, est devenue immortelle pour sa fidélité à son époux : qui oserait mettre cette fidélité en parallèle avec la fidélité à un époux divin ? Toutefois, il ne semble pas avoir élevé la femme jusqu'à la dignité hiérarque, prenant un moyen terme entre les chrétiens qui, ayant chassé les femmes du chœur, furent bientôt forcés de les remplacer par des eunuques, et l'ancienne organisation grecque, qui leur donnait un rôle aussi important que celui des hommes. Julien dut facilement trouver dans la société romaine, pour occuper les différents degrés de son clergé, des hommes d'une valeur égale à celle des prêtres galiléens, des hommes dont l'état philosophique et moral est assez bien représenté par celui d'Ammien Marcellin, l'historien à la fois enthousiaste et impartial de Julien, en qui plusieurs critiques modernes ont vu un chrétien parce qu'il professe les vertus et les maximes que nous avons pris l'habitude d'appeler chrétiennes. Il ne faut pas juger les prêtres hellènes par les reproches que Julien leur adresse. Voyez les exhortations des Pères : ils blâment sans cesse la tiédeur de leurs adhérents, au moment même où la ferveur des chrétiens a été la plus grande et où leur nombre augmentait chaque jour. Quelque zèle qu'on montrât pour les dieux, le souverain pontife trouvait qu'on n'en faisait jamais assez. Julien recommande à son clergé de pratiquer et de prêcher l'aumône, comme le plus sûr moyen d'attirer sur soi les faveurs célestes. Qu'on me montre, dit-il, un homme qui se soit appauvri par ses aumônes.
Les miennes m'ont toujours enrichi malgré mon peu d'économie... J'en ai fait
souvent l'épreuve lorsque j'étais particulier. En partageant avec les pauvres
le peu que j'avais, je retirai des mains des usurpateurs la succession de mon
aïeul. Donnons donc à tout le monde, plus libéralement aux gens de bien, mais
sans refuser le nécessaire à personne, pas même à notre ennemi : car ce n'est pas aux mœurs ni au caractère, c'est à l'homme que nous
donnons. Cette charité de Julien était sincère, sa conduite de particulier l'avait prouvé ; il la devait non à son éducation arienne, comme on l'a dit, mais à l'esprit général du temps ; il avait en outre pour encourager l'aumône chez les hellènes des motifs de rivalité dont nous parlerons tout à l'heure. Quant au culte, Julien adopta les nouveautés introduites par les chrétiens, tout en conservant côte à côte et intégralement l'ancien culte. L'originalité des chrétiens avait été de confondre la basilique et le temple, l'originalité de Julien consistait à les maintenir distincts tout en donnant à chacune de ces deux formes du culte le plus de développement possible. Tout en se préoccupant de l'avenir, il ne voulait pas rompre avec le passé ; dans les formes extérieures de la religion comme dans son dogme, il ne voulait pas briser avec la tradition hellénique. Ce que les anciens Grecs appelaient un temple, ou plutôt une demeure sacrée, une demeure divine, n'était pas un seul bâtiment, comme les églises actuelles de nos villes, mais un tout fort complexe, le plus souvent situé hors de la ville, ou formant à lui seul avec ses annexes une petite ville. Outre le temple proprement dit, qui était toujours très-petit comparativement aux nôtres, ne renfermant essentiellement que la statue du dieu qui lui donnait son nom et un autel, divers bâtiments dispersés s'étendaient à l'entour. C'étaient des autels couverts ou en plein air, consacrés à d'autres divinités dont le culte était associé à celui du dieu principal, soit par nature, soit par des circonstances purement locales[4] ; c'étaient des chapelles de famille, des chapelles où étaient conservées les reliques des héros, celle où siégeait l'oracle, les habitations de plusieurs prêtres et des suppliants, enfin les lieux où étaient placés les objets du culte, les oiseaux, les richesses sacrées, les dépôts que les fidèles mettaient sous la garde des dieux. Le tout était enfermé dans une vaste enceinte, le plus souvent fortifiée ; sur la partie extérieure se trouvaient encore des autels banals pour les étrangers et pour tous ceux qu'une impureté quelconque exilait de l'enceinte sacrée. Tous ces bâtiments étaient généralement étagés sur une colline dont le temple occupait le sommet afin que de loin il frappât seul la vue. A mesure que les cités grecques devenaient plus florissantes, les temples s'enrichirent et s'agrandirent, on se mit à resserrer les annexes dans l'intérieur ; des ex-voto et des statues de toute sorte furent rangés autour de la statue principale, d'autres autels à côté du maître-autel ; mais le temple resta toujours un sanctuaire réservé aux prêtres, aux magistrats, aux citoyens qui y venaient sacrifier. Les jours de fête, la foule entrait seulement dans la première enceinte et restait en plein air. Quand le temple était hors de la cité, comme celui de Daphné, près d'Antioche, et celui d'Eleusis, cette enceinte sacrée présentait l'aspect d'un vaste jardin, qui avait souvent près d'une lieue de tour. Des escaliers de marbre, des simulacres de toute sorte, rappelant les idées et les cultes les plus variés, des bosquets en fleur la décoraient avec un grand luxe ; c'était là que se célébraient les danses sacrées et les repas en l'honneur des dieux. En dehors de l'enceinte, le temple avait encore des dépendances considérables. C'étaient des bois sacrés d'oliviers, d'orangers et de figuiers qui servaient d'avenues pour arriver au temple, des eaux merveilleuses, renommées pour la guérison des maladies ou pour les qualités qu'elles donnaient à l'intelligence, de vastes pâturages où erraient en liberté les troupeaux du dieu. Là encore se dressaient des statues et des autels. Enfin, pour quelques temples privilégiés, la principale de ces annexes était l'endroit où se célébrait le mystère. On le choisissait d'ordinaire, non sur une hauteur comme le temple, mais dans un lieu bas, quelquefois dans une caverne, pour se dérober aux profanes. Plus tard, à mesure que le nombre des initiés s'accrut, on en fit des espèces de théâtres pouvant contenir un grand nombre de personnes ; bientôt on voulut les couvrir, on en fit des vastes hangars, puis on donna peu à peu à ces hangars un aspect monumental et on les transforma en basiliques. Nous l'avons dit : à mesure que l'importance politique des Grecs avait diminué, l'importance et le nombre des mystères avait augmenté, mais jamais au point que la basilique fit disparaître le temple. Ce que les hellènes n'avaient pas fait, les galiléens voulurent le faire ; pénétrés de la sublimité de lin-carnation et de la Rédemption, la représentation théâtrale de la naissance, de la mort et de la résurrection du Christ devint le fond de leur culte ; ils ne voulurent point d'autres solennités, et ils n'offraient plus d'autre sacrifice à la divinité que celui du Sauveur. Tant que les galiléens formèrent des sociétés secrètes, des églises dans le sens païen du mot, la basilique leur suffit ; outre la représentation des mystères, ils y pouvaient tenir leurs conseils et y instruire leurs catéchumènes ; mais dès qu'ils s'accrurent en nombre et en puissance, depuis surtout qu'ils étaient devenus religion officielle, et que le culte, outre les cérémonies purement religieuses, dut présider à tous les actes importants de la vie civile, la basilique ne leur suffit plus. Les basiliques d'alors avaient la même disposition intérieure que la Bourse de Paris ; non-seulement on n'y pouvait célébrer qu'une messe à la fois, dans le chœur, mais encore les basses messes n'existaient point. Les messes, ou plutôt les mystères du Messie, avaient la même forme que le mystère d'Éleusis, que nous avons décrit au chapitre IV ; c'était un ensemble de cérémonies qui duraient plusieurs jours, et toujours une solennité extraordinaire. Les prêtres galiléens eurent beau multiplier ces sortes de représentations, en s'emparant de tous les objets que pouvait fournir la vie de Jésus et de sa mère, ils purent à peine en trouver une trentaine ; le reste du temps, c'est-à-dire plus de deux cents jours-dans l'année, le culte dans la basilique chrétienne se réduisait à des chants de psaumes, à des sermons et des lectures en commun. Il n'était pas possible de lutter avec cette nudité contre la multiplicité et la majesté des cérémonies qui se célébraient dans les temples helléniques, et pour lesquelles les peuples du Midi ont conservé un goût traditionnel. D'ailleurs, dans la basilique primitive, rien ne correspondait à des cérémonies de baptême, de mariage, d'enterrement, et généralement à toutes les fêtes tristes ou gaies de la famille. Il fallut donc que les galiléens, qui avaient méprisé le temple, le refissent ou du moins inventassent quelque chose d'analogue. Ils y arrivèrent naturellement et sans dessein prémédité par le culte des saints tombeaux. L'importance de ce culte chez les galiléens était une conséquence naturelle de leur légende de l'Homme-Dieu ; tant qu'ils furent persécutés, ce fut autour des tombeaux, dans (les gorges et des souterrains qu'ils célébraient leurs mystères. De même que les basiliques étaient apparues dans le culte hellénique comme annexes des temples, elles étaient apparues dans le culte galiléen comme annexes des saints tombeaux. L'assimilation entre les tombeaux et les temples s'établit d'autant mieux, que très-souvent les tombeaux étaient d'anciens temples qu'au jour de leur triomphe les galiléens avaient envahis, et dont ils avaient chassé violemment le dieu pour mettre, au-dessus et derrière l'autel, la statue et les reliques du saint, nouveau patron de la cité. Plus ces patrons étaient d'ancienne date, plus le récit de leur vie terrestre devenait un tissu de miracles, auxquels s'ajoutait la longue liste de ceux qu'ils avaient faits depuis leur mort au profit de leurs anciens compatriotes et de tous ceux qui venaient visiter leurs tombeaux et les orner de riches offrandes. Dans ces tombeaux transformés en chapelles, on déposait sur l'autel des viandes et diverses provisions de bouche[5] qu'on mangeait ensuite en commun, c'est-à-dire qu'on offrait au saint des sacrifices qui ne différaient point des sacrifices païens. Dans l'enceinte qui entourait la chapelle, analogue à l'enceinte du temple que nous avons décrite, on plaçait les tombeaux des personnages dont la piété avait enrichi l'église, et ceux de martyrs et de saints d'une dignité moindre. Cette enceinte était le théâtre de toute la partie superstitieuse et merveilleuse du galiléisme ; les fidèles, agités par quelque violent désir qu'ils n'eussent pu accomplir par leurs propres forces, ou dévorés par une vague inquiétude, venaient en foule y dormir, après une longue privation de nourriture. Le saint leur apparaissait en songe, leur dévoilait l'avenir, leur dictait une règle de conduite, ou leur faisait quelque don qui leur permettait d'échapper à leurs ennemis ou de s'en débarrasser. Au réveil, beaucoup prophétisaient ou entraient en convulsions, surtout les femmes. Ces spectacles, où la foule encore païenne était admise, étaient la cause de nombreuses conversions. La plupart des mariages, des baptêmes, des cérémonies funèbres se faisaient aux saints tombeaux ; ils étaient aussi le théâtre de fêtes tout à fait païennes et de danses : dans le Midi, les tombeaux s'entourent rapidement d'une végétation si charmante, qu'ils sont des rendez-vous de promenades et de repas. On voit que Julien, en conservant le temple distinct de la basilique, s'éloignait beaucoup moins qu'il ne semble au premier abord du culte chrétien de son temps. Si au moyen âge le culte des saints tombeaux se confond avec celui de la basilique, devenue cathédrale et entourée de nombreuses chapelles latérales dédiées aux saints, il faut attribuer cette transformation insensible, non à quelque influence propre à l'esprit chrétien, mais à diverses causes, parmi lesquelles se place la nécessité de mettre les fidèles à couvert dans les pays où l'hiver est long et rigoureux. Supposé que l'hellénisme eût triomphé en France, en Allemagne, en Angleterre, nous n'en aurions pas moins eu l'architecture romane, puis la gothique. Car il ne faut pas se figurer les temples que Julien voulait élever, et dont un règne de deux ans ne lui laissa pas jeter les fondements, comme des imitations du Parthénon ; depuis longtemps la mode était changée, et les Romains avaient construit des temples à dômes. Les dômes plaisaient alors, non-seulement dans l'empire, mais aux Indes et dans toute l'Asie supérieure. Comme les saints tombeaux des chrétiens, les temples de l'hellénisme auraient rappelé les temples bariolés des bouddhistes. Au goût, à l'harmonieuse simplicité de la Grèce antique aurait succédé le monstrueux et le symbolique. Les frises extérieures auraient représenté, au lieu de calmes processions, des figures grimaçantes, des légendes bizarres, comme les bas-reliefs de nos cathédrales. Il faut en dire autant des statues en ronde-bosse placées sur les autels : sans doute les hellènes n'eussent pas brisé systématiquement, comme l'ont fait les chrétiens par fanatisme, les chefs-d'œuvre de la statuaire antique, et un plus grand nombre d'entre eux seraient parvenus jusqu'à nous ; mais les hellènes n'y auraient attaché aucun prix, ils les auraient peu à peu fait disparaître des temples, parce que depuis longtemps les belles nudités leur paraissaient indécentes et peu propres à exciter le sentiment religieux. Un grand nombre aurait péri par négligence ; celles dont la matière était précieuse n'en auraient pas moins été volées et brisées. En moins de deux siècles, malgré le triomphe de l'hellénisme, les temples à deux frontons et à colonnes construits sur l'ancien modèle, les statues de beau style et de proportion non gigantesque auraient été remplacés par des édifices de style byzantin, par des statues habillées et peintes. Ainsi dans les arts, comme en philosophie et en poésie, le goût du moyen âge n'eût pas été sensiblement modifié par le triomphe de Julien. Mais Julien, au lieu de détruire et de maudire l'antique, l'eût enterré et scellé avec pompe et piété ; et l'humanité, au sortir de sa longue hallucination, aurait pu le faire sortir moins défiguré de son tombeau. Julien conserva dans les temples les oracles, bien qu'il avoue que de son temps les dieux en étaient avares. C'était du reste un mode de divination qu'il n'aimait pas. En haine des chrétiens, qui en abusaient près des sépulcres, et à cause de sa foi toute scientifique, il n'aimait pas ces convulsions, ces réponses à moitié inintelligibles, et surtout cette inspiration toute de hasard et de chance sur laquelle on ne pouvait régulièrement compter. Il préférait la divination obtenue d'après des règles qu'il croyait certaines, par le vol des oiseaux, les sorts, les tables astrologiques, les entrailles des victimes. Les prêtres hellènes, en consultant les livres que Julien avait fait faire par ses moines, pouvaient toujours rendre une réponse aux fidèles, et surtout, ce qui pour l'élève de Maxime était le point capital, ils pouvaient violenter les dieux en recommençant plusieurs fois les opérations et imposer leur volonté à l'avenir. Par ce seul fait que l'exercice de cette divination demandait un profond savoir, l'hellénisme ne pouvait en user qu'avec modération, et Julien ne permettait les prédictions qu'aux hiérarques, ou à quelques prêtres célèbres par leur science hiératique. Cette superstition établie systématiquement dans le sanctuaire, et qui au premier abord semble n'avoir pas d'analogue dans le christianisme, jette aujourd'hui beaucoup de défaveur sur la réforme religieuse de Julien. On ne réfléchit point que les réformateurs religieux vraiment intéressants et importants en histoire ne sont pas ceux qui ont, comme on dit, devancé leurs contemporains, mais ceux qui ont su donner aux croyances de leur époque la satisfaction la plus complète en même temps que la tendance la plus morale. Il ne s'agit pas, en cette question, de discuter si l'homme peut ou non, par certaines pratiques et certains agencements de syllabes, découvrir l'avenir, se mettre en communication avec les esprits, et les forcer d'obéir à ses ordres, mais si, au temps de Julien, la foi dans les opérations théurgiques était assez générale pour qu'il fût nécessaire de compter avec elle. Il n'y a point à hésiter sur la réponse : non-seulement une telle croyance était alors générale, mais universelle. Il n'y avait pas un homme distingué dans tout l'empire qui en fût exempt. Celle des galiléens ne se distinguait de celle des juifs, des gnostiques, des hellènes, qu'en ce qu'elle était moins scientifique, et que les plus ignorants parmi eux se mêlaient de prédire et de conjurer. Les ariens donnaient surtout dans les songes, et ils condamnaient la divination par le vol et les sorts. Athanase, au contraire, croyait que Dieu lui faisait connaître sa volonté par le vol et les sorts[6]. Julien se trouvait donc agir, sans s'en douter, avec une habileté supérieure en réglementant la théurgie et la divination ; il la maintenait dans des bornes étroites, en faisait une puissance entre les mains des sages et les empêchait de devenir nuisibles, tandis que les chrétiens, en ne les réglementant pas, en les abandonnant à la fantaisie ou à la supercherie du premier venu, en les considérant tantôt comme des dons de Dieu, tantôt comme des dons du diable, en ont fait la plus laide des plaies sociales et un prétexte constant de persécutions qui, jusqu'au milieu du dix-septième siècle, a frappé des victimes de plus en plus nombreuses. Julien voulait établir dans toutes les villes des basiliques pour les mystères helléniques, et en augmenter le nombre dans les cités qui en possédaient déjà. Ces mystères, tous différents les uns des autres par les détails et les noms divins qui y étaient prononcés, peuvent se classer cependant en trois espèces, correspondant aux cérémonies et aux légendes de Noël, de Pâques et de l'Assomption. La première espèce célébrait l'incarnation du Verbe dans le sein de la nature, la naissance du Sauveur et les bienfaits de son séjour sur la terre. Julien prit pour type le mystère de Pessinunte[7]. La deuxième espèce célébrait la mort, la descente aux enfers, puis la résurrection du Sauveur et les lamentations de la Mère des douleurs. Julien prit pour type les grandes Éleusinies. La troisième espèce, qui roulait d'ailleurs sur le même fonds de légendes et d'idées, célébrait plus particulièrement la nature, la vierge mère, le principe fécondé, la gloire de la déesse qui disait dans les mystères égyptiens : Le fruit que je porte est le soleil[8]. Elle célébrait la déesse des moissons, de l'agriculture, de l'enfantement, et aussi de la science. Julien prit pour type les mystères d'Isis et de Diane Éphésienne. Outre ces mystères destinés à glorifier les trois principaux types divins de l'hellénisme, il y en avait une foule de petits en l'honneur des génies et des dieux intermédiaires, patrons des cités. A mesure que la fête d'une de ces divinités arrivait, on donnait la représentation théâtrale des légendes locales ou générales dont elle était l'objet, comme les galiléens le faisaient en l'honneur des saints. Les dieux intermédiaires de l'hellénisme sont analogues à nos saints, et Julien opposait les miracles qu'ils faisaient et les oracles qu'ils rendaient en certains lieux consacrés, aux miracles des saints tombeaux. Telle est, dans l'ensemble de son culte et de son clergé, la religion que Julien voulait opposer au galiléisme et que le temps lui permit à peine d'esquisser. Pour la théologie hellénique, nous avons montré qu'elle était identique à la théologie chrétienne, il nous reste à parler des moyens directs que Julien employa pour extirper le galiléisme, et du genre de persécution qu'il fit subir aux galiléens. Ce fut d'abord par des écrits, où il essaya de les convaincre d'ignorance, de superstition et de mauvaise foi. Nous ne connaissons que des fragments de l'ouvrage qu'on appelle vulgairement la Défense du paganisme, et qui serait beaucoup mieux nommé : Réfutation du judaïsme et du galiléisme ; mais comme Cyrille avait recueilli ces fragments dans tout l'ouvrage pour le réfuter, ils peuvent nous donner une idée juste de l'ensemble. Les arguments de Julien seraient peu capables d'ébranler un chrétien de nos jours, ils nous paraissent souvent bizarres, mais ils étaient merveilleusement propres à frapper les contemporains, dont l'état philosophique n'était point du tout celui des chrétiens actuels ; ils ramenèrent à la religion paternelle beaucoup de chrétiens hésitants qui, sous Constance, s'étaient convertis autant par complaisance que par intérêt, et ils blessèrent profondément les Pères chrétiens. Il commence par attaquer le Pentateuque, qu'il attribue sans hésitation à Moïse, ce qui prouve que dès lors cette opinion était admise sans conteste. Selon Julien, l'infériorité du législateur des Juifs sur les législateurs des Grecs et des Romains lui vient de ce qu'il a mal connu la nature des anges ou dieux intermédiaires. Cette ignorance l'a mené à des impiétés et à des immoralités de toute sorte ; le peuple façonné par lui a donc ignoré le droit, la morale privée, la douceur envers l'étranger, et, comme la connaissance des dieux intermédiaires est nécessaire pour s'élever à la conception de l'ordre dans l'univers, le peuple juif, qui n'a jamais connu le Cosmos, n'a pu avoir aucune idée de la proportion, de l'harmonie et de la beauté. L'ignorance de Moïse en ce qui concerne les anges ou dieux intermédiaires éclate dès les premières pages de la Genèse ; on voit qu'il sait leur existence, mais il ne possède sur eux aucun détail précis et n'en parle qu'en masse. Son récit de la création peut se réduire à ceci : Le démiurge dit : Que les choses soient ; et les choses furent. Voilà qui était bien difficile à énoncer ! Qui doute qu'en effet tout ce qui existe n'ait été engendré par un premier principe ? Mais ce qui était difficile à dire, et que Moïse ignorait, c'est comment ce principe a agi pour créer l'univers, et comment, étant parfait et un, il a pu engendrer un monde imparfait et plein de diversité. Il fallait nous donner non la création en gros, mais tout le détail, comme le font les Grecs, et appuyer chaque fait de preuves tirées de la nature des choses ; car, si l'on ne prend cette peine, on n'écrit que pour des enfants. Si Moïse l'avait prise ; si, au lieu de maudire les étrangers, il avait été chercher chez eux la science qui lui manquait, il n'aurait pas ignoré que la création du monde matériel présuppose dans l'ordre des causes la création d'un monde immatériel, des dieux et des génies. Il aurait raconté à son peuple comment le démiurge a fait sortir de son sein d'abord le Verbe, et ensuite tous les esprits, auxquels il a donné le gouvernement des diverses parties de la terre et du ciel. Il eût ainsi préservé son peuple de l'erreur qui l'a rendu l'opprobre des nations. Car Moïse, n'ayant point connu la distinction parfaitement nette qu'il importe d'établir entre le démiurge et les génies, a bientôt confondu le génie d'Israël avec le démiurge, et le génie d'Israël, flatté de cette erreur, a tout fait pour y entretenir le peuple préposé à sa garde. Un génie est sans doute un être supérieur à l'homme, mais il est encore plus éloigné du démiurge. Celui-ci est parfait, toujours identique à lui-même ; il ne connaît aucune passion ; un génie, au contraire, est jaloux des hommages qu'on lui rend, irrité de ceux qu'on rend à ses collègues, mal disposé pour l'étranger. Il y a d'ailleurs des génies de différents degrés, et celui d'Israël est un des plus infimes, à en juger par, le peu de puissance qu'il a su donner à son peuple. Moïse, convaincu que le génie d'Israël n'est autre que le démiurge, prête à ce dernier les sentiments les plus contraires à sa nature ; il parle de son courroux, de sa vengeance, des massacres qu'il ordonne, et enfin du choix spécial qu'il a fait du peuple juif pour le diriger à travers les nations, comme si la Providence n'avait pas la même justice et la même affection pour tous les peuples. Moïse, inspiré par le génie d'Israël, ordonne à son peuple de ne point adorer les dieux des nations ; et plus tard, les prophètes juifs, sans se laisser désabuser par tous les malheurs qui frappent Israël, déclarent que les dieux n'existent pas, hors le Dieu d'Israël. — Voilà l'erreur infâme, l'idée d'exclusion et d'intolérance que les galiléens ont prise aux Juifs. Si elle vient à dominer dans l'empire, qui doute que les génies des diverses nations que nous allions aujourd'hui dans nos prières ne se tournent contre nous quand ils verront que nous n'avons d'hommage que pour un d'entre eux ? Qui douté même que les dieux incapables d'envie, mais susceptibles de punir les offenses, qui contemplent sans cesse le Parfait, ces génies supérieurs que le démiurge n'a pas proposés à la garde spéciale d'une nation, mais qu'il a chargés de gouverner les célestes sphères et les affections de l'âme, ne cessent de nous envoyer leurs dons quand nous ne les demanderons plus ? Mars ne nous apprendra plus l'art militaire, et nous serons, comme les Juifs, vaincus et traînés en captivité ; Minerve et Jupiter ne nous apprendront plus la justice et la politique, Apollon la musique, Cybèle et Vénus les secrets de la génération ; Mercure ne nous introduira plus dans le monde des idées et des formes ; vil troupeau sans lois, sans arts, sans sciences, sans espérance dans la vie future qu'une grossière résurrection de notre chair, nous n'aurons pour tout renseignement que le Décalogue dicté à Moïse par le génie d'Israël : Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère ; banalités de morale que nos pères, dès le temps de Romulus, avaient déjà écrites et commentées, et qu'on trouve partout. — Encore si ces galiléens, qui nous ont abandonnés pour exalter Moïse, suivaient sa loi ; mais ils en retranchent et y ajoutent suivant leur fantaisie, de sorte qu'on ne peut avoir aucune foi en eux. Le culte des Juifs, tout pitoyable qu'il est, ne manque pas de grandeur dans ce qu'il a de commun avec celui de tous les autres peuples de la terre. Les Juifs ont toujours honoré les dieux par des sacrifices d'animaux, ainsi que de tout temps les hommes ont honoré les dieux ; il est même dit expressément dans la Genèse qu'Abel est préféré à Caïn, parce que celui-ci n'offrait à la Divinité que des végétaux, tandis qu'Abel offrait des animaux. Néanmoins les galiléens ont cru devoir condamner ces sacrifices, et n'offrent à 'durs dieux que du vin et des gâteaux. Moïse dit que Dieu faisait connaître sa volonté à Abraham, soit par les entrailles des victimes, suit par l'état des astres[9], soit par le vol des oiseaux, et les galiléens condamnent ces pratiques chez les hellènes, bien qu'eux-mêmes s'y adonnent en secret. — Enfin plusieurs usages des Juifs, tels que l'abstinence de certaines viandes, la circoncision, ils ne les suivent pas ; bien que Moïse, qu'ils disent inspiré de Dieu, les ait pourtant ordonnés. C'est qu'ils s'inquiètent peu d'être conséquents, pourvu qu'ils trompent et flattent le vulgaire. Pour réussir, ils modifient la loi à leur volonté. C'est, par exemple, ce qu'ils ont fait quand ils ont pris aux hellènes le dogme du Verbe et de la lumière incréée, quoique contraire à l'opinion de Moïse, qui dit constamment qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et qui, lorsqu'il parle du Christ, loin de dire qu'il sera un dieu, dit que le Christ sera un prophète comme lui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Julien attaque encore les chrétiens par des arguments que beaucoup d'autres ont employés après lui et que je me dispenserai de répéter. Il essaye de montrer qu'ils ont rapporté au Christ une foule de passages qui ont trait, non pas au Christ, mais seulement à des circonstances particulières à l'histoire et aux mœurs des Juifs, et ensuite de prouver que les paroles des apôtres sont le plus souvent contradictoires entre elles et avec celles de Jésus, et que, depuis les apôtres, les galiléens ont encore ajouté à cette confusion ; puis il s'écrie : — Enfin, ces galiléens superbes qui refusent d'adorer les dieux, de se servir des différents moyens qu'ils nous ont donnés de prédire l'avenir et de le modifier, à quelle abjection ne sont-ils pas descendus ! Ce pouvoir qu'ils refusent aux dieux, ils l'accordent à des hommes ou plutôt à des cadavres. On les voit en foule aller dormir près des tombeaux, afin d'avoir des songes merveilleux dont ils prennent ensuite pour guides les prétendus enseignements, et c'est pour la plupart des galiléens tout le sérieux de la nouvelle religion. Quelque sensibles qu'aient été les galiléens à ces attaques qu'ils ont essayé de réfuter pied à pied, et dont ils ont plus tard fait disparaître le texte, un autre coup que leur porta Julien les blessa davantage, et contribua plus que tout autre à faire de lui un monstre à leurs yeux. C'est la défense qu'il fit à tout galiléen d'ouvrir école et d'enseigner les auteurs classiques. Selon Julien, les hellènes seuls avaient besoin de parler purement la langue grecque, afin de pouvoir comprendre les anciens et trouver dans le passé des preuves à l'appui de leurs croyances ; mais c'était une duplicité honteuse, un trafic contraire à l'honnêteté, de faire métier d'expliquer Homère, Hésiode, Démosthène, Platon, Aristote, quand on désapprouvait leur religion. Car, ou l'on présentait les mythes helléniques aux écoliers comme des fables puériles et des contes de nourrices, et alors le souverain pontife de l'hellénisme devait sévir contre de tels sacrilèges ; ou l'on en parlait d'un ton convenable, et alors on mentait publiquement. Il faut mesurer l'habileté de cette interdiction à la douleur et aux colères de saint Grégoire ; tous les lettrés et tous les savants galiléens comprirent que c'en était fait du galiléisme si cette loi restait en vigueur pendant quinze ans, pendant le temps de former une nouvelle génération. Les seuls galiléens sérieux étaient ceux de la classe moyenne ; le menu peuple des grandes villes était tout prêt à retourner à l'hellénisme si l'ancienne religion venait à leur offrir les secours et les spectacles de la nouvelle. Or les parents nobles ou de classe moyenne, mis en demeure de laisser leurs enfants ignorants ou de les envoyer aux rhéteurs hellènes, n'auraient pas plus hésité que par le passé, et Julien s'était arrangé de manière à confondre entièrement l'éducation et l'enseignement ; ce qui n'avait pas lieu avant lui et ce que fit le clergé chrétien au moyen âge. Basile, instruit par un rhéteur hellène, n'en fut pas moins chrétien, et Julien, au contraire, instruit par un rhéteur galiléen, n'en fut pas moins hellène ; mais Julien venait de changer entièrement la situation : il venait de transformer en prêtres hellènes tous les rhéteurs distingués ; il leur ordonnait pontificalement de faire prendre en mépris à leurs élèves le christianisme, de leur montrer combien étaient illogiques la création et la fin du monde, impie le culte des saints et barbares les Écritures saintes. Les galiléens ainsi convaincus d'ignorance et condamnés à l'ignorance, il leur restait une supériorité, comme parti religieux, que les hellènes n'avaient pas encore songé à leur enlever : l'organisation de leur charité, imitée de celle des Juifs. Jusqu'à Julien, les vivres à distribuer aux indigents, les hôpitaux et les asiles où ils étaient soignés dans les grandes villes, ressortissaient au pouvoir civil, aidé par les particuliers riches ; c'est ce système auquel sont revenues aujourd'hui toutes les nations civilisées. Sauf les jours de grandes fêtes où les indigents prenaient leur part des sacrifices, les temples n'étaient pas les lieux de distribution des secours, et les pontifes n'intervenaient pas spécialement dans la charité publique et dans la direction des hospices. Les pontifes galiléens, au contraire, avaient cherché, dès l'origine, à concentrer entre leurs mains les aumônes des fidèles, et, depuis que les empereurs protégeaient leurs sectes, les munificences impériales et les secours votés par les assemblées municipales. En outre, c'était chez les galiléens la coutume, fort louée et encouragée par les prêtres, que les fidèles et surtout les femmes de condition se rendissent chaque matin aux saints tombeaux avec des paniers chargés de vivres dont ils sacrifiaient une partie sur l'autel, et qu'ils distribuaient ensuite sous la direction des prêtres à tous les mendiants qui se présentaient. Cette charité avait l'inconvénient d'encourager les pauvres de profession et la fainéantise incurable des prétendus ermites, que Julien attaque si violemment en d'autres circonstances ; elle était en outre l'occasion de désordres[10], car les repas se faisaient en commun dans le saint lieu, contrairement à l'usage des Grecs, qui emportaient d'ordinaire dans leur demeure leur part des sacrifices ; mais elle livrait aux galiléens et à leurs prélats tout le menu peuple des grandes villes, qu'ils soulevaient à leur gré contre les hellènes : c'était assez pour que Julien la fit adopter par son clergé. Il ordonna à ses hiérarques de suivre l'usage des Juifs et de la secte impie des galiléens, qui, dit-il, non-seulement nourrit ses pauvres, mais souvent les nôtres. Il leur ordonne, en outre, d'établir dans chaque cité des hospices, pour que, dit-il, les gens sans asile et sans moyens d'existence y jouissent de nos bienfaits, quelle que soit la religion qu'ils professent. Enfin Julien n'oublia pas le moyen le plus simple d'abaisser le galiléisme, c'était de mettre aux prises les uns avec les autres, par une tolérance affectée et sous prétexte de finir les différends, les innombrables sectes qui déchiraient l'Église, et le galiléisme avec le judaïsme, son ancêtre détesté. Mettre les chrétiens aux prises ne lui coûta que quelques frais de poste et la peine de les convoquer. Une fois les évêques réunis dans son palais, il les y enferma et leur signifia qu'il fallait que les persécutions que les diverses sectes s'infligeaient les unes aux autres cessassent tout à fait, et que chaque chrétien suivit sa conscience. Il savait bien ce qu'il faisait, dit A. Marcellin, et que les chrétiens entre eux sont les pires des bêtes féroces. En effet, tous ces prêtres qui se détestaient, forcés de passer plusieurs heures par jour côte à côte, pendant que Julien les interrogeait malignement sur leurs différends, oubliaient qu'on se moquait d'eux, et s'injuriaient avec ardeur. Julien frappait sur son tribunal, et s'écriait au milieu du bruit : Écoutez-moi ! écoutez-moi ! les Allemands et les Francs m'ont bien écouté. Son projet d'opposer le judaïsme au galiléisme lui coûta plus cher et ne réussit pas aussi bien. Il résolut de reconstruire, dans toute son ancienne splendeur, le temple de Jérusalem : Il avait confié, dit A. Marcellin, l'exécution de cette entreprise à Alypius d'Antioche, qui avait jadis exercé dans les Bretagnes le pouvoir des préfets. Pendant qu'Alypius, secondé par Id recteur de la province, pressait activement les travaux, d'épouvantables globes de flamme, qui s'élevèrent de terre près des fondements, rendirent la place inaccessible aux travailleurs, après avoir été fatals à plusieurs d'entre eux. Le terrible élément s'opposant toujours à la reprise des travaux, il fallut abandonner l'entreprise. Ce récit d'un des miracles fondamentaux du christianisme est évidemment le récit d'un hellène. A. Marcellin, qui lisait publiquement son histoire à Rome, sous le règne d'un prince chrétien, n'a pu passer sous silence un miracle de la religion officielle, mais il en dit peu de mots et passe sans réflexion à un autre sujet. Les chrétiens en parlaient avec plus de détails. Saint Grégoire de Nazianze affirmait que des Juifs, poursuivis dans les rues par les flammes, avaient voulu entrer dans une église chrétienne, mais que les portes, se refermant subitement, leur avaient opposé une résistance invincible. Il ajoutait qu'une grande croix lumineuse avait apparu au ciel ; de plus, tout homme chrétien ou hellène qui racontait ou entendait raconter cette merveille en découvrait aussitôt les traces, soit sur lui-même, soit sur son voisin, et voyait les habits de celui-ci ou les siens parsemés de signes qui surpassaient en beauté les plus belles broderies, et en variété lés peintures les plus parfaites. D'autres chrétiens avaient vu des feux tombés du ciel venir se joindre à celui qui sortait de terre ; d'autres avaient vu briller pendant toute la nuit les broderies imprimées sur les habits. Beaucoup de Juifs terrifiés avouaient que le génie des galiléens était bien puissant et qu'il avait vaincu en cette occasion celui d'Israël. Julien était sur le point de commencer son expédition contre les Perses, quand il apprit avec mille variantes les miracles que le dieu des galiléens venait de faire en faveur de sa secte. Il s'emporta d'abord contre la pusillanimité et l'ignorance des Juifs, qui n'avaient su opposer aucun miracle à ceux des galiléens ; il leur fit honte de leur décadence, en leur rappelant que Moïse était jadis sorti vainqueur de sa lutte contre les théurges égyptiens ; puis il promit qu'à son retour de Perse il irait avec Maxime à Jérusalem exécuter des prodiges et des évocations qui feraient rentrer sous terre tous les génies protecteurs du galiléisme. Le succès rapide des réformes de Julien, l'accueil que lui firent les différents peuples de l'empire, dépassèrent ce que Julien lui-même avait espéré[11]. Toute la haute classe, qui s'était convertie au christianisme avec Constantin, retourna à l'hellénisme avec Julien. Le peuple des grandes villes, le seul qui eût eu à souffrir des empiétements des prêtres galiléens, soutenus par les empereurs et les eunuques, montrait partout sa joie. Les Égyptiens, auxquels Julien venait de rendre leur bœuf Apis, poussaient leur piété jusqu'au meurtre. Ceux d'Alexandrie tuèrent Georges de Cappadoce[12], pontife chrétien de cette métropole, qui, sous Constance, n'avait négligé aucune occasion d'augmenter les biens ecclésiastiques aux dépens des biens municipaux et de ceux des dieux. Il avait eu l'imprudence de dire en passant devant le temple de Sérapis : Quand verrai-je à bas ce sépulcre ? On le traîna par les rues et on le brûla. Julien écrivit aux Alexandrins une lettre sévère, mais qui se terminait par un pardon en faveur de Sérapis, occasion du désordre. Bien que Julien se fût interdit par habileté de verser le sang des chrétiens, sa piété était trop ardente pour ne pas être, comme celle de ses ennemis, empreinte de fanatisme, et cette émeute dut lui faire plaisir. Ceux qui l'ont peint comme un prince plein d'impartialité et de sang-froid l'ont bien mal connu. S'il pratiquait d'ordinaire le pardon des injures et l'aumône même envers les chrétiens, s'il a fait le plus souvent respecter leurs droits et leur a rendu justice exacte, s'il les a traités avec douceur, c'est que Jupiter le lui avait ordonné ; mais quand il avait le droit pour lui, comme dans l'affaire de Saint-Marc d'Aréthuse, où il s'agissait de faire rendre à cet évêque arien des terres appartenant aux dieux et qu'il avait vendues, il appliquait avec joie la loi romaine dans toute sa rigueur. S'il fût revenu vainqueur de son expédition contre les Perses, il eût été amené fatalement à une persécution générale. Du jour où son clergé eût fonctionné régulièrement, pris de l'autorité et enlevé aux galiléens par ses largesses le menu peuple des villes, Julien eût été sommé par ses coreligionnaires d'accomplir son devoir de souverain pontife, de punir les chrétiens comme sacrilèges et athées, et de les faire périr en cas de récidive. Mais cette persécution n'aurait point sans doute échoué comme les précédentes. Si les persécutions des autres empereurs n'avaient point empêché le nombre des chrétiens de s'accroître, c'est qu'ils frappaient les corps sans pourvoir aux besoins des esprits ; Julien avait pris l'ordre inverse ; sa religion donnait sur tous les points l'équivalent du christianisme, excepté en ce qui touche au dogme de la fin du monde, dogme incompatible avec tout ordre social,' du moment qu'on le prend à la lettre et qu'on attend la fin du monde du jour au lendemain, dogme que les chrétiens, désireux de fonder quelque chose de durable, commençaient à éluder en reculant la terrible échéance dans un avenir indéfini. Une persécution dirigée par Julien se fût donc accomplie dans les meilleures conditions pour le succès ; l'extinction du paganisme par l'épée des empereurs chrétiens prouve qu'il est possible de supprimer une religion par la violence, pourvu qu'on ait su la remplacer en lui prenant tout ce qu'elle avait de bon. Les habitants d'Antioche firent éclater le même zèle que ceux d'Alexandrie ; cette métropole, qui la veille semblait toute galiléenne, parut le lendemain tout hellène. Quand Julien arriva pour la première fois dans leur ville pendant les fêtes d'Adonis, ils vinrent en masse à sa rencontre, comme autrefois ceux de Vienne : il était aussi pour eux un sauveur. Il fut obligé d'interdire par édit les applaudissements qui accueillaient son entrée dans les temples. L'enthousiasme des Antiochiens ne devait pas être de longue durée, car s'ils exaltaient en Julien le souverain pontife restaurateur de l'hellénisme, ils ne devaient pas tarder à prendre en haine l'empereur aux mœurs rigides et aux décisions arbitraires. |