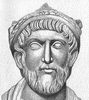JULIEN L'APOSTAT
PRÉCÉDÉ D'UNE ÉTUDE SUR LA FORMATION DU CHRISTIANISME
INTRODUCTION.
|
III. — THÉOLOGIE DE PLATON ET D'ARISTOTE. Le rameau de la race japhétique qui était devenu la race grecque, mis en perpétuel contact en Asie Mineure, dans les îles Ioniennes, dans les Deux-Siciles, avec Sem et Cham, les religions et les mœurs sémitiques et chamitiques ne tardèrent pas à s'infiltrer en Grèce. Cette infiltration produisit d'abord des résultats merveilleux. Pendant trois générations, d'Eschyle à Phidias, les Grecs bénéficièrent de tout ce qu'il y avait de meilleur dans Sem et dans Cham et donnèrent à l'humanité le modèle des plus belles mœurs auxquelles il soit donné à l'homme de parvenir. La Grèce eut Prométhée et Œdipe, frères de Job, plus grands que Job. Elle eut le Parthénon, frère des temples égyptiens, plus sublime que les temples égyptiens. Mais dès le temps de Socrate la décadence était commencée. Toutes les langues japhétiques ne peuvent rester belles qu'en gardant la conception polythéiste de Japhet qui ne voit dans l'univers que des individus éternels, et considère les corps non comme des substances, mais comme des phénomènes secondaires, résultat de l'harmonie entre des âmes, ou mieux encore comme le langage des âmes, comme leur vibration éthérée. Dès que l'usage de l'alphabet se répandit, dès que la conception sémitique et chamitique d'une matière inerte fut introduite en Grèce, les radicaux dont chacun avait été la graine d'une conjugaison, arbre immense se bifurquant en une infinité de branches et donnant naissance à toute une forêt, devinrent des cailloux inertes comme les radicaux de Cham ; la conjugaison devint roide et sans nuances comme celle de Sem, ou plutôt les mots n'eurent plus d'âme, ils ne purent plus pousser et marcher tout seuls, ils devinrent des tronçons d'arbres abattus par la hache qu'il fallut désormais scier, vriller, équarrir, numéroter pour en faire des phrases ayant le sens commun. Avant de distinguer avec Aristote dix catégories dans le discours on fut forcé d'en distinguer deux, le verbe (ρέμα) et le nom (ονομα), parce que tout radical ne pouvait plus indifféremment, comme à l'origine, pousser en verbe et pousser en nom, exprimer, suivant les circonstances, l'action ou ses objets. Le langage qui avait été pour Japhet le chant inspiré du rossignol devint la leçon apprise du perroquet. La poésie devint la prose, le rythme du vers fut remplacé par la grammaire. La théogonie qui avait été la synthèse parfaite de la métaphysique et de la physique se sépara en théologie, ou étude raisonnée des idées primordiales de l'homme, et en logique, ou étude raisonnée des procédés du langage et des méthodes en physique. Au lieu de concevoir instantanément le vrai, on discuta la nature du vrai, au lieu de savoir on discuta sur les bases de la science, au lieu d'avoir de belles mœurs on discuta sur la morale, au lieu de causer familièrement avec les dieux, d'entendre leur langage aussi clairement que le langage humain, de les sentir en soi, autour de soi, on chercha péniblement la divinité. Ce malaise général, fruit de la confusion des langues et des idées primordiales, qui s'est étendu depuis sur toute l'Europe, et dont l'Europe ne sortira plus, car, pour en sortir, il lui faudrait redevenir polythéiste — croire que l'oxygène, par exemple, est un individu doué de volonté comme l'homme —, a pris son expression première et par suite sa plus complète expression dans Maton et dans Aristote. Les éléates et les pythagoriciens n'avaient fait qu'introduire en Grèce les uns la cosmologie sémitique, les autres la cosmologie chamitique, sans y rien changer d'important. Chez eux point de distinction tranchée entre la métaphysique, l'art, les sciences physiques. Avec Platon et surtout Aristote cette distinction apparaît nettement, quoiqu'ils s'imaginent pouvoir ensuite faire la synthèse de ce qu'ils ont séparé. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache point, on ne peut désormais se soustraire à l'influence sourde, mais encore pleinement active de ces deux génies ; les conceptions maladives qu'ils ont exprimées les premiers sont devenues le fond de l'état philosophique des Européens. Pour se débarrasser d'eux il faudrait penser en sanscrit aussi spontanément que les poètes védiques, causer avec Elohim aussi familièrement que Moise, savoir le cophte et manier l'algèbre égyptienne comme un prêtre de Thèbes. Il faudrait n'avoir dans la tête que trois conceptions primordiales, la conception des monades, d'un- univers uniquement composé de forces éternelles agissant volontairement ; la conception du rayonnement, du point mathématique doué d'une force d'expansion égale et infinie dans tous les sens, et devenant instantanément la sphère d'un rayon infini ; la conception algébrique des radicaux, des idées absolues, pures, infinitives, en dehors du temps et du mode, et engendrant les temps et les modes par simple juxtaposition. Puisque cela est impossible, et qu'un Européen moderne a une foule de conceptions qu'il ne saurait faire dériver de ces trois-là, Platon et Aristote seront toujours nos maîtres, parce qu'ils ont les premiers souffert du malaise dont nous souffrons, parce que pour eux les premiers, parole et vérité, nature et divinité, n'ont plus été termes synonymes, et on ne saurait trop chercher à comprendre ce qu'ils ont pensé, fût-ce pour se garder de penser comme eux. Tout le vocabulaire scientifique moderne, les mots idée, pensée, phénomène, forme, formule, loi, espèce, race, genre, fait, agent, substance, substantif, corps, matière, inertie, étendue, volume, propriété, masse, température, virtuel, puissance, force, physiologie, physique, etc., n'ont de sens qu'à travers Platon et Aristote. Faire table rase de Platon et d'Aristote, ce serait implicitement faire table rase de toute la science moderne, et déclarer que Galilée, Descartes, Leibnitz, Newton, Lavoisier, Cuvier et tant d'autres ne voyaient goutte, qu'ils nous ont allumé un mauvais lampion guenons avons l'indulgence de prendre pour le soleil. Ce serait en revenir à la conception d'Eschyle et de Phidias, qui n'admettaient d'autres idées que les idées parlantes, les dieux, d'autre science humaine que la science concrète des poèmes, des temples et des statues. Essayons de comprendre les idées primordiales de Platon et d'Aristote, car c'est d'un essai de synthèse entre eux qu'est sortie, que s'est successivement modifiée et se modifiera encore la théologie chrétienne, j'entends celle de tous les chrétiens, qu'ils professent leur religion ou s'en moquent, qu'ils se préoccupent de la Divinité ou ignorent le sens de ce mot, car c'est ici une question de race et de langue. Or, la race et la langue ne sont pas les vêtements de la pensée, mais sa réalité, et ce sont ceux qui ne s'occupent ni de race ni de langue, ceux qui croient inutile de connaître ce que leurs ancêtres ont aimé et dit il y a quarante siècles dans les plaines de l'Arie, qui obéissent le plus servilement aux préjugés qui leur viennent de la race et de la langue. L'idée mère de Platon, la seule qu'il n'ait jamais abandonnée, — car pour toutes les conséquences qu'il en a tirées, elles ont singulièrement varié avec les époques, suivant les fantaisies de cet esprit charmant qui ne prit jamais la science humaine au sérieux — est l'assimilation tout égyptienne du monde avec la tête humaine. Pour lui le monde est la sphère type dont les têtes humaines sont les copies plus ou moins parfaites. Pour comprendre les lois de l'univers, il faut étudier les lois cérébrales ; et réciproquement, puisque nous ne pouvons voir ce qui se passe dans l'intérieur de la tête humaine, il faut, pour connaître sa structure intérieure, regarder la structure de la tête universelle dans l'intérieur de laquelle nous vivons. Ainsi que Platon le dit dans son Timée, si outre le cerveau symétrisé en boule et par rapport à un point, n'ayant qu'une boîte osseuse et pas d'os intérieurs, nous avons un corps qui est plutôt un appendice de nous-mêmes que nous-mêmes, symétrisé par rapport à des axes, et ayant une charpente osseuse intérieure, c'est que nous sommes en relations continuelles avec d'autres êtres et que nous nous nourrissons des substances extérieures. Mais le monde rumine éternellement, il se nourrit de sa propre substance sans que rien s'en perde et sorte de la circulation, il n'y a, de plus, en dehors de lui aucun être avec lequel il puisse entrer en communication ; la forme d'une sphère parfaite est donc la seule qui lui convient. S'il a des yeux et des oreilles, ces yeux regardent non les espaces extérieurs, mais le centre ; ces oreilles n'entendent que les battements de sa circulation. Le monde est terminé par une boite osseuse impénétrable, sphère creuse dont la surface intérieure est polie comme un granit égyptien : En lui vivent tous les animaux, soit mortels, soit immortels ; il en est rempli. C'est l'animal visible qui renferme tous les animaux visibles, c'est Dieu devenu accessible aux sens, c'est l'image complète du Dieu qui n'est que concevable ; Dieu très-grand, excellent, beau, parfait, achevé, unique et individuel[1]. C'est de cette idée mère, de ce parallélisme entre le cerveau (έγκέφαλόν) et le monde, que Platon va tirer à la fois sa logique et sa physique s'éclairant l'une l'autre. Avant tout Platon est l'introducteur en Grèce de l'idéographie égyptienne, de l'algèbre. Ce qui le frappe dans cette idéographie, c'est la possibilité, inconnue jusque-là aux Grecs, de représenter chaque radical, chaque verbe à l'infinitif, chaque idée pure en dehors de toute indication de temps et de dimension, de circonstances spéciales, par un symbole, par un hiéroglyphe, note conventionnelle, ou dessin d'animal, puis de conjuguer ou combiner ces radicaux sans les altérer, comme en grec, par des désinences et des redoublements, de manière à exprimer toute une série de pensées dont la loi d'engendrement reste parfaitement claire et où toutes les erreurs sautent aux yeux. Il distingue donc dans le Logos, dans le langage, soit parlé, soit écrit, deux éléments, les radicaux ou verbes à l'infinitif, immobiles, absolus, purs, qu'il appelle les idées, les vues, et la conjugaison ou combinaison, dont il appelle la cause, la force : le Νοΰς. Le Νοΰς a pour manifestation immédiate la νόησις, la parole, la pensée, l'engendrement, la conception, la création, toutes idées identiques pour Platon, qui assimile entièrement les créations du cerveau et les créations de la nature. Par suite de cette assimilation, il se représente la conjugaison, la conception ou νόησις, comme un système de vibrations, et le Nous ou Logos comme le système de forces qui produit ce système de vibrations. L'étude des lois de la tête humaine, de la logique, a permis à Platon de réunir en un seul mot Nous, correspondant à l'Elohim de Sem, les forces qui gouvernent la nature ; maintenant l'étude de la nature, les regards jetés sur cette tête immense que nous appelons le monde, va lui permettre de se figurer les mouvements cérébraux. La sphère totale du monde, l'intérieur de la sphère creuse de granit poli est divisé en trois couches concentriques. Au centre est la sphère de la terre immobile[2], environnée par la couche d'air. A la limite supérieure de cette couche d'air commence la couche de feu, l'empyrée, qui s'étend jusqu'à la boîte osseuse. C'est dans la région du feu que l'âme du monde a toute son énergie. La couche de feu est animée d'un premier mouvement de circulation générale qui la fait tourner sur elle-même en vingt-quatre heures ; cette circulation générale se combine avec sept circulations partielles, de rapidité et de rayons différents, correspondant à la course mensuelle de la lune, annuelle du soleil, et aux révolutions des cinq planètes. Ces sept astres sont eux-mêmes des tourbillons de feu. Toutes ces circulations, en se combinant et se choquant, envoient le feu, la chaleur et la lumière, jusqu'au centre du monde, et créent la variété infinie des phénomènes naturels qui sont les pensées de l'âme du monde. Nais dans toutes ses manifestations, dans toutes ses pensées, l'âme du monde agit comme l'âme humaine, d'après un modèle, les idées, les verbes à l'infinitif, les radicaux, les hiéroglyphes. La conjugaison ou circulation céleste a pour effet d'empêcher les molécules de feu de se répandre uniformément dans le ciel, elle les groupe autour d'une infinité de centres secondaires, il s'y forme des pleins et des vides, des figures s'y dessinent comme sur un sable vibrant. Ces figures (les constellations) sont les dessins parfaits de tous les radicaux du langage, de toutes les idées pures. Un démiurge, un divin architecte, les a mises an point dans le ciel pour l'éternité, comme l'architecte égyptien à mis au point, sur la muraille du temple, des sphinx, des phénix, des lions, des mains, des yeux, et tant d'autres symboles des types infinitifs. Placé sur la terre dans une atmosphère brumeuse et orageuse, l'homme ne peut voir ces dessins célestes dans leur beauté parfaite, et il est sourd à la musique des astres, mais autrefois il a vécu dans la région du feu. N'ayant qu'un corps de feu, il suivait les rotations des astres. Il a pu admirer les dessins parfaits des concepts ou des types absolus, entendre la symphonie exécutée par le principe qui les conjugue. C'est d'après les souvenirs de cette vie antérieure, souvenirs plus ou moins exacts suivant les individus, que nous raisonnons et agissons. Tel est dans son ensemble le système à la fois physique et logique, non des platoniciens, mais de Platon lui-même, si toutefois il est permis de dire que Platon se soit jamais donné la fatigue de soutenir un système. Dans la prose de Maton, la métaphysique est encore spontanée et sœur de la poésie. Cet admirateur enthousiaste de Cham et de Sem, ce grand renégat de la religion japhétique, est tout plein encore du souffle de Japhet ; il a beau vouloir chasser les dieux de la nature, il les y sent malgré lui. Les dieux qui autrefois venaient causer familièrement avec Japhet ne daignent plus venir causer avec lui ; il essaye de s'en consoler en les plaçant dans les constellations. Autre est Aristote : tout ce qui chez son maître était fantaisie brillante devient chez lui système arrêté. Bien plus japhétique que Platon par le fond de la doctrine, il l'est bien moins par le sentiment. Les trois idées primordiales d'Aristote sont : 1° celle de son maître Maton, l'idée du monde comme étant un animal immense réduit à sa tète par sa perfection même, se nourrissant de sa propre substance sans en rien perdre, ne pouvant voir que soi, entendre que soi, concevoir que soi, puis qu'il n'y a rien en dehors de lui ; 2° la superposition des espèces ou visages se servant de races les unes aux autres, dans lés deux sens, à partir de l'espèce humaine, la limite supérieure de la hiérarchie étant le visage de l'être en général, et la limite inférieure les espèces des quatre corps simples ou éléments : terre, eau, air, feu ou calorique ; 3° identification de l'idée de force avec l'idée de matière ou d'impénétrabilité, et par suite négation de l'inertie. Le monde ou être universel d'Aristote. Le monde d'Aristote diffère en plusieurs points de celui de Platon, mais c'est en les rapprochant qu'on comprend celui-là. Platon admet, comme les Égyptiens et les pythagoriciens leurs élèves, que les cinq éléments ou corps simples sont différentiés par la forme polyédrique de leurs molécules ; ces molécules ont été créées par des vibrations au sein de la matière première, vibrations qui ont eu pour effet d'y établir des vides et des pleins. Aristote n'admet aucun vide dans l'intérieur du monde, aucune porosité ni discontinuité, et selon lui les éléments sont différenciés non par des molécules ni des densités, mais par des mouvements naturels différents, qui seuls constituent leur essence. Celui du feu est la tendance à s'éloigner du centre de la terre, celui du solide terreux la tendance à s'en rapprocher, celui du liquide à se mettre sur le solide, celui de l'air à se mettre sur le liquide et sous le feu. Enfin, le cinquième élément des Égyptiens, le corps de granit poli et composé de molécules dodécaédriques, est transformé par Aristote en pur diamant, d'une eau merveilleuse et inaltérable, à la façon chaldéenne. Ce cinquième corps, qui parait à Aristote si supérieur aux autres qu'il ne l'appelle pas élément, qu'il n'admet son existence que dans le ciel et ne le fait pas entrer dans la composition des êtres sublunaires, est disposé autour du monde en huit sphères creuses concentriques ; il a pour mouvement naturel la rotation autour du centre occupé par la terre immobile. Ces huit sphères constituant le ciel, sont séparées les unes des autres par de vastes couches d'air ; dans la sphère creuse la plus rapprochée de nous est fixé, est pris dans un anneau le globe de la lune, qui est en diamant comme celui de tous les astres, et qui dépasse par en haut et par en bas de la plus grande partie de sa sphéricité ; dans la suivante est fixé de même le globe de diamant appelé Vénus, puis viennent celui de Mercure, du Soleil, de Mars, de Jupiter, de Saturne ; enfin, à la dernière sphère sont fixés en nombre infini les petits globes des étoiles fixes, dont la sphère creuse n'est animée que d'un seul mouvement de rotation, le mouvement diurne. En tournant, les sphères creuses passent sans les déranger entre les deux touches d'air entre lesquelles elles sont comprises ; mais au lieu où est fixé l'astre il y a un choc continuel, l'air choqué choque l'air à son tour, se transforme en feu, et de choc en choc la lumière arrive jusqu'à notre œil C'est surtout le passage du soleil, plus gros à lui seul que tous les autres astres réunis, qui produit par le choc la lumière et la chaleur ; aussi le soleil est-il pour Aristote le grand régulateur, générateur et destructeur de toutes choses. L'idée d'espèce dans Aristote. Quoique Aristote ait fortement combattu les pythagoriciens, qu'il ait supprimé de la science l'idée de molécule et de vibration, et toutes les théories musicales, il comprend l'espèce à la façon égyptienne, comme la fait comprendre une corde vibrant à la fois autour de chacune de ses parties aliquotes, et pouvant toujours être considérée comme la partie aliquote d'une corde plus grande. Il n'admet, à priori, comme réelles que les deux existences que tout philosophe est bien forcé d'admettre sous peine de se taire, sa propre existence et celle du monde extérieur considéré dans son ensemble, de l'immense animal dont tous les êtres particuliers sont les phénomènes. Entre le monde et le philosophe, il y a la série des espèces qui les unissent. En multipliant l'idée de lui-même, il arrive à la famille, à la cité, à la nation, à l'homme en général, au mammifère, au vertébré, à l'animal, à l'être simplement vivant, enfin à l'espèce suprême, qu'il appelle Dieu, dont l'animal, le végétal et le minéral ne sont que des races, et qui les contient toutes sans être aucune d'elles. En se divisant lui-même en espèces plus restreintes, il arrive au système cérébral ou logique, système osseux, sanguin, etc., et en subdivisant chacune de ces espèces en espèces plus restreintes, il trouve au fond de toutes les quatre espèces élémentaires différenciées par un mouvement naturel spécial. Au-dessous de l'idée des quatre espèces élémentaires, il n'y a plus que la matière première absolue, les points matériels formant un tout continu et immobile, auxquels ne serait appliquée aucune force. L'existence de pareils points est-elle admissible ? En ôtant à un point matériel toute virtualité propre, ne le faisons-nous pas rentrer dans le néant ? L'idée de matière n'est-elle pas une simple abstraction ? et si elle est une simple abstraction, quelle est la réalité dont nous l'avons abstraite ? L'idée de matière dans Aristote. — Pour saisir l'idée d'Aristote sur la matière, il faut se rappeler que non-seulement matière (ΰλη) signifie, en grec comme en français, matière logique et matière physique, matière de nos discours, de nos pensées, et matière de la nature ; mais que ces deux sens, qui pour nous ne sont pas tout à fait identiques, sont en grec complètement identiques. Cela tient à ce que νόησις veut dire à la fois pensée, engendrement, création, comme en français le mot conception. Pour Platon et Aristote, qui se figurent le monde comme le cerveau type, comme l'animal parfait réduit à sa tête, cette identité est nécessaire. Enfin, il faut se rappeler que le mot δύναμεις doit être traduit indifféremment en français par force, pouvoir, possibilité, possible, vertu, virtualité. Selon Aristote, toutes les fois qu'un être, un objet réel, animal, végétal, substance chimique, se présente à nous, nous ne pouvons le saisir en lui-même : tout ce que nous saisissons c'est l'effet qu'il nous produit. C'est cet effet que nous représentons, en lui attribuant un visage, une espèce. L'espèce est la manifestation de cet être en nous ; son action sur nous. Mais en même temps nous sentons que cet être existe en dehors de nous, qu'il reste ce qu'il est sans nous, que son existence est possible indépendamment de l'effet qu'il nous produit actuellement ; c'est cette idée que nous représentons en lui attribuant une matière. Matière, espèce, pures abstractions ; les êtres sont parfaitement uns et indivisibles, la matière est l'être en possibilité, en force, en virtualité, en puissance δύναμει ; l'espèce est l'être en effet, en action, en exercice, en actualité, en activité, en manifestation, ένεργεια. Mais en considérant un même objet nous y découvrons toute une hiérarchie d'espèces, nous y découvrons donc aussi toute une hiérarchie de matières, à chaque nouvelle espèce que nous lui attribuerons correspondra une nouvelle matière. Enfin, quand nous arrivons à l'espèce suprême, à Dieu, et que nous nous demandons quelle matière il faut lui attribuer pour qu'il devienne à nos yeux l'être suprême, la réalité suprême, le monde, nous comprenons que cette matière est la matière première. Dieu est l'être suprême en activité, en actualité ; la matière est l'être suprême en puissance, en virtualité, c'est la force première, abstraction faite de son effet nécessaire, de l'effet immédiat sans lequel elle ne serait pas la force première. Le dieu d'Aristote. — Aristote se demande ensuite en quoi consiste essentiellement cette activité de l'espèce suprême, de Dieu. L'activité divine ne peut être autre que la conception, νόησις (pensée et création), mais vers quel but tend cette conception ? Dieu, qui est la continuité des points matériels et l'éternité, la simultanéité infinie, est au-dessus du temps et de l'étendue, qu'il n'engendre que médiatement. Il ne conçoit pas à notre façon des phénomènes et des êtres distincts les uns des autres en des points, en des instants séparés. Il ne conçoit qu'un phénomène et qu'un être éternel lui-même, lui le νόος, le principe concevant, et il se conçoit constamment et invariablement. Tous les phénomènes et êtres secondaires s'ensuivent médiatement, sans qu'il les connaisse et s'en préoccupe en aucune façon. Dieu conçoit, dit Aristote, et sa conception est la conception du principe concerant (νόησις νοΰς). |