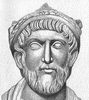JULIEN L'APOSTAT
PRÉCÉDÉ D'UNE ÉTUDE SUR LA FORMATION DU CHRISTIANISME
INTRODUCTION[1].
|
Histoire du Verbe et de la formation du christianisme. — I. Le Nouveau Testament d'après l'école de Tubingue. — II. La question des races : Sem, Cham et Japhet. — III. Théologie de Platon et d'Aristote. — IV. Théologie alexandrine. — V. Apport de chaque race à la construction du christianisme. — VI. L'Hellénisme. L'érudition allemande et l'érudition française se prêtent un secours mutuel dont bénéficie l'Europe et qui est le nœud de l'équilibre européen. Chacune d'elles est sans l'autre insuffisante et sans force de propagation. Celle-ci manque de principe, celle-là de forme. Il en est ainsi depuis le dix-septième siècle, et ce contraste suivi d'harmonie acquiert tous les jours une importance plus grande, à mesure que les Français redeviennent plus Français, c'est-à-dire plus Latins, plus centralisateurs et plus universalistes, et que les Allemands redeviennent plus Allemands, plus Saxons, plus Germains, plus féodaux, plus décentralisateurs dans les choses de la politique comme dans celles de l'esprit. La construction historique du christianisme en fournit une preuve récente. Cette construction, tout allemande d'initiative, ne devient et ne deviendra populaire même en Allemagne qu'à travers l'esprit français. En Allemagne, une foule d'écoles militantes à la fois théologiques et philologiques, qui se croient séparées par des abîmes, luttent à grand bruit les unes contre les autres, et qui ne semblent en France qu'un seul courant, qu'une seule école, dont les différentes parties ne sont séparées que par des nuances allemandes, c'est-à-dire imperceptibles à un œil français. L'esprit allemand aime l'infini et l'esprit français le fini. Celui-ci n'accepte que ce qui est proportionné dans tous les sens, achevé, accompli, parfait, net et compréhensible. Celui-là, au contraire, manquant du sentiment des proportions, n'est attiré que vers les principes incompréhensibles qui n'ont pas encore rendu sensible à l'âme la perfection. Celui-ci admire la statue déjà faite et sait la juger avec goût, celui-là aime à méditer sur le sable du moule, et à suivre de l'œil les circuits et les tourbillons du bronze en fusion. L'œuvre achevée, figée, n'a pour lui de prix qu'autant qu'il a saisi les lois de son engendrement. Chez tous les grands hommes de l'Allemagne, et dans tous les genres, on trouvera ce même amour de l'inachevé et de l'infini, venant d'un certain dédain pour la perfection restreinte qui ne laisse plus rien à désirer à l'esprit, et qui ferme les voies à une perfection plus étendue. Qu'il s'agisse en religion du grand Luther, nous le verrons s'épuiser en efforts pour remonter jusqu'au temps de la première fonte du christianisme, et briser sans pitié l'édifice solide et savamment ordonné du christianisme latin. Ce que Luther a fait contre le catholicisme, Leibniz le fera contre le cartésianisme ; à l'univers parfaitement machiné de Descartes où tout vient de Dieu, seul principe actif, il oppose un univers où il n'y a que des âmes, des monades, des forces douées de volonté et éternelles montant vers un Dieu inactif, par le développement continu et infini de leur virtualité propre. En même temps, au calcul des fluxions, où Newton s'était efforcé de rapetisser et de limiter l'idée de l'infini pour l'appliquer plus commodément à la mécanique des astres, il oppose le vrai calcul infinitésimal, la conception de l'infinité des ordres d'infinis, parce qu'il ne se préoccupe pas des applications, mais seulement de la loi d'engendrement des infinis, et qu'en mathématique comme en métaphysique ce qui est irrévocablement fermé et achevé lui déplaît. Dans sa manière de sentir le beau, Gœthe manifeste le même esprit. Né dans le Nord, et froid, il est attiré vers la beauté méridionale et chaude ; mais il la goûte sans en jouir pleinement en enfant de la maison. Ce qu'il admire dans les chefs-d'œuvre de la poésie et de l'art grecs, c'est moins ces chefs-d'œuvre eux-mêmes que les lois qui ont pu réaliser dans le temps la civilisation grecque. Il croit qu'une fois qu'il aura saisi ces lois, il s'assimilera cette beauté ; il ne veut pas jouir de l'art comme en ont joui Homère et Phidias, mais devenir plus grand qu'eux. Pour la beauté antique, il ne renoncera pas à la beauté chrétienne, ni à la beauté moderne ; il se fait fort de les posséder et de les manifester également toutes trois, et ces œuvres d'art sont si savantes. qu'elles ne sont plus des œuvres d'art, mais des traités d'esthétique universelle qui ne manifestent plus que l'idée spinoziste, celle d'une substance continuellement et infiniment créatrice. Même en musique, le fleuron le plus étincelant de l'Allemagne, se manifestent ce même dédain pour la perfection, la proportion, les horizons fermés, ces mêmes aspirations vers les horizons infinis. Gluck et Mozart ne sont pas des Allemands, mais des Autrichiens, c'est-à-dire des Slabo-Ougro-Gréco-Latins[2] élevés par une cour toute française, où l'on ne parlait que français, où l'on ne prisait que les modes, le ton, les grands airs de la cour française, où l'on enseignait que Racine est le type du poêle et Louis XIV le type du roi. Tandis que les Italiens pur sang, énervés par la fausse dévotion et la fausse indépendance, sont en train de renier leurs aïeux, tombent dans le trille, la roulade, la cadence périodique, la gaieté creuse, la grandeur fausse et la passion banale, ces Italiens de contrebande, ces maîtres adorables, recueillent la saine et pure tradition de la Renaissance italienne, et à la savante harmonie, à la mélodie sereine des vieux maîtres italiens, ils ajoutent le dramatique français. Il n'y a dans ces hommes rien d'allemand, et toutes les races de l'Europe, sauf la race allemande, peuvent réclamer ces Homères. Pour Haydn, c'est un pur maître de la Renaissance italienne qui a rapetissé sa manière à la portée des princes dont il fut le domestique, et qui, abandonnant l'Église et le peuple, s'est complu à la musique instrumentale. Beethoven seul est un vrai Allemand d'Allemagne, et aussitôt se manifeste en lui ce même esprit de Luther, de Leibniz et de Gœthe, cette même prétention de faire la synthèse de l'infini, cette même recherche de la loi universelle des engendrements, ce même dédain pour la joie limitée, pour les formes parfaites parce qu'elles sont finies. Élevé dans les traditions de la musique autrichienne, toute sa vie se passera à s'en dégager ; il faut briser les vieux moules et donner chaque jour un nouveau coup d'aile ; et, jusqu'au jour où il mourra sous l'effort, il cherchera une musique qui, dégagée de toutes les traditions du passé, lui soit tellement personnelle, qu'elle ne puisse fonder une école dans l'avenir. Tous ceux qui voudront s'inspirer de lui ne seront que des caricatures. Si tel est l'esprit allemand, toutes les traditions françaises au contraire rapprochent l'esprit français, — non l'esprit du peuple qui n'a pas de caractère bien précis, mais celui de tous les hommes de génie qui se sont succédé en France depuis la Renaissance, — de Molière, de la Fontaine, de Pascal, de Racine, aussi bien que des écrivains philosophes du dix-huitième siècle ; — de l'esprit grec. Esprit qui, calqué sur le climat de la Grèce, n'a jamais goûté que les horizons bornés, pour lequel fini a toujours été synonyme de parfait et de divin, et infini de pas fini et de laid. Je vais essayer de montrer comment ces traditions françaises nous permettent de beaucoup mieux comprendre que les Allemands eux-mêmes les sciences exégétiques et philologiques qu'ils ont fondées depuis le commencement de ce siècle, de mettre dans leurs découvertes la proportion, l'harmonie, les rapports simples, de faire une juste place à chaque ouvrier dans la construction de l'édifice chrétien. |