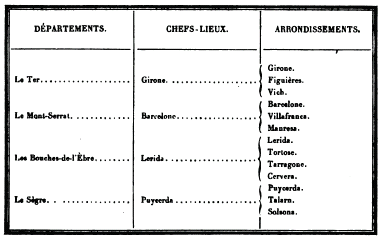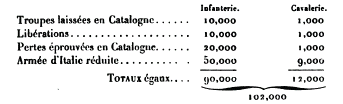HISTOIRE D'ANNIBAL
LIVRE TROISIÈME. — ANNIBAL EN ESPAGNE.
CHAPITRE VI. — CONQUÊTE DE LA
CATALOGNE.
|
A l'heure où les hostilités allaient s'ouvrir en Italie, il importait d'assurer à la péninsule ibérique la tranquillité la plus complète pour la durée probable de la guerre, de la préserver de toute insurrection intérieure, de la mettre à l'abri de toute insulte de la part des Romains. Il était de bonne politique de garnir le pays d'une armée composée d'éléments étrangers, et, réciproquement, d'en éloigner les contingents espagnols, dont la turbulence était à craindre. Annibal désigna donc pour l'Afrique les Thersites, les Mastiens, les Ibères de la montagne et les Olcades, en tout 1.200 hommes de cavalerie et 13.850 d'infanterie, non compris un certain nombre de Baliares. Les uns allèrent tenir garnison à Carthage, les autres furent répartis dans les villes métagonitiques[1], c'est-à-dire sur le littoral africain sis à l'ouest de Kollo[2]. En opérant ainsi, le général carthaginois protégeait ses communications en arrière, de Kollo à Mers-el-Kebïr. C'était la métropole qui devait surveiller la côte, de Carthage à Kollo, et, à cet effet, elle reçut d'Annibal 4.000 fantassins tirés des villes mêmes de la Métagonie[3]. Ces mesures étaient fort sages. Tous les hommes se trouvaient dépaysés et servaient d'otages là où ils avaient à tenir garnison. Les derrières de l'Espagne, c'est-à-dire de la base d'opérations, devenaient ainsi parfaitement sûrs. L'armée destinée aux garnisons de la péninsule compta 12.650 hommes d'infanterie, dont 11.850 Libyens, 300 Ligures, 500 Baliares ; et 2.450 de cavalerie, dont 350 Libyens ou Liby-Phéniciens, 300 Ilergètes[4], 1800 Imazir'en, Massyliens ou Massésyliens, Macéens et Maures. A la cavalerie fut adjointe une troupe de 21 éléphants[5]. L'escadre chargée du service des côtes de l'Espagne fut formée de 50 quinquérèmes, 2 quadrirèmes et 5 trirèmes[6]. En résumé, l'armée permanente qui allait demeurer en deçà de l'Èbre était, en nombre rond, d'un effectif de 15.000 hommes, dont 2.500 cavaliers, et elle était appuyée par une flotte de 57 navires[7]. Soldats, équipages et cornacs, tout était étranger à l'Espagne. Restait à pourvoir au commandement de ces forces de terre et de mer. Annibal avait alors auprès de lui ses trois frères, Asdrubal, Hannon et Magon. Le jeune et bouillant Magon devait le suivre en Italie ; il destinait à Hannon un poste important en deçà des Pyrénées ; le brave et intelligent Asdrubal était naturellement désigné pour l'emploi de gouverneur général de la péninsule. Annibal l'installa dans ces fonctions[8], et il n'eut jamais qu'à se louer de ce frère, digne et glorieux fils du grand Amilcar. Le jeune général assemble ensuite ses soldats. Il avive chez tous la haine du nom romain, et promet solennellement les plus belles récompenses à ceux qui l'aideront à sauver sa patrie. Il remue en eux la fibre religieuse et appelle sur leur valeur la protection des dieux. En terminant ce beau mouvement oratoire, il fait lire l'ordre du jour qui fixe la date du départ pour l'Italie, et cette communication est accueillie avec le plus vif enthousiasme. Au jour dit, et par une belle matinée de printemps[9], l'armée tout entière s'ébranle et dit adieu à Carthagène, la ville des roses[10]. Cédant aux destins qui l'entraînent par delà les Pyrénées et les Alpes, elle s'éloigne à grands pas et ne songe plus qu'au salut de la métropole. Pendant que ces belles troupes font leurs premières étapes, Annibal, qu'ont jusque-là préoccupé les soins d'une organisation difficile, Annibal songe enfin à son foyer. Sa première pensée est de soustraire sa femme et son enfant aux dangers de la guerre. Il ne peut songer à les emmener en Italie. L'Espagne ne lui parait pas non plus très-sûre ; après son départ, il le pressent, une lutte terrible va s'engager entre son frère Asdrubal et les Romains. Tout bien considéré, Imilcée et son fils s'embarqueront pour Carthage ; cette dure séparation est nécessaire. Annibal a vu disparaître à l'horizon la voile qui emporte
ce qu'il a de plus cher au monde. Il fait taire les voix émues de son cœur,
et rejoint les colonnes qui s'acheminent vers la vallée de l'Èbre. Partie de
Carthagène, l'armée se dirigea vers Etovisse (Oropesa), le long du littoral[11], et arriva au
fleuve qui, suivant les traités, servait de limite aux Carthaginois et aux
Romains. Jusque-là, les premiers sont sur leur terrain, et leur marche est
facile ; mais la scène va changer. Sur la rive gauche se profilent les crêtes
d'une âpre région, peuplée d'habitants à demi sauvages : c'est Le quadrilatère compris entre le Sègre, l'Èbre, la mer et les Pyrénées, dit aussi Malte-Brun[13], est un pays entièrement montagneux, excepté dans le voisinage des côtes. Sa charpente est formée par les ramifications des Pyrénées, qui s'y répandent d'une manière si confuse, qu'on ne trouve aucun enchaînement entre elles, et que la contrée n'apparaît que comme un entassement désordonné de sierras, de pics, de rochers, ouvert çà et là de gorges repliées en tous sens, d'étroits défilés, de vallons parcourus par des rivières torrentueuses et sujettes à des débordements. Pour achever de faire connaître les limites de cette
Suisse espagnole, due à un bizarre épanouissement des Pyrénées orientales, il
n'y a plus qu'à en exposer l'hydrographie. Le Sègre[14], dont le
développement total est de De ses sources à son confluent le Sègre sert de fossé à
l'important contrefort qui divise en deux parties distinctes le revers sud
des Pyrénées orientales. L'une, région des vallées transversales, comprend tous
les cours d'eau qui ont le Sègre pour commun déversoir ; l'autre, région des
vallées latérales, est arrosée par le Llobregat, le Ter, Ce second groupe, si nettement dessiné, constitue ce qu'on
nomme le grand
bassin de Le Llobregat (Rubricatus) prend ses sources sur le revers méridional de la portion de chaîne comprise entre le col de Port, à hauteur d'Urgel, et le massif de Tosas, au sud de Puycerda (Puig-Cerda). Il décrit d'abord plusieurs omégas s'alignant par la base, suivant la direction nord-sud ; mais le massif du Mont-Serrat[16] l'infléchit vigoureusement, et, dès lors, ses eaux coulent du nord-ouest au sud-est. Son embouchure se trouve à Des flancs du Puig-Mal, d'une part, et du pic de Castalone, de l'autre, descendent quatre torrents : le Ripart, le Freiser, le Ter proprement dit et le Riutort. Le Ripart et le Freiser se réunissent en fourche à Ribas ; le Ter et le Riutort confluent de même à Campredon. Ribas et Campredon sont, à leur tour, comme les deux pointes d'une autre fourche, dont l'embase est à Ripoll. Tel est le bassin de réception du Ter. A Ripoll, commence le canal d'écoulement. Encaissé depuis ses sources jusqu'à son embouchure, le Ter suit d'abord une direction nord-sud jusqu'à l'aplomb de Vich. Là, il s'infléchit brusquement d'équerre et coule de l'ouest à l'est jusqu'à Girone, d'où, remontant légèrement vers le nord, il va se jeter à la mer, un peu au-dessous du golfe de Roses. La chaîne pyrénéenne, deux contreforts adjacents et le
pâté de la rive gauche du Ter dessinent le vaste entonnoir où s'engouffrent
les eaux qui alimentent le torrent de La portion de la grande chaîne correspondant au territoire
de Pratz de Mollo est couronnée d'un large plateau de Telle est, esquissée à grands traits, l'hydrographie de Le Sègre, ce long couloir qu'envahissent des crues aussi
subites que violentes, semble, à première vue, jouir d'une propriété
militaire importante. On dirait un chemin naturel qui permet de tourner les
rivières de Les affluents de gauche du haut Sègre correspondent à des
passages importants qui ouvrent Le grand contrefort pyrénéen jeté entre les bassins du
Sègre et du Llobregat présente une force de résistance considérable, et le
massif du Mont-Serrat est particulièrement célèbre dans l'histoire militaire
de la France[17].
Une position non moins importante est celle qu'occupe, sur le Cardoner, la place
de Cardona, ce réduit pour les temps de malheur,
comme disent les Catalans. C'est sous l'appui de cette place qu'ils se
réorganisèrent en 1811, après le départ du maréchal Suchet pour Valence.
Cardona, qui marque véritablement le centre militaire de De Montblanch elle conduit à Valls, où Gouvion-Saint-Cyr
mit les Espagnols en pleine déroute (25 février 1809) ; à Reus, qui ouvrit
bientôt après ses portes à l'armée française ; enfin à Tarragone, qui fut assiégée
et prise en 1811. Nous aurons terminé l'examen des voies de communication de
cette portion de Quant aux places de l'Èbre, elles sont assez mal reliées
entre elles. Coupé par de nombreux barrages, le fleuve n'est guère navigable
que pendant la saison des crues, et l'on ne saurait donner le nom de routes
aux chemins difficiles qui mènent de Mequinenza à Tortose[21]. Une armée qui
veut dominer la vallée du Llobregat doit nécessairement occuper les points de
Castellard de Nueh, Pobla, Baga, Pedra-Sorca. Doria, Nuria, les Sept Cases et
Mollo sont pareillement les clefs du haut Ter. Quant à Tosas, elle commande à
la fois les vallées du Ter et du Llobregat, et cette position est extrêmement
importante ; car il est facile de barrer la gorge du haut Ter, étranglée
entre d'énormes montagnes[22]. En descendant
la portion transversale de la vallée de ce fleuve, une armée partie des
Pyrénées orientales pourrait tourner toutes les défenses qui précèdent
Girone, cette porte de Nous avons dit qu'une route reliait Manresa à Girone en
passant par Vich, poste fortifié des plus précieux, qui domine tout le massif
entre le Ter et le Llobregat, et sert d'appui aux places de la rive droite de
ce dernier cours d'eau[24]. Parallèlement à
cette route de Manresa à Vich, et au pied du grand massif de montagnes, sont
deux communications dont il faut tenir compte. L'une, dite l'ancienne route,
et défendue par Hostalrich, conduit de Barcelone à Girone. L'autre, la route de Girone est le point de C'est seulement en aval de Bezalu que Ce qui fait surtout la force de cet âpre pays, c'est la
rareté et le mauvais état des communications. Des sentiers difficiles relient
Vich et Campredon à Olot. De deux stations de La route de France, de Bescara à Pont-des-Moulins, par Figuières, suit le pied des collines du haut Ampurdan. Le pays est, en outre, desservi par le chemin de Figuières à Bezalu, par Nevata, et un sentier qui mène de Campredon à Saint-Laurent de Muga, par le col de Bassagoda ; ce dernier fut fréquemment pratiqué par les bandes catalanes qui, en 1795, fourmillaient dans le triangle ayant pour sommets Olot, Campredon et la Magdelaine[26]. Mentionnons enfin un chemin voisin du littoral, passant au travers des marais, et qui porte le nom de San-Pedro Pescador. Le pays tourmenté que nous venons d'explorer à vol
d'oiseau est, on le conçoit, déchiré par de nombreux torrents. Les plus
importants sont : l'Alga et le Manol. L'Alga descend du massif de Nostra-Senora del
Monte et aboutit aux marais de Ciurana, derrière lesquels l'armée
française prit position en 1795. Le Manol vient des hauteurs de Llorona, se
grossit à gauche des torrents secondaires de Sistella et de Dans le rentrant formé par le Manol et De Pont-des-Moulins, sur Il était indispensable d'esquisser, ainsi que nous venons
de le faire, la physionomie de Des difficultés d'un autre ordre naissent du caractère à demi sauvage des habitants, qui, à l'approche des étrangers, s'enfuient dans la montagne, en emportant toutes leurs provisions[33]. La race catalane, aussi vigoureuse qu'intelligente et fière, est singulièrement endurcie à toutes les fatigues du corps. Elle n'a qu'un besoin, mais violent, celui de l'indépendance ; qu'une passion, mais féroce, celle de la guerre de montagnes. Ce sont, disait Vauban, gens un peu pendards, aimant naturellement l'escoupetterie et se faisant un grand plaisir de chasser aux hommes[34]. A la première alarme, on voit debout tout homme en état de porter un fusil ; la jeunesse se forme en compagnies franches qui prennent le nom de Miquelets ; le reste de la population s'organise en Soumatens. Au premier son du tocsin, les habitants des villages abandonnent leurs demeures, enterrent leurs grains, replient leurs troupeaux et vont se réfugier sur des pitons inaccessibles. Mais les races primitives se laissent fatalement entraîner à des excès que la civilisation condamne ; ces rudes Catalans sont d'un courage incomparable, et, il faut bien le dire, leur cruauté est à la hauteur de leur courage[35]. En résumé, Mais il est temps de clore cette étude et de retrouver les troupes d'Annibal massées sur la rive droite de l'Èbre. 90.000 hommes d'infanterie, 12.000 hommes de cavalerie, en tout 102.000 hommes, se disposent à franchir le fleuve[40]. M. Duruy attribue un effectif trop restreint aux troupes carthaginoises qui vont procéder à cette opération ; l'éminent historien n'accorde que 94.000 hommes ; mais les textes sont précis et en accusent 102.000. Ces textes, d'une concision regrettable[41], semblent d'ailleurs démontrer que le passage s'effectua sans difficultés sérieuses[42]. Nous apprenons de Tite-Live que l'armée fut, à cette occasion, répartie en trois colonnes[43]. Pour déterminer aussi exactement que possible la direction
de ces trois passages, il est d'abord indispensable de relire attentivement
Polybe et Tite-Live, nos guides ordinaires. Après
avoir franchi l'Èbre, dit Polybe (III, XXXV), il soumit les
Ilergètes, les Bargusiens, les Ærénosiens et les Andonisiens, jusqu'aux
Pyrénées. Opérant plus rapidement qu'il n'avait l'espérer, il enleva de vice
force plusieurs places importantes, et livra nombre de combats qui lui
coûtèrent beaucoup de monde. Tite-Live (XXI,
XXIII) s'exprime comme il suit : Il soumis les Ilergètes, les Bargusiens, les Ausétans, et
le Lacétanie, région qui occupe le versant méridional des Pyrénées.
Ceci étant, il convient de mettre en regard l'un de l'autre ces deux récits
succincts. Les Ίλουργηπτοί
de Polybe, les Ilergètes
de Tite-Live nous présentent la peuplade des Ilerdan, ayant pour place forte Alerda
(Lérida), et pour capitale Athanagia[44], probablement
Sananja, sur affluent du Sègre. Les Βαργουσίοι,
ou Bargusii,
avaient évidemment pour centre la place importante de Berga. Jusque-là,
Polybe et Tite-Live sont parfaitement d'accord ; mais voici venir la
divergence : l'un mentionne la soumission des Αίρηνόσιοι,
des Άνδόσινοι,
de tout le pays jusqu'aux Pyrénées ; l'autre, celle des Ausetani et de Les Αίρηνόσιοι
sont, à notre sens, la peuplade des Inrousien, ayant pour capitale Anresa,
la moderne Manresa[45] ; les Άνδόσινοι,
celle des Indonien,
avec Andona
(Cardona ou Kerdona) pour place forte
principale[46].
Les Ausetani
étaient répandus sur toute En résumé, les concordances de Polybe et de Tite-Live
démontrent qu'Annibal s'est rendu maître de Lérida et de Berga ; les
divergences des deux historiens n'aboutissent point à des contradictions.
Suivant le premier, les Carthaginois ont pris Manresa et Cardona ; d'après
l'autre, ils ont aussi occupé le col de Tosas, Vich et toute la basse
Catalogne, de Avant de passer l'Èbre, il divise son armée de 102.000 hommes en trois corps, que nous supposerons d'égale force, soit de 34.000 hommes chacun, et qui doivent, en se donnant toujours la main, s'avancer parallèlement vers les Pyrénées. Le premier, celui de droite, comprenant sans doute le gros du bagage, les éléphants, les impedimenta, franchit le fleuve au gué d'Amposta, point de passage de lord Bentinck en 1813, et doit, en suivant le littoral, s'emparer de la basse Catalogne. Il est appuyé par la flotte carthaginoise. Le deuxième corps passe à Mora, où le maréchal Suchet établit, en 1810, un pont volant et un dépôt de munitions. Il a pour mission de pousser droit sur la vallée du Llobregat et de soumettre le cœur du pays. Le troisième, enfin, franchit le fleuve aux environs de Mequinenza[52], et se porte sur la vallée du Sègre. Pendant que le deuxième corps, ou corps du centre, se
dirige du sud au nord, par Tivisa, Montblanch, Cervera, vers son objectif,
Manresa, pour pousser ensuite sur Cardona, Berga, Baga et le col de Tosas ;
le corps de droite prend Tortose, Reus (Rous, tria capita), Tarragone (Ta-Ras-Ko),
Barcelone (Bahr-Kino),
Girone, Ampurias ; le corps de gauche s'empare de Lérida, Sananja, Solsona, Les trois corps combinent leur marche, et peuvent, à
chaque instant, se porter l'un vers l'autre pour se prêter un solide appui.
Sur la ligne de l'Èbre, les communications sont difficiles, mais le passage
est encore praticable, puisque Palafox sut replier directement 15.000 hommes
de Mequinenza sur Tortose ; et que le siège de cette dernière place fut
entrepris par le maréchal Suchet, qui avait préalablement concentré ses
moyens d'action au confluent du Sègre et de Plus haut, Lérida se relie : à Tarragone, par les défilés
de Montblanch ; à Barcelone, par Cervera, Igualada, le revers sud du
Montserrat, ou vallée de L'expédition ne dura que deux mois ; mais le succès n'en
fut acheté qu'au prix d'un sang précieux. Les engagements de chaque jour et
les sièges qu'il fallut entreprendre coûtèrent aux Carthaginois environ 21.000
hommes, soit le cinquième de leur effectif total[54], sacrifice
énorme, mais non fait en pure perte, puisque Cependant il fallait organiser le pays de manière à tirer de celte conquête tout le parti possible. Le jeune général chargea son frère Hannon du soin de faire régner l'ordre à l'intérieur de la province. Ainsi nommé gouverneur général de la Catalogne[55], Hannon, que M. Duruy appelle Magon[56], eut, à cet effet, à sa disposition une petite armée de 10.000 hommes d'infanterie et de 1000 chevaux[57]. Ces forces étaient jugées suffisantes pour qu'il pût tenir le pays par le moyen de garnisons solidement installées dans les places[58], demeurer maître des passages des Pyrénées[59] et pourvoir à la garde des magasins de dépôt de l'armée d'Italie[60]. Il n'est pas absolument impossible de déterminer en quel point le frère d'Annibal avait établi le siège de son gouvernement. En s'attachant aux textes, comme il convient de le faire en toute élude historique, on peut admettre que le quartier général de l'armée punique d'occupation était à Berga[61]. Cette position est, en effet, exceptionnellement favorable à toutes les opérations ayant pour objet la défense du territoire catalan et la sûre possession des cols de la frontière pyrénéenne. En pivotant autour de cette place, qui commande les bassins de tous les cours d'eau de l'intérieur, un petit noyau de bonnes troupes peut exercer sur le pays une action considérable. A portée des plaines d'Urgel, les détachements peuvent facilement vivre, et la disposition des communications qui rayonnent autour de Manresa leur vaut, pour ainsi dire, le don d'ubiquité dans la haute et dans la basse Catalogne. De plus, sans descendre des hauteurs qu'ils occupent, il leur est facile de gagner tous les cols de la grande chaîne[62]. Cependant la mission d'Hannon n'était pas sans présenter certaines difficultés. Les Romains avaient depuis longtemps pris pied en Catalogne, et y entretenaient un parti puissant. Il leur était donc facile d'agiter le pays, de s'y créer de nouvelles alliances, de ramènera eux les peuplades qui, lors des opérations d'Annibal, avaient déserté leur cause. C'est ce qu'ils ne manquèrent pas de faire, tant sur la côte que dans l'intérieur[63], aussitôt que les Carthaginois eurent passé les Pyrénées. Le littoral catalan était bien semé de villes phéniciennes[64], dont l'active
c00pération semblait assurée aux Carthaginois. Mais les liens d'une commune
origine s'étaient sans doute fort relâchés sous l'action de la diplomatie
romaine. Les ports de commerce qui avaient accueilli Annibal, lors de son
passage par Les haines nationales, qui s'invétèrent avec les siècles,
ne s'implantent si profondément dans l'esprit public que parce qu'elles sont
une conséquence des rivalités économiques, un résultat de la concurrence
commerciale et du froissement des intérêts privés. Or les Grecs et les
Carthaginois, qui s'étaient tant de fois rencontrés et heurtés en Asie Mineure,
dans l'Archipel et en Sicile, ne pouvaient sceller en Espagne une amitié bien
durable. Les colonies grecques de D'ailleurs, il convient aussi de tenir compte du caractère et de la valeur personnelle du jeune frère d'Annibal. Hannon n'était pas plus capable de commander en Catalogne, que ne le fut plus tard le roi Joseph de gouverner l'Espagne sous l'autorité de Napoléon. Son impéritie militaire est frappante et rappelle les fautes du brave Augereau[67]. Mais, sans songer aux graves mécomptes qui peuvent attrister les débuts de la campagne d'Italie, Annibal, ferme en ses résolutions, poursuit à grands pas sa route vers les Pyrénées, et prend, avant de s'y engager, une mesure commandée par la raison politique. Il licencie une partie de ses troupes[68], et ne garde qu'une élite de 50.000 hommes d'infanterie et 9.000 hommes de cavalerie[69]. Le passage de l'armée d'Annibal en Catalogne a dû laisser
des traces, que le temps a, malheureusement, effacées. On peut toutefois
mentionner un pont dit d'Annibal, jeté sur le Llobregat, au confluent de
la Noya[70],
et aussi les Echelles
d'Annibal, pointes de rochers qui se dressent à pic, en forme de degrés,
sur le revers occidental du Mongri, à l'embouchure de On se rappelle que, lors du passage de l'Èbre, et pour la conduite de ses opérations en Catalogne, Annibal avait partagé son armée en trois corps. L'un de ces corps, celui de droite, suivait le littoral, et, constamment en communication avec la flotte, comprenait la majeure partie de la cavalerie, ainsi que les éléphants ; il devait sans doute être chargé de l'escorte du trésor et du convoi. Bien que le jeune général allât régulièrement pousser des reconnaissances et diriger les opérations de guerre dans toutes les cases de l'échiquier catalan, il se tenait, le plus souvent, au corps de droite, qui était, en somme, le gros de l'armée, et dont tous les mouvements devaient être surveillés de près. En résumé, la route suivie par ce corps de droite, et
qu'on peut appeler la route d'Annibal en Catalogne, n'a pas dû
s'écarter sensiblement du tracé qu'indique l'Itinéraire d'Antonin[72]. L'armée carthaginoise
s'est dirigée d'Amposta sur Ampurias par Perello, Cambrils (Oleastrum),
Tarragone (Ta-ras-ko),
Vendrell (Palfuriana),
Villafranca (Antistiana),
Martorell (Fines),
Barcelone (Bahrkino),
la route de Annibal établit son quartier général sous Ampurias. Du haut de la montagne de Jupiter, où flotte le pavillon carthaginois, le regard des soldats embrasse le panorama des Pyrénées ; le coursier punique semble hennir d'impatience et dévorer l'espace qui le sépare encore des champs de l'Italie. |