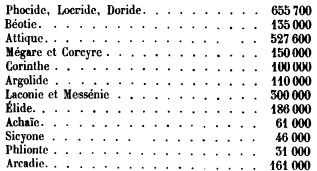LA VIE PRIVÉE ET LA VIE PUBLIQUE DES GRECS
CHAPITRE VIII. — LA RELIGION.
|
SOMMAIRE. — 1.
Fondation des villes. — 2. Petitesse des États grecs. — 3. L’esprit
municipal. — 4. Les classes sociales. — 5. Les non-citoyens à Athènes. — 6.
Concession du droit de cité. — 7. Poursuites dirigées contre un faux citoyen.
— 8. Révision des listes civiques. — 9. Le citoyen. — 10. Asservissement du
citoyen à l’État. — 11. Les repas publics à Sparte. — 12. Les dèmes et les
tribus. — 13. Amour de la liberté. — 14. Obligation pour le citoyen de
défendre les institutions nationales. — 15. Préférence donnée au gouvernement
de la classe moyenne. — 16. Les institutions démocratiques. — 17. L’Assemblée
athénienne d’après les poètes comiques. — 18. Une séance de l’Assemblée athénienne.
— 19. Réunion extraordinaire de l’Assemblée. —20. Un homme d’État du Ve
siècle : Périclès. — 21. Un homme politique du IVe siècle : Hypéride. — 22.
Défauts de la démocratie athénienne. — 23. Le Sénat à Sparte. — 24.
L’Assemblée populaire à Sparte. —25. La royauté à Sparte. — 26. Les éphores.
— 27. Luttes des partis en Grèce. — 28. Massacres à Corcyre. — 29. Un tyran
grec du Ier siècle av. J.-C. 1. — FONDATION DES VILLES. Les Grecs croyaient que l’emplacement d’une ville devait être choisi et révélé par la divinité. Aussi, quand ils voulaient en fonder une, consultaient-ils l’oracle de Delphes. Hérodote signale comme un acte d’impiété ou de folie que le Spartiate Doriée ait osé bâtir une ville sans consulter l’oracle et sans pratiquer aucune des cérémonies prescrites, et le pieux historien n’est pas surpris qu’une ville ainsi construite en dépit des règles n’ait duré que trois ans. Thucydide, rappelant le jour où Sparte fut fondée, mentionne les chants pieux et les sacrifices de ce jour-là. Le même historien nous dit que les Athéniens avaient un rituel particulier et qu’ils ne fondaient jamais une colonie sans s’y conformer. On peut voir dans une comédie d’Aristophane un tableau assez exact de la cérémonie qui était usitée en pareil cas. Lorsque le poète représentait la plaisante fondation de la ville des Oiseaux, il songeait certainement aux coutumes qui étaient observées dans la fondation des villes des hommes ; aussi mettait-il sur la scène un prêtre qui allumait un foyer, en invoquant les dieux, un poète qui chantait des hymnes et un devin qui récitait des oracles. Pausanias parcourait la Grèce vers le temps d’Hadrien. Arrivé en Messénie, il se fit raconter par les prêtres la fondation de la ville de Messène, et il nous a transmis leur récit. L’événement n’était pas très ancien ; il avait eu lieu au temps d’Épaminondas. Trois siècles auparavant, les Messéniens avaient été chassés de leur pays, et depuis ce temps-là ils avaient vécu dispersés parmi les autres Grecs, sans patrie, mais gardant avec un soin pieux leurs coutumes et leur religion nationale. Les Thébains voulaient les ramener dans le Péloponnèse, pour attacher un ennemi aux flancs de Sparte ; mais le plus difficile était de décider les Messéniens. Épaminondas, qui avait affaire à des hommes superstitieux, crut devoir mettre en circulation un oracle prédisant à ce peuple le retour dans son ancienne patrie. Des apparitions miraculeuses attestèrent que les dieux nationaux des Messéniens, qui les avaient trahis à l’époque de la conquête, leur étaient redevenus favorables. Ce peuple timide se décida alors à rentrer dans le Péloponnèse à la suite d’une armée thébaine. Mais il s’agissait de savoir où la ville serait bâtie ; car d’aller réoccuper les anciennes villes du pays, il n’y fallait pas songer : elles avaient été souillées par la conquête. Pour choisir la place où l’on s’établirait, on n’avait pas la ressource ordinaire de consulter l’oracle de Delphes, car la Pythie était alors du parti de Sparte. Par bonheur, les dieux avaient d’autres moyens de révéler leur volonté. Un prêtre messénien eut un songe où l’un des dieux de sa nation lui apparut et lui dit qu’il allait se fixer sur le mont Ithôme, et qu’il invitait le peuple à l’y suivre. L’emplacement de la ville nouvelle étant ainsi indiqué, il restait encore à savoir les rites qui étaient nécessaires pour la fondation ; mais les Messéniens les avaient oubliés ; ils ne pouvaient pas, d’ailleurs, adopter ceux des Thébains ni d’aucun autre peuple ; et l’on ne savait comment bâtir la ville. Un songe vint fort à propos à un autre Messénien : les dieux lui ordonnaient de se transporter sur le mont Ithôme, d’y chercher un if qui se trouvait auprès d’un myrte, et de creuser la terre en cet endroit. Il obéit ; il découvrit une urne et, dans cette urne, des feuilles d’étain sur lesquelles était gravé le rituel complet de la cérémonie sacrée. Les prêtres en prirent aussitôt copie et l’inscrivirent dans leurs livres. On ne manqua pas de croire que l’urne avait été posée là par un ancien roi des Messéniens avant la conquête du pays. Dès qu’on fut en possession du rituel, la fondation commença. Les prêtres offrirent d’abord un sacrifice ; on invoqua les anciens dieux de la Messénie, les Dioscures, le Zeus de l’Ithôme, les anciens héros, les ancêtres connus et vénérés. Tous ces protecteurs du pays l’avaient apparemment quitté, suivant les croyances des anciens, le jour où l’ennemi s’en était rendu maître ; on les conjura d’y revenir. On prononça des formules qui devaient avoir pour effet de les déterminer à habiter la ville nouvelle en commun avec les citoyens. C’était là l’important : fixer les dieux avec eux était ce que ces hommes avaient le plus à cœur, et l’on peut croire que la cérémonie religieuse n’avait pas d’autre but. Ils pensaient, par des formules et par des rites, attacher les dieux nationaux au sol qu’ils allaient eux-mêmes occuper, et les enfermer dans l’enceinte qu’ils allaient tracer. Aussi leur disaient-ils : Venez avec nous, ô êtres divins ! et habitez en commun avec nous cette ville. Une première journée fut employée à ces sacrifices et à ces prières. Le lendemain, on traça l’enceinte, pendant que le peuple chantait des hymnes religieux. Fustel de Coulanges, la Cité antique, p. 157-159. 2. — PETITESSE DES ÉTATS GRECS. Pour les modernes, un État grec semble une miniature[1]. L’Argolide a huit ou dix milles de long et quatre à cinq de large ; la Laconie à peu près autant ; l’Achaïe est une bande étroite de terre sur le flanc d’une chaîne qui descend dans la mer. L’Attique entière égale à peine la moitié d’un de nos départements. Le territoire de Corinthe, de Sicyone, de Mégare, se réduit à une banlieue. D’ordinaire, et notamment dans les îles et les colonies, l’État n’est qu’une ville avec une plage et un pourtour de fermes. D’une acropole, on voit avec les yeux l’acropole et les montagnes du voisin. Dans une enceinte si resserrée, tout est net pour l’esprit ; la patrie morale n’a rien de gigantesque, d’abstrait et de vague comme chez nous ; les sens peuvent l’embrasser ; elle se confond avec la patrie physique ; toutes deux sont fixées dans l’esprit du citoyen par des contours précis. Pour se représenter Athènes, Corinthe, Argos ou Sparte, il imagine les découpures de sa vallée ou la silhouette de sa ville. II en connaît tous les citoyens, comme il s’en figure tous les contours. (Taine, Philosophie de l’art, II, p. 125.) Les plus grands esprits eux-mêmes ne concevaient pas qu’un État hellénique pût avoir une vaste étendue. Quand Platon essaie d’organiser une république, qui, dans sa pensée, était parfaitement viable, il commence par déclarer qu’elle ne doit pas avoir plus de 5.040 familles. Si le territoire, dit-il, suffit à l’entretien de cette quantité d’habitants, il est assez grand, et il ne faut pas aller au delà. (Lois, V, p. 737 et 740.) Aristote est du même avis : Un État dont la population est trop nombreuse a de la peine à se bien gouverner, si même cela n’est pas tout à fait impossible. Du moins ne voyons-nous pas que dans aucun de ceux qui sont considérés comme ayant un bon système de gouvernement, l’on ait abandonné sa population à un développement illimité. (Politique, IV (VII), 4, 5.) 3. — L’ESPRIT MUNICIPAL. Chaque cité, par l’exigence de sa religion même, devait être absolument indépendante. 11 fallait que chacune eût son code particulier, puisque chacune avait sa religion et que c’était de la religion que la loi découlait. Chacune devait avoir sa justice souveraine, et il ne pouvait y avoir aucune justice supérieure à celle de la cité. Chacune avait ses fêtes religieuses et son calendrier ; les mois et l’année ne pouvaient pas être les mêmes dans deux villes, puisque la série des actes religieux était différente. Chacune avait sa monnaie particulière, qui, à l’origine, était marquée de son emblème religieux. Chacune avait ses poids et ses mesures. On n’admettait pas qu’il pût y avoir rien de commun entre deux cités. La ligne de démarcation était si profonde qu’on imaginait à peine que le mariage fût permis entre habitants de deux villes différentes. Une telle union parut toujours étrange et fut longtemps réputée illégitime. La législation d’Athènes répugnait visiblement à l’admettre. Presque partout les enfants qui naissaient d’un tel mariage étaient confondus parmi les bâtards et privés des droits de citoyen. Pour que le mariage fût légitime entre habitants de deux villes, il fallait qu’il y eût entre elles une convention particulière. Chaque cité avait autour de son territoire une ligne de bornes sacrées. C’était l’horizon de sa religion nationale et de ses dieux. Au delà de ces bornes, d’autres dieux régnaient, et l’ou, pratiquait un autre culte. Le caractère le plus saillant de l’histoire de la Grèce, c’est le morcellement poussé à l’excès et l’esprit d’isolement de chaque cité. La Grèce n’a jamais réussi à former un seul État. On a attribué l’incurable division des Grecs à la nature de leur pays, et l’on a dit que les montagnes qui s’y croisent établissaient entre les hommes des lignes de démarcation naturelles. Mais il n’y avait pas de montagnes entre Thèbes et Platée, entre Argos et Sparte, entre Sybaris et Crotone. La nature physique a sans nul doute quelque action sur l’histoire des peuples, mais les croyances de l’homme en ont une bien plus puissante. Entre deux cités voisines, il y avait quelque chose de plus infranchissable qu’une montagne, c’était la série des bornes sacrées, c’était la différence des cultes, c’était la barrière que chaque cité élevait entre l’étranger et les dieux. Elle défendait à l’étranger d’entrer dans les temples de ses divinités poliades ; elle exigeait de ses divinités poliades de haïr et de combattre l’étranger[2]. Pour ce motif, les anciens n’ont pu établir ni même concevoir aucune autre organisation sociale que celle de la cité. Les Grecs n’ont pas eu la pensée que plusieurs villes pussent s’unir et vivre à titre égal sous un même gouvernement. Entre deux villes, il pouvait y avoir alliance, association momentanée en vue d’un profit à faire ou d’un danger à repousser, mais il n’y avait jamais union complète, car la religion faisait de chaque ville un corps qui ne pouvait s’agréger à aucun autre. L’isolement était la loi de la cité. Fustel de Coulanges, la Cité antique, p. 237-239. 4. — LES CLASSES SOCIALES. Si l’on examine l’état social de la Grèce à l’époque la plus ancienne, c’est-à-dire pendant la période monarchique, on y remarque en premier lieu une classe qui comprend tous les chefs de famille. Ces hommes sont souvent aussi nobles que le roi, et ils s’attribuent volontiers une origine divine. Comme le roi, ils portent le nom de ihatleth ; dans Ithaque, la maison d’Ulysse était la plus royale de toutes ; elle n’était point la seule qui eût le caractère royal. Ils étaient en outre de riches propriétaires fonciers, et une bonne partie du sol cultivé était entre leurs mains. Enfin, ils se réunissaient en conseil auprès du souverain, et, suivant les cas, ils l’éclairaient de leurs avis ou lui dictaient leurs volontés. — La seconde classe de la société embrassait tous ceux qui étaient apparentés avec les chefs des familles nobles. Eux aussi se rattachaient à l’aristocratie par la naissance comme par les droits ; ils possédaient la terre, et, s’ils ne siégeaient pas au conseil, ils assistaient à l’assemblée des citoyens. Leur infériorité venait simplement de ceci, qu’ils obéissaient au chef de famille, tandis que ce dernier n’obéissait qu’au roi. — Le troisième degré était occupé par les serviteurs permanents de la maison, subdivisés eux-mêmes en esclaves et en affranchis. — On peut ranger dans une dernière classe tous les individus qui ne figuraient à aucun titre dans les cadres des familles dont je parle, soit qu’ils en fussent sortis de gré ou de force, soit qu’on eût refusé de les y admettre ; pour ce motif même, ils menaient une existence très précaire ; c’étaient des gens de métier, des ouvriers ruraux d’occasion, des aventuriers, des mendiants. Quand la royauté disparut, l’organisation sociale des États grecs n’en fut point modifiée. L’aristocratie continua de dominer, et il y eut seulement cette différence que le gouvernement lui appartint désormais tout entier. Cette classe, à la fois noble et riche, est souvent appelée par les anciens la classe des chevaliers. Il faut bien entendre le sens de ce mot. Un chevalier n’était pas un homme qui allait à la guerre, monté sur un cheval ; c’était un homme qui possédait des chevaux. En un temps où les pâturages abondaient, les chevaux étaient, comme les bœufs et les moutons, une des sources principales du capital. La fortune se reconnaissait surtout à ce signe qu’on avait de nombreuses têtes de bétail, et il suffisait de dire qu’un individu pratiquait l’élevage des bestiaux, pour dire qu’il était un grand propriétaire foncier. La prépondérance des chevaliers venait de ce qu’ils détenaient une bonne partie du sol. Dans quelques républiques, cette classe portait le nom de géomores. Ce terme désigne les hommes qui se partagent le territoire. Il était usité notamment à Syracuse et à Samos. Les géomores occupaient tout le sol et exerçaient tout le pouvoir. L’aristocratie n’était pas une caste tout à fait fermée ; car il n’était pas rare qu’un étranger, s’il était de noble naissance, y pénétrât. Mais elle ne s’ouvrait guère aux gens d’origine roturière. Il semble même que les mariages mixtes ne fussent point tolérés. Peu à peu, néanmoins, il se forma en dehors d’eux une sorte de bourgeoisie riche, dont les progrès furent désormais constants. Celle-ci puisait principalement sa fortune dans le commerce et l’industrie, qui, à partir du vine siècle, prirent un énorme développement. Mais elle en arriva aussi à acquérir le sol. Elle mit en culture des terrains vagues, des pâturages, des bois, que l’État lui abandonnait. Elle saisit avec empressement toutes les occasions qui s’offrirent de faire brèche dans les domaines des nobles, et ces occasions devinrent de plus en plus fréquentes. La Grèce, à cette époque, nous offre le spectacle d’une société où les rangs sont loin d’être fixés, et où, au contraire, un mouvement continu d’ascension pousse la basse classe à se rapprocher de la classe moyenne, et cette dernière à se confondre avec la classe supérieure. C’est par le travail que s’accomplit ce progrès. Hésiode loue ce genre d’émulation qui excite l’homme à lutter d’activité avec son voisin. Il trouve des expressions d’une singulière vigueur pour traduire son ardeur à la besogne, son âpreté au gain. Il n’était pas seul à éprouver ces sentiments. 11 ne fait en cela que reproduire les idées qui avaient cours autour de lui, et on conçoit que de semblables dispositions aient conduit beaucoup d’individus à l’aisance, puis à la fortune. Toute barrière tendit à disparaître entre les deux classes qui se partageaient la richesse ; elles s’allièrent l’une à l’autre par des mariages, au grand scandale des nobles, qui tenaient à la pureté de leur sang, et bientôt l’ancienne aristocratie de naissance fut presque partout remplacée par une aristocratie censitaire. C’est ainsi qu’à Athènes les distinctions sociales furent déterminées depuis Solon (commencement du VIe siècle) par le revenu de chacun. Il y eut une première classe, celle des pentacosiomédimnes, qui comprit tous les citoyens dont les terres donnaient un revenu net de 500 médimnes (262 hectol.), soit en grains, soit en liquides. La deuxième, celle des chevaliers, devait récolter 300 médimnes (157 hectol.) ; la troisième, celle des zeugites (qui possédaient un attelage), 200 médimnes (105 hectol.). Au-dessous de ce chiffre, on était inscrit parmi les thètes. Des privilèges spéciaux étaient accordés à chacune d’elles ; mais les charges étaient en rapport avec les privilèges, et un citoyen avait d’autant plus d’obligations envers l’État qu’il avait plus de droits. Il est à remarquer que dans cette répartition des citoyens on ne tenait compte que de la richesse foncière. Plus tard, les Athéniens eurent égard aussi à la richesse mobilière, et ils admirent dans les premières classes quiconque avait un revenu ou un capital suffisant, sans se demander quelle en était la provenance. Mais les classes n’avaient plus alors le même caractère qu’autrefois ; elles ne conféraient plus de droits politiques et ne servaient qu’à établir les différentes catégories de contribuables. L’ancienne division de Solon fut même supprimée au cours du IVe siècle. On distingua désormais dans Athènes les plus riches, ceux qui avaient le cens liturgique, et enfin ceux qui ne l’atteignaient pas. Ce n’étaient point là, à vrai dire, des classes sociales, mais des cadres institués en vue de la perception de l’impôt. Il ne faudrait pas croire pourtant que l’égalité la plus complète ait dès ce moment régné en Attique ; il y eut toujours une véritable hiérarchie. Les esclaves, les affranchis, les métèques ou étrangers domiciliés, en occupaient les degrés inférieurs, et la loi les plaçait tous bien au-dessous du citoyen, puisqu’elle ne reconnaissait aucun droit à l’esclave, qu’elle refusait tous les droits politiques au métèque et à l’affranchi, et qu’elle ne leur accordait même pas tous les droits civils. Ainsi, dans les sociétés les plus démocratiques, les citoyens, tous égaux entre eux malgré d’insignifiantes réserves, formaient une oligarchie très exclusive, qui se détachait nettement sur le fond de la population, qui s’ouvrait difficilement aux hommes restés en dehors, et qui affectait à l’égard de ces derniers le dédain qu’avaient eu jadis les nobles pour la roture. A Athènes, ces privilégiés étaient au nombre de 80.000, et les autres dépassaient le chiffre de 400.000. Dans les États aristocratiques, les rangs étaient encore plus marqués. Si l’on prend Lacédémone pour type, on y voit trois catégories de personnes : les Hilotes, colons qu’un lien indissoluble fixait au sol, les Périèques, qui descendaient des habitants primitifs du pays, et qui n’avaient plus que la jouissance des droits civils, enfin les Spartiates, Doriens d’origine et seuls citoyens. Parmi ceux-ci, il se créa à la longue des subdivisions. Au sein même de cette oligarchie déjà peu nombreuse surgit une nouvelle oligarchie encore plus restreinte qu’on appela la classe des Égaux, et qui concentra dans ses mains toute la richesse et tout le pouvoir. Les Néodamodes, les Mothakes, les Inférieurs s’échelonnèrent au-dessous d’eux. On désignait par là des hommes qui n’avaient pas réussi à acquérir tous les droits civiques ou qui, pour des raisons multiples, les avaient perdus en partie. Toutes les classes subordonnées avaient pour les Égaux une haine profonde. Il n’était pas un périèque, hilote ou un néodamode, dit Xénophon, à qui il n’eût été agréable de les manger tout crus. Il y eut dans toutes les républiques une ligne de démarcation que les lois ne purent jamais effacer, parce qu’elle tenait à la nature des choses ; c’est celle qui séparait les riches et les pauvres. Il est même visible qu’à partir du IVe siècle ce fut là l’unique distinction qui subsista entre les citoyens. Elle avait beau n’être point légale, elle n’en était pas moins réelle. Dans quelques cités, on s’efforça de l’atténuer par un système d’impôts qui dépouillait chaque année le riche d’une portion notable de sa fortune, et par un système de secours qui, s’il n’élevait pas le pauvre jusqu’à l’aisance, l’empêchait pourtant de tomber dans l’extrême misère ; tel fut le cas d’Athènes. Cette façon de procéder eut pour effet de diminuer l’antagonisme des classes et de conjurer les révolutions. Mais la paix sociale ne fut en Grèce qu’une exception. Le pauvre avait moins de facilités que chez nous pour grandir par le travail et l’économie, car il avait à compter avec la concurrence de l’esclavage, et il ne trouvait pas toujours à occuper ses bras ni son intelligence. Il n’était pas assurément sans exemple qu’un individu parti des derniers rangs de la société atteignît peu à peu les premiers, mais c’était assez rare. Il y avait donc dans chaque ville deux classes en présence : l’une qui possédait, qui augmentait sa richesse et qui voulait la conserver ; l’autre, indigente à la fois et paresseuse, jalouse autant que misérable, qui convoitait la richesse, et qui ne savait ni ne pouvait y parvenir. (Fustel de Coulanges.) Celle-ci avait pour elle le nombre et la force brutale ; elle eut l’idée de mettre à profit ce double avantage pour s’approprier les biens de ses adversaires. De là une longue série de violences et de guerres civiles. Ce fléau, en Grèce, fut de tous les temps mais il s’aggrava au IIIe et au IIe siècle. 5. — LES NON-CITOYENS À ATHÈNES. En dehors même des esclaves, beaucoup d’habitants de l’Attique n’étaient pas citoyens. 1° Métèques. — Un métèque était un étranger qui se fixait dans une ville avec l’intention d’y demeurer désormais. Il était obligé de prendre un patron parmi les citoyens, sous peine de confiscation. Il était astreint aux impôts ordinaires et au service militaire, sauf qu’on ne l’admettait pas dans la cavalerie ; de plus il payait une taxe spéciale de 12 drachmes par an. Il n’avait pas le droit de propriété foncière ; il ne pouvait posséder que des esclaves ou des objets mobiliers ; par suite, la plupart des métèques se livraient au commerce et à l’industrie. Quelques-uns recevaient le privilège de l’isotélie. Dans ce cas, ils n’avaient pas de patron, ils étaient dispensés de la taxe, et ils jouissaient de tous les droits civils du citoyen. 2° Affranchis. — L’affranchi étant presque toujours d’origine étrangère, était assimilé au métèque. Il n’en différait que sur un point, il avait nécessairement pour patron son ancien maître, au lieu de le choisir librement. 3° Νόθοι. — On appelait ainsi non seulement les enfants naturels, nés de deux personnes non mariées, mais encore les individus qui avaient pour père ou pour mère un étranger. Leur condition était celle des métèques. Il convient d’ajouter que le plus souvent on fermait les yeux sur cette irrégularité. C’était une grande faveur que d’obtenir le droit de cité. Mais il fallait de nombreuses formalités. D’abord la loi interdisait de créer Athénien quiconque n’avait pas mérité de devenir citoyen par des services signalés rendus à l’État. (Démosthène, Contre Néæra, 89.) En second lieu, un particulier rédigeait un projet de décret dans ce sens, et le peuple décidait si ce décret lui serait soumis. S’il prononçait la prise en considération, il votait dans une réunion ultérieure, six mille citoyens au moins étant présents à l’Assemblée. Enfin tout citoyen avait le droit d’intenter un procès à l’auteur de la motion, s’il ne la trouvait pas justifiée, et les tribunaux avaient la faculté de l’annuler. On essayait parfois de se faire inscrire indûment sur les registres civiques, avec la complicité de quelque magistrat : Si la fraude était découverte, on s’exposait à perdre ses biens et à être vendu comme esclave. 6. — CONCESSION DU DROIT DE CITÉ. Considérant qu’Événor le médecin s’est toujours montré bienveillant à l’égard du peuple, qu’il a mis son art au service des citoyens et des autres habitants de la cité, et que récemment il a donné au trésor un talent d’argent, le peuple a décidé de louer Événor, fils d’Évépios, Argien, et de lui décerner une couronne d’olivier, pour prix de sa bienveillance à l’égard du peuple athénien. Il sera Athénien, lui et tous ses descendants ; il pourra se faire inscrire dans la tribu, le dème et la phratrie qu’il voudra, conformément à la loi. On votera sur lui dans la prochaine réunion de l’Assemblée. Le présent décret sera gravé sur une stèle de pierre et déposé à l’Acropole. Corp. inscript. Attic., t. II, 187. 7. — POURSUITES CONTRE UN FAUX CITOYEN. Un certain Pancléon, étranger, se disait Platéen, ce qui l’eût à peu près assimilé aux citoyens d’Athènes. Un Athénien, qui avait à se plaindre de lui, le poursuivit en justice, et nous avons le discours qu’il prononça à ce sujet. Comme il ne cessait depuis longtemps de me nuire, je vins à la boutique de foulon où il travaillait, et je le citai devant le polémarque[3], pensant qu’il était métèque. Il prétendit qu’il était Platéen ; je lui demandai quel était son dème, et il me répondit qu’il était du dème de Décélie. Je me rendis alors chez un coiffeur que fréquentaient les gens de Décélie, et je m’informai s’ils connaissaient dans leur dème un certain Pancléon ; personne ne le connaissait. Je me mis en rapport avec le Platéen Euthycrite, pour savoir s’il connaissait Pancléon, Platéen, fils d’Hipparmodoros ; il me dit qu’il connaissait Hipparmodoros, mais que celui-ci n’avait point de fils. Les Platéens se réunissent le dernier jour du mois au marché au fromage ; j’y allai ; j’interrogeai ; nul ne connaissait Pancléon. Un seul, appelé Nicomède, me dit qu’il avait eu un esclave de ce nom, dont il m’indiqua l’âge et le métier, et que cet esclave s’était enfui. En effet, quelques jours après, Nicomède se saisit de Pancléon, comme étant son bien. Des amis de œ dernier le lui arrachèrent de force.... D’après Lysias, XXIIIe discours. 8. — RÉVISION DES LISTES CIVIQUES. Parfois on procédait à une révision générale de la liste des citoyens. Cette opération se faisait dans l’intérieur de chaque dème. Les membres du dème, réunis en assemblée, votaient successivement sur les différents noms, et on rayait ceux qui avaient été inscrits sans droit. On pouvait d’ailleurs en appeler aux tribunaux, dont la sentence était définitive. Le discours de Démosthène Contre Eubulide nous fournit sur tout ceci de nombreux détails. Lorsque mon nom fut appelé, dit le plaignant, il ne faisait plus jour. On était au numéro soixante, et je fus le dernier qui fut appelé ce jour-là. Les plus âgés des habitants étaient déjà partis pour retourner chez eux. Il ne restait pas plus de trente personnes. A l’appel de mon nom, Eubulide se leva d’un bond, et se mit à me diffamer, parlant vite et beaucoup, et avec de grands éclats de voix, sans produire un seul témoin à l’appui de ses allégations ; puis il engagea les membres du dème à voter ma radiation. Je demandai que l’affaire fût remise au lendemain. L’heure était avancée, je n’avais personne pour m’assister, je me trouvais pris au dépourvu. Mais cet homme n’eut aucun égard à ma demande formelle, et distribua sur-le-champ des bulletins de vote aux citoyens présents. Ses partisans se levèrent donc et votèrent. On n’y voyait déjà plus ; ils reçurent chacun deux ou trois bulletins, et les jetèrent dans l’urne. Il n’y avait pas plus de trente votants, et il se trouva plus de soixante bulletins, au grand étonnement de nous tous. (10-13.) Le plaignant porte alors l’affaire devant le tribunal, et il s’efforce d’établir que son père n’est pas étranger, comme on l’a prétendu, mais Athénien ; sa mère est aussi Athénienne. Quant à lui, il a toujours eu la qualité de citoyen ; la preuve, c’est qu’il a exercé un sacerdoce dans son propre dème. Il signale encore d’autres abus qui ont été commis dans la révision des listes : Voici des frères qui ont le même père et la même mère. Les uns ont été rayés, les autres non. Voici de malheureux vieillards qui ont été exclus, et dont on a gardé les fils. Mais écoutez ce qu’on a fait de plus fort. Des étrangers voulaient devenir citoyens. Ils les ont admis, moyennant une somme qu’ils se sont partagée à raison de cinq drachmes par tête. Le nombre est grand de ceux que les complices d’Eubulide ont rayés ou maintenus pour de l’argent. Déjà autrefois, Antiphile, son père, étant démarque, employa une manœuvre semblable pour se faire donner de l’argent de plusieurs mains. Il prétendit que le registre public avait péri, fit voter les habitants du dème sur eux-mêmes, et en attaqua dix qui furent exclus ; mais le tribunal les rétablit tous, sauf un. (58-60.) 9. — LE CITOYEN. Le citoyen était l’homme qui avait la plénitude des droits civils et politiques. Les droits civils étaient le droit de contracter un mariage légitime, le droit de posséder des biens fonciers et mobiliers, et le droit de soutenir en personne un procès devant les tribunaux. Les droits politiques étaient le droit d’assister aux séances de l’Assemblée populaire, d’y prendre la parole, et d’aspirer aux magistratures. Dans les États aristocratiques, tous les hommes libres et majeurs (sauf les étrangers) jouissaient des droits civils, mais ils ne jouissaient pas tous des droits politiques. Ainsi, à Athènes, même après Solon, les fonctions publiques étaient réservées aux classes riches ou aisées, et les pauvres étaient complètement exclus du pouvoir. Presque partout il fallait remplir certaines conditions de naissance ou de fortune pour participer au gouvernement, et le progrès de la démocratie consista justement à supprimer peu à peu toutes ces barrières. Tel est notamment le trait caractéristique de l’histoire intérieure d’Athènes. Mais là même, les citoyens ne formaient qu’une très petite minorité par rapport au chiffre total de la population. Ils n’étaient pas plus d’une vingtaine de mille sur 500.000 âmes ; et quelques-uns trouvaient que c’était encore beaucoup trop. Il n’y en eut guère que 5.000 sous le régime oligarchique des Quatre Cents. — A Sparte, on suivit la marche toute contraire. Primitivement, on y comptait, dit-on, 9.000 citoyens, et un moment vint où l’on tomba à 700. Une des peines que les tribunaux prodiguaient le plus était la privation des droits civiques, ou atimie. Cette déchéance avait des degrés. Tantôt elle se réduisait à la perte de tout ou partie des droits politiques, tantôt elle s’étendait aux droits civils ; elle était soit temporaire, soit définitive, et même héréditaire. Cela dépendait du délit qui avait été commis. Les individus άτιμοι étaient fort nombreux dans toutes les cités grecques. Parfois on les amnistiait, et ils recouvraient alors leur situation antérieure. Mais il était très difficile d’obtenir la réhabilitation d’un άτιμος isolé ; il y fallait à peu près les mêmes formalités que pour la création d’un nouveau citoyen. 10. — ASSERVISSEMENT DU CITOYEN A L’ÉTAT. La cité avait été fondée sur une religion et constituée comme une Église. De là sa force ; de là aussi son omnipotence et l’empire absolu qu’elle exerçait sur ses membres. Dans une société établie sur de tels principes, la liberté individuelle ne pouvait pas exister. Le citoyen était soumis en toutes choses et sans réserve à la cité, il lui appartenait tout entier. La religion qui avait enfanté l’État et l’État qui entretenait la religion se soutenaient l’un l’autre et ne faisaient qu’un ; ces deux puissances associées et confondues formaient une puissance presque surhumaine à laquelle l’âme et le corps étaient également asservis. Il n’y avait rien dans l’homme qui fût indépendant. Son corps appartenait à l’État et était voué à sa défense. Sa fortune était toujours à la disposition de l’État ; si la cité avait besoin d’argent, elle pouvait ordonner aux femmes de lui livrer leurs bijoux, aux créanciers de lui abandonner leurs créances, aux possesseurs d’oliviers de lui céder gratuitement l’huile qu’ils avaient fabriquée. La vie privée n’échappait pas à cette omnipotence de l’État. Beaucoup de cités grecques défendaient à l’homme de rester célibataire. Sparte punissait non seulement celui qui ne se mariait pas, mais même celui qui se mariait tard. L’État pouvait prescrire à Athènes le travail, à Sparte l’oisiveté. Il exerçait sa tyrannie jusque dans les plus petites choses : à Locres, la loi défendait aux hommes de boire du vin pur ; à Milet, à Marseille, elle le défendait aux femmes. Il était ordinaire que le costume fût fixé par les lois de chaque cité ; la législation de Sparte réglait la coiffure des femmes, et celle d’Athènes leur interdisait d’emporter en voyage plus de trois robes. A Rhodes, la loi défendait de se raser la barbe ; à Byzance, elle punissait d’une amende celui qui possédait chez soi un rasoir ; à Sparte, au contraire, elle exigeait qu’on se rasât la moustache. L’État avait le droit de ne pas tolérer que ses citoyens fussent difformes ou contrefaits. En conséquence il ordonnait au père à qui naissait un tel enfant de le faire mourir. Cette loi se trouvait dans l’ancien code de Sparte. Nous ne savons pas si elle existait à Athènes ; nous savons seulement qu’Aristote et Platon l’inscrivirent dans leurs législations idéales. Il y a dans l’histoire de Sparte un trait que Plutarque et Rousseau admiraient fort. Sparte venait d’éprouver une défaite à Leuctres, et beaucoup de citoyens avaient péri. A cette nouvelle, les parents des morts durent se montrer en public avec un visage gai. La mère qui savait que son fils avait échappé au désastre et qu’elle allait le revoir montrait de l’affliction et pleurait. Celle qui savait qu’elle ne reverrait plus son fils témoignait de la joie et parcourait les temples en remerciant les dieux. Quelle était donc la puissance de l’État qui ordonnait le renversement des sentiments naturels et qui était obéi ? L’État n’admettait pas qu’un homme fût indifférent à ses intérêts ; le philosophe, l’homme d’étude n’avait pas le droit de vivre à part. C’était une obligation qu’il votât et qu’il fût magistrat à son tour. Dans un temps où les discordes étaient fréquentes, la loi athénienne ne permettait pas au citoyen de rester neutre ; il devait combattre avec l’un ou l’autre parti. Contre celui qui voulait demeurer à l’écart des factions et se montrer calme, la loi prononçait une peine sévère, la perte du droit de cité.... L’homme n’avait pas le choix de ses croyances. Il devait croire et se soumettre à la religion de la cité. On pouvait haïr ou mépriser les dieux de la cité voisine ; quant aux divinités d’un caractère général ou universel, comme Zeus céleste, on était libre d’y croire ou de n’y pas croire. Mais il ne fallait pas qu’on s’avisât de douter d’Athènè Poliade ou d’Érechthée, ou de Cécrops. Il y aurait eu là une grande impiété qui eût porté atteinte à la religion et à l’État en même temps, et que l’État eût sévèrement punie. Socrate fut mis à mort pour ce crime. La liberté de pensée à l’égard de la religion de la cité était absolument inconnue chez les anciens. Il fallait se conformer à toutes les règles du culte, figurer dans toutes les processions, prendre part au repas sacré. La législation athénienne prononçait une peine contre ceux qui s’abstenaient de célébrer religieusement une fête nationale. L’État n’avait pas seulement, comme dans nos sociétés modernes, un droit de justice à l’égard des citoyens. Il pouvait frapper sans qu’on fût coupable, et par cela seul que son intérêt était en jeu : Aristide assurément n’avait commis aucun crime et n’en était même pas soupçonné, mais la cité avait le droit de le chasser de son territoire par ce seul motif qu’il avait acquis par ses vertus trop d’influence et qu’il pouvait devenir dangereux, s’il le voulait. On appelait cela l’ostracisme ; cette institution n’était pas particulière à Athènes ; on la trouve à Argos, à Mégare, à Syracuse, et Aristote fait entendre qu’elle existait dans toutes les cités grecques qui avaient un gouvernement démocratique. Or l’ostracisme n’était pas un châtiment ; c’était une précaution que la cité prenait contre un citoyen qu’elle soupçonnait de pouvoir la gêner un jour. A Athènes, on pouvait mettre un homme en accusation et le condamner pour incivisme, c’est-à-dire pour défaut d’affection envers l’État. La vie de l’homme n’était garantie par rien, dès qu’il s’agissait de l’intérêt de la cité. C’est donc une erreur singulière entre toutes les erreurs humaines que d’avoir cru que dans les cités anciennes l’homme jouissait de la liberté. Il n’en avait même pas l’idée. Il ne croyait pas qu’il pût exister de droit vis-à-vis de la cité et de ses dieux. Le gouvernement a plusieurs fois changé de forme ; mais la nature de l’État est restée à peu près la même, et son omnipotence n’a guère été diminuée. Le gouvernement s’appela tour à tour monarchie, aristocratie, démocratie ; mais aucune de ces révolutions ne donna aux hommes la vraie liberté, la liberté individuelle. Avoir des droits politiques, voter, nommer les magistrats, pouvoir être archonte, voilà ce qu’on appelait la liberté ; mais l’homme n’en était pas moins asservi à l’État. Fustel de Coulanges, la Cité antique, livre III, ch. XVIII. 11. — LES REPAS PUBLICS À SPARTE. Nulle part la discipline sociale n’était aussi forte qu’à Sparte. L’État y réglait la vie du citoyen jusque dans les plus petits détails. Il lui interdisait, par exemple, tout travail, toute occupation lucrative. On voulait qu’il ne songeât qu’à ses devoirs civiques ou militaires. Il lui imposait même l’obligation de prendre en commun avec tous les autres le repas du soir. Les repas publics, dit Plutarque, sont nommés phiditia par les Lacédémoniens. Chaque table était de quinze personnes en moyenne. Chaque convive fournissait par mois un médimne de farine d’orge (78 litres), huit conges de vin (39 litres), cinq mines de fromage (3 kilogr.), cinq demi-mines de figues, et avec cela quelque argent pour l’ordinaire. D’ailleurs, quand on faisait un sacrifice ou qu’on était allé à la chasse, on envoyait des viandes au repas commun, car il était permis de souper chez soi avec les mets de son sacrifice ou de la chasse ; mais, en toute autre circonstance, il fallait manger à la table commune. Pendant longtemps on observa strictement cette loi. Ainsi, le roi Agis, revenant d’une expédition où il avait vaincu les Athéniens, et voulant souper avec sa femme, fit demander des portions ; les polémarques les lui refusèrent. Les enfants mêmes assistaient à ces repas ; on les y conduisait comme à une école de tempérance ; ils y entendaient parler de politique, prenaient modèle sur les hommes libres, et s’accoutumaient à plaisanter, à railler sans bouffonnerie, et à être raillés sans dépit.... A mesure que chaque convive entrait, le plus âgé de l’assemblée lui montrait la porte et lui disait : Il ne sort pas un mot par là. Quand on voulait être admis à une table commune, il fallait, dit-on, subir l’épreuve que voici. Chacun prenait une boulette de pain, et la jetait, sans rien dire, en manière de suffrage, dans un vase que l’esclave de service portait sur sa tête. Pour agréer, on laissait simplement tomber la boulette ; pour refuser, on l’aplatissait fortement entre ses doigts. Si l’on en trouvait une seule, on ne recevait point le postulant, attendu qu’on ne voulait admettre personne qui ne fût agréable à tous les autres. Le plat le plus en vogue chez les Spartiates était le brouet noir. Les vieillards le préféraient à la viande, qu’ils abandonnaient aux jeunes gens. On dit qu’un roi de Pont acheta un cuisinier lacédémonien tout exprès pour savoir ce qu’était ce mets ; il en goûta et le trouva détestable. Prince, lui dit le cuisinier, il faut, pour le savourer, s’être baigné dans l’Eurotas. Après avoir bu sobrement, les convives s’en retournaient sans lumière. Il ne leur était permis de se faire éclairer ni dans cette occasion ni dans aucune autre ; on voulait qu’ils s’habituassent à marcher la nuit et dans les ténèbres avec assurance et intrépidité[4]. Plutarque, Vie de Lycurgue, 12 ; trad. Talbot. 12. — LES DÈMES ET LES TRIBUS. Tout citoyen faisait partie d’un dème et d’une tribu[5]. On connaît les noms de plus de 150 dèmes attiques, et ceux-ci étaient groupés en 10 tribus. Le dème était une partie déterminée du territoire d’un État ; c’était une commune, ayant le double caractère d’une association et d’une division administrative. (Haussoullier.) Tous les dèmes n’avaient pas une égale importance, mais tous avaient une organisation identique. Chacun d’eux avait à sa tête une sorte de maire électif, nommé le démarque, et plusieurs fonctionnaires civils ou religieux ; chacun avait ses cultes locaux, ses biens, son budget, ses têtes. Ses affaires étaient administrées par l’ensemble des citoyens qui habitaient le dème. Quant à la tribu, elle n’était pas une circonscription territoriale, mais une simple réunion de dèmes, pris arbitrairement dans différentes régions du pays, absolument comme si chez nous chaque canton se composait de communes situées aux quatre coins d’un département. Voici les noms des dix tribus de l’Attique : Érechthéis, Ægéis, Pandionis, Léontis, Acamantis, Œnéis, Cécropis, Hippothontis, Æantis, Antiochis. Elles avaient aussi leurs magistrats, leurs assemblées, et leurs ressources particulières. Décret rendu par une tribu (Corpus inscript. Attic., t. II, 564) : Considérant qu’Antisthène, fils de Nicandros,... a fait voter un décret qui permettra aux membres de la tribu de connaître l’état de leurs terres, et qui porte notamment que les épimélètes de la tribu inspecteront deux fois par an les propriétés, pour voir si elles sont cultivées conformément aux contrats, et si les bornes sont à leur place..., la tribu Érechthéis décide de louer Antisthène, et de lui décerner une couronne d’or, à cause de sa vertu et de l’esprit de justice qu’il montre sans cesse à l’égard des membres de la tribu ; et comme il n’a qu’une fille, les épimélètes veilleront spécialement sur elle ; si elle a besoin de quelque chose, ils en informeront la tribu réunie en assemblée, et ils ne souffriront pas qu’il lui soit fait aucun tort.... Décret rendu par un dème (ibid., 579) : Proposition de Philoctémon, fils de Chrémès : Considérant que Démocrate, fils d’Euphilétos, et Hégésias, fils de Lysistratos, chargés des frais de la chorégie, se sont bien acquittés de ce soin, les Aixonéens décident de les louer et de leur décerner à chacun une couronne d’or de 30 drachmes, en récompense de leur bon vouloir et de leur zèle à l’égard des démotes ; le démarque Dorothéos et les trésoriers leur donneront pour un sacrifice 10 drachmes sur les revenus du dème. Le démarque Dorothéos fera graver ce décret sur une stèle de pierre et la fera placer au théâtre, afin que les chorèges futurs sachent que le dème d’Aixoné récompensera leur zèle. 13. — AMOUR DE LA LIBERTÉ. La tyrannie est le pire fléau des États. Et d’abord, ce n’est plus alors la loi qui règne sur tous les citoyens ; le tyran en dispose à son gré ; il est seul maître ; l’égalité n’existe plus. Au contraire, sous l’empire de la loi, le pauvre et le riche ont des droits égaux ; il est permis au plus humble de répondre au puissant qui l’insulte, et le petit l’emporte sur le grand s’il a pour lui la justice. Un peuple est libre quand on demande aux citoyens : Qui a quelque chose à dire pour le bien de la république ?[6] Si l’on veut parler, on se met en lumière ; sinon, on garde le silence. Où trouver une plus complète égalité ? Là où le peuple est souverain, il est heureux d’avoir à son service de vaillants citoyens. Le tyran s’en inquiète, au contraire ; et les plus illustres, ceux qu’il croit capables de penser, il les fait périr, parce qu’il tremble pour sa tyrannie. Comment donc un État pourrait-il être fort quand il y a un homme qui fauche et moissonne les jeunes courages comme des épis dans un champ, au printemps ? A quoi bon amasser des richesses et gagner le pain de ses enfants, si l’on ne travaille que pour enrichir le tyran ? Élève-t-on chastement une vierge dans la maison maternelle pour qu’elle serve aux plaisirs, aux caprices du tyran, et plonge ses parents dans le désespoir ? Plutôt mourir que de voir mes filles exposées à ces violences ! Euripide, les Suppliantes, 429 et suiv. ; trad. Hinstin. 14. — OBLIGATION POUR LE CITOYEN DE DÉFENDRE LES INSTITUTIONS NATIONALES. En 409 av. J.-C., les Athéniens votèrent la loi suivante ; elle montre jusqu’où allait pour un citoyen le devoir de respecter et de défendre les institutions établies. Si un homme renverse la démocratie à Athènes ou exerce une magistrature quelconque après le renversement de la démocratie, il sera traité comme un ennemi du peuple athénien ; on pourra le tuer impunément, et ses biens seront confisqués, sauf un dixième pour Athéna. Le meurtrier et le complice du meurtre seront purs de toute souillure et de toute impiété. Tous les Athéniens, en immolant des victimes accomplies, jureront de le tuer. Que le serment soit comme il suit : Je m’engage à faire périr par la parole ou par l’action, par un vote ou de ma propre main, si je le puis, tout homme qui renversera la démocratie à Athènes, ou, après le renversement de la démocratie, acceptera dans la suite quelque fonction publique, ou aspirera à la tyrannie, ou aidera le tyran. Et si un autre le tue, je regarderai le meurtrier comme saint aux yeux des dieux et des démons, pour avoir tué un ennemi du peuple athénien. Je vendrai tous les biens du mort et donnerai au meurtrier la moitié du produit sans en rien retenir. Si quelque citoyen meurt en tuant ou en essayant de tuer l’un de ces criminels, je lui témoignerai ma reconnaissance ainsi qu’à ses enfants, comme on l’a fait pour Harmodios et Aristogiton et leurs descendants.... Tel est le serment ordonné par la loi, que devront prononcer tous les Athéniens, avant la fête des Dionysies, en immolant des victimes parfaites, et invoquant sur celui qui y restera fidèle des biens en abondance, sur le parjure la ruine pour lui-même et pour les siens. Andocide, Sur les mystères, 96-98 ; trad. Hinstin. 15. — PRÉFÉRENCE DONNÉE AU GOUVERNEMENT DE LA CLASSE MOYENNE. Il y a trois classes de citoyens : les riches, qui sont inutiles et ne songent qu’à amasser toujours plus de richesses ; puis ceux qui ne possèdent rien et manquent du nécessaire, violents, envieux surtout, toujours prêts à lancer des traits ingénieux contre ceux qui possèdent, et à se laisser tromper par les discours de chefs malfaisants. C’est la classe moyenne qui sauve les États, en maintenant dans la cité l’ordre établi. (Euripide, Suppliantes, 238 et suiv.) La société civile la plus parfaite est celle qui existe entre citoyens qui vivent dans une condition moyenne. Il ne peut y avoir d’États bien administrés que ceux où la classe moyenne est nombreuse et plus puissante que les deux autres, ou au moins plus puissante que chacune d’elles ; car elle peut faire pencher la balance en faveur du parti auquel elle se joint, et par là empêche que l’une ou l’autre obtienne une supériorité décisive. C’est donc un très grand bonheur que les citoyens ne possèdent qu’une fortune médiocre, et suffisante pour leurs besoins. Car toutes les fois que les uns ont d’immenses richesses et que les autres n’ont rien, il en résulte ou la pire des démocraties, ou une oligarchie effrénée, ou une tyrannie intolérable. (Aristote, Politique, VI (IV), 9, 8.) 16. — LES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES. Voici quelles sont les institutions démocratiques. c’est que toutes les magistratures soient électives par tous, et parmi tous les citoyens ; que tous aient autorité sur chacun, et chacun, à son tour, sur tous ; que les magistratures soient données par la voie du sort, au moins celles qui n’exigent ni expérience ni connaissances techniques ; que les dignités ou les emplois ne soient point distribués d’après un certain chiffre de fortune ou de revenu, ou le soient d’après un chiffre très faible ; que la même personne ne puisse exercer deux fois aucune magistrature, ou qu’il y en ait très peu qui soient dans ce cas, et qu’elles ne puissent être possédées qu’un très petit nombre de fois par le même individu, à l’exception des emplois militaires ; que toutes les fonctions, ou le plus grand nombre possible, ne soient jamais de longue durée ; que tous les citoyens soient appelés à juger dans les tribunaux ; que les juges soient pris dans toutes les classes, et prononcent sur toutes les sortes d’affaires, ou sur le plus grand nombre, sur les plus graves, comme sont les redditions de comptes des magistrats, les affaires générales de l’État, et les contrats privés ; enfin que la décision de toutes choses, au moins des principales, dépende entièrement de l’Assemblée générale des citoyens, et non d’aucune magistrature, ou au moins dans un très petit nombre de cas. (Aristote, Politique, VII (VI), 1, 8 ; trad. Thurot.) C’est d’après ces principes que fut organisée la démocratie athénienne. L’Assemblée du peuple était ouverte à tous les citoyens âgés de vingt ans ; pour y attirer même les plus pauvres, on imagina d’allouer d’abord une obole (0 fr. 16) et plus tard trois (0 fr. 48) à quiconque venait y siéger. Elle tenait des séances très nombreuses ; elles nommait les magistrats électifs, faisait les lois, décidait la paix et la guerre, jugeait certains crimes ou délits, et dirigeait véritablement toute la politique extérieure et intérieure de la république. Le Sénat ou Conseil, composé de cinq cents membres tirés au sort parmi les citoyens âgés de trente ans, étudiait au préalable toutes les propositions qui devaient être soumises au peuple, sans avoir le droit de les arrêter par un veto préventif ; il contrôlait en outre tous les fonctionnaires préposés aux différents services de l’administration ; les sénateurs ne demeuraient en charge qu’un an et touchaient une indemnité journalière de cinq oboles (0 fr. 80). Toutes les magistratures étaient conférées par l’élection ou par la voie du sort. Pour y aspirer, il n’était pas besoin de posséder un chiffre déterminé de fortune ni d’offrir des garanties de capacité ou de compétence ; il suffisait de justifier qu’on était un homme de bonne vie et mœurs. Elles ne duraient qu’un an, et elles étaient exercées chacune par plusieurs individus à la fois : ainsi les dix stratèges avaient tous ensemble le pouvoir exécutif. Un magistrat athénien n’avait aucune autorité propre ; il n’était que l’agent des volontés du peuple, de qui il dépendait étroitement. On ne se contentait pas de lui demander compte de sa conduite, quand ses fonctions étaient expirées ; à dix reprises différentes, dans le courant de l’année, on examinait ses actes, et on votait pour savoir s’il serait destitué. Le peuple, en un mot, était souverain dans la réalité comme en théorie ; il était la source de tous les pouvoirs, et il gouvernait l’État, non par des intermédiaires, mais directement. 17. — L’ASSEMBLÉE ATHÉNIENNE D’APRÈS LES POÈTES COMIQUES. L’Assemblée du peuple était remplie surtout des artisans et des marchands du Pirée et de la ville, les propriétaires qui habitaient loin d’Athènes n’ayant pas le loisir de s’y rendre, si ce n’est dans des circonstances exceptionnelles. Du jour où l’on fut payé pour y assister, c’est-à-dire au commencement du IVe siècle, les plus pauvres citoyens, que la nécessité de gagner leur salaire quotidien avait peut-être retenus jusque-là, l’envahirent. Ainsi les intérêts les plus graves de l’État dépendaient d’une majorité de prolétaires. Aristophane en invente un exemple amusant dans l’Assemblée des femmes. Celles-ci, déguisées en hommes, remplissent le Pnyx et se mêlent aux citoyens qui vont délibérer. Leur chef, Praxagora, propose un décret ayant pour objet de confier désormais aux femmes la décision des affaires. Alors, raconte un témoin oculaire, la foule des cordonniers, c’est-à-dire la foule des prolétaires, se met à applaudir ; les paysans, plus sensés, protestent par un grognement, mais, étant moins nombreux, ils sont battus. Voilà, au dire d’Aristophane, comment les choses se passaient. Quelles décisions réfléchies et prudentes pouvaient être prises par une telle réunion de citoyens ignorants, et, en raison même de leur pauvreté, irresponsables ? Tous ces Athéniens, qui, pris à part, et dans la vie ordinaire, étaient si intelligents, si sensés, devenaient, une fois assis sur le rocher du Pnyx, des badauds à qui l’on pouvait en faire voir de toutes les couleurs. Au milieu du tumulte, des cris, des applaudissements et des sifflets, tout en mangeant et en buvant, au point que les archers chargés de la police de l’Assemblée sont obligés d’emporter parfois la plus tapageurs, ils écoutent les orateurs, prêts à suivre celui qui saura le mieux les prendre par l’endroit sensible. Les grandes affaires de l’État les touchent moins que les questions de personnes, et lorsqu’ils s’en occupent, c’est pour se laisser aller aux illusions de leur imagination échauffée, ou aux impulsions de leurs instincts. Que le prix du poisson dont ils se nourrissent ait baissé, cela les intéresse bien plus que de faire la paix avec Lacédémone. Les hommes auxquels ils s’abandonnent ne doivent être que les pourvoyeurs de leurs besoins et de leurs plaisirs ; ils les écoutent tant qu’ils servent leurs passions, et leur donnent congé dès qu’ils en trouvent d’autres plus empressés à leur tenir la table prête. Ils préféreront le charlatan qui leur promettra de bonnes sandales et une tunique chaude pour l’hiver, à celui qui a pris Sphactérie. Aussi impitoyables dans leur rancune qu’aveugles dans leur confiance, leur idole d’aujourd’hui sera demain leur victime. En vain le favori de la veille s’évertuera, à force de servilité, à conserver les bonnes grâces du peuple ; en vain il se mettra à ses pieds et lui offrira sa tête pour qu’il s’y essuie les doigts après s’être mouché ; le peuple est las de son dernier courtisan et sourit au nouveau. Leur égoïsme naturel a été surexcité par les flatteries de leurs ministres ; ils sont habitués à se considérer comme les maîtres de tout, et, rapportant tout à eux, ils approuvent les exactions dont ils profitent, favorisent les spoliations qu’ils partagent, et font de la loi la complice de leurs vols. La mobilité de leur imagination les pousse à désirer toujours ce qu’ils n’ont pas : aujourd’hui Pylos, demain la Sicile, ensuite Carthage ; leur ignorance leur fait croire que tout est possible et les encourage à tout bouleverser ; ils ne se figurent pas que gouverner puisse être autre chose que faire et défaire sans cesse les lois. Ils rejettent le lendemain les mesures qu’ils s’étaient hâtés de prendre la veille ; ils jouent avec les décrets comme des enfants avec des balles ; les lois ressemblent chez eux aux toiles d’araignées qu’on déchire d’un coup de balai et qu’une nuit suffit à reconstruire. Quittez Athènes pendant trois mois, et vous ne la reconnaîtrez plus. La majorité dont nous parlions tout à l’heure applaudit à la proposition saugrenue de Praxagora, parce que c’est la seule nouveauté qui n’ait pas encore été essayée. Quand il a une fois goûté à ce plaisir d’être l’arbitre souverain de toutes choses, disposant par son vote des magistratures et des commandements, le peuple ne veut plus y renoncer ; il s’attache d’autant plus fort à ce pouvoir qu’il lui a coûté plus de peine, et qu’il s’en trouve moins digne ; il devient jaloux, soupçonneux, ennemi de toute supériorité ; dans la crainte des tyrans, il est tyran lui-même. Le souvenir de la tyrannie d’Hippias est resté vivant dans le souvenir de la démocratie ; à la fin des repas, en guise de chanson à boire, on chante les fameux couplets d’Harmodios ; pour peu qu’un citoyen riche déplaise aux gens de la dernière classe, ils voient en lui un prétendant à la tyrannie ; il se forme ainsi une catégorie de suspects. Cléon est dénoncé comme un tyran par son rival le marchand de boudins ; le chœur des vieux juges, dans les Guêpes, flaire en Bdélycléon un tyran, parce qu’il veut empêcher son père de juger. Leurs invectives contre le jeune aristocrate sont le résumé de bien des discours de démagogues. N’est-il pas évident pour nous tous, les pauvres, que la tyrannie se glisse secrètement jusqu’à nous pour nous saisir ? Eh ! misérable, nouvel Amynias, avec tes longs cheveux, tu prétends nous interdire l’usage des lois de la république, sans prétexte, sans discours spécieux ; tu veux commander seul ! Le chœur des vieillards voit dans le complot de Lysistrata une entreprise tyrannique. Au reste, on ne parle à Athènes que de conjurations ; la tyrannie est à la mode, elle a cours sur le marché, elle y est plus commune que le poisson salé. Ainsi, une Assemblée souveraine, où domine une majorité anonyme de pauvres gens préoccupés seulement de vivre aux dépens des riches et d’assurer contre eux le pouvoir qu’ils sont arrivés à conquérir, voilà la nouvelle royauté d’Athènes. Couat, Aristophane, pp. 69-72. 18. — UNE SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE ATHÉNIENNE. Dans ce passage, Euripide, sous prétexte de décrire l’Assemblée d’Argos réunie pour juger Oreste, trace le tableau d’une séance de l’Assemblée populaire d’Athènes. Je venais des champs, et, par hasard, j’étais entré dans la ville.... Je vois la foule arriver et prendre place sur la colline, où, le premier, dit-on, Danaos réunit une assemblée publique. A la vue de cette foule, j’interroge un citoyen : Que se passe-t-il à Argos ? Est-ce une nouvelle venue de l’ennemi, qui met ainsi en émoi la ville de Danaos ? — Ne vois-tu pas, me répond-il, Oreste qui s’avance, pour soutenir une lutte contre la mort dont il est menacé ? Alors, en effet, s’offre à mes yeux un spectacle inattendu, que j’aurais voulu ne jamais voir : Pylade et Oreste marchent ensemble ; l’un est abattu, épuisé par la maladie ; l’autre partage en frère les douleurs de son ami. Quand l’Assemblée des Argiens est au complet, un héraut se lève et dit : Qui veut parler ? Il s’agit de décider si Oreste doit périr ou non, pour avoir tué sa mère. Là-dessus se lève Talthybios. Toujours du parti des puissants, il prononce un discours ambigu : il entremêle l’éloge et le blâme, vantant Agamemnon, mais accusant Oreste d’avoir établi à l’égard des parents un précédent fâcheux ; et en même temps il ne cessait de caresser du regard les amis d’Égisthe.... Après lui parle le roi Diomède : il ne veut pas qu’on mette à mort Oreste, mais qu’on observe la loi religieuse, en le condamnant à l’exil. Son discours est accueilli par des murmures d’approbation et de blâme. Ensuite se lève un bavard effréné, puissant par son audace, Argien sans être d’Argos, un intrus dans la cité, qui compte sur le tapage, sur l’intempérance inculte de sa langue, et qui pourrait sans doute encore jeter la république dans quelque malheur. Car, lorsqu’un homme dont la parole est agréable et l’esprit pervers persuade la multitude, c’est un grand fléau pour la cité. Mais ceux qui ne lui donnent que de bons conseils, inspirés par la sagesse, servent utilement sa cause, sinon dans le présent, au moins dans l’avenir.... Cet homme disait donc qu’il fallait lapider Oreste ; c’est Tyndare qui le poussait à parler ainsi. Mais voici qu’un autre se lève et soutient un avis contraire. Il n’est pas beau ; mais c’est un homme de cœur, fréquentant peu la ville et les Assemblées, un de ces travailleurs des champs qui seuls sauvent leur pays, habile pourtant, quand il lui plaît, aux luttes de la parole, intègre, irréprochable dans sa vie. Il proposa de couronner Oreste, le fils d’Agamemnon, pour avoir voulu venger son père en tuant une femme perfide et impie.... Les honnêtes gens jugèrent qu’il avait raison, et personne ne parla après La victoire resta cependant à ce méchant démagogue qui demandait la mort d’Oreste. Euripide, Oreste, vers 866 et suiv. ; trad. Hinstin. 19. — RÉUNION EXTRAORDINAIRE DE L’ASSEMBLÉE. Démosthène raconte en ces termes l’assemblée extraordinaire qui se tint à la nouvelle que Philippe s’était emparé d’Élatée, tout près de la frontière de l’Attique. C’était le soir, un homme vient annoncer aux prytanes qu’Élatée est prise. Aussitôt les uns se lèvent de table, chassent les marchands de l’agora et font déployer les barrières ; les autres mandent les stratèges, appellent le trompette ; ce n’est que trouble dans la ville. Le lendemain, au point du jour, les prytanes convoquent le conseil. Vous, de votre côté, vous vous rendiez à l’Assemblée, et, avant que le conseil eût rien agité, rien résolu, tout le monde était rangé à ses places sur la colline. Bientôt après, les membres du conseil arrivent ; les prytanes déclarent la nouvelle et font paraître celui qui l’a apportée ; cet homme parle lui-même. Le héraut demande : Qui veut monter à la tribune ? Personne ne se lève. Il recommence plusieurs fois. Personne encore. Et tous les stratèges, tous les orateurs étaient présents ; et la patrie, de cette voix qui est la voix de tous, appelait un citoyen qui parlât pour la sauver ; car la voix du héraut qui se fait entendre, quand les lois l’ordonnent, c’est la voix de la patrie. Qui donc devait se présenter alors ?... Il fallait un homme qui eût suivi les affaires dès le principe, qui eût étudié la conduite de Philippe et pénétré ses desseins.... Celui que voulait un tel jour, c’était moi. Je parus, je montai à la tribune. Il proposa qu’on envoyât à Thèbes pour conclure une alliance avec cette cité. Nul ne contredit, tous applaudirent, et non seulement je donnai ce conseil, mais je rédigeai le décret ; le décret voté, j’allai en ambassade ; ambassadeur, je persuadai les Thébains Je poursuivis l’affaire, à travers tout, du commencement à la fin. Démosthène, Discours sur la couronne, 169 et suiv. ; trad. Dareste. 20. — UN HOMME D’ÉTAT AU Ve SIÈCLE : PÉRICLÈS. Tout le temps que Périclès fut à la tête de l’État pendant la paix, il gouverna avec modération : il sut le garder contre les périls, et sous cette direction, Athènes devint très grande. Quand la guerre (du Péloponnèse) eut éclaté, il est évident que là aussi il eut, pour l’avenir, le juste sentiment de la force de sa patrie ; et lorsqu’il fut mort, on rendit encore plus complètement justice à sa prévoyance au sujet de la guerre.... Puissant par sa considération et par son intelligence, et à l’abri de tout soupçon de vénalité, il maintenait la foule libéralement ; il la menait, au lieu d’être mené par elle, parce que, ne devant pas son pouvoir à des moyens illégitimes, il ne la flattait pas dans ses discours, mais pouvait par son autorité la contredire même avec force. Quand il voyait les Athéniens se livrer à une confiance déplacée et insolente, il les maîtrisait par sa parole et les frappait de crainte. Cédaient-ils à des frayeurs insensées, il relevait leur courage et les ramenait à la confiance. Il y avait donc à Athènes de nom, la démocratie ; de fait, l’autorité suprême du premier des citoyens. Mais les hommes qui vinrent après lui, plus égaux entre eux et désirant tous le premier rang, se mirent à abandonner les affaires aux caprices du peuple. De là vinrent bien des fautes. Thucydide, II, 65 ; trad. par J. Girard. 21. — UN HOMME POLITIQUE DU IVe SIÈCLE : HYPÉRIDE. Hypéride commença, comme la plupart des autres orateurs, par être logographe. C’était un office difficile à remplir. La discussion de droit était, il est vrai, moins savante et moins compliquée que chez nous ; mais il fallait déployer une habileté bien autrement grande pour réussir dans le reste du plaidoyer. Conserver au personnage qu’on faisait parler le caractère qui convenait à son âge et à sa condition, instruire et charmer cette espèce de jury ignorant et délicat qui devait prononcer la sentence, flatter ses passions politiques dans les causes importantes où il devenait assez nombreux pour former une véritable assemblée, et cependant ne se départir que rarement de l’élégance vive et familière, qui semblait imposée également par le goût de ces tribunaux populaires si souvent renouvelés au moyen du sort, et par la nécessité de se maintenir dans les limites du temps que mesurait assez avarement l’horloge à eau : voilà à quelles conditions devait satisfaire un bon écrivain de plaidoyers. Au bout de quelques années de ce métier, quand il y réussissait, il possédait un talent singulièrement souple et se sentait maître de sa fortune, soit comme avocat, soit comme orateur politique. Se bornait-il à mettre au service des particuliers sa science de légiste et son habileté d’écrivain, il levait tribut sur une clientèle assurée. Osait-il affronter, le grand jour de la place publique, il apportait les qualités les plus chères aux Athéniens, l’aisance et le naturel, les ressources d’une dialectique ingénieuse, le tact et la connaissance des hommes, enfin ces grâces discrètes qu’il avait pu développer à loisir par la pratique d’affaires où il ne mettait que son esprit. Le langage dont il devait user dans l’Assemblée du peuple différait peu de celui qui avait plu aux tribunaux dans ses plaidoyers politiques. D’ailleurs l’orateur ne rompait point avec l’avocat. Il en remplissait souvent le rôle, mais non plus sous un masque étranger. Non seulement les nécessités de la vie politique le contraignaient souvent de se défendre ou d’accuser pour son propre compte ; mais souvent aussi il venait en personne et à titre d’ami soutenir l’accusateur ou l’accusé par un discours subsidiaire qui pouvait être la pièce capitale du procès. Il y trouvait un moyen de prouver son dévouement à son parti et de fonder ou de maintenir son propre crédit dans sa tribu. C’est ainsi qu’un homme politique, dans l’intérêt même de sa carrière, donnait aux luttes des tribunaux une part considérable de son activité. Il y avait donc tout avantage pour lui à s’y être préparé de bonne heure. Voilà la marche que suivirent à Athènes beaucoup d’orateurs, dans le nombre, Démosthène ; voilà aussi celle que suivit Hypéride. Il fut d’abord seulement avocat, puis il fut à la fois avocat et orateur. C’est ce qui explique le nombre assez considérable de plaidoyers civils qu’il avait fournis aux recueils de l’antiquité. Des affaires de tribune et de succession, des débats entre contribuables, des procès intentés à des spéculateurs sur les denrées alimentaires, des actions d’immoralité, des plaintes pour injures ou voies de fait, des disputes à propos d’aqueducs ou de limites de propriétés : tels sont quelques-uns des sujets qui exercèrent devant les tribunaux l’éloquence d’Hypéride. Il affirme lui-même qu’il n’a jamais attaqué personne en son propre nom. Le fait est contredit par le procès d’Aristagora. Toutefois il ne lui était guère possible de se rendre à lui-même, vers la fin de sa carrière, ce témoignage, s’il ne s’y sentait autorisé par une réputation de modération relative. Les succès qu’il obtint devant les tribunaux contribuèrent sans doute à lui procurer les moyens de satisfaire son goût pour le luxe et pour le plaisir. En effet, au milieu du relâchement qui était alors général dans la société athénienne, on lui prête des mœurs particulièrement voluptueuses. On raconte qu’après la mort de sa mère, il alla jusqu’à chasser son fils Glaucippe de la maison paternelle, pour y établir à demeure la courtisane Myrrhine, célèbre par ses fastueuses exigences ; ce qui ne l’empêchait pas d’entretenir en même temps deux autres maîtresses, Aristagora au Pirée, et à Éleusis, dans ses propriétés, la Thébaine Phila, qu’il avait rachetée de l’esclavage pour un prix fort élevé.... Avec le souvenir de ses désordres, nous a été transmis celui de son amour pour la bonne chère. Il faisait tous les jours sa promenade au marché au poisson, et la comédie contemporaine s’est plus d’une fois égayée de son goût pour cet aliment si prisé par la gourmandise antique.... Un autre poète le représente comme joueur, et l’on sait avec quelle sévérité ce défaut était flétri par l’antiquité. Tel était Hypéride dans sa vie privée, sensuel, cédant sans réserve aux tentations que lui offrait la licence des mœurs de son siècle, effréné dans ses passions, sans souci ni de l’opinion ni de ses devoirs et de sa dignité de père, prodiguant en folles dissipations les richesses qu’il gagnait par son éloquence. La comédie médisait de l’origine de ces richesses. Il ne faut ni s’exagérer ni complètement nier la valeur de ces imputations. La satire politique ne disait pas toujours la vérité, surtout au théâtre. On doit ajouter que l’accusation de vénalité faisait, pour ainsi dire, partie des charges professionnelles d’un orateur. Quel orateur de cette époque ne s’est pas entendu appeler vendu ? Lycurgue seul conserve une réputation bien établie d’intégrité, et encore une tradition le représente-t-elle se justifiant à son lit de mort contre les accusations de Ménésechme, son successeur dans l’administration du trésor. D’un autre côté, l’opinion avait quelque raison de se déclarer aussi facilement contre les orateurs : souvent les affaires publiques étaient pour eux une source considérable de revenus. Les étrangers qui recherchaient la protection du peuple athénien, les villes grecques et les rois du Nord et de l’Asie, dont les intérêts étaient engagés avec les siens, ne croyaient pas pouvoir trop chèrement payer l’appui d’une éloquence applaudie au Pnyx ; et que n’étaient-ce pas que les trésors de certains princes ou seulement des satrapes, pour ne point parler du Grand Roi, comparés aux ressources des petites cités de la Grèce et d’Athènes elle-même ! De là, en grande partie, la haute position des principaux orateurs, riches et illustres patrons de pareils clients. Avec les stratèges, ils formaient dans l’État une sorte de classe supérieure, à la fois respectée et suspecte. Comme eux, ils exerçaient une influence décisive sur les destinées de la patrie ; comme eux, ils étaient en butte aux accusations de trahison, aux vengeances du peuple et à la haine des étrangers ; comme eux enfin, ils semblaient souvent réclamer, à titre de compensation légitime, le droit de se livrer à tous les excès du luxe et du plaisir. Alliés et ennemis donnaient aux uns et aux autres les moyens d’entretenir, dans l’intérêt ou aux dépens de la patrie, cette existence privilégiée. Nul ne rechercha avec plus d’ardeur qu’Hypéride ces avantages de la carrière d’orateur ; mais nul aussi n’en accepta plus résolument les périls, n’y opposa un cœur plus ferme ni un patriotisme plus énergique. J. Girard, Études sur l’éloquence attique, pp. 97-106. 22. — DÉFAUTS DE LA DÉMOCRATIE ATHÉNIENNE. Nous excellons dans l’action comme dans la parole ; et nous avons si peu de tête que, dans la même journée, sur la même affaire, nous n’avons plus la même opinion. Ce que nous condamnions avant d’aller à l’Assemblée, nous le votons, une fois réunis ; et puis, mi instant après, ce que nous venons de voter ici, à peine séparés, nous le blâmons de nouveau. Nous qui nous flattons d’être les plus sages des Grecs, nous prenons pour conseillers des gens que tout le monde méprise ; et ce sont eux que nous rendons maîtres absolus des affaires publiques, alors qu’aucun de nous ne voudrait leur confier aucune de ses affaires privées. Mais voici ce qu’il y a de plus déplorable : ceux que, tout d’une voix, nous déclarerions les plus pervers des citoyens sent pour nous les plus fidèles gardiens de la cité. Nous jugeons les métèques d’après les patrons qu’ils choisissent, et nous ne réfléchissons pas qu’on nous jugera nous-mêmes d’après les hommes qui nous gouvernent. Et combien nous différons de nos ancêtres ! Ils prenaient les mêmes chefs pour la république et pour l’armée[7] : celui qui du haut de la tribune peut donner les meilleurs conseils leur paraissait aussi capable de prendre les meilleures résolutions le jour où il serait livré à lui-même. Nous, au contraire, nous jugeons indignes des fonctions de stratège, comme étant dénués d’intelligence, des hommes dont nous suivons les avis dans les questions les plus graves ; et d’autres, que nul ne voudrait consulter sur ses intérêts privés ni sur les intérêts publics, nous les envoyons au dehors avec une autorité absolue, comme si, à l’armée, ils devaient être plus avisés et plus capables de prendre un parti sur les affaires de la Grèce entière qu’ici même, sur les affaires d’Athènes ! Isocrate, Discours sur la paix, 52 et suiv. ; trad. Hinstin. 23. — LE SÉNAT À SPARTE. Le conseil dirigeant de la cité était, à Sparte, le Sénat. Il se composait de vingt-huit membres, tous âgés de soixante ans au minimum, et inamovibles. Voici, d’après Plutarque (Lycurgue, 26), comment se faisait l’élection. L’Assemblée du peuple se réunissait ; une commission était enfermée dans un local voisin d’où l’on pouvait tout entendre sans rien voir. Chaque candidat traversait la place, dans un ordre déterminé à l’instant même par le sort ; sur son passage, la foule poussait des acclamations plus ou moins chaleureuses. La commission notait l’intensité des cris proférés en l’honneur des différents candidats, et on déclarait élu celui pour qui les clameurs avaient été le plus fortes[8]. Ce dernier, ceint d’une couronne, se rendait successivement dans tous les temples. Derrière lui marchait un cortège de jeunes gens qui louaient et exaltaient le nouveau sénateur, et de femmes qui chantaient des hymnes. Chacun de ses amis lui offrait une collation, en lui disant que la cité entière l’honorait par là. Après quoi, il allait au repas public ; les choses s’y passaient comme d’habitude, sauf qu’on lui servait deux portions, dont il mettait une à part. Le repas fini, ses parentes se présentaient à la porte de la salle ; il appelait celle qu’il estimait le plus, et lui donnait la portion qu’il avait réservée, lui disant qu’ayant reçu cette part comme un prix de vertu, il la lui cédait au même titre. Cette femme, à son tour, était reconduite par les autres à son domicile. L’entrée au Sénat était, du moins en théorie, la récompense suprême d’une vie honorable et consacrée au bien public. Mais Aristote laisse entendre que ces sénateurs étaient souvent accessibles à la corruption. En tout cas, c’étaient eux véritablement qui gouvernaient l’État. 24. — L’ASSEMBLÉE POPULAIRE À SPARTE. L’Assemblée du peuple, où étaient admis les citoyens âgés de trente ans, était loin d’avoir la même importance qu’à Athènes. Elle ne se réunissait qu’une fois par mois, à moins qu’il n’y eût urgence à la convoquer dans l’intervalle. On y restait debout ; ce qui prouve que les discussions n’étaient pas longues. Aucun particulier n’avait lé droit d’y faire une proposition ; on ne délibérait que par les motions présentées par le sénat, et le sénat lui-même n’apportait que des projets émanés de l’initiative des éphores. Primitivement, les simples citoyens ne pouvaient pas prendre la parole ; ils se bornaient à écouter les discours des sénateurs et des magistrats ; et l’Assemblée acceptait ou rejetait la loi en discussion, sans avoir la faculté de l’amender. On votait par cris, comme dans les élections, Au Ive siècle, il semble bien que chacun des assistants fût autorisé à parler et que le peuple fût libre de modifier à sa guise la proposition dont il était saisi ; mais dans ce cas les sénateurs avaient la ressource de la retirer avant le vote final, et par là d’empêcher toute décision d’intervenir. On voit combien l’Assemblée spartiate différait de l’Assemblée athénienne. En principe, elle était souveraine, comme l’autre, et toutes les questions importantes lui étaient soumises ; mais ce n’était pas elle qui gouvernait ; elle n’avait guère, en matière de législation, qu’un droit de sanction, et, en matière de gouvernement, qu’un droit de contrôle. 25. — LA ROYAUTÉ À SPARTE. Les rois étaient au nombre de deux ; ils se succédaient dans deux familles distinctes, qui descendaient d’Héraclès, et qui presque toujours étaient en rivalité. Les Spartiates entretenaient de leur mieux ce désaccord, afin de diminuer l’autorité réelle de leurs rois, dont ils se défiaient singulièrement. Les anciens étaient frappés du prestige dont on les entourait. Si l’on fait un sacrifice public, dit Hérodote, ils ont au festin la première place ; on les sert les premiers, et ils ont double part. Ils commencent les libations et ils reçoivent les peaux des victimes immolées. A la nouvelle lune et le septième jour du mois, l’État leur donne à chacun une victime sans défaut pour l’offrir à Apollon, et un médimne de farine et du vin. Dans les jeux, ils ont un siège d’honneur. Ils consultent par des individus de leur choix l’oracle de Delphes et ils ont la garde des oracles rendus.... A leur mort, on expédie des courriers qui annoncent la nouvelle dans toute la Laconie ; les femmes parcourent les villes, en frappant des chaudrons ; dans chaque famille, deux personnes libres, un homme et une femme, doivent prendre le deuil, sous peine d’une forte amende. De toute la contrée, beaucoup accourent aux funérailles, et s’y livrent à d’immenses lamentations, en se donnant de grands coups. Si un roi meurt à la guerre, on expose sa statue sur un lit orné de belles couvertures ; pendant dix jours, on suspend les assemblées et les tribunaux, et on demeure dans le deuil. (VI, 57-58.) Les Spartiates, ajoute Xénophon (Gouvernement des Lacédémoniens, XV, 9), veulent montrer par là qu’ils honorent leurs souverains, non comme des hommes, mais comme des demi-dieux. Tous ces usages s’expliquent par le caractère religieux dont les rois à Sparte et partout ailleurs étaient revêtus. Mais leur pouvoir politique n’était pas très considérable, et il ne cessa de diminuer avec le temps. Ils parlaient à l’Assemblée, sans la présider ; ils siégeaient au Sénat, mais ils n’avaient chacun qu’une voix. S’ils acquéraient quelque influence dans le gouvernement, comme Agésilas, ils le devaient moins à leurs attributions propres qu’à leurs qualités personnelles. Ils étaient puissants, s’ils réussissaient à gagner les éphores et le Sénat ; sinon, ils étaient sans force. Ils étaient les commandants naturels de l’armée, et c’étaient eux d’ordinaire qui conduisaient les expéditions militaires. Mais on leur adjoignait deux éphores, qui, sans avoir le droit de leur faire aucune observation, notaient tout ce qu’ils voyaient. A partir de la guerre du Péloponnèse, on institua à côté d’eux un conseil, dont ils devaient suivre les avis. Enfin, qu’un ordre secret venu de Sparte les rappelât, il fallait aussitôt obéir. Tous les mois, ils renouvelaient le serment de régner conformément aux lois établies. Tous les neuf ans, les éphores pouvaient, sous prétexte de quelque présage céleste, suspendre un roi de sa charge, jusqu’à ce que l’oracle de Delphes ou d’Olympie eût déclaré s’il était digne de l’exercer. Ils pouvaient en tout temps lui infliger une amende ; c’est ce qu’ils firent à l’égard d’Agésilas, pour le punir de sa popularité. Les rois avaient à rendre compte de tous leurs actes. On les citait volontiers en justice, et l’on en vit plusieurs destitués, exilés, ou mis à mort pour des raisons politiques. 26. — LES ÉPHORES. Il y avait cinq éphores, nommés tous les ans par un procédé que nous ne connaissons pas, et qui était peut-être analogue à celui dont on se servait pour les sénateurs. Ils n’étaient pas nécessairement choisis parmi les familles les plus nobles et les plus riches. Aristote remarque que des individus obscurs arrivaient souvent à cette magistrature. Ils étaient les véritables chefs du pouvoir exécutif. Tout le gouvernement de l’État se trouvait concentré dans leurs mains, pourvu qu’ils fussent d’accord avec le Sénat. Voici deux circonstances où se montre bien la nature de leur pouvoir. Un certain Cinadon se met à la tête d’une conspiration. Il est trahi par un de ses complices, qui le dénonce aux éphores. Ceux-ci procèdent secrètement à une enquête ; puis ils agissent sans retard. Ils ne songent même pas à convoquer l’Assemblée du peuple ; ils se contentent de réunir à la hâte quelques sénateurs. Comme ils ne savaient pas quel était le nombre des conjurés, et qu’ils craignaient une émeute, ils chargent Cinadon d’une mission hors de la ville, et ils lui disent d’emmener avec lui quelques jeunes gens que lui indiquera un autre magistrat ; c’étaient des hommes sûrs, à qui l’on avait donné les instructions nécessaires. A l’endroit convenu, ils arrêtent Cinadon ; ils se font livrer par lui les noms de ses principaux partisans ; et ils les signalent aux éphores, qui les jettent en prison. (Xénophon, Helléniques, III, 3.) A la fin de la guerre du Péloponnèse, les Athéniens vaincus demandent la paix. Ils envoient une députation au roi de Sparte Agis, qui était campé en Attique. Agis répond qu’il n’a pas les pouvoirs de traiter. Ils veulent alors entrer en pourparlers avec les autorités de Sparte. Arrivés à la frontière, leurs ambassadeurs font connaître aux éphores leurs conditions ; les éphores déclarent qu’elles sont insuffisantes et refusent de les entendre. On s’adresse alors à Lysandre, qui, sans être roi, avait plus que personne contribué à la défaite des Athéniens ; il répond, comme Agis, que tout dépend des éphores, et il informe en même temps ces derniers de la démarche qu’on a tentée auprès de lui. On envoie une nouvelle députation à Sparte avec pleins pouvoirs. Cette fois, les éphores consentent à négocier, et ils remettent aux Athéniens le texte écrit des propositions qui devront être acceptées. (Xénophon, Helléniques, II, 2 ; Plutarque, Vie de Lysandre, 14.) 27. — LUTTES DES PARTIS EN GRÈCE. Pendant la guerre du Péloponnèse, des luttes s’élevèrent dans toutes les villes entre les démocrates, qui appelaient les Athéniens, et les partisans de l’oligarchie, qui appelaient les Lacédémoniens.... Comme les deux partis trouvaient dans cette double alliance le moyen de nuire à leurs ennemis, et, du même coup, de s’accroître eux-mêmes, ces insurrections devinrent une ressource toute prête pour les esprits remuants et ambitieux. Ces troubles amenèrent pour les cités des maux nombreux et terribles, qui ont existé et qui existeront toujours, tant que la nature humaine sera la même, mais qui sont plus ou moins violents suivant les cas et les circonstances.... Les États étaient donc divisés par les séditions, et l’expérience des premiers, profitant aux autres, les poussait aux derniers excès et aux innovations les plus hardies, soit dans l’habileté des agressions, soit dans l’atrocité des vengeances. Chacun alors changea, par abus dans l’application, le sens ordinaire des mots. L’audace inconsidérée s’appela dévouement courageux au parti ; la lenteur prévoyante devenait une lâcheté déguisée ; la modération, une marque de la timidité ; et, quand on était prudent en tout, c’est qu’on n’était capable de rien. Se précipiter en furieux, c’était vraiment être homme ; niais tenir compte de sa sûreté dans un projet d’attaque, c’était chercher un prétexte pour reculer.... Les liens de parti devinrent plus étroits que ceux de famille, parce qu’on trouvait dans son parti plus de promptitude et de détermination.... On aimait mieux venger une insulte que de ne l’avoir pas reçue. Les serments de réconciliation, quand on était contraint d’en faire, n’avaient de force qu’au moment même où on les prêtait en désespoir de cause. Mais, à la moindre occasion, celui qui avait repris courage le premier, voyant l’autre sans méfiance, éprouvait plus de plaisir à lui nuire au moyen de la foi jurée qu’à l’attaquer ouvertement.... La cause de tous ces maux fut le désir du pouvoir excité par l’avidité et l’ambition ; et de là vint, une fois les querelles engagées, l’ardeur des partis. En effet, les chefs de cités, mettant en avant les beaux noms d’égalité politique ou de sage aristocratie, sous prétexte de veiller aux intérêts de la patrie, faisaient d’eux le prix de leur rivalité. Luttant par tous les moyens pour obtenir la victoire, ils osèrent se porter aux plus grands excès.... Quant aux citoyens modérés, ils étaient victimes des deux factions. Thucydide, III, 82-83 ; trad. par J. Girard. 28. — MASSACRES A CORCYRE (425 AV. J.-C.). Durant sept jours que la flotte athénienne fut à Corcyre, les Corcyréens massacrèrent tous ceux qu’ils regardaient comme ennemis de la démocratie. Quelques-uns furent victimes d’inimitiés privées ; des créanciers furent tués par leurs débiteurs. La mort parut sous mille formes.... Le père tuait son fils : on arrachait des asiles sacrés les suppliants, ou on les égorgeait au pied des autels. Plusieurs périrent murés dans le temple de Dionysos. Six cents échappèrent au carnage, et réussirent à s’établir sur un point fortifié d’où ils exercèrent leurs ravages dans toute la campagne. A la longue pourtant, ils durent capituler, étant attaqués à la fois par les démocrates de la ville et par les Athéniens. Il fut convenu qu’ils seraient transportés dans un îlot voisin, en attendant qu’on les expédiât à Athènes, où l’on se prononcerait sur leur sort. Les démocrates de Corcyre, craignant que Les Athéniens ne leur laissassent la vie sauve, imaginèrent un stratagème. Ils envoyèrent sous main des hommes dévoués qui, avec un faux-semblant de bienveillance, dirent aux prisonniers que ce qu’ils avaient de mieux à faire était de s’évader au plus vite sur un navire qu’on tiendrait à leur disposition. Ceux-ci donnèrent dans le piège. Mais les mesures étaient prises pour que leur bâtiment fût capturé à son départ. Dès lors la convention était rompue. Les Corcyréens n’eurent pas plus tôt ces hommes en leur puissance, qu’ils les enfermèrent dans un grand local, d’où on les retirait vingt par vingt, garrottés deux à deux, à travers une double haie d’hoplites, qui les frappaient ou les piquaient, à mesure qu’ils reconnaissaient un ennemi. A leurs côtés étaient des individus armés de fouets pour presser leur marche. Soixante furent ainsi extraits et tués à l’insu de leurs compagnons de captivité. Les autres croyaient qu’on les transférait ailleurs, mais on les détrompa. Mieux informés, ils invoquèrent les Athéniens, les conjurant de les tuer eux-mêmes, s’ils le voulaient. Ils déclarèrent qu’ils ne sortiraient plus, et qu’ils empêcheraient personne d’entrer. Les Corcyréens n’eurent garde de forcer les portes ; mais ils escaladèrent le toit, y firent des trous, et jetèrent à l’intérieur des flèches et des tuiles. Les prisonniers s’abritaient de leur mieux. Quelques-uns se donnaient eux-mêmes la mort. Ils s’enfonçaient dans le gosier les flèches qu’on leur avait lancées ; ils s’étranglaient avec les sangles des lits qui se trouvaient là, ou avec les lambeaux de leurs vêtements déchirés. Pendant la plus grande partie de la nuit qui recouvrit cette scène de carnage, tout fut mis en œuvre, de part et d’autre, pour donner ou recevoir la mort. Le jour venu, on empila les cadavres sur des charrettes, et on les transporta hors de la ville. On réduisit en esclavage les femmes qui avaient été prises. Thucydide, III, 81 et 85 ; IV, 446-448 ; trad. Bétant. 29. — UN TYRAN GREC DU SECOND SIÈCLE AV. J.-C. Nabis, tyran de Sparte, exilait les hommes les plus distingués par leur richesse ou par l’illustration de leurs ancêtres, et il distribuait leurs biens et leurs femmes à ses principaux partisans et à ses mercenaires, tous assassins et voleurs. Ces derniers, chassés de leurs patries à cause de leurs impiétés et de leurs crimes, accouraient de partout auprès de lui. Il était leur patron et leur roi ; il faisait d’eux ses satellites et ses gardes du corps, et il fondait sur eux une réputation d’impiété et une puissance qui fût inébranlable. Il ne se contentait pas de bannir les citoyens ; il s’arrangeait encore pour que, même au dehors, ils ne trouvassent aucun lieu sûr, aucune retraite paisible. Les uns étaient massacrés sur les routes par ses émissaires ; d’autres étaient rappelés d’exil pour être mis à mort ; enfin, dans les villes où ils résidaient, il faisait louer les maisons voisines des leurs par des individus qui n’inspiraient point de défiance, et il y envoyait des Crétois, qui par des ouvertures pratiquées dans les murs et par les fenêtres les perçaient de flèches, soit qu’ils fussent debout ou couchés. Il n’y avait en somme aucun endroit où l’on pût se réfugier, et la plupart des Lacédémoniens expulsés périssaient ainsi. Il, inventa une espèce de machine, qui représentait une femme couverte de beaux vêtements, et semblable à sa propre femme. Quand il mandait quelques citoyens pour leur soutirer de l’argent, il leur parlait d’abord avec amabilité.... Si on se laissait toucher par ses discours, il n’allait pas plus loin. Si l’on résistait, il ajoutait : Peut-être n’ai-je pas le talent de te persuader ; mais je présume qu’Apéga y réussira mieux. C’était là le nom de sa femme. Alors l’image dont j’ai parlé apparaissait. Nabis, la prenant par la main, la levait de son siège ; puis il saisissait l’homme, et l’amenait tout doucement vers la poitrine de la statue, dont les bras, les mains et les seins étaient garnis de clous en fer cachés sous ses habits. Il appuyait les mains du patient sur le dos de la femme, et l’attirant par quelque ressort, il le serrait peu à peu contre le sein de la prétendue Apéga, si bien qu’il l’obligeait par ce supplice à dire tout ce qu’il voulait. Il était intéressé dans les pirateries des Crétois. Il répandait dans tout le Péloponnèse des meurtriers, des détrousseurs de grand chemin, des voleurs de temples ; il prenait sa part de leurs rapines, et il leur ménageait dans Sparte un asile assuré.... Polybe, XIII, 6-8. |