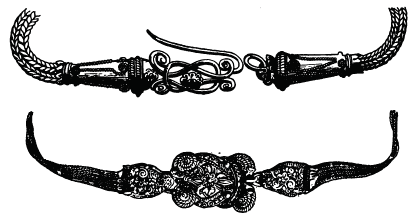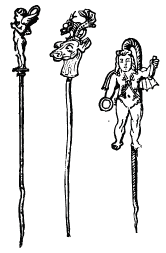LA VIE PRIVÉE ET LA VIE PUBLIQUE DES GRECS
CHAPITRE IV. — LA VIE PRIVÉE.
|
SOMMAIRE. — 1. Les
palais homériques. — 2. Aspect général des villes grecques. — 3. La maison
riche des Ve et IVe siècles. — 4. Le mobilier. — 5. Ornementation des vases.
— 6. Variations du costume grec. — 7. Le costume des hommes au Ier siècle. —
8. Le costume des femmes. — 9. La barbe et la chevelure. — 10. Bains. — 11.
La toilette des femmes. — 12. Les bijoux. — 13. Les repas. — 14. Les
cuisiniers. — 15. Un symposion. — 16. Les parasites. — 17. Le luxe à Sybaris.
— 18. Prix des denrées alimentaires. — 19. Prix des objets d’habillement et
d’ameublement. — 20. Le budget d’un ménage athénien. — 21. La médecine. — 22.
Les prêtres médecins. — 23. Guérisons opérées dans le sanctuaire d’Épidaure.
— 24. Les médecins publics. — 25. Les médecins privés. — 26. Les funérailles.
— 27. Nécessité de la sépulture. — 28. Double mode de sépulture. — 29. Objets
placés dans les tombeaux. — 30. Le culte du tombeau d’après les monuments
figurés. — 31. Une fondation funéraire. 1. — LES PALAIS HOMÉRIQUES. Dans les maisons royales, une seule partie paraît avoir été en pierre : c’étaient les chambres à coucher du maître et des personnes de sa famille. Telle est la pièce qu’Ulysse construit autour du tronc d’olivier sauvage qui sert de pied à son lit ; telles sont les soixante-deux chambres destinées aux fils et aux filles de Priam dans le grand palais de Troie ; tel est encore l’appartement de la déesse Circé. Ces chambres de pierre, très petites, devaient être enveloppées dans des constructions de bois. C’était de poutres et de planches qu’étaient faites ces grandes salles où l’on se réunissait pour manger et pour boire ; il en était de même de ces magasins où l’on gardait les provisions, les vêtements et les armes, ainsi que de ces abris où couchaient les esclaves. Le sel était de terre battue. Les parois et les plafonds des chambres, les battants, les chambranles et quelquefois même le seuil des portes étaient faits de sapin, de chêne, de frêne ou d’olivier. Par le polissage et peut-être à l’aide d’un vernis, le menuisier donnait aux faces apparentes des poutres et des planches un certain luisant. Ce qui assombrissait encore la couleur de ces boiseries, c’était la fumée du foyer, celle des graisses qui, lorsque rôtissait la viande, coulaient en grésillant sur les charbons ardents, celle enfin des éclats de bois résineux que l’on allumait, à la tombée de la nuit, sur un disque de métal, pour éclairer les appartements. Partout se déposait cette suie, qui dans la maison d’Ulysse avait endommagé les armes appendues aux lambris. Il n’y avait pas en effet de cheminée ; on faisait le feu, soit au milieu de la pièce, soit contre un mur, et la fumée s’en allait par la porte, ou par les interstices des ais de la cloison et du toit. Quelques passages d’Homère semblent indiquer la connaissance d’une décoration dont l’Orient a usé de bonne heure : nous voulons parler de revêtements en métal, en ivoire ou en faïence émaillée qui auraient été appliqués sur les plafonds et les murs, parfois sur les seuils des portes. Mais ces textes ne concernent que les demeures bâties par les dieux, ou encore le palais d’Alcinoos dans cette île de Schéria où tout est enchanté. Quant au palais de Ménélas, Télémaque y admire l’éclat du bronze, de l’or, de l’argent ou de l’ivoire ; mais le poète ne dit pas que ces, matières recouvrent les murs ; peut-être étaient-elles incrustées dans le mobilier. Dans la salle à manger où se réunissent les prétendants, on fait la cuisine toute la journée ; et les abatis des animaux tués sont entassés dans des corbeilles ou jetés dans les coins ; ce sont des pieds et des têtes de bœuf, ce sont des’ peaux fraîches et souillées de sang. La cour n’est pas plus propre. Devant la porte du logis, il y a un tas de fumier où s’étend et dort le vieux chien d’Ulysse ; de même dans le palais de Priam. Quand on cherche à se figurer une habitation, on songe aux konaks actuels des pachas et des beys de l’Asie Mineure. Même développement des constructions qui, partie en pierre, partie en bois, couvrent un large espace de terrain. Mêmes divisions de l’édifice : la partie ouverte et publique, le selamlik, qui correspond au mégaron d’Homère ; la partie secrète et privée, le harem, qui est l’ancien thalamos ; enfin de vastes dépendances pour les esclaves et les provisions. Devant et parmi ces bâtiments, des cours spacieuses et mal tenues, où flânent les gens et où vaguent les animaux. Dans les intérieurs, même mélange d’un certain luxe et d’un laisser-aller qui surprend l’Européen. Des armes de prix, des pipes enrichies de pierres précieuses, des tasses, des cafetières, des bassins d’une forme élégante, et surtout de beaux tapis. Avec cela, partout de la poussière, des murs tachés, des plafonds que la pluie a percés et salis. Dans des enfoncements, on voit amoncelées en pile les couvertures, que le soir les serviteurs étendent sur les divans et sur les planches, comme ils le font sans cesse dans l’Odyssée. Perrot, Revue des Deux Mondes, t. LXX (1885), pp. 294-298. 2. — ASPECT GÉNÉRAL DES VILLES GRECQUES. Pendant longtemps les cités grecques n’ont connu le luxe que pour les monuments publics. Les demeures particulières, d’une mesquinerie qui nous surprend, manquaient du confortable le plus élémentaire. Évidemment, ces gens-là ne vivaient guère chez eux, et le plus souvent dormaient dehors sous les portiques. Les rues des villes, étroites et tortueuses, rétrécies encore par les saillies et les balcons du premier étage, laissaient à peine arriver la lumière. Athènes surtout garda longtemps la physionomie la plus piteuse. La ville pourtant avait été brûlée pendant la guerre médique ; mais on la reconstruisit avec la même négligence ; les rues continuèrent à serpenter au hasard ; les maisons des quartiers populeux restèrent très petites et incommodes. Les étrangers en parlaient avec dédain. Démosthène lui-même voyait avec une sorte d’étonnement les pauvres logis de Miltiade, d’Aristide, de Thémistocle. Ce n’est que peu à peu que le luxe avait gagné les habitations privées. On avait rejeté plus loin le mur d’enceinte et percé de nouveaux quartiers. L’architecte Hippodamos de Milet accomplit une véritable révolution dans la construction des villes. Pour ses travaux du Pirée, de Thurium, de Rhodes, if se préoccupa de disposer les rues sur un plan régulier, d’aligner les maisons. Platon fait allusion aux nouveaux règlements de police dirigés contre les propriétaires. A Athènes, les astynomes et l’Aréopage furent chargés de veiller à la bonne tenue des maisons, d’imposer des réparations, de dresser les contraventions. Presque toutes les villes, Athènes et Mégare, Scione et Potidée, Samos et Sardes, s’entourèrent de grands faubourgs, où le luxe se déploya plus à l’aise. Pour comprendre ce changement, il suffit de comparer dans Athènes les vieux quartiers du Pnyx et de l’Aréopage aux quartiers neufs du Céramique et du Dipylon : aux taudis étriqués ont succédé de véritables habitations. Mais il est difficile de transformer les rues commerçantes des villes et d’y agrandir les maisons. Aussi la classe riche garda-t-elle l’habitude de vivre à la campagne. Thucydide et Isocrate constatent que de leur temps il faut chercher hors des murs les belles habitations. Au IVe siècle, Démosthène s’effraie du luxe croissant des maisons particulières. Pourtant, c’est surtout dans les pays d’outre-mer, aux colonies, qu’apparaît ce goût nouveau ; et c’est là que l’habitation hellénique, aux Ve et IVe siècles, atteint son apogée, dans les palais des tyrans et des rois. Monceaux, Dict. des antiquités, II, p. 342. 3. — LA MAISON RICHE DES Ve ET IVe SIÈCLES.
La porte ouverte, on entre dans la cour (B) (άύλή), entourée de trois, quelquefois des quatre côtés, par des péristyles. C’est le centre de la maison ; c’est là que se tiennent souvent dans la journée les maîtres du logis, qu’on reçoit les visiteurs, et même qu’on mange par les beaux temps. Au milieu se dresse l’autel de Zeus Herkeios ; vers le fond, à droite et à gauche, dans les coins de la cour ou dans des pièces latérales, les autels des dieux de la propriété (θεοί κτήσιοι), et des dieux de la famille (θεοί πατρώοι). Des deux côtés, sous les portiques, s’ouvrent différentes pièces, chambres à coucher, magasins, offices. Ils se trouvent aussi les chambres des hôtes. Par le portique qui fait face à l’entrée, ou, si le portique ne se prolonge pas de ce côté, par une large porte, on pénètre dans la salle des hommes (C). C’est la principale pièce du logis où se réunit la famille ; elle contient le foyer ou l’autel d’Hestia, parfois enfermé dans une petite chapelle ronde. Toute cette partie de la maison qui vient d’être décrite formait l’άνδρωνΐτις ou appartement des hommes. Au fond de la salle du foyer s’ouvrait une porte, la porte de derrière la cour (θύρα μέταυλος), par où l’on entrait dans l’appartement des femmes ou gynécée. On y rencontrait d’ordinaire la chambre conjugale (θάλαμος) et la chambre des filles (E, D), placées à droite et à gauche de la salle des hommes, puis d’autres pièces (G), où travaillaient les femmes esclaves. Derrière le gynécée s’étendait souvent un petit jardin (K) ; on y arrivait par une porte dite porte du jardin (θύρα κηπαία). La cour et les pièces du rez-de-chaussée couvraient des sous-sols, des citernes, des caves. Les maisons riches étaient aussi munies d’une salle de bains, d’une boulangerie, d’une pâtisserie. Quand on cessa de préparer le repas sur l’autel d’Hestia, on construisit une cuisine dans le voisinage de la salle des hommes, où l’on mangeait habituellement. La fumée des fourneaux s’échappait par des tuyaux de cheminée, les seuls de la maison ; car les appartements ne se chauffaient jamais qu’avec des foyers portatifs, analogues au brasero d’Italie et d’Orient. Les maisons grecques, d’Athènes notamment, avaient presque toujours un premier étage. Quand les pièces du rez-de-chaussée suffisaient à la famille, on louait volontiers à des étrangers les pièces supérieures, auxquelles des escaliers conduisaient, dans ce cas, directement de la rue. Dans les habitations modestes, le premier étage était relié au rez-de-chaussée par un escalier intérieur, et renfermait des magasins, des greniers, très souvent l’appartement des femmes ; c’est là aussi que couchaient les servantes. Sur la cour et sur la rue, le premier étage faisait saillie. Déjà Hippias, fils de Pisistrate, avait frappé d’une taxe les balcons, les escaliers extérieurs et les fenêtres grillées du premier. Au IVe siècle, Iphicrate fit voter par les Athéniens un impôt analogue sur ces balcons de bois Dans les belles maisons, les galeries étaient décorées de balustrades et de colonnes. Les murs donnant sur la rue étaient percés de petites fenêtres, où se tenaient volontiers les femmes ; ces lucarnes étaient protégées par des volets ; il n’y eut de vitres que sous l’empire romain. A Athènes, après la guerre du Péloponnèse, on commence à construire des maisons plus élevées. On ajoute un deuxième étage, et même un troisième. Aristophane, dans le Plutus, raille la hauteur de la maison de Timothée. Celle de Midias, à Éleusis, était si démesurée, qu’elle couvrait d’ombre ses voisines. Toutes ces maisons avaient des toits en tuile. Pour la construction, on employait des matériaux divers, des pierres de taille ou des moellons pour la fondation, de la brique crue et du bois pour les murs. Ces murs étaient faciles à percer ; à Athènes, c’était la spécialité d’une classe de voleurs (τοιχωρύχοι). Longtemps la décoration fut très simple. On se bornait à étendre sur les murs une couche de chaux. Au IVe siècle se répandent des habitudes de luxe. Dans la maison de Phocion, les murs étaient ornés de plaques de bronze. On employait aussi dans l’ornementation l’or et l’ivoire. Alcibiade fit décorer sa demeure de peintures murales. Le goût s’en répandit vite. Il y en avait dans tous les vestibules de la petite ville de Tanagra. Dans le péristyle, on plaçait des tapisseries, des broderies, de riches pavements. La plupart des pièces étaient fermées par des portières. Les plafonds étaient parfois, dès le temps d’Eschyle, couverts d’arabesques ; les Corinthiens donnèrent l’exemple des lambris sculptés, et l’on y vit souvent de vrais tableaux. Si l’on considère la décoration, l’aménagement, les proportions de la grande maison hellénique au IVe siècle, on ne peut s’empêcher de lui trouver belle apparence. Mais les riches habitations étaient rares, et l’on n’en peut tracer qu’une sorte de plan idéal. Dans toute la ville, il y avait une foule de logis intermédiaires entre la pauvre boutique taillée dans le roc et la grande maison à péristyle[1]. Monceaux, Dict. des antiquités, II, pp. 345-346. 4. — LE MOBILIER. 1° Sièges. — Le diphros est un siège bas, sans dossier, à quatre pieds disposés en X ou perpendiculaires. Quand il avait la première forme, il se pliait sans difficulté ; car le siège se composait de sangles entrelacées ; quand il avait la seconde, il ne se pliait pas, le siège et les pieds étant solidement attachés ensemble. En ajoutant un dossier à un diphros non pliant, on créa le κλισμός, qui offre une grande analogie avec nos chaises ; on entendait par θρόνος tous les sièges plus grands qui, outre un dossier élevé, avaient encore des appuis latéraux pour reposer les bras. Dans les temples, le thronos était le siège de la divinité ; chez les particuliers, c’était la place d’honneur du maître de la maison et de ses amis. Difficiles à déplacer par suite de leurs dimensions, ces meubles étaient parfois fixés aux murs, tandis que les autres sièges étaient mobiles. On les faisait généralement en bois dur. Ceux des dieux et des magistrats étaient souvent en marbre. Presque toujours ils avaient, sur toutes leurs parties, de riches ornements. On les couvrait volontiers de peaux moelleuses, de tapis ou de coussins. Pour y monter, on se servait fréquemment d’escabeaux. 2° Lits. — La charpente de la couchette antique n’était autre chose qu’un prolongement du diphros. Prolonge-t-on le diphros à pieds croisés, on obtient un lit de camp ; prolonge-t-on le diphros à pieds droits, on a une sorte de banquette dépourvue de dossier. En ajoutant un dossier au chevet, puis un autre aux pieds, ensuite un troisième dans le sens de la longueur, on produisit des meubles semblables à nos chaises longues et à nos sophas. Comme matériaux, on employait, outre les bois ordinaires, l’érable et le hêtre ; avec ce dernier, on fabriquait des meubles soit massifs, soit plaqués. Les lits étaient soigneusement travaillés, surtout les parties qui n’étaient pas recouvertes d’étoffes, comme les pieds et les dossiers. Les pieds étaient sculptés ou bien ouvragés au tour ; le reste du lit était souvent incrusté d’or, d’argent, ou d’ivoire. Dans Homère, il n’est jamais question de coussins et autres objets de literie luxueux. Le lit de l’homme riche se compose d’abord des ρηγέα, qui étaient soit des couvertures tissées de laine longue, soit une espèce de matelas. On mettait par-dessus des τάπητες. Quelquefois on étendait sous les ρηγέα des peaux de brebis. Sur le corps, on plaçait des χλαΐναι. Ce mot, qui signifie manteau, indique qu’avant de se coucher on ôtait ses vêtements pour s’en couvrir, ou bien qu’on avait des couvertures de laine pour cet usage. — Après Homère, on posa immédiatement sur la sangle le matelas appelé κέφαλον, τυλεΐον ou τύλη, qui était formé d’un mélange de laine et de plume enfermé dans une enveloppe de toile ou de laine. Sur ce matelas, on disposait des couvertures. Des oreillers rembourrés complétaient la literie. Les Grecs avaient encore des lits pour lire, pour écrire et prendre leurs repas. Ils les couvraient de tissus moelleux et plucheux, remarquables par leur finesse et l’éclat de leurs couleurs ; un ou deux coussins, bien bombés, maintenaient le corps à demi assis, ou servaient d’appui au bras gauche. 3° Tables. — On n’employait les tables que pour porter les ustensiles nécessaires dans les repas. Tantôt carrées, tantôt rondes ou ovales, reposant sur trois pieds ou sur un seul, elles étaient comparables aux nôtres, avec cette différence pourtant qu’elles étaient plus basses, et que leur plateau atteignait à peine la hauteur du lit. Les pieds étaient exécutés avec beaucoup de goût. On aimait à leur donner la forme de jambes d’animaux ou à les terminer en sabots. On fabriquait ces meubles avec du hêtre principalement, et plus tard avec du bronze, des métaux nobles et de l’ivoire. 4° Coffres. — Les Grecs conservaient leurs vêtements dans des coffres plus ou moins grands[2]. Il est douteux qu’on ait connu dans la haute antiquité les commodes à tiroirs mobiles et les armoires droites, munies de vantaux. Cela ne se voit guère que dans des monuments d’une époque plus récente. Les coffres à serrer les habits, mentionnés assez souvent dans Homère, avaient sans doute quelque ressemblance avec nos vieux bahuts. Ils étaient chargés de figures et d’ornements de toute sorte, sculptés ou incrustés de métal et d’ivoire. Ces meubles sont rarement représentés sur les monuments figurés ; mais il n’est pas rare d’y rencontrer de petits coffrets portatifs, où l’on serrait les objets de toilette, les bijoux. A l’époque homérique, une bande d’étoffe nouée tenait lieu de fermoir. Dans la suite, on consolida les extrémités de cette bande avec de la terre glaise humectée ou de la cire ; on y appliquait alors un anneau à cacheter. On imagina même de clore ces caisses avec des serrures. 5° Ustensiles de ménage. — Parmi les ustensiles à conserver les provisions, le πίθος occupe la première place, à cause de son volume. C’était un vase sans pied, à panse épaisse d’argile, se terminant tantôt en pointe, tantôt à plat. Dans le premier cas, il était assez petit, et on l’enfonçait dans la terre, pour qu’il pût se tenir en équilibre ; dans le second, il était de grandes dimensions et avait un large orifice. Le στάμνος ressemblait au pithos, quoique d’une moindre capacité. Le βΐκος se rattache à la même famille. Dans toutes ces jarres, on enfermait du vin, de l’huile, des figues, des salaisons. L’amphore était un vase à deux anses, à large panse ovoïde, à collet plus ou moins long, avec un orifice proportionné à la panse ; elle reposait souvent sur un pied ; mais souvent aussi elle finissait en pointe, et il fallait alors l’appuyer contre un mur ou la placer sur un socle. Le κάδος était une variété de l’amphore. L’hydrie était une sorte de cruche, ayant sur la panse une troisième anse, qui permettait de plonger le vase dans l’eau et de le soulever ensuite pour le mettre sur la tête. Le κώθων était usité en voyage, notamment parles soldats en campagne ; c’était une bouteille à goulot étroit, à anses, et à panse assez forte ; elle était faite d’une argile spéciale, qui débarrassait l’eau de ses impuretés. Tel était aussi le βομβυλιός ; le liquide en sortait goutte à goutte, avec un certain glouglou. Les lécythes étaient des vases à pied de forme allongée, munis d’une anse et destinés à recevoir des parfums. L’άλάβαστρον était un petit flacon cylindrique, un peu rétréci vers le collet et pourvu de deux oreillons où se trouvait parfois une ouverture ; on le suspendait au moyen d’un fil passé dans ces trous. Ce vase était destiné à renfermer des parfums et des essences. — Les ustensiles à mélanges, usités dans les repas et dans les libations, portaient le nom général de cratère. Le cratère avait une grande panse, un large orifice, deux anses sur les côtés et un pied propre à lui donner une assiette solide ; la forme d’ailleurs a beaucoup varié[3]. — On distinguait parmi les vases à verser : l’aryballe, élargi dans le bas et rétréci au collet, dit Athénée, comme une bourse dont les cordons sont serrés ; l’œnochoé, le chous, le prochous, qui offraient quelque analogie avec nos brocs ; le cotyle, qui était usité comme mesure de capacité, mais qui était aussi un vase de libations et qui servait, dans les repas, à boire le vin pur ; le kyathos, espèce de tasse à long manche, qui permettait de puiser dans un autre vase, sans plonger ses doigts dans le liquide. — Quant aux vases à boire, c’étaient la φιάλη, écuelle plate, sans anses et sans pied, au fond un peu bombé ; la κύλιξ, coupe à deux anses portée sur un pied très gracieux ; le κάνθαρος, grande tasse à deux anses, à fond tantôt plat, tantôt pointu ; le κάνθαρος, coupe à grandes anses et à pied élevé ; le καρχήσιον, coupe oblongue, légèrement renflée au milieu de la panse et garnie d’anses qui descendaient jusqu’au bas ; enfin le ρυτόν ou κέρας, qui était en forme de corne. — Pour la batterie de cuisine, il n’en reste, sauf quelques plats, presque aucun vestige. La χύτρα était une marmite à deux anses où l’on faisait cuire les légumes et la viande. Parfois elle avait trois pieds ; mais d’ordinaire on la plaçait sur un trépied. Le λέβης, généralement d’airain, était à peu près semblable. Nos musées possèdent des exemplaires de plats ; ils sont tous d’un travail massif ; les poissons que représentent leurs peintures indiquent assez leur usage ; de là le nom d’ίχθύαι qu’on leur donnait[4]. — Le calathos était une corbeille faite de jonc ou d’osier entrelacé, assez étroite à la base, s’évasant graduellement ; on y mettait la laine destinée aux ouvrages de tapisserie et de broderie. On pouvait y mettre aussi des fleurs, des fruits, des épis, les produits de la moisson ou de la vendange. Pendant les repas, le pain et la pâtisserie fine étaient servis dans des corbeilles rondes ou ovales, assez basses et munies d’anses (κανοΰν). On employait encore ces objets pour les offrandes aux dieux ; dans la procession des Panathénées figuraient des jeunes filles, appelées canéphores[5]. 6° Flambeaux et lampes. — Pour éclairer et chauffer les appartements, les Grecs se servaient déjà, au temps d’Homère, de récipients à feu reposant sur de hauts piliers et remplis de bûches et de bois sec ou de copeaux résineux. Ils avaient aussi des torches résineuses composées de morceaux de bois de pin longs et minces, reliés au moyen de bandes d’écorce de roseau ou de papyrus. Plus tard, on imagina des espèces d’étuis en métal ou en argile dont la surface était unie, et l’intérieur plein de substances résineuses ; on les appelait du nom de φανός. L’étui était généralement fixé au milieu d’un pot de terre destiné à recevoir le charbon qui tombait ou la résine qui coulait. Le phanos placé sur un pied était un λυχνοΰχος. On ignore à quel moment précis l’usage des lampes à huile s’introduisit en Grèce ; on les connaissait, en tout cas, à la fin du Ve siècle. Elles étaient en terre cuite ou en métal, et affectaient les formes les plus variées ; elles avaient deux ouvertures, l’une par où entrait l’huile, l’autre par où sortait la mèche. La nuit, pour s’éclairer dans les rues, on employait des torches ou des lanternes consistant en une lampe mise dans une corne transparente. On allumait le feu avec les étincelles qui couvaient sous la cendre du foyer ; on savait pourtant produire la flammé en frottant vivement deux morceaux de bois, dont l’un taillé en vilebrequin s’enfonçait dans l’autre. Guhl et Koner, La vie antique, I, pp. 184-225 ; trad. Trawinski. 5. — ORNEMENTATION DES VASES. Je reproduis ici la description de quelques peintures de vases, pour montrer quelle était souvent la richesse de leur ornementation. On connaît une série de vases dont la destination commandait des sujets d’un ordre spécial. Ce sont les belles amphores à panse élancée, à col allongé, désignées sous le nom de loutrophores, et qui jouaient un rôle dans les cérémonies du mariage. Sur une d’elles est figuré d’un côté le départ du nouveau couple pour sa demeure. L’époux, un tout jeune homme, couronné de myrte, a pris sa femme dans ses bras et va la déposer sur le char attelé de mulets que conduit le parochos, choisi parmi les amis du fiancé ; près d’eux se tient un des enfants chargés de faire la conduite à l’épousée. Dans une autre partie, séparée de la première par une colonne dorique, le père et la mère de l’époux, celle-ci tenant des torches nuptiales, accueillent les mariés au seuil de la maison paternelle.... La peinture d’une œnochoé place sous nos yeux une scène d’intérieur au gynécée. Le milieu de la composition est occupé par une sorte de tablette munie de pieds, peut-être tout simplement un tabouret, suspendue au plafond de la chambre à l’aide de trois cordelettes. Une femme, tenant un petit objet rond qui ressemble à un vase à parfums, est occupée à y empiler des, vêtements soigneusement pliés ; près de là, d’autres vêtements, jetés à la hâte sur un siège à dossier, attendent leur tour. De l’autre côté, une femme, vêtue d’une robe de fine étoffe et d’une courte tunique sans manches couverte de broderies, est absorbée dans une opération qui provoque au plus haut point la curiosité d’un jeune garçon ; elle verse le contenu d’une œnochoé sur des objets réunis en tas et où il faut peut-être reconnaître des pièces d’étoffe. La première face d’un scyphos du Ve siècle représente l’enlèvement d’Hélène. Pâris marche vers la gauche, d’un pas rapide. Il est coiffé du grand casque argien, a sur le corps deux fines tuniques et sur les épaules un grand manteau de voyage. Il tient dans la main droite une longue lance, et, de la main gauche, serre le poignet d’Hélène, qui le suit, les yeux baissés, la marche indécise, dans une pudique attitude de tristesse. Elle a son voile sur la tête, à la manière des jeunes filles et des fiancées. Aphrodite, debout derrière elle, travaille des deux mains à arranger savamment les plis de ce voile et encourage sa protégée à partir allègrement. Eros, figuré dans les airs sous la forme d’un enfant ailé, cherche, lui aussi, en lui montrant la route, à l’entraîner. Quelques figurants achèvent de remplir la scène ; derrière Aphrodite, Peitho (la Persuasion) semble, comme la déesse, parler à Hélène et la confirmer dans sa résolution ; devant Pâris, un jeune guerrier, Énée, la tête nue, les cheveux légèrement bouclés, le pétasos suspendu derrière le dos, deux javelots dans la main droite, et dans la gauche un bouclier rond décoré de l’image d’un lion, a l’air de trouver que l’on s’attarde, et, tournant la tête vers ses compagnons, il paraît les exciter à aller vite. Enfin, tout à fait à droite de ce groupe de six personnages, dans le petit espace laissé vide par l’anse de la coupe, est un homme jeune et beaucoup plus petit que les autres, et qui fait un geste d’étonnement. Sur l’autre face est Ménélas, retrouvant dans le palais de Priam, après la prise de Troie, son épouse infidèle, et tirant son glaive pour la tuer. Hélène s’enfuit vers Aphrodite. Celle-ci, par un geste d’une singulière audace, enlève rapidement l’épais manteau dans lequel Hélène était enveloppée, et son attitude impérieuse, sa tête levée, ses yeux regardant bien en face, son bras droit étendu, commandent à Ménélas de se réconcilier avec sa femme. Trois figures de remplissage encadrent ce groupe d’une composition ingénieuse et très vivante : à gauche, la jeune prêtresse Khriséis, suivie de son père, Khriseus ; droite, Priam, assis sur un diphros. Rayet et Collignon, Histoire de la céramique grecque, pp. 202-203 et 247-250. 6. — VARIATIONS DU COSTUME DES FEMMES. L’ancien costume hellénique, avant les guerres Médiques, est un costume ajusté, que serre aux hanches une étroite ceinture. Autour du torse, il s’applique sur les chairs ; au-dessous de la taille, il tombe droit par devant, et, chez les femmes, traîne par derrière sur les talons, tout gaufré de petits plis dont le nombre et la rigoureuse symétrie ne s’expliquent pas seulement par la nature du tissu, mais encore par l’empois et le fer à repasser. Quelques siècles plus tard, le goût n’est plus le même. L’élément principal du costume, c’est toujours une pièce d’étoffe en forme de carré long, que des agrafes et, plus rarement, des points de couture permettent de disposer en différentes manières autour du corps ; mais cette pièce a pris plus d’ampleur, et la laine, qui avait les préférences des Doriens, parait l’avoir emporté dans tout le monde grec sur la toile de lin dont les Ioniens, à l’époque d’Homère, faisaient aussi un très fréquent usage. Le tissu de laine a bien plus de corps que la toile ; il est plus indépendant des formes qu’il enveloppe ; le mouvement y creuse des sillons plus larges et plus fermes. Cette substitution d’une matière à une autre a dia être pour beaucoup dans le changement qui s’est produit ; on en pourrait encore trouver d’autres raisons, tirées des mœurs qui se sont modifiées, du sens esthétique qui s’est affiné. Quoi qu’il en soit, la draperie s’est affranchie des minuties de l’apprêt ; elle s’est défaite de cet air de gêne et d’étranglement auquel n’échappent guère les costumes collants. Les anciens Ioniens goûtaient fort la claire blancheur des toiles de lin ; mais ils teignaient la laine en rouge, en violet, en jaune, en bleu. On prenait plaisir à la complication des dessins, que le tisserand les obtint sur son métier par le mélange des fils ou que l’aiguille de la brodeuse les traçât sur le fond. Dans les bordures, l’élément géométrique prodiguait ces combinaisons ; dans le champ, c’étaient des étoiles, des feuillages, des fleurs, des animaux réels ou chimériques, parfois des figures de dieux et de génies, des scènes de chasse ou de combat. Les Grecs n’ont jamais perdu tout à fait le goût de ces vêtements multicolores, de ces étoffes à grands ramages. Pourtant ce qui domina au Ve et au IVe siècle, c’était un vêtement simple et uni, blanc ou brun, orné tout au plus d’une bande jaune, rouge ou bleue ; cette bande était parfois sobrement décorée d’un méandre ou quelque autre motif analogue. Perrot, Revue des Deux Mondes, t. LXX (1885), pp. 299-300. 7. — LE COSTUME DES HOMMES AU IVe SIÈCLE. Le principal vêtement des hommes était le chiton ; il se mettait directement sur le corps, sans chemise. Le chiton était une pièce d’étoffe qui de haut en bas enveloppait tout le corps. D’un côté, il était complètement fermé, et n’avait qu’une emmanchure pour passer le bras. De l’autre côté, les coins supérieurs de l’étoffe se rejoignaient sur l’épaule au moyen d’une agrafe ou d’un bouton. Le chiton était, de ce côté-là, tantôt cousu dans toute sa longueur, tantôt, mais plus rarement, ouvert ; une ceinture permettait de le retrousser à volonté. Les Athéniens le portèrent d’abord long, comme les Ioniens d’Asie Mineure ; après les guerres Médiques, ils le remplacèrent par le modèle court des Doriens, qui ne dépassait pas le genou. Souvent on y adaptait des manches ou des demi-manches. Celui des esclaves et des ouvriers (exomis) n’avait qu’une emmanchure pour le bras gauche, et laissait à nu le côté droit. Par-dessus le chiton, on jetait un vêtement de forme oblongue et très ample appelé himation. On fixait un des coins de l’étoffe sur la poitrine au-dessous du bras gauche ; l’étoffe couvrait ensuite l’épaule gauche, le dos, passait sur ou sous le bras droit, revenait sur l’épaule gauche, et retombait finalement, par une de ses extrémités, sur le dos. C’était donc une sorte de manteau espagnol. Une variété de ce manteau était le tribonion, espèce de surtout beaucoup plus petit, originaire des cités doriennes. La chlamyde était un manteau court qu’on attachait par une agrafe autour du cou et qui flottait librement sur les épaules et sur le dos. On le portait à la chasse, à la guerre et en voyage. Les jeunes gens, à Athènes, et les citoyens, à Sparte, en faisaient leur costume ordinaire. Dans la ville, les Grecs allaient habituellement tête nue. A la campagne ou en voyage, ils s’abritaient contre le soleil soit avec le πΐλος, calotte de feutre sans rebord, ou à rebord très petit, soit avec le πέτασος, chapeau de feutre, moins profond que les nôtres, et muni d’une courroie qui servait à le fixer sur la tête, ou à le retenir quand on le rejetait sur le dos. La chaussure la plus usitée était une sandale attachée au pied par des courroies. Les Grecs connaissaient aussi une véritable botte (endromis), en peau ou en feutre, qui montait jusqu’au mollet, même au delà, et se laçait sur le devant. Au reste, ils marchaient souvent nu-pieds. 8. — LE COSTUME DES FEMMES. Rien de plus simple que le costume féminin. La partie fondamentale en est la tunique (chiton), tombant jusqu’aux talons. C’est une robe où le corsage ne fait qu’un avec la jupe ; tantôt le vêtement a de petites manches ; tantôt il est ouvert par le haut et s’agrafe sur l’épaule. C’est le costume d’intérieur, fait d’une étoffe à la fois souple et lourde, généralement de la laine, quelquefois du lin. D’ordinaire cette robe est blanche, et bordée d’une bande de couleur ; elle est serrée à la taille par une ceinture qui permet de varier les effets ; les jeunes filles la mettaient autour de la taille ; les femmes mariées la portaient plus haut, suivant la mode que l’époque du Directoire emprunta à l’antiquité. Les bras demeuraient à découvert ; les pieds étaient finement chaussés. Les femmes de Thèbes, dit un ancien, portent des bottines minces, basses et étroites, de couleur rouge ; ces bottines sont si bien lacées que le pied semble presque nu. A Tanagra, les figurines portent des bottines jaunes à semelle rouge. Tel était le vêtement d’intérieur ; mais ce négligé un peu sommaire n’était ni assez chaud ni assez décent pour la rue, ni assez élégant. Quand on voulait sortir et faire toilette, on mettait par-dessus l’himation, nommé tantôt péplos, tantôt calyptra. Il est assez difficile de marquer la différence de ces deux termes, d’autant plus que les Grecques n’étaient pas moins curieuses de modes nouvelles que nos contemporaines. Il semble pourtant que la calyptra était plus petite et plus fine, le péplos plus épais et plus ample. L’important d’ailleurs était de savoir ajuster élégamment cette pièce d’étoffe large de 1m,50 et de deux à deux fois et demie plus longue, qui tantôt était blanche et tantôt rose, comme à Tanagra, ou bordée de bandes de couleur pourpre ou noire. La manière de la porter variait à l’infini. Faisait-il un peu chaud, dit Rayet, voulait-elle se mettre à l’aise, la Grecque laissait la calyptra flotter par derrière à la hauteur de la taille, en la soutenant seulement sur les deux bras à demi repliés et laissant les bouts pendre de chaque côté ; ou bien encore elle rassemblait un de ces bouts et le rejetait négligemment par-dessus son épaule gauche. Ce n’était plus alors qu’une écharpe élégante, un prétexte à des poses gracieuses. Voulait-elle se draper plus strictement, elle posait la pièce d’étoffe sur le sommet de la tête et rejetait l’extrémité droite par-dessus l’épaule gauche, de manière à la faire pendre par derrière ; le vêtement collait ainsi sur la poitrine et laissait une main en liberté. Quelquefois le bas de la figure était voilé par la pièce d’étoffe ; c’était la mode des femmes de Thèbes. La partie de leur himation, dit un auteur ancien, qui forme voile au-dessus de leur tête, est disposée de telle sorte que le visage est réduit aux proportions d’un petit masque ; les yeux sont seuls à découvert, tout le reste est caché sous le vêtement. Sur le sommet de la tête, les femmes posaient volontiers un chapeau rond, presque plat, et surmonté d’une pointe ; à la main, elles prenaient l’éventail en forme de lotus, généralement peint en bleu clair ; aux bras, aux mains, elles attachaient les bijoux d’or ; enfin le fard et l’antimoine servaient à faire la figure, et de savantes mixtures donnaient aux cheveux une belle teinte d’un fauve doré qui rappelle le blond vénitien. Diehl, Excursions archéologiques en Grèce, pp. 575 et suiv. 9. — LA BARBE ET LA CHEVELURE. Dans les monuments les plus anciens, on ne voit pas de barbe entière, mais seulement un épais collier à l’assyrienne, qui enveloppe les joues, s’avance fort au delà du menton, et laisse le tour des lèvres entièrement dégagé. Cette mode persista à Sparte. Les Lacédémoniens avaient la barbe longue et touffue, parce qu’ils y voyaient une marque de virilité ; mais chaque année, à leur entrée en charge, les éphores renouvelaient la prescription légale de couper sa moustache. Athènes, on laissait pousser la barbe, sans excès toutefois, et l’on en prenait le plus grand soin. Il y avait cependant des individus qui par coquetterie se rasaient et s’épilaient, sans crainte des mauvais propos qu’on débitait sur eux. Quelques rares témoignages prouvent que le rasoir et les pâtes épilatoires furent d’assez bonne heure en usage, notamment dans la Grande-Grèce. Pourtant ce n’est qu’à partir d’Alexandre que l’on renonça, d’une manière générale, à porter la barbe. Couper sa barbe, ou, au contraire, la porter longue et intacte, fut, selon les temps, un signe d’affliction et de deuil. (Saglio, Dict. des antiquités, I, p. 667-669.) Avant les guerres Médiques, la coiffure des Grecs a un caractère tout oriental. Les grandes robes de lin et les longues chevelures, qui distinguaient alors les principaux citoyens, devaient leur donner un aspect semblable à celui des dignitaires égyptiens ou assyriens. Tantôt les cheveux flottaient librement, divisés en mèches bouclées qui tombaient toutes droites dans le dos ou étaient ramenées en partie de chaque côté sur la poitrine ; tantôt on les rejetait en arrière, soit en longues tresses, soit en une seule masse serrée par un ruban. Quelquefois, au lieu de les laisser pendre dans le dos, on les enroulait et on les relevait sur la nuque, en forme de chignon. — Après les guerres Médiques, la coiffure des hommes se raccourcit, et devient toute différente de celle des femmes. A Athènes, les hommes ne portent plus les cheveux longs que pendant leur enfance, et jusqu’à l’âge d’éphèbe. On renonce aux arrangements symétriques. Les cheveux sont courts, mais non pas ras, du moins chez ceux qui fréquentent encore les gymnases et les palestres ; plus tard ils atteignent une longueur moyenne et tombent sur le cou, sans atteindre les épaules. S’ils bouclent, c’est naturellement. Une épaisse chevelure, haute sur le front, se répandant autour du visage, fut toujours, aux yeux des Grecs, un signe de force et de fierté. Pour les Spartiates, on ne sait s’ils avaient la chevelure longue ou courte en temps ordinaire ; les renseignements des anciens sur ce point sont contradictoires. Les Eubéens sont caractérisés par l’épithète όπισθοκόμαι (qui portent les cheveux en arrière) ; les Thraces, par celle de άκροκόμαι (qui les relèvent sur le sommet de la tête) ; les Macédoniens eurent les cheveux longs jusqu’à Alexandre, et courts après. — Ces usages souffraient d’ailleurs des exceptions. A Athènes, par exemple, les élégants, comme Alcibiade, portaient une longue chevelure soigneusement entretenue. Ce fut aussi le trait distinctif des philosophes que d’avoir de longs cheveux. Les athlètes, au contraire, les ont ordinairement très courts, et parfois tout ras. La coiffure des femmes changea également après les guerres Médiques, en ce sens qu’elle fut désormais moins apprêtée. Beaucoup laissaient flotter librement leurs boucles ; d’autres liaient l’extrémité de leurs cheveux ou l’emprisonnaient dans une espèce de bourse ; d’autres encore les séparaient en bandeaux unis qui se rattachaient au chignon, ou les relevaient, les enroulaient en couronne autour d’une bandelette, les maintenaient par une tresse. Il en était enfin qui les laissaient descendre seulement jusqu’au cou, et atteindre à peine les épaules. Des bandelettes, de longues épingles, des résilles, ou des sortes de mouchoirs aidaient à consolider l’édifice, souvent assez haut, de la coiffure. Une simple touffe ramassée et nouée sur le sommet de la tête paraît avoir été une coiffure propre aux jeunes filles. A Sparte, celles-ci avaient les cheveux longs et libres ; mais le jour du mariage, on les leur rasait complètement. On invoquait volontiers l’assistance du coiffeur ou de la coiffeuse. Les ustensiles ordinaires de ces artistes étaient les peignes, les ciseaux à cheveux, les ciseaux à ongles, les rasoirs, les miroirs, les serviettes, les fers à biser. On parfumait la chevelure avec des essences odoriférantes ; on la peignait, on la frisait. Les teintures n’étaient pas non plus inconnues aux femmes grecques ; dès le Ve siècle, on savait se faire des cheveux noirs ou blonds. Les faux cheveux étaient aussi en usage ; on portait une perruque entière, ou bien de simples tours de cheveux. D’après quelques épigrammes de l’Anthologie, c’était une denrée courante qu’on achetait à l’agora avec les autres articles de toilette. Pottier, Dict. des antiq., I, p. 1355 et suiv. 10. — BAINS. L’usage des bains, chauds ou froids, fut commun en Grèce dès les temps anciens. Les hommes et les femmes ne se contentent pas de se plonger dans la mer ou dans les rivières, ils prennent aussi des bains préparés à domicile. Homère les décrit avec sa précision habituelle. Le feu est allumé sous un trépied ; au-dessus est posé un vase d’airain, où chauffe l’eau qui doit être versée dans la cuve et mêlée à l’eau froide ; la personne à qui le bain est destiné entre dans cette cuve, et une autre la lave en répandant l’eau sur sa tête et ses épaules, puis la frotte d’huile et l’habille. Ce sont des femmes qui prennent ces soins, ordinairement les servantes, ou les filles de la maison, quelquefois la maîtresse elle-même. Dans Homère, le bain n’est considéré que comme un moyen accidentel de se délasser ; il n’est pas encore d’une pratique courante et journalière. Bien des siècles plus tard, la fréquentation des bains chauds, hormis au gymnase, passait pour un signe de mollesse. Les anciennes lois d’Athènes défendaient d’en établir dans l’enceinte de la ville, tandis que les bains froids et la natation faisaient partie de la première éducation. Les Spartiates se plongeaient tous les jours dans les eaux de l’Eurotas ; mais les bains chauds ne leur étaient permis qu’exceptionnellement. Peu à peu cependant d’autres mœurs prévalurent. A Athènes notamment, on s’accoutuma à se baigner chaque jour vers le milieu de l’après-midi. Quelques-uns même se baignaient deux ou trois fois par jour, faisaient des bains leur séjour ordinaire, y soupaient, s’y livraient à des exercices et à des distractions de toute espèce. Il y avait des bains publics ; il y en avait aussi de privés dans les maisons riches, d’autres enfin qui étaient des entreprises particulières, et où l’on entrait en payant. Une légère redevance était due également par ceux qui allaient aux bains publics. Beaucoup d’individus les fréquentaient par plaisir ; les pauvres y venaient pour se chauffer. Le baigneur fournissait au besoin l’huile, les terres grasses, la soude, et les divers ingrédients dont on se servait pour la toilette ; mais le plus souvent on les apportait avec soi, ou on les faisait apporter par un esclave, ainsi que le linge et les strigiles. On voit sur un vase peint un édifice qui a la forme d’un portique surmonté d’un fronton. A l’intérieur, l’eau jaillit de deux mufles de panthère ; deux hommes debout la reçoivent en douche, en se frottant la poitrine, le dos et les épaules, faisant eux-mêmes et sans aide les opérations dont un homme de service était ordinairement chargé ; des éphèbes, groupés deux à deux de chaque côté du portique, se font aussi les onctions d’usage avec l’huile contenue dans de petits vases qu’ils ont suspendus aux branches des arbres, auprès de leurs vêtements. Tout cela indique une représentation du bain fort ancienne. La scène se passe en plein air, et, autant qu’on en peut juger, il n’y a dans l’établissement aucune pièce spécialement destinée aux frictions, ni à la conservation de l’huile, ni au dépôt et à la garde des habits : autant de dépendances jugées indispensables dans les bains, quand ils eurent pris tout leur développement, ou dans les gymnases dont les bains faisaient partie. Ordinairement le bain chaud précédait le bain froid. On se plongeait dans l’eau chaude et on la faisait répandre sur son corps ; ou bien on provoquait la sueur en se tenant dans une étuve, soit sèche, c’est-à-dire dont l’air était sec et chaud, soit remplie de vapeur par l’aspersion de cailloux et de morceaux de fer incandescents. Hérodote mentionne le bain de vapeur comme une chose connue de tout le monde au Ve siècle. Les Sybarites eurent les premiers, dit-on, des baignoires où l’on pouvait se coucher. Il y avait même dans quelques établissements des piscines alimentées par une eau courante. Mais ce qu’on rencontre le plus fréquemment sur les monuments figurés, ce sont de grandes vasques circulaires, montées sur un pied rond ou sur une colonnette, près desquelles se tiennent des baigneurs, hommes ou femmes, debout, plongeant leurs bras dans le bassin, se faisant arroser d’eau, ou occupés des soins de leur toilette. Dans une peinture de vase, un garçon de bain s’apprête à répandre l’eau d’un récipient sur un personnage placé devant lui, tandis qu’un autre se racle avec une strigile ; un instrument semblable est suspendu à la muraille, ainsi qu’un sac à éponge ou une fiole d’huile. Saglio, Dict. des antiquités, I, pp. 648-651. 11. — LA TOILETTE DES FEMMES. Les longs loisirs que faisait aux femmes leur vie habituelle dans l’intérieur de la maison les portaient à s’occuper beaucoup de toilette. Ischomachos vit un jour la sienne toute couverte de céruse, afin d’augmenter la blancheur de son teint, et de rouge, pour se donner un faux incarnat ; elle avait en outre des chaussures élevées, afin d’ajouter à sa taille. Il la blâma de ces raffinements qui ne peuvent guère tromper que les gens du dehors, et lui conseilla de se montrer à lui simple et convenablement parée. (Xénophon, Économique, ch. X.) La femme de Strepsiade, au dire de son mari, sentait toujours les parfums, le safran. (Nuées, 50.) Aristophane nous représente les femmes honnêtes de son temps, toutes parées, toutes ornées de fleurs, même dans leurs maisons, portant d’élégantes chaussures et des robes aux couleurs voyantes (Lysistrata, 43-45). Un poète de l’Anthologie mentionne des étoffes légères teintes en safran et en pourpre, des cheveux d’emprunt parfumés de nard, des mules blanches, une boîte pour le fard et les pommades. Voici, d’après Aristophane, l’énumération des objets qui composaient l’attirail de la toilette féminine : Rasoir, miroir, ciseaux, cérat, natron, faux cheveux, franges, bandeaux, mitres, rouge végétal, céruse, parfums, pierre ponce, cordons, résille, voile, fard, colliers, crayons pour les yeux, robe de lin, ellébore, ceinture, mantelet, longue robe, fer à friser, boucles d’oreille, pendants, bracelets, agrafes, anneaux pour les jambes, sceaux, chaînes, bagues, liniments, étuis, cornalines. (Fragm. 309, Didot.) L’art de déguiser les imperfections physiques était poussé très loin. La femme est-elle petite ? On met du liège à ses chaussures. La grande a des semelles minces, et ne sort pas sans pencher la tête, pour diminuer sa taille. Manque-t-elle de hanches ? on lui coud quelque chose par-dessous, et les passants s’écrient en la voyant : Oh ! les belles formes ! Si elle a le ventre gros, qu’on lui fasse une poitrine pareille à celle des acteurs comiques ; quand elle sera debout, son ventre semblera rentrer en arrière, comme s’il était tiré par un crochet. Elle a des sourcils roux, on a du noir pour les peindre. Elle est noire, on l’enduit de céruse. Elle est trop pâle, on use alors de la poudre aux amours. (Alexis, dans les Fragments des comiques grecs, de Didot, p. 537 ; trad. par J. Denis.) 12. — LES BIJOUX. Plutôt que de donner une sèche énumération des bijoux que l’on portait en Grèce et des termes qui les désignaient, je préfère reproduire la description de quelques-uns d’entre eux. Pendants d’oreille. — Un petit cygne en émail blanc est suspendu à une rosace bordée d’un feston de petits anneaux en fils d’or et de godrons émaillés. De chaque côté du cygne trois chaînettes de formes diverses sont attachées à la rosace ; l’une, composée d’astragales, se termine par une clochette ; les deux autres en fils tressés par une petite amphore et par une baguette ou pointe conique. (Saglio, Dict. des antiq., I, p. 797.) Bracelets. — Un bracelet grec du IVe siècle, trouvé en Crimée dans la tombe d’un roi ou d’une reine de la Chersonèse, consiste en une torsade qui se termine à ses deux extrémités par une virole décorée d’oves en émail bleu et de filigranes, d’où se dégage le corps d’un sphinx, les ailes déployées, les pattes en avant ; les griffes tiennent un fil d’or. Un autre consiste en un anneau à jour formé de gros fils d’or forgé. Une plaque carrée y tient au moyen de charnières ; elle se compose d’une feuille d’or offrant huit ibis figurée au repoussé la partie antérieure d’un lion couché. Cette plaque est ornée de neuf grenats montés en chaton et de fleurs en forme de campanule ; chaque charnière est bordée de petits grenats. (Ibid., p. 455.) Chaînes. — On retrouve dans l’antiquité à peu près toutes les façons de chaînes qui sont usitées chez les modernes. On reproduit ici une chaîne en cordon formant collier, qui provient de l’île de Chypre, et une tresse plate formée de cinq rangs d’anneaux, qui ont été découverts dans la Russie méridionale. (Saglio, Dict. des antiq., I, p. 969.)
Ceinture. — Une ceinture originaire d’Ithaque consiste en un ruban d’or, avec un nœud pour fermoir ; les deux bouts du ruban sont bordés d’un léger feston ; des fleurons, des palmettes en filigrane et de petites hyacinthes incrustées rehaussent discrètement le contour ; de chaque côté du nœud sont suspendues trois cordelettes attachées à la ceinture au moyen d’un anneau qui surmonte un masque de Silène, et terminées par des grenades. (Ibid., p. 798.) Diadème. — Un des
plus beaux bijoux grecs du Louvre est un diadème de femme ou stéphanè, où
Épingles à cheveux. — La figure ci-contre offre, réduite de moitié, une épingle en or, ornée à son extrémité d’une tête de cerf ou d’élan, du plus fin travail. Une autre est surmontée d’un Amour, qui joue de la flûte. Une troisième porte l’image d’un petit génie ailé qui tient d’une main une patère, de l’autre un objet de forme cylindrique, peut-être un vase à parfums. (Saglio, Dict. des antiq., I, p. 62.) Miroirs. — Les miroirs grecs sont en bronze, et généralement arrondis. Au point de vue de la technique, ils se divisent en deux classes : 1° les miroirs simples, en forme de disques, offrant une face convexe, bien polie, qui reflétait l’image, et une face concave, ornée de figures tracées au burin ; ces disques sont garnis d’un manche, en forme de statuette munie d’un socle, qui permettait, soit de les tenir à la main, soit de les poser sur une table ; 2° les miroirs figurant une boîte ; ils se composent de deux disques métalliques s’emboîtant l’un dans l’autre, quelquefois réunis par une charnière. Le disque supérieur ou couvercle est orné extérieurement de figures en bas-relief, tandis qu’à l’intérieur il est poli avec soin, et argenté ; c’est cette face qui réfléchissait l’image. Le second disque est décoré au dedans de figures gravées au trait ; souvent le contour des figures est rempli par une légère couche d’argent, tandis que le fond est doré. Collignon, Manuel d’archéol. grecque, pp. 547-348. 13. — LES REPAS. Il y avait deux déjeuners, dont l’un était pris en se levant ; il consistait en un peu de pain trempé dans du vin. Le second (άριστος ou άριστν) avait lieu vers le milieu de la journée. Nous savons peu de chose sur la nature de ce repas ; on peut seulement conclure de quelques textes que la nourriture y était plus substantielle, car on avait recours à la cuisine. Le repas qui correspond à notre dîner (δεΐπνον) se plaçait à la tombée de la nuit, ou même lorsque la nuit avait déjà commencé. C’était le repas pour lequel on faisait des invitations. Un Grec de la ville n’aimait pas de manger seul ; il ne croyait pas avoir vraiment soupé, s’il avait soupé sans amis. De là le grand nombre d’associations, les souscriptions et cotisations qui permettaient de participer à des repas de corps. Ces festins avaient lieu soit chez un des convives, soit chez quelque affranchi, qui louait une salle pour cet usage, soit chez une courtisane. On appelait aussi άπό σπυρίδων δεΐπνον le souper où chacun apportait son écot dans des corbeilles (σπυρίδες). Les invitations se faisaient d’une manière fort simple. On priait ses amis de venir, soit de vive voix, sur l’agora, soit en envoyant un esclave chez eux. Les invités liés avec la famille amenaient volontiers des amis avec eux. Il n’était même pas rare qu’on s’invitât soi-même, par un abus qui engendra la race si méprisée des parasites. Plutarque consacre un chapitre entier à examiner jusqu’à quel point on peut user de cette licence. Les convives s’habillaient avec soin ; d’ordinaire ils prenaient un bain et se parfumaient. La politesse exigeait d’eux une parfaite exactitude, et l’on se mettait à table sans attendre les retardataires. Primitivement on mangeait assis. Mais cette habitude ne se conserva que dans un petit nombre de cités, notamment en Crète. Déjà, avant les guerres Médiques, les Spartiates avaient eux-mêmes adopté la coutume orientale de s’étendre sur des lits. 11 ne s’agit ici que des hommes ; car les enfants et les femmes, admis par hasard à un repas, étaient toujours assis. Cette règle ne s’appliquait pas aux courtisanes. Chaque lit contenait une ou deux personnes ; placés côte à côte, ils formaient alors une espèce de divan. Ils étaient garnis de belles couvertures, et souvent assez élevés pour qu’on dût y monter au moyen de petits bancs. Les convives avaient derrière eux des coussins semblables à des oreillers ou à des traversins, et ornés d’une housse aux couleurs et aux dessins variés ; on les apportait parfois avec soi. Les convives appuyaient le coude gauche sur le coussin ; de cette façon, ils étaient à moitié assis, à moitié couchés sur le côté. Les deux convives d’un même lit, se tournaient le dos ; mais il est probable que, tout en s’appuyant sur le même bras, ils donnaient une inclinaison différente à leurs corps, en plaçant le bras, l’un plutôt vers le dos, l’autre devant la poitrine. Le nombre des lits et des tables était variable. On les disposait de manière à rapprocher autant que possible les convives, en formant sans doute un demi-cercle ou un fer à cheval autour des tables. Les tables, carrées et plus tard rondes, étaient un peu plus basses que les lits. Il y en avait une pour chaque lit. On observait un certain ordre de préséance. La place d’honneur était à droite du maître de la maison ; la moins honorable, celle qui en était le plus éloignée. Il se produisait souvent des disputes à cet égard entre les convives. Aussi Plutarque recommande-t-il à l’hôte de désigner à chacun sa place. Tout d’abord, on ôtait ses chaussures, pour ne les reprendre qu’en sortant. Des esclaves lavaient les pieds de tous, et parfois les parfumaient ; puis ils passaient de l’eau pour se laver les mains. C’est alors seulement qu’on apportait les tables toutes servies. Chacun n’avait qu’à tendre la main pour saisir les portions déjà préparées dans des plats. On n’avait ni fourchettes ni couteaux ; la cuiller était usitée pour les mets liquides ou garnis de sauce, mais on la remplaçait volontiers par une croûte de pain. On mangeait presque tout avec les doigts. On n’avait pas non plus de nappe ni de serviettes ; on s’essuyait avec de la mie de pain, ou avec une pâte spéciale qu’on roulait entre ses doigts de manière à en faire des boulettes. Chaque invité était libre d’amener avec lui ses esclaves ; sinon, on était servi par les esclaves de l’hôte. Pour diriger tout ce personnel, il y avait un individu appelé έφεστηκώς ou τραπεζοποιός. Dans quelques maisons, il était de règle que le menu fût soumis au maître par le cuisinier. On appelait πρώται τράπεζαι le repas proprement dit, qui pouvait comprendre plusieurs services, et δεύτεραι τράπεζαι le dessert avec le commencement du symposion. Cette dénomination venait de ce que dans l’intervalle on changeait les tables. Nous avons peu de renseignements sur la marche générale d’un grand repas grec. Il ne paraît pas qu’on débutât, comme chez les Romains, par des hors-d’œuvre froids accompagnés de vin doux, du moins avant l’Empire. Jusque-là, on avait l’habitude de commencer par des mets propres à exciter l’appétit, mais qui n’étaient pas nécessairement froids. On apportait ensuite les viandes, poissons, légumes et ragoûts de toutes sortes dont se composaient les πρώται τράπεζαι. Après cela, les esclaves présentaient de l’eau et des serviettes ; on se parfumait, on se couronnait de fleurs ; on faisait des libations au Bon Génie, en buvant une gorgée de vin pur. Les tables étaient alors enlevées, et on en apportait d’autres, où était servi le dessert. C’était la fin du δεΐπνον et le signal du συμπόσιον. Alors seulement on se mettait à boire. Les mets précédents s’appelaient έδέσματα ; ceux du dessert, τρωγάλια. Le dessert autrefois était simple ; à l’époque macédonienne, il formait comme un second repas, avec gibier et volailles. On y mangeait des fruits frais ou secs, puis du fromage. Pour s’exciter à boire, on prenait de l’ail, de l’oignon, du sel mélangé avec du cumin ou d’autres herbes, des gâteaux salés et épicés. Les pâtisseries ne manquaient pas non plus. L’Attique était célèbre pour ses gâteaux, où le miel remplaçait le sucre ; on en faisait aussi au fromage, au pavot et au sésame. Naturellement, le luxe des repas ne fut pas toujours ni partout le même. Au Ve siècle, les raffinements de la table étaient inconnus en Grèce. Jusqu’au temps d’Alexandre, Athènes était renommée pour la frugalité de ses habitants, pour la simplicité qui régnait même chez les riches. Les Béotiens, au contraire, aimaient les grands festins et la bonne chère. Sybaris et les villes de la Grande-Grèce poussaient encore plus loin ce goût-là. Les Spartiates, qui pendant de longs siècles furent très sobres, ne le cédaient en rien à aucune autre ville hellénique, quant au luxe de la table, vers l’époque de Cléomène (2e moitié du IIIe siècle). Ch. Morel, Dict. des antiquités, t. I, pp. 1272-1276. 14. — LES CUISINIERS. En Grèce, le mot propre pour désigner les fonctions de cuisinier est μάγειρος. Les lexicographes anciens font dériver ce mot de μαγίς, μάζα, galette de farine, ou bien de μάσσω, pétrir. En effet, à l’origine, la fabrication du pain était l’acte principal de la cuisine, et les attributions du cuisinier comprenaient indistinctement tout ce qui se rapporte à l’alimentation. Au temps d’Homère, ce sont les femmes esclaves qui sont occupées à moudre le blé dans l’intérieur de la maison, et sans doute à préparer tous les accessoires du repas ; on ne voit pas que les fonctions de cuisinier soient attribuées à un serviteur en particulier. Bien plus, il est d’usage que les hommes libres, même les héros et les rois, se chargent d’immoler les animaux destinés aux repas, et, avec l’aide de quelques serviteurs, procèdent eux-mêmes au dépeçage et à la cuisson des viandes. Le dîner offert par Achille dans sa tente aux envoyés des Grecs, les repas chez Ménélas, chez Nestor, la réception d’Ulysse par le porcher Eumée, sont des exemples typiques de cet usage. Toutefois, on peut croire que l’intervention directe du chef de la maison est due, dans la plupart des cas, au désir d’honorer un hôte ; il est probable que, dans la vie ordinaire, le soin de ces apprêts était laissé à de jeunes compagnons d’armes (κοΰροι) ou bien à des écuyers tranchants (δαιτροι). De toute façon, dans la vie homérique, ces fonctions n’ont aucun caractère servile. Les apprêts d’un repas sont en même temps ceux d’un sacrifice aux dieux ; il s’y mêle toujours une pensée religieuse qui leur enlève toute vulgarité. La cuisine devint assez tard un métier, et pendant longtemps on se contenta du repas le plus simple, préparé dans l’intérieur de la maison par les soins des maîtres eux-mêmes. Hérodote donne à entendre que de son temps les Grecs ignoraient encore l’usage des hors-d’œuvre et des plats nombreux et compliqués que goûtaient déjà les Orientaux, et Athénée dit que jusqu’au temps d’Alexandre, Athènes même fut renommée pour la frugalité et la simplicité de la nourriture. Nous pouvons croire cependant qu’avant cette époque les Athéniens avaient introduit chez eux un certain luxe de table, qui comportait un personnel assez nombreux. Dès le milieu du Ve siècle, il est question des μάγειροι, chargés spécialement d’apprêter les repas ; dans une comédie de Cratinos, on voit apparaître le personnage du cuisinier qui vante son art et dit qu’il n’est pas donné à tout le monde de savoir assaisonner un poisson ; chez Aristophane, la servante de Perséphonè annonce à Xanthias, qu’il prend pour Héraclès, le menu que sa maîtresse a lait préparer pour lui : deux marmites de pois cassés, un bœuf entier, des gâteaux et des galettes, des volailles bouillies, des croquettes frites et du vin délicieux ; on n’attend plus que lui, car le cuisinier allait retirer les poissons du feu et l’on dressait la table. Faut-il croire, d’après Athénée, que tous les cuisiniers jusqu’aux premiers Macédoniens aient été des hommes libres ? Il paraît probable, au contraire, que l’art culinaire dut être beaucoup plus tôt abandonné à des serviteurs subalternes. Ne voyons-nous pas par de nombreux fragments de la comédie nouvelle, que le type de l’esclave cuisinier, fripon et hâbleur, devint dès le commencement du IVe siècle très commun sur la scène grecque ? Leurs noms mêmes désignent des esclaves : Σύρος, Καρίων, Δράκων, Δαίδαδος ; ce sont des surnoms qui indiquent leur pays d’origine ou leur caractère de voracité et de fourberie. On les faisait venir souvent de l’étranger, de Byzance, de Sicile, etc. ; dans une comédie de Posidippe, un cuisinier dit formellement qu’il a été acheté comme esclave. Malgré leur vile condition, les cuisiniers d’Athènes paraissent avoir pris dans la ville une place assez considérable, si l’on en juge par les railleries dont les poètes comiques poursuivent leurs prétentions. Ce sont des artistes en leur genre ; leur apprentissage dure deux ans sous la direction d’un cuisinier en réputation, et, pendant ce temps, ils portent le tablier de l’apprenti. Souvent même, on les prend tout enfants pour les instruire. Pour un métier si difficile, l’apprenti n’a pas seulement les leçons de ses maîtres : on lui met entre les mains des livres qui contiennent les règles de son art. Enfin, de temps à autre, le disciple subit des examens. Ce n’est qu’après ces longues études qu’il peut aspirer à devenir un de ces artistes illustres dont on cite les noms, et qu’un seul plat a suffi à rendre célèbres ; sept d’entre eux sont comparés aux sept sages de la Grèce. A Athènes, le cuisinier a sous ses ordres l’όψοποιός, qui hache les condiments, allume et souffle le feu, le τραπεζοποιός, qui arrange la table, lave la vaisselle, remplit les coupes, le διάκονος ou άγοραστής, qui va au marché, etc. Dans un dîner d’apparat, on ne compte pas moins de douze cuisiniers employés aux préparatifs du festin. Les maisons bourgeoises ne comportaient pas pour tous les jours un train aussi luxueux. On avait des facilités pour se procurer, quand on en avait besoin, un plus grand nombre de cuisiniers. Il y avait sur l’agora un endroit spécial, où se tenaient des cuisiniers de louage avec tous leurs ustensiles et leurs aides. En somme, le luxe en ce genre paraît avoir été poussé, à Athènes, dès le siècle, aussi loin qu’il le fut à Rome. Le menu du repas était sans doute moins compliqué en Grèce ; le nombre et l’importance des cuisiniers n’y fut pas moindre. Athénée raconte que le cuisinier de Démétrius de Phalère, nommé Moschion, s’enrichit à tel point avec les restes de la table de son maître, qu’en deux ans il put acheter trois grandes maisons, et que dans la ville beaucoup de familles haut placées eurent à souffrir de ses insolences. Xénophon s’indignait déjà des raffinements qu’on avait introduits dans la cuisine de son temps, et Platon n’hésitait pas à chasser les cuisiniers de sa République. Le cuisinier est un des types caractéristiques de la comédie nouvelle, et les Latins n’ont fait que Je transporter sur leur scène, où nous le retrouvons sous les traits amusants de Congrio, d’Anthrax, de Cario, de Cylindrus. C’est la même figure d’esclave, hâbleur, voleur, gourmand, beau parleur. Sur la scène grecque, il se présentait sous deux aspects et sans doute sous deux masques différents : le premier masque représentait le cuisinier indigène ; l’autre était le cuisinier étranger, venu de Sicile ou d’ailleurs. Le costume devait se composer de la courte tunique, que portaient les serviteurs et les esclaves, avec la ceinture autour de la taille. Le luxe des cuisiniers n’était pas poussé au même degré dans toutes les villes grecques. Pendant qu’à Athènes, en Béotie, en Sicile et dans les villes de la Grande-Grèce, comme Sybaris, il avait un grand développement, Sparte résista plus longtemps à l’invasion des raffinements culinaires. On n’y tolérait des cuisiniers que pour l’apprêt le plus simple des viandes, et Élien prétend qu’on chassait de la ville ceux qui essayaient d’y introduire quelque recherche. Pottier, Dict. des antiq., I, pp. 1499-1501. 15. — UN SYMPOSION. Dès qu’on a retiré les tables, fait les libations, et chanté le péan, il entre, comme divertissement, un Syracusain, suivi d’une excellente joueuse de flûte, d’une danseuse merveilleuse par ses tours, d’un garçon qui jouait de la cithare et dansait à ravir. L’homme qui faisait voir ces merveilles en tirait de l’argent. Quand la joueuse de flûte eut assez flûté, le cithariste assez joué de la cithare, et que tous deux parurent avoir suffisamment amusé : Par Zeus, dit Socrate, tu nous traites d’une façon splendide : Callias ! Il ne te suffit pas de nous servir un repas magnifique, il faut encore que tu nous offres un spectacle et une musique fort agréables. Alors Caillas : Mais si on nous apportait encore des parfums, nous jouirions de leur senteur. Socrate repousse cette idée. Sur ce, la musicienne fait entendre sa flûte, et un individu placé près de la danseuse lui donne des cerceaux, jusqu’à douze. Elle les prend ; puis elle danse et les jette en l’air, en calculant à quelle hauteur elle doit les lancer pour les recevoir en cadence.... On apporte ensuite un cerceau garni d’épées, la pointe en haut. La danseuse y entre par une culbute, et en sort par une autre, de manière à faire craindre aux spectateurs qu’elle ne se blesse ; mais elle achève ses tours avec assurance et sans accident.... Alors le jeune garçon se met à danser. Voyez, dit Socrate, comme ce beau garçon paraît encore plus beau, quand il prend des attitudes, que lorsqu’il est en repos. En dansant, aucune partie de son corps n’est demeurée inactive. Cou, jambes, mains, tout était en mouvement ; c’est ainsi que doit danser quiconque veut avoir le corps souple. Ma foi ! Syracusain, ce serait volontiers que j’apprendrais de toi toutes ces poses. — A quoi donc cela te servirait-il ? — Mais à danser, par Zeus !... — Eh bien ! Socrate, avertis-moi, quand tu voudras apprendre ; je me mettrai en face de toi, et nous étudierons ensemble. — Allons, s’écria Philippe (le bouffon), qu’on joue aussi de la flûte pour moi ; je vais danser. Il se lève en effet, et fait le tour de la salle, en imitant la danse du garçon et de la jeune fille. D’abord, comme on avait félicité le garçon de paraître embelli par ses attitudes, il affecta dans ses vêtements un ridicule exagéré. La jeune fille avait fait la roue en se renversant en arrière ; Philippe sous prétexte de l’imiter se courbait en avant. Enfin on avait loué le garçon de ce que tous ses membres étaient en action pendant la danse ; Philippe commande à la joueuse de flûte un rythme plus vif, et il agite tout à la fois sa tête, ses bras, ses jambes, jusqu’à ce que, n’en pouvant plus, il tombe sur un lit en disant : La preuve, mes amis, que ma danse même est un bon exercice, c’est que je meurs de soif. Hé ! garçon, emplis-moi une grande coupe. — Oui, ajouta Callias, et à nous aussi ; tu nous as donné soif en nous faisant rire.... En ce moment, le jeune garçon, ayant accordé la cithare sur la flûte, commence à jouer de son instrument et à chanter. Tout le monde applaudit. Il me semble, dit Socrate, que ces gens-là sont en état de nous divertir ; mais je suis sûr que nous pouvons valoir mieux qu’eux. Ne pourrions-nous pas, puisque nous voilà réunis, essayer de nous être utiles aussi bien qu’agréables ? — Eh bien, s’écrient plusieurs convives, indique-nous quels discours nous devons aborder pour produire cet effet. Une conversation, moitié plaisante, moitié sérieuse, s’engage entre eux. Au milieu de cette causerie, le Syracusain s’aperçut qu’on négligeait son spectacle. Jaloux de Socrate : N’est-ce pas toi, lui dit-il, qu’on appelle le songe-creux ? — Il serait plus juste de m’appeler le songe-peu. — Oui, si tu ne passais pas pour un songeur en l’air. — Connais-tu rien qui soit plus en l’air que les dieux ? — Non, par Zeus ! seulement on prétend que tu ne t’en soucies guère. — Eh bien ! voilà justement pourquoi je m’occupe d’eux ; c’est d’en haut qu’ils sont utiles en pleuvant ; c’est d’en haut qu’ils envoient la lumière. — Laissons cela ; mais dis-moi combien il y a de sauts de puce entre nous ; on dit que tu es fort sur cette géométrie-là. Alors Antisthène : Dis-moi, Philippe, est-ce que cet homme ne te fait pas l’effet de ressembler à un insolent ?... Ne pourrions-nous pas bien, reprit Socrate, chanter tous en chœur ? Et en même temps il entama une chanson. Lorsqu’il l’eut achevée, on apporte à la danseuse une roue de potier, sur laquelle elle devait faire des tours merveilleux. Syracusain, dit Socrate, je songe par quel moyen ton garçon et cette fille pourraient se livrer à des exercices faciles et nous causer à nous une joie vive ; je suis sûr que c’est aussi ce que tu désires. Je trouve que faire la culbute à travers un cercle d’épées est un tour très dangereux, et qui ne convient pas à un banquet. C’est encore une chose étonnante de lire et a d’écrire en tournant sur une roue ; mais je ne vois pas quel plaisir peut donner un pareil spectacle.... Si ces enfants prenaient des poses pour figurer les Grâces, les Nymphes, les Heures, ce serait plus aisé et en même temps plus joli. — Ma foi, Socrate, dit le Syracusain, tu as raison, et je vais « vous montrer un spectacle qui vous divertira. Le Syracusain sort pour tout préparer, et, en son absence, a lieu une nouvelle conversation. Il rentre, et fait représenter par son personnel l’hymen de Dionysos et d’Ariane. Xénophon, le Banquet, ch. 2 et suiv. ; trad. Talbot. 16. — LES PARASITES. Un poète de la comédie ancienne, Eupolis, a créé le type si fameux depuis des parasites. Dans sa pièce intitulée les Flatteurs, ce sont des philosophes, des artistes, des poètes dramatiques qui assiègent la maison du riche Callias et, pour prix de leurs compliments et de leurs bons mots, se font nourrir et entretenir par le riche amphitryon dont ils mettent les biens au pillage. Le parasitisme devait naître naturellement dans une société si éprise du beau parler, où l’esprit donnait tous les droits et excusait toutes les platitudes. Les poètes Acestor et Mélanthios, le savant Protagoras, clients importuns et faméliques de Callias, sont les premiers de la lignée. Souples et adroits, humbles et empressés, ils acceptent toutes les rebuffades et profitent de toutes les complaisances ; ils ont la main et le dos toujours prêts à recevoir les coups ou les présents ; ils s’en vantent eux-mêmes dans un passage qui nous a été conservé. Spectateurs, nous allons vous dire la vie que mènent les parasites ; écoutez. Nous sommes en tout des gens comme il faut ; nous avons d’abord pour nous suivre un petit esclave, qui, le plus souvent, ne nous appartient pas, mais qui est pourtant un peu à nous. J’ai ces deux élégants manteaux, que je mets à tour de rôle pour aller à l’agora ; là, dés que je vois un riche imbécile, immédiatement me voilà autour de lui, et si le richard dit un mot, je le félicite chaudement, et je m’extasie, comme si ses discours me faisaient grand plaisir. Ensuite nous allons tous, chacun de son côté, vers la soupe d’autrui ; là, il faut que le parasite sache dire vivement beaucoup de bons mots ; sinon, il est jeté à la porte. C’est ce qui vient d’arriver à Acestor ; il laissa échapper une plaisanterie déplacée, et l’esclave le conduisit à la porte, lui mit les menottes aux mains, et le livra au sergent de ville. Couat, Aristophane, pp. 366-367. 17. — LE LUXE À SYBARIS. Les Sybarites usaient de leur richesse pour entretenir un luxe inouï, bien plus conforme aux habitudes de l’Asie qu’à celles de la Grèce. Il n’y avait pas chez eux de bonne maison qui n’eût ses nains et ses petits chiens de Malte, achetés à grands frais. L’usage était de faire porter aux enfants, jusqu’à l’âge de puberté, de ; robes de pourpre et un riche bandeau d’or dans les cheveux. Les citoyens de la ville n’admettaient pas qu’un homme comme il faut pût porter autre chose que ces étoffes de Milet en laine exceptionnellement fine, couvertes de somptueuses broderies, qui passaient alors dans tout le bassin de la Méditerranée comme le dernier mot du luxe en ce qui touche au vêtement. On nous a conservé la description de la merveille du genre, de ce péplos brodé que le Sybarite Alcisthène avait fait exécuter sur commande par les plus fameux métiers d’Asie Mineure, et dont il se montra un jour paré dans une grande procession. C’était une longue pièce d’étoffe dont les broderies étaient disposées en trois zones : en haut les animaux sacrés des Indiens, en bas ceux des Perses, et dans la bande intermédiaire, la plus large des trois, une série de divinités, Zeus, Thémis, Athènè, Aphrodite et Héra, placées entre les deux figures d’Alcisthène et du fleuve Sybaris, qui occupaient les deux extrémités. Un siècle et demi plus tard, Denys de Syracuse, ayant trouvé ce célèbre vêtement dans le butin de la prise de Cortone, où on le conservait, le vendit aux Carthaginois pour 120 talents, c’est-à-dire en poids seulement, 691.999 francs, s’il s’agit de talents attiques, 1 216.000 francs, s’il s’agit de talents carthaginois, et comme valeur réelle environ 2.760.000 francs, dans le premier cas, 4.432.000 francs dans le second.... Sybaris avait inventé en faveur des cuisiniers le système des brevets d’invention. Celui qui avait créé un plat nouveau jouissait pendant un an du privilège de l’exploiter seul. Parmi les mets les plus raffinés de la cuisine grecque, entre autres parmi les manières d’accommoder le poisson, que les Hellènes regardaient comme le manger le plus délicat, il y en avait bon nombre dont on attribuait l’invention aux Sybarites. Par exemple, ils passaient pour avoir imaginé les premiers ce condiment si recherché qu’on appelait le garon, et qu’on faisait avec des laitances de maquereau confites à la saumure, puis délayées dans du vin doux et de l’huile : cela devait ressembler quelque peu à l’anchovy’s sauce, si appréciée des Anglais. Mais le poisson que les Sybarites prisaient avant tout était l’anguille. On raconte qu’ils avaient accordé exemption d’impôts à ceux qui s’adonnaient à l’élève des anguilles, comme aux chasseurs de profession qui approvisionnaient de gibier le marché de la ville. Gourmets déterminés, les Sybarites étaient aussi de grands buveurs. Ils furent, dit-on, les premiers des Grecs à manger de la graine de chou tout en buvant après le repas, ce que l’on regardait comme retardant les effets de l’ivresse. Comme ils n’aimaient pas à se gêner, on dit encore qu’ils furent les premiers à tenir des pots de chambre dans les salles de festin, sous les lits où se couchaient les convives. Ce qui était plus grave, ce qui choquait l’esprit des mœurs grecques dans ce qu’il avait de meilleur, le respect de la femme mariée, c’est que les Sybarites faisaient figurer dans leurs soupers et dans les banquets publics, qui toujours finissaient dans le désordre de l’ivresse, les femmes libres pêle-mêle avec les hommes.... Ils donnèrent l’exemple de couvrir les rues contre l’ardeur trop grande des rayons solaires, en prolongeant de chaque côté n auvent les toits des maisons. Ceci témoigne en faveur de leur intelligence pratique. Ils comprenaient les conditions de la construction des villes dans les pays chauds, mieux que les ingénieurs modernes, qui s’en vont faire à Alger, à Athènes, à Alexandrie, de larges boulevards et de vastes places où le soleil fait rage. On peut même soupçonner qu’ici les Sybarites ont été bien moins les inventeurs que les importateurs d’un vieil usage de l’Orient, qui s’est conservé fidèlement jusqu’à nos jours dans les villes arabes. Il doit en être de même de leur goût pour les bains de vapeur, où ils avaient introduit des raffinements inconnus aux autres Grecs. Quant à leur habitude de se construire à la campagne des grottes artificielles pour y passer au frais les heures chaudes des journées d’été, il y a là une recherche de bien-être qui montre des délicats, mais qui en elle-même est assez innocente. Enfin ce que l’on raconte du soin qu’ils avaient pris de reléguer les métiers bruyants dans les faubourgs, afin que leur fracas n’incommodât pas les voisins dans l’intérieur de la ville, et de la défense d’y tenir des coqs, pour qu’ils ne réveillassent pas au milieu de la nuit ceux qui voulaient dormir, ne passerait pas dans nos cités pour autre chose que pour des règlements de bonne police. Fr. Lenormant, la Grande-Grèce, I, pp. 283-288. 18. — PRIX DES DENRÉES ALIMENTAIRES. Blé.
Les cours d’ailleurs pouvaient beaucoup varier d’une année et même d’un mois à l’autre. Vin.
Huile.
Poisson. Anguilles du lac Copaïs : 3 drachmes à la fin du Ve siècle. Congre : 10 oboles (1 fr. 60). Mulet : 8 oboles (1 fr. 28). Loup de mer : 8 drachmes (7 fr. 84). Trois belles sèches 1 drachme (0 fr. 98). Des moules : 7 chalques (0 fr. 28). Un poulpe : 4 oboles (0 fr. 64). Un lot d’oursins : 1 obole (0 fr. 16). Un poisson salé : 5 chalques (0 fr. 20). Un lot de thon mariné : 2 à 3 oboles (0 fr. 32 à 0 fr. 48). Viande. Je donne les prix du bétail sur pied. 1° Bœuf. Au VIe siècle, un bœuf ordinaire se vendait 5 drachmes (4 fr. 90). Pour l’année 410 av. J.-C., on a le prix de 51 dr. (50 fr.), et pour l’année 374 celui de 77 drachmes 2 oboles (76 fr.). Un peu plus tard, il monta peut-être à 100 drachmes (98 fr.). 2° Mouton. Au commencement du VIe siècle, un mouton se vendait 1 drachme (0 fr. 98) ; au commencement du IIIe siècle, un petit mouton est évalué 10 dr. (9 fr. 80). 3° Porc. Un cochon de lait : 3 dr. (2 fr. 94) en 413. Gibier et volaille. Perdrix : 1 obole (0 fr. 16). Plat de grives : 1 drachme (0 fr. 98). Brochette de sept pinsons : 1 obole. Geai : 1 obole. Corneille : 5 oboles (0 fr. 48). D’après Böckh, Économie politique des Athéniens, livre I, ch. XV-XVII ; Caillemer, Mémoires de l’Académie de Caen, 1877, p. 606 et suiv.,1878, p. 450 et suiv. ; et Guiraud, La propriété foncière en Grèce, p. 559-561. 19. — PRIX DES OBJETS D’HABILLEMENT ET D’AMEUBLEMENT. Dans Plutarque, Socrate dit qu’une exomis de 10 .drachmes (9 fr. 80) est à bon marché. Une chlamyde coûtait 12 drachmes (11 fr. 76). On payait jusqu’à 20 drachmes (19 fr.) un himation élégant. Les tissus d’Amorgos et les étoffes faites avec le byssos d’Arcadie atteignaient des prix encore plus élevés. Socrate semble évaluer à 3 mines (294 fr.) le prix d’une étoffe teinte en pourpre. Une jolie paire de chaussures pour hommes se vendait 8 drachmes (7 fr. 85) à l’époque d’Aristophane. Un petit chariot destiné aux jeux des enfants valait une obole (0 fr. 16). Pour six cratères en terre cuite on n’exigeait que 4 drachmes (3 fr. 92), pour un κάδος, 3 drachmes (2 fr. 94). Une hydrie, faite d’une matière inconnue, est estimée 30 drachmes (29 fr. 40). Un buffet orné de figures de Satyres et de têtes de taureau en bronze, dont le travail n’était pas parfait, avait, d’après Lysias, une valeur de 30 drachmes. Un petit chariot à deux roues pour les courses, probablement avec des ornementations d’ivoire et de métal, coûtait 3 mines (294 fr.). Diogène de Laërte indique 3000 drachmes (2.940 fr.) comme prix d’achat d’une statue de grandeur naturelle. Böckh, Économie politique des Athéniens, livre I, ch. XIX. 20. — LE BUDGET D’UN MÉNAGE ATHÉNIEN. Les Athéniens n’étaient pas dépensiers. Ils avaient en Grèce une réputation de sobriété qu’ils justifiaient pleinement. ils mangeaient très peu de viande de boucherie, et se nourrissaient surtout de légumes et de poissons. Ils n’avaient pas ces besoins naturels ou factices qui proviennent chez nous du climat et de l’amour du bien-être. Ils ne demandaient pour leur entretien que le strict nécessaire, et ils n’en étaient ni moins heureux ni moins civilisés pour cela. Voyons quelle pouvait être, au Ve siècle, la dépense annuelle d’une famille pauvre qui comprenait trois personnes. 1° Nourriture. — Dans une comédie d’Aristophane, un individu prétend qu’avec 3 oboles (0 fr. 48), lui, sa femme et son enfant ont de quoi vivre pendant une journée entière. Cette assertion n’a rien d’exagéré. Nous savons qu’un Athénien consommait 1 litre environ de farine par jour. Il ne buvait guère plus d’un quart de litre de vin, d’autant plus qu’il ne prenait jamais de via pur. Cela faisait au total 0 fr. 057, et pour 3 personnes 0 fr. 174. Il reste encore pour l’ordinaire 0 fr. 306, et cette somme était probablement suffisante, si l’on réfléchit au bas prix des denrées alimentaires. Ainsi la nourriture de ce ménage revenait à 175 fr. par an. 2° Loyer. — Les logements des pauvres étaient fort modestes. Les anciens Grecs se souciaient beaucoup moins que nous d’avoir un intérieur confortable, car ils passaient presque tout leur temps au dehors. Un certain Ératosthène, qui avait quelque aisance, puisqu’il possédait une esclave, habitait une maison à un étage, qui paraît bien n’avoir eu que quatre pièces. Un voyageur qui visita Athènes vers la fin du IVe siècle av. J.-C. nous dit que les maisons y étaient pour la plupart misérables, et, si un homme comme le père de Démosthène, qui avait un revenu de 5 à 6.000 francs, en consacrait 350 à son loyer, on devine qu’un ménage de pauvres gens ne devait pas dépasser plus du dixième de cette somme, soit 35 fr. environ. 3° Habillement. — Je compte pour trois personnes trois tuniques à 9 francs, trois paires de sandales à 1 franc, et trois manteaux à 9 francs, qui duraient au moins quatre ans. On arrive ainsi à un total de 37 francs pour le vestiaire, et ce chiffre est sans doute bien au-dessus de la vérité. 4° Dépenses diverses. — On ne voit pas trop ce qu’un Athénien de la basse classe pouvait inscrire de ce chef à son budget. Il avait des plaisirs, mais ils étaient gratuits. Très souvent dans l’année il assistait à de belles fêtes ; mais tous ces spectacles, processions, courses de chevaux et de chars, luttes athlétiques, régates, concerts, représentations dramatiques, ne lui coûtaient absolument rien. Il n’était même pas rare que ces jours-là il fût nourri par les riches. Il se baignait et faisait de la gymnastique sans bourse délier ; il y avait pour cela des établissements ouverts à tout venant. Si l’on tombait malade, on était soigné gratis par un médecin officiel. Avait-on la fantaisie d’aller en pèlerinage à Olympie ou ailleurs, on s’y rendait à pied, comme Socrate. Les voyages, du reste, n’étaient point coûteux, du moins par mer, s’il est vrai qu’on ne demandât pas plus de 2 francs pour transporter une famille d’Égypte au Pirée. Les parents étaient tenus de donner à leurs enfants un minimum d’instruction primaire ; mais l’école n’était ni publique ni gratuite, et la rétribution scolaire était d’une douzaine de francs par an. Toutefois, nous n’avons pas à en tenir compte ici ; car nous supposons que la famille en question était formée de trois adultes. On aboutit en somme à cette conclusion que ce ménage pauvre se suffisait avec un budget de 250 francs, et, en laissant une certaine marge pour l’imprévu, avec 270 francs. On menait assurément, pour ce prix, une vie très modeste ; mais on n’était pas dans le besoin. Or on calcule qu’aujourd’hui une famille de paysans, composée de même, dépense en moyenne 450 francs. Naturellement, il fallait beaucoup plus pour vivre dans l’aisance. Dans un discours de Démosthène, un individu, qui avait hérité de 45 mines (4.400 fr.), déclare qu’on est gêné si l’on se trouve réduit aux revenus d’un pareil capital, c’est-à-dire à 528 francs. Un autre prétend qu’il a pu être nourri et élevé avec 636 fr. par an. Démosthène lui-même, sa sœur, plus jeune que lui, et leur mère recevaient annuellement 7 mines (688 fr.), et ils n’avaient pas de loyer à payer ; de plus les frais de l’éducation du premier étaient comptés à part. Lysias croyait faire largement les choses en évaluant à 1000 dr. (980 fr.) la dépense annuelle de deux petits garçons, d’une petite fille et de deux jeunes servantes. Quant à ceux qui menaient un certain train de maison, ils avaient à peine de quoi y subvenir avec un capital d’une cinquantaine de mille francs et un revenu de 6.000 (Xénophon, Économique, ch. 2). Il est vrai que pour eux les impôts étaient assez lourds. 21. — LA MÉDECINE. Il y avait en Grèce deux sortes de médecines ; celle qui procédait par incantations et formules magiques, celle qui observait et traitait par des remèdes empiriques. La première parait avoir dominé à l’époque d’Homère, et même longtemps après lui. Mais elle fut peu à peu supplantée par la seconde. Un passage des œuvres attribuées à Hippocrate (médecin des Ve et IVe siècles) montre le soin que les médecins apportaient dans le diagnostic. Nous diagnostiquons les maladies d’après la nature commune à toutes choses et d’après la nature particulière de chaque individu, d’après la maladie et le malade, d’après les choses qui lui sont administrées..., d’après la constitution générale de l’atmosphère, et d’après celle qui est propre à chaque contrée, d’après les habitudes, le régime, le genre d’occupations habituelles, l’âge, les paroles, les mœurs, le silence, les idées, le sommeil, les insomnies, la nature et le moment des rêves, les mouvements des mains, les démangeaisons, les larmes, les paroxysmes, les déjections, les urines, les crachats, les vomissements. Il faut encore considérer la sueur, le froid, les frissons, la toux, l’éternuement, le hoquet, la respiration, les éructations, les vents rendus avec ou sans bruit, les hémorragies, les hémorroïdes ; il faut examiner ce qui résulte de ces signes et ce qu’ils comportent. (Traité des épidémies, livr. I, ch. 3, § 10 ; trad. Daremberg.) Les médecins tenaient grand compte de l’influence du milieu. Celui qui veut bien pratiquer la médecine doit faire ce qui suit : considérer premièrement les effets que chacune des saisons de l’année peut produire ; car elles ne se ressemblent pas du tout, mais elles diffèrent beaucoup les unes des autres, et chacune en particulier diffère beaucoup d’elle-même dans ses vicissitudes ; en second lieu, les vents chauds et les vents froids, surtout ceux qui sont communs à tous les pays ; ensuite ceux qui sont propres à chaque contrée. Il faut également considérer les qualités des eaux ; car, autant elles diffèrent par leur saveur et par leur poids, autant chacune d’elles diffère par ses propriétés. Le médecin qui arrive dans une ville nouvelle devra examiner dans quelle position elle se trouve par rapport aux vents et au soleil levant.... Il examinera aussi si le sol est nu et sec, ou boisé et humide, s’il est enfoncé et brûlé par des chaleurs étouffantes, ou s’il est élevé et froid. Enfin il étudiera le genre de vie qui plaît le plus aux habitants ; il saura s’ils sont amis du vin, grands mangeurs et paresseux, ou s’ils sont amis des exercices gymnastiques et de la fatigue, doués d’un bon appétit et buvant peu. (Traité des airs, des eaux, et des lieux, chap. I ; trad. Daremberg.) 22. — LES PRÊTRES MÉDECINS. Les premiers médecins furent en Grèce les prêtres attachés aux temples d’Asclépios, le dieu de la santé. Quelques-uns de ces temples étaient fort anciens, notamment ceux de Tricca en Thessalie, et de Titane en Sicyonie. Dans la suite, ils devinrent de plus en plus nombreux, et Pausanias n’en mentionne pas moins de soixante-trois. Ces sanctuaires avaient été construits en général à une certaine distance des villes, dans des lieux élevés et salubres, dans le voisinage de limpides fontaines, au milieu de bois sacrés dont la fraîche verdure réjouissait les yeux. Ils étaient desservis par des prêtres qui se faisaient les interprètes du dieu en exerçant la médecine. L’histoire de la médecine grecque se confond à l’origine avec celle des sanctuaires d’Asclépios ; la science médicale fut d’abord le monopole des familles sacerdotales qui, de père en fils, s’en transmettaient les secrets cachés aux profanes. D’assez bonne heure, il est vrai, les Asclépiades sortirent des temples pour aller soigner les malades, et admirent à leurs écoles des élèves étrangers à leur caste. Mais cela n’empêcha pas que l’on vint en foule se faire traiter dans les Asclépieia les plus fameux. Avant de pouvoir consulter le dieu dans son temple, le malade était soumis à un grand nombre de pratiques, dont les unes, telles que les jeûnes, les ablutions et les bains, étaient simplement hygiéniques, tandis que les autres, comme les purifications et les sacrifices, avaient un caractère religieux. Après cette préparation, il était admis dans le temple pour y passer la nuit, soit sur la peau de l’animal qu’il avait sacrifié, soit sur des lits placés auprès de la statue d’Asclépios : c’est ce qu’on appelait l’incubation. Là, dans le silence et la demi-obscurité du sanctuaire, où il apercevait les serpents familiers déroulant leurs longs anneaux sur les parvis, où il croyait voir tout près de lui le dieu présent, son imagination était vivement frappée. Pendant son sommeil le dieu lui apparaissait en songe, ou s’approchait de lui pour lui indiquer les remèdes qui devaient le guérir. Le lendemain, il racontait ce qu’il avait r t ou entendu aux prêtres, qui interprétaient ces visions et appliquaient le traitement prescrit par le dieu. Ceux qui s’en retournaient guéris suspendaient dans le temple des ex-voto, jetaient des pièces d’or ou d’argent dans la fontaine sacrée, et faisaient graver sur des stèles, avec leurs noms, l’indication de leurs maladies et des remèdes employés. Decharme, Mythologie de la Grèce antique, pp. 296-297 ; 2e éd. 23. — GUÉRISONS OPÉRÉES DANS LE SANCTUAIRE D’ÉPIDAURE. On a trouvé à Épidaure des inscriptions attestant des guérisons opérées dans le sanctuaire d’Asclépios, un des plus célèbres de la Grèce : Un homme ayant les doigts de la main paralysés, à l’exception d’un seul, vint en suppliant vers le dieu, et voyant les tableaux (ex-voto) dans l’enceinte sacrée, il se prit à douter des guérisons et à railler les inscriptions qui les attestaient. S’endormant alors, il eut une vision. Il lui sembla qu’il jouait aux osselets auprès du temple et se préparait à jeter un coup : soudain le dieu parut, et s’élançant sur sa main, lui étendit les doigts l’un après l’autre. Le dieu s’étant éloigné, l’homme, pour bien se convaincre de la chose, referma ses doigts et les rouvrit un à un ; le dieu lui demanda s’il avait encore des doutes au sujet des inscriptions sur les offrandes du temple, et il répondit que non. Le dieu lui dit alors : Parce que tu n’as pas cru tout à l’heure à des choses qui ne sont pas incroyables, je t’accorde maintenant une incroyable guérison. Et, le jour ayant paru, il sortit guéri. Ambrosia d’Athènes était borgne. Cette femme vint en suppliante vers le dieu, et, se promenant dans l’enceinte sacrée, elle se moqua de quelques-unes des guérisons, prétendant qu’il était invraisemblable et impossible que des boiteux marchassent et que des aveugles vissent, simplement pour avoir eu un songe. S’étant endormie, elle eut une vision. Il lui sembla que le dieu fui apparaissait et lui disait qu’il la guérirait, mais qu’il exigeait d’elle, à titre de salaire, qu’elle plaçât dans le temple un cochon d’argent en souvenir de la stupidité dont elle avait fait preuve ; parlant ainsi, il entrouvrit l’œil malade, et y versa un certain remède. Quand le jour parut, elle sortit guérie. Un enfant muet vint en suppliant au temple pour recouvrer la voix. Après qu’il eut offert le sacrifice préliminaire et accompli les autres cérémonies d’usage, le serviteur qui portait le feu du sacrifice se tourna vers le père de l’enfant et lui dit : Consens-tu, d’ici à un an, si tu obtiens ce que tu es venu demander, à offrir un sacrifice au dieu pour prix de cette guérison ? Alors l’enfant dit tout à coup : J’y consens. Le père étonné lui ordonna de parler de nouveau, et l’enfant parla de nouveau, et dès ce moment fut guéri. Pandaros, Thessalien, avait des taches sur le Iront. S’étant endormi, il eut une vision. Il lui sembla que le dieu attachait un bandeau autour de ces taches, et lui ordonnait, quand il serait sorti du dortoir, d’enlever le bandeau et de le placer comme offrande dans le temple. Le jour paraissant, il se leva et enleva le bandeau ; il vit que son visage était délivré des taches et consacra le bandeau dans le temple. Emphanès, enfant d’Épidaure, souffrait de la pierre. Il s’endormit ; il lui sembla que le dieu lui apparaissait et lui disait : Que me donneras-tu, si je te guéris ? L’enfant répondit : Dix osselets. Le dieu se mit à rire et dit qu’il le guérirait. Le jour venu, il sortit guéri. Evippos porta pendant six ans dans la joue une pointe de lance : il s’endormit, et le dieu, ayant arraché la lance, la lui remit entre les mains. Quand le jour parut, il sortit guéri, portant la lance dans ses mains. Hermodicos de Lampsaque, impotent du corps. Il s’endormit, et le dieu, l’ayant guéri, lui ordonna de sortir et de porter dans l’enceinte sacrée la plus grande pierre qu’il pourrait : en effet, il y porta celle qui est aujourd’hui devant le dortoir. Un homme fut guéri d’un mal au doigt par le serpent. Cet homme souffrait beaucoup d’une plaie cruelle à un orteil. Les serviteurs du temple le portèrent dehors et le firent asseoir sur un siège. Le sommeil l’ayant pris, un serpent sortit du dortoir et guérit son orteil avec sa langue ; puis il se retira dans le dortoir. L’homme, s’étant réveillé et se sentant guéri, dit qu’il avait eu un songe, et qu’un beau jeune homme avait paru appliquer un remède sur son orteil. Héraieus de Mytilène. Cet homme n’avait pas de cheveux sur la tête, mais il en avait beaucoup sur les joues. Honteux des railleries dont il était l’objet, il s’endormit dans le dortoir : le dieu lui frotta la tête avec un onguent et fit que les cheveux repoussèrent. Reinach, Traité d’épigraphie grecque, pp. 76-79. 24. — LES MÉDECINS PUBLICS. Il y avait des médecins publics dans la plupart des cités grecques. Un des plus anciens que l’on mentionne est Démocédès de Crotone. Obligé de fuir son père qui le maltraitait, il s’était rendu à Égine. Il s’y établit, et, dès la première année, il surpassa tous les autres médecins, quoiqu’il n’eût point d’instrument ni rien de ce qui pouvait l’aider à pratiquer son art. La seconde année, les Éginètes lui donnèrent un traitement d’un talent ; la troisième année, les Athéniens lui donnèrent cent mines, et la quatrième, Polycrate, tyran de Samos, deux talents. La guerre le fit tomber aux mains du roi de Perse Darius. Il eut la chance de guérir ce prince d’une maladie, et dès lors il demeura à sa cour, comblé de biens, sauf la liberté de retourner en Grèce. (Hérodote, IV, 131-132.) Il ne rentra à Crotone que vers la fin de sa vie. Le médecin public était probablement le directeur d’un ίατρεΐον mis à sa disposition par la cité, et pourvu par elle de médicaments, d’instruments de médecine et de chirurgie, de lits, etc. C’est là que, payé par l’État, il exerçait son art et soignait gratis les malades qui venaient le consulter ; il était secondé par tout un personnel d’esclaves dont l’entretien était à la charge de la cité. Il faut nous figurer ces ίατρΐα, au moins les plus importants, comme de timides essais d’hôpitaux laïques, particulièrement réservés aux pauvres. Une inscription athénienne de la première moitié du IIIe siècle av. J.-C. prouve que dans cette ville les médecins publics étaient nombreux. Ils formaient une sorte de corporation ayant des intérêts communs et sans doute une caisse. Il y avait une certaine rivalité entre eux et les prêtres guérisseurs, d’autant plus que les Asclépiéia devinrent avec le temps des foyers de superstition et de charlatanisme. Pourtant les médecins ne cessèrent jamais d’affecter un grand respect à l’égard d’Asclépios et de la déesse Hygie, qu’ils considéraient comme leurs patrons. A Athènes, ils avaient l’habitude de leur offrir deux fois par an un sacrifice solennel, et les traités mis sous le nom d’Hippocrate reconnaissent l’efficacité de la prière, des vœux, des supplications, des cérémonies religieuses, tout en recommandant de recourir aussi à d’autres moyens. D’après P. Girard, l’Asclépiéion d’Athènes, pp. 83-87. 25. — LES MÉDECINS PRIVÉS. Il existait des médecins privés qui faisaient des visites à domicile. Xénophon parle de ceux qui matin et soir vont voir leurs malades. (Économique, ch. 13, 2.) Le document hippocratique intitulé le Serment indique quels étaient leurs principaux devoirs. Je ferai servir tout mon pouvoir et tout mon discernement au soulagement des malades ; j’écarterai ce qui pourrait tourner à leur perte ou à leur détriment. Jamais je ne donnerai un médicament mortel à qui que ce soit, quelques sollicitations qu’on me fasse ; jamais je ne serai l’auteur d’un semblable conseil.... Je conserverai ma vie et ma profession pures et saintes. Je ne taillerai jamais les calculeux, mais je les adresserai à ceux qui s’occupent spécialement de cette opération. Dans quelque maison que je sois appelé, j’y entrerai avec l’intention d’y soulager les malades, me conservant pur de toute iniquité volontaire et corruptrice.... Les choses que je verrai ou que j’entendrai dire dans l’exercice de mon art, ou hors de mes fonctions dans le commerce dès hommes, et qui ne devront pas être divulguées, je les tairai, les regardant comme des secrets inviolables. (Œuvres choisies d’Hippocrate, par Daremberg, p. 5 ; 2e édition.) Voici encore quelques prescriptions curieuses sur la profession médicale : Il est du devoir d’un médecin de conserver, autant que sa nature le lui permet, le teint frais et de l’embonpoint ; car le vulgaire s’imagine qu’un médecin qui n’a pas bonne apparence ne doit pas bien soigner ses clients. Il doit être propre sur sa personne, avoir un vêtement décent et porter des parfums agréables, mais dont l’odeur ne soit pas incommodante ; car cela plaît aux malades. Il doit rechercher cet esprit de modération qui ne consiste pas seulement dans le silence, mais encore dans une vie parfaitement réglée ; rien ne contribue autant à la bonne réputation. Qu’il ait un caractère noble et généreux, et, s’il se montre tel, il passera aux yeux de tous pour un homme respectable et pour un ami de l’humanité. Trop de promptitude à parler, et trop d’empressement à agir, lors même que cela serait tout à fait utile, est une cause de mépris. Qu’il règle son empressement sur les droits que lui donne le malade ; car les mêmes offices rendus aux personnes gagnent du prix en raison de leur rareté. Quant à son extérieur, le médecin doit avoir l’air méditatif, mais non pas chagrin ; autrement il paraîtrait arrogant et misanthrope. D’un autre côté, celui qui s’abandonne à un rire immodéré et à une jovialité excessive passe pour insupportable ; aussi doit-il grandement éviter ce défaut. Que l’honnêteté accompagne le médecin dans toutes ses relations ; l’honnêteté doit, en beaucoup de circonstances, offrir un ferme appui, et pour le médecin en particulier, c’est un gage précieux dans ses relations avec ses clients. (Ibid., p. 57.) 26. — LES FUNÉRAILLES. Les peuples de l’antiquité ont presque tous donné aux cérémonies des funérailles plus de développement et de solennité que les modernes. Chez les Grecs en particulier, elles formaient une sorte de drame en trois actes, dont les mœurs et les lois réglaient avec précision les plus menus détails. Le premier de ces actes était l’exposition du corps ou πρόθεσις. A peine le cadavre était-il refroidi, que les femmes de la famille s’en emparaient, le lavaient, l’oignaient d’huile parfumée, le revêtaient de vêtements blancs, et le couchaient sur un lit de parade dressé dans la première pièce de la maison mortuaire et visible de la rue. Une couronne de feuillage était placée sur le front des hommes ; une stéphanè en or chez les riches, en cire peinte chez les pauvres, ornait la tête des femmes. Parfois aussi, ce semble, un masque posé sur le visage cachait l’altération des traits. Des lécythes remplis de parfums étaient disposés çà et là sur la couche pour combattre la mauvaise odeur. La πρόθεσις durait un jour entier, afin que la réalité de la mort fût bien établie, et que tout le monde pût constater qu’elle n’était point due à la violence. Pendant cette journée, les parents et les amis venaient joindre leurs lamentations à celles des gens de la maison. Un vase rempli d’eau de source et placé près de la porte de la rue leur permettait de se purifier en sortant, car l’entrée dans une maison funestée par la mort constituait une souillure, et, avant de l’avoir effacée, l’on n’eût pu sans impiété ni prendre part à une cérémonie religieuse ni pénétrer dans un sanctuaire, ni même mettre le pied sur l’agora.... C’est le lendemain de la πρόθεσις que se faisait le transport du mort à l’endroit de la sépulture (έκφορά). Le départ avait lieu de très grand matin, soit à la nuit noire, soit aux premières lueurs de l’aube, de manière que l’ensevelissement fût terminé avant le lever du soleil et que cet astre n’aperçût point un spectacle impur. Avant de quitter la maison mortuaire, on faisait un sacrifice, nous ne savons à quelles divinités. La victime immolée s’appelait προσφάγιον, et, dans chaque ville, l’espèce en était déterminée ; à Athènes, une loi de Solon interdisait de sacrifier un bœuf. Puis le cortège se formait. Parfois, et vraisemblablement lorsque le défunt était d’une famille aisée, le corps était placé sur une charrette attelée de chevaux et de mulets. D’autres fois, et plus souvent sans doute, il était mis sur un brancard porté par des hommes à gages. Le corps avait la tête en avant, le visage découvert, le corps revêtu des mêmes vêtements que pendant la πρόθεσις.... A Athènes, à Céos, et probablement aussi dans beaucoup de villes, la loi limitait à trois au maximum le nombre les vêtements laissés au mort : la couverture placée sous lui, la tunique dont il était vêtu, le manteau qui l’enveloppait... Chez les Lacédémoniens, une loi attribuée à Lycurgue ordonnait de répandre sur le cadavre du guerrier mort des feuilles d’olivier, et d’étendre sur lui son manteau de guerre, une chlamyde rouge appelée φοινικίς. A Athènes, l’ordre du cortège était fixé par la loi. En avant du mort marchait une femme portant le vase (χυτρίς) destiné aux libations à faire sur la tombe : on l’appelait l’έγχυτρίστρια. Puis venaient les parents du mort revêtus de costumes sombres, jusqu’au degré de cousinage inclusivement. Il était interdit aux parentes plus éloignées et aux étrangères de se mêler à la cérémonie, à moins qu’elles n’eussent plus de soixante ans ; cette exception autorisait la présence de pleureuses à gages. Les hommes marchaient d’abord. Si le mort avait été assassiné, l’un d’eux, le plus proche parent, portait une lance, en signe de menace contre le meurtrier. Derrière venaient les femmes ; une loi de Gambréon, en Mysie, leur interdisait d’avoir des vêtements en haillons Enfin la marche était fermée par les joueurs de flûte, chargés d’accompagner des sons plaintifs de leurs instruments le thrène psalmodié par la famille. A Rome, la loi des Douze-Tables limitait leur nombre à dix, et il est probable qu’en cela on n’avait fait que traduire la loi de Solon. C’est dans cet ordre que toute la troupe s’acheminait par les rues étroites, les femmes pleurant, gémissant, se frappant la poitrine (la loi de Solon leur interdisait de se déchirer les joues avec les ongles), les hommes se lamentant avec plus de réserve, les joueurs de flûte s’évertuant de leur mieux, si bien que le vacarme réveillait en passant les habitants du quartier. On arrivait ainsi au petit jour hors de la ville, au lieu choisi pour la sépulture, et alors commençait le troisième acte des funérailles, l’ensevelissement du corps, le plus souvent, du moins à Athènes, sans crémation. Rayet, Monuments de l’art antique, t. II. 27. — NÉCESSITÉ DE LA SÉPULTURE. L’âme qui n’avait pas son tombeau n’avait pas de demeure ; elle était errante. En vain aspirait-elle au repos, qu’elle devait aimer après les agitations et le travail de cette vie ; il lui fallait errer toujours, sous forme de larve ou de fantôme, sans jamais s’arrêter, sans jamais recevoir les offrandes et les aliments dont elle avait besoin. Malheureuse, elle devenait bientôt malfaisante. Elle tourmentait les vivants, leur envoyait des maladies, ravageait leurs moissons, les effrayait par des apparitions lugubres, pour les avertir de donner la sépulture à son corps et à elle-même. De là est venue la croyance aux revenants. Toute l’antiquité a été persuadée que sans la sépulture l’âme était misérable, et que par la sépulture elle devenait à jamais heureuse. Ce n’était pas pour l’étalage de la douleur qu’on accomplissait la cérémonie funèbre, c’était pour le repos et le bonheur du mort.... On peut voir dans les écrivains anciens combien l’homme était tourmenté par la crainte qu’après sa mort les rites ne fussent pas observés à son égard. C’était une source de poignantes inquiétudes. On craignait moins la mort que la privation de sépulture. C’est qu’il y allait du repos et du bonheur éternel. Nous ne devons pas être trop surpris de voir les Athéniens faire périr des généraux qui, après une victoire sur mer, avaient négligé d’enterrer les morts. Ces généraux, élèves des philosophes, distinguaient peut-être l’âme du corps, et, comme ils ne croyaient pas que le sort de l’une fût attaché au sort de l’autre, il leur avait semblé qu’il importait assez peu à un cadavre de se décomposer dans la terre ou dans l’eau. Ils n’avaient point bravé la tempête pour la vaine formalité de recueillir et d’ensevelir leurs morts. Mais la foule qui, même à Athènes, restait attachée aux vieilles croyances, accusa ses généraux d’impiété et les fit mourir. Par leur victoire ils avaient sauvé Athènes ; mais par leur négligence ils avaient perdu des milliers d’âmes. Les parents des morts, pensant au long supplice que ces âmes allaient souffrir, étaient venus au tribunal en vêtements de deuil et avaient réclamé vengeance. Dans les cités anciennes, la loi frappait les grands coupables d’un châtiment réputé terrible, la privation de sépulture. On punissait l’âme elle-même, et on lui infligeait un supplice presque éternel. Fustel de Coulanges, la Cité antique, pp.10-12. 28. — DOUBLE MODE DE SÉPULTURE. Dès l’époque homérique, en Grèce et dans les colonies, l’inhumation et l’incinération des morts ont été pratiquées en même temps. On trouve dans la nécropole de Myrina[6] ces deux modes de sépulture employés simultanément. L’inhumation y est d’un usage plus fréquent ; ce qui est naturel, puisque c’est le moyen le moins dispendieux. On constate, surtout dans les sarcophages, la présence d’ossements calcinés. L’incinération a dû être faite généralement en dehors du tombeau, plus rarement dans le tombeau même, dont les parois portent alors la trace du feu. Les restes calcinés reposent au fond de la caisse de tuf ou du sarcophage ; ils sont parfois placés dans un vase de terre ou de métal ; les menus objets qu’on ensevelit avec le mort se trouvent mêlés à ces ossements. Il arrive quelquefois que le même tombeau réunit les deux modes d’ensevelissement, et que des squelettes inhumés reposent à côté d’ossements calcinés. La position du corps inhumé est à peu près uniforme ; il est couché sur le dos, dans le fond de la caisse, les bras allongés le long du corps. Cette position varie, quand plusieurs morts sont ensevelis ensemble, ce qui est un fait assez commun. Beaucoup de tombeaux contenaient deux et trois corps, couchés en sens inverse, parfois superposés et comme enchevêtrés. En plusieurs endroits, c’étaient de véritables ossuaires, sortes de fosses communes, où les ossements étaient confondus, à peine recouverts de terre et mêlés de poteries grossières en morceaux. Cette communauté de sépulture pour les membres d’une même famille enfermés dans un seul caveau ou pour les pauvres jetés dans la même fosse nous autorise à croire que les rites religieux des Grecs n’interdisaient pas de rouvrir le tombeau pour y enterrer successivement plusieurs personnes, car il est inadmissible que tous ces morts aient été déposés en même temps à cette place. Un tombeau permet de constater plus sûrement encore un double ensevelissement fait à des époques différentes : un mort repose avec quelques objets dans le fond de la fosse ; au-dessus de lui, deux autres morts ont pris place, mais séparés du précédent par une couche d’humus. On voit que la tombe a été rouverte, la terre enlevée jusqu’à une certaine profondeur, et les corps disposés sur la couche où reposait déjà un membre de la même famille. Il était d’ailleurs défendu de mettre le corps d’un étranger dans la tombe. Plusieurs corps inhumés étaient privés de têtes. Tantôt c’est la tête seule qui manque au squelette, tantôt la tête et les pieds ; ailleurs le corps tout entier a été brûlé, sauf la tête qui reste intacte, ou bien, au contraire, toute la partie supérieure du corps a été incinérée et les ossements des jambes restent seuls visibles. Le double procédé d’inhumation et d’incinération, appliqué au même corps, est donc un fait authentique, dont on doit tenir compte dans l’histoire des rites funéraires de l’antiquité, si étrange qu’il paraisse. Pottier et Reinach, la Nécropole de Myrina, t. I, pp. 73-15. 29. — OBJETS PLACÉS DANS LES TOMBEAUX. Les Grecs avaient l’habitude de déposer dans les tombeaux des objets destinés aux besoins du mort ; car ils pensaient que le mort continuait de vivre dans la tombe. Ces objets sont, en général, de quatre sortes : 1° Ceux qui ont dû appartenir au mort et lui servir dans les usages journaliers de la vie. Dans les tombeaux riches, on constate que le corps a été enseveli avec certaines parures, par exemple une bandelette d’or qu’on fixait sur le front au moyen d’un cordon passé dans les deux trous des extrémités. Quelques-uns de ces objets, entre autres des couronnes formées de fines feuilles de métal, sont de destination purement funéraire, étant données l’extrême ténuité et la fragilité de ces ornements. On n’a trouvé aucun bijou précieux dans la nécropole de Myrina, sauf une bague d’or munie d’un énorme chaton en verre qui imite la couleur de l’émeraude, quelques autres bagues et bracelets de bronze, des broches, des amulettes et des perles de collier. 2° Les objets qui sont destinés à recevoir la boisson ou la nourriture du mort, coupes et soucoupes, plats de terre cuite et de bronze, etc., sont parfois de simples simulacres, comme certaines bouteilles en terre de petite dimension qui n’ont même pas de cavité intérieure. La boisson tient surtout une place importante, car il n’y a presque pas de sépulture où l’on ne trouve une ou plusieurs bouteilles en terre ; dans certains tombeaux, on en a recueilli jusqu’à cinquante ou soixante. Les lampes de terre cuite sont aussi très fréquentes dans certaines nécropoles, mais rares à Myrina. 3° Les monnaies qu’on trouve en assez grand nombre, mais non pas dans tous les tombeaux,-représentent l’obole de Charon[7]. Elles sont en général près de la tête, mais leur vraie place est entre les dents mêmes du mort. Un même tombeau en contient parfois plusieurs ; ordinairement, il n’y en a qu’une. Elles sont toutes de bronze, souvent en mauvais état.... 4° Les figurines de terre cuite forment une catégorie toute spéciale d’objets, dont la destination est encore actuellement discutée. Il est difficile de ne pas voir quelque relation entre les terres cuites trouvées dans le tombeau et le sexe ou l’âge du mort. Dans une tombe de femme, on ne trouvera guère que des statuettes de femme, et, parmi les divinités, Aphrodite et Éros, Déméter, des Nikès, etc. Dans un tombeau d’homme, on trouvera, dans des proportions à peu près égales, des statuettes d’hommes et de femmes. Parfois même, les statuettes et les menus objets sont en quelque sorte rapetissés à la taille du jeune mort ; les jouets et les osselets qu’on rencontre dans leurs tombeaux prouvent bien qu’on appropriait le mobilier funéraire au goût et aux habitudes des enfants. Pottier et Reinach, la Nécropole de Myrina, t. I, pp. 101-108. 30. — LE CULTE DU TOMBEAU D’APRÈS LES MONUMENTS FIGURÉS. Comme dans les scènes de πρόθεσις, le rôle des femmes parait être prépondérant dans les cérémonies d’offrandes au tombeau. Bien que la présence des hommes ne soit pas rare, les assistants se composent en majeure partie de femmes. Les gestes sont, en général, plus mesurés et plus calmes que dans la πρόθεσις. On voit cependant encore quelques assistants porter la main à leur tête comme pour s’arracher les cheveux ; mais l’attitude ordinaire est celle d’un personnage debout et tranquille qui tient dans ses mains les offrandes destinées au mort ou qui semble réfléchir tristement ; ailleurs il s’avance vers la stèle avec la main élevée à la hauteur du visage, ou s’agenouille au pied et semble parler au tombeau. C’est moins l’expression de la douleur qui domine dans toutes ces scènes qu’une sorte de regret religieux et de mélancolie résignée. Un de ces gestes parait pourtant avoir un caractère plus particulier et signifier autre chose qu’une vague expression de regret et d’hommage. On remarque un certain nombre de peintures où les personnages, en étendant la main vers le tombeau ou en l’élevant à la hauteur du visage, rapprochent deux doigts l’un de l’autre, en général le pouce et l’index. C’est là un geste d’adoration. Dans ces scènes, il arrive fréquemment que l’himation a des couleurs claires, bleu ou rouge. Ces peintures, en effet, ne correspondent plus à la cérémonie mortuaire proprement dite. Les rites funèbres obligeaient les parents du défunt à revenir au tombeau le troisième jour après la mort, puis le neuvième et le trentième ; on apportait au mort le repas funèbre ; on renouvelait les libations et les offrandes du premier jours lette période d’un mois représentait à Athènes la durée complète du deuil. On quittait alors les vêtements sombres. Voilà pourquoi l’himation apparaît ici avec des couleurs claires. Le jour anniversaire de la mort, ou, suivant d’autres, le jour anniversaire de la naissance du défunt amenait encore une réunion des parents autour du tombeau. Mais rien n’empêchait, le reste du temps, de venir s’asseoir au pied de la stèle pour parler au mort, pour renouveler les fleurs et les bandelettes, pour apporter de nouvelles offrandes. L’emplacement même de la nécropole aux portes de la ville engageait à ces visites pieuses, qui sont dans les mœurs et dans les habitudes de tous les peuples. Les objets qu’on voit dans les mains des personnages, au pied ou autour de la stèle et dans le champ du vase, sont de nature très variée. Tous ne représentent pas des offrandes. Un certain nombre ne figurent que comme des ustensiles nécessaires à l’accomplissement des rites funèbres ; par exemple, la corbeille, le coffret, les vases à libations ; quelques-uns, comme la bandelette, les couronnes, les vases à parfums, sont spécialement destinés à l’ornementation de la stèle ; les autres enfin, objets de toilette, armes, oiseaux, gâteaux et fruits, libations, sont des offrandes dont le mort lui-même a la jouissance. Il est intéressant de constater sur les peintures du Ve et du IVe siècle la simplicité et la frugalité de ces offrandes. On n’y voit aucune allusion aux libations de sang, aux holocaustes de victimes si souvent mentionnés par les auteurs. Ce n’est pas l’effet du hasard ; c’est le véritable caractère des rites de l’époque. Aux temps homériques, le sang des humains et des animaux est la nourriture la plus agréable qu’on puisse offrir au mort. Achille, sur le tombeau de Patrocle, égorge douze jeunes Troyens, quatre chevaux, deux chiens, une foule de bœufs et de brebis. Ulysse évoque les ombres des morts en immolant des brebis au bord d’une fosse, et les ombres, se répandant autour comme un essaim de mouches, boivent avidement cette libation sanglante. Les holocaustes humains font partie de toute l’histoire héroïque ; plus tard, les poètes en feront un ressort dramatique pour exciter la terreur et la pitié dans l’âme des spectateurs. Mais ces coutumes barbares n’existent déjà plus quand commence la véritable histoire. Déjà même, au VIIe siècle, l’habitude de sacrifier les animaux de grande taille est considérée comme un rite dispendieux qu’on réserve aux divinités, et la loi de Solon défend d’immoler un bœuf dans les cérémonies funèbres. Au VIe siècle, la loi d’Iulis permet encore d’immoler des victimes suivant le rite ancien ; mais, au Ve, l’offrande des victimes parait devenir le privilège des dieux et des héros morts. C’est ainsi que le héros Pélops était honoré chaque année. Les guerriers de Platées recevaient dans une cérémonie annuelle l’offrande d’un taureau. De tels honneurs étaient exceptionnels au Ve siècle. Ce sentiment devient encore plus évident chez les écrivains de la fin du siècle et du commencement du IVe. Platon rappelle comme une habitude barbare les sacrifices humains et cite comme un usage également abandonné la coutume d’immoler des animaux avant la cérémonie de l’έκφορά. Le sacrifice des victimes n’est jamais non plus représenté sur les vases peints de ce temps.... Deux pratiques montrent sous un aspect intime et familier les hommages rendus aux morts. C’est d’abord la conversation des assistants avec le défunt. Debout ou agenouillés devant la stèle, ils étendent les mains vers le tombeau avec un mouvement qui semble indiquer qu’ils parlent au mort. C’est la peinture de ces entretiens familiers, tels que les retracent de nombreuses inscriptions funèbres portant la formule d’adieu, χαΐρε, ou un petit dialogue entre le défunt et le passant. Sur les vases, la scène a un caractère plus intime d’entrevue entre le mort et ses parents. La seconde coutume est de faire de la musique au pied du tombeau pour réjouir le mort dans sa solitude. L’instrument dont on se sert est la lyre. Sur les peintures de vases, c’est un éphèbe assis ou debout qui tient la lyre, tandis que les assistants paraissent l’écouter. Différents passages des auteurs font allusion à l’emploi de la musique dans les cérémonies mortuaires ; en particulier, la tinte était usitée dans la πρόθεσις et dans l’έκφορά. Nous trouvons également un tympanon entre les mains d’une femme sur un lécythe du Louvre. La lyre est connue comme instrument funèbre. Nous saisissons ici une des pensées les plus délicates de la religion des morts. Les offrandes matérielles, la nourriture et la boisson ne suffisent pas au défunt, et l’affection de ses proches doit songer à lui procurer des distractions intellectuelles ; du fond de son tombeau, il entendra encore le son des voix qu’il a aimées, leurs paroles de tendresse et de consolation ; et les doux accords de la lyre le berceront dans l’éternel sommeil. Pottier, Étude sur les lécythes blancs attiques à représentations funéraires, pp. 56 et suiv. 31. — UNE FONDATION FUNÉRAIRE. Quelquefois un individu, avant de mourir, déterminait lui-même les cérémonies qui auraient lieu à perpétuité auprès de son tombeau et laissait des fonds à cet effet. C’est ce que fit une certaine Épictéta, de Théra. Puissé-je continuer d’administrer mes biens, étant en force et en santé ! Toutefois, s’il m’arrivait quelque chose, eu égard à la condition humaine, je dispose comme il suit, conformément à la recommandation de mon mari Phœnix, qui a fait faire une chapelle consacrée aux Muses en l’honneur de notre fils défunt Cratésilochos, qui a placé dans ce Musée les figures et statues de lui et de Cratésilochos, avec les monuments funéraires, et qui m’a priée d’achever le musée en y plaçant les Muses, les statues et les monuments. Deux ans après, le fils qui me restait, Andragoras, est décédé, et m’a recommandé à son tour d’exécuter complètement la recommandation de son père Phœnix, d’ériger en son honneur une statue et un monument, comme il a été fait en l’honneur de son père et de son frère, de fonder une communauté d’hommes du parentage et de donner cette communauté une somme de trois mille drachmes, dont le revenu servira aux frais de ses assemblées. En conséquence, ayant achevé et érigé toutes choses suivant les recommandations de Phœnix et d’Andragoras, et ayant aussi fondé la communauté des parents dont les noms sont écrits ci-dessous, laquelle communauté s’assemblera dans le Musée, je donne trois mille drachmes à ladite communauté.... Je laisse le Musée avec l’enclos et les monuments funéraires à ma fille Épitéleia ; je veux qu’ayant recueilli tous nos biens, elle paye chaque année, dans le mois Éleusinien, deux cent dix drachmes[8] à la communauté fondée par moi. Nul n’aura le droit de vendre le Musée ni l’enclos des monuments. Aucune des figures qui sont soit dans le Musée, soit dans l’enclos des monuments, ne pourra être mise en gage, ni échangée, ni aliénée, en aucune manière, ni par aucune connivence, et il ne pourra être fait dans l’enclos aucune construction, à moins qu’on veuille construire un portique. Le Musée ne pourra être mis à la disposition de personne, si ce n’est pour les noces d’un descendant d’Épitéleia.... Personne n’aura le droit d’emporter aucun des, objets qui sont dans le Musée.... Le sacerdoce des Muses et des héros[9] appartiendra au fils de ma fille, Andragoras, et, à défaut de celui-ci, successivement au plus âgé des descendants d’Épitéleia. La communauté se réunira dans le Musée, chaque année, au mois Delphinios. Elle recevra de mes successeurs les deux cent dix drachmes ; elle désignera dans son sein trois hommes pour officiants, et elle sacrifiera le 19e jour aux Muses, le 20e aux héros Phœnix et Épictéta, le 21e à Cratésilochos et Andragoras. Si le payement des deux cent dix drachmes n’est pas fait par Épitéleia et ses héritiers à la communauté, celle-ci prendra les récoltes de mes terres de Mélènes, jusqu’à concurrence de deux cent dix drachmes.... Les noms des parents que j’ai réunis en communauté sont : (suivent vingt-cinq noms)[10]. On admettra également les femmes habitant avec eux et leurs enfants, à savoir les filles tant qu’elles sont en puissance de leurs pères, et les garçons, même après leur majorité, enfin leurs descendants, en suivant la même distinction. Les épicières seront admises aussi avec leurs maris et leurs enfants, conformément aux règles ci-dessus. Inscriptions juridiques grecques, Il, p. 78 et suiv. |
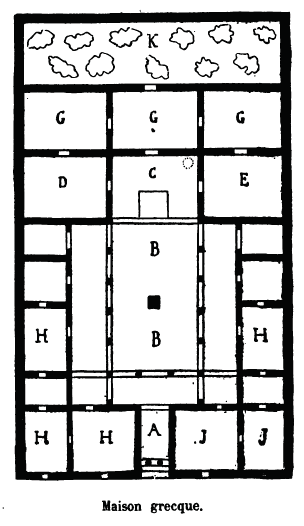 L’habitation
était ordinairement précédée d’une barrière qui empiétait sur la rue.
L’espace libre entre cette barrière et la porte formait un vestibule, souvent
décoré de peintures, d’une inscription destinée à détourner les voleurs et le
mauvais sort, de la primitive image d’Hécate, d’Hermès et d’un autel
d’Apollon Agyieus.... A droite et à gauche de l’entrée étaient disposées des
écuries ou des boutiques
L’habitation
était ordinairement précédée d’une barrière qui empiétait sur la rue.
L’espace libre entre cette barrière et la porte formait un vestibule, souvent
décoré de peintures, d’une inscription destinée à détourner les voleurs et le
mauvais sort, de la primitive image d’Hécate, d’Hermès et d’un autel
d’Apollon Agyieus.... A droite et à gauche de l’entrée étaient disposées des
écuries ou des boutiques