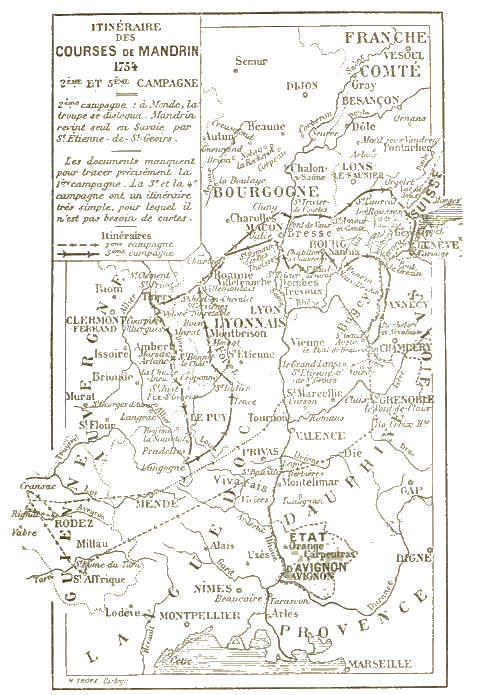MANDRIN, CAPITAINE GÉNÉRAL DES CONTREBANDIERS DE FRANCE
TROISIÈME PARTIE. — LA CARRIÈRE DE MANDRIN
XX. — CINQUIÈME CAMPAGNE[1] (4 octobre-29 octobre 1754).
|
Mandrin passe sous le canon de l'Écluse. — Il met à contribution la recette buraliste de Nantua. — La surprise de Cerdon en Bugey. A Bourg-en-Bresse : Mandrin et Mgr l'intendant. — La Dombes. — Réquisitions à Saint-Paul-de-Varax. — Le coche d'eau à Saint-Romain-des-Iles. — Alerte à Lyon. — Roanne, Thiers, Ambert, Marsac, Arlanc, la Chaise-Dieu. — Combat entre Fix et Saint-Geneix. — Le Puy-en-Velay : siège de la maison de l'entreposeur des tabacs. Une vente publique. — Chez le receveur des Fermes à Montbrison. — Boën-sur-Lignon, Charlieu, Cluny. — Mandrin et M. d'Espagnac, gouverneur militaire de la Bresse et du Bugey. — Pont-de-Vaux, Saint-Amour-en-Comté, Orgelet. — Rentrée en Suisse par les Rousses et la Faucille. Vainement Louis XV fait-il demander aux autorités suisses d'empêcher que les Mandrins ne fassent de nouvelles incursions en France : le bailli de Nyon répond qu'il ne dispose pas de forces suffisantes[2]. A cette époque, les contrebandiers avaient leurs principaux entrepôts de marchandises au val de Chézery — duché de Savoie —, en la terre de Ballon[3]. Franchissant le Rhône au Pont-de-Grezin, Mandrin rentre en France dans la nuit du 3 au 4 octobre 1754. Plusieurs chefs contrebandiers qui, jusque-là, avaient opéré d'une manière indépendante, étaient spontanément venus se ranger sous ses ordres, avec leurs adhérents[4]. Il pénètre ainsi en France, à la tête de la troupe de margandiers la plus nombreuse que l'on y ait encore vue ; deux ou trois cents hommes, en comptant les valets qui conduisent un convoi de 98 chevaux chargés de tabacs et d'étoffes. Les Mandrins s'intitulent voyageurs et marchands contrebandiers. Ils passent sous le feu des canons de l'Écluse et franchissent la Valserine à six heures du soir. Un détachement de fusiliers, fourni par la garnison de Châtillon-de*Michaille, était établi au pont de Bellegarde. Leur logis, à dix pas du pont, avait été entouré d'épaulements qui en faisaient une manière de fortin. Les fusiliers, qui s'y trouvent en sûreté, n'ont garde d'en sortir. La poste aux lettres de ce jour est retardée ; Mandrin l'a arrêtée afin de prendre sur elle l'avance nécessaire au succès de son entreprise, car il ne doutait pas que les lettres expédiées de Genève n'annonçassent sa nouvelle expédition.
Mandrin prend le chemin de Nantua par la vallée de la Valserine. La route du col de la Faucille, riante d'abord, devient solitaire et sauvage à la hauteur du Crêt de la Neige et du Reculet. Avec sa troupe, il suit la rivière jusqu'à Châtillon-de-Michaille, qui se voit de loin perché sur son promontoire. Après Châtillon, le lit de la Valserine prend la direction du Nord, tandis que la route de Nantua, barrée par la montagne, oblique à gauche, pour retrouver la gorge où elle doit s'engager. Au fond du ravin gronde la Semine, affluent de la Valserine, rebondissant et brisant ses eaux sur les rochers. Ni culture, ni maisons. Les montagnes, qui enserrent le défilé, sont trop abruptes pour que l'homme ait pu y accrocher sa demeure. La route fuit sur une pente égale, en légères sinuosités, très blanche au milieu des sombres forêts de chênes et de hêtres, parsemées de rochers aux formes pittoresques. Une solitude faite de rocs et de verdure, où l'on rêve aux ermites du vieux temps. En se retournant, on aperçoit le Credo, les derniers escarpements du Sorgia, égratignés de rainures presque à pic, les couloirs par lesquels les bûcherons font glisser les sapins dans la plaine. Avec un bruit monotone, la Semine coule sur une pente très raide ; le lit, aux endroits où il s'évase, ressemble à un gigantesque escalier. C'est comme les gradins d'un amphithéâtre en ruine. Mais, peu à peu, le torrent devient rivière. Des scieries remplissent de leur bruit joyeux la vallée profonde qui s'élargit enfin à l'endroit où la Semine la quitte à son tour, pour faire place au Combet. La Semine a guidé les Mandrins jusqu'à Saint-Germain de Joux ; ils arrivent à Notre-Dame-de-Lorette, à des prairies, à des champs d'orge et d'avoine que l'homme a créés autour des rochers. De-ci, de-là, se groupent à présent de rares habitations ; La Voutte, Frébuge, Burlandier. La vallée s'élargit encore. Derrière une forêt de roseaux d'un vert sombre apparaît le petit lac de Sylans, au fond d'un cirque de montagnes sans issue apparente. Sur la gauche de la route que suivent les bandits, le lac étend ses eaux d'un vert plus tendre que celui des prairies. Ils passent à Pisserache, ils traversent Montua. Le col tourne, le lac disparaît. Dans l'étroit vallon qui se creuse en tuile sur la droite, parmi les masses noires des sapins, la Doye prend sa source. Ce sont des flaques d'une couleur moirée, à croire qu'on y a versé des pots de minium et des essences. Le ruisseau suit la route où vont les contrebandiers, la coupe aux Nayrolles et va se jeter dans le lac de Nantua. Au centre de son paysage de montagnes, qui s'allongent en vagues immenses dans toutes les directions, le petit lac de Nantua miroite, jolie tache bleu saphir, à la lumière du ciel. Deux montagnes à pic l'étranglent comme dans un étau, et, tout au fond de ce fjord paisible, quelques maisons, groupées autour d'un clocher, ont l'air de barques de pécheurs endormies dans une calanque. On lit dans un mémoire rédigé à cette date sur la position des troupes aux ordres de M. le comte de Tavanes, lieutenant-général en Bourgogne[5] : Nantua est une ville située à l'entrée des gorges du Valromey et sur le grand chemin de Lyon. Elle n'a qu'une seule rue, à l'issue de laquelle on a mis à chaque côté une barrière qui tient lieu de poste. On peut veiller de ces cieux barrières à ce qui pourrait se glisser entre les montagnes et la ville. Il y a trois compagnies à Nantua et, comme ce poste est en seconde ligne, à trois lieues de Châtillon-de-Michaille et à trois lieues d'Oyonas, il a ordre de se porter au secours de l'un ou de l'autre s'ils étaient attaqués. Ce poste sert également à défendre les gorges du Valromey au cas que les contrebandiers, ayant passé le Rhône des environs de Seyssel, voulussent tomber sur Nantua par les montagnes du Valromey. Il y a d'ailleurs dans cette ville un grenier à sel considérable. Les contrebandiers ne sauraient attaquer Nantua sans s'exposer à être mis entre deux feux par le poste de Châtillon. Cette unique rue de Nantua est en ellipse ; les maisons en sont étroites, avec de jolis balcons en fer forgé ; les frontons des portes et des fenêtres recroquevillés, dans le style de l'époque. Petits hôtels bourgeois, derrière lesquels des masures antiques, sans âge, se serrent étroitement, si près de la montagne, poussées par elle, qu'elles grimpent l'une sur l'autre, étagées en gradins de reposoir. Ni les trois compagnies, ni les dispositions stratégiques de M. de Tavanes n'empêchent Mandrin d'entrer dans la ville, sur les onze heures du soir. Il se fait conduire au bureau de tabac, géré par une daine, connue à Brioude, la veuve Robin. Ou cogne à l'huis, on éveille la daine, on lui offre du tabac, on exige dix mille livres. Dix mille livres ! Mme Robin dans sa caisse n'a que deux cents écus. Quelques-uns des margandiers voudraient recommencer les scènes de Brioude ; mais, cette fois-ci, très rudement, Mandrin leur impose silence : Taisez-vous ! Personne n'a le droit de parler en ma présence ![6] Enfin, il donne un reçu pour 700 livres et laisse cieux bennes de tabac. Pendant ce temps, quelques contrebandiers parcouraient la ville, en tirant des coups de fusil. Ils menaçaient d'une balle quiconque s'aviserait de mettre le nez à la fenêtre. D'autres cherchaient les gardes dont se composaient les trois compagnies ; mais ceux-ci s'étaient tapis dans leurs paillasses. Quelques compagnons s'étaient mis à boire dans les cabarets qu'ils avaient fait rouvrir à grands coups de talons de crosses dans les portes. Au fait, les Mandrins employèrent toute cette nuit à boire ; car, étant repartis au signal de quelques coups de fusil, après avoir passé à la Cluse, où les bis-tan-clac-pan, on veut dire les métiers à tisser, étaient silencieux à cette heure nocturne, ils burent encore à une petite lieue de là, au village de Saint-Martin-du-Frêne, puis encore à Pont-de-Maillac, où ils se reposèrent enfin et dormirent sous la garde de leurs sentinelles. Ils n'en repartirent pas moins avant l'aube. Du lieu dit Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, ils s'engagent dans des combes boisées, où la route se serre entre les futaies d'ormes et chênes, entourée d'une végétation broussailleuse, très touffue II n'était pas encore jour quand, peu avant d'arriver à Cerdan en Bugey, les contrebandiers furent brusquement arrêtés par une fusillade qui partait des fourrés voisins. C'était une embuscade de gapians et la première fois qu'on osait attaquer Mandrin. Ses compagnons répondirent ; mais, à la faveur de l'obscurité, sous le couvert des bois, les employés disparurent. Dans cette affaire, Mandrin eut un cheval tué et un homme blessé. En outre, un de ses valets, Caratin dit Gros-Claude, en faisant le coup de feu contre les agresseurs, eut le pouce de la main gauche emporté, son fusil lui ayant éclaté entre les doigts[7]. Les Mandrins poursuivirent leur route par Poncin et par Neuville-sur-Ain, où ils franchirent la rivière. Ils parurent devant Bourg, capitale de la Bresse, le 5 octobre 175, à dix heures du matin[8]. Ils étaient au nombre de 152 hommes, y compris les valets qui menaient les chevaux de bât[9]. On doit toujours avoir présent à l'esprit que le nombre d'hommes, directement commandés par Mandrin, au cours d'une expédition, est très variable. Il lui arrive fréquemment d'envoyer des détachements dans des directions diverses et, d'autre part, outre les enrôlements qu'il fait à prix d'argent, il engage souvent des journaliers, c'est-à-dire des recrues qui ne s'attachent à sa suite que pour un temps très court. Bourg avait 6.000 habitants et des caisses considérables[10], qui ne devaient pas laisser de séduire nos compagnons. Les clochetons de la vieille ville, aux maisons de bois peint, aux toitures pointues et vernissées, apparaissaient en un fouillis pittoresque au dessus de l'antique chemise de briques, rempart bastionné sous Henri II. L'année d'avant, avaient précisément été refaites les serrures des lourdes portes aux pentures de fer ouvré, pratiquées dans l'enceinte, comme si l'on eût prévu l'attaque des Mandrins. Mais leur arrivée fut si brusque, ils se saisirent avec tant de promptitude des diverses entrées de la ville[11] et portèrent si rapidement une troupe de solides gaillards, armés jusqu'aux dents, à la place des Halles, où les rues principales aboutissaient et où la défense aurait pu s'organiser, que le gouverneur n'eut pas le temps de mettre eu éveil les dragons casernés dans la ville[12], ni de rassembler les milices bourgeoises. Celles-ci pouvaient mettre en ligne l'imposant effectif de six à sept cents hommes, divisé en six pennonages, les uns armés d'arquebuses à rouet, et les autres de hallebardes d'une forme aussi terrible que réjouissante, dont quelques spécimens sont encore conservés au musée de la ville. Mandrin laissa une partie de ses troupes aux portes et dans les faubourgs, et, par la rue principale, que traversait un ruisseau, le Cône, où l'on jetait les ordures ménagères, il se dirigea droit vers les Halles les plus belles et les plus vastes qui soient en France ; elles semblent une petite ville. Là, affluait toute la circulation. Après y avoir posté un fort planton de ses camarades, comme il vient d'être dit, le contrebandier, suivi du gros de sa bande, se rendit à la maison du directeur des Fermes, M. Jean Hersmuller de la Roche, lequel, à la nouvelle de l'arrivée des compagnons, avait pris la fuite, comme l'avaient fait et comme le feront tous ses confrères. Mandrin ne trouva au logis que Mme la directrice, qui était jeune et très jolie[13]. La cour de l'hôtel fut envahie en un clin d'œil par les mulets chargés de tabac. Les contrebandiers rangèrent en gros tas quarante-quatre ballots couverts de serpillière. Il y en avait, disait leur chef, pour 20.000 livres, et il priait la dame de les lui compter. Mandrin était, ce jour-là, de très bonne humeur. La jeune femme n'en fut pas moins terrifiée. Elle n'avait jamais vu un bandit de si près ; et puis elle n'avait pas d'argent. Qu'à cela ne tienne, Madame, on vous en fera trouver. Par une heureuse rencontre, Jean-François Joly de Fleury, intendant de justice, police et finances dans les provinces de Bourgogne, Bresse et Bugey, était précisément à Bourg, suivant l'usage, pour le département des impositions[14]. Il logeait à l'hôtel de M. de Varenne, receveur des tailles, où il se trouvait dans le moment même, en compagnie du gouverneur de la ville, M. de Choin, et d'une société élégante, composée d'une trentaine de gentilshommes et de plusieurs dames de distinction[15]. Mandrin avait surpris Mme la directrice des Fermes à sa toilette. Il était nécessaire que, sur-le-champ, elle l'accompagnât chez Mgr l'intendant. Mais, Monsieur, je ne suis pas habillée ! Mme la directrice n'en était pas moins charmante, et l'un des contrebandiers d'enlever la jeune femme dans ses bras robustes et de la déposer dans la rue, telle qu'elle était, en petites pantoufles, en pet-en-l'air et cotillon court, un peignoir sur les épaules et les cheveux épars[16]. Ainsi Mme la directrice s'en va par les rues, encadrée de deux bandits hirsutes et poussiéreux, qui ont le fusil sur l'épaule. L'air agite l'éventail de ses longs cheveux, ses petites mules clapotent sur les pavés noircis. La chaussée est bordée de maisons en bois aux boutiques basses et profondes ; les étages supérieurs, soutenus par des poutres en saillie, en surplomb sur la rue. Mandrin a son grand chapeau de feutre noir dont la visière antérieure, rabattue, ombrage ses yeux clairs, son visage aux traits énergiques, hâlé. Ses boucles blondes lui tombent sur la nuque. Un foulard rouge au cou, son gilet de panne rouge, et son habit de pinsbeck gris, aux boutons de cuivre brillant ; une culotte de peau, des guêtres noires, des souliers aux boucles d'argent. A la ceinture de soie verte et rouge brillent les crosses de deux pistolets, au côté l'épée en verrouil, et, dans sa main droite, sa fidèle carabine à deux coups, baïonnette au canon[17]. Je précédai cette incivile bande de trente pas, écrit le lieutenant du roi, M. de Bohan. Le spectacle était des plus curieux. Les bourgeois de la ville se pressaient au pas des portes et les femmes se mettaient aux fenêtres. Mandrin et ses hommes étaient d'une gaieté folle. En passant, ils expliquaient aux habitants, avec des quolibets et des lazzi, que les braves gens comme eux devaient être sans crainte, qu'on n'en voulait qu'à la Ferme et à ses suppôts. Sur les onze heures du matin, dit Joly de Fleury, nous fûmes informés de ces faits par différentes personnes de considération. Ayant vu par nous-mêmes, poursuit l'intendant, plusieurs de ces contrebandiers, qui entraient avec ladite dame de la Roche dans la première cour de la maison que nous habitions, nous avons prié M. de Bohan, lieutenant de roi de cette ville, et M. de Chossat, capitaine au régiment de Nice, tous deux chevaliers de Saint-Louis, d'aller trouver de noire part le commandant de la troupe et de l'engager à se retirer. Ces détails sont délicieux et rendus par Joly de Fleury sur un ton de distinction et d'humour tranquille qui en rehausse la saveur. Les deux chevaliers de Saint-Louis trouvèrent en Mandrin un homme qui, comme eux, savait négocier dans les belles formes. Il commença par offrir ses excuses à Monseigneur l'intendant de se voir ainsi dans l'obligation de venir faire du bruit à sa porte. Il suppliait Sa Grandeur de ne pas lui en tenir rigueur et de croire à la sincérité de son désespoir. C'était au sieur J.-B. Bocquillon, adjudicataire général des Fermes, qu'il en avait, et il ne lui était pas possible de cesser ses hostilités envers les protégés de ce dernier, jusqu'à ce que l'argent, qui lui revenait en paiement du tabac qu'il avait livré, lui eût été versé[18]. Excuses dont l'intendant fut assurément touché puisqu'il les note avec soin dans son rapport au ministre. On se mit d'ailleurs facilement d'accord. Mandrin réclamait 20.000 livres pour le tabac qu'il avait déposé chez M. le directeur des Fermes. Joly de Fleury les fit compter par les soins de M. de Varenne, receveur des tailles[19], et les deux chevaliers de Saint-Louis firent porter l'argent au capitaine Mandrin par des valets de ville, tel qu'on présente le vin d'honneur à l'intendant[20]. Pendant ce temps Mgr l'intendant et sa noble compagnie se hâtaient de déguerpir et de franchir les murs qui se dressaient entre l'hôtel du receveur des tailles, et le couvent contigu des Capucins. Les dames montaient par des échelles et tombaient de l'autre côté dans les bras de beaux cavaliers empressés à les recevoir. Mandrin ne fit aucune difficulté pour rendre aussitôt la liberté à Mme de la Roche et il libella une quittance ainsi conçue : Je déclare avoir reçue de Monsieur le chevalier Chosat quapitaine au régt de Nice, la somme de vingt mille livres. pour marchandise que j'ai livré à Madame La Roche à Bour, ce 5e otobre 1754. L. MANDRIN[21]. Vingt mille livres, en toutes lettres, selon les règles d'une bonne comptabilité. Puis il se retira avec ses hommes, au faubourg des Halles, du côté de Besançon, où les compagnons se répandirent tumultueusement dans les auberges. Mme de la Roche, qui avait peur de rentrer chez elle, fut menée à l'hôtel du Gouvernement. Elle était toujours en jupon court, un jupon de flanelle à fleurs, ses longs cheveux se déployaient en éventail sur ses épaules. De ses pieds, les petites mules s'échappaient, glissant sur les pavés : elle les rattrapait, de mauvaise humeur. Dans l'hôtel du Gouvernement, on mit à sa disposition l'appartement de M. Lenoir, commissaire des guerres. Il était deux heures et demie. On sait qu'en ce temps on dînait à trois heures. Était-ce réaction ? Chacun mangea de bon appétit, Mgr l'intendant, M. le gouverneur, M. le lieutenant de roi, ces dames et leurs cavaliers, dans le grand réfectoire aux murailles blanches des Capucins ; Mandrin et ses hommes dans les cabarets du faubourg des Halles. Mandrin avait particulièrement séduit M. de Chossat, capitaine au régiment de Nice-Infanterie, beau-frère du subdélégué de Bourg[22], et M. de Saint-André, ingénieur des Ponts et Chaussées. Ils s'attachèrent à lui et ne le quittèrent durant une grande partie de la journée[23]. Seule, Mme de la Roche se remettait difficilement de son émotion. Dans la chambre du Gouvernement mise à sa disposition, elle retira son pet-en-l'air, ses petites mules et son jupon à fleurs, et se mit dans un grand lit, où elle ne put dormir. Mandrin était attablé à l'auberge, quand un peintre de la ville vint solliciter l'autorisation, tandis que le jeune chef de contrebandiers serait à manger, de s'asseoir dans un coin de la salle, afin de tirer de lui quelques croquis pour un portrait[24]. Ayant terminé son dîner, tandis que nombre de ses camarades continuaient de boire en différents cabarets et que d'autres vendaient aux bourgeois empressés leurs marchandises de contrebande[25], Mandrin se rendit aux prisons de la ville où il se fit représenter les registres de la geôle et délivra dix prisonniers pour contrebande, faux-saunage et un déserteur[26], qu'il emmena avec lui, déclarant ici encore aux autres détenus, laissés dans leurs chaînes, qu'il ne voulait parmi les siens, ni voleurs, ni malfaiteurs[27]. A quatre heures de l'après-midi, l'intendant et sa compagnie étaient encore à table chez les Capucins — après de si vives émotions, il était utile de se restaurer longuement — quand une nouvelle députation vint gratter à la porte. Mandrin réclamait encore 3.000 livres pour six balles de contrebande qu'il avait fait porter chez l'entreposeur des tabacs, M. François. Il ne pouvait en conscience, disait-il, passer dans une ville telle que Bourg sans laisser du tabac à l'entreposeur. A vrai dire, les plénipotentiaires, que Mandrin avait délégués cette fois, étaient dépourvus de tenue et de correction diplomatiques. Ils s'étaient arrêtés en chemin pour boire à la santé de Mgr l'intendant. Du moins eurent-ils le tact de ne pas pénétrer dans la salle, où se trouvait si brillante compagnie, et de rester au seuil, la porte ouverte, en s'appuyant l'un contre l'autre pour tenir debout. MM. de Chossat et de Saint-André, reçurent encore mission de suivre cette nouvelle négociation. Les deux délégués envoyés par Mandrin parlaient avec rondeur et tendresse, mais ils embrouillaient tout. MM. de Saint-André et de Chossat prirent donc le parti d'entrer directement en rapport avec le chef même de la bande, et cette seconde affaire fut rapidement conclue, comme la première, après un échange de part et d'autre de beaucoup de marques d'amitié et de considération. Le capitaine des contrebandiers donna quittance de l'argent qui lui fut remis : Je reconnais avoir reçu de M. François la somme de 3.000 livres pour trois charges de tabac que je lui ai livrées, de laquelle somme il se fera tenir compte par MM. les fermiers généraux. Fait à Bourg, le 5 octobre 1754. L. MANDRIN. Ce M. François, entreposeur des tabacs à Bourg, était le père de l'astronome, Joseph-Jérôme Le François de Lalande, qui était entré à vingt-deux ans à l'Académie des sciences. L'illustre savant se trouvait précisément à ce moment à Bourg, dans la modeste maison de son père où la scène eut lieu, et il a même pris soin de laisser, lui aussi, une courte relation du passage des brigands[28]. Mme François, de son nom de jeune fille. Marianne Mouchinet, était directrice de la poste. Enfin, sur les cinq heures, après de nouvelles et copieuses libations dans les auberges, les Mandrins quittèrent Bourg et s'éloignèrent sur la route de Chalamont en Dombes. Ils chantaient à tue-tête. La plupart d'entre eux étaient dans un tel état d'ivresse qu'à peine pouvaient-ils tenir à cheval. Après le départ des gais compagnons, les employés de la régie se mirent à peser gravement le tabac livré : le compte se trouva exact, 4 918 livres pesant, note Joly de Fleury dans son rapport, que nous avons fait renfermer dans un ballot dans une chambre du receveur des tailles[29]. Le passage de Mandrin à Bourg est un des endroits intéressants de sa vie. Encouragé par la sympathie — ce que le gouvernement appellera le mauvais vouloir[30] — des habitants, il s'y était surpassé. Il est vrai que la personnalité même de Joly de Fleury était faite pour s'harmoniser avec la sienne. Voltaire l'aimait beaucoup : Homme aimable, dit-il, et conteur charmant. Nous ne rendons pas suffisamment justice à ces grands seigneurs de l'ancien régime, à leur manière très humaine de gouverner les provinces et dans un très grand style. En cette circonstance, l'intendant de Bourgogne fut d'ailleurs blâmé par les contemporains. On ne trouve pas bon, écrit l'abbé d'Aurelle[31], que M. de La Valette — Joly de Fleury —, après avoir fait donner deux fois de l'argent à Bourg en Bresse, se soit retiré aux Capucins en bonne et nombreuse compagnie. On a dit comment Mandrin avait éveillé l'intérêt du capitaine au régiment de Nice, M. de Chossat, et de l'ingénieur des Ponts et Chaussées en service à Bourg, M. de Saint-André. Il leur avait découvert le fond de ses pensées. Car il lui arrivait de réfléchir sur la voie dans laquelle il s'était engagé. Il la devinait sans issue. Du moins, ses foudroyantes expéditions lui avaient révélé sa vocation. Il rêvait de devenir soldat, de servir son pays. Il avait déjà le tempérament des hommes de la Révolution ; il était très patriote. MM. de Chossat et de Saint-André se firent l'interprète de ses désirs auprès de Joly de Fleury, et celui-ci les transmit favorablement au ministre. Ils comptaient sans la bureaucratie française qui sévissait déjà. Les bureaux de la Guerre font répondre à l'intendant[32] : A l'égard de l'amnistie qui vous a été demandée pour Mandrin, comme il a été condamné à mort pour fausse monnaie, il ne doit point espérer de grâce, et d'ailleurs il serait de mauvais exemple de traiter avec des gens de cette espèce. Sans parler de l'erreur grossière que commettaient les bureaux en confondant Louis Mandrin avec sou frère Pierre, — jamais Louis Mandrin n'avait été condamné pour fausse monnaie, — on notera ce seul trait, que ces Messieurs ne voulaient pas traiter avec des gens de cette espèce. Les bureaux de la Guerre préféraient, dans ce moment même, traiter avec la vieille mère d'un principal chef de contrebandiers pour tâcher de se faire livrer en trahison ceux qu'ils ne parvenaient pas à réduire par les armes[33]. Aussi bien, on verra par la suite jusqu'où l'administration sera amenée dans cette voie. A Bourg, un artiste était donc venu demander à Mandrin la permission de tirer son portrait. Il en fut fait une gravure qui fut imprimée à Lyon. Et la vente en eut un tel succès, que l'administration dut la faire interdire[34]. Il était sans exemple, lisons-nous dans le registre des délibérations de la municipalité de Gex[35], il était sans exemple, et la postérité aura de la peine à le croire, que, dans un État aussi respectable qu'est la France, une troupe de bandits, sous le nom de contrebandiers, ait eu la témérité d'entrer armés dans plusieurs villes du royaume, d'y enlever les caisses des Fermes, du roi, d'exiger des contributions des habitants, d'ouvrir les prisons royales et d'en sortir les prisonniers. De ce moment aussi, Mandrin connut les gloires de la presse. La nouvelle de ces beaux faits, écrit Terrier de Cléron[36], méritait d'embellir les papiers circulaires de Hollande, de Berne et d'Avignon ! Il devenait le principal sujet d'entretien des nouvellistes de café[37]. On parlait du célèbre Mandrin à Marseille, tout le long de la côte et jusqu'aux Échelles du Levant[38]. Quand il s'agit de rembourser à M. de Varenne l'argent
avancé par lui pour les bennes de tabac, le Contrôleur général écrivit à
l'intendant de Bourgogne : Je ne puis me déterminer
à faire payer par les fermiers généraux les 23.000 livres que le receveur des
tailles de Bourg-en-Bresse a payées aux contrebandiers. Je ne vois aucune
raison qui puisse les assujettir à ce remboursement, si ce n'est l'intention
que les contrebandiers ont eue de leur faire supporter cette perte ; ce qui
ne peut être un motif pour le Conseil. Je ne puis me persuader que ces
scélérats eussent pu se porter à de pareils excès, s'ils n'avaient des
correspondances dans le pays et s'ils n'y étaient appuyés par la bonne
volonté des peuples ; c'est ce qui peut conduire à prendre le parti de faire
supporter par les provinces mêmes, par la voie de l'imposition, ces espèces
de contributions, exigées par les contrebandiers ; lorsque les contribuables
sauront que ce sont eux qui doivent supporter ces exactions et tous les dommages
qui en résultent, ils seront animés par leur propre intérêt à les prévenir[39]. Que s'il eût manqué quelque chose à l'impopularité des fermiers généraux et à la faveur dont le peuple et la noblesse entouraient les contrebandiers[40], M. le Contrôleur général prenait soin d'y pourvoir. En quittant Bourg, les Mandrins s'engagèrent sur la route de Lyon. Ils entraient dans la partie marécageuse de la Dombes, parsemée d'étangs, des centaines d'étangs parmi les taillis de bouleaux et de chênes ; puis des landes, des jachères ; sur des mottes aux pentes mollement inclinées, des fermes isolées, comme aplaties sous leurs toitures basses et allongées ; par endroit, des terres d'une blancheur crayeuse, creusées en assiettes : ce sont d'anciens étangs momentanément remis en culture. Au delà de Servas, ce caractère se généralise encore une lagune immense d'où émergent de vastes surfaces de bois et de terres labourées, des horizons lointains. Le soir même, 5 octobre, les Mandrins arrivent à Saint-Paul-de-Varax, qui dresse sa silhouette féodale sur un tertre dominé par la vieille église romane. Ils y passent la nuit et reprennent le lendemain matin, 6 octobre, en tournant brusquement vers l'Ouest, la direction de Chatillon-sur-Chalaronne, Châtillon-lès-Dombes, comme on disait aussi. La route est une berge enveloppée par les flots. Parmi les étangs qu'on traverse sur des chaussées étroites, la longue file des contrebandiers semble, de loin, s'avancer dans l'eau. Sur leur droite, les étangs sont bordés de bois ; des vols de mouettes blanches jettent leur image mouvante sur les nappes d'eau tranquilles, où les arbres reflètent leur silhouette élargie, où séjournent des troupeaux entiers, immobiles durant des heures, trempés jusqu'au poitrail. Des bergères de quinze ans y poussent vigoureusement des poulains, campées sur eux à califourchon, sans autres rênes que leurs crinières, car, aux chevaux comme aux bœufs, l'eau des étangs fortifie les muscles. D'entre les roseaux s'échappent, au passage des cavaliers, des sarcelles craintives, des couples de canards sauvages, tandis que, au cri rauque du chef de file, des bandes de vanneaux ont déjà gagné le milieu de l'étang. Dans les pièces de terre qui séparent les eaux, les cochons et les oies paissent en liberté, et de longs attelages de six et huit bœufs s'enfoncent dans les jachères, entre les taillis. Vers le Sud, au fond du Grand-Bataillar, comme se nomme le principal de ces petits lacs, les plans s'effacent, les horizons se noient dans la brume en d'autres étangs qui se perdent dans la direction de Marlieux. C'est une impression de mer, de mer grise et délaissée, comme celle que donnent la Camargue et les lagunes de la Crau. En cette journée du 6 octobre, gravissant les collines plantées de genêts, les Mandrins arrivent à Châtillon-sur-Chalaronne, aux confins de la principauté de Dombes et de la Bresse. La petite ville se serre entre ses anciens remparts coupés de portes à pont-levis, avec ses tanneries qui font un bruit vieillot aux bords de la rivière : elle se cache, comme en un berceau, dans une combe rendue verdoyante par les eaux de la Chalaronne. La troupe des contrebandiers passe sous les halles grandioses que Mlle de Montpensier, princesse de Dombes, a fait construire : immense hangar en bois de chêne, aux piliers massifs, couvert de tuiles ; ils passent devant l'église que saint Vincent de Paul a parfumée de ses vertus ; ils arrivent par des ruelles étroites et sombres chez le receveur des gabelles que Mandrin, le chapeau bas et le pistolet à la main, invite à ne pas lui refuser une contribution de 2.500 livres. M. le receveur n'a garde de la lui refuser[41]. De Châtillon, les margandiers prennent la route de Saint-Trivier, dans la principauté de Dombes. Les étangs ont disparu. C'est la vallée de la Chalaronne, au cours sinueux, entre de longs espaces sablonneux plantés de saules et de peupliers en désordre ; par endroits, les eaux de la rivière disparaissent sous les branches pendantes des vergnes, qui se replient jusqu'au milieu du cours d'eau. A Saint-Trivier, Gros-Claude, le valet de Mandrin, blessé à la main lors de la surprise de Cerdon-en-Bugey, demeure pour se faire soigner[42]. La bande continue par Thoissey. Voici les prairies de la Saône, et, dans une nappe de lumière, à l'horizon, les monts du Beaujolais. Le 7 octobre, les compagnons atteignent le pont de Saint-Romain-des-Iles, sur la Saône, hameau de Romanèche, où ils font halte un instant. Mandrin s'est assis sur l'herbe, au revers d'un coteau faiblement incliné, où tournent des moulins à vent. La rivière est tranquille et large, et ses eaux viennent mourir en un lent clapotis sur la grève où des oies barbotent. La rive est encombrée de troncs d'arbres qu'on y a traînés pour les équarrir et lés confier ensuite au courant. Sur l'autre bord, une aunaie tend un rideau de verdure sombre, d'où émergent, à intervalles réguliers, des peupliers pointus. Mandrin garde les yeux fixés sur la rivière qui se perd à l'horizon. Il tient à la main, comme de coutume, sa carabine. On dirait un chasseur guettant un vol de canards sauvages parmi les joncs. Il se lève. Il a vu au loin le coche d'eau, la diligence, qui remonte la Saône de Lyon à Chaton, tirée par trois chevaux de halage. Or, il lui est revenu, comme au loup du bon La Fontaine, que les gapians de Chalon-sur-Saône ont mal parlé de lui et des siens. On sait combien il avait, sur ce point, l'épiderme sensible. Mandrin fait signe au postillon d'arrêter. Celui-ci n'en a cure. D'un coup de fusil, Mandrin a coupé le jarret à l'un de ses chevaux. Mandrin entre dans le bateau avec cet air de commandement qui ne le quitte plus. Il dévisage les passagers, fait déplacer les ballots de marchandises. Mais n'y trouvant que des gendarmes, Des Gascons, des abbés, des Carmes, Des femmes — où n'en voit-on pas ? il permet à la voile vagabonde de continuer sa route[43]. Le poète oublie un malheureux gapian que l'on dénicha à fond de cale, où il s'était tapi parmi des balles de peaux de moutons. Les contrebandiers voulaient lui casser la tête ; mais cette fois Mandrin s'y opposa ; car ce gapian se trouvait aussi innocent qu'un gapian pouvait bien l'être. Dans la suite, cet employé des Fermes, en des circonstances tragiques, rappellera ce trait au bandit, qui ne s'en souviendra plus et répondra : J'oublie aisément mes bienfaits[44]. Peu après, deux fermiers généraux, Chalut et Ferrand, qui rentraient de leur tournée en Provence et en Lyonnais, faillirent tomber eux aussi entre les mains de nos compagnons. Ils échappèrent parce qu'on les avertit que les Mandrins les guettaient pour faire de leurs précieuses personnes des otages destinés à être pendus ou roués vifs, le jour où l'un ou l'autre des contrebandiers serait encore conduit au supplice[45]. Jusqu'au fond de leurs palais, nos financiers étaient pris de peur. Ils quittaient leurs châteaux ou leurs maisons de plaisance, situés dans la campagne, pour venir se renfermer dans les villes de garnison. Terrier de Cléron cite l'un d'eux qui, se trouvant à Marseille, préféra se rendre à Paris, par la Méditerranée et par l'Océan, que de risquer de tomber entre des mains contrebandières en traversant la Provence, le Dauphiné ou la Bourgogne[46]. On imagine l'émotion que répandit dans Lyon l'aventure du coche d'eau[47]. Les officiers municipaux font à la hâte pratiquer des coupures sur la route de Mâcon. L'auteur de la Mandrinade, qui écrit à Lyon, fait une plaisante description de l'agitation générale : on met sur pied les quartiers qui viennent se ranger sur la contrescarpe, en une aimable bigarrure d'armes et d'équipements. Les tafetatiers Jurent et font le diable à quatre. Les clercs de la basoche ne sont plus à tenir. Il en est même qui s'aventurent, sur la route, hors de la ville : Mais déjà l'éclat des étoiles De la nuit annonce les voiles : Et, dans un splendide festin, On se prépare à voir Mandrin. Un verre de vin dans la panse, On a beaucoup plus de vaillance. Mais on enlève tous les plats, Et Mandrin ne s'avance pas[48]. La bande passe la Saône au pont de Saint-Romain. Du Nord au Sud, la terre s'étend, illimitée, presque nue : les collines ont perdu leurs bruyères ; ce sont des vignes, des vignes et des vignes, qui semblent avoir été à leur crête comme nivelées à coups de faux. Elles entourent les hameaux de Villefranche, de Fleurie, de Romanèche et de Villié-Morgon. Les Mandrins contournent les coteaux rocailleux où Chiroubles raye de la blancheur de ses maisons, dominées par un clocher carré, la masse des vignes qui s'empourpre en ces premières semaines d'automne. Par-dessus cette mer de pampres et d'échalas, les monts du Beaujolais allongent vers le couchant leurs grandes vagues immobiles. Laissant sur sa gauche la capitale du Beaujolais, Mandrin s'en alla prendre gite, le 7 octobre au soir, au petit village de Julie. Il eu repart à l'aube naissante. Peu à peu les vignobles ont disparu à l'Orient ; voici de nouveau les forêts, avec leurs ruisseaux, leurs ombrages et leurs rocs pointus. Les bruyères semblent de bronze en ce mois d'automne, les genêts n'ont plus de fleurs. Les Mandrins s'engagent sous de hautes châtaigneraies. Le 8, ils franchissent les crêtes qui séparent le Beaujolais du Forez[49]. Et ils se retrouvent en pays de montagnes, où les populations leur sont dévouées. Devant eux les sommets des monts s'arrondissent, semblables à d'énormes ballons atterrés, jusqu'aux plaines de la Loire, qu'on devine, sans les apercevoir encore, par delà les dernières hauteurs. Les contrebandiers se croient presque en sûreté, aussi Mandrin sectionne-t-il sa petite armée en plusieurs divisions. Il conserve la direction de la plus importante qui compte encore 150 hommes et marche sur Charlieu[50]. Il y entre le 9 octobre. A l'entrepôt des Fermes, il reçoit 4.500 livres pour lesquelles il donne un reçu et 914 livres de faux tabac. Puis il prend la route de Roanne[51]. Une avant-garde de vingt-quatre contrebandiers entre dans Roanne .sur les quatre heures du soir, et, après avoir rapidement parcouru la petite ville, vient se ranger militairement devant l'église. Le gros de la troupe arrive entre quatre et cinq heures du soir. Elle fait une entrée bruyante, fifres en tête[52]. Mandrin introduisit ainsi cent cinquante hommes dans la ville. Le reste de ses troupes, qui avait rejoint, demeura durant la journée dans les environs, réparti en quatre escouades : l'une au bas de la localité voisine de Perreux, une autre au bas de Vernay, une troisième au bois de Combray sur la route de Roanne à Saint-Haon, la quatrième au bois de Raffin. Chacun de ces postes comptait une cinquantaine d'hommes. Le lendemain, une arrière-garde de soixante hommes, passa encore sous les murs de la ville[53]. A ce moment Mandrin dispose donc de quatre cents hommes environ. A l'approche des Mandrins, tous ceux qui, de près ou de loin, touchaient à l'administration des Fermes et furent avertis à temps, coururent se cacher. On escaladait à cet effet, de tous côtés, les murs des maisons religieuses[54]. Pour aller plus vite, Mandrin divisa à Roanne sa troupe en trois bandes, dont l'une se rendit chez M. Hue, receveur des gabelles et lui demanda 21.000 livres, que M. Hue dit ne pas avoir en sa possession. Qu'à cela ne tienne, on vous emmènera en otage, vous et votre fils. Cela nous vaudra cinquante mille livres de rançon. Faites avancer deux chevaux. Ce qui modifia les idées de M. le receveur ; du moins demanda-t-il que ses caisses fussent ouvertes en présence d'un juge et d'un greffier. Rien de plus juste, dit Mandrin. Nous ne sommes pas des voleurs. Les caisses contenaient dix mille livres, que Mandrin fit descendre dans la salle basse, où il les répartit entre ses hommes. En échange, il laissa dix-huit gros ballots de tabac enveloppés de serpillière et deux autres ballots plus petits qu'il compta au même prix. Une autre bande procédait de même chez M. Forest, entreposeur des tabacs. L'entreposeur s'était enfui, laissant sa fille pour recevoir les bandits. Ceux-ci demandèrent à la demoiselle vingt mille livres : Mais, Messieurs, je n'ai rien. Mandrin n'était pas à la tête de cette deuxième bande et l'on s'en aperçoit à sa façon de procéder. Mlle Forest est promenée par la ville, comme l'avait été, à Bourg, Mme de la Roche ; mais, tout en marchant, les contrebandiers tenaient leurs fusils braqués sur la pauvre demoiselle, se disant prêts à tirer. On se rendit ainsi chez M. Lyvron, receveur des tailles. Celui-ci dit qu'il avait en mains 2.400 livres et qu'il était prêt à les donner pourvu qu'on lui remit en échange un reçu valable, ce que ne pouvait faire une fille mineure. Nos contrebandiers se rendirent à la justesse de cette observation, ils s'en retournèrent avec la jeune fille au logis paternel, où ils se mirent à enfoncer les armoires dans lesquelles ils finirent par trouver 1.295 livres, dont ils s'emparèrent. La somme ne leur suffisait pas. Il fallut que Mlle Forest se remit en route avec eux. Elle parvint à emprunter 1.206 livres à des amis de son père. En échange, les margandiers laissèrent un reçu signé Mandrin, et 400 livres de tabac. Cependant la troisième bande était occupée à rechercher M. de la Rochejaquelein, capitaine-général des Fermes, et M. Corson, receveur alternatif des tailles sorti d'exercice. Les Mandrins apprirent qu'ils étaient réfugiés chez les Minimes, d'où ces cieux fonctionnaires, prévenus en hâte, se sauvèrent par-dessus les murs du jardin après avoir revêtu un déguisement. Mandrin se rendit enfin à la prison. Il se fit présenter les registres d'écrou par la femme du geôlier, dame Antoinette, car le geôlier, Jean Chartier, était absent ; puis il exigea que les prisonniers fussent traduits devant lui l'un après l'autre, afin qu'il les pût interroger. Au vrai, en ces fonctions de juge, Mandrin inclinait à une indulgence excessive. Celle-ci fut du moins tempérée à Roanne par le sous-brigadier de la maréchaussée qui s'offrit pour y remplir auprès du bandit les fonctions d'assesseur. Le sous-brigadier remontra donc au contrebandier que la plupart de ces gens qu'il voulait rendre libres étaient des voleurs et des assassins. Et Mandrin de réfléchir : le brigadier avait raison. Dans le préau commun, les prisonniers rassemblés attendaient avec anxiété que le chef des margandiers eût prononcé sa sentence. Enfin cieux des compagnons de Mandrin apparurent et appelèrent à voix haute : Antoine Sauvageau, dit Lebon et Jacques Audonie. C'étaient les deux seuls que Mandrin, en fin de compte, jugeait dignes de sa clémence. Ils étaient détenus pour rébellion contre la maréchaussée de la Pacaudière. Audonie et Lebon se présentèrent et se jetèrent parmi les contrebandiers[55]. Joli tableau d'ancien régime : dans cette prison, pleine de sacripants confiés à la garde d'une femme, un contrebandier, chargé lui-même d'une condamnation capitale, siège, interroge et juge avec la gravité d'un magistrat. C'est le brigadier de la gendarmerie qui lui sert d'assesseur ; les prisonniers, réunis dans la cour, se soumettent à cette autorité nouvelle, et, finalement, le procureur du roi, dressant de ces faits un procès-verbal officiel, s'exprime ainsi : Comme ces sortes d'incursions attaquent plutôt l'intérêt des Fermes que le bien public, nos concitoyens, en gens raisonnables, — M. le procureur au parquet de Roanne écrit bien en gens raisonnables, — ont paru indifférents à leur arrivée. Du 5 octobre au 17 décembre 1754, Terrier de Cléron compte dix villes, Bourg, Homme, Thiers, Le Puy, Montbrison, Cluny, Pont-de-Vaux, Saint-Amour, Orgelet et Sourie, où Mandrin affranchit de cette façon les prisonniers pour contrebande, pour faux-saunage, pour désertion ou autres délits de ce genre. Le préjugé, disait le bandit, ne manquera pas de taxer tout ceci d'attentats. Il ne m'empêchera pas d'exercer, en faveur des innocents, les œuvres de justice et de miséricorde. Après quoi, il demandait les registres d'écrou. Il y écrivait lui-même et signait que Mandrin avait, tel jour, en tel ville, délivré les prisonniers[56]. A Roanne, Mandrin eut la satisfaction de se voir apprécié, non seulement par M. le procureur du roi, mais par le receveur des gabelles lui-même, M. Hue, qui s'entretint, avec lui très cordialement. Mandrin offrit de lui donner les noms de tous les gens de sa troupe, car, lui disait-il, nous agissons à visage découvert. Les compagnons quittèrent Roanne, le 9 octobre, à six heures du soir. Le lendemain, 10 octobre, arrivèrent, sous le commandement de M. de Coutan, les 120 dragons envoyés par l'intendant de Lyon pour la protection de la ville. M. de Coutan et ses dragons exprimèrent leur étonnement de ce que les contrebandiers fussent déjà partis. Ceux-ci se trouvaient réunis à Villemontais, sur la route de Roanne à Clermont. Selon Antoine Vernière, ils y auraient expédié un des leurs qui ne pouvait plus les suivre[57]. Il arrivait parfois aux contrebandiers d'en agir ainsi, à la demande même de ceux de leurs compagnons qu'ils étaient obligés de laisser derrière eux, afin d'éviter que ceux-ci fussent livrés aux horribles tortures et au supplice épouvantable qui leur étaient réservés. Passant à Saint-Just-en-Chevalet, Mandrin et ses hommes
s'arrêtèrent dans l'espoir d'y dénicher les gapians de la brigade de
Saint-Priest-la-Prugne qui y résidaient. Il recherchait
les employés comme un chasseur va à la quête du gibier, dit très bien
l'abbé Régley[58].
Lesdits gapians avaient pris la fuite. Enfin, on en trouva quelques-uns, un
sous-brigadier, Antoine Rolland, qui fut assommé, un garde qui fut grièvement
blessé. Dans le logis, qui fut pillé, les compagnons butinèrent armes et
effets[59]. Les Mandrins entrèrent dans Thiers, ce même jour, 10 octobre 1754, à cinq heures du soir[60]. De même qu'il Roanne, Mandrin s'y était fait précéder par une avant-garde de vingt compagnons. Quand ceux-ci arrivèrent, avec des chevaux de bâts portant les ballots couverts de toile et noués de grosses cordes, les habitants les prirent, tout d'abord, pour des employés des Fermes qui avaient fait une saisie de marchandise. Les contrebandiers entrèrent par la Porte-Neuve et allèrent droit à la maison de la veuve Mellore, entreposeuse de tabac. Sa plus jeune fille, Françoise-Joséphine Bardin, née d'un premier mariage, était seule au logis. Les Mandrins réclamaient une somme considérable. La jeune fille n'eut pas de peine à leur démontrer l'impossibilité où elle était de la leur donner. En venant dans une ville, Mandrin était toujours exactement renseigné sur la topographie du lieu et sur la qualité des principaux habitants. La scène déjà vue se renouvelle. Mlle Bardin est menée par quatre contrebandiers, armés jusqu'aux dents, chez un riche négociant de qui Mandrin a donné le nom et l'adresse, M. Barthélemy Riberolles. Celui-ci, qui avait soixante-quinze ans, avait fait barricader sa demeure, et se tenait sur la défensive, entouré de ses domestiques. Par la fenêtre, il parlementa avec la jeune fille. Il ne voulait à aucun prix laisser entrer chez lui des gens armés. M. Riberolles discourait encore que sa maison était déjà entourée d'une centaine de fusiliers qui avaient pénétré dans la cour par le jardin y attenant de M. Mignot, seigneur des Torrents et des Champs, subdélégué à Thiers. M. Riberolles, qui avait du courage, n'en persista pas moins à refuser de l'argent sur billet à Mlle Bardin. Un autre groupe de Mandrins s'étaient rendus chez le receveur du grenier à sel, M. de Manovelly. Ils lui réclamaient 20.000 livres. Le receveur ouvrit sa caisse qui contenait 300 écus. Riberolles, qui s'était décidé à descendre, discutait avec les contrebandiers dans son jardin, quand parut cette seconde bande avec le receveur du grenier à sel, également pour obtenir un prêt d'argent. Ils arrivèrent, eux aussi, par le jardin contigu et Riberolles prêta une de ses échelles, pour y faire grimper Manovelly, qui n'avait pas l'agilité de nos montagnards. Enfin le négociant, sur les instances du receveur du grenier à sel, qui se trouvait très niai à l'aise en face des fusils que les contrebandiers lui braquaient sous le nez et sur la poitrine, se décida à aller chercher trois sacs d'argent. On fit ainsi 5.000 livres, en échange desquelles les Mandrins laissèrent des ballots de tabac et leur chef un de ses fameux reçus. D'autres contrebandiers conduisaient les chevaux de bât à l'abreuvoir banal. Le subdélégué en compta quatre-vingts ; tandis que leurs camarades[61] entraient dans les maisons, espérant y dénicher quelques brigadiers des Fermes, mais ceux-ci étaient tous parvenus à s'échapper. Ils se réfugièrent à Puy-Guillaume, attendu, écrit leur capitaine général, M. Marlet[62], que les contrebandiers les cherchaient partout chez eux pour les tuer. La nuit survint. La petite ville fourmillait de Mandrins, qui se répandaient dans les rues, tirant des coups de fusil et de pistolets, s'amusant de la peur qu'ils répandaient autour d'eux. Ces salves se continuèrent jusqu'à l'aurore. Système ordinaire des contrebandiers, afin d'empêcher les gens de sortir et de se réunir pour organiser la résistance. Les habitants de Thiers reconnurent dans la bande quelques colporteurs dauphinois qui étaient précédemment venus dans la ville, ainsi que deux ou trois contrebandiers originaires de la localité. La veuve Mellore, l'entreposeuse, prévenue de l'embarras où se trouvait sa plus jeune fille, arriva le lendemain matin avec sa fille aînée. Il fallut que ces dames, à leur tour, se missent en quête d'argent. Elles parvinrent à emprunter 2.400 livres, en échange desquelles elles reçurent du faux tabac ; quant à M. Manovelly, il dut encore verser 1.000 livres, pour lesquelles encore, très consciencieusement, les Mandrins lui donnèrent du tabac. Les Mandrins quittèrent Thiers le 11 octobre, sur les deux heures de l'après-midi. A la sortie de la ville, ils firent une fausse marche dans la direction de Puy-Guillaume. Que s'ils avaient su y trouver toute une nichée de gapians, sans doute auraient-ils poussé jusque-là. Mais brusquement ils revinrent sur leurs pas et prirent la route d'Ambert. Ils gîtèrent la nuit dans plusieurs hameaux, à trois ou quatre lieues de Thiers, lieux dits et maisons isolées, au logis de Garbière[63], à la Croix-Neuve[64], à la Rodelière[65], aux Genestes[66] et à Chabrelau[67], dispersant leur troupe sur le territoire de plusieurs communes[68]. Le 12 octobre, sur les onze heures du matin, Mandrin entrait dans Ambert par la porte de Clermont, avec tous ses hommes à cheval, comme en parade militaire[69]. Il s'agit tout d'abord de se loger. Ils vont se mettre par groupes de six, dix, quinze, chez les divers aubergistes de la petite ville, chez Antoine Mayet, chez Jacques Sabatier, chez Claudine Gaillet, veuve de Jean Chesles jeune ; chez Vital Chaotard, cabaretier et lieutenant de la ville d'Ambert ; chez René Ribeyron, estaminier, et chez quelques autres. Ils demandaient pour eux à déjeuner, pour leurs chevaux, du foin et de l'avoine. Ils n'admettaient pas qu'il leur fût répondu : L'auberge est pleine. Au reste ils payaient exactement. Les consuls d'Ambert ayant voulu faire sonner le tocsin, conformément aux ordonnances royales, quelques contrebandiers s'emparèrent des serviteurs de l'église en leur conseillant de se tenir tranquilles, s'ils ne voulaient être pendus à la pointe du clocher ; et, en toute sécurité, commença la tournée habituelle chez les receveurs des Fermes et chez les entreposeurs. .Mme Michel Artaud, débitante, doit verser 1500 livres contre un reçu et des balles de tabac. Place Grenette, les Mandrins ont, pour une fois, la bonne fortune de trouver chez lui l'entreposeur, M. Lussigny. Ils lui prennent dans sa caisse pour mille écus d'or, à leurs conditions coutumières. Mandrin lui-même offrit à M. Lussigny de faire passer devant notaire procès-verbal du marché conclu. Après s'être muni de deux témoins, les sieurs J.-B. Ratier, peintre, et Henri Faure, négociant, on va trouver Me Herbuer-Laroche, qui dresse un acte en bonne et due forme. Mandrin y prend le titre de marchand et chef des contrebandiers[70]. Tous ces actes et les suivants, sont naturellement rédigés sur papier formulé — papier timbré, dirions-nous aujourd'hui. Comme M. Lussigny sortait, il fut entouré de quelques autres contrebandiers. L'un d'eux parlait haut, et se donnait également comme chef. Il appliqua à l'entreposeur le canon de son fusil sur la figure en réclamant encore 20.000 livres, sinon il le couperait en deux. Le pauvre entreposeur avait beau lui remontrer qu'il venait de compter mille écus à ses compagnons, le chef contrebandier répondait qu'il s'en moquait, — il employait même une expression plus énergique ; — si bien que M. Lussigny dut entrer chez M. Nicolon de Blanval pour lui emprunter 1 800 livres, puis chez Mayet et Cays, négociants associés, qui lui remirent un sac de 200 écus. Comme il revenait à son logis, avec ce sac — car les 1 800 livres de M. Nicolon de Blanval avaient été encaissées sur-le-champ par le chef contrebandier, — il y trouva une troisième bande qui forçait sa femme à prendre d'autres balles de tabac, après lui avoir fait acheter au prix de 56 écus, vingt-six mouchoirs de toile peinte. Ces faits furent constatés par de nouvelles quittances sur papier formulé, délivrées par M. Herbuer-Laroche, et contresignées par Mandrin. Ici se passe encore une des scènes qui caractérisent notre jeune contrebandier. Comme on était occupé à la rédaction de l'acte, Mme Lussigny se plaignit du prix élevé auquel était monté son lot de mouchoirs, 56 écus ! Au fait, dit Mandrin, c'est un prix de fermier général ! Voyant que la quittance portait 56 écus pour si peu de marchandises, il fit chercher le contrebandier qui était campé vis-à-vis de notre porte avec nos camarades et, après lui avoir donné une sérieuse réprimande, il lui fit rendre vingt-six écus, en disant que les mouchoirs en valaient bien trente[71]. Mme Lussigny, surprise et charmée, et sans trop s'arrêter au mauvais vouloir de son mari, offrit à l'honnête bandit un verre de vin vieux. Au commencement du siècle, on conservait encore dans la maison — relique précieuse — le gobelet d'argent où Mandrin avait bu[72]. D'autres bandes, de dix ou douze hommes chacune, prélevaient pendant ce temps, l'une 1.000 livres chez Marie Fayolle, cabaretière et débitante ; l'autre 1.000 livres chez Françoise Buisson ; une troisième, 2.000 livres chez la veuve Marie Croix, rue de la Gaye, vingt-et-un louis chez Rose-Marie Pailhon, débitante de tabac. Ces dames recevaient toutes, pour leur argent, des balles de tabac, au prix moyen de 5 francs la livre et des reçus signés Louis Mandrin, à l'exception toutefois de la veuve Croix, qui eut un reçu signé La Lancette. Vers midi, le maréchal ferrant avait dis ferrer à neuf pour nos compagnons un certain nombre de leurs chevaux, travail pour lequel il fut payé cinq livres sept sols. Enfin, les contrebandiers visitèrent, selon leur coutume, la prison de la ville, qui leur fut ouverte par Damienne Jouvain, la geôlière — ici encore le mari était absent. La prison était vide heureux pays — en sorte que les contrebandiers se retirèrent sans autrement se mal comporter. Quelques historiens ont exprimé leur surprise d'avoir vu entrer en scène, à Ambert, plusieurs chefs contrebandiers. On a noté plus haut que le titre de chef était régulièrement appliqué, parmi les margandiers, à tous ceux d'entre eux qui possédaient en propre des chevaux et avaient à leurs gages des valets. Chaque bande comptait donc un certain nombre de chefs. Ceux-ci obéissaient à un capitaine qu'ils avaient élu. Du jour où Mandrin fut parmi eux, il fixa toujours leur choix. C'est à cette époque aussi qu'il faut sans doute placer la scène que Terrier de Cléron a datée par erreur du 19 août : Mandrin y étala — à Ambert — sur la place les couleurs de ses brillantes indiennes, qu'il vendait la baïonnette au bout du canon. Les servantes n'en étaient pas plus effrayées que leurs maîtresses. Elles ne voyaient en lui qu'une charmante figure aussi appétissante que ses marchandises et ses façons. Son coup d'œil ne mettait en fuite que les employés. Il était cinq heures quand la bande quitta Ambert, prenant la route de Marsac. En s'en allant, les margandiers promettaient aux bonnes gens de revenir les voir avant un mois. Les contrebandiers, qui emportaient de la petite ville un beau butin, vu que, chez les seuls directeurs et entreposeurs des tabacs, ils avaient récolté 13.094 livres, furent coucher à Marsac, où ils levèrent encore une contribution de quatre cents écus[73]. Au départ de ses hôtes, M. Lussigny s'était empressé de fermer à barres et à verrous toutes les huisseries du logis. Bien lui en prit. A nuit close, vint y frapper le contrebandier La Faies, celui auquel Mandrin avait fait restituer de l'argent sur les mouchoirs. Il était revenu, bride abattue, mais trouvant les portes barrées, il s'en retourna tout en jurant[74]. Dans l'église d'Arlanc, capitale de la baronnie de ce nom, se célébrait la grand'messe, le dimanche 13 octobre, quand les Mandrins y arrivèrent comme des lions enragés. On a la déposition des notables[75], où se traduit en termes pittoresques l'effet que produisit cette bande farouche dans la petite ville. Les Mandrins étaient au nombre de cent quinze. Ils avaient la figure la plus affreuse. Ils conduisaient soixante chevaux, dont chacun était chargé de deux ballots en sautoir, enveloppés de serpillières de toile et noués de grosses cordes. Le service divin en fut interrompu. C'étaient des brigands, hérissés d'armes à feu. Chacun d'eux avait une gibecière en bandoulière. Ils commencèrent par s'emparer de la place de la Halle pour y faire manger les chevaux, ainsi que de toutes les avesnes de la ville. Ils occupèrent tous les cabarets, où il fallut les servir à leur fantaisie. Ils sacraient et tempêtaient ; ils déclaraient qu'ils étaient vernis avec la résolution de massacrer, ceux qui ne leur obéiraient pas. Les scènes connues se répètent : descentes chez les buralistes et les entreposeurs, obligation d'acheter du tabac de contrebande, promenade des malheureux débitants par la ville de maison en maison, sous bonne escorte, afin de leur faire emprunter les sommes exigées. Quand les nommés Mayet, Coppat et Douvreleur, marchands de tabac, représentèrent que leur débit était très médiocre, qu'ils n'avaient point chacun trois louis à leur disposition, ce furent des jurements : on allait leur brûler la cervelle et incendier leurs maisons. Les contrebandiers enfoncèrent les portes de leurs armoires, mirent sens dessus dessous leurs garde-robes, fouillèrent jusque dans leurs poches. Ils tirèrent dans l'intérieur de leurs demeures des coups de fusils dont vitres et meubles furent brisés. Chez Douvreleur, ils répandirent six livres de poudre sur la paillasse du lit, faisant le geste d'en approcher une mèche allumée ; chez Mayet, ils portèrent du chanvre et de la braise, avertissant d'ailleurs les habitants d'Adam : que s'ils s'avisaient de soutenir leurs débitants de tabac ou de sonner le tocsin, ils mettraient le feu à la ville. Puis, de maison en maison, la promenade des malheureux entreposeurs recommença. Les contrebandiers les bourraient de la crosse de leurs fusils, leur disant : Marchez, J... F..., pour nous fournir d'argent. Allons partout où il s'en trouvera ; car s'il en fallait pour nous faire pendre, vous en trouveriez d'abord[76]. Enfin, en les traînant et en les maltraitant comme des criminels, ils firent ramasser aux sieurs Mayet père et fils 760 livres, à Douvreleur 1.000 livres et 1.500 livres aux deux Couppat. Dans les boutiques, ils prirent les marchandises qui leur convenaient, à prix de contrebandier. Les débitants recevaient des ballots de tabac et des reçus signés cette fois Monsieur Mandrin ; car le jeune capitaine les fit écrire par l'un de ses hommes. Ils ne sont pas de son écriture. Les Mandrins quittèrent Arlanc à six heures du soir, pour atteindre le même jour encore la Chaise-Dieu, où, dès leur arrivée, leur chef établit un poste au pied du clocher de l'église afin d'empêcher qu'on n'y sonnât le tocsin. Les buralistes s'étaient enfuis. Richard père, assisté du sieur Pissis, médecin, sortit sa femme, qui était dans le lit, malade, par une porte de derrière ; il courut lui-même s'enfouir au fond d'une grange, sous un tas de paille. Les portes des divers débits de tabac furent enfoncées à coups de crosses. Étaient restés au logis, soit le fils, soit la fille, ou les servantes. Les contrebandiers entendaient leur faire prendre de leurs marchandises pour 10.000, 15.000, 20.000 livres. Ils menaçaient de mettre le feu aux maisons. A cet effet ils portaient des mèches enfoncées dans les canons de leurs carabines et disposaient des tisons sur les planchers. Le Père Malevergne, cellérier de l'abbaye, et l'abbé Belladier, régisseur des revenus du cardinal de Rohan, abbé de la Chaise-Dieu, prêtèrent de l'argent aux buralistes. Mandrin était descendu à l'enseigne du Saint-Esprit, où se vinrent faire les transactions et où il délivra quelques-unes de ses célèbres quittances. Il reçut de Richard père et fils une somme de 2.000 livres, pour laquelle il fit jeter dans leur boutique quatre ballots de tabac pesant 340 livres. Les contrebandiers régnèrent ainsi en maître à la Chaise-Dieu, depuis leur arrivée, le 13 octobre sur les neuf heures du soir, jusqu'au lendemain deux heures après midi qu'ils partirent. Ils avaient mis des postes dans les divers quartiers, ne laissant passer et circuler dans la ville que ceux qui leur plaisaient[77]. En quittant la Chaise-Dieu, les Mandrins prirent la route du Velay. On voit ici encore la rapidité de leurs mouvements. Depuis Thiers jusqu'à la Chaise-Dieu, ils avaient couvert, en quarante-huit heures, une distance de cent kilomètres, en dépit des stations qu'ils avaient faites à Ambert et à Arlanc[78]. Un de leurs biographes écrira : Hé ! qui me fournira des jambes Pour suivre ces chasseurs ingambes ? Qu'ils vont vite et qu'ils tirent droit ![79] Une partie des troupes qui avaient pénétré en France sous Fa direction de Mandrin, le 4 octobre, s'était détachée du corps principal, pour marcher sur Saint-Étienne, où elle avait trouvé le meilleur accueil. Au point que les compagnons s'y étaient instillés. A Saint-Étienne, durant le jour, nos contrebandiers vendaient publiquement leur tabac, leurs flanelles et leurs indiennes ; ou bien ils se promenaient sur ta place, dans les rues, avec leurs fusils doubles, leurs sabres et leurs pistolets ; la nuit ils allaient par pelotons, chantant et jouant du tambour de basque[80]. Saint-Étienne devenait la Capoue des contrebandiers. Loin d'imiter l'activité inlassable de leurs camarades, ils s'y oubliaient dans les plaisirs. Pour renforcer leur attirail de guerre, ils marchandèrent à la manufacture d'armes deux pétards, dont ils se fabrique journellement à Saint-Étienne pour l'armement des vaisseaux. Mais on ne s'entendit pas sur le prix. Il arriva que des cavaliers de la maréchaussée du Puy voulurent emmener de Saint-Étienne à Lyon quatre déserteurs. Les Mandrins les forcèrent à lâcher leurs prisonniers. La population, prenant une fois de plus le parti des contrebandiers, poursuivit la maréchaussée à coups de pierres. Les Mandrins sont maîtres de la ville, écrit l'intendant de Lyon[81], et les ouvriers leur paraissent dévoués. L'administration finit par s'émouvoir[82]. Dans la nuit du 4 au 5 novembre, cent huit dragons arrivèrent secrètement, sur les minuit ; car c'étaient à présent les gendarmes qui arrivaient en se couvrant des ténèbres et à pas de loups, comme des voleurs. Six des contrebandiers furent saisis dans leur lit, au logis Saint-Denis. L'un d'eux, ayant fait mine de saisir son pistolet, fut tué par un officier[83]. Parmi eux, leur chef, La Mouche. Il était de ceux qui donnaient des quittances signées du nom de Mandrin. On les conduisit dans la prison seigneuriale, au cachot du Lion d'Or[84]. Mandrin, de son côté, avait été attaqué sur la route de la Chaise-Dieu au Puy, entre Fis et Saint-Geneix, par un détachement des hussards de Lenoncourt. Mais il n'était pas, lui, dans son lit. Les hussards de Lenoncourt furent mis en déroute[85] et les Mandrins entrèrent en bon ordre dans la pittoresque capitale du Velay. Ils s'y présentèrent le 16 octobre, sur les midi, devant la porte des Farges[86]. La ville n'occupait pas au XVIIIe siècle la même étendue qu'aujourd'hui. Elle laissait, en dehors de son enceinte moyenâgeuse, le rocher Corneille et la fameuse pointe d'Aiguihle avec sa vieille chapelle sous le vocable de Saint-Michel[87]. Les Mandrins longèrent les vieux murs de l'enceinte, à créneaux et ù mâchicoulis, avec leurs tours d'angle, lourdes, ventrues, coiffées de toitures en champignons pointus ; ils avaient à leur droite la pointe d'Aiguille, et arrivèrent à la porte Pannessac. Sous la voûte en arc brisé, ils engagèrent la longue file de leurs chevaux. Ils suivirent la rue Pannessac jusqu'à la rue du Consulat, où se trouvait l'entrepôt des tabacs tenu par M. Dupin. Les Mandrins étaient coiffés de leurs chapeaux à larges bords, ils avaient le corps enveloppé de grandes houppelandes[88] qui laissaient passer le canon luisant des fusils ; leurs valets faisaient avancer à coups de bourrades les chevaux chargés de bennes et de ballots. Ils avaient fait annoncer qu'ils ne feraient aucun mal aux habitants paisibles, mais que, sur leur parcours, on se gardât de mettre la tête derrière les volets entrebâillés, qu'ils prendraient cette posture pour un danger ou une menace... Cependant, derrière les vitres, beaucoup de personnes regardaient le défilé[89]. Le capitaine général des Fermes, M. Le Juge, prévoyant l'arrivée des contrebandiers, avait fait garnir d'hommes et de munitions la maison de l'entreposeur ; il y avait installé tout un arsenal, fusils et munitions ; il y avait fait monter des tas de grosses pierres aux étages supérieurs, pour en accabler les assaillants ; les grilles des fenêtres et les barres des portes en avaient été visitées et renforcées ; vingt commis y couchaient et y montaient la garde nuit et jour. Durant que la majeure partie des contrebandiers se répandaient dans la ville en quête de logis, vingt ou trente d'entre eux gravissaient l'étroite ruelle montante où se trouvait la maison du sieur Faure, marchand, dans laquelle était logé l'entrepôt de M. Dupin. Au moment où Mandrin et ses hommes arrivèrent en face de la maison, dont les portes aux fortes serrures et les sourds volets de bois étaient fermés, une fusillade, qui s'échappa d'ouvertures habilement ménagées, tua l'un d'entre eux, et en blessa plusieurs autres, notamment Michel le Blondin, âgé de dix-huit ans, originaire du Pont-de-Beauvoisine. Il mourut le lendemain sur la paroisse Saint-Pierre le Monastier dans la ville. L'un des coups de feu, qui furent tirés dans ce moment, cassa le bras gauche à Mandrin lui-même. La rue du Consulat est une ruelle traversière, large de quatre mètres à peine, qui grimpe au flanc du coteau où est construite la vieille ville. Les maisons, hautes de deux étages, se sont comme enflées dans la partie supérieure, en sorte qu'en s'élevant elles vont chacune se rapprochant de celle qui est en face ; elles ont des toits en appentis protégeant les murs contre la pluie ; et la mince bande de ciel clair, qui court au-dessus de la rue, en est plus étroite encore. Jamais de ses rayons le soleil n'en vient blanchir les pavés. Jusqu'à nos jours, la rue a conservé l'aspect du temps ancien, avec ses portes larges et basses, l'archivolte en plein cintre garnie de ferrures Louis XV. Les fenêtres, à croisillons blancs, sont fermées par des volets pleins, en bois naturel, rabattus le jour contre le mur. Vers le milieu de la rue, une fontaine, formée d'un pilastre de vieille pierre, où se détache en haut relief une figure de dauphin, entourée de réseaux à quenouille, surmontée d'un trident : la margelle s'arrondit demi-circulaire. Sur de plates barres de fer, qui y sont fixées, les femmes placent leurs seaux pour recueillir le jet de la fontaine ; les chevaux viennent boire à l'eau du bassin. On imagine à quel point l'étroitesse de la rue favorisait la résistance organisée dans la maison de l'entreposeur. Les contrebandiers font face à l'ennemi. Le gros de la bande, qui était dispersé en ville, est accouru au bruit de la fusillade ; mais c'est en vain que les compagnons déchargent leurs armes. Les balles s'aplatissent aux murs et à peine parviennent-elles à percer les contrevents de bois plein. On s'était procuré un lourd marteau de maréchal-ferrant avec lequel, à grands coups, on cherchait d'enfoncer la porte, sous la direction de Mandrin ; vainement. C'est alors que l'un des lieutenants de celui-ci, nommé Binbarade, eut l'idée de grimper sur la toiture d'une maison voisine, suivi d'une quinzaine d'hommes, d'où il s'efforça, en démolissant une muraille de peu de résistance, de pénétrer dans l'entrepôt[90]. La fusillade continuait entre gapians et contrebandiers, crépitant du côté de la rue, et se répétant à présent en un écho bruyant au haut du toit. Sur les Mandrins, qui se pressaient au pied de l'édifice, les employés faisaient pleuvoir une grêle de grosses pierres. Le faite des maisons voisines était garni de contrebandiers : on les voyait debout ou accroupis dans les gouttières. Leurs chapeaux à larges bords se découpaient en noir sur la clarté du ciel. C'est dans ce moment que Binbarade fut blessé d'un coup de feu à la bouche, dont il eut une partie des dents fracassées[91]. Un autre contrebandier, Bernard, dit la Tendresse ou le Grand Grenadier, eut également, tandis qu'il était sur le toit, la main gauche déchirée d'un coup de fusil tiré par les employés[92]. Ce Binbarade était un déserteur du régiment de Bourgogne-Infanterie, âgé de vingt-huit ans. Il portait en queue ses cheveux noirs bien frisés, il avait le visage plat, la barbe noire, très fournie. Il était de Mézillac en Vivarrais. De là, ses compagnons l'appelaient Binbarade, en lui donnant le nom d'un fameux bandit de ce pays. Bernard, dit la Tendresse ou le Grand Grenadier, était un déserteur du régiment de Champagne. La résistance des employés, pris entre cieux feux, ne tarda pas à faiblir. Une blessure reçue par leur chef, le capitaine général, fut le signal de la débandade. Douze gapians lâchèrent pied ; peu après M. Le Juge, avec les six employés qui étaient demeurés auprès de lui, s'échappa de toit en toit, par les immeubles voisins. Quelques-uns des employés avaient été blessés. A peine Mine Dupin, la femme de l'entreposeur, parvint-elle à échapper en se sauvant de maison en maison. On imagine la fureur des margandiers. Ils ne parlaient de rien moins que de promener les têtes du capitaine général des Fermes, de l'entreposeur et de sa femme, au bout de piques, dans les rues de la cité. La maison fut saccagée, du grenier à la cave. Dans la cave les compagnons trouvèrent du bon vin de Tavelle ; douze bouteilles de ratafia, quatre bouteilles de vin d'Alicante, dix bouteilles de vin de Xérès, vingt-cinq bouteilles de vin muscat, cinquante bouteilles de vin de Bourgogne, et quatre bouteilles d'eau de la Côte, la fameuse liqueur de la Côte-Saint-André, du pays de Mandrin, et pour laquelle celui-ci avait une prédilection particulière. Dans le cellier, du lard et des jambons et des saucisses. Le tout fut bu, mangé ou emporté. Quant au mobilier, dans le premier moment d'exaspération, on pensa à le mettre en pièces. Il parut plus pratique de le mettre à l'encan. Devant une table, dans la rue, l'un des Mandrins s'est improvisé commissaire-priseur. La foule des acheteurs a été attirée au roulement de tambour. La gendarmerie même est arrivée pour veiller par sa présence à la bonne tenue de la vente. Au reste, durant tout le cours de cette épopée, la maréchaussée ne cessa de se montrer, vis-à-vis de nos contrebandiers, d'une correction et d'une bonne grâce parfaites. Et se dispersent au vent des enchères : le grand lit de Damas à la duchesse et le beau lit à la turque en satin bleu avec ses couvertures de laine de Ségovie et ses courtes-pointes en dentelle du Puy ; et le lit à niche de drap écarlate, et le lit à tombeau de cadis vert ; beaucoup d'autres lits encore, qui sont vendus au plus offrant ; s'en vont à la criée : la belle tapisserie en point de Hongrie et les tapisseries Bergame, les tableaux et les miroirs, les bahuts, les crédences, les chiffonniers et les guéridons ; tous les livres de la bibliothèque. Mme Dupin avait une garde-robe admirablement montée. C'est une infinie quantité de chemises avec ou sans dentelles, une multitude de corsets, de tabliers, de camisoles et de mouchoirs ; des cornettes de nuit, des bonnets piqués, des bonnets à dentelles, d'autres bonnets garnis de mousseline, des manchettes brodées, des manchettes rayées, des manchettes festonnées, des manchettes unies, des manchettes à dentelles ; et quelle quantité de coiffures ! treize coiffures de mignonnettes, onze coiffures à dentelles, trois palatines de dentelles, des coiffes de mousseline, des coiffes de gaze, des coiffes de taffetas noir. Il y eut des contrebandiers qui, trouvant ces coiffes à leur goût, s'en parèrent en manière de cocarde qu'ils fixèrent à leur chapeau, gracieux trophée de leur victoire. Et toutes les robes de Madame : robes de cretonne brochée, robes de persienne, robes de cotonnade, robes de gros de Tours, robes de taffetas, robes de soie ou de satin, robes de gros de Naples ; une capote de camelot garnie de taffetas ; les jupes et les jupons : jupons de mousseline ornés de falbalas, jupons de beau bazin uni, jupons de cotonne, jupons de bourre de soie façon de Nîmes, jupons de peluche, jupons de flanelle ; les manteaux de lit de damas, les manteaux de lit de satin blanc, les manteaux de lit de taffetas garnis de blondes, c'est-à-dire de dentelles ; et les souliers à boucles d'argent, à boucles de brillants, les souliers glacés, les souliers de damas blanc, les souliers de carton, les souliers d'étoffe de soie ; une boite de toilette remplie de fleurs d'Italie, rubans, pompons, bracelets, colliers et autres ajustements de femme ; et les habits de Monsieur ; puis, la garde-robe de Mlle Dupin, et celle de MM. Dupin fils. M. le capitaine-général des Fermes, qui avait organisé à l'entrepôt la résistance des employés, fournit à cette vente sa belle épée à poignée d'argent, avec le ceinturon, sa redingote de drap bleu foncé, une chemise estimée à dix livres et un bonnet de nuit estimé quarante sols. Le linge et la batterie de cuisine, les meubles et les menus bibelots, tout y passa[93]. On croit voir la scène dans la ruelle étroite : les chevaux qui hennissent, les ballots empilés contre les murs, l'agitation affairée des contrebandiers, aux larges chapeaux de feutre noir, vendant à la criée les meubles et les hardes de M. l'entreposeur des Fermes, aux gens du pays, en sarraux bleus et chapeaux ronds, les femmes en bonnets blancs noués de rubans de couleur, en grosses jupes à plis droits ; tous se pressent autour des vendeurs ; — et les gendarmes, impassibles, veillant à ce que tout se passe régulièrement. Dans les greniers on trouva un important dépôt de blé. Mandrin voulait l'enlever, quand on lui fit observer qu'il n'appartenait pas à l'entreposeur, mais à un bourgeois de la ville qui l'y avait mis en dépôt. Le bonhomme était là, suppliant qu'on lui laissât son bien. Mandrin y consentit ; mais il lui fit payer une amende de six cents livres, pour lui apprendre à se commettre avec les suppôts des Fermes générales. Tout ce qui ne fut pas vendu fut brisé, détruit, mis en lambeaux. Le juge des Fermes au département du Velay, qui visite l'immeuble le 19 octobre, y trouve tout en pièces, les armoires enfoncées, les portes brisées, les serrures fracassées, les faïences précieuses en mille morceaux sur le parquet. Il ne reste d'intact que quatre tonneaux dans la cave, encore deux d'entre eux sont-ils vides, les deux autres à moitié pleins, une partie du vin en ayant été répandu sur le sol. Enfin, pour combler leur vengeance, les Mandrins voulurent incendier la maison, et déjà ils avaient fait démeubler un logis y attenant, qui courait le risque de brûler également ; déjà, et à quatre reprises, ils avaient allumé la chandelle, mais chaque fois ils avaient renoncé à leur dessein sur les prières d'une religieuse, une sœur de Saint-Charles[94], qui les suppliait, à mains jointes, de ne pas créer de nouveaux malheurs. Il y avait chez ces hommes, jusque dans leurs plus violents excès, un fond de bonté réelle et que l'on pourra comparer avec celle de leurs adversaires. Les Mandrins couronnèrent leur journée en se rendant, comme de coutume, aux prisons, afin d'en faire sortir les détenus pour désertion ou pour contrebande. Ils espéraient y trouver un des leurs, nominé Rochette, qui y avait été enfermé trois semaines auparavant ; mais on avait brûlé à nos compagnons la politesse en transférant le prisonnier en lieu sûr et qui ne put être découvert. Les contrebandiers sortirent du Puy durant la nuit du 16 octobre, pour arriver le lendemain à Pradelles, où ils réclamèrent 10.000 livres à l'entreposeur, mais se contentèrent de 2.000 livres, pour lesquelles ils laissèrent quatre balles de tabac[95]. A Langogne, le 18, ils en obtinrent 7 060. Nos compagnons y arrivèrent au nombre de 140. Ils ont profité, pour se jeter sur les quartiers, du temps du changement des troupes, écrit M. de Saint-Priest, intendant du Languedoc. Puis, par les plateaux élevés et incultes que domine le mont Mézenc, ils atteignirent Tence en Vivarais, dans la soirée du 19. De l'entreposeur de Tence, les Mandrins eurent 2.000 livres, en échange de quatre ballots de tabac. Le lundi 21, à quatre heures du soir, ils entrent à Saint-Didier-en-Velay, aujourd'hui Saint-Didier-la-Séauve. Ils y passèrent la soirée à rendre visite à M. Mollin, entreposeur des tabacs et à quelques revendeurs de sel, desquels ils tirèrent 2.400 livres à leurs conditions ordinaires ; et, durant la nuit, ils pillèrent les maisons des employés des Fermes qui s'étaient enfuis, à l'exception d'une seule, car le gapian qui l'habitait était également aubergiste et leur avait fourni du vin. Jamais bon procédé ne trouva Mandrin paresseux à en rendre témoignage. Les Mandrins quittèrent Saint-Didier le 22 octobre, dans la matinée, après avoir soldé leurs dépenses dans les auberges[96]. Ils pénétrèrent dans le Forez et firent ce même jour, après une course de six lieues, leur entrée à Saint-Bonnet-le-Château, sur les trois heures de l'après-midi. Descente chez les divers hôteliers qui doivent fournir du fourrage aux chevaux ; visite à M. Gaudin, entreposeur des tabacs et en même temps receveur du grenier à sel, à qui l'on réclame 10.000 livres, pour une quantité d'excellent tabac qu'on va lui fournir ; mais Gaudin n'a que 1.816 livres chez lui. Il offre tout ce qu'il a en or, argent, monnaie ou vieilles espèces. Il est bourré de coups de crosse ; on lui met des canons de fusil à bout touchant ; finalement on le promène à son tour, par la ville, deux heures-durant, pour lui faire emprunter chez ses amis et connaissances, ici 43 louis, ailleurs 456 livres ; de M. Rony, changeur, il obtint 264 livres, de l'abbé Grimaud, 60 livres. Ils n'ont enfin abandonné ledit Gaudin, que lorsqu'ils l'ont vu excédé de lassitude, pour avoir été conduit dans tous les endroits et à toutes les maisons de la ville pendant plus de deux heures et à trois reprises différentes, et qu'il n'y avait pas à espérer qu'il pût trouver quelque autre argent[97]. Chez la veuve Antoine Tarchier, débitante de tabac, par les mêmes procédés, la bouche du fusil à la face, les contrebandiers obtiennent 300 livres contre un reçu et une benne de tabac prohibé. Puis la visite obligatoire aux maisons habitées par des gapians. Mais ceux-ci s'étaient mis en campagne. Ils étaient en tournée pour l'intérêt des Fermes. La femme de Jean Chalus, brigadier, a fait barricader sa porte. Les Mandrins grimpent par la fenêtre, dont ils enfoncent le châssis vitré. Ils vident les armoires, pillent la garde-robe, jettent dans la rue les paquets de linge, les habits, les draps, la batterie de cuisine, détruisent les livres de compte. La serrure d'un coffre, qu'ils trouvent fermé, est fracassée d'un coup de feu ; ils emportent treize louis d'or et une paire de pistolets. Ils emportent même un coupon d'étoffe qui avait été baillé à la dame Chalus pour son travail de couturière. Le lendemain la pauvre femme ne possédait plus que cieux matelas et deux habits de son mari sauvés par une voisine. Même scène chez la femme d'André Gaignaire, employé. Les Mandrins prennent tout, complets de drap, culottes, chemises, bonnets de nuit, pistolets, couteaux de chasse ; et ils se retirent en jurant et menaçant que son mari ne restera pas huit jours en vie, s'il ne se démet immédiatement de son maudit emploi. Les contrebandiers quittèrent Saint-Bonnet-le-Château entre huit et neuf heures du soir ; ils passèrent la nuit à Moingt et entrèrent dans Montbrison le 23 octobre, à onze heures du matin. Ils étaient encore 150 compagnons. Mandrin allait trouver à Montbrison un receveur des Fermes, M. Baillard du Pinet, qui devait enfin être homme à l'attendre et à lui tenir tête. M. du Pinet sut comprendre Mandrin et lui parler, aussi lui devons-nous l'une des pages qui nous font le mieux pénétrer dans l'esprit du célèbre contrebandier. Les Mandrins mirent donc pied à terre devant la maison de M. Pierre Baillard du Pinet, receveur du grenier à sel. Celui-ci, prévenu, s'était renfermé chez lui. Connue les contrebandiers se mettaient à heurter violemment à la porte et à menacer de tout briser, du Pinet leur dit de la fenêtre qu'il leur ouvrirait, s'ils lui promettaient de ne pas le tuer et de n'entrer qu'en petit nombre. Mandrin s'avança et lui répondit que, sur les deux points, il pouvait être rassuré[98]. La porte s'ouvrit et Mandrin entra, lui dixième. Il demandait au receveur 20.000 livres eu échange du tabac qu'il allait lui livrer. Le receveur accueillit le bandit avec fermeté, mais avec politesse. Il l'introduisit avec ses compagnons dans son salon, où il les présenta à sa femme, à sa sueur et à sa mère, nullement effrayées, et qui ne tardèrent pas à se mêler à une conversation commune. Celle-ci glissait d'un sujet à l'autre. Mandrin, qui avait le bras en écharpe, racontait comment il avait été blessé au Puy. Il souffrait beaucoup et demanda incidemment s'il ne serait pas possible de faire venir un chirurgien pour le panser. M. du Pinet se lova et donna ordre à un domestique d'aller quérir un chirurgien. Dans ce moment, Mandrin était très las. Il était affaibli par le sang qui coulait de sa blessure. Mme du Pinet lui offrit de lui faire préparer un bouillon. Il accepta, et gracieusement la dame se rendit à la cuisine pour y recommander à la cuisinière de préparer ce bouillon avec soin. L'auteur de la Mandrinade assista à la scène et la rapporte en ses vers burlesques, dans le style mis à la mode par Scarron : Une dame, en fin cotillon, Court aussitôt à sa cuisine, Ordonner à sa Catherine D'en mettre vite un sur le feu[99]... Notre poète — appelons-le poète, puisqu'il écrit en vers — est frappé par le ton d'autorité de Mandrin, par son allure hautaine. Il ne daigne pas dire merci à l'accorte soubrette qui lui sert son potage. De bon cœur dans ma peau j'enrage De voir, dans la fleur de son âge, Ce beau tendron au cuir poli Servir, sur un drap bien blanchi, Ce bouillon à ce méchant traître, Qui, le prenant d'un ton de maitre, Ne lui dit pas : Bien obligé[100]. Cependant le domestique, envoyé à la recherche d'un chirurgien, revenait tout penaud. Il ne s'en trouvait pas dans tout Montbrison qui consentît à venir soigner Mandrin. Alors Mme du Pinet, qui décidément avait pris le brigand en sympathie, offrit de sortir elle-même pour aller quérir un praticien. L'un des contrebandiers, qui répondait au nom de Chevalier, voulut l'accompagner, avec ses armes. A la vue de mes armes, disait-il, le chirurgien se décidera ; et il sortit avec Mme du Pinet. Ce Chevalier n'était autre que le frère de Mandrin, Claude, qui avait alors vingt-trois ans. Chevalier était son nom parmi les contrebandiers[101]. A Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Claude avait exercé le métier de peigneur de chanvre. Il était de taille moyenne, plutôt petit. Il avait avec son frère aîné un air de ressemblance, un air de famille, des cheveux châtain clair tirant sur le blond, des yeux gris. Sa barbe était de la même couleur que ses cheveux. Il avait une jolie figure[102]. Tandis qu'on était à la recherche du chirurgien, Mandrin, sensible à la sympathie qui venait à lui, se laissait aller à confier le fond de ses pensées à M. du Pinet. C'est un homme grand, froid dans la conversation, écrira le receveur du grenier à sel. Il convient qu'il fait un mauvais métier. Mandrin s'excusait de l'avoir entrepris à force ouverte, sur les pertes que les Fermiers lui avaient fait subir dans son entreprise de Montpellier — l'affaire des mules. Comme M. du Pinet lui représentait que sa blessure avait besoin de repos, il répondait qu'il ne pouvait en prendre en France, mais qu'il serait bientôt en pays étranger et que là, il se reposerait. Les deux autres chefs parurent à M. du Pinet des jeunes gens qui étaient sans grande qualité pour leur métier. On a vu que l'un d'eux était Claude Mandrin, et le second François-Saint-Pierre, dit le Major, de qui il a déjà été question. Les autres contrebandiers, qui étaient entrés et qui s'intéressaient peu à ces considérations d'un ordre général, revenaient toujours à demander 20.000 francs au receveur. Celui-ci pria alors Mandrin d'entrer seul avec lui dans son bureau. Il lui montra ses livres, lui justifia que sa recette ne s'élevait mensuellement qu'à 7.000 livres, qu'il payait dès que le mois était expiré. Dans le moment, il n'avait que 5.002 francs en caisse. Mandrin, qui entendait raison, lui dit alors qu'il le tiendrait quitte pour 6.000 livres, mais en le suppliant de lui garder le secret de cette concession, à cause de sa troupe, dont il ne faisait pas ce qu'il voulait. Comme il manquait 1.000 livres à M. du Pinet pour parfaire la somme, Mandrin lui dit qu'il les lui ferait prêter par le receveur des tailles, et il désigna quatre de ses compagnons qui accompagnèrent M. du Pinet chez M. Lecomte, le receveur. Le chirurgien étant enfin arrivé avec Mme du Pinet, Mandrin fut pansé. Quand les quatre contrebandiers, qui, sur l'ordre de Mandrin, avaient accompagné M. du Pinet, virent que celui-ci ne rapportait que mille livres, ils voulurent le forcer à rebrousser chemin. Mais le receveur leur dit que c'était le chiffre fixé par leur chef et ils se calmèrent. L'argent sur la table, Mandrin voulut qu'on dressât de la transaction un procès-verbal régulier. On eut peine à trouver des officiers de justice, aucun notaire ne voulant se mêler de cette aventure ; enfin, le procureur du roi répondit à l'appel et rédigea un procès-verbal en présence de deux conseillers au présidial. Comme Mandrin avait fait déposer dans la cour de l'hôtel des marchandises pour une valeur de 20.000 livres, il fallut remettre le surplus — vu qu'il n'emportait que 6.000 francs — sur le dos des chevaux. Il laissa douze balles de tabac et fit recharger le reste, qui consistait en flanelles et en indiennes, au grand murmure et mécontentement de sa troupe. En se retirant, Saint-Pierre et Chevalier querellèrent leur chef de ce qu'il s'était contenté de si peu d'argent ; Mandrin répliqua qu'il savait ce qu'il faisait et qu'ils devaient se taire. Durant ces opérations, une poignée de contrebandiers s'étaient rendus à la prison dont ils avaient enfoncé les portes à coups de hache. Ils en tirèrent dix-neuf détenus qui s'agrégèrent à la bande. Il est remarquable que le concierge de la prison, Simon Rajat, quand il fut interrogé sur l'invasion des bandits, déclara avoir entendu dire la veille à l'un des prisonniers, Louis Charlin, qui s'adressait à ses camarades : Réjouissons-nous, Mandrin est à Chazelles. Il doit venir ce soir à Montbrison. Audemain, sur les dix heures, il viendra nous délivrer[103]. Avec les prisonniers qu'il s'était adjoints, Mandrin devait avoir, au sortir de Montbrison, près de 200 hommes sous ses ordres ; une partie d'entre eux prirent une destination qui nous est inconnue. Une centaine d'hommes entrèrent ce même jour, mercredi 23 octobre, avec Mandrin, à Boën-sur-Lignon, vers les sept heures du soir. Ils se transportèrent chez les différents débitants de tabac, et leur réclamèrent une somme totale de 2000 livres pour lesquelles ils leur offraient du tabac et des étoffes. C'étaient tous de pauvres petits marchands sans ressources. A dix heures du soir, à l'auberge de la Croix-Blanche, où Mandrin était descendu, les débitants de tabac arrivèrent tous ensemble. A la demande de Mandrin, ils s'étaient fait accompagner du capitaine-châtelain et des divers officiers de la ville et prévôté de Boën. Le curé du lieu et les recteurs de l'hôpital leur avaient prêté les deux mille livres demandées. Ils reçurent en retour quatre ballots couverts en serpillière, dont deux ballots de tabac et deux d'indiennes. Un procès-verbal fut dressé par le commis-greffier et Mandrin signa avec le capitaine-châtelain, le juge Girard, le procureur fiscal, le commis greffier et les divers débitants[104]. Dans la nuit du 23 au 21 octobre, à Villemontais, les Mandrins se séparèrent en deux corps, dont le premier prit la route de la Dombes, où l'on vit, le 26 au matin, entre Chalamont et Meximieux, une douzaine de contrebandiers arrêter M. Poirier, receveur à Coligny, et lui faire retourner ses poches. Elles contenaient onze louis d'or, qui étaient destinés à M. Adine, pour le compte des intéressés à la marque des fers[105], et furent pris par les compagnons. Le corps principal, commandé par Mandrin, se dirigea sur Roanne que traversèrent deux cents contrebandiers, au galop de leurs montures, le fusil haut, dans cette nuit du 23 au 24 octobre. Ils n'avaient avec eux aucun cheval de charge. Une arrière-garde, composée de quatre-vingts hommes, passa par Roanne le 24, sur les cinq heures du soir[106]. Le 24 octobre, Mandrin arriva à Charlieu, dont le receveur lui dut verser 1.000 livres en échange d'un stock d'indiennes et de tabacs. Après y avoir passé la nuit, il en repartit avec sa troupe, le 25, à huit heures du matin[107]. Par delà les coteaux couverts de châtaigneraies, au bas desquels, dans les prairies, ruminent de grands bœufs blancs, on aperçoit Cluny. Les grosses tours romanes de l'antique abbaye bénédictine émergeaient des toitures rougeâtres. Les Mandrins entrèrent dans la ville, par les quinconces de tilleuls. Les maisons étaient portées sur des voûtes en plein cintre, échoppes basses et sombres, soutenues par de lourds piliers. A Cluny, Bernard dit la Tendresse ou le Grand Grenadier, qui avait été atteint d'un coup de feu au Puy, sur le toit de la rue du Consulat, s'arrêta épuisé par sa blessure. Le malheureux y fut pris, le 28. On lui fit son procès et il fut rompu vif[108]. En quittant Cluny, vers Mâcon, l'horizon s'agrandit. Ce sont des plateaux inclinés, couverts de champs tondus, car les récoltes ont été faites ; vastes étendues de chaumes roussis au soleil. Les contrebandiers gravissent les cols de ces derniers contreforts des Cévennes ; à leurs pieds, du côté de l'Est, où ils se dirigent, les plaines de la Bresse, de la Dombes et du Dauphiné ; au loin surgissent des masses blanches, immobiles, les neiges des Alpes. La route glisse vers le Sud, où se détachent, parmi les collines, des roches abruptes, taillées en dents de scie, les roches de Solutré et de Vergisson. La terre a des teintes rougeâtres, les sommets sont couverts de bruyères. La route coupe les vallons, elle grimpe les côtes, elle suit les ombrages de la petite Grosne. A mesure qu'on approche de Mâcon, les villages se multiplient. Mais les Mandrins ne pénètrent pas dans la ville ; ils passent la Saône en amont, le 26 octobre. Le chemin est bordé de talus herbeux ; il traverse des prés détrempés. Au bord des mares profondes, de vieux saules éclatés montrent leurs entrailles, comme des bœufs entr'ouverts à l'étal des bouchers. La prairie se développe en hémicycle, Colisée immense, dont les collines du Mâconnais paraissent les gradins. Des troupeaux nombreux, conduits par des pâtres qui chantent. Insensiblement le sol s'élève. Sur la route de Pont-de-Vaux, les Mandrins s'avançaient en bon ordre quand vient à leur rencontre un postillon de grande maison. Celui-ci, à leur vue, épouvanté, tourne bride. Le baron d'Espagnac, mestre de camp dans les armées du roi, avait pris une part importante à la victoire de Fontenoy, comme aide de camp du maréchal de Saxe. Il venait d'être nommé, le 16 octobre 1-154, gouverneur militaire de la Bresse, du Bugey et du pays de Gex. Le siège de son état-major était à Bourg, d'où il devait diriger les corps de troupes placées dans le pays pour combattre les contrebandiers. En compagnie de son chef, le comte de Tavanes, gouverneur de Bourgogne et de Bresse, Espagnac parcourait, en chaise de poste, le pays où il allait avoir à exercer son commandement. A sa grande surprise il vit revenir le postillon — qui, selon l'usage, précédait sa voiture — dans un état d'effarement qui lui laissait à peine l'usage de la parole. Mandrin ! Au fait, voilà que, au tournant de la route, débouchent une centaine d'hommes, sous les ordres du célèbre contrebandier[109]. Force fut au baron d'Espagnac de faire arrêter la voiture, de décliner ses nom et qualités. Mandrin connaissait les hauts faits de Maurice de Saxe et considérait connue un honneur de pouvoir entrer en contact avec un officier qui avait été l'un de ses principaux auxiliaires. Et il avait une faveur à lui demander. Une faveur ! — Je vous serais très reconnaissant, Monsieur le mestre de camp, de vouloir bien passer mes gens en revue et de les faire manœuvrer pendant quelques minutes. Il ne s'agissait pas de refuser. Mandrin céda au baron d'Espagnac son propre cheval et il le suivit modestement sur la monture d'un de ses hommes. La revue se passa selon toutes les règles militaires et l'aide de camp du maréchal de Saxe se déclara émerveillé de l'exactitude et de la rapidité qu'il avait constatées dans les mouvements de cette troupe d'élite. Sans doute il exagérait. Peu après, à Bourg-en-Bresse, Mine d'Espagnac recevait, en un rouleau de carton, une étoffe des Indes de l'impression la plus fine, dont M. le mestre de camp n'eut pas de peine à deviner la provenance[110]. Les Mandrins arrivèrent le 26 octobre à Pont-de-Vaux, qui a de vieilles portes à beffroi, sur la Reyssouze, aux eaux louches, teintées de vert, comme mêlées d'absinthe, bordées de saules et d'acacias. Du pont de la ville, on entend le vieux moulin qui fait tic tac au fil de l'eau ; on entend le clapotis des lavandières agenouillées parmi les piles de linge blanc. Une rue unique, en ellipse, comme à Nantua, aux gros pavés rocailleux, aux larges banquettes, où s'étale, orgueilleuse, la maison du bailli ; une rue à pignons couverts en tuiles rouges, où sont percées au rez-de-chaussée de larges baies en plein cintre, les devantures des magasins. Après avoir mis en liberté un déserteur retenu dans les prisons de la ville[111], les contrebandiers se répandirent dans les cabarets, burent à leur coutume, payèrent de même et se gîtèrent pour la nuit[112]. Au sortir de Pont-de-Vaux, la route de Saint-Amour court en ligne droite, sur un plateau légèrement ondulé, dénudé et triste jusqu'aux premiers contreforts du Jura. Pays de fondrières : le chemin est défoncé par les pieds fourchus des bœufs dont il garde l'empreinte. En cette fin d'octobre, les pluies sont tombées et les valets sacrent et tempêtent en pressant les chevaux qui enfoncent dans la boue. Les Mandrins traversent des forêts, au sortir desquelles ils quittent la Bresse pour entrer dans la région du Jura. A mesure qu'on approche de la montagne et qu'on s'y engage, le sol devient rocailleux. Il a sous les pieds des résonances de métal. Les pentes sont d'une raideur telle que les routes, pour se frayer un passage, se tordent en vipères blessées. Et les lignes du paysage lui-même sont tourmentées, déchiquetées. Les Mandrins se dirigent vers l'Est, où l'horizon est fermé par un rideau de roches, aux teintes d'un gris violet. C'est le Réaumont, creusé de ravins, bossué de collines. Les ceps, serrés en phalanges, grimpent à l'assaut des pentes, ou bien ils glissent et s'étalent dans des hémicycles, jusqu'au fond des cirques creusés en entonnoirs. Le long des crêtes, ils se profilent sur le ciel, ils entourent les celliers qui se cachent sous les noyers séculaires, ils s'accrochent aux ronces des murgers, ils rampent et s'appuient sur d'énormes pierres qui affleurent le sol, ou qui sont posées verticalement, pareilles à des menhirs. Par Saint-Trivier-de-Courtes, les Mandrins arrivent à Saint-Amour-en-Comté, le 27 octobre, avant le jour. Le jeune capitaine y fait panser sa blessure. C'est une antique petite ville, serrée dans ses gros murs de l'époque féodale, aux ruelles étroites et grimpantes. Des hommes, chaussés de larges souliers ferrés, causent de leurs affaires au pied de la tour Guillaume. Les contrebandiers y dînent et en repartent, après avoir rendu libres les prisonniers incarcérés pour dettes dans les geôles du roi[113]. Saint-Amour est sur les contins de la Franche-Comté, que nos compagnons vont traverser au galop de leurs montures pour regagner la Suisse. Rapidement, par de courts lacets inclinant vers le Nord-Est, ils montent encore. Ils atteignent l'Oratoire des Quatre-Bornes. Ils ont devant eux de larges plateaux accidentés, avec des forêts et des landes pierreuses. Ils ne rencontrent plus que rarement un écart, une habitation cachée dans la verdure. Terre de dur labeur. Les vents de la montagne obligent les chaumières à se grouper en hameaux dans les coins abrités. Les contrebandiers ont chevauché sur les hauteurs durant quelques heures et ils redescendent par Gray et par Loysia dans la paisible vallée du Surand. Ils égueyent la petite rivière. Sur les mottes, les ruines des vieux manoirs, le château d'Andelot, celui d'Orgelet. Ici les Mandrins dévalisent encore la maison d'un employé des Fermes et ouvrent les prisons. Ils franchissent l'Ain à Pont-de-Poitte. Sur leur droite apparaît Clairvaux, qu'ils aperçoivent au loin, à l'Orient, avec sa vieille église dressée sur son promontoire. A nouveau le chemin remonte, grimpe sur les rochers, monte encore, frôle des précipices sur une longue étendue, et, au nord de Crillac, abandonne l'attrayant paysage, pour s'engager dans la montagne. Par une échappée on aperçoit encore Clairvaux, au Sud cette fois. Les maisons en sont comme enchâssées dans des massifs de verdure ; à droite une vieille tour se profile, toute noire, sur le ciel clair. Nos compagnons atteignent les Petiles-Chiettes[114], le premier village du haut-Jura. La montagne devient menaçante, tant elle est proche, abrupte, tapissée de sapins énormes. Sur la droite, à peu de distance, en suivant la ligne de la forêt, le sol s'affaisse et se creuse en cuvette. La route pénètre dans les gorges, la végétation cesse. Chaos de rochers, paysage à la Salvator Rosa. De droite et de gauche, des rocs, accroupis comme des monstres, gardent l'entrée du défilé ; à travers les blocs de pierre, les pentes s'accentuent encore ; c'est la montée du château de l'Aigle, dont on ne tarde pas à apercevoir les ruines déchiquetées. Les nuages, en passant, se déchirent aux cimes des montagnes. Les contrebandiers arrivent ainsi au col et au village même de la Chaux-du-Dombief, d'où ils descendent au Morillon, pour y franchir le pont du Dombief. Le paysage s'élargit. Le petit lac de Ratay, au bord du chemin, met une note claire près de la lisière d'une forêt de hêtres dont les branches dépouillées ont jonché le sol de leurs feuilles roussies. En cette fin d'octobre, à cette altitude, c'est l'hiver. Les feuilles brunes sont tombées sur l'eau des marcs, elles y sont tombées si dru, que l'eau en est couverte connue d'une nappe de vieux cuir troué. Les contrebandiers se hâtent vers la frontière. Rendant plus triste encore le deuil de la nature, à Salave-de-Bise et à Salave-de-Vent, de noires tourbières, semblables à des landes rasées par l'incendie, assombrissent le plateau marécageux sur lequel s'étale, au milieu de pauvres cultures, Saint-Laurent-du Grand-Vaux. A Saint-Laurent, les compagnons tuent encore un gapian. C'était pour Mandrin comme un point final par lequel il croyait devoir clore chacune de ses campagnes. La route s'engouffre dans la forêt du Mont-Noir. A l'opposé du col de la Savine, sur le haut d'un cirque élevé, la commune des Rousses éparpille jusqu'à la frontière suisse ses chalets capitonnés de neige. Le village est tout bondé d'employés qui se sont terrés à l'approche des Mandrins. Le village est triste à cette altitude de 1.200 mètres, avec ses terres froides, rebelles à la culture, sous les crêts dénudés qui l'entourent. Il est environné de lieux-dits aux appellations sinistres, le Goulet de l'Enfer, la Malcombe, le Cimetière aux Bourguignons, le chalet du Massacre ; et, planant au-dessus des cimes avoisinantes, la sombre Dôle, à la coupole aplatie, pelée comme une crête de vautour. C'est la route la plus élevée du Jura. Elle en longe à présent la dernière chaîne, près des sommets. A travers les forêts, trouées de clairières, la Dôle se dresse sur la droite. On la voit par échappées, au fond desquelles les carrés de neige, au milieu des pâturages, ressemblent à des linges étendus. En bas, dans la combe abritée de Mijoux, près de la Valserine naissante, qui contourne les chalets écrasés contre terre, des vaches paissent, agitant leurs clochettes, — le son argentin des clochettes est le seul bruit qui monte de la vallée. Les contrebandiers s'engagent dans le col de la Faucille. Menaçants, au-dessus de leurs têtes, des groupes de rochers et de sapins énormes. A l'extrémité du passage, dans le large triangle formé par son évasement subit, brusquement la Savoie et une partie de la Suisse apparaissent à leurs yeux : le croissant du lac Léman, au centre du paysage, depuis les lointains indécis du Valais jusqu'à la pointe où Genève s'étale comme une plage rocailleuse, dans son cadre de montagnes : la Dent du Midi, la Dent d'Oche, le massif de la Chartreuse et la masse énorme du Mont Blanc. Le 28 octobre, par les Rousses et le col de la Faucille, les Mandrins sont rentrés en Suisse[115], d'où ils étaient partis le 4 octobre précédent. Dès le 29 octobre, on signale Mandrin avec sa troupe, au nombre d'environ deux cents, dans les environs de Nyon et de Morges. La bande se partagea entre Coppet, Nyon et Rolle[116], sur les bords du grand lac bleu. Le 2 novembre, Mandrin était à Carouge, village sur la frontière qui sépare la Savoie de l'État de Genève, à deux portées de fusil de cette dernière ville, mais en Savoie[117]. Durant cette cinquième campagne, qui vient de se dérouler en trois semaines, du 4 au 28 octobre 1754, le jeune capitaine — que Voltaire, son voisin, va appeler le plus magnanime des contrebandiers[118], — franchit avec sa troupe plus de deux cent cinquante lieues. Quelle fougue ! quelle activité ! quelle énergie et quelle présence d'esprit ! Il a le don de tout prévoir et de tout organiser. Ce sont les qualités essentielles des grands chefs militaires. Que de difficultés il a écartées, — au point que jamais une difficulté ne lui a barré le chemin. En ce cerveau rudimentaire, on trouve, comme un don naturel, le génie stratégique, qui assure les marches et donne une connaissance instinctive des conditions géographiques d'un pays traversé pour la première fois. Ce Mandrin a des ailes, écrit encore Voltaire, il a la vitesse de la lumière. Toutes les caisses des receveurs des domaines sont réfugiées à Strasbourg. Mandrin fait trembler les suppôts du fisc. C'est un torrent, c'est une grêle, qui ravage les moissons dorées de la Ferme[119]. Incomparable chef de partisans, Mandrin n'eût-il pas fait un merveilleux chef d'armée ? On l'a dit, on doit le répéter, rien n'est plus vrai. Mandrin avait le tempérament, le génie militaire, le don des décisions rapides, vigoureusement et hardiment exécutées, qui ont fait les jeunes et grands généraux de l'époque révolutionnaire, les Hoche et les Marceau. Il avait déjà leurs idées, il avait leur vigueur, il avait leur enthousiasme. Il n'est rien d'être un grand homme : il faut venir à son moment. C'est encore Voltaire qui parle ; il avait pu étudier nos contrebandiers de près : J'ai eu à craindre les sifflets sur les bords de la Seine — Prométhée — et les Mandrins sur les bords du lac Léman. Ils prenaient assez souvent leurs quartiers d'hiver dans une petite ville auprès du château où je suis, et Mandrin vint il y a un mois se faire panser de ses blessures par le plus fameux chirurgien de la contrée. Du temps de Romulus et de Thésée il dit été un grand homme ; mais de tels héros sont pendus aujourd'hui. Voilà ce que c'est que d'être venu au monde mal à propos : il faut prendre son temps en tout genre[120]... Du moins l'opinion publique ne s'y trompait pas. Le peuple aime ce Mandrin à la fureur, écrit Voltaire à son ami Dupont. Il s'intéresse pour celui qui mange les mangeurs de gens[121]... Partout le peuple favorise Mandrin. La constatation en revient. lamentable et naïve, dans la correspondance des intendants et des subdélégués avec les ministres. La valeur du bandit, qui appuye sur les sentiments populaires, réduit à l'impuissance les représentants de l'autorité[122]. |