HISTOIRE DES ROMAINS
DOUZIÈME PÉRIODE — L’ANARCHIE MILITAIRE (235-268). COMMENCEMENT DE LA DÉCADENCE.
CHAPITRE XCIV — SEPT EMPEREURS EN QUATORZE ANS (235-249).
I. — MAXIMIN (835-238) ; GORDIEN I ET GORDIEN II ; PUPIEN ET BALBIN (238).
La fortune inouïe qui arrivait à Maximin ne lui ôta pas le sentiment de son indignité et le mit en défiance contre tous ceux qui possédaient ce qu’il n’avait jamais eu, des aïeux, un nom, l’éducation, la fortune. Il n’osa venir à Rome. Cette ville pleine de glorieux souvenirs, ce sénat, où il n’était pas encore entré[4] et qui était toujours l’ombre d’une grande chose, intimidaient le Barbare. Les amis, les conseillers d’Alexandre, toute sa domesticité, et dans le nombre plusieurs chrétiens, furent d’abord bannis ou tués ; puis une conspiration fausse ou vraie coûta la vie au patricien Magnus, personnage consulaire, et à quantité de gens[5]. L’armée comptait beaucoup de troupes d’origine asiatique et africaine, archers de l’Osrhoëne et de l’Arménie, Maures armés de javelots, Parthes qui avaient fui la domination persane, tous dévoués à la dynastie sortie d’Émèse et de Leptis. L’élu des Pannoniens, le meurtrier d’Alexandre, leur était doublement odieux ; ils voulurent le renverser et proclamèrent empereur, malgré lui, un consulaire, qu’un de ses amis assassina par dépit de n’avoir pas eu la préférence. Ce meurtre désorganisa la rébellion ; de nouvelles victimes tombèrent, et Maximin se hâta de chercher dans une victoire sur les Germains la consécration de son pouvoir. Ces Barbares ne résistaient pas à une attaque sérieuse. Abandonnant aux Romains leurs moissons et leurs villages de bois, qui furent brûlés, ils se réfugièrent au milieu de forêts où ils pensaient que les légions n’oseraient entrer, et en des marais dont seuls ils connaissaient les endroits praticables. Maximin les y suivit, en tua bon nombre et envoya aux sénateurs, avec ses lettres de victoire, un tableau qui le représentait combattant, entouré d’ennemis, sur un cheval à demi enfoncé dans la vase. Il prétendit avoir saccagé le pays sur un espace de 400 milles. D’autres guerres, que nous ne connaissons pas, lui valurent les titres de Dacique et de Sarmatique. De Sirmium, dont il avait fait le centre de ses opérations, il surveillait la ligne des Carpates et se proposait de pénétrer jusqu’aux mers du Nord : ce fils des Goths voulait étouffer la barbarie d’où il était sorti[6]. Un tel dessein et sa vie passée dans les camps du Danube, en de rigoureux climats, donnent à ce parvenu une certaine grandeur farouche. Mais les sénateurs, laissés oisifs dans la curie, les énervés de Rome, d’Alexandrie et d’Antioche, qui, du fond de leurs villas somptueuses, n’apercevaient pas les périls que le Nord recélait en ses flancs, et la populace privée de ses plaisirs accoutumés par un prince qui ne songeait qu’à la guerre, s’indignaient de l’affront fait à la pourpre impériale : on l’appelait le Cyclope, le Busiris, la bête fauve ; on faisait tout haut des vœux pour sa mort, et, au théâtre, les acteurs déclamaient des vers où il était dit : L’éléphant est gros, et on le tue ; le lion est fort, et on le tue ; le tigre est terrible, et on le tue. Prends garde à tout le monde, toi qui ne crains personne ; car ce qu’un seul ne peut faire plusieurs le feront. Le rude soldat rendait mépris pour mépris à des efféminés dont la main ne savait plus tenir une épée, à ces foules vivant de sportules et de spectacles, qui n’avaient vu couler d’autre sang que celui des gladiateurs, et l’empereur répondait aux mauvais propos par des sentences. Malgré les efforts de l’impératrice, qui s’efforçait vainement d’adoucir ce naturel farouche[7], les meurtres, les confiscations se multipliaient, et la haine croissait contre le Thrace, qui osait dire tout haut qu’on ne pouvait gouverner un tel empire que par la plus extrême sévérité. Cette haine, Maximin la sentait partout, même dans les flatteries, et sa cruauté en était d’autant plus grande. Ceux mêmes qui avaient aidé à sa fortune devenaient coupables d’en avoir connu les humbles commencements, et il faisait disparaître les témoins gênants de son obscurité. Comme il n’y avait de salut pour lui que dans l’armée, il la gorgea d’or, et, celui de l’État ne suffisant pas, il pilla les villes et les temples, battit monnaie avec les statues des dieux, et confisqua les fonds destinés aux spectacles et aux distributions ; des citoyens périrent en essayant de défendre les images de leurs divinités. Une catastrophe devenait inévitable ; les peuples crurent qu’une grande éclipse de soleil l’annonçait.
Gordien accepta, et Carthage, qui n’avait pas vu d’empereur
depuis Hadrien, reçut avec transport le nouvel auguste. Il s’associa son
fils, qui était un de ses légats, et dépêcha sur l’heure des émissaires à
Rome avec des lettres pour les consuls, le sénat, le peuple, les prétoriens,
et des meurtriers pour le préfet du prétoire, ministre impitoyable des
cruautés de Maximin. Ils y portaient aussi la fausse nouvelle que l’empereur
venait d’être tué dans son camp, au fond de Cependant des messagers étaient partis pour faire entrer
les provinces dans le mouvement de Rome et de Carthage. Leurs dépêches,
écrites au nom du sénat et du peuple romain, demandaient aux nations de
secourir la commune patrie et de reconnaître les deux princes qui venaient de
délivrer la terre d’une bête fauve[11]. Maximin se
moqua d’abord des nouveaux Carthaginois
et promit, à ses soldats que cette révolte sénatoriale leur vaudrait un riche
butin. Il n’y avait point, en effet, d’Annibal à Carthage, et lorsque le
légat de Des idées qui prirent corps plus tard germaient alors. Hérodien avait cru, au temps de Caracalla, qu’un partage de l’empire était possible. Dans la délibération qui s’ouvrit après l’arrivée du courrier d’Afrique, un sénateur demanda la nomination de deux empereurs ; l’un restant à Rome pour les affaires civiles, l’autre à l’armée pour les opérations militaires ; c’était une première ébauche du système de Dioclétien. L’avis prévalut, et le sénat proclama deux augustes, Pupien[13], un homme de guerre, et Balbin, qui s’était honoré dans la carrière civile. Pour rendre leurs pouvoirs absolument égaux, on leur donna à tous deux le titre de grand pontife, qui n’avait jamais été partagé, et ils accordèrent aux deux Gordiens celui de divus.
Rome avait trois empereurs, elle n’en eut pas moins la
guerre civile. Maximin n’y avait laissé que les vétérans du prétoire, et
cette soldatesque, dont nous avons plus d’une fois marqué l’insolence, était
toujours mal vue de la noblesse et de la populace. Un jour, deux de ces
soldats, entrés sans armes et en curieux dans le temple où les Pères
délibéraient, dépassèrent l’autel de Maximin se trouvait dans la position où Sévère avait été quarante-cinq ans auparavant ; mais il ne montra pas la prévoyance de l’Africain, et son armée, n’ayant pas de vivres préparés sur la route qu’elle avait à suivre, n’avança que lentement. Il est vrai que les dispositions des provinciaux n’étaient plus les mêmes : les habitants fuyaient à l’approche des Barbares que Maximin menait avec lui, et les villes où il entrait étaient vides d’hommes et de provisions[15]. Le sénat eut donc le temps de faire des levées en Italie,
de fortifier les places, de couper les routes. La flotte de Ravenne avait
enlevé ou détruit toutes les barques du littoral et ne laissait rien arriver
par l’Adriatique à l’armée de Pannonie[16]. Vingt
consulaires s’étaient partagé l’Italie pour en faire comme une forteresse, et
de Ravenne, où il réunissait son armée, Pupien dirigeait tout. Cette ville, Quand il atteignit les rives de l’Isonzo, le torrent grossi par la fonte des neiges roulait large et furieux, et le magnifique pont de pierre qui le traversait avait été coupé. L’armée y fut arrêtée plusieurs jours, jusqu’à ce que l’on eût construit des radeaux avec les tonneaux et les planches trouvés dans les maisons abandonnées. Sur l’autre bord, à quelques milles du fleuve, s’élevait
Aquilée, la vraie porte de l’Italie dans cette région. Que Maximin la prît ou
que, du consentement des habitants, il la traversât avec ses bandes affamées,
la grande et riche cité était perdue. Aussi ces descendants des colons
romains s’étaient-ils résolus à faire une résistance désespérée. Ils avaient
fermé les brèches de leurs murailles, amassé d’immenses provisions, fabriqué
des armes et des machines de guerre. Les femmes, renouvelant des exemples
fameux, avaient donné leurs chevelures pour faire des cordages ; un temple
élevé dans Rome à Toutes les attaques furent déjouées, tous les assauts repoussés ; une pluie de poix enflammée arrêtait les colonnes ennemies, et du haut des murs les balistes lançaient contre les machines des javelots enveloppés de matières incendiaires, qui y mettaient le feu. Maximin se vengeait de ses échecs répétés en faisant tuer les chefs qui conduisaient si mal ses affaires. On ne tarda pas à murmurer de ces exécutions injustes : d’ailleurs les vivres manquaient, l’armée ne volait arriver ni convois ni troupes nouvelles, tout l’empire paraissait ennemi, et le prince n’était pas de ceux qui donnent le courage de combattre contre tous. Les soldats de la deuxième légion Parthique étaient les plus inquiets. Leurs femmes, leurs enfants et leurs biens, laissés Albano, se trouvaient o la merci de leurs adversaires. Pour les sauver, ils égorgèrent Maximin et son fils. Son règne avait été de trois ans et quelques jours (258)[21]. Alors l’armée demanda à entrer dans la place ; les Aquiléens n’eurent garde d’y consentir. Ils descendirent des vivres du haut de leurs murailles, en se les faisant payer, puis ouvrirent des marchés à leurs portes, et l’on eut l’étrange spectacle d’assiégés qui nourrissaient les assiégeants. Pupien, accouru de Ravenne au milieu de cette armée sans chef, prit ses serments de fidélité aux trois empereurs de Rome, et renvoya ces corps dans leurs cantonnements après leur avoir, comme il convenait, largement payé le prix du sang. Durant ces péripéties, le sénat avait vécu dans l’anxiété d’un homme qu’on tient le couteau sur la gorge. Aussi sa joie fut extrême comme l’avait été sa terreur, et il la témoigna par l’éclat retentissant de sa reconnaissance envers les dieux et les empereurs : aux uns, de solennelles actions de grâces et des hécatombes ; aux autres, vainqueurs sans combat, des trophées, des chars de triomphe, des statues équestres dorées et, pour faire du nouveau, des statues portées par des éléphants.
Moins de cinq mois avaient suffi pour l’accomplissement de la triple tragédie dont Rome, Carthage et le camp d’Aquilée avaient été le théâtre. La restauration sénatoriale avait duré tout juste le temps nécessaire pour que le soldat revînt de la surprise que lui avait causée cette entreprise audacieuse, et elle ne pouvait durer davantage, parce que le sénat n’avait pour lui ni force d’opinion ni force matérielle : la puissance était ailleurs. De Commode à Dioclétien, les vrais maîtres de l’empire ont été les soldats, et les malheurs de cette domination ne furent momentanément conjurés que lorsque l’armée eut à sa tète des chefs à la fois énergiques et habiles, tels que Sévère, Aurélien et Probus. La constitution de l’empire exigeait, pour qu’il fût prospère, que de grands princes tinssent toujours le gouvernail. Mais la nature n’est pas si prodigue d’hommes supérieurs, et la sagesse humaine n’avait pas suppléé, par de bonnes institutions, à ce que la nature ne donnait pas. II. — GORDIEN III (238-244).En quelques mois, six empereurs avaient péri : il ne restait qu’un enfant, Gordien III[25]. Les meurtriers l’emmenèrent dans leur camp. Naguère, ils l’avaient fait césar par haine de Pupien et de Balbin ; quand il fut seul, ils le firent auguste ; un prince de douze à treize ans était le chef qui leur convenait. Cependant l’empire, fatigué des dernières commotions, se reposa durant quelques années.
Ce Timésithée, qui avait honnêtement rempli d’importants emplois de finance et fait plusieurs fois fonction de gouverneur de province, vice præsidis, se trouva être un homme ; il repoussa dans l’ombre ceux qui n’auraient jamais dû en sortir. Une de ses lettres à Gordien montre l’étendue du mal et l’énergie du remède : A Auguste, mon maître et mon fils, Timésithée son beau-père et son préfet. C’est pour nous une grande joie de vous voir échapper à la honte de ce temps, où des eunuques et des hommes que vous regardiez comme vos amis faisaient de tout un infâme trafic. Notre joie est d’autant plus vive, que vous vous applaudissez de cet heureux changement : ce qui prouve assez, mon respectable fils, que de tels abus n’étaient pas votre ouvrage. On ne pouvait, en effet, souffrir plus longtemps que des eunuques disposassent des commandements militaires ; que d’honorables services fussent laissés sans récompense ; que le caprice ou l’intérêt de quelques hommes fit périr des innocents et absoudre des coupables ; que le trésor fût vidé par ceux qui formaient tous les jours des intrigues pour vous inspirer de fâcheuses préventions contre les meilleurs citoyens ; qui écartaient les bons, avançaient les méchants, et trafiquaient des paroles même qu’ils vous prêtaient. Remercions donc les dieux qui vous ont donné la volonté de guérir les maux de la république. Il est doux d’être le beau-père d’un prince qui veut tout savoir et qui éloigne de lui les hommes par lesquels il semblait jadis être mis lui-même à l’enchère. A cette lettre, Gordien répondit : L’empereur Gordien Auguste à Timésithée, son père et son préfet. Si les dieux tout-puissants ne protégeaient l’empire romain, nous serions encore comme exposés en vente par des eunuques, achetés eux-mêmes au marché. Enfin je comprends maintenant que ce n’était ni un Félix que je devais mettre à la tête des cohortes prétoriennes, ni un Sérapammon qu’il fallait nommer chef de la quatrième légion, et, pour ne pas tout rappeler à la fois, que je ne devais point faire bien des choses que j’ai faites. Mais je rends grâces aux dieux de ce que vous, dont le désintéressement est connu, vous m’ayez appris ce que la captivité où l’on me tenait m’empêchait de savoir. Que pouvais-je faire, lorsque Maurus vendait mon gouvernement et que, d’accord avec Gaudianus, Reverendus et Montanus, il louait ceux-ci et blâmait ceux-là ? Que pouvais-je, sinon approuver ce qu’il m’avait dit et ce que confirmait le témoignage de ses complices ? Croyez-moi, mon cher père, un empereur est bien malheureux quand on lui cache la vérité. Ne pouvant aller s’en instruire au dehors, il est forcé d’écouter ce qu’on lui dit et de se décider sur les rapports qu’on lui fait. Timésithée n’était renommé que pour son éloquence et son intégrité ; il se montra, quand ce fut nécessaire, bon général. Il fit réparer les fortifications des villes et frontières, y entassa de grandes quantités de vivres pour que les corps pussent, au besoin, s’y ravitailler. Les places de première ligne furent approvisionnées pour une année en blé, lard, vinaigre, orge et paille ; les villes moins importantes pour un ou deux mois. Il savait ce que contenaient les magasins d’armes et s’assurait du bon état de celles qui étaient aux mains des soldats. Des camps, il renvoyait les bouches et les bras inutiles, les vieillards et les enfants, qui gênaient les manœuvres et gaspillaient les rations. La discipline était facilement maintenue, parce qu’il veillait avec la plus active sollicitude à tous les besoins du soldat, de sorte que, même dans les marches lointaines, les provisions arrivaient toujours à point. Aussi avait-il pu faire reprendre l’usage d’entourer d’un fossé le lieu où l’armée campait, ne fût-ce qu’un jour ; et comme il visitait les postes, même durant la nuit, personne ne manquait de vigilance. En peu de temps un homme habile et dévoué au bien public rendait aux troupes leurs qualités militaires, et l’armée redevenait l’instrument redoutable qu’elle avait été si longtemps. Les Perses s’en aperçurent. Satisfaits ou fatigués du
premier choc qui avait eu lieu sous Alexandre Sévère, ils s’étaient tenus en
repos jusque vers la fin du règne de Maximin ; mais les nouvelles dynasties
asiatiques ne remplacent pas immédiatement la tente par le harem. Elles ont
besoin, pour se consolider, de donner issue, de temps à autre, à la
belliqueuse ardeur qui a servi à les fonder. Ardeschir menaça de nouveau l’Arménie
et les provinces romaines. A sa mort, en 240, il eut pour successeur son fils
Shapur ou Sapor, qui fut, durant un tiers de siècle (240-273), l’infatigable ennemi des
Romains. Ce prince dirigea une invasion formidable, que rien n’arrêta, jusqu’au
cœur de En 242, il était sur le bord de l’Hellespont, d’où il gagna rapidement l’Euphrate. La cavalerie persane ne résista pas mieux que les Alains
et les Goths. Mais le souvenir de ces combats est perdu. Il n’en reste que
quelques lignes d’une dépêche de l’empereur au sénat : a Après le récit des
avantages remportés durant notre marche et dont chacun mériterait l’honneur d’un
triomphe, nous avons brisé le joug que les habitants d’Antioche portaient
déjà noué autour de leur tète et nous avons délivré Malheureusement quelque temps après, le sage tuteur mourut, emporté par une maladie ou par un poison que Philippe lui aurait donné (243). Ce Philippe était un Arabe de la Trachonitide[33], fils d’un chef de voleurs fameux en ce pays-là et qui avait vécu d’abord comme son père. Enrôlé dans les troupes romaines, il s’y éleva de grade en grade jusqu’à se trouver l’officier le plus important de l’armée après la mort de Timésithée. Gordien lui donna l’héritage de celui qui était peut-être sa victime, la préfecture du prétoire, et l’on continua les opérations contre les Perses. Une grande bataille gagnée près de Resaina, sur le Chaboras, avait ouvert la route de la capitale persane, quand une sédition éclata. Le nouveau préfet du prétoire l’avait fomentée en désorganisant à dessein le service si bien établi par son prédécesseur. Des ordres secrets égaraient les convois et empêchaient les bateaux chargés de vivres d’arriver au camp. Quand il vit le mécontentement naine et s’étendre, il chargea ses émissaires d’aller, par les tentes et les groupes de soldats, se répandre en plaintes contre Gordien : un prince si jeune était incapable de gouverner l’empire et de conduire l’armée ; il fallait lui donner un collègue qui pût rendre les services que Timésithée avait rendus. L’armée, pressée par la famine, déféra l’empire à Philippe et ordonna qu’il gouvernerait conjointement avec Gordien, comme son tuteur[34]. Les amis du jeune empereur ne pouvaient se méprendre sur ce partage d’autorité imposé par les soldats : c’était un maître qu’on lui donnait, et les insolences préméditées de Philippe ne permettaient pas d’en douter. Ils préparèrent une contre-révolution. Quand ils crurent pouvoir compter sur un nombre suffisant de fidèles, ils obtinrent une convocation de l’armée, comme si elle était une assemblée délibérante. Gordien, monté sur sou tribunal, se plaignit de l’ingratitude de Philippe, qu’il avait, dit-il, comblé de ses bienfaits, et demanda justice aux soldats, c’est-à-dire la destitution de l’empereur qu’ils avaient nommé. Mais le parti contraire l’emporta, et ce fut Gordien dont ils prononcèrent la dégradation. Ici Capitolin place une scène de lâches supplications où Gordien aurait descendu honteusement toutes les marches du pouvoir, en mendiant d’abord le partage de l’autorité, puis le rang de césar ou le titre de préfet du prétoire ; enfin le grade de duc et la vie. Nous n’avons pas plus de raison de croire à la bassesse de ce jeune homme qu’à son grand courage : mais à vingt ans on ne meurt pas ainsi. Gordien fut tué près de Zaitha, la ville des Oliviers, où son assassin lui fit élever un magnifique tombeau, qui, un siècle plus tard, était encore debout[35]. Trois autres empereurs, Valérien, Carus et Julien, mourront dans ces déserts. Philippe écrivit au sénat que les soldats l’avaient élu empereur à la place de Gordien, mort de maladie, et le sénat décerna à l’un l’apothéose, à l’autre les titres impériaux. Il se consola de sa secrète douleur, en accordant à tous les membres survivants de cette tragique famille, naguère si heureuse, l’exemption de la tutelle, des légations et des charges municipales, munera. C’était tout ce qu’il pouvait maintenant donner (février ou mars 244). III. — PHILIPPE (244).Au lieu de continuer la guerre contre les Perses, découragés par leur défaite à Resaina, Philippe se hâta de conclure la paix avec eux, à des conditions qui leur étaient avantageuses[36], et il rentra dans Antioche. Eusèbe, qui serait disposé à faire de ce meurtrier un chrétien, dit qu’on racontait de son temps[37] que Philippe ayant voulu, avec l’impératrice, célébrer la pâque dans cette ville, l’évêque, saint Babylas, leur avait interdit l’entrée de l’église ; que tous deux s’humilièrent, firent l’exomologèse ou confession publique de leurs fautes et prirent place parmi les pénitents. Ces bruits devinrent, dans la suite, une certitude[38], sans qu’on voie l’intérêt qu’avait l’Église à réclamer un pareil prosélyte. Il se peut que cet Arabe ait eu, dans sa jeunesse, connaissance du christianisme ; qu’à l’exemple de Mammée, il ait entretenu des relations avec Origène[39], et il est certain que, durant son règne, comme sous celui d’Alexandre, les chrétiens jouirent d’une paix profonde[40] ; mais toute sa conduite publique fut celle d’un empereur païen. D’après la légende d’une de ses monnaies, il croyait que son avènement avait été prédit par Apollon[41], et les médailles d’Otacilia Severa portent des types profanes : honneurs sacrilèges qu’une chrétienne véritable aurait refusés. D’ailleurs, en ce temps de confusion religieuse, beaucoup d’esprits étaient incertains sur leurs croyances. Le syncrétisme rationnel des philosophes alexandrins devenait un syncrétisme irréfléchi dans bien des âmes. Ainsi un monument singulier, d’une date pourtant très postérieure, représente un Saint Georges avec une tête d’épervier, c’est-à-dire le héros d’une légende chrétienne confondu avec un dieu égyptien, Horus[42]. Le prétendu christianisme de Mammée et d’Otacilia était de même nature et moins précis encore.
Philippe lit une ordonnance sévère contre le vice grec ; s’il ne réussit pas à détruire cette dégradante aberration qui met l’homme au-dessous de la bête, du moins n’osa-t-on plus s’en vanter et en rire[44]. Son fils n’avait que sept ans[45] : le nomma césar, puis auguste (247), oubliant le sort de ces jeunes fils d’empereurs pour qui la pourpre n’avait été qu’un linceul, et il mit tous ses proches dans les emplois. Son frère Priscus commanda l’armée de Syrie ; son beau-père (?), Severianus, celle de Mœsie. Il eut, du reste, des égards pour les sénateurs et parait avoir gouverné doucement, sans cruautés ni confiscations. Toutefois il fit passer au fisc le palais de Pompée, propriété des Gordiens, qui l’avaient beaucoup embelli. Les Carpes, peuple d’origine gétique, probablement établi du côté du Pruth, avaient encore pénétré dans les pays du bas Danube il semble être allé lui-même les chasser et avoir employé deux campagnes à cette guerre (245-6)[46]. Après son retour à Rome, la nouvelle y arriva que les Syriens, exaspérés des exactions de Priscus, avaient nommé un empereur, Jotapien, qui se disait descendant d’Alexandre, et qu’en Mœsie quelques mutins en avaient proclamé un autre, Marinus[47]. Philippe, fort troublé, consulta le sénat. Un des membres de cette assemblée, Dèce, qui savait ce que valaient les nouveaux augustes, annonça que ces rois de théâtre ne pourraient se soutenir ; en effet ils tombèrent d’eux-mêmes. Philippe crut cependant nécessaire d’envoyer à l’armée du Danube le sage conseiller qui avait si bien vu quelle tournure prendraient les événements. Dèce résista longtemps, prévoyant que ces légions qui, depuis quatorze ans, n’avaient point fait de sédition, saisiraient le premier prétexte pour se donner le plaisir et les bénéfices d’une révolte. Dèce, en effet, était à peine au milieu des cantonnements, que les soldats le saluaient empereur malgré lui. Ceux qu’il était chargé de punir à cause des derniers troubles avaient imaginé cette combinaison, qui, du même coup, les sauvait du châtiment et leur assurait un donativum. Dèce écrivit à Philippe que, aussitôt arrivé à Rome, il déposerait la pourpre. L’empereur ne se fia pas à cette parole et marcha au-devant de l’armée de Pannonie ; il fut vaincu et tué près de Vérone[48]. Les prétoriens, qu’il avait laissés à Rome, égorgèrent son fils : l’enfant avait douze ans, et jamais on ne l’avait vu sourire (249)[49]. |
 L’aristocratie romaine et la noblesse provinciale
abandonnant le service militaire, les fils des Barbares y entraient, et,
arrivés aux grades supérieurs, ils disposaient des troupes, par conséquent de
l’empire. Voilà comment y parvint un Thrace, en qui se réunissaient plusieurs
barbaries. Par son père, Maximin
L’aristocratie romaine et la noblesse provinciale
abandonnant le service militaire, les fils des Barbares y entraient, et,
arrivés aux grades supérieurs, ils disposaient des troupes, par conséquent de
l’empire. Voilà comment y parvint un Thrace, en qui se réunissaient plusieurs
barbaries. Par son père, Maximin Vers le milieu de février 258
Vers le milieu de février 258 Une foule nombreuse s’était assemblée en face du Capitole,
où le sénat délibérait. À la nouvelle des résolutions prises, de violentes
clameurs s’élevèrent, surtout contre Pupien qui, gouverneur de la ville,
avait réprimé avec sévérité ces infractions à la police que le petit peuple
commet ou excuse si volontiers. Aussi quand les nouveaux empereurs voulurent
gagner le palais impérial, ils lurent, avec leur suite, refoulés dans le Capitole.
Les Gordiens, étant très riches, avaient beaucoup d’amis qui s’étaient promis
d’exploiter leur règne. De cette famille il restait un enfant, petit-fils par
sa mère du proconsul d’Afrique
Une foule nombreuse s’était assemblée en face du Capitole,
où le sénat délibérait. À la nouvelle des résolutions prises, de violentes
clameurs s’élevèrent, surtout contre Pupien qui, gouverneur de la ville,
avait réprimé avec sévérité ces infractions à la police que le petit peuple
commet ou excuse si volontiers. Aussi quand les nouveaux empereurs voulurent
gagner le palais impérial, ils lurent, avec leur suite, refoulés dans le Capitole.
Les Gordiens, étant très riches, avaient beaucoup d’amis qui s’étaient promis
d’exploiter leur règne. De cette famille il restait un enfant, petit-fils par
sa mère du proconsul d’Afrique Quand le bruit des acclamations fut tombé et la flamme des
sacrifices éteinte, Pupien envisagea froidement la situation et la trouva
encore pleine de périls.
Quand le bruit des acclamations fut tombé et la flamme des
sacrifices éteinte, Pupien envisagea froidement la situation et la trouva
encore pleine de périls.  Les deux empereurs vécurent d’abord en bonne intelligence
; pour attester leur concorde, ils faisaient frapper des monnaies
représentant deux mains jointes, avec les légendes :
Les deux empereurs vécurent d’abord en bonne intelligence
; pour attester leur concorde, ils faisaient frapper des monnaies
représentant deux mains jointes, avec les légendes :  On ne parle que d’une insurrection en Afrique ; elle fut
vite apaisée par le gouverneur de la Maurétanie Césarienne
On ne parle que d’une insurrection en Afrique ; elle fut
vite apaisée par le gouverneur de la Maurétanie Césarienne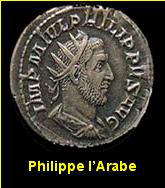 Les événements du règne de Philippe notes sont à peu près inconnus.
L’Histoire Auguste, de Gordien III à Valérien, c’est-à-dire de 244 à
253, est perdue, et, pour remplir cette lacune, nous n’avons que les secs ou
douteux résumés de Zosime et de Zonare, qui écrivaient, l’un au cinquième
siècle, l’autre au douzième. Ils parlent d’une solennité qui agita l’Italie
entière : la célébration des jeux Séculaires pour le millième anniversaire de
la fondation de Rome
Les événements du règne de Philippe notes sont à peu près inconnus.
L’Histoire Auguste, de Gordien III à Valérien, c’est-à-dire de 244 à
253, est perdue, et, pour remplir cette lacune, nous n’avons que les secs ou
douteux résumés de Zosime et de Zonare, qui écrivaient, l’un au cinquième
siècle, l’autre au douzième. Ils parlent d’une solennité qui agita l’Italie
entière : la célébration des jeux Séculaires pour le millième anniversaire de
la fondation de Rome 