HISTOIRE DES ROMAINS
ONZIÈME PÉRIODE — LES PRINCES AFRICAINS ET SYRIENS (180-235).
CHAPITRE XCIII — ALEXANDRE SÉVÈRE (11 MARS 22 2-19 MARS 23 5).
I. — RÉACTION CONTRE LE RÈGNE PRÉCÉDENT ; MAMMÉE ET ULPIEN ; LE CONSEIL DU PRINCE.Voilà donc, par la grâce des soldats, l’héritage d’Auguste encore une fois aux mains de deux femmes et d’un enfant. Quelle vitalité dans cet empire qui, tombé en quenouille, restait encore debout et imposant !
Du jour de son avènement, dit Hérodien[1], il fut entouré de tout l’appareil de la puissance souveraine ; mais le soin de l’empire fut remis aux deux princesses, qui s’efforcèrent de ramener les bonnes mœurs et la gravité antique. Elles choisirent seize sénateurs, les plus distingués par l’expérience et l’intégrité de la vie, pour former le conseil ordinaire du prince[2]. Rien ne s’exécuta que de leur avis. Le peuple, l’armée, le sénat, étaient charmés de cette forme nouvelle de gouvernement, qui remplaçait la tyrannie la plus insolente par une sorte d’aristocratie. Je ne sais si le sénat fut aussi satisfait que le dit Hérodien, de la nouvelle importance donnée au consilium principis qui préparait les décisions impériales. Nous reviendrons ailleurs sur cette institution, qui enlevait aux anciens maîtres de Rome leurs dernières attributions. Les pères conscrits se donnèrent du moins le plaisir de vouer aux dieux infernaux le prince ou le consul qui, à l’avenir, ferait siéger une femme dans l’auguste assemblée. Je suis assuré que ce sénatus-consulte leur parut aussi digne de mémoire que celui qui avait ordonné à Pyrrhus victorieux de sortir d’Italie[3]. On s’empressa, continue l’historien, de rendre à leurs sanctuaires les statues des dieux qu’Élagabal avait enlevées. On retira leurs places et leurs honneurs aux fonctionnaires qui les avaient indûment obtenus, et l’on confia les emplois aux citoyens les plus capables.... Afin de préserver le prince des écarts que pouvaient causer l’autorité absolue, l’ardeur de l’âge ou quelqu’un des vices naturels à sa famille, Mantinée gardait soigneusement l’entrée du palais et, n’y laissait pénétrer aucun homme décrié pour ses mœurs. Cette réaction contre le dernier règne, ces précautions pour sauver le nouveau des mêmes excès, étaient légitimes, et, puisqu’on avait. jugé bon de raire d’un enfant un empereur, il fallait le mener doucement des jeux aux affaires. On ne pouvait y mieux réussir que par ce gouvernement (le femmes âgées et de vieillards, par cette autorité paternelle et douce, dont le calme et la somnolence étaient propres à garantir une minorité, et à faire gagner au prince ses vingt-cinq ans, si les soldats consentaient à lui eu donner le temps. Dans le conseil impérial, Mammée avait appelé son compatriote Ulpien, qu’elle nomma préfet du prétoire[4], ce qui faisait de lui le second personnage de l’État. En réalité, vu l’âge de l’empereur, il en était le premier, car il assistait aux audiences du prince, lui rapportait les affaires, avec la solution à donner, et avait la conduite de tout le gouvernement. Sous ce grand jurisconsulte[5], la justice fut impartiale et la police vigilante. Ceux qui spéculaient sur la misère du peuple, la vénalité d’un juge ou la complaisance d’un fonctionnaire, eurent des comptes sévères à rendre ; mais personne ne perdit son bien ou la vie sans un jugement rendu après débats contradictoires[6]. Beaucoup de rescrits honnêtes furent promulgués. Ils n’ont pas apporté de modifications dans le droit, mais on avait la bonté prévoyante, qui est le caractère de ce règne[7] et que d’ailleurs nous avons déjà trouvée dans la législation des Antonins et de Sévère. On y parle même de la liberté des sujets : à la condition, il est vrai, qu’on soit assuré de leur bonne volonté et de leur obéissance[8]. L’habileté de ses sages conseillers se marque encore par des détails d’administration, dont quelques-uns eurent une véritable importance. La préfecture du prétoire devint d’ordre sénatorial : l’extension de la compétence judiciaire du préfet, qui avait parfois à juger des sénateurs, rendait ce changement nécessaire, et ses décisions eurent force de loi, quand elles ne furent pas contraires aux constitutions existantes[9]. Avec Ulpien, cette charge arriva à l’apogée de sa puissance Quatorze curateurs, tous consulaires furent chargés de décider, avec le préfet de Rome, de toutes les affaires concernant les quatorze quartiers de la ville[10]. Cet édit donnait un conseil municipal à la capitale de l’empire, dont la police avait été jusqu’alors soumise à la seule autorité du préfet ; il prescrivait, en outre, que les résolutions, pour être valables, seraient prises en présence de tous les membres, ou à tout le moins de la majorité d’entre eux. Ce conseil choisi, et non élu, n’en était pas moins pour Rome une garantie de meilleure administration. Les assesseurs des présidents obtinrent des honoraires, ce qui leur donna le caractère de fonctionnaires publics, mais augmenta les dépenses du trésor[11] ; et il fut interdit aux gouverneurs de province comme aux gens de leur entourage, de faire le négoce ou l’usure dans les pays de leur obédience. On a vu quelles sages recommandations Ulpien leur faisait pour la protection du menu peuple. Il était d’usage, depuis longtemps, de donner des terres aux vétérans : -on établit la règle que les officiers et les soldats mis en possession de domaines sur les frontières pourraient les transmettre à leurs enfants, quand ceux-ci suivraient le métier des armes : sinon, la terre revenait au fisc[12]. C’étaient des bénéfices militaires et le commencement d’un ordre nouveau de propriétés. La fonction de dux, c’est-à-dire de chef d’armée, sans commandement territorial, que nous avons vue poindre sous Sévère, paraît devenir une charge régulière[13]. Enfin le gouvernement constitua ce qu’on pourrait appeler des banques de dépôt[14], et il organisa en corporations les métiers qui n’avaient pas encore pris cette forme ; il assigna à chacune un defensor, comme on en donnera plus tard aux cités[15], et il établit pour elles une juridiction particulière. Quelques-unes étaient ? fort riches, celle des orfèvres par exemple, qui avait élevé un arc à Septime Sévère. C’était un ordre nouveau de l’industrie qui se produisait ou se développait. II. - DOUCEUR, PIÉTÉ ET FAIBLESSE D’ALEXANDRE SÉVÈRE.Quelle part revient au prince dans ces mesures ? Avec un empereur de treize ans, les conseillers avaient dû garder longtemps le pouvoir. Mais on peut dire que tout ce qu’ils firent dans l’intérêt des sujets répondait, sinon à la pensée, du moins au cœur du prince.
.... In sanctis quid facit aurum ? Mais il était libéral avec les pauvres, avec ses amis, avec ceux de ses officiers qui avaient bien rempli leur charge. On se souvient de la grande institution alimentaire de Trajan : il la continua en l’étendant[18] et il en fonda une autre ; il prêta de l’argent à des familles pauvres pour qu’elles pussent acheter de la terre et ne leur demanda qu’un intérêt de 3 pour 100 payable sur les produits du fonds[19]. Souvent même il donna gratuitement une terre, des esclaves, du bétail et des instruments d’agriculture. S’il augmenta la taxe sur les industries de luxe, sur les orfèvres[20], doreurs, pelletiers, etc., il diminua les autres impôts, et se plaignit que les agents du fisc fussent un mal nécessaire. Il accorda des remises à quantité de villes, à condition que l’argent qu’il leur laissait servit à relever leurs édifices ruinés ; il restaura, à ses frais, beaucoup d’anciens ponts et en construisit de nouveaux. Enfin il fonda des écoles, paya des professeurs, pensionna des élèves, récompensa les avocats qui ne prenaient rien de leur partie[21] : ce sont nos bourses de scolarité et notre assistance judiciaire. Pour lui-même, une grande frugalité et beaucoup d’économie, au point de se réduire à emprunter de la vaisselle d’argent et des esclaves, lorsqu’il donnait un festin d’apparat ; envers tous, plébéiens ou sénateurs, même envers ses gens, une affabilité qui, dans l’empereur, ne laissait pas voir le maître. A vingt ans c’était un sage. Cette sagesse, qui n’était pas le fruit de l’expérience, mais un don de nature, cette bonté, qui se montrait en tout, font honneur à l’homme : au prince, on demande autre chose. Sa tendresse filiale était de la faiblesse, quand il n’osait résister à sa mère qui, troublée par tant de catastrophes, cherchait, en thésaurisant[22], une garantie contre les mauvais jours ; comme si, pour elle et son fils, en cas de défaite, il y avait d’autre refuge que la mort. Cette faiblesse devint même un jour odieuse, si, comme le conte Hérodien, il permit que Mammée chassât du palais sa jeune épouse, qui réclamait les honneurs d’une augusta, et qui les méritait[23] ; s’il laissa tuer son beau-père, coupable de s’être plaint aux justiciers du temps, les soldats du prétoire, des outrages qu’il avait reçus de l’impératrice[24]. Son regret de ne pouvoir supprimer tous les impôts est une
parole de femme ou de courtisait du populaire, et son amour pour On vante encore la pensée pieuse qui lui faisait mettre, dans son lararium, Apollonius de Tyane à côté de Jésus, Orphée auprès d’Abraham : vague religion de l’humanité, dont, cependant, les confuses aspirations suffiront à quelques âmes d’élite. Saint Augustin a connu une matrone qui, elle aussi, avait construit un édicule où elle brûlait de l’encens devant les images de Jésus et de Paul, d’Homère et de Pythagore[25]. Ces hommages il la sainteté et au génie honorent l’individu, mais ce n’était pas avec une aussi simple croyance qu’on pouvait mener (les peuples avides de merveilleux. Comme le prince dont il avait le nom et les vertus, le
jeune empereur aurait été dans la vie privée le premier des hommes ; au
souverain pouvoir, il fut, bien plus que Marc Aurèle, insuffisant. C’est que
le gouvernement des choses humaines est une tâche virile. Les grands hommes
sont les hommes de commandement, ceux qui peuvent comprendre et qui savent
vouloir. Ces qualités étaient surtout nécessaires dans un État tel que l’empire
romain, et, il faut bien le reconnaître, Alexandre Sévère ne les avait pas.
Son buste du Louvre, aux traits mous et indécis, fait songer à un débonnaire,
incapable d’agir et qui semble regarder sans voir. Julien, dans les Césars,
le montre tristement assis sur les degrés qui menaient à la salle où allaient
banqueter les empereurs et les dieux ; Silène se moque de lui et de sa mère,
la thésauriseuse ; Durant quelques années, la soldatesque assouvie avait laissé l’empire paisible. Mais, pour conserver la discipline parmi ces hommes grossiers, avides et violents, qui connaissaient leur force et ne connaissaient plus l’empire, ni les magistrats, ni la loi, il aurait fallu un prince qui leur imposât une crainte respectueuse, en même temps que l’obéissance, qui les tint sous le harnais, les rassasiât de butin et de gloire, c’est-à-dire d’orgueil. Avec sa puissante armée de mercenaires, l’empire était condamné à n’avoir plus pour chefs obéis que de grands généraux. Sévère l’avait été : Alexandre ne l’était pas. Aussi l’ordre civil, que le premier avait protégé contre ses soldats, ne put l’être par le second. On dit qu’avant de renoncer à la philosophie et aux arts, il avait consulté les sorts virgiliens, et que le poète-prophète avait répondu par les vers fameux : Excudent
alii spirantia mollius æra. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tu
regere imperio populos, Romane memento. Lampride donne à son héros les qualités que ces vers exigent pour l’exercice de la souveraine puissance ; il fait de lui un défenseur farouche de l’ancienne discipline. Les soldats, dit-il, l’avaient appelé Sévère à cause de son excessive rigueur[26], et, comme preuve, il montre les populations accourues sur le passage de l’armée, qui prenaient les soldats pour des sénateurs[27] en voyant la gravité de leur tenue et la sagesse de leur conduite ; ou bien il cite certaines réminiscences classiques que le prince utilisait. Un sénateur connu pour ses rapines vient le saluer à la curie ; Alexandre renouvelle contre lui l’apostrophe de Cicéron à Catilina : O tempora, o mores ! vivit, imo in senatum venit ! Une légion se mutine ; il lui jette le mot de César : Retirez-vous, Quirites. Quelques officiers, qui n’avaient pas su tenir leurs soldats, furent, il est vrai, mis à mort, mais au bout d’un mois la légion coupable était rétablie. On parle aussi de troupes décimées. Les faits suivants ne permettent pas de donner à ce règne un tel caractère de sévérité. Une querelle s’éleva dans Rome entre les bourgeois et les prétoriens. Les uns et les autres se valaient[28] ; mais, pour que la populace osât affronter la troupe, il fallait qu’elle eût été poussée à bout par bien des insolences, et nous savons que les soldats ne s’en faisaient point faute. On se battit trois jours, et il y eut beaucoup de morts. A la fin, les prétoriens, chassés des rues, mirent le feu aux maisons ; l’incendie allait gagner la ville entière, quand les deux partis consentirent à s’arrêter. On ne sait quel fut dans cette affaire le rôle du gouvernement ; mais on a le droit de dire que de tels désordres ne se produisent que sous une autorité chancelante, et l’on peut se demander ce que faisaient les légionnaires des provinces, quand les prétoriens, si affectionnés au jeune prince, se conduisaient de cette manière en face de lui. Mammée avait d’abord mis à la tête des prétoriens deux capitaines expérimentés, Flavianus et Chrestus ; plus tard, elle leur avait encore donné Ulpien pour collègue. Ces gens de guerre n’aimaient pas il trouver au prétoire des hommes de loi qui, y portant les habitudes régulières des magistrats, faisaient exécuter les ordonnances. Le nouveau préfet déplut aux cohortes et à leurs chefs qui formèrent le projet de se débarrasser de lui[29]. Ulpien les prévint en faisant tuer les deux préfets et leurs complices. Cette tragédie en provoqua une autre. Tout le corps prit parti pour les victimes, Ulpien fût plusieurs fois en danger de mort. Dans une dernière et formidable émeute, il s’était réfugié au palais : les soldats en forcèrent les portes et l’égorgèrent aux pieds d’Alexandre, qui le couvrait vainement de sa pourpre impériale[30] (228). On se croirait déjà aux rives du Bosphore entendant les janissaires réclamer la tête d’un vizir. Un certain Epagathos, ancien homme de confiance de Caracalla et de Macrin, avait joué un rôle dans cette catastrophe en animant les soldats contre Ulpien. Ce n’était qu’un affranchi : on n’osa pourtant le punir, de peur d’exciter une nouvelle émeute. Il fut chargé d’une mission en Égypte, puis rappelé, sous un prétexte, en Crète, où l’exécuteur l’attendait[31]. Cette justice de sérail prouverait à elle seule l’incurable faiblesse de ce gouvernement. Le récit suivant de Dion en est un autre indice. Notre historien n’était pas un foudre de guerre et, à l’armée, il a dû ne jamais prendre de résolutions bien viriles. Cependant, lorsqu’il revint de son gouvernement de Pannonie, les prétoriens trouvèrent qu’il s’y était montré trop sévère pour la discipline. Ils demandèrent mon supplice, dit-il, craignant qu’on ne les soumit à un régime semblable. Au lied de faire attention à leurs plaintes, l’empereur me donna le consulat. Mais l’irritation des prétoriens lui fit craindre qu’en me voyant avec les insignes de cette dignité, ils ne me tuassent, et il m’ordonna de passer hors de Rome, dans quelque endroit de l’Italie, le temps de ma charge[32]. Le prudent consulaire fit mieux : trouvant que la vie publique devenait trop difficile, il abandonna Rome, l’Italie même son grand livre d’histoire, qu’il ferma sur ce dernier récit et sur ce vers d’Homère : Jupiter déroba Hector aux traits, à la poussière du carnage, au sang et au tumulte des combats[33]. Dion n’avait rien de commun avec Hector, mais c’était bien d’une mêlée sanglante qu’il se retirait. Nous quittons ici un pâle écrivain, mais un homme qui, ayant étudié la république dans sa grandeur et dans sa décadence, l’empire sous Auguste et sous Néron, sous Hadrien et sous Commode, avait pu suivre l’enchaînement logique de cette histoire se déroulant, à travers les siècles, sous la double action de la sagesse politique et des nécessités produites par les circonstances. Si nous cherchons quels étaient ses sentiments en fait de gouvernement[34], nous verrons que, malgré les actes de cruauté qu’il avait racontés, malgré ceux dont lui-même avait été le témoin et faillit être la victime, Dion était grand partisan de la monarchie impériale. Quand l’empereur était mauvais, on souhaitait le changement du prince, on ne souhaitait pas un changement de régime. Personne alors n’imaginait autre chose, et, il faut bien le reconnaître, nulle autre chose n’était possible. Dion ne demande au prince que de s’entendre avec le sénat, sou conseil. C’était déjà le vœu de Tacite, et ce fut la pratique des Antonins. Malheureusement, depuis Caracalla, et de jour en jour davantage, prince et consuls, préfets du prétoire et sénateurs, tous étaient à la merci des soldats, et le caractère d’un tel régime est la fréquence des émeutes. Des séditions, en effet, éclataient partout ; quelques-unes, dit un contemporain, furent très redoutables[35] ; et il fallut casser des légions entières[36] ; celles de Mésopotamie tuèrent leur chef Flavius Héracléon et firent un empereur, qui, pour leur échapper, se jeta dans l’Euphrate et s’y noya. Un autre prit la pourpre dans l’Osrhoëne. Un troisième essaya de la prendre à Rome même. Pour ce dernier, l’empereur, averti, l’invite au palais, le mène au sénat, à l’armée, l’accable d’affaires et le brise de fatigue. Au bout de quelques jours l’ambitieux demande par grâce à retourner dans sa maison et son obscurité. Ces séditions et ces tentatives avortent, mais l’empire en
est ébranlé, et l’ennemi y trouve un encouragement. Dans III. — LES ARSACIDES.Depuis le jour où Arsan le Brave s’était révolté contre les Séleucides, quatre cent soixante-dix années[37] s’étaient écoulées, durée bien longue pour une dynastie orientale. La monarchie parthique s’était étendue de l’Euphrate à l’Indus, mais les Arsacides, hommes de ruse ou de force, suivant l’occasion, n’eurent rien du génie organisateur de Rome. Ils n’établirent ni une armée permanente, par conséquent régulière, ni une administration reliant les diverses parties de l’État de manière à en former, au profit de l’autorité royale, un tout homogène. Ils laissèrent subsister autour d’eux une féodalité puissante[38], cause de troubles continuels, et, dans leurs provinces, des populations qui, n’ayant de commun avec le reste de l’empire que le tribut payé au grand roi, gardèrent leurs coutumes, leurs souvenirs et leurs chefs nationaux, c’est-à-dire l’espérance et le moyen de retrouver un jour l’indépendance. Les affronts qu’infligèrent à la monarchie parthique Trajan, Avidius Cassius et Septime Sévère, même Caracalla, avaient détruit son prestige, que le traité avec Macrin ne rétablit pas. Dans les monts de Les monarchies orientales s’établissent avec la même
rapidité qu’elles s’écroulent. En quelques années, les montagnards de La révolution qui venait de s’accomplir était religieuse
autant que politique. Les Arsacides, subissant l’influence de la civilisation
qu’Alexandre avait portée dans l’Asie occidentale, s’étaient hellénisés. Ils
aimaient les usages de En retour de l’assistance que lui donnaient ces prêtres, Ardeschir leur accorda une grande influence. Il remit, dit un historien grec, les mages en honneur[43]. Ce clergé, redevenu puissant, fera de l’intolérance la loi politique des Sassanides et déchaînera la persécution contre les chrétiens ; mais aussi le zèle religieux et national de ces princes donnera à la nouvelle dynastie une vitalité, un éclat, que la précédente n’avait pas eus[44]. Le danger pour l’empire romain augmentant de ce côté, il sera forcé de dégarnir la ligne du Rhin et du Danube afin de fortifier celle de l’Euphrate et du Tigre, et, pour veiller de plus près sur cet ennemi nouveau, il finira par déplacer le centre de sa puissance, en reportant sa capitale de l’Occident à l’Orient. La guerre de quatre siècles qui va commencer entre les deux empires est donc encore une de ces guerres comme le zèle religieux en a tant allumé. Elle se caractérise à son origine, chez les deux peuples, par un retour aux souvenirs de l’expédition d’Alexandre : d’un côté, admiration et confiance ; de l’autre, haine et malédiction. On a vu Caracalla honorer la mémoire du héros macédonien, le second Sévère prendre son nom, et les légions s’organiser en phalange. Il semblait que l’ombre du conquérant grec allait marcher devant l’armée romaine pour la guider sur la route de Ctésiphon. Au delà du Tigre, cet Alexandre dont nous avons l’habitude de célébrer l’âme généreuse était devenu pour les mages, dans leur patriotique et religieuse douleur, le maudit qui égorgea les nobles et les prêtres, qui brûla les livres de la révélation et qui brûle à son tour dans les flammes éternelles. Aujourd’hui encore les Parsis ne parlent d’Iskander le Roumi que comme d’un abominable tyran. Après lui, disent-ils, la religion fut à bas et les fidèles dans l’oppression, jusqu’à ce que le roi Ardeschir eut rétabli la vraie foi[45]. Ces sentiments contraires annoncent la grandeur de la lutte qui va s’engager. IV. — EXPÉDITIONS CONTRE LES PERSES ET LES GERMAINS ; MORT D’ALEXANDRE SÉVÈRE.Avant de se prendre corps à corps avec le grand empire
occidental, le fils de Sassan tourna ses armes contre les peuples voisins de A cette nouvelle, Alexandre et ses pacifiques conseillers
écrivirent au Perse une belle lettre, pleine des plus édifiantes
recommandations. Les ravages continuèrent ; Nisibe fut assiégée, et les
coureurs ennemis pénétrèrent jusque dans Ici, les récits diffèrent. Selon un contemporain, l’empereur
divisa ses forces en trois corps : le premier prit par l’Arménie, pays allié
des Romains, pour pénétrer chez les Mèdes ; le second, par le désert, pour
atteindre le confluent du Tigre et de l’Euphrate et menacer directement A vrai dire, il n’y avait point de vaincus. Les Perses
pouvaient se glorifier d’un grand succès, mais Le second récit est, pour les Romains un chant de triomphe. Extrait des actes du sénat, du septième jour des calendes d’octobre ; discours du prince : Pères conscrits, nous avons
vaincu les Perses. Un long discours est inutile ; il importe seulement que
vous sachiez quels étaient leurs forces et leurs préparatifs. Ils avaient
sept cents éléphants portant des tours remplies d’archers. Nous en avons pris
trois cents ; deux cents ont été tués sur place ; nous en avons conduit ici
dix-huit. Ils avaient raille chariots armés de faux ; nous aurions pu en
amener deux cents dont les chevaux ont péri ; mais nous né l’airons pas cru
nécessaire, parce qu’il eût été facile de vous en présenter d’autres. Nous
avons défait cent vingt mille cavaliers, et tué, durant la guerre, dix mille
de leurs cataphractaires[48]. Nous avons pris un grand nombre de Perses, que nous
avons vendus. Nous avons reconquis tout le territoire qui est entre les deux
fleuves, Le lendemain, en mémoire de ce grand succès, un congiaire fut donné au peuple et l’on célébra des jeux Persiques. Les dix-huit éléphants qu’on y montra firent croire aux trois cents qu’on prétendait avoir pris[49]. Il ne fallait donc pas en douter : Rome venait de renouveler la gloire de Sévère et de Trajan[50]. Rome, du moins, avait besoin de faire croire à ce bulletin
de victoire. Plusieurs mois furent employés à réorganiser les forces de
l’Occident, et en 234
[51] Alexandre partit
pour Alexandre avait régné treize ans, mais n’en avait que vingt-six[53]. Il est le dernier des princes syriens. Si parmi eux l’on compte Sévère, à cause de l’influence exercée sur lui pat : Julia Domna, cette dynastie avait tenu l’empire plus de quarante années : court espace de temps qui fut marqué par de grands événements et de sanglantes tragédies, mais durant lequel acheva de disparaître ce qui restait de sang et d’esprit romains. N’étaient les jurisconsultes, qui conservaient la science romaine par excellence, on se croirait, par les mœurs et par les croyances, dans une monarchie asiatique. L’empire penche à l’Orient, et bientôt il s’y perdra. Le respect d’Alexandre pour Abraham et Jésus, les anciennes relations de sa mère avec Origène, l’avaient rendu favorable aux juifs et aux chrétiens[54]. Ceux-ci jouirent sous son règne d’une paix profonde et d’une sorte d’existence légale. Dans une contestation que l’Église de Rome eut avec des cabaretiers au sujet d’un terrain public, il prononça en faveur dés chrétiens : Mieux vaut, dit-il, que cet endroit devienne un lieu de prière qu’un lieu de débauches[55]. La manière dont l’Église procédait à ses élections sacerdotales l’avait frappé, et il songea un moment à l’imiter pour les fonctions d’État[56]. De cette pensée il ne resta, comme on l’a vu, que l’invitation faite au peuple de dénoncer les fautes des candidats proposés pour les emplois. Lampride prétend qu’Alexandre voulait bâtir un temple au Christ, le mettre au rang des dieux, et que les prêtres l’en détournèrent en déclarant, sur la foi des livres sacrés, que, s’il exécutait ce projet, les autres temples seraient abandonnés[57]. Cela pouvait être dit à Constantin, mais n’a pu l’être au fils de Mammée, les chrétiens n’étant pas alors assez nombreux pour inspirer cette crainte. Toutefois ils profitèrent de la tolérance d’Alexandre pour bâtir leurs premières églises, qui sont, peu de temps après, mentionnées par Origène[58]. De Mammée on a fait aussi une chrétienne ; singulière
chrétienne que cette impératrice appelée sur ses monnaies Le règne de ce jeune et malheureux prince, à qui, malgré sa faiblesse, nous devons accorder une estime particulière, fut donc le moment où le passé et l’avenir, les deux grandes forces sociales, auraient pu se rapprocher sans se confondre et vivre en paix jusqu’à ce que la transformation s’opérât[62]. Une conciliation de fait n’était pas impossible entre l’empire devenu dédaigneux de ses vieilles divinités et un christianisme qui eût été respectueux de l’ordre établi. L’un acceptant comme règle de gouvernement la tolérance religieuse ; l’autre, satisfait de la liberté qui lui était laissée, continuant à gagner paisiblement les âmes, mais ne gagnant pas violemment le pouvoir, faisant la conquête du monde à titre de vérité morale et non pas en parti victorieux qui s’établit de force dans les positions doit il précipite ses adversaires. Malheureusement les révolutions de ce monde ne s’accomplissent pas avec cette sagesse. L’esprit de Tertullien a remplacé dans l’Église celui de Clément, et dans l’État les violents vont aussi succéder aux pacifiques. Des deux côtés, on emploiera la force : Dioclétien au nom des dieux ; les successeurs de Constantin au nom du Christ, et l’empire chancellera sur sa base. |
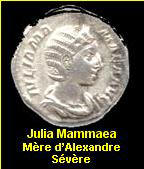 Mais ces deux femmes étaient d’un esprit supérieur. Nous
connaissons l’habile prudence de Mæsa et l’esprit élevé de la mère d’Alexandre.
Celle-ci développa, par une éducation bien conduite, les heureuses
dispositions de cette âme douce et pieuse. Elle entoura son fils des maîtres
les plus habiles, à la condition qu’ils fussent aussi les plus honnêtes, et
elle lui fit apprendre assez de littérature et d’art pour qu’il en eût le
goût et qu’il les honorât : pas assez pour qu’il fût tenté d’y donner le
temps dû aux affaires publiques. On remarquera qu’Alexandre s’exprimait plus
facilement en grec qu’en latin. Cette invasion du grec dans la haute société
romaine est le signe des progrès accomplis par une autre invasion, celle de l’hellénisme
oriental et du syncrétisme alexandrin, dont ce prince fut aussi un des
représentants.
Mais ces deux femmes étaient d’un esprit supérieur. Nous
connaissons l’habile prudence de Mæsa et l’esprit élevé de la mère d’Alexandre.
Celle-ci développa, par une éducation bien conduite, les heureuses
dispositions de cette âme douce et pieuse. Elle entoura son fils des maîtres
les plus habiles, à la condition qu’ils fussent aussi les plus honnêtes, et
elle lui fit apprendre assez de littérature et d’art pour qu’il en eût le
goût et qu’il les honorât : pas assez pour qu’il fût tenté d’y donner le
temps dû aux affaires publiques. On remarquera qu’Alexandre s’exprimait plus
facilement en grec qu’en latin. Cette invasion du grec dans la haute société
romaine est le signe des progrès accomplis par une autre invasion, celle de l’hellénisme
oriental et du syncrétisme alexandrin, dont ce prince fut aussi un des
représentants.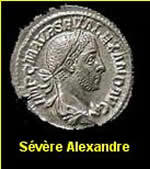 Le biographe d’Alexandre a voulu faire de ce règne ce que
Xénophon avait fait de celui de Cyrus, une belle moralité, et, quoique
ce scribe de Constantin n’eût pas encore embrassé la religion de son maître,
il a, pour le flatter, représenté le moins païen des empereurs comme à demi
chrétien. Il en est résulté qu’Alexandre a été l’enfant gâté de l’histoire,
comme si, au sortir de l’atmosphère viciée où l’on venait de vivre et avant d’entrer
dans les ténèbres sanglantes de l’âge suivant, on s’était arrêté avec
complaisance sur cette douce figure, que la jeunesse, la vertu et le malheur
ont consacrée. A certains égards, cette bonne renommée d’Alexandre est
légitime. Après les saturnales du dernier règne, il montra un empereur pur
dans ses mœurs, simple dans ses goûts et qui faisait de sa vie une censure
publique plus efficace que toutes les dispositions légales. On s’attache à ce
prince aimable qui voulait que le crieur public proclamât, tandis qu’on
châtiait les criminels, ces mots gravés au frontispice de son palais :
Le biographe d’Alexandre a voulu faire de ce règne ce que
Xénophon avait fait de celui de Cyrus, une belle moralité, et, quoique
ce scribe de Constantin n’eût pas encore embrassé la religion de son maître,
il a, pour le flatter, représenté le moins païen des empereurs comme à demi
chrétien. Il en est résulté qu’Alexandre a été l’enfant gâté de l’histoire,
comme si, au sortir de l’atmosphère viciée où l’on venait de vivre et avant d’entrer
dans les ténèbres sanglantes de l’âge suivant, on s’était arrêté avec
complaisance sur cette douce figure, que la jeunesse, la vertu et le malheur
ont consacrée. A certains égards, cette bonne renommée d’Alexandre est
légitime. Après les saturnales du dernier règne, il montra un empereur pur
dans ses mœurs, simple dans ses goûts et qui faisait de sa vie une censure
publique plus efficace que toutes les dispositions légales. On s’attache à ce
prince aimable qui voulait que le crieur public proclamât, tandis qu’on
châtiait les criminels, ces mots gravés au frontispice de son palais : 