HISTOIRE DES ROMAINS
SEPTIÈME PÉRIODE — LES TRIUMVIRATS ET LA RÉVOLUTION
(79-30)
CHAPITRE LV — L’INTÉRIEUR DE ROME PENDANT LE PROCONSULAT DE CÉSAR (58-49).
I. — CLODIUS, CICÉRON ET MILON.Neuf ans auparavant, Rome avait vu partir par la voie
Flaminienne cet élégant débauché qui mêlait le plaisir aux préoccupations les
plus graves[1],
et qui semblait s’inquiéter autant des plis de sa toge que du succès d’une
affaire. Nul n’avait cru qu’avec ce corps usé par les excès et les travaux,
il pourrait résister aux fatigues d’une longue guerre. Mais un jour on avait
appris qu’il avait battu quatre cent mille Helvètes et cent vingt mille
Suèves, puis lés Belges et les Armoricains ; une autre fois, qu’il avait
franchi le Rhin et porté les aigles romaines jusque dans Il fallait donc oublier celui que les oisifs du lac Curtius appelaient l’ami complaisant de Nicomède et le complice de Catilina, pour reconnaître enfin le grand général qui mettait aux pieds de Rome, sans l’avoir un instant distraite de ses plaisirs, cette race gauloise, dont le turbulent courage avait si longtemps troublé l’ancien monde. Trente batailles, où trois millions d’hommes avaient combattu, valaient bien les équivoques victoires de Pompée et ses lauriers glanés sur les pas de tant de rivaux moins heureux. Tandis qu’aux moyens d’influence que nous lui connaissons déjà, César ajoutait le plus puissant de tous, le prestige de la gloire, qu’était devenue la république ? Pour bien comprendre ces temps déplorables et juger équitablement les acteurs, il faut regarder dans ce chaos impur d’ambitions sans portée, de vices sans éclat, de crimes sans but, où le peuple est représenté par des gladiateurs et quelques mendiants avinés, le sénat par des vieillards tremblants[3], les lois par des marchés, la liberté par des émeutes ; temps odieux qui nous gâtent Cicéron, Caton même, et où les chefs du sénat, ainsi que ceux du peuple, se dégradent et s’abaissent comme pour laisser mieux voir le maître inévitable dont l’image, malgré l’éloignement, est présente et semble chaque gour grandir à l’horizon. Nous avons laissé Clodius maître du Forum de l’aveu des
triumvirs. Mais ce personnage était trop ambitieux pour se contenter
longtemps de servir d’instrument à l’ambition d’autrui. En mettant aux
enchères sa faveur et l’influence que sa charge lui donnait, en vendant à
Menula d’Anagni l’impunité, à Brogitarus le riche sacerdoce de Il y avait cependant trop d’audace à vouloir lutter à la fois contre César et contre Pompée. Celui-ci écrivit à son allié des Gaules pour savoir ce qu’il pensait du rappel de Cicéron[5], et un tribun désigné, Sextius, porta la lettre[6] : double preuve de l’entente qui existait encore entre les deux puissants personnages, et de la grande situation que César conservait à Rome, où Pompée, le sénat et le collège des tribuns n’osaient rien faire de considérable avant de s’être assurés de son assentiment. César cessa de s’opposer au retour de l’orateur, qu’il croyait résigné, après cette rude épreuve, à ne plus se croire l’homme nécessaire ; et les triumvirs ne laissèrent arriver aux charges, pour l’année suivante, que des adversaires de Clodius. Le 1er janvier 57, les nouveaux consuls[7] ayant demandé le rappel de Cicéron, le sénat rendit le décret le plus honorable pour l’exilé ; mais, quand le projet de loi fut porté devant l’assemblée publique, Clodius et les siens empêchèrent le vote. Cicéron conseilla de le battre avec ses propres armes. Il y avait alors au banc des tribuns un individu sans talent, trais aussi sans scrupule, homme de main, criblé de dettes et qui ne pouvait échapper à ses créanciers qu’en obtenant une province à piller. Pour cela, il fallait être d’un parti ; il se donna à Pompée, et les amis de Cicéron lui fournirent les moyens d’enrégimenter, comme Clodius, une bande de gladiateurs et de spadassins. Telle était l’impuissance des lois et des magistrats, que
rien ne se fit plus que sous la protection de l’une ou de l’autre de ces deux
bandes de brigands armés. Maintes fois elles en vinrent aux mains. Dans une
de ces rencontres, Quintus, le frère de Cicéron, gravement blessé, n’échappa
qu’en se cachant sous des cadavres ; un tribun faillit être tué. Afin de
rejeter sur leurs adversaires l’odieux de cet attentat, les amis de Clodius
voulaient égorger un autre tribun, leur partisan, puis accuser Milon de ce
meurtre. Tel fut le nombre des morts, que les
cadavres encombrèrent le Tibre, qu’ils remplirent les égouts, et que le Forum
fut inondé de sang[8]. Les sénateurs
appelèrent à Rome beaucoup d’Italiens ; ils défendirent d’observer le ciel,
que chaque parti faisait parler suivant ses besoins, et Milon contenant
Clodius avec ses gladiateurs, la loi du rappel passa. Après dix-sept mois d’absence,
Cicéron rentra dans Rome, porté, dit-il, sur les bras de toute l’Italie. A
quoi Vatinius répondait : Mais si l’Italie t’a
rapporté sur ses épaules, d’où viennent donc tes varices, unde ergo tibi
varices ? ( Quels étaient les sentiments, les desseins de cet homme pour qui, durant six mois, le sénat avait suspendu toute affaire ? Cette confiance qu’il avait naguère en lui-même et dans les institutions de son pays, le triumvirat l’avait affaiblie, son exil la ruina. Dans le malheur, toute sa philosophie lui avait été inutile, et il était tombé dans un grand abattement. Puis-je oublier, répétait-il à ses amis, ce que j’étais et ce que j’ai perdu ?[9] Rutilius avait donné un autre exemple. Depuis ce temps, sa conduite cessa d’être à la hauteur du rôle qu’il avait joué six ans auparavant et qu’il ne reprit, pour quelques jours, qu’au lendemain de la mort de César. Après tout, que pouvait-il, lui, homme nouveau, sans liens de famille avec l’aristocratie, et à qui les grands reprochaient durement son origine[10] ? Son plan de conciliation universelle avait échoué comme celui de Drusus. Les hommes d’argent, qui s’étaient serrés autour de lui dans un moment où toutes les fortunes semblaient menacées, allaient maintenant là où leur intérêt les appelait, vers ceux qui réglaient à leur gré les travaux publics et les tributs des provinces. Les ordres, les comices, le sénat ! vains mots, formes vides, souvenirs effacés d’une république qui n’existait plus. Le droit, c’était la force[11] ; et la force était à celui qui osait le plus. Cicéron, admirablement doué pour les luttes pacifiques des temps tranquilles, n’avait point assez d’audace pour attaquer de front les puissants du jour. Contre Catilina il avait été énergique et résolu, parce qu’un grand parti le soutenait et que la cause était gagnée d’avance. Aujourd’hui que le drapeau qu’il avait levé alors ne ralliait, plus personne, il comprenait que, dans une république guerrière qui finit, l’éloquence peut donner un instant le pouvoir, mais que ce sont les armes qui l’assurent. Il trouvait que les grands n’avaient pas pour son ennemi Clodius une haine assez vigoureuse, et qu’ils lésinaient sur l’indemnité pour ses maisons abattues ou billées. Je vois bien, écrivait-il tristement[12], que je n’ai été qu’un sot[13]. Aussi, dans son esprit découragé, le soin de ses intérêts remplaça les préoccupations politiques, et celui que le sénat et le peuple avaient proclamé le père de la patrie se fit le lieutenant de Pompée et l’agent de César !
Milon sorti du tribunat, Clodius se fit élire à l’édilité, ce qui suspendait toute poursuite contre lui, et, à son tour, il accusa Milon. Pompée le défendit ; mais Clodius ameuta la foule autour du tribunal et infligea au malencontreux avocat les plus sanglantes moqueries. Il faut lire cette scène dans les lettres de Cicéron pour bien savoir où en étaient la république et la liberté. Pompée parla, ou plutôt essaya de le faire, car, dès qu’il se leva, la bande de Clodius commença ses clameurs, et tout le long du discours ce ne furent que vociférations et injures. Quand il eut fini, Clodius, à son tour, voulut parler ; mais les nôtres lui rendirent la pareille, et avec un tel bruit, qu’il en perdit les idées et la voix. Deux heures durant on fit pleuvoir sur lui les injures, les vers obscènes ; de son côté, il criait aux siens, au milieu du tumulte : Qui veut faire mourir le peuple de faim ? et la bande répondait : Pompée ! — Qui veut se faire envoyer à Alexandrie ? — Pompée ! A la fin on en vint aux coups. Représentez-vous notre grave personnage, avec sa vanité solennelle et ses airs de triomphateur, recevant en plein visage, au milieu de tels tumultes, ces épigrammes acérées : il en souffrait cruellement. Une autre affaire augmenta sa mortification. Ptolémée
Aulète, chassé par les Alexandrins, était venu à Rome, comptant, pour
recouvrer sa couronne, sur l’appui de César, qu’il avait déjà payé, et sur
celui de Pompée, qui le logea dans sa maison. Se sentant chaque jour
descendre dans l’opinion, Pompée, pour sortir par quelque brillante
expédition d’une situation ingrate, désirait qu’on le chargeât de rétablir le
prince. Les Égyptiens écrasés d’impôts par Aulète, députèrent à Rome cent
ambassadeurs pour plaider leur cause. Les uns furent tués en route, les
autres achetés. Un d’eux, qui voulait tout révéler, fut assassiné. Pompée n’en
continua pas moins sa protection à l’hôte indigne, mais sans réussir à se
faire désigner pour le ramener dans son royaume. Un sénatus-consulte donna
cette mission au gouverneur de Clodius essaya de faire servir ces présages à deux fins en les tournant aussi contre Cicéron. Les dieux étaient offensés, disait-il, de la profanation d’un terrain qu’il avait consacré a une déesse. L’orateur répondit. Mais des deux côtés on se lassa des cette lutte hypocrite dont le ciel faisait les frais ; on en revint aux coups, aux violences, et Cicéron, soutenu de Milon, brisa dans le Capitole les tables d’airain où étaient gravés les actes du tribunat de Clodius. L’ancien consul devenait, lui aussi, au milieu de la cité, un chef de bande, et il encourait les reproches sévères de Caton, qui revenait alors de Chypre ; dans une de ces bagarres, le grand orateur Hortensius faillit être tué[16]. Cette mission de Chypre, honorable pour Caton, qui l’avait
acceptée malgré lui et qui y montra son intégrité, ne l’était pas pour Rome.
Sous prétexte que le roi de Chypre, un frère d’Aulète, avait été de
connivence avec les pirates, on lui ordonna, bien qu’il eût reçu le titre d’ami
du peuple romain, de descendre du trône. Caton lui offrit en dédommagement le
riche sacerdoce de Mais il était trop Romain pour que, le premier ennui de l’injustice
à commettre une fois passé, il n’ait pas tenu à ce que l’on ratifiât les
résultats de sa mission qui avait accru l’empire d’une province et l’ærarium d’un trésor. Or Cicéron voulait faire
invalider tous les actes du tribunat de Clodius, comme accomplis malgré les
auspices, et la légation de Caton en Chypre était un de ces actes. De là le
refroidissement entre Cicéron et lui. Chacun ne regardant qu’à ses intérêts
personnels et se conduisant d’après ses amitiés ou ses haines, il semblait qu’il
n’y eût même plus de parti politique. Le vrai maître de Rome en cette année
56 était l’édile Clodius, et qui pourrait dire ce que Clodius voulait ?
Pompée, menacé par lui et attaqué par Caton, ne savait plus ni que faire ni
que dire. Il avait peur d’être assassiné ; il n’osait se risquer dans les
rues de Rome et n’allait ait sénat que si l’assemblée se tenait prés de sa
demeure. On en veut à ma vie,
disait-il à Cicéron[17], Crassus soutient C. Caton, qui machine des procès contre
mes amis. On fournit de l’argent à Clodius, on excite contre moi Bibulus,
Curion et bien d’autres. Il est temps, si je ne veux pas périr, que je
pourvoie à ma sûreté, abandonné que je suis par ce peuple qui n’a d’oreilles
que pour les bavards, par une noblesse ennemie, un sénat injuste et une
jeunesse dépravée. Aussi je vais appeler à moi les gens de la campagne.
Et Cicéron ajoute : Clodius prépare sa bande,
mais nous avons jusqu’à présent l’avantage dit nombre, et nous attendons des
recrues du Picenum et de Ainsi de vraies batailles remplaçaient les discussions législatives, et l’orateur si souvent heureux à la tribune se promettait merveille, non plus de son éloquence, niais de la vigueur de ses recrues : le vote était, à ceux qui avaient les meilleurs poings ; de sorte qu’on voit bien ce que faisait la violence, mais qu’on ne voit plus où était la liberté. Comme elles sont belles ces paroles de Cicéron : Legum omnes servi sumus, ut liberi esse possimus ! Mais tout le monde voulait être le maître de la loi, et personne n’en était le serviteur. Une autre chose se dégage nettement de l’ensemble des faits qu’on vient de lire : l’impopularité croissante de Pompée auprès du sénat comme auprès du peuple : par conséquent la nécessité pour lui de se rapprocher du tout-puissant conquérant des Gaules, et l’obligation de subir ses conditions en échange de son concours. Tel est le secret de la conférence de Lucques et l’explication des événements de l’année 55, où le sort de Rome fut décidé. II. — CONFÉRENCE DE LUCQUES (56) ; PROROGATION DES POUVOIRS DE CÉSAR (55).Tandis que la capitale du monde romain était livrée à de misérables intrigues, César poursuivait sa glorieuse carrière. Il semblait tout occupé de combattre les Belges, les Suèves ou les Bretons, et, sans quitter ses provinces, il était présent dans Rome. L’or, l’argent, les dépouilles conquises, y allaient, pour être partagés entre les édiles, les préteurs, les consuls mène et leurs femmes. Mais cette gloire de César, cette conquête de Rome, qui se
faisait en même temps que celle de Suétone a conservé le souvenir des famosa epigrammata d’un autre poète, Licinius Calvus, contre les deux triumvirs[22], et ces pièces copiées par les uns, récitées par les autres, avec commentaires outrageants, couraient de main en main parmi la noblesse. Les gens d’esprit jugent souvent par les petits côtés ; le peuple, qui sent simplement, reçoit sans y résister la vive impression des grandes choses ; il était fier de ces victoires gauloises qui effaçaient la plus grande humiliation de Rome et qui portaient son nom si loin et si haut[23]. César avait soin qu’on les connût dans la ville. Un service de courriers parfaitement organisé y faisait rapidement arriver le récit de ses batailles[24], et les bulletins de la brande armée étaient une glorieuse réponse à de méchants vers, dont les prétendus républicains se servaient alors pour tuer la popularité du proconsul, en attendant qu’ils pussent le tuer lui-même. Pour le moment, ils s’occupaient de lui enlever son armée et ses provinces. Le sénat désignait dix-huit mois à l’avance les provinces proconsulaires, et le quinquennium de César commencé en 58 devait finir en 54 ; il y avait donc lieu de se demander qui le remplacerait[25]. Domitius Ahenobarbus, son ancien ennemi, qui briguait le consulat pour l’année 55, disait tout haut qu’il irait, au sortir de charge, par conséquent en 54, se mettre à la tête de l’armée des Gaules. Un tribun avait attaqué la loi julienne sur les terres, et, dans la curie, le débat avait été très orageux. Cicéron s’était engagé dans l’affaire. La noblesse et lui croyaient le moment venu d’en finir avec César, même avec Pompée. L’un était menacé dans son commandement par l’envoi d’un successeur, et dans sa popularité par le rappel de ses lois. L’autre, bafoué du peuple et repoussé des grands comme un transfuge, se retrouvait dans la situation que la jalousie dit sénat lui avait faite cinq années plus tôt, à son retour d’Asie, alors que César lui avait sauvé l’honneur, en faisant ratifier les actes de son généralat. Enfin, si les pères conscrits n’avaient point d’armée, ils avaient la bande des gladiateurs de Milon qui s’accroissait chaque jour[26], et cela suffisait pour faire passer inopinément quelque fâcheuse proposition. Il était donc grand temps d’aviser. César prépara une éclatante manifestation de son crédit et une convention secrète qui en assurât la durée.
Au mois d’avril 56, il parlait encore contre les triumvirs avec autant de passion que Domitius, et il mettait le grotesque Bibulus au-dessus de tous les conquérants de la terre. Épouvanté par ce triomphe inattendu, qui attestait la force de César dans Rome et jusque dans le sénat, il se rejeta de ce côté, rougissant de son peu de courage, mais l’avouant tout haut. Oui, c’est une palinodie, écrit-il à Atticus ; adieu la droiture, la vérité et les belles maximes ; mais qui saurait imaginer ce qu’il y a de perfidie dans nos prétendus chefs ? Ils m’ont mis en avant, puis abandonné et poussé dans le précipice. Et, tout en citant Platon, il se disait qu’il avait fait assez pour la république, qu’il était temps de songer à son repos, à sa sûreté[27] : Il faut en finir ; puisque ceux qui ne peuvent rien me refusent leur amitié, je chercherai des amis parmi ceux qui peuvent beaucoup[28]. Et il devint plus souple que le petit bout de l’oreille[29]. Un tribun, C. Caton, faisait, paraît-il, les plus violentes propositions contre César, Cicéron les qualifia de lois détestables, monstrueuses ; et il ne perdit plus une occasion de louer le proconsul des Gaules, déclarant que, au lieu de le rappeler, on devrait le contraindre à rester dans son gouvernement, s’il voulait le quitter avant la fin de ses glorieux travaux. Il est vrai que, dans sa correspondance, Cicéron montrait de tout autres sentiments[30]. Cette contradiction peut servir à apprécier son caractère et son courage, mais elle regarde ses biographes ; son adhésion publique, qui a dû en entraîner bien d’autres, importe seule à l’historien, parce qu’elle explique l’impuissance des républicains. Cependant, lorsque Pompée revint de Lucques à Rome, il y eut dans le sénat de violentes altercations. Tandis que les uns persistaient à proposer le rappel de César, les autres demandèrent pour lui le droit de choisir dix lieutenants et de faire payer par le trésor public la solde des six légions, qu’il avait ajoutées aux quatre primitivement comprises dans son gouvernement. Cicéron combattit la première motion et appuya la seconde ; on n’osa point ne pas être de son avis[31]. Avait-on cru, dans l’ignorance où l’on était encore des conventions de Lucques, que, par cette concession, on gagnerait les amis de César dont l’appui ferait échouer la demande d’un nouveau consulat pour Crassus et Pompée ? C’est possible ; du moins la majorité sénatoriale se retourna aussitôt contre les deux triumvirs et décréta un deuil national qu’on ne prenait que dans les calamités publiques. Précédés du consul Marcellinus et vêtus comme en un jour de funérailles[32], les sénateurs descendirent au Forum dans l’espoir de frapper par cet appareil l’imagination du peuple et d’obtenir de lui quelque résolution favorable. Ce n’était pas le deuil de la république et de la liberté qu’ils portaient, mais celui d’une oligarchie qui sentait sa mort prochaine. Aussi, quand s’avança la théorie funèbre, lorsqu’on vit ces visages autrefois menaçants, maintenant abattus, avec des larmes dans les yeux ; lorsque ces mains, en d’autres temps si rudes, se tendirent suppliantes vers la foule, celle-ci répondit à l’expression théâtrale de cette douleur intéressée par des cris de colère et de moquerie. Malgré l’ordre du sénat, Pompée avait gardé sa toge sénatoriale et il blâma en termes énergiques cette démarche séditieuse. A ses paroles, Clodius ajouta des sarcasmes et des invectives ; les sénateurs inquiets retournèrent précipitamment au lieu de leur séance ; et, comme Clodius faillit être tué dans la bagarre, le peuple voulut brûler la curie avec ceux qui s’y trouvaient. La scène pathétique n’ayant pas réussi, le sénat essaya de l’autorité et prépara un décret dont nous ne connaissons pas la teneur, mais qui était sans nul doute destiné à lui rendre l’avantage dans sa lutte contre Pompée. Bon nombre de sénateurs attachés ou vendus aux triumvirs l’empêchèrent de passer. Alors Marcellinus, s’adressant directement aux associés de César, leur demanda : Voulez-vous donc le consulat tous les deux ? — Peut-être oui, peut-être non, répondirent-ils. Tout le monde comprit, et le sénat, reconnaissant son impuissance à lutter plus longtemps contre eux, cessa ses fonctions. On ne put, dit un vieil historien, réunir le nombre de membres exigés par la loi[33], pour qu’un sénatus-consulte fût rendu sur l’élection des magistrats, et l’année s’acheva sans que le sénat quittât le deuil ; il n’assistant aux jeux publics, ni au banquet du Capitole célébré en l’honneur de Jupiter, ni aux féries latines dit mont Albain. Comme s’il était réduit en servitude, il ne s’occupa d’aucune affaire publique[34]. La justice même fût suspendue. Les élections consulaires n’avaient pas été faites à l’époque accoutumée, de sorte qu’il fallut nommer tous les cinq jours un interroi dont la principale fonction devait être la tenue des comices, quand il serait possible de les réunir. Le président de ces assemblées avait une grande influence sur l’élection, parce que, chargé de présenter au peuple la liste des candidats, il avait le droit de n’y point inscrire les noms qui ne lui convenaient pas. Crassus et Pompée attendirent gage vint le tour d’un sénateur sur lequel ils pussent compter, et alors ils se mirent sur les rangs. Un seul des candidats osa se présenter, Domitius Ahenobarbus, beau-frère de Caton. Le jour du vote, comme il se rendait de grand matin au Forum avec beaucoup de clients, une troupe se rua sur lui ; on tua l’esclave qui le précédait, et il n’eut que le temps de fuir avec Caton, blessé : les triumvirs furent élus. Ils remplirent de leurs créatures toutes les charges et empêchèrent Caton d’être nommé préteur. Pour l’édilité, il se livra, au Champ de Mars, un vrai combat, où il y eut encore des blessés et des morts. La toge de Pompée fut couverte de sang. À la vue de cette robe ensanglantée, Julie crut son époux tué et s’évanouit. L’émotion, la chute, déterminèrent un accouchement prématuré, et depuis ce temps elle languit. Au bout d’un an, elle mourut en donnant le jour à un enfant qui ne vécut pas, et César, qui aurait tenu à Pompée par de doubles liens, comme père de sa femme et aïeul de son enfant, devint pour lui un étranger ; dans quelques années, il sera un adversaire, puis un ennemi. Ce malheur de famille devait causer bien des malheurs publics. Les triumvirs avaient pris le consulat pour prendre autre
chose. Le tribun Trebonius présenta une rogation qui donnait à Pompée l’Espagne
et l’Afrique[35],
à Crassus César avait fidèlement exécuté les conventions arrêtées à Lucques[37]. De nombreux soldats des légions gauloises envoyées à Rome avec le jeune Crassus, qu’y précédait une glorieuse renommée, avaient assuré par leur vote le succès des élections consulaires, et l’auteur du plébiscite trébonien était un de ses agents. Crassus et Pompée avaient maintenant à lui tenir parole. Le lendemain du jour où la rogation de Trebonius avait été votée, les deux consuls firent passer une loi Licinia-Pompeia qui prorogea le proconsulat de César. Pour combien d’années ? Pour cinq ans, selon Cicéron, Tite Live, Velleius Paterculus, Suétone, Appien, Plutarque et César ; pour trois ans, suivant Dion. La raison, d’accord avec les textes les plus anciens, dit que cette prorogation dut être égale en durée aux pouvoirs proconsulaires que Crassus et Pompée venaient d’obtenir, et que César ne pouvait consentir à laisser ses rivaux, comme il serait arrivé dans l’hypothèse de Dion, en possession des armées, des provinces et du trésor, tandis que lui-même ne serait plus qu’un simple particulier[38]. Pompée, qui devait à César de quitter une impasse pour une situation éminente, ne pouvait lui manquer sitôt de parole. César fut donc, comme le disent les écrivains les plus autorisés, prorogé dans son proconsulat pour cinq ans. Il eut le droit de se choisir dix lieutenants et de prendre, comme Pompée, dans le trésor public, la solde de ses légions, au lieu de les payer sur le butin de guerre, ce qui laissait entre ses mains d’immenses ressources. Enfin, un second consulat lui était promis pour l’année 48[39], et une loi postérieure l’autorisa à le briguer absent. La triarchie, ou le gouvernement à trois, était reconstituée. Cette fois Crassus et Pompée croyaient avoir établi entre
eux et leur collègue l’égalité : ils avaient autant de provinces et ils
pourraient avoir autant de légions que le proconsul des Gaules. Ils avaient
même sur lui l’avantage d’être en possession du consulat, et Pompée gardait
son intendance des vivres qui lui permettait de rester au centre du
gouvernement. Niais en méditant une lutte contre les Parthes qui lui valût la
renommée et les richesses que César avait trouvées en Gaule, Crassus comptait
trop sur ses forces ; en prenant l’Espagne cet l’Afrique, provinces
paisibles, sauf quelques révoltes partielles, Pompée ne trouvera pour ses
légions ni gloire ni butin, et le droit qu’il retient de demeurer à Rome
causera sa perte. Au moment décisif, L’année 55 s’écoula sans événements importants, et les triumvirs, confiants dans l’avenir, laissèrent, pour l’année suivante, Domitius arriver au consulat, Caton à la préture : leur haine ne semblait plus dangereuse[40]. III. — EXPÉDITION DE CRASSUS CONTRE LES PARTHES (54).
Depuis l’administration de Pompée, la face des choses n’avait
pas changé dans l’Orient. Æmilius Scaurus, son questeur, qu’il avait laissé
en Syrie avec deux légions pour contenir les Arabes, y avait, pendant trois
ans, vendu la paix et la guerre. Ses deux successeurs (59-58) n’avaient fait remarquer, ni
en bien ni en mal, leur courte administration. Cependant Crassus embarqua son armée à Brindes, et, comme on était
dans la mauvaise saison, il n’osa se fier à sa flotte pour tourner Les Parthes habitaient originairement un grand pays cerné,
au sud, à l’ouest et au nord, par les montagnes de Devenus les maîtres de l’Asie, les Parthes avaient bien vite changé leurs tentes de poil de chameau en palais somptueux, leurs habits de peau en robes flottantes[44], leurs mœurs grossières en habitudes de mollesse raffinée. Cependant ils gardaient un reste de la sève originelle ; une noblesse guerrière entourait leur prince. Lorsqu’il partait en guerre, il pouvait appeler autour de son étendard dix-huit rois auxquels il avait donné en fiefs autant de satrapies, et ses cavaliers, les cataphractaires, couverts d’une cotte de mailles, passèrent après la défaite de Crassus pour être irrésistibles[45]. Les Arsacides, ennemis des Arméniens, recherchèrent l’alliance de Rome lorsque commencèrent les démêlés de Tigrane avec la grande république. En 92, Arsace IX envoya des députés à Sylla, et Arsace XII renouvela cette alliance durant la guerre de Lucullus contre les rois de Pont et d’Arménie. Mais lorsqu’il proposa à Pompée de fixer à l’Euphrate la frontière des deux empires, le proconsul ne répondit pas à cette ouverture et refusa de reconnaître au prince le titre de roi des rois. C’était un moyen de réserver à l’ambition romaine les éventualités de l’avenir. La guerre civile, ébranlant quelques années plus tard l’empire parthique, parut devoir le faire tomber bientôt dans cette demi sujétion qui, pour les États voisins de Rome, était l’annonce d’une mort prochaine. Gabinius avait été sur le point de reconduire à Séleucie Mithridate, un des fils parricides d’Arsace XII. S’il avait fait cette expédition, il aurait sans doute laissé une garnison dans la ville royale, comme il en laissa une dans Alexandrie ; et le Tigre, au lieu de l’Euphrate, aurait pu devenir la frontière orientale de Rome. Mais les promesses de Ptolémée Aulète l’emportèrent sur celles de Mithridate ; et le prince parthe, ayant tenté seul de renverser son frère Orodès, fut assiégé, pris et tué par lui dans Babylone. Malgré cette mort, il restait assez de troubles dans le royaume pour qu’un habile homme pût profiter de ces événements. Crassus ne se donna le temps ni de prendre connaissance du pays ni de nouer d’utiles intrigues avec les mécontents et avec les peuples du voisinage, qui lui eussent fourni une nombreuse cavalerie ; il se hâta de passer l’Euphrate, s’empara de quelques villes, dispersa quelques troupes, et se fit proclamer imperator pour ces légers succès. Mais, au lieu d’avancer hardiment sur Babylone et Séleucie, puisque l’ennemi ne semblait pas prêt à se défendre, et d’enlever rapidement ces deux villes qui haïssaient la domination des Parthes, il retourna hiverner en Syrie, où il laissa son urinée perdre sa discipline (54). Lui-même, malgré ses soixante et un ans, ne s’occupait qu’à visiter les temples pour en ravir les trésors ; ceux d’Hiérapolis et de Jérusalem furent pillés : du dernier il enleva 2000 talents[46]. Une ambassade d’Orodès lui ayant demandé raison de la violation du territoire de l’empire : C’est à Séleucie, dit-il, que je rendrai réponse. A quoi un des envoyés repartit : Tu entreras quand des cheveux auront poussé là ; et il lui montrait la paume de sa main. Le roi d’Arménie, Artavasde, vint le rejoindre avec six mille cavaliers bardés de fer, et offrit le passage par son royaume, où l’armée romaine trouverait des vivres, des routes sures, un terrain favorable à sa tactique et l’assistance de trente mille Arméniens ; Crassus refusa. Décidé à traverser les plaines de Les Parthes avaient divisé leurs forces. Orodès opérait
dans le Nord avec ses fantassins, en vue d’arrêter le roi d’Arménie au sortir
des montagnes, et le suréna, ou généralissime, réunissait à l’ouest une
innombrable cavalerie, pour envelopper au milieu de ces immenses plaines la
pesante infanterie romaine. Les deux armées se rencontrèrent non loin du
petit fleuve Balissus (le
Bélik). Le jeune Crassus, qui de Le proconsul avait profité du ralentissement de l’attaque
principale pour gagner une colline. Il croyait la victoire assurée, quand les
cavaliers ennemis vinrent avec des cris de joie et d’insultantes paroles
promener en face des légions la tête de son fils. Le combat recommença et
dura jusqu’à la nuit avec les mêmes vicissitudes. Les Parthes enfin s’éloignèrent
en criant au malheureux père qu’ils lui donnaient une nuit pour pleurer son
fils. Couché à terre dans un morne abattement, Crassus sondait l’abîme où son
ambition l’avait jeté. En vain Cassius chercha à lui rendre du courage ; il
fallut que lui-même donnât l’ordre de la retraite, en abandonnant quatre
mille blessés. On gagna la ville de Carrhes, mais on ne pouvait songer à s’y
enfermer ; au soir l’armée partit sans bruit.. Égarée par ses guides, elle
fut rejointe par les Parthes, et les soldats effrayés forcèrent le triumvir d’accepter
une entrevue avec le suréna. C’était un guet-apens : Crassus et son escorte
furent massacrés ( Quand on apporta à Orodès la tête du triumvir, on jouait devant ce roi barbare les Bacchantes d’Euripide. L’acteur saisit le hideux trophée, et chanta comme la bacchante qui devait tenir la tête de Penthée : Nous apportons des montagnes ce cerf qui vient d’être tué ; nous allons au palais, applaudissez à notre chasse. Quelques faibles débris des sept légions purent repasser l’Euphrate
; Cassius, parti de Carrhes avant son général et heureusement arrivé en
Syrie, eut le temps d’y organiser la défense, et quand les Parthes parurent l’année
suivante, il les repoussa (52). Une seconde et plus formidable tentative qu’ils firent
sous la conduite de Pacorus, fils de leur roi, ne réussit pas mieux (51). Cassius,
enfermé dans Antioche, les laissa piller la province ; quand il les vit
confiants et désordonnés, il courut à eux et leur infligea une défaite qui en
délivra Le désastre de Crassus arrêta pour bien longtemps la
domination de Rome à l’Euphrate. Fous verrons plus tard pourquoi il était
difficile qu’elle franchit le fleuve et comment elle ne le fit, sous de
vaillants princes, que par le nord de IV. — NOUVEAUX DÉSORDRES DANS ROME ; POMPÉE SEUL CONSUL (52).Durant la désastreuse expédition de Crassus, Pompée était resté à Rome. Il avait cherché à consolider son influence par la magnificence des jeux qu’il donna pour l’inauguration de son théâtre : quarante mille spectateurs y trouvèrent place et cinq cents lions y furent tués. Son année consulaire passée, il avait envoyé des lieutenants eu Espagne, et, sous prétexte d’accomplir les devoirs de sa charge pour les vivres, il était demeuré aux portes de Rome. Ce consulat, pour lequel la ville avait été si longtemps troublée, n’avait rien produit[48], rien du moins pour les réformes utiles, mais beaucoup pour l’ambitieux général lui s’était attribué tant d’avantages personnels. Lorsque l’on compare cette stérilité à l’activité féconde de César en 59, on a la mesure des deux hommes. En déposant les faisceaux, Pompée laissa la république dans la plus déplorable situation. Littéralement tout se pesait au poids de l’or, le mérite des candidats, comme l’innocence des accusés, et le Forum n’était qu’un marché où s’achetaient les suffrages, les charges, les provinces. Gabinius avait vendu l’Égypte 10.000 talents à Ptolémée Aulète et volé aux Syriens 100 millions de drachmes ; il s’était mis en révolte même contre Rome, méprisant les sénatus-consultes et les livres sibyllins, sortant de sa province, malgré les expresses défenses de la loi, et refusant de remettre son gouvernement au remplaçant qui lui fut envoyé. L’irritation était extrême dans le sénat, moins à cause des illégalités commises qu’en raison de ces immenses richesses qui semblaient ne devoir rien laisser aux successeurs. Malgré l’assistance de Pompée, il fut condamné. Un seul fait montrera jusqu’où allait la dépravation. C. Memmius, écrit Cicéron, vient de lire en plein sénat un marché d’élection passé entre lui et son compétiteur Domitius d’un côté, d’autre part les deux consuls en charge. Par ce traité, Memmius et Domitius s’engagent, sous la condition d’être désignés consuls pour l’année prochaine, soit à payer aux consuls en charge 400.000 sesterces, soit à procurer : 1° trois augures affirmant avoir assisté à la promulgation d’une loi curiate qui n’existait pas ; 2° deux consulaires déclarant s’être trouvés à une séance de distribution des provinces consulaires, séance qui n’avait pas eu lieu[49]. a Que de malhonnêtes gens dans un seul contrat ! b dit Montesquieu. Ajoutons que 400.000 sesterces pour tan double faux si audacieux, c’était supposer la conscience des augures et des consulaires à bien bon marché ! Mais le peuple lui-même ne se vendait pas cher : Verrès n’avait acheté sa préture que 80.000 sesterces. En même temps que la vénalité, la violence : à chaque instant les traits, les pierres, le sauve-qui-peut ; et point de journée sans meurtre[50] ; un consul même fut blessé. Un certain Pomptinus attendait, depuis sept ans, en dehors du pomerium, un triomphe que le sénat lui refaisait pour des succès remportés en 61 sur les Allobroges. Un préteur, son ami, réunit enfin quelques citoyens au point du jour, et, contrairement à la loi qui interdisait toute assemblée avant la première heure, il leur fit voter ce que Pomptinus désirait. Ce candidat persévérant triompha, mais au milieu d’un désordre extrême : on se battit sur plusieurs points, et il y eut des morts. Pour les plus mesquines ambitions, pour les plus petites choses, on violait la loi et le sang coulait[51]. Qu’on se représente, au milieu d’une telle société, Caton, alors préteur, allant nu-pieds, sans tunique, siéger sur son tribunal et faisant distribuer à la populace, au lieu des fastueuses profusions dont elle avait l’habitude, des raves, des laitues et des figues, ou bien proposant, après l’extermination des Tenctères et des Usipiens, qu’on livrât César aux Germains comme infracteur de la pair, et l’on comprendra que cette opposition n’allait pas au delà d’une protestation qui ne corrigeait personne et faisait sourire tout le monde, excepté Favonius, le singe de Caton. Ces deux hommes, qui se croyaient des Romains de l’ancien temps, ne changeaient pas, mais beaucoup d’autres avaient changé. On a vu l’évolution rapide opérée par Cicéron à l’époque de la conférence de Lucques. L’excellent homme qui, dans un État paisible, eût gardé avec honneur la première place, était, dans cette république orageuse, tiré en sens contraire par ses idées et par ses intérêts ; tantôt les uns, tantôt les autres l’emportaient ; car il était aussi Pauvre de caractère qu’il était riche de talents. Pour le moment, ses intérêts l’attachaient à César, et il le fatiguait de ses éloges. Il avait entrepris un poème en l’honneur du proconsul et eut soin qu’il en fût informé ; le poème fini, il le lui envoya, puis en commença un autre[52]. César, qui ménagea toujours le grand orateur par goût pour son esprit, prit son frère Quintus comme lieutenant et chargea Cicéron de veiller à l’emploi d’une partie des fonds qu’il faisait passer à Rome pour ses constructions. Lorsque Quintus reprocha à son frère de l’avoir contraint d’accepter cette lieutenance, ces fatigues ces dangers, dus un pays qui semblait à Cicéron lui-même au bout du monde[53] : Le prix de ce sacrifice, lui répond-il, sera la consolidation de notre position politique par l’amitié d’un homme puisant et bon. On voit à quoi se bornent ses désirs. Il ne s’effraye même pas de la dictature imminente de Pompée ; il en cause sans indignation, comme de tout autre événement. Pompée en veut-il ? N’en veut-il pas ? Qui le sait ? Mais tout le monde en parle. Et, ajoute Appien, tout le monde le souhaite. On le disait ouvertement : Aux maux présents il n’y a qu’un remède, l’autorité d’un seul[54]. Pompée s’en défendait, tout en encourageant secrètement les désordres qui rendaient cette dictature nécessaire. Du moins, parmi les conservateurs, beaucoup croyaient voir sa main dans les émeutes. Pour la seconde fois en trois ans, on ne put, dans l’année 55, faire les élections consulaires : l’interrègne dura sept mois. De guerre lasse, les grands se rapprochèrent du sphinx menaçant dont on devinait les désirs, mais qui continuait à les cacher. En paraissant croire à son désintéressement, on le força par des flatteries calculées à laisser élire, le septième mois, deux consuls. Soit impuissance réelle de ce gouvernement à durer plus longtemps, soit intrigues de Pompée, soit plutôt ces deux causes réunies, l’interrègne recommença l’année suivante (52). Milon, Scipion et Hypsæus demandaient le consulat les armes à la main ; Clodius briguait la présure de la même manière, et chaque jour une sédition éclatait[55]. Au milieu de ces meurtres obscurs, il y en eut un qui
porta le désordre au comble. Milon se rendant à Lanuvium, sa ville natale,
dont il était le premier magistrat (dictateur), rencontra Clodius sur la voie Appienne, près de
Boville. Comme les barons romains du moyen âge, ils ne marchaient l’un et l’autre
qu’escortés d’une bande de spadassins. Ires deux troupes se croisèrent, en se
lamant des regards furieux, cependant elles s’éloignaient, lorsque deux
gladiateurs de Milon restés en arrière se prirent de querelle avec des gens
de Clodius. Celui-ci, accouru au secours des siens, fut blessé et se réfugia
dans une hôtellerie. Milon pensa qu’il ne lui en coûterait pas plus de l’achever,
et, comme sa bande était nombreuse, l’autre s’enfuit en laissant onze morts
sur la place. La porte de la taverne fut alors enfoncée, le cabaretier tué,
Clodius percé de coups et son cadavre jeté sur la route, où il resta jusqu’au
soir. Un sénateur qui revenait de sa villa le ramena à Rome[56] ( On comprend que ces abominations aient fini par ouvrir les yeux à creux qui les fermaient obstinément, pour ne pas voir que le seul moyen de sauver la vie sociale qui périssait était la concentration des pouvoirs dans la main d’un chef énergique. Un sénatus-consulte décida que la curie brûlée serait rebâtie aux frais du trésor par Faustus Sylla et qu’elle porterait le nom de son père Par cet hommage inattendu à la mémoire du bourreau des marianistes, la majorité sénatoriale montrait à la fois ses sentiments à l’égard du neveu de Marius et le souvenir reconnaissant qu’elle conservait de l’homme qui, trente ans plus tôt, avait rétabli l’ordre par la dictature. Naguère Caton attaquait encore Pompée au sénat : Il dispose de tout, disait-il ; dernièrement, il a prêté à César six mille hommes sans que l’un vous les ait demandés, sans que l’autre vous en ait prévenus. Des armes, des chevaux, une légion entière, sont les présents qu’échangent maintenant des particuliers. Avec son titre d’imperator, Pompée distribue les armées et les provinces tout en restant dans la ville où il machine des troubles et des séditions, afin de se frayer par l’anarchie un chemin à la royauté[58]. Mais, en face de la dissolution imminente de l’État, il en vint, lui aussi, à désespérer de la république. Il la voyait menacée de deux dangers : au dedans par l’anarchie, qui n’était que trop certaine ; au dehors par César, qui cependant n’avait encore justifié ses soupçons ni par des actes ni par des paroles ; et quand il cherchait autour de lui qui voudrait défendre l’aristocratie, il trouvait, même en ceux que Cicéron avait appelés le parti des honnêtes gens, tant d’indifférence, qu’il se décida enfin à demander pour elle à un homme la protection que les lois ne pouvaient plus lui donner. Mieux vaut, dit-il, se choisir un maître qu’attendre le tyran qui certainement naîtra de cet immense désordre ; et il appuya la proposition que fit Bibulus de nommer Pompée seul consul. il pensait que, content de ce titre, Pompée userait avec modération de son pouvoir, qu’il rétablirait l’ordre dans la ville, et saurait contraindre César à quitter son armée. Cette tâche remplie, Caton se promettait de le forcer à compter avec le sénat. S’il échouait, cette dictature du moins n’aurait été qu’une passagère et bienfaisante tyrannie. Pompée le confirma dans cette espérance, en feignant de ne plus agir que par ses conseils. Il fut élu seul consul le 27 février 52. Cet événement était grave, car il consommait la réunion de Pompée avec le sénat et sa rupture avec le proconsul des Gaules. Depuis deux ans on prévoyait ce résultat. La mort de Julie, l’épouse aimante de Pompée, la fille chérie de César, avait brisé un lien que tous deux auraient respecté (54) ; et depuis la fin de Crassus (53), ils se trouvaient en présence, sans intermédiaire qui prévint ou arrêtât les chocs. Une rivalité à trois peut durer, parce qu’un des trois maintient l’équilibre en se portant de l’un ou de l’autre côté ; une rivalité à deux amène bientôt la guerre. Pompée avait depuis longtemps reconnu la fausse position que lui avaient faite sa versatilité et l’habileté de son adversaire ; pour rompre avec lui, il n’attendait qu’un retour du sénat ; or voici que les grands, que Caton même, lui offraient, par une violation de toutes les règles constitutionnelles, une domination sans partage. Proconsul d’Espagne, il était légalement considéré comme absent, c’est-à-dire incapable d’être élu à une charge urbaine, et on lui donnait le consulat ! Cette suprême magistrature de la cité devait toujours être partagée, et il était seul consul. S’il voulait un collègue, c’était lui, et non pas les comices,. qui devait le choisir ; encore prenait-on des garanties contre son désintéressement, en ne lui permettant pas de se donner avant deux mois ce collègue autrefois nécessaire[59]. Le consul n’avait pas, dans Rome, l’autorité militaire, le jus necis ; Pompée restant gouverneur de province gardait l’imperium, et, pour que personne ne discutât son droit à l’exercer dans la ville, le sénat l’avait encore investi de l’autorité dictatoriale par la formule des jours de péril public : Caveat consul. Enfin au pouvoir on avait ajouté les moyens d’action : un décret lui ouvrait le trésor et lui prescrivait de lever des troupes en Italie. Il était donc le maître, et comme il le voulait être, en sauvant les apparences, puisqu’il n’avait rien pris de vive force et qu’il tenait tout du sénat. Mais qui ne voit que l’aristocratie fondait l’empire ? Il suffit de comparer les pouvoirs de Pompée avec ceux d’Auguste pour reconnaître qu’ils sont à peu prés semblables ; car la révolution impériale ne fut que la concentration viagère dans les mains d’un seul des droits répartis chaque année par la république entre plusieurs. Au moment où les grands, par haine contre César et par
impuissance à gouverner[60], sacrifiaient à
un chef incapable ce qu’ils appelaient la liberté romaine, le proconsul qu’ils
voulaient proscrire, dédaignant leurs menaces séniles, faisait pour Rome
cette merveilleuse campagne de l’année 52, qui le place à côté d’Annibal, et
tenait Pour expliquer la violence de cette haine, il faut reconnaître que les grands avaient de très sérieux motifs de détester César ; mais l’histoire doit rechercher si ces motifs étaient légitimes. La véritable question entre eux était le maintien ou le renversement de la législation cornélienne, qui avait tout pris au peuple pour tout donner au sénat. Quoique bien des brèches eussent été pratiquées dans la forteresse aristocratique, même par la main de Pompée, elle tenait bon et restait debout ; le neveu de Marius voulait en forcer les portes. Sans qu’il eût commis une illégalité, et par le seul fait d’avoir relevé le parti populaire écrasé sous Sylla, les nobles avaient à trembler pour leur pouvoir, et ils tremblaient plus encore pour leurs biens. Ses lois consulaires, si elles avaient été exécutées, auraient tari la source où ils puisaient leurs richesses ; d’un mot il pouvait même les ruiner, en provoquant un plébiscite qui autorisât les revendications des familles dépouillées par Sylla, ou qui forçât les anciens généraux à remettre au trésor le butin de guerre qu’ils s’étaient approprié. La plupart des fortunes de l’oligarchie étaient faites de l’or ravi aux provinces, comme celle de Lucullus, et de terres enlevées aux proscrits, comme celle du plus violent adversaire de César, ce Domitius qui en avait assez pour être en état de promettre durant la guerre civile à chacun de ses soldats, une ferme prise sur son bien. Jusqu’à présent, les spoliateurs avaient tenu leurs vols hors d’atteinte par la loi qui avait interdit aux fils des victimes de Sylla l’accès aux charges publiques. Ils avaient espéré rendre la proscription éternelle, en prévenant toute dangereuse rogation d’un fils de proscrit qui parviendrait au tribunat. Que César fasse restituer leurs droits civiques à ceux qu’une loi d’odieuse iniquité en a privés, et l’oligarchie perdra ces immenses domaines acquis par le meurtre[61]. Voila les craintes que l’on cachait sous l’accusation de tyrannie prochaine, et l’histoire, surtout en notre temps, n’est pas tenue de partager ces colères ; voilà aussi pourquoi la majorité sénatoriale aimera mieux déchaîner la guerre civile que de voir un second consulat de César : c’est le secret de ses avances à Pompée. Ce personnage devait beaucoup à son ancien collègue qui, en 59, l’avait défendu contre les grands ; qui, en 55, avait loyalement contribué à faire sa fortune présente. Mais lorsque Pompée fut assuré de la grande situation que lui avait faite le plébiscite trébonien, quand il eut joint à son intendance des vivres, qui lui livrait Rome et l’Italie, le proconsulat d’Espagne et d’Afrique, qui lui donnait des provinces et des adnées, il n’avait plus gardé pour le proconsul des Gaules que des égards de convenance, lesquels cessèrent avec la vie de Julie. En vain César lui proposa de consolider leur alliance politique par une double alliance de famille : César épousant une fille de Pompée, et celui-ci une petite-nièce de César ; il refusa et fit entrer dans sa maison la fille d’un ennemi acharné de son ancien beau-père[62]. L’amitié de César, qu’il avait subie dix ans, pesait à son orgueil, et cette renommée devenue si grande lui était importune. Il entendait ne plus partager avec personne, et nous allons le voir se servir de son autorité consulaire pour annuler les avantages qu’il avait été contraint, en l’année 55, de faire accorder au proconsul des Gaules. D’abord il voulut montrer que tout le monde aurait à
compter avec lui. Il proposa de nouvelles lois contre la corruption, la violence
et la brigue[63],
en leur donnant un effet rétroactif de vingt années. Le proconsul en fut
blessé, car, avec ces lois, un affidé des grands pouvait le citer devant des
juges bien faciles à corrompre ou à intimider. Caton lui-même trouvait cette
disposition inique. Les amis de César réclamèrent ; Pompée ne les écouta pas.
Pour se débarrasser de Milon et de sa bande, il laissa instruire le procès du
meurtrier de Clodius. Cicéron avait longtemps souhaité ce meurtre, et Caton
osa dire en plein sénat que Milon avait agi en bon citoyen, tant ces temps
malheureux troublaient les consciences les plus honnêtes[64]. Mais le peuple
était trop irrité pour que justice ne fût point faite. Les soldats dont
Pompée entour le tribunal effrayèrent le défenseur, qui plaida mal[65] ; l’accusé s’exila
à Marseille. Quand il y reçut Clodius mort, Milon en exil et leurs bandes dispersées, le calme revint, tant il suffisait d’un homme ayant la volonté de maintenir l’ordre pour que la paix régnât dans la cité[67]. Mais Pompée, capable d’actes énergiques, était incapable de les soutenir longtemps, parce qu’en politique il allait à l’aventure, sans principe arrêté ni plan de conduite, se fiant, en vrai Romain, à la fortune du jour, c’est-à-dire aux circonstances ; aujourd’hui avec Sylla, demain avec César ; restaurateur des droits populaires, puis défenseur de l’oligarchie. Il ne se tenait même pas pour obligé par les lois qu’il avait faites[68]. Il avait interdit les éloges que prononçaient au tribunal les amis puissants d’un accuse ; et quand Metellus Scipion, son beau-père, fut cité en justice, il vint le défendre, c’est-à-dire ordonner l’acquittement[69] ; pour le même délit, Plautius Hypsœus était condamné. Il avait fait décréter que les magistrats ne pourraient avoir une province que cinq années après leur sortie de charge ; la mesure était excellente, il l’annula en demandant que ses pouvoirs proconsulaires fussent prorogés pour cinq ans avec le droit de prendre chaque année 1000 talents dans le trésor[70]. Il avait établi par la loi de jure magistratuum que nul ne pourrait, absent de Rome, briguer une charge, et il y introduisit presque aussitôt une exception qui la détruisait. Ces contradictions prouvent que Rome n’aurait pas trouvé en Pompée l’homme résolu et ferme dont elle avait besoin, mais les grands ne s’en inquiétaient pas. Tout à leur haine, ils aidaient le consul à enlacer César dans un réseau de dispositions législatives qui devaient réduire le proconsul des Gaules à l’impuissance. La nouvelle loi judiciaire permettait, à un moment donné, d’incriminer tous ses actes, et le procès de Milon venait de montrer comment Pompée comprenait la liberté des tribunaux. L’interdiction de briguer absent une magistrature le forçait, s’il voulait un second consulat, d’abandonner ses provinces et de se mettre à la discrétion de ses ennemis. Échappait-il aux juges, c’est-à-dire à l’exil, et parvenait-il à obtenir du peuple les faisceaux consulaires, l’obligation d’attendre cinq ans, après sa sortie de charge, un gouvernement provincial, le laissait désarmé, durant ces cinq années, en face de Pompée, maître jusqu’en 46 du trésor et de grandes forces militaires. Les nobles ne voulaient à aucun prix le laisser arriver à un nouveau consulat. Le premier avait révélé un plan de réformes qui serait certainement repris et développé, et ils croyaient que leur nouvel allié venait d’arrêter un ensemble de mesures qui devait les mettre à l’abri de ce danger. Mais, dans cette campagne législative si bien conduite, Ies habiles gens du sénat avaient tout calculé, sauf le degré de résignation auquel s’abaisserait, devant ces convoitises si claires et ces menaces si peu déguisées, l’homme dont les victoires permettaient d’oublier le désastre de Crassus. Contre la loi judiciaire, César s’était contenté des réclamations de ses amis, résolu qu’il était à ne pas s’exposer aux coups de la justice romaine tant que celui qui venait, par ses lois, de lui déclarer la guerre, garderait à Rome une dictature officielle ou à demi voilée. Au sujet de la disposition qui mettait un intervalle de cinq années entre l’exercice d’une grande charge et la gestion d’un proconsulat, il se dit sans doute que ce qui avait été fait par un consul pourrait être défait par un autre. Un consulat lui était donc nécessaire pour briser ces lacs si artificieusement tressés par son allié d’hier, son adversaire d’aujourd’hui ; et ce consulat, il fallait qu’il pût le briguer du fond de sa province, parce qu’il était perdu s’il reparaissait un seul jour dans la ville sans être couvert par l’imperium[71]. Il exigea que la loi touchant l’absence fût modifiée, et il doit l’avoir fait de telle façon, que Pompée, qui n’était pas en mesure de rompre avec lui, fût contraint d’y consentir. Un refus aurait fait éclater probablement la guerre civile trois années plus tôt. Cicéron s’interposa. Il se rendit à Ravenne, on l’ancien associé du proconsul des Gaules l’avait envoyé, et, de retour à Rome, il agit auprès de son ami Cælius, alors investi de la puissance tribunitienne, pour faire accepter les conditions qu’il rapportait[72]. Pompée pressa lui-même les autres tribuns de provoquer une loi qui consacrât le droit réclamé par César. Le plébiscite fut voté et dut l’être à l’unanimité, puisque le peuple, représenté par ses dix tribuns, l’acceptait, et que le parti sénatorial, entraîné malgré lui par Cicéron et Pompée, le subissait[73]. Sur la table d’airain où la loi consulaire contre les absents était déjà gravée, Pompée ajouta l’exception[74] qui venait d’être faite en faveur de César. Après la solennité de ce dernier vote, il ne pouvait plus avoir l’espérance de trouver des jurisconsultes pour rappeler que, selon la loi des Douze Tables, le privilegium était nul et de nul effet. Il avait menacé,et il était revenu sur sa menace : jeu double et dangereux qui révélait son caractère incertain. César venait de gagner sa cause, non par la force, mais par une loi ; car, en lui accordant le bénéfice de l’absence, on lui assurait toutes les garanties que réclamaient son ambition et sa sécurité. Le plébiscite, en effet, lui reconnaissait implicitement le droit de rester à la tête de son armée jusqu’au jour où il pourrait briguer légalement le consulat, c’est-à-dire jusqu’au milieu de 49[75]. Cicéron, redevenu son ennemi, sera forcé de le proclamer lui-même. En lui donnant le bénéfice de l’absence, on lui a donné le droit de garder son armée jusqu’aux comices consulaires[76]. Tout cela était fort peu républicain : mais est-ce qu’il y avait alors une république a Rome ? Bien habile serait celui qui pourrait dire où était le droit véritable. L’argent et l’intimidation ayant depuis longtemps décidé les votes, toute loi pouvait être abrogée, toute élection cassée pour vice de forme, corruption ou violence, à quelque faction qu’appartint l’élu ou l’auteur de la loi. La république était morte depuis que Rome n’avait plus de libres comices, et l’on peut dire que, depuis le meurtre des Gracques, elle n’en avait pas eu. V. — EFFORTS DE L’OLIGARCHIE POUR ENLEVER À CÉSAR SES POUVOIRS.Le deuxième consulat de Pompée en 55 avait été stérile ;
la dictature qui, venait de lui être accordée, en 52, pour rétablir l’autorité
du sénat et ruiner celle de César, n’avait pas relevé l’une et avait consolidé
l’autre. L’oligarchie avait bien mal choisi le chef en qui elle espérait un
nouveau Sylla. Caton était plus résolu, mais ses amis mètres se défiaient de
cet homme à l’esprit, court et violent, qui n’a mérité que par sa mort de
vivre dans la mémoire de la postérité. Malgré son nom et malgré son zèle pour
la faction des grands, ceux-ci ne le laissèrent point arriver plus haut que
la préture. En cette année 52, il avait sollicité le consulat, et on lui
avait préféré un Marcellus, qui devait gérer sa charge pour le compte de
Pompée et du parti. Le nouveau consul était un de ces nobles qui s’irritaient
de n’entendre depuis huit années retentir dans Rome que le nom de César. Ils
avaient été réduits longtemps à déplorer en secret ses victoires ; se croyant
assurés maintenant de l’appui du conquérant de l’Asie, ils cessaient de se
contenir en cessant de craindre. Marcellus commença l’attaque ; il provoqua
directement le proconsul des Gaules, afin de l’amener à commettre quelque
imprudence qui légitimât une mesure extrême. César avait établi à Novocummum,
dans Mais Pompée hésitait encore et employait le temps à visiter ses villas. Tandis que son rival achevait en cette campagne sa longue guerre et se donnait la libre disposition de toutes ses forces, lui, il allait prés de Tarente soigner sa santé et philosopher avec Cicéron, qui le trouva animé, dit-il, des meilleures et des plus patriotiques intentions. Il voulait s’en aller plus loin encore, en Espagne. Était-ce ruse pour tromper le crédule consulaire et faire célébrer son désintéressement aussi haut que sa gloire ? Cela est probable ; mais, à ce jeu double, il perdait l’avantage que lui eût donné une ferme décision et une offensive hardie. En demeurant dans l’inaction et le silence, il laissa le sénat s’avancer et saisir le premier rôle ; de sorte qu’au moment de l’explosion la question se trouva posée, non plus entre lui et César, mais entre César et l’aristocratie, dont Pompée ne fut que le général. Il n’en pouvait être autrement : Pompée, ne représentant aucun principe, n’était pas le véritable adversaire de César ; et, puisque le sénat avait seul dans l’État gardé de l’autorité, c’était lui qui devait livrer pour la république la dernière bataille.
L’aristocratie, maîtresse, dans la ville, de toutes les
positions, huait de ses vœux le jour de la lutte. Un moment elle avait cru
que les Bellovaques venaient de la débarrasser de César. En mai 51, on se
disait à l’oreille qu’il avait perdu sa cavalerie ; que la septième légion
était battue, lui-même coupé de ses troupes et cerné[80]. Lorsqu’on sut
la vérité, on ne fut que plus pressé d’amener Pompée à se déclarer
ouvertement. Dans une séance du sénat ( Quand les grands accordaient au proconsul cette trêve imprudente, qui lui permettait d’achever en Gaule son ouvrage et de se préparer pour la guerre civile, ils avaient cependant des troupes en Italie. L’armée levée par Pompée pour rétablir l’ordre dans la ville n’avait pas été licenciée. Cantonnée à Ariminum, sur la frontière du gouvernement de César, elle pouvait en quelques marches lui fermer les passages des Alpes. Mais les grandes assemblées ne connaissent point le prix du temps ; comme le peuple d’Athènes qui écoutait ses orateurs quand Philippe passait les Thermopyles, le sénat sera encore a délibérer tandis que César franchira le Rubicon. Cependant M. Marcellus, qui voyait expirer son année consulaire sans avoir pu réaliser le vœu de l’oligarchie, avait voulu en imposer l’exécution à ses successeurs. La résolution du 30 septembre était conçue en ces termes : Les consuls de la prochaine année mettront en discussion dans le sénat la question du remplacement de César à la séance du ter mars 50 ; jusqu’à ce que cette question soit réglée, le sénat se réunira tous les jours de comices ; six des sénateurs, juges dans les tribunaux, seront tenus de les quitter pour se rendre à la curie ; nul ne pourra y faire opposition ; ceux qui t’essayeront seront déclarés ennemis publics ; le sénat prendra en considération les services des soldats de l’armée des Gaules pour rendre à la vie civile les vétérans qui ont droit au congé et ceux qui auront des motifs valables pour l’obtenir[83]. La menace était claire : enlever à César son commandement et désorganiser son armée, annuler d’avance le veto des tribuns et placer ceux qui voudraient s’en servir sous le coup de la peine suprême. Trois tribuns s’opposèrent à cette proposition, et le collègue de Marcellus s’y montra contraire ; mais la majorité sénatoriale l’adopta. Cette décision révolutionnaire, où toutes les illégalités sont réunies, était une véritable déclaration de guerre. Le sénat avait eu le courage de la prendre parce qu’il comptait sur Pompée, qui s’était avancé ce jour-là plus qu’il n’avait fait encore : Que César refuse d’obéir au décret qui sera rendu, avait-il dit, ou qu’un de ses affidés y fasse empêchement, c’est tout un. — Mais s’il prétend être consul et conserver son armée ? lui demanda-t-on. — Mais si mon fils lève le bâton sur moi ? répondit-il. Pompée revenait au système syllanien : tout par et pour le sénat. S’il ne demande pas la suppression du veto tribunitien qu’il avait fait rétablir, il le traite du moins en vieillerie surannée qui ne doit plus arrêter personne ; la situation se précise, comme il convient à la veille des grandes solutions. César ne répondit pas à ces provocations. Il voyait
clairement et depuis longtemps qu’on voulait l’obliger à déposer le paludamentum avant de revêtir la toge consulaire,
pour que l’on pût casser ses actes et se débarrasser par un exil du chef
populaire et de ses menaçantes réformes[84]. Mais la
difficulté était de lui faire commettre cette imprudence. Les défections qu’on
provoquait autour de lui, en offrant des congés à ses soldats, ne se firent
point. Ses dix légions, dont il avait doublé la solde[85] et qu’il
entretenait en grande partie à ses dépens, lui étaient dévouées comme jamais
armée ne l’avait été à son chef. On avait un jour entendu titi centurion
dire, aux portes du sénat, en mettant la main à la garde de son épée : Ce que vous refusez à César, ceci le lui donnera[86]. Aussi
laissait-il ses adversaires délibérer, décréter et menacer en paroles ; il
passait même cet hiver au fond de Le 1er mars 50, la délibération commença. Les pouvoirs du proconsul, prorogés pour cinq ans par la loi Licinia-Pompeia, ne finissaient qu’en 49, les grands ne voulurent pas attendre si longtemps, et le consul C. Marcellus mit aux voix son rappel pour le 13 novembre de la présente année, ce qui aurait donné sept mois à ses accusateurs, bien plus qu’il n’en fallait pour enlever une condamnation. La majorité allait adopter cet avis, malgré le silence de l’autre consul, lorsque Curion se levant loua la sagesse de Marcellus, mais ajouta que la justice et l’intérêt public voulaient que la même mesure fût appliquée à Pompée[88]. Il faut en finir, dit-il, avec les pouvoirs exceptionnels et rentrer dans la constitution, qui n’en permet pas. Si l’on refusait, il opposerait son veto. Ce moyen était habilement choisi. Au milieu des partis, Curion semblait seul penser à la république. Quand il sortit dut sénat, le peuple jeta des fleurs sur son passage, pour honorer le courageux athlète qui acceptait cette lutte difficile[89] ; les grands n’osèrent braver son opposition. Cependant César avait enfin tout terminé en Gaule. Dans l’été de l’année 50 il passa les Alpes sous prétexte de recommander aux municipes et aux colonies des bords du Pô la candidature à l’augurat de son questeur Marc Antoine[90], mais en réalité pour se rapprocher de Rome, et obtenir des Cisalpins une démonstration en sa faveur qui retentit jusque dans le sénat. Partout, en effet, les populations sortirent à sa rencontre ; et des sacrifices, des fêtes, célébrèrent son arrivée dans chaque ville. Durant cette marche triomphale dans l’Italie même, ses légions se rassemblaient sur le territoire des Trévires ; il retourna en Gaule pour les passer en revue. Sans doute à cette solennité militaire de tacites promesses furent échangées entre le chef et les soldats ; ceux-ci connaissaient les desseins formés contre leur général, et, à défaut même d’affection pour lui, leur intérêt les exit avertis qu’ils partageraient ses malheurs ou sa prospérité. César destitué, condamné, qui payerait leurs services ? Serait-ce celui qui, sans César, n’aurait pu faire donner un pouce de terre à ses légions d’Orient ? Vers ce temps, Pompée tomba malade à Naples[91]. Quand il
guérit, les habitants rendirent aux dieux de solennelles actions de grâces ;
de Naples ce mouvement gagna les cités voisines ; Pouzzoles se couronna de
fleurs, et dans toute Cette prompte obéissance étonna. On pensa en trouver l’explication
dans ce que racontait des dispositions de l’armée entière Appius Claudius,
qui avait ramené de La lutte devenait cependant imminente. Un observateur clairvoyant, en ce moment à Rome, écrivait à Cicéron : La guerre est inévitable et voici le terrain où vont se heurter les deux puissants du jour. Pompée ne veut pas souffrir que César soit consul avant d’avoir quitté ses légions et ses provinces, et César est persuadé qu’il n’y a de salut pour lui qu’en gardant son armée[94]. Mais en Italie nuls préparatifs, aucune mesure de défense ; et quand on demandait à Pompée quelle force arrêterait l’ennemi, si les césariens passaient les monts, il répondait avec ses souvenirs de jeunesse : En quelque endroit de l’Italie que je frappe du pied la terre, il en sortira des légions. Les consuls partageaient sa quiétude, et Marcellus, le plus animé contre César, était bien résolu à en finir. De quel côté était, je ne dirai pas le droit, mais la stricte légalité ? César avait en sa faveur trois lois : 1° Le plébiscite vatinien et le sénatus-consulte de l’année 59 qui lui avaient donné pour cinq ans le gouvernement des deux Gaules. 2° La loi consulaire Licinia-Pompeia qui, en 55, avait renouvelé son proconsulat pour une égale durée. 3° Le plébiscite des dix tribuns de l’année 52 qui l’autorisait à briguer absent un second consulat. Les deux premières lois lui assuraient dix ans de proconsulat, 58-49 ; la troisième, où il est facile de voir une confirmation indirecte des deux premières, lui conférait le droit de conserver ses provinces et son armée jusqu’à l’époque où il pourrait légalement demander un nouveau consulat. Comme il tenait à ce que ses adversaires ne pussent trouver aucun argument de droit contre lui, il n’avait jamais prétendu briguer les faisceaux consulaires avant le milieu de l’année 49, parce qu’une loi cornélienne, au-dessus de laquelle Pompée s’était placé, mais que tout le monde observait, avait exigé qu’il y eût, pour le même sénateur, un intervalle de dix années entre deux magistratures consulaires. Le sénat n’avait point soulevé la question de la durée des pouvoirs de César tant que l’union avait subsisté entre les triumvirs : en 56, la majorité admettait encore que le proconsulat des Gaules ne finissait qu’en 54. Mais, quand les meneurs eurent gagné Pompée en lui donnant une sorte de dictature, ils prétendirent que la loi Vatinia, votée en59, marquait le point de départ du gouvernement de César ; par conséquent que, suivant,le principe de droit que toute année commencée est tenue pour achevée, annus cœptus pro pleno habetur[95], le proconsulat décennal se terminait en 50 : thèse impossible à défendre, puisque, si cette loi eût fait César proconsul dés l’année 59, il aurait eu dans Rome, durant son consulat, l’imperium militaire, ce qui était contraire aux lois ; thèse d’ailleurs soutenue avec des variations de date et, dans Cicéron, avec des affirmations contradictoires qui prouvent que la haine contre César dictait seule l’opinion de ses adversaires. Pompée, par exemple, place le terme des pouvoirs de César au 1er mars 50, puis au 15 novembre de la même année[96]. Ainsi, à Rome, les grands pensaient, depuis leur
réconciliation avec Pompée, que les pouvoirs du proconsul des Gaules
expiraient en 50. Lui, au contraire, soutenait que l’année proconsulaire
datait du jour où le proconsul entrait dans sa province, et la raison comme
les textes obligent d’accepter cette opinion. Or il n’avait franchi la
frontière de Du reste, les subtils et savants calculs faits à ce propos tombent devant la loi parfaitement claire qui permettait à César de briguer le consulat quoique absent[98]. Cicéron reconnaît qu’en lui accordant ce privilège on l’avait par cela même autorisé à garder son armée jusqu’aux comices consulaires de juillet 49 : quum id datum, illud una datum. Toute la question est dans ces six mots, ou plutôt ces six mots la décident. Aussi, lorsque le consul Marcellus ouvrit dans le sénat la discussion sur la répartition des provinces, il abandonna la thèse que les pouvoirs de César étaient expirés, et, par une manœuvre peut-être habile, mais assurément peu honnête, il demanda que César fût obligé de venir à Rome solliciter le consulat : La loi, disait-il, ne lui permettait de conserver son armée que pour le temps de son consulat. Mais de la loi de 52 il effaçait le mot essentiel, le droit pour César de briguer absent[99]. Ce qui donnait au consul cette assurance, c’est qu’à Rome
on regardait la position de César comme très critique. On savait qu’il n’avait
que cinq mille hommes dans A la question de Marcellus : Doit-on envoyer un successeur au proconsul des Gaules ? La majorité fut pour l’affirmative. Doit-on retirer à Pompée ses pouvoirs ? Une faible minorité se prononça pour la motion. Mais Curion, au nom de l’intérêt public, changea ces questions en celles-ci : Les généraux doivent-ils abdiquer en même temps ? et trois cent soixante-dix voix contre vingt-deux appuyèrent la proposition : preuve que si la majorité sénatoriale préférait Pompée à César, elle préférait encore à Pompée la république. Au dehors, les plus vifs applaudissements accueillirent le courageux tribun. Curion avait trouvé la vraie solution pour ce mémorable conflit, celle qui sauvegardait la paix et ne compromettait pas l’avenir. César, de retour à Rome sans son armée, niais avec sa gloire, aurait gardé sur Pompée, privé comme lui de ses légions, l’ascendant du génie et, dans l’État, une influence qui lui eût permis de faire doucement entrer le gouvernement dans la voie où l’appelaient les besoins de l’empire. Mais les grands voulaient la perte de César, et ils savaient que, si les deux rivaux abdiquaient, César désarmé resterait encore pour eux redoutable. Ils ne pouvaient donc accepter de mesure commune aux deux proconsuls, et Pompée n’en voulait pas[100]. Marcellus rompit l’assemblée en s’écriant: Vous l’emportez ! Vous aurez César pour maître. Quelques jours après, au commencement de décembre, le bruit se répandit que l’armée des Gaules passait les Alpes ; Marcellus proposa d’appeler les cieux légions de Capoue ; Curion soutint, comme il était vrai, qu’aucun mouvement de troupes n’avait eu lieu. Alors Marcellus : Puisque je suis empêché de délibérer avec le conseil suprême sur les dangers de l’État, j’y pourvoirai seul, dit-il ; et traversant la ville, accompagné du consul désigné, Lentulus, et des sénateurs du parti[101], il se rendit vers Pompée, lui remit son épée, et lui ordonna de prendre, pour la défense de la république, le commandement de toutes les troupes cantonnées en Italie. Pompée accepta, en ajoutant, fidèle jusqu’au dernier moment à son hypocrite modération : Si l’on ne trouve pas d’expédient meilleur. L’expédient, en effet, était détestable, car le consul se substituait au sénat et au peuple ; de son autorité propre il investissait pompée de la dictature, en foulant aux pieds les sénatus-consultes aussi bien que les plébiscites. Il n’était pas possible de violer plus ouvertement la constitution ; et c’était une minorité sénatoriale qui commençait l’appel aux armes et la révolution ! Curion traita cette démarche inouïe[102] comme elle
méritait de l’être, et s’opposa à la levée des troupes. Mais sa charge
finissait, et les grands, entrés enfin dans les voies de la violence, ne
comptaient plus se laisser arrêter par un tribun. Avant le Il était alors à Ravenne avec la treizième légion, cinq mille
hommes de pied et trois cents chevaux. Curion le pressait d’attaquer. Afin de
continuer à se couvrir des apparences légales que son adversaire venait de
rejeter, il manda au sénat qu’il consentait à ne garder, jusqu’à son élection
au consulat, que Le veto des tribuns empêcha d’abord que l’avis de Scipion fût rédigé en forme de décret, et la foule du Forum il laquelle ils disaient que César ne demandait qu’à revenir, simple particulier, rendre compte à l’assemblée souveraine de son administration, s’indignait qu’on refusât d’écouter celui qui invoquait la justice du peuple. Pour faire taire ces propos et cette opposition, Pompée,
qui campait aux portes de Rome avec des troupes, envoya quelques cohortes
dans la ville ; et, à la séance du 6 janvier, le sénat rendit un décret qui
chargeait les consuls de veiller au salut de la république : c’était la
déclaration de guerre. Les tribuns persistant dans leur vélo, les consuls les
engagèrent à sortir de la curie s’ils voulaient éviter quelque outrage. A ces
mots, Antoine se leva, et prenant les dieux à témoin de la violence faite aux
magistrats populaires : C’est parce qu’ils
parlent au nom de la prudence et de l’équité, s’écria-t-il, qu’on les chasse honteusement, ainsi qu’on le ferait de
criminels et d’homicides. Puis, comme saisi d’une fureur
prophétique, il annonça la guerre, les meurtres, la proscription ; et il
appela la vengeance divine sur la tête de ceux qui provoquaient tous ces maux[106]. Mais des
soldats pompéiens approchaient ; ils allaient envelopper la curie. Antoine et
Cassius se bâtèrent d’en sortir, suivis de Cœlius et de Curion ; la nuit
suivante, tous quatre, cachés sous des habits d’esclaves, s’enfuirent vers le
camp de César. H avait déjà, aux yeux de beaucoup, la légalité officielle ;
avec eux, il parut avoir le droit populaire, et l’oligarchie le mettait dans
le cas de légitime défense ( Tandis que les tribuns se dirigeaient en toute hâte sur
Ariminurn, le sénat votait le décret de proscription et distribuait les
provinces au mépris des règles constitutionnelles. Il donna des commandements
à des sénateurs qui n’avaient point le droit d’en obtenir, de sorte qu’on vit
de simples particuliers se faire précéder dans Rome de licteurs. Scipion et
Domitius ne pouvaient être encore proconsuls ; le premier eut Si le tableau qui vient d’être tracé de la situation intérieure de Rome est véridique, l’ambition de César était légitime et sa victoire aussi désirable qu’elle était certaine, car il avait la force pour vaincre, comme il avait le génie polir mettre à profit la victoire et donner le repos dont le monde était affamé. L’humanité avance, selon les temps, par le pouvoir d’un seul aussi bien que par la liberté de tous. Mais il ne s’agissait pas de sacrifier la liberté. Où était-elle dans ces saturnales sanglantes qui, depuis si longtemps, faisaient de la vie du peuple romain la plus tragique des histoires ? Où était-elle pour ce grand corps des nations latines qui, au lieu de marcher vers l’avenir d’un pas assuré et tranquille, s’agitait sur place en convulsions violentes ? Chose étrange ! En notre siècle de démocratie et de coups d’État de la rue ou du palais, on est pour la faction des grands contre le chef populaire ; pour les héritiers de Sylla contre le successeur des Gracques ; pour la révolution qui se faisait Rome dans l’intérêt de quelques-uns contre celle qui, au passage du Rubicon, se fit au profit du plus grand nombre[107]. Tout le monde se laisse abuser par la fausse étiquette de république romaine placée sur les monuments et qu’on lira encore sur les enseignes des soldats de Probus. Sans doute, l’homme qui venait de rendre à Rome l’immense service de mettre à ses pieds cette race gauloise si redoutée et de refouler, pour trois siècles, l’invasion germanique, cet homme allait violer la loi qui défendait aux proconsuls de sortir en armes de leurs provinces. Mais n’en violait-on pas à son égard, et, après la déclaration de guerre des consuls, y avait-il encore des lois ? On demande, en vérité, trop à la nature humaine lorsqu’on suppose qu’il était possible au glorieux général, à coup sûr proscrit dans Rome[108] s’il y rentrait sans la protection d’une charge publique, de se remettre à la discrétion de nobles intrigants ou d’Épiménides qui avaient bien longtemps dormi. On ne voit pas que ceux qui prétendaient sauver la liberté n’entendaient sauver que les intérêts oligarchiques. Deux mots résument la question de légalité : les grands
commençaient la guerre pour faire exécuter leur sénatus-consulte illégal du |
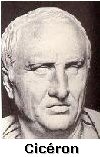 Quelque temps après son retour, une disette momentanée
causa une émeute : des cris de mort étaient proférés contre le sénat, et les
séditieux menaçaient de brûler les sénateurs dans la curie. Cicéron se hâta
de parer à Pompée sa dette de reconnaissance, en appuyant une motion qui le
chargeait pour cinq années de l’intendance des vivres, avec la surveillance
des ports et marchés dans tout l’empire
Quelque temps après son retour, une disette momentanée
causa une émeute : des cris de mort étaient proférés contre le sénat, et les
séditieux menaçaient de brûler les sénateurs dans la curie. Cicéron se hâta
de parer à Pompée sa dette de reconnaissance, en appuyant une motion qui le
chargeait pour cinq années de l’intendance des vivres, avec la surveillance
des ports et marchés dans tout l’empire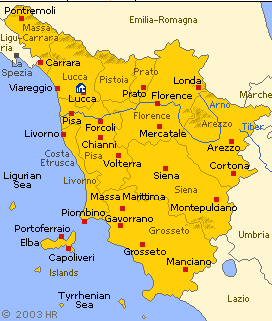 Il achevait à Lucques son hivernage, lorsqu’on apprit à
Rome que Crassus et Pompée s’étaient rendus près de lui, que deus cents
sénateurs lui faisaient leur cour, avec un tel nombre de personnages
importants, qu’on avait vu à sa porte jusqu’à cent vingt faisceaux de
préteurs et de proconsuls. Jupiter tonnant en un ciel serein aurait beaucoup
moins effrayé que la terrible nouvelle ; aussitôt, parmi les sénateurs restés
à Rome, des défections se produisirent. La plus considérable fut celle de
Cicéron.
Il achevait à Lucques son hivernage, lorsqu’on apprit à
Rome que Crassus et Pompée s’étaient rendus près de lui, que deus cents
sénateurs lui faisaient leur cour, avec un tel nombre de personnages
importants, qu’on avait vu à sa porte jusqu’à cent vingt faisceaux de
préteurs et de proconsuls. Jupiter tonnant en un ciel serein aurait beaucoup
moins effrayé que la terrible nouvelle ; aussitôt, parmi les sénateurs restés
à Rome, des défections se produisirent. La plus considérable fut celle de
Cicéron. Crassus avait soixante ans, une grande fortune
Crassus avait soixante ans, une grande fortune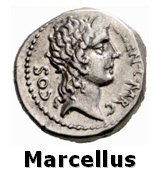 Les élections pour l’année 50 ne furent déjà plus dans le,
sens de Pompée : les consuls désignés, Æm. Paullus et un C. Claudius
Marcellus, étaient de zélés partisans du sénat. Dans les autres charges, les
candidats de cette opinion triomphèrent. La nomination au tribunat du jeune
Curion parut encore une victoire aux ennemis de César.
Les élections pour l’année 50 ne furent déjà plus dans le,
sens de Pompée : les consuls désignés, Æm. Paullus et un C. Claudius
Marcellus, étaient de zélés partisans du sénat. Dans les autres charges, les
candidats de cette opinion triomphèrent. La nomination au tribunat du jeune
Curion parut encore une victoire aux ennemis de César. 