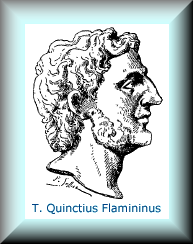|
I. — PREMIÈRES OPÉRATIONS DES ROMAINS EN GRÈCE.
Le vainqueur de Zama était à peine descendu du Capitole,
et les temples retentissaient encore d’actions de grâces, quand un des
consuls vint, au nom du sénat, dire aux centuries assemblées : Voulez-vous, ordonnez-vous que la guerre soit déclarée au
roi Philippe et aux Macédoniens pour avoir fait injure et guerre aux alliés
du peuple romain ? Tout d’une voix, les centuries repoussèrent la
proposition. On avait assez de gloire et de combats, on voulait du repos et
la paix ; mais déjà le peuple romain ne s’appartenait plus. Instrument d’une
nécessité que lui-même s’était imposée, il était invinciblement poussé à la
conquête du monde. En vain aurait-il voulu s’arrêter dans cette voie
sanglante où il perdra lui-même sa liberté. La victoire l’avait fait roi, il
fallait qu’il acceptât les soucis, les périls et les glorieuses misères de sa
royauté. Les sénateurs, disait le
tribun Bœbius, veulent éterniser la guerre pour
éterniser leur dictature. Le consul rappela le traité avec
Annibal, les quatre mille Macédoniens envoyés à Zama[1], les menaces de
Philippe contre les villes libres de Grèce et d’Asie ; ses attaques contre
les alliés de Rome en Orient, contre Attale de Pergame, les Rhodiens et
Ptolémée Épiphane, le pupille du sénat. En ce moment il assiégeait Athènes. Athènes sera une nouvelle Sagonte, et Philippe, un autre
Annibal. Portez la guerre en Grèce si vous ne voulez pas l’avoir en Italie.
Allez donc voter, dit-il en finissant, et
puissent les dieux qui ont agréé mes sacrifices et m’ont donné d’heureux
présages, vous inspirer de décréter ce que le sénat a résolu. Le
peuple céda. Cependant le sénat avait si peu de sérieuses alarmes qu’il
n’arma pour l’Italie et les provinces que six légions, bien que la guerre
recommençât alors dans la
Cisalpine, où le Carthaginois Amilcar soulevait les
Insubres.
On a vu plus haut quelles étaient la situation de la Grèce et de l’Orient, les
forces et les amitiés de chaque État. En Orient, Philippe s’était allié avec
Antiochus III
de Syrie et Prusias de Bithynie pour dépouiller de ses possessions de Thrace
et d’Asie le roi d’Égypte, Ptolémée Épiphane, que défendaient Rhodes et
Attale de Pergame. En Grèce, Sparte sous Nabis, Athènes, qui venait
d’échanger avec Rhodes le droit de cité, les Étoliens, qui dominaient d’une
mer à l’autre[2]
et occupaient les Thermopyles, étaient ses ennemis déclarés, et ses excès ne
lui avaient laissé que de tièdes amis. Le consul Sulpicius, chargé de le
combattre, emmena seulement deux légions ; Carthage lui donna du blé,
Masinissa des Numides, Rhodes et Attale leurs vaisseaux, les Étoliens, après
quelque hésitation, leurs cavaliers, les meilleurs de la Grèce. Nabis, sans
se déclarer pour Rome, était déjà en guerre ouverte avec les Achéens.
Dès que les opérations commencèrent, Philippe, malgré son
activité, se trouva comme enveloppé d’un réseau d’ennemis. Un lieutenant de
Sulpicius, envoyé au secours d’Athènes, brûla Chalcis, la principale ville de
l’Eubée ; les Étoliens, unis aux Athamanes, saccagèrent la Thessalie ; Pleurate,
roi d’Illyrie, et les Dardaniens descendirent en Macédoine ; enfin un autre
lieutenant poussa une reconnaissance jusque dans la Dassarétie. Ce
fut de ce côté que Sulpicius attaqua, c’est-à-dire par Lychnidos et la future
voie Égnatienne, en se dirigeant sur la forte place d’Héraclée (près de Monastir).
Philippe arriva à temps pour la couvrir et ferma aux Romains le défilé d’où
ils auraient pu descendre dans les fertiles plaines de la Lyncestide. Mais,
dans ces montagnes, la phalange macédonienne était inutile, et, bien que
Philippe eût réuni jusqu’à vingt-quatre mille hommes, il ne put empêcher le
Romain de tourner sa position par le nord et de déboucher dans la plaine par
la route de la Pélagonie[3]. Sulpicius se
trouva donc, au bout de quelques mois, au cœur de la Macédoine. Mais
l’hiver approchait ; sans magasins, sans places fortes, il ne pouvait
hiverner au milieu du pays ennemi : il revint à Apollonie.
Pendant l’été, la flotte combinée avait chassé des
Cyclades les garnisons de Philippe, pris Orée et pillé les côtes de la Macédoine (200). Quelques
ravages dans l’Attique, de légers avantages sur les Étoliens, qui s’étaient
jetés sur la Thessalie,
et la prise de Maronée, riche et puissante cité de la Thrace, n’effaçaient pas
pour Philippe le danger d’avoir laissé l’ennemi arriver jusqu’au cœur de son
royaume.
Le nouveau consul Tillius trouva l’armée mutinée et passa
la campagne à rétablir la discipline (199). Il n’y réussit sans doute qu’en donnant leur congé aux
mutins qui, partis pour cette guerre dans l’espérance d’une expédition rapide
et d’un riche butin, n’avaient eu ni l’un ni l’autre. Du moins, le successeur
de Tillius dut amener neuf mille nouveaux soldats. Encouragé par cette
inaction, le roi prit l’offensive et vint occuper sur les deux rives de
l’Aoüs, près d’Antigonie, une position inexpugnable qui couvrait la Thessalie et l’Épire,
et d’où il pouvait couper aux Romains leurs communications avec la nier,
s’ils recommençaient l’expédition de Sulpicius.
Le peuple venait d’élever au consulat Titus Quinctius
Flamininus, bien qu’il ne fût âgé que de trente-deux ans et qu’il n’eût
encore exercé que la questure l’année précédente ; mais sa réputation avait
devancé ses services ; d’ailleurs il était d’une de ces nobles familles qui
déjà se mettaient au-dessus des lois. Bon général, meilleur politique, esprit
souple et rusé, plutôt Grec que Romain, et de cette génération nouvelle qui
délaissait les traditions des aïeux pour les mœurs étrangères. Flamininus fut
le véritable fondateur de la politique machiavélique qui livra la Grèce sans défense aux
légions. On a voulu faire de lui un second Scipion, mais il n’a ni l’élévation
ni l’héroïsme Titus Quinctius de l’Africain. Le sang de Philopœmen et
d’Annibal doit retomber sur lui. On le voit, déjà les chefs de Rome diminuent
de grandeur, comme les intérêts qu’ils servent.
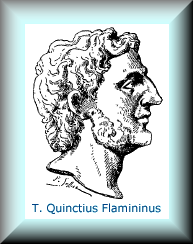
Flamininus ne fit d’abord pas mieux que son prédécesseur.
L’inutile tentative de Sulpicius avait montré que la Macédoine était
difficilement abordable par les montagnes du Nord-Ouest et l’attaque du Sud
par la flotte n’avait conduit qu’à des pillages qui ne terminaient rien.
Restait à tenter le passage de front. Mais Philippe s’était établi dans une
gorge serrée entre deux montagnes, dont les flancs abrupts et nus
descendaient jusqu’au fleuve, qui occupait presque toute la largeur de la
passe[4].
Durant six semaines, Flamininus resta en face du camp inattaquable
des Macédoniens. Chaque jour des escarmouches avaient lieu ; mais quand les Romains se perforceoyent de gravir contre mont,
ils estoyent accueillit de force coups de dards et de traicts, que les
Macédoniens leur donnoyent de çà et de là par les flancs : si estoyent les
escarmouches fort aspres pour le temps qu’elles duroyent, et y demouroyent
plusieurs blessez et plusieurs tuez d’une part et d’autre ; mais ce n’estoit
pas pour décider ni vuider une guerre[5]. Le découragement
arrivait, lorsque Charops, un chef épirote, dont l’armée macédonienne
épuisait le pays, fournit au consul les moyens de renoncer à cette dangereuse
inaction. Il lui envoya un berger qui, habitué à conduire son troupeau dans
le défilé de Cleïsoura, connaissait tous les sentiers de la montagne, et qui
offrit de mener les Romains en trois jours à un endroit où ils se
trouveraient au-dessus dit camp ennemi. Après s’être assuré que le pâtre
venait bien de la part du roi, Flamininus forma un corps d’élite de quatre
mille fantassins et de trois cents chevaux, lui commanda de ne marcher que la
nuit, la lune, en cette saison, suffisant à éclairer le chemin, et, arrivé au
lieu désigné par le pitre, d’allumer un grand feu dont la fumée annoncerait
aux légions le succès de l’entreprise. Le consul s’était assuré du guide par
deux moyens efficaces : promesse de grandes récompenses, s’il restait fidèle
; ordre aux soldats de le tuer, s’il les conduisait à une embuscade. Pour
attirer l’attention des Macédoniens vers le bas du fleuve, des attaques qui
semblaient devenir sérieuses se renouvelèrent incessamment durant deux jours.
Le troisième, au signal convenu, un cri immense s’élève du fond de la vallée
et, en même temps, descend des hauteurs qui dominent le camp royal. Les
Macédoniens, attaqués de front et menacés d’être tournés, s’épouvantent ; ils
fuient et ne s’arrêtent que dans la Thessalie, derrière la chaîne du Pinde[6].
Au bruit de cette victoire, qui donnait l’Épire à
Flamininus, les Étoliens se jetèrent sur la Thessalie, et
Amynander, roi des Athamanes, ouvrit aux Romains l’entrée de cette province
par le défilé de Goniphi. Philippe, n’osant risquer un nouveau combat,
s’était retiré dans la vallée de Tempé, après avoir pillé le plat pays, brûlé
les villes ouvertes et chassé les populations dans les montagnes. Cette
conduite offrait un dangereux contraste avec celle des Romains, auxquels
Flamininus faisait observer la plus exacte discipline, et qui avaient
souffert de la faim plutôt que de rien enlever dans l’Épire[7]. Aussi plusieurs
places ouvrirent leurs portes, et Flamininus était arrivé déjà sur les bords
du Pénée, quand la courageuse résistance d’Atrax arrêta sa marche
victorieuse. Près de là s’élevait l’importante ville de Larissa que les
Macédoniens occupaient en force. Le conseil recula.
Dans cette campagne, la flotte alliée avait pris, en
Eubée, Caryste et Érétrie (198), d’où elle enleva quantité
de statues, des tableaux d’anciens maîtres et des chefs-d’œuvre de toute
sorte. Les Macédoniens trouvés dans ces places durent livrer leurs
armes et payer une rançon de 300 sesterces par homme.
Au lieu de perdre l’hiver, comme ses prédécesseurs, en
retournant prendre ses quartiers autour d’Apollonie, Flamininus conduisit,
ses légions à Anécyrrhe, sur le golfe de Corinthe, où les vaisseaux de Corcyre
(Corfou), son
port de ravitaillement lui apporteraient en toute sécurité les provisions
dont il avait besoin. Il se trouvait là au centre de la Grèce. Tandis que
ses troupes enlevaient les petites villes de la Phocide et assiégeaient
la forte place d’Élatée, qu’elles finirent par prendre, ses négociations, ses
menaces, les conseils des amis de home et de nouvelles hostilités de Nabis
obligeaient les Achéens à accepter son alliance[8]. Il avait promis
de leur rendre Corinthe, mais la garnison macédonienne repoussa toutes les
attaques et enleva même Argos, qu’elle céda à Nabis. Cet affreux tyran y
proclama leur lois : l’une pour l’abolition des dettes, l’autre pour le
partage des terres ; ce qui montre bien le caractère que prenaient en Grèce
toutes les révolutions de ce temps. Nabis, ayant tiré de Philippe ce qu’il en
pouvait espérer, passa aussitôt dans le parti romain ; déjà le reste du
Péloponnèse y était entré.
Flamininus tenait à terminer lui-même cette guerre par une
paix ou mieux encore par une victoire. Philippe lui ayant demandé une
conférence, il l’accorda, et on y prit, de part et d’autre, les précautions
soupçonneuses dont on usa tant au moyen âge. Elle eut lieu sur le bord de la
mer, dans le golfe Maliaque. Le roi s’y rendit sur un vaisseau de guerre
escorté de cinq barques, mais refusa d’en descendre et parlementa du haut de
la proue de sa galère. Nous sommes bien mal ainsi,
lui dit Flamininus, si vous veniez à terre nous
pourrions mieux nous entendre. Le roi s’y refusant, il ajouta : Que craignez-vous donc ? — Je ne crains, reprit-il, que les dieux immortels, mais je n’ai pas confiance en
ceux qui vous entourent. Le jour se passa en vaines récriminations
; le lendemain le roi consentit à quitter son navire, à condition que
Flamininus éloignerait les chefs alliés, et il descendit à terre avec deux de
ses officiers. Le consul ne se fit suivre que d’un tribun ; on convint d’une
trêve de deus mois durant laquelle le roi et les alliés enverraient une
ambassade au sénat. Les Grecs exposèrent d’abord leurs griefs ; quand les
Macédoniens voulurent répliquer par un long discours, ils furent sommés de
dire seulement si leur maître consentait à retirer ses garnisons des villes
grecques, et, sur leur réponse, qu’ils n’avaient point d’instructions à cet
égard, on les congédia. C’est ce que Flamininus souhaitait.
Dans la
Grèce centrale, les seuls Béotiens hésitaient encore[9]. Flamininus leur
demande une conférence. Le stratège Antiphile sort à sa rencontre avec les
principaux Thébains. Il s’avance presque seul, avec le roi de Pergame, parle
à chacun des députés, les flatte, les distrait ; tout en causant, il arrive
aux portes et les mène jusqu’à la place publique, entraînant après lui tout
le peuple, avide de voir un consul et d’entendre un Romain qui parle si bien leur
langue. Mais deux mille légionnaires suivaient à quelque distance : tandis
que Flamininus tient la foule sous le charme, ils s’emparent des murs :
Thèbes était prise[10].
Dans cette campagne d’hiver, d’une espèce nouvelle,
Flamininus avait conquis la
Grèce et réduit Philippe aux seules forces de son royaume.
Il pouvait maintenant l’attaquer de front. Au retour du printemps, il l’alla
chercher jusqu’à Phères en Thessalie, à la tête de vingt-six mille hommes,
dont six mille étaient Grecs et parmi eux cinq cents Crétois. Philippe, qui
depuis vingt
ans usait ses forces dans de folles entreprises, ne put
réunir vingt-cinq mille soldats qu’en enrôlant jusqu’à des enfants de seize
ans[11]. Sur ce nombre
l’armée comptait seize mille phalangistes.
La diplomatie du sénat plutôt que ses armes avait eu les
honneurs de la première guerre de Macédoine. Cette fois, la légion, avec ses
mouvements rapides et ses armes de jet, les javelots et le terrible pilum, allait enfin se trouver aux prises avec
la phalange d’Alexandre, niasse épaisse, dont les soldats, placés sur seize
de profondeur et armés de lances longues de 21 pieds, semblaient une
muraille hérissée de piques. Depuis cette bataille de Chéronée qui avait mis la Grèce aux pieds de la Macédoine,
c’est-à-dire depuis cent quarante et un ans, la phalange était réputée le
plus formidable engin de guerre que l’homme eût encore trouvé.
Les Romains étaient sur les bords du golfe Pagasétique, à
portée de leur flotte ; Philippe à Larisse, son quartier générai. Les deux
armées allèrent à la rencontre l’une de l’autre et deux jours durant
marchèrent côte à côte, séparées par une chaîne de collines, sans qu’aucune
se doutât de ce dangereux voisinage. Qu’on suppose Annibal dans le camp
macédonien[12],
et Philippe aurait pu dire des Romains avec plus de vérité que le Nicomède de
notre grand tragique :
Et
si Flamininus en est le capitaine,
Nous
pourrons lui trouver un lac de Trasimène[13].
La bataille se livra en juin 497, près de Scotussa, dans
une plaine parsemée de collines nommées les Têtes de Chien, Cynocéphales. L’action s’engagea, malgré
les deux généraux, par la cavalerie étolienne, et Philippe n’eut ni le temps
ni les moyens de ranger sa phalange. Sur ce terrain accidenté, elle perdait
sa force avec son unité ; le choc des éléphants de Masinissa, une attaque
habilement dirigée sur ses derrières, et la pression inégale des légionnaires
la rompirent ; huit mille Macédoniens restèrent sur le champ de bataille. La
destruction de cette phalange, que les Grecs croyaient invincible, leur inspira
pour le courage et la tactique des Romains une admiration que Polybe lui-même
partage.
Philippe se réfugia avec ses débris dans la ville de
Gonnos, à l’entrée des gorges de Tempé, où se trouve la route habituelle de
Thessalie en Macédoine. Il y couvrait son royaume ; mais, n’ayant plus assez
de force ni de courage pour continuer la lutte, il demanda à traiter. Les
Étoliens voulaient pousser la guerre à outrance. Flamininus leur répondit en
vantant l’humanité des Romains. Fidèles à leur
coutume d’épargner les vaincus, ils ne renverseraient pas,
disait-il, un royaume qui couvrait la Grèce contre les Thraces,
les Illyriens et les Gaulois, et dont l’existence, n’osait-il
ajouter tout haut, était nécessaire à la politique du sénat pour balancer le
pouvoir des Étoliens. Philippe rappela ses garnisons des villes et des îles
de Grèce et d’Asie qu’elles occupaient encore, laissa libres les Thessaliens,
et donna aux Perrhèbes, c’est à-dire aux Romains, Gonnos, la vraie porte de
son royaume. Il livra sa flotte, moins cinq vaisseaux de transport, licencia
son armée, moins cinq mille hommes, s’engagea à ne point dresser un seul
éléphant de guerre, paya 500 talents[14], en promit 50
comme tribut annuel pendant dix ans, et jura de ne faire aucune guerre sans
l’assentiment du sénat.
Après l’avoir désarmé, on l’humilia comme roi, en le
forçant de recevoir et de laisser libres et impunis les Macédoniens qui
l’avaient trahi. Flamininus stipula même l’indépendance des Orestins, tribu
macédonienne qui s’était soulevée durant la guerre, et dont le pays était une
des clefs du royaume du côté de l’Illyrie romaine. Pour sûreté de ces
conditions, Philippe donna, des otages, parmi lesquels les Romains firent
comprendre son jeune fils Démétrius.
Au moment où la Macédoine subissait ce traité désastreux, le
roi de Syrie, Antiochus, à l’instigation d’Annibal, apprêtait ses forces. Flamininus, dit Plutarque, en plaçant à propos
la paix entre ces deux guerres, en terminant
l’une avant que l’autre eût commencé, ruina d’un seul coup la dernière espérance
de Philippe et la première d’Antiochus.
Les commissaires adjoints par le sénat à Flamininus
voulaient que des garnisons romaines remplaçassent celles du roi à Corinthe,
à Chalcis et à Démétriade : c’eût été trop tôt jeter le masque. Les Grecs
eussent vite compris que, avec les entraves de la Grèce remises
aux mains de Rome, toute liberté serait illusoire. L’opinion publique, si
mobile en un tel pays, était à craindre. Déjà les Étoliens, les plus
audacieux de tous, l’agitaient par des discours et des chansons. Ils
prétendaient que leur cavalerie avait gagné la bataille de Cynocéphales,
accusaient les Romains de méconnaître leurs services et raillaient les Grecs,
qui se croyaient libres parce qu’on leur avait mis au cou les fers qu’ils
portaient aux pieds. Flamininus vit bien que le meilleur moyen de faire
tomber ces accusations et de vaincre d’avancé Antiochus, qui menaçait de
passer en Europe, c’était d’employer contre lui l’arme qui avait si bien
réussi contre Philippe, la liberté des Grecs.

II — PROCLAMATION DE LA LIBERTÉ DE LA GRÈCE.
Durant la célébration des jeux isthmiques, auxquels la Grèce entière était
accourue, un héraut imposa tout à coup le silence et promulgua le décret
suivant : Le sénat romain et T. Quinctius,
vainqueur du roi Philippe, rendent leurs franchises, leurs lois et l’immunité
de garnisons et d’impôts aux Corinthiens, aux Phocidiens, aux Locriens, à
l’île d’Eubée et aux peuples de Thessalie. Tous les Grecs d’Europe et d’Asie
sont libres. Une joie immense éclata à ces paroles. Deux fois
l’assemblée se fit répéter le décret, et Flamininus faillit périr étouffé
sous les fleurs et les couronnes[15]. Il y avait donc, s’écriaient-ils, une nation sur la terre qui combattait, à ses risques et
périls, pour la liberté des peuples, qui passait les mers pour faire
disparaître toute domination tyrannique, pour établir en tous lieux l’empire
du droit, de la justice et des lois. Au libérateur de la Grèce on éleva, comme à un
demi-dieu, des temples, que Plutarque trouva encore debout trois siècles plus
tard et qui avaient leurs prêtres, leurs sacrifices et leurs chants
sacrés : Chantez, jeunes filles, le grand
Jupiter et Rome, et Titus notre sauveur.
Ainsi ce peuple, qui ne savait plus faire de grandes
choses pour la liberté, savait encore l’aimer avec passion et en payait d’une
apothéose la trompeuse image. Quand Flamininus s’embarqua, les Achéens lui
amenèrent douze cents prisonniers romains des guerres d’Annibal, qui avaient
été vendus en Grèce et qu’ils venaient de racheter de leurs deniers. Des Grecs
seuls savaient remercier ainsi (194).
Rome ne prenait rien des dépouilles de la Macédoine. La
Locride et la Phocide
retournaient à la ligue étolienne ; Corinthe à la ligue achéenne. Au roi
d’Illyrie, Pleurate, étaient donnés Lychnidus et le pays des Parthéniens,
limitrophe de la Macédoine
et pouvant par conséquent y conduire ; au chef des Athamanes, Amynander,
toutes les places qu’il avait prises durant la guerre ; au Pergaméen Eumène,
fils d’Attale, l’île d’Égine ; à Athènes, Paros, Délos et Imbros ; à Rhodes,
les villes de Carie[16] ; Thasos était
déclarée libre. Si les légions restaient dans la Grèce, c’est qu’Antiochus
approchait, et que les Romains voulaient, disaient-ils, la défendre après
l’avoir délivrée.
Flamininus avait d’autres vues encore. Malgré le don de
Corinthe, les Achéens étaient incapables de résister à Nabis, maître de
Gythion, de Sparte et d’Argos. Ce Nabis était un abominable tyran, dont la
cruauté est fameuse. Rome ne l’en avait pas moins reçu dans son alliance ;
elle l’en chassa lorsqu’elle crut n’avoir plus besoin de lui. Dans une
assemblée réunie à Corinthe, le proconsul représenta aux alliés l’antiquité
et l’illustration d’Argos : Devait-on laisser une
des capitales de la Grèce
aux mains d’un tyran ? Du reste, qu’elle fut libre ou asservie, il importait
peu aux Romains. Leur gloire d’avoir affranchi la Grèce en serait moins pure
sans doute ; mais, si les alliés ne redoutaient pas pour eux-mêmes la
contagion de la servitude, les Romains n’auront rien à dire, et ils se
rangeront à l’avis de la majorité. Les Achéens applaudirent à ces
hypocrites conseils et armèrent jusqu’à onze mille hommes[17]. Ce zèle alarma
Flamininus ; il voulait bien abaisser Nabis, non le détruire. Ses lenteurs
calculées, ses demandes d’argent et de vivres, fatiguèrent les alliés ; ils
le laissèrent bientôt traiter avec le tyran, qui livra l ‘Argolide, Gythion
et ses villes maritimes (195).
Ainsi Nabis restait dans le Péloponnèse contre les
Achéens, comme Philippe dans le Nord contre la ligue étolienne. Rome pouvait
rappeler maintenant ses légions ; car, avec ce mot trompeur : la liberté des
peuples, elle avait rendu l’union encore plus impossible, et augmenté les
haines, la faiblesse et les factions. Chaque ville avait déjà ses partisans
de Rome[18],
comme Thèbes, où ils venaient d’assassiner le béotarque Brachyllas ; et ces
hommes, dans leur aveuglement, poussaient la Grèce au-devant de la servitude. Il n’était
donc plus nécessaire de la tenir dans les entraves. Flamininus évacua sans
crainte Chalcis, Démétriade et l’Acrocorinthe.
Avant de quitter la Hellade, il offrit une couronne d’or au dieu de
Delphes et il consacra dans son temple des boucliers d’argent, sur lesquels
il avait fait graver des vers grecs qui célébraient, non pas la victoire de
Cynocéphales, mais la liberté rendue aux nations helléniques. C’était le mot
d’ordre : les Romains voulaient paraître des libérateurs, et les Grecs se
prêtaient à cette illusion. En réalité, lorsque Flamininus retourna triompher
à Nome, il y porta cet utile protectorat de la Grèce que tous les
successeurs d’Alexandre s’étaient disputé, sans le pouvoir saisir[19] (194).
|