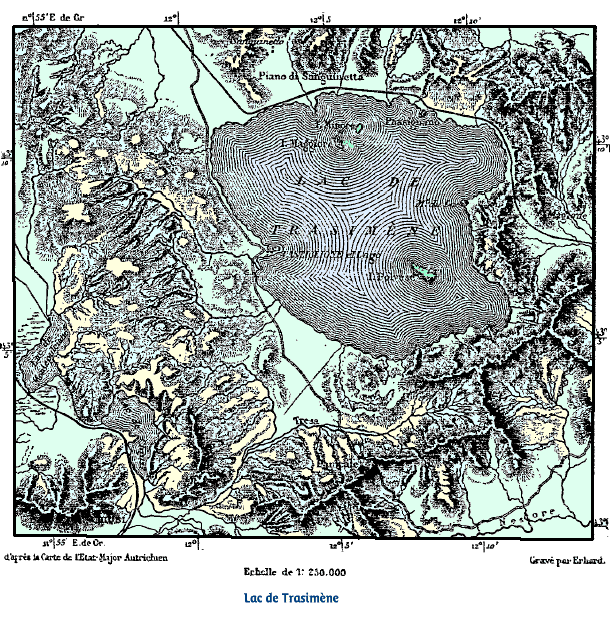|
I. — ANNIBAL EN ESPAGNE[1].
Si le sénat, répondant à l’appel d’Utique et des
mercenaires, durant la révolte des armées de Carthage, leur avait envoyé deux
légions, c’en était fait de la grande cité africaine ; Amilcar n’entreprenait
pas la conquête de l’Espagne, Annibal ne tentait point celle de l’Italie, et
des maux infinis étaient épargnés à d’innombrables populations. Rome manqua
d’audace. Ce n’est pas que le respect de la foi jurée l’arrêtât. Ses prêtres,
ses augures, lui auraient aisément trouvé les moyens de mettre en repos une
conscience peu scrupuleuse ; mais, au lendemain de la première guerre Punique,
elle avait à panser ses blessures ; et, n’osant risquer une grande iniquité,
elle se contenta d’une petite, le secours indirect donné aux mercenaires
d’Afrique et le rapt de la Sardaigne. Amilcar eut le temps de sauver
Carthage et de doubler son empire.
En l’année 218, à la veille de la seconde guerre l’unique,
les possessions des Carthaginois étaient dispersées depuis la Cyrénaïque, jusqu’aux
bouches du Tage et du Douro, sur une ligne de 8 à 900 lieues, mais étroite,
sans profondeur, et pouvant être à chaque instant coupée soit par les nomades
Africains dans leurs rapides incursions, soit par un ennemi qui trouvait
toujours à débarquer sur cette immense étendue de côtes. La république
romaine, au contraire, présentait l’aspect d’un empire régulièrement
constitué : Rome placée au centre de la péninsule ; la péninsule couverte
elle-même par trois mers ; et au delà de ces trois mers, comme autant de
postes avancés qui gardaient les approches de l’Italie, l’Illyrie, d’où les
légions surveillaient la
Macédoine et la
Grèce ; la
Sicile, d’où elles apercevaient l’Afrique ; la Corse et la Sardaigne, au milieu
de la route vers la Gaule
ou l’Espagne et qui commandaient la navigation de la mer Tyrrhénienne.
Ce qui ajoutait à la force de cette domination c’est que dans
la plus grande partie de l’Italie elle était acceptée, sinon avec amour, du
moins avec résignation[2]. Les peuples
pauvres et belliqueux aiment mieux payer tribut avec du sang qu’avec de l’or[3] ; et Rome ne
demandait aux Italiens que des soldats. En échange de leur orageuse
indépendance, elle leur avait donné la paix, qui favorisait le développement
de la population, de l’agriculture et du commerce. Ils n’avaient plus à
redouter que chaque nuit une troupe ennemie virile, moissonne leurs champs,
leurs vignes et leurs arbres, ravisse leurs troupeaux, briller leurs
villages, emmène en servitude leurs femmes et leurs enfants. Rome avait mis
un terme à ces maux et à ces terreurs qui, avant elle, se renouvelaient
chaque jour sur mille points de l’Italie. Ses censeurs couvraient la
péninsule de routes, desséchaient les marais, jetaient des ponts sur les
fleuves et construisaient des temples, des portiques, des égouts clans les
cités italiennes, de sorte que Rome n’était pas seule à bénéficier des
dépouilles du monde[4]. Pour défendre
les eûtes contre les descentes de l’ennemi ou des pirates, le sénat les avait
dernièrement encore garnies de colonies maritimes ; pour protéger les
marchands italiens, il avait déclaré la guerre aux Illyriens et à Carthage[5]. Quelques-uns des
grands usaient noblement de leur titre de patrons des villes, pour exécuter
au profit des alliés d’immenses travaux. Ainsi Curius était devenu le
protecteur de Reate en creusant un canal dans le roc d’une montagne pour
jeter dans la Nera
le trop-plein du lac Velinus[6]. Si l’on avait
encore la seconde décade de Tite-Live, on y trouverait sans doute beaucoup de
faits semblables qui montreraient que cette domination, établie par la force,
quelquefois par la violence et la perfidie, e faisait pardonner par ses
bienfaits.
La gloire de Rome rejaillissait d’ailleurs sur les
Italiens comme celle d’Athènes et de Sparte avaient été l’honneur de la Grèce. Tous, malgré
les différences de leur condition, venaient de se serrer autour d’elle à la
nouvelle d’une invasion gauloise, et nous verrons Annibal victorieux rester
deux ans au milieu de l’Italie sans y trouver un allié. Le temps avait
cimenté cet édifice construit par le sénat durant la guerre du Samnium et
fait de toutes les nations italiennes une masse inébranlable par son union.
Cependant, dans les derniers pays soumis, il y avait encore parmi le peuple,
dont le patriotisme est souvent plus désintéressé que celui des grands, des
regrets pour la liberté perdue[7]. Mais partout la
noblesse s’était franchement ralliée aux Romains, comme à Vulsinies, à
Arretium, à Capoue, à Nole, à Nucérie, à Tarente, à Compsa et dans la Lucanie ; des alliances
de famille entre cette noblesse italienne et celle de Rome resserraient
encore ces liens. A Venise, les nobles du livre d’or méprisèrent ceux de la`
terre ferme ; à Rome, Ap. Claudius prenait pour gendre un Campanien, et le
consulaire Livius épousait la fille d’un sénateur de Capoue[8].
Il s’en fallait que l’empire des Carthaginois, en
apparence si colossal, reposât sur d’aussi fermes appuis. Les énormes
contributions frappées sur leurs sujets et les atrocités de la guerre
inexpiable ne les, avaient pas sans doute réconciliés avec les Africains.
Utique même et Hippone-Zaryte avaient voulu se donner aux Romains Sur les
côtes de la Numidie
et de la Maurétanie,
quelques postes occupés de loin en loin et cernes par les barbares, étaient à
peine suffisants pour porter aide et secours aux navires dans la dangereuse
traversée d’Espagne. En Espagne même l’autorité de Carthage, ou plutôt d’Annibal,
n’était sûrement établie que dans la Bétique. Dans le reste du pays jusqu’à libre,
les peuples avaient été vaincus, mais non
domptés ; et les généraux romains pourront s’y présenter bien plus facilement
qu’Annibal en Italie, comme les libérateurs de la péninsule[9].
Amilcar avait élevé ses fils dans la haine de Rome. Ce sont quatre lionceaux, disait-il en les
montrant, qui grandiront pour sa ruine
; et Annibal dans sa vieillesse contait au roi Antiochus qu’avant de partir
pour l’Espagne, son père, au milieu d’un sacrifice solennel, lui avait fait
jurer une haine éternelle aux Romains.
 Dès son arrivée au camp
d’Asdrubal, dit Tite-Live, il attira
sur lui tous les yeux. Les vieux soldats crurent revoir Amilcar dans sa
jeunesse : c’était sur son visage la même expression d’énergie, le même feu
dans le regard. II ne tarda guère à n’avoir plus besoin du souvenir de son
père pour se concilier la faveur. Jamais esprit ne fut plus propre à deux
choses opposées, obéir et commander ; aussi eût-il été difficile de décider
qui le chérissait davantage du général ou de l’armée. Asdrubal ne cherchait
point d’autre chef quand il s’agissait d’un coup de vigueur ; et, sous nul
autre, les soldats ne montraient plus de confiance. D’une audace incroyable
pour affronter le danger, il gardait dans le péril une merveilleuse prudence.
Nul travail ne fatiguait son corps, n’abattait son esprit. Il supportait
gaiement le froid et le chaud. Pour sa nourriture, il donnait satisfaction au
besoin, jamais au plaisir. Ses veilles, son sommeil, n’étaient point réglés
par le jour et la nuit. Les affaires terminées, il ne cherchait le repos ni
sur une couche moelleuse ni dans le silence. Souvent on le vit, couvert d’une
casaque de soldat, étendu sur la terre, entre les sentinelles avancées ou au
milieu du camp. Son vêtement ne se distinguait pas de celui de ses compagnons
; tout son luxe était dans ses chevaux et dans ses armes. Le meilleur à la
fois des cavaliers et des fantassins, il allait le premier au combat et se
retirait le dernier. Tant de qualités étaient accompagnées de grands vices :
une cruauté féroce, une perfidie plus que punique, nulle franchise, nulle
pudeur, nulle, crainte des dieux, nul respect pour la foi du serment, nulle
religion. Avec ce mélange de vertus et de vices, il servit trois ans sous
Asdrubal ; sans rien négliger de ce que devait faire ou voir un futur général
des armées carthaginoises. Dès son arrivée au camp
d’Asdrubal, dit Tite-Live, il attira
sur lui tous les yeux. Les vieux soldats crurent revoir Amilcar dans sa
jeunesse : c’était sur son visage la même expression d’énergie, le même feu
dans le regard. II ne tarda guère à n’avoir plus besoin du souvenir de son
père pour se concilier la faveur. Jamais esprit ne fut plus propre à deux
choses opposées, obéir et commander ; aussi eût-il été difficile de décider
qui le chérissait davantage du général ou de l’armée. Asdrubal ne cherchait
point d’autre chef quand il s’agissait d’un coup de vigueur ; et, sous nul
autre, les soldats ne montraient plus de confiance. D’une audace incroyable
pour affronter le danger, il gardait dans le péril une merveilleuse prudence.
Nul travail ne fatiguait son corps, n’abattait son esprit. Il supportait
gaiement le froid et le chaud. Pour sa nourriture, il donnait satisfaction au
besoin, jamais au plaisir. Ses veilles, son sommeil, n’étaient point réglés
par le jour et la nuit. Les affaires terminées, il ne cherchait le repos ni
sur une couche moelleuse ni dans le silence. Souvent on le vit, couvert d’une
casaque de soldat, étendu sur la terre, entre les sentinelles avancées ou au
milieu du camp. Son vêtement ne se distinguait pas de celui de ses compagnons
; tout son luxe était dans ses chevaux et dans ses armes. Le meilleur à la
fois des cavaliers et des fantassins, il allait le premier au combat et se
retirait le dernier. Tant de qualités étaient accompagnées de grands vices :
une cruauté féroce, une perfidie plus que punique, nulle franchise, nulle
pudeur, nulle, crainte des dieux, nul respect pour la foi du serment, nulle
religion. Avec ce mélange de vertus et de vices, il servit trois ans sous
Asdrubal ; sans rien négliger de ce que devait faire ou voir un futur général
des armées carthaginoises.
Tite-Live exagère certainement les vices d’Annibal, et il
ne met en relief que les qualités du soldat. L’histoire de la seconde guerre
Punique va nous montrer le grand capitaine. héritier de l’ambition des Barcas
avec plus de génie et d’audace, Annibal voulut se faire, aux dépens de Rome,
un empire qu’il n’était pas assez fort pour se faire aux dépens de Carthage[10]. Une guerre
italienne était d’ailleurs un moyen glorieux de mettre un terme à la lutte
que soutenaient sa famille et son parti ; et, malgré les traités, malgré la
plus saine partie du sénat[11], il la commença.
Il ne demanda rien à Carthage, ne mit d’espoir qu’en lui-même et dans Ies
siens : puis, entraînant sur sa route Espagnols et Gaulois, il franchit les
Alpes. Sa conduite devant. Sagonte, le choix de la route qu’il prit, pour ne
point se mettre dans la dépendance des flottes de Carthage ; ses promesses à
ses troupes[12],
son traité avec Philippe, l’abandon où Carthage le laissa après Cannes, le
pouvoir presque illimité. que, vaincu, il sut encore saisir dans sa patrie,
montrent ses secrets desseins et ce qu’il aurait fuit de la liberté de son
pays, s’il y était rentré victorieux. La seconde guerre Punique n’est qu’un
duel entre Annibal et Rome, et en parlant ainsi nous ne croyons pas diminuer
l’importance de la lutte, parce qu’elle montrera ce qu’il y a de force et
d’inépuisables ressources dans le génie d’un grand homme, comme dans les
institutions et les mœurs d’un grand peuple[13].
Amant de commencer cette guerre, il fallait être sûr de
l’Espagne. Le Sud et l’Est étaient soumis, mais les montagnards du centre et
de la haute vallée du Tage résistaient encore. Annibal écrasa les Olcades
dans la vallée du Xucar (221),
les Vacéens dans celle du Douro et les Carpétans sur les rives du Tage aux
environs de Tolède (220).
Les Lusitaniens et les peuples de la Galice restaient libres, Annibal se garda bien
d’aller user contre eux son temps et ses forces. Jusqu’à l’Èbre, l’Espagne
paraissait soumise ; c’était assez pour ses desseins.
Dans le traité imposé par Rome à Asdrubal, l’indépendance
de Sagonte au sud de l’Èbre avait été formellement garantie. Pour engager
irrévocablement la guerre, Annibal, à la tête de cent cinquante quille
hommes, vint assiéger cette place, qui aurait servi d’arsenal et de point
d’appui aux légions s’il leur avait laissé le temps d’arriver en Espagne.
Cette conduite était injuste, mais habile. Sagonte, ville grecque et commerçante,
à mi-chemin entre l’Èbre et Carthagène, faisait, sur cette côte, concurrence
aux marchands carthaginois ; Annibal voulut la leur offrir comme victime, en
expiation de la guerre qu’il les forçait d’accepter. Par le pillage d’une des
plus grandes cités de la péninsule il comptait aussi acheter d’avance le
dévouement de ses soldats. Rome lui envoya des députés ; il refusa de les
recevoir, sous prétexte qu’il ne pourrait répondre de leur vie s’ils se
risquaient au milieu de tant de soldats barbares. Les députés allèrent à
Carthage demander qu’on leur livrât l’audacieux général.
Malgré le juste ressentiment qu’elle avait gardé de la
conduite de Rome dans l’affaire de la Sardaigne, Carthage ne souhaitait pas la
guerre. Ses riches marchands, voyant les Romains dédaigner les profits du
négoce, et Marseille, Syracuse, Naples, Tarente, prospérer sous leur
domination ou dans leur alliance, s’étaient déjà familiarisés avec l’idée de
la suprématie romaine. Mais le peuple et le sénat étaient dominés par la faction
barcine. Malgré les efforts d’Hannon, il fut répondu aux députés que Sagonte
avait elle-même allumé cette guerre, et que les Romains agiraient injustement
s’ils préféraient cette ville à Carthage, leur plus ancienne alliée.
Durant ces ambassades, Sagonte était presse avec la
dernière vigueur. Située, dit
Tite-Live, à environ 1000 pas du rivage[14], elle n’avait pas la mer pour défense, et Annibal put
l’attaquer de trois côtés à la fois. Un angle de la muraille s’avançait dans
une vallée ouverte : il poussa de ce côté ses mantelets à l’abri desquels le
bélier pouvait être conduit jusqu’au pied du rempart. Mais ce mur, étant la
partie de l’enceinte la plus menacée, en était aussi la pus forte : une haute
tour le dominait, et la garde en était confiée aux plus braves des Sagontins.
Ils gênaient les travaux en lançant sua les assiégeants une grêle de traits
et de projectiles de toutes sort s ; puis, lorsqu’ils croyaient avoir écarté
l’ennemi, ils se jetaient sur les ouvrages et tâchaient de les détruire. Ces combats
se renouvelaient souvent ; dans l’un d’eux, Annibal eut la cuisse traversée
d’une javeline. Quand ses soldats le virent tomber, il y eut parmi eux tant
de confusion et d’épouvante, que les mantelets faillirent être abandonnés et
que, pendant quelques jours, le siège se changea en blocus.
Annibal guéri, l’attaque fut
reprise avec acharnement, et les travaux d’approche atteignirent le pied du
mur, que le bélier ébranla en plusieurs endroits. Trois tours et la muraille
qui les joignait s’écroulèrent avec fracas. Déjà les Carthaginois se
croyaient maîtres de la ville. Mais les Sagontins, couvrant, à défaut de
murs, la cité de leurs corps, arrêtèrent l’ennemi au milieu des décombres.
Ils avaient un javelot en bois de sapin terminé par un fer acéré, long de 3 pieds, qui pouvait
transpercer tout à la fois l’armure et le corps. À l’endroit où le fer
sortait de la hampe était, une étoupe goudronnée qu’on allumait ait moment de
lancer le javelot et dont le jet activait la flamme. Aussi la falarique,
c’était son nom, causait-elle une grande frayeur. Lors même qu’elle
s’arrêtait dans le bouclier[15] sans blesser le soldat, elle le forçait, par crainte dut
feu, à jeter ses armes et à s’exposer sans défense aux coups de l’ennemi.
Ces attaques avaient eu lieu avant l’arrivée des députés
romains au camp d’Annibal et à Carthage. Elles recommencèrent après la
rupture des négociations, et pour exciter l’ardeur des soldats, Annibal leur
promit tout le butin de la ville. Durant la trêve, les Sagontins avaient
élevé un nouveau mur derrière la brèche, mais les assauts recommencèrent plus
terribles : l’innombrable armée punique enveloppant presque toute l’enceinte,
les assiégés ne savaient, au milieu des clameurs qui retentissaient de toutes
parts, quel endroit ils devaient secourir de préférence. Annibal était
présent partout. II avait fait construire une tour mobile plus élevée
qu’aucune des fortifications de Sagonte et divisée en étages dont chacun
était armé de balistes ou de catapultes qui couvraient de leurs projectiles
le haut du mur et en chassaient les défenseurs. Ceux-ci ne pouvant plus
défendre l’approche de, leur muraille, il envoya cinq cents Africains qui
attaquèrent l’enceinte à coups de pioche ; et, comme elle n’était formée que
de pierres liées avec un ciment de terre, une large ouverture fut pratiquée
par où l’ennemi pénétra dans la ville. Mais le combat recommença de maison à
maison, et les Carthaginois, ayant réussi à s’emparer d’une hauteur,
l’environnèrent ; d’un mur et y établirent des catapultes et des balistes pour
battre de là l’intérieur de Sagonte. C’était une citadelle qu’ils avaient
dans la ville même et qui la dominait. Les Sagontins, de leur côté,
couvrirent d’un nouveau mur ce. qu’ils possédaient encore de leur ville.
Resserrés de jour en jour davantage, ils voyaient. leur dénuement s’accroître
et l’espoir d’un secours s’évanouir. La confiance revint un moment, lorsqu’on
apprit qu’Annibal était obligé de marcher contre les Orétans et les
Carpétans, que soulevait la rigueur des levées. Mais Sagonte ne gagna rien à
ce départ dit général ; Maharbal, chargé de continuer le siège, déploya une
telle activité, que ni les assiégeants ni les assiégés ne s’aperçurent de
l’absence du chef. Ce dernier, au retour de sa courte et heureuse campagne,
engagea un combat sanglant à la suite duquel une partie de la citadelle des
Sagontins fut emportée. Alors deux hommes, Alcon de Sagonte et l’Espagnol
Alorcus, essayèrent de ménager un accommodement. Les conditions exigée, par
le vainqueur furent telles, qu’Alcon n’osa même pas les faire connaître à ses
concitoyens : Annibal ne laissait aux habitants que la vie et deux vêtements
; ils devaient livrer leurs armes, leurs richesses, abandonner leur ville et
se retirer en un lieu qu’il leur désignerait. Alorcus, qui avait été autrefois
l’hôte des Sagontins, s’offrit à leur porter ces dures propositions. Il
s’avança en plein jour vers les sentinelles ennemies, auxquelles il remit ses
armes, et, avant franchi les retranchements, il se fit conduire chez le
principal magistrat, qui l’introduisit dans le sénat. Il n’avait point fini
de parler que les plus considérables parmi les sénateurs faisaient dresser
sur la place publique un bûcher, y jetaient l’or et l’argent trouvés dans le
trésor public ou dans leurs maisons et s’y précipitaient eux-mêmes. Ce
spectacle avait déjà répandu la consternation
dans la foule accourue des remparts sur le forum, lorsque de glands cris
s’élevèrent : une tour s’écroulait et une cohorte carthaginoise, s’élançant
sur les ruines, apprenait au chef de l’armée que la place était dégarnie de
défenseurs. Annibal, accouru avec toutes ses forces, s’ouvrit facilement
passage et commanda de tuer tous ceux qui étaient en âge de porter les armes
: Mesure cruelle, dit Tite-Live, mais dont la nécessité fut démontrée par l’événement : car
comment épargner des hommes qui se brûlaient dans leurs maisons avec leurs
femmes et leurs enfants, ou qui, les armes à la main, combattaient jusqu’au
dernier soupir[16] (219).
Cette résistance héroïque dont l’Espagne donnera d’autres
exemples avait duré huit mois. Une partie des richesses de Sagonte envoyée à
Carthage diminua encore le nombre des partisans de la paix, et, quand une
seconde ambassade arriva de Rome pour demander une solennelle réparation, ce
furent les Romains qu’on accusa de violer les traités. La discussion se
prolongeait dans le conseil des anciens. A la fin Fabius, relevant un pan de
sa toge, s’écria : Je porte ici la paix ou la
guerre, choisissez ! — Choisissez
vous-même, répondit-on de toutes parts. — Eh bien ! la guerre, reprit Fabius ; et il
laissa retomber sa toge comme s’il secouait sur Carthage la mort et la
destruction (219).
Annibal hâta ses préparatifs. Il envoya quinze mille
Espagnols tenir garnison dans les places de l’Afrique, et il appelé en
Espagne quinze mille Africains : les uns et les autres seraient dis otages
qui répondraient de la fidélité des deus pays. Son armée s’élevait à
quatre-vingt-dix mille fantassins, avec douze mille chevaux et cinquante-huit
éléphants. Une défaite navale aurait ruiné sans retour ses projets, et les
flottes de Carthage ne dominaient plus sur la Méditerranée. Il
résolut de s’ouvrir une route par terre. C’était une entreprise bien hardie
que d’aller chercher les Romains jusqu’au cœur de l’Italie, en laissant
derrière soi les Alpes, le Rhône et les Pyrénées. Mais, depuis l’aventureuse
expédition d’Alexandre, tout semblait possible avec de l’audace. Peut-être
Annibal ne croyait-il pas Rome plus forte en Italie que Carthage ne l’était
en Afrique. Des émissaires secrètement envoyés, avec de l’or, chez les
Gaulois et les Cisalpins, pour étudier Ies passages des montagnes et les
dispositions des peuples, avaient rapporté des réponses favorables. Les Boïes
et les Insubres, dans la vallée du Pô, promettaient de se lever en masse, et
il semblait peu difficile de rallumer la haine mal éteinte des derniers
Italiens que Tome avait vaincus. Capoue ne se résignait pas au rôle obscur
d’une cité sujette ; les Samnites saris doute se réveilleraient, et Tarente,
et l’Étrurie !... Et puis on n’avait que le chois de recevoir la guerre ou de
la porter en Italie ; déjà le consul Sempronius faisait à Lilybée d’immenses
préparatifs pour une descente, et Scipion levait des troupes qu’il voulut
conduire en Espagne. Il fallait les prévenir. L’exemple de Regulus prouvait
les avantages de la guerre offensive ; ce système était le seul d’ailleurs
qui convint à la position d’ Annibal, et celui auquel on serait toujours
forcé de revenir, même après des victoires en Afrique et en Espagne. S’il y
avait des dangers dans cette marche, on devait aussi compter sur le prestige
qui entourerait l’armée, quand les Italiens verraient descendre de la cime
des Alpes ces soldats partis des Colonnes d’Hercule et leur apportant la
liberté. Depuis Pyrrhus, pas un ennemi n’avait pénétré dans l’Italie
centrale. Au milieu de ce riche pays, la guerre nourrirait la guerre, et l’on
pourrait se passer de Carthage. Si de nouvelles forces étaient nécessaires,
Magon, laissé entre l’Èbre et les Pyrénées avec onze mille soldats, Asdrubal,
qui restait en Espagne avec quinze mille hommes, cinquante-cinq vaisseaux et
vingt et un éléphants, suivraient la route «Annibal allait leur tracer, se
recrutant en chemin de tous ces Gaulois si mal disposés pour Rogne et qui
depuis si longtemps connaissaient et aimaient le lucratif service de Carthage[17].
Quand il conçut ce plan audacieux, Annibal n’avait que
vingt-sept ans : l’âge de Bonaparte à Lodi[18].

II. — ANNIBAL EN GAULE ; PASSAGE
DES ALPES.
Après un sacrifice solennel offert dans Cades à Melkarth,
le grand dieu de la race phénicienne, Annibal partit de Carthagène au
printemps de l’année 218 et arriva au bord de l’Èbre avec cent deux mille
hommes. Au delà de ce fleuve, le pays est difficile, hérissé de montagnes,
dont une, le Monserrat, haut de 1300 mètres, est presque impraticable. Il
passa avec le gros de ses forces entre elle et la mer, dans la direction
d’Emporium, taudis que des corps détachés allaient vers le nord-ouest
refouler les montagnards dans les hautes vallées. Il aurait voulu ne pas
laisser un seul ennemi entre l’Èbre et les Pyrénées ; on verra les Scipions y
trouver bien vite des amis. Beaucoup de soldats avaient déserté avant de
franchir les montagnes, quelques autres s’effrayaient ; il en renvoya onze
mille, donna encore dix mille hommes d’infanterie et mille chevaux à son
jeune frère Hannon pour garder les passages, et entra en Gaule avec cinquante
mille fantassins et neuf mille cavaliers, tous vieux soldats dévoués à sa
fortune ; trente-sept éléphants suivaient l’armée.
En quittant Carthage, les ambassadeurs romains s’étaient
rendus en Gaule pour engager les barbares à fermer aux Carthaginois les
passages des Pyrénées. A cette proposition de combattre pour le peuple qui
avait abandonné Sagonte et qui opprimait les Gaulois italiens, il s’éleva
dans l’assemblée des Bébryces (Roussillon) de tels rires,
dit Tite-Live (XXI, 20), mêlés de cris furieux, que les vieillards eurent peine à
calmer la jeunesse. De retour à Rome, les députés racontèrent que
dans toutes les cités transalpines, Marseille exceptée, ils n’avaient pas
entendu une parole de paix ou d’hospitalité, et que la haine pour Rome,
l’argent répandu par les émissaires d’Annibal, préparaient au Carthaginois
une route facile. Il fallait donc le retenir dans sa péninsule. Le consul
Sempronius, qui de la Sicile
préparait une descente en Afrique, eut ordre de redoubler d’activité, et P.
Scipion, son collègue, pressa les levées pour l’armée d’Espagne. A ce moment,
le sénat croyait que quatre légions suffiraient pour avoir raison de Carthage
et de ce jeune présomptueux : c’est vingt-trois qu’il faudra bientôt armer
contre le seul Annibal.
On prit aussi des précautions contre les Cisalpins. Pour
les contenir, deux colonies, chacune de six mille hommes, furent envoyées à
Crémone cet à Plaisance. Mais les Boïes et les Insubres dispersèrent les
colons, les chassèrent jusque dans Modène, qu’ils assiégèrent, et surprirent
au milieu d’une forêt le préteur Manlius, qui faillit y périr. Ces événements
retardèrent le départ de Scipion et le prièrent d’une légion qu’il dut
envoyer aux colonies du Pô. Cependant, quand sa flotte entra dans le port de
Marseille, il croyait Annibal encore au delà des Pyrénées ; le Carthaginois
était déjà sur le Rhône[19].
Les Bébryces avaient fait avec lui un traité d’alliance[20] ; les Volks Arécomiques
virent une menace pour leur indépendance dans cette grande armée qui
s’approchait et se retirèrent derrière le Rhône afin d’en disputer le
passage. Annibal les trompa : il envoya une partie de ses troupes traverser
secrètement le fleuve à 25 milles au-dessus du camp des barbares, avec
mission de les prendre à dos, quand il tenterait lui-même le débarquement.
Troublés par cette double attaque et par l’incendie de leur camp, les Folks
se dispersèrent. Annibal avait mis ses éléphants sur d’immenses radeaux, et
ses troupes sur des barques achetées à tous les peuples riverains ; les
chevaux suivaient à la nage ; les Espagnols avaient passé sur des outres et
sur leurs boucliers[21].
Le lendemain, cinq cents Numides descendirent le Rhône
pour éclairer le bas du fleuve. Ils rencontrèrent une reconnaissance de trois
cents cavaliers romains conduits par des guides gaulois à la solde de
Marseille. Les deux troupes se chargèrent. Il ne revint que trois cents
Numides ; les Romains avaient perdu cent soixante hommes, mais ils citaient
restés maîtres du champ de bataille. Plus tard on vit dans ce combat un
présage de l’acharnement de cette guerre, du sang qu’elle coûterait et de
l’issue qu’elle devait avoir.
Annibal hésitait, il avait encore quarante-six mille
hommes : devait-il poursuivre sa marche ou se retourner contre le consul, qui
levait son camp pour venir l’attaquer ? Une victoire en Gaule n’aurait rien
décidé ; d’ailleurs un chef boïen venait d’arriver au camp offrant des guides
et l’alliance de son peuple. Annibal s’éloigna du consul en remontant le long
du fleuve. Quelle route prit-il ? Ici Polybe et Tite-Live différent, et après
eux tous les modernes[22]. Polybe avait
visité les lieux et interrogé des montagnards qui avaient vu passer
l’expédition : son récit doit être suivi ; malheureusement il ne lève pas
toutes les difficultés, qui resteront sans doute insurmontables. Au reste,
qu’Annibal ait passé par le mont Cenis, le mont Viso, le mont Genèvre ou le
petit Saint-Bernard, il importe peu à l’histoire, qui s’intéresse surtout au
résultat : les Alpes audacieusement franchies par une grande armée.
Après quatre jours de marche, Annibal entra dans l’île des Allobroges, que forment le Rhône
et l’Isère. Deux frères, dans ce pays, se disputaient le pouvoir ; il prit le
parti de l’aîné, le fit triompher, et reçut en retour des vivres et des
vêtements dont ses soldats allaient avoir un si grand besoin. Le nouveau roi
voulu même l’accompagner avec tous ses barbares jusqu’au pied des montagnes.
Déjà on voyait les Alpes, leurs neiges éternelles et leurs pics menaçants.
Mais Annibal avait fait traduire à ses troupes les discours des députés
boïens, leur promesse de les guider par une route courte et sûre, le tableau
qu’ils traçaient de la magnificence et de la richesse des pays au delà des
Alpes. Aussi la vue de ces montagnes redoutées, loin d’abattre les courages,
animait les soldats[23], comme si elles
étaient elles-mêmes le terme de la guerre, comme si c’étaient les murs de
Rome, ainsi que le disait Annibal, qu’ils allaient escalader en les passant.
Ce fut au milieu d’octobre que les Carthaginois entrèrent
dans les Alpes[24].
La neige cachait déjà les pâturages et les sentiers, et la nature semblait
frappée d’engourdissement ; un pâle soleil d’automne ne dissipait que
lentement l’épais brouillard qui chaque matin enveloppait l’armée, et de
longues et froides nuits, troublées par le bruit solennel des lointaines
avalanches et des torrents roulant au fond des précipices, glaçaient les
membres de ces hommes d’Afrique. Cependant le froid et la neige, et les
précipices et les chemins non frayés, ne furent pas les plus grands
obstacles. Mais les montagnards essayèrent plusieurs fois de barrer la route
aux Carthaginois. Un jour Annibal se trouva en face d’un défilé gardé par les
Allobroges et que dominaient dans toute sa longueur des rochers à pic
couronnés d’ennemis. Il s’arrêta et fit dresser un camp ; heureusement les
guides gaulois l’avertirent que la nuit les barbares se retiraient dans leur
ville. Avant le jour, il occupa le défilé et les hauteurs avec des troupes
légères. Il n’y en eut pas moins un sanglant combat, et, pendant quelques
heures, une horrible confusion. Les hommes, les chevaux, les bêtes de somme,
roulaient dans les précipices ; nombre de Carthaginois périrent. Cependant
l’année passa, prit la ville et y trouva des vivres et des chevaux qui
remplacèrent ceux qu’on avait perdus. Plus loin, une autre peuplade vint
au-devant d’Annibal, portant des rameaux en signe de paix et offrant des
otages et des guides. Il accepta, mais en prenant des mesures pour n’être
point trompé. La cavalerie et les éléphants, dont la vue seule effrayait les
barbares, formèrent l’avant-garde ; l’infanterie resta derrière, les bagages
au centre. Le deuxième jour, l’armée entra dans une gorge étroite où les
montagnards l’attendaient, cachés dans le creux des rochers. Toute une nuit,
Annibal fut coupé de sols avant-garde ; ce fut la dernière attaque. Après
neuf jours de marche, il atteignit le sommet de la montagne et s’y arrêta
deux jours pour faire reposer ses troupes. De là il leur montrait les riches
plaines du Pô, et, dans le lointain, le lieu où était Rome, la proie qu’il
leur avait promise. La descente fut difficile ; on rencontra dans un défilé
un glacier recouvert par une neige nouvelle et où les hommes et les chevaux
restaient engagés. La gorge était d’ailleurs si étroite, que les éléphants
n’auraient pu passer : on perdit trois jours à leur creuser un chemin dans le
roc. Enfin, le quinzième depuis son départ de l’île, il arriva sur les terres
des Insubres, dans le voisinage du territoire des Taurins[25]. Le passage lui
avait coûté, de son aveu, trente-six mille hommes. Il ne lui restait que
vingt mille fantassins et six mille cavaliers[26]. Napoléon, qui
mettait Annibal au-dessus de tous les généraux de l’antiquité, disait : Il paya de la moitié de son armée la seule acquisition de
son champ de bataille.

III. — ANNIBAL DANS LA CISALPINE ; COMBAT DU
TESSIN ; BATAILLE DE LA
THÉBIE (218).
Annibal avait mis cinq mois à faire les 400 lieues qui
séparent Carthagène de Turin ; il n’avait clone marché, en moyenne, qu’à
raison de moins de trois lieues par jour. Cette lenteur, qui se comprend,
avait donné le temps aux Romains de fortifier leurs positions dans la Cisalpine de manière à
contenir la turbulence gauloise. Aussi, malgré les promesses des députés
Boïens, aucun peuple n’accourut au-devant des Carthaginois. D’ailleurs,
fidèles, même en présence des légions, à leurs haines héréditaires, ces
tribus restaient toutes ennemies les unes des autres. Les Taurins, en ce
moment, attaquaient les Insubres. Annibal leur proposa son alliance, et, sur
leur refus, enleva leur ville d’assaut ; tous ceux qui s’y trouvaient furent
égorgés. Cette rapide et sanglante expédition lui attira quelques
volontaires, mais les légions romaines campaient sur les bords du Pô ; les
Gaulois attendirent, pour se donner à Annibal, que la victoire eût prononcé
en sa faveur. Contents d’ailleurs d’avoir attiré l’armée carthaginoise en
Italie, ils voulaient laisser aux prises ces deux grands peuples dont la main
pesait si lourdement sur tous les barbares de l’Occident, peut-être dans la
secrète pensée que, à la faveur de leur mutuel épuisement, ils pourraient un
jour prendre en Italie le rôle que jouaient en Asie, avec tant de profit, les
Galates, leurs frères.
Annibal avait besoin d’une victoire. Pour parler à ses
soldats une langue que tous comprissent, il rangea son armée en cercle, fit
amener au milieu de jeunes montagnards prisonniers, tout meurtris de coups,
chargés de fers et exténués par la faim. Il leur montre des saies brillantes,
de riches armes, des chevaux de bataille, et leur demande s’ils veulent
combattre. Le vainqueur aura la liberté et des présents ; la mort délivrera
le vaincu des horreurs de la captivité. Ils acceptent avec joie, luttent et
triomphent ou meurent en riant. Annibal, s’adressant alors à ses soldats,
leur fait voir dans ces prisonniers, dans ce combat, leur propre image.
Enfermés entre deux mers et les Alpes, ils ne reverront jamais leur patrie,
s’ils ne s’en rouvrent le chemin par la victoire. Ou traîner dans l’esclavage
une vie misérable, ou mourir glorieusement, ou vaincre et gagner les
richesses de l’Italie. Aux dépouilles de Rome il ajoutera des terres en
Espagne, en Italie, en Afrique, partout où ils en demanderont ; et il les
fera, s’ils le veulent, citoyens de Carthage[27]. Que les dieux
l’immolent, s’il manque à ses promesses, comme il immole lui-même cet agneau
: et, saisissant une pierre, il broie contre l’autel la tête de la victime.
L’activité d’Annibal avait déconcerté les plans du sénat ;
il ne s’agissait plus de le combattre en Espagne ni d’assiéger Carthage, mais
de sauver l’Italie. Sempronius, dont la flotte avait déjà gagné une victoire
navale et pris Malte, fut rappelé ; Publius Scipion, après sa vaine tentative
pour arrêter Annibal par une bataille sur les bords du Rhône, avait de
lui-même renoncé à sa province, envoyé son frère Cneus en Espagne avec ses
légions, et repris en toute hâte la route de l’Italie par mer. Il espérait
atteindre à temps le pied des Alpes, pour accabler à la descente l’armée
exténuée par les fatigues et les privations. Cette fois encore, malgré sa
diligence, il arriva trop tard. De Pise il avait gagné Plaisance, pris le
commandement dés forces romaines disséminées le long du. Pô et franchi ce
fleuve, afin de se placer derrière le Tessin, entre les Carthaginois et les
Insubres. Né au Saint-Gothard, le Tessin forme, au pied des Alpes, le lac
Majeur, d’où il sort clair, rapide et profond,, pour tomber dans le grand
fleuve italien au-dessous de Pavie : c’était la barrière du pays insubrien[28]. Scipion y
courut. Mais, si les Romains étaient fort braves, bien armés et bien
organisés en légions, leurs généraux, renouvelés tous les ans, n’étaient
point, des tacticiens expérimentés, encore moins des stratégistes. Au lieu de
s’établir derrière le Tessin, dont il aurait pu faire une bonne ligne de
défense, Scipion le passa avec ses cavaliers et son infanterie légère.
Annibal poussait en même temps une reconnaissance de ce côté. Une action courte
et sanglante s’engagea. Les Numides, par la rapidité de leur charge, eurent
vite raison des hommes armés à la légère qu’ils rendirent inutiles, et firent
plier la cavalerie romaine. Le consul même fut blessé ; sans son jeune fils,
le futur vainqueur de Zama, il aurait péri.
Cette journée du Tessin n’avait été qu’une affaire
d’avant-garde cependant Scipion, reconnaissant la supériorité, des
Carthaginois en cavalerie, se replia derrière le Pô, résolu à éviter toute
bataille en plaine ; mais il ne fit rien pour disputer à l’ennemi le passage
du fleuve, qu’Annibal traversa librement. Une nuit, deux mille Gaulois, au
service des Romains, égorgèrent les gardes du camp et se rendirent au
Carthaginois, qui les renvoya chez eux comblés de présents ; ils allaient provoquer
au milieu de leurs compatriotes des défections fatales aux Romains. Le consul
s’était d’abord arrêté à Plaisance. Pour ne pas se laisser enfermer dans
cette place, il alla prendre position dans une vallée qui débouche sur cette
ville et où il s’adossait à l’Apennin dont Sempronius longeait le pied pour
le rejoindre. Il assit son camp sur des hauteurs au-dessus de la Trébie. Ce torrent,
tristement fameux dans notre histoire comme dans celle de Rome, descend de
l’Apennin au fond d’une étroite vallée qui ne s’ouvre en plaine qu’à 12
milles de Plaisance. Là, Scipion attendit l’arrivée de son collègue
Sempronius, qu’il avait appelé à lui et qui, en quarante jours, était venu
avec toutes ses forces de Rhegium à Ariminum. Quelle route suivirent ces
légions depuis les bords de l’Adriatique jusqu’à la Trébie ? Traverser la Cisalpine par le pays
des Boïes, c’était s’exposer aux attaques des Gaulois et au péril de
rencontrer Annibal avant la jonction avec l’autre armée consulaire,
Sempronius a dû prendre par l’Étrurie, suivre le versant méridional de
l’Apennin, qui cachait sa marche, et déboucher par les cols qui s’ouvraient
derrière Scipion[29].
Les Romains avaient une partie de leurs magasins à
Clastidium, poste fortifié sur le Pô, en amont de Plaisance. Annibal enveloppa
cette place, effraya ou gagna le commandant, un homme de Brindes, et y entra
: acquisition précieuse pour lui et très dommageable pour les Romains.
Sempronius n’en fut que plus pressé de combattre. Polybe, ami des Scipions,
dit que Sempronius, fier d’un léger succès remporté dans une escarmouche,
voulut, malgré son collègue, livrer bataille pour ne pas laisser aux généraux
de l’année suivante, l’honneur de délivrer l’Italie. Il n’était pas possible
que deux consuls et quarante mille Romains refusassent le combat à ces
Carthaginois que, dans la première guerre Punique, ils avaient si souvent
vaincus, et ce n’était point pour qu’il contemplât du haut de son camp
retranché la dévastation des plaines du Pô que Sempronius avait été rappelé
de Sicile. Ce chef eut donc raison de combattre, mais il eut tort de prendre
de mauvaises dispositions et de se laisser tromper par des ruses qu’il aurait
dû deviner. Un matin, les Numides vinrent insulter son camp avant l’heure où
les soldats prenaient leur repas, et les attirèrent au delà des eaux glacées
de la Trébie,
jusqu’au milieu d’une plaine où Annibal avait caché, dans le lit d’un
torrent, deux mille hommes confiés à son frère Hannon. Affaiblis par la faim,
par le froid, par la neige que le vent leur fouettait au visage, les Romains
étaient à demi vaincus, quand ils vinrent heurter l’infanterie carthaginoise
bien repue, bien reposée, les membres assouplis par l’huile, et qu’Annibal
avait tenue jusqu’au dernier moment sous la tente ou devant de grands feux.
Près de vingt-cinq mille Romains périrent ou disparurent : dix mille
seulement avec Sempronius se firent jour au travers des Gaulois d’Annibal[30] et atteignirent
Plaisance où, la nuit venue, Scipion ramena quelques fugitifs, ceux qui
avaient pu regagner le camp. Ce grand succès était dû à la cavalerie numide,
encore près de trois fois plus nombreuse que celle des légions[31] et qui avait mis
le désordre dans les deux ailes, tandis que les cavaliers d’Hannon jetaient
l’épouvante dans le corps de bataille, en l’attaquant par derrière.
La défaite du Tessin avait rejeté les Romains au delà du
Pô, celle de la Trébie
les rejeta au delà de l’Apennin ; sauf Plaisance[32], Crémone et
Modène, la Cisalpine
était perdue pour eux.
Jusqu’ici le plan d’Annibal avait, réussi. Mais, tandis
qu’il s’ouvrait la route de Rome, Cneus Scipion, en Espagne, fermait à ses
frères celle de la Gaule.
Des troupes envoyées en Sardaigne, en Sicile, à Tarente,
des garnisons mises dans toutes les places fortes, et une flotte de soixante
galères coupaient ses communications avec Carthage. Il s’en effrayait peu,
car les Gaulois accouraient en foule sous ses drapeaux, et les prisonniers
italiens, traités avec bienveillance, puis relâchés sans rançon, allaient,
pensait-il, lui gagner les peuples de la Péninsule. Des
deux routes qui y conduisaient, il prit encore la plus difficile, mais la
plus courte, et, malgré la saison avancée, il essaya de passer l’Apennin. Un
ouragan terrible, comme ceux qui éclatent parfois dans ces montagnes, le
repoussa. Il rentra dans la
Cisalpine et attendit en bloquant Plaisance, le retour du
printemps.

IV. — TRASIMÈNE (217) ET CANNES
(216).
Napoléon a dit : Lorsqu’on
tient l’Italie septentrionale, le reste de la péninsule tombe comme un fruit
mûr. Cela était vrai de son temps où, des deux côtés de l’Apennin,
tout était mûr pour une chute prochaine, mais ne l’était pas du temps
d’Annibal, parce qu’un peuple brave, discipliné pet résolu à vaincre y
attendait l’envahisseur derrière le triple et inexpugnable rempart des villes
ceintes de murailles cyclopéennes et que des voies faciles reliaient les unes
aux autres.
Les Gaulois avaient compté sur une expédition rapide, sur
du butin, et il leur fallait nourrir l’armée, se soumettre à la discipline.
Le mécontentement amena des complots auxquels Annibal n’échappa, dit-on, que
par de continuels travestissements, se montrant tantôt en jeune homme, tantôt
en vieillard, et déjouant ainsi les trames, ou inspirant à ces grossiers
esprits une sorte de respect religieux[33]. Dès que les
froids cessèrent, il se résolut à aller chercher en Étrurie les légions qui
n’avaient pas osé venir lui disputer la Cisalpine. Pour
les tromper encore, il prit la route la plus difficile en se jetant au milieu
d’immenses marais où, durant quatre jours et trois nuits, l’armée marcha dans
l’eau et la vase. Les Africains et les Espagnols, placés à l’avant-garde,
passèrent sans trop de pertes ; mais les Gaulois, qui suivaient sur un sol
déjà défoncé, glissaient à chaque pas et tombaient. Sans la cavalerie qui les
poussait l’épée dans les reins, ils auraient reculé ; beaucoup périrent.
Presque tous les bagages et les bêtes de somme restèrent dans le marais.
Annibal lui-même, monté sur son dernier éléphant, perdit un œil par les
veilles, les fatigues et l’humidité des nuits[34]. Au sortir de
ces fondrières, qui furent desséchées plus tard lorsqu’on traça la voie
Émilienne, il entra dans l’Apennin, le franchit au défilé de Pontremoli, et
descendu dans la vallée de l’Arno, marcha par Fæsulæ sur Arretium.
Si les Romains, surveillant tous ses mouvements, étaient
venus l’attaquer au sortir du marais on de la montagne, ils auraient arrêté
là sa fortune. Mais ils ne savaient pas faire la guerre avec cette
prévoyance. Campés sous les murs d’Arretium et d’Ariminum, ils attendaient
patiemment que l’ennemi se montrât par les routes habituelles, oubliant que,
huit années auparavant, les Gaulois en avaient suivi une autre qui, sans
l’heureuse inspiration du consul Æmilius, les eût menés droit à Rome. Les
légions d’Arretium étaient commandées par Flaminius qui, tribun, avait fait
passer une loi agraire ; consul, avait vaincu malgré les augures ;
censeur avait exécuté de grands travaux d’utilité publique en les payant avec
les redevances que les détenteurs des forêts, pâtures et mines d trésor, et
que, par la connivence du sénat, ils oubliaient de verser. Le peuple venant
de lei donner, malgré les grands, un second consulat. Récemment, Flaminius
avait encore augmenté la haine de la noblesse contre lui, en soutenant une
loi qui défendait à tout sénateur d’avoir en mer un navire de plus de trois
cents amphores[35].
Aussi pour annuler son élection, les plus sinistres présages s’étaient
montré ; les uns imaginés par ceux qui avaient intérêt à les produire,
tous acceptés par la crédulité populaire, même par celle des plus graves
personnages.
A Lanuvium, Junon avait agité sa lance ; des pierres
brûlantes étaient tombées à Préneste, et des feux avaient brillé en mer. Dans
la campagne d’Amiterne, on avait vu errer de blancs fantômes ; à Faléries,
les sorts s’étaient rapetissés, et sur un d’eux on avait lu : Mars brandit sa lance. A Cæré, les eaux avaient
roulé du sang ; à Capène, deux lunes s’étaient montrées au ciel. En Sicile,
des flammes avaient brillé à la pointe des lances ; en Gaule, un loup avait
arraché l’épée d’une sentinelle ; des boucliers avaient sué du sang ; des
épis étaient tombés sanglants sous la faucille : folles terreurs nées de
croyances bizarres ou de l’effroi causé par des phénomènes incompris, et qui
prouvent ce que l’esprit humain peut enfanter de sottes imaginations, même
chez le peuple le plus froid de la terre. Au nom du sénat, le préteur de la
ville promit aux dieux de riches offrandes, s’ils conservaient pendant dix
ans la république dans l’état où elle était avant la guerre ; les matrones dédièrent
une statue de bronze à la
Junon de l’Aventin, et de continuels sacrifices, des
prières solennelles, remplirent la ville et l’armée de craintes
superstitieuses. Le nouvel élu n’en tint compte. Certain d’être arrêté à Rome
par de faux auspices[36], il part
secrètement de la ville sans avoir revêtu chez lui, suivant l’usage, la toge
prétexte, insigne de sa charge, sans avoir pris au Capitole le paludamentum
ou vêtement militaire, ni accompli sur le mont Albain le sacrifice
obligatoire à Jupiter Latiaris.
Pour justifier ce mépris des dieux et des plus vieilles
coutumes, une victoire lui était nécessaire. Polybe dit qu’il la chercha avec
une imprudence présomptueuse. Cependant on le voit attendre ; dans son camp
d’Arretium l’attaque d’Annibal, et, quand le Carthaginois, qui, privé de
machines de guerre, ne pouvait prendre une ville ni forcer un camp, l’a
dépassé, il suit ses traces sans se hâter, avertit son collègue qui part
d’Ariminum avec toutes ses forces, de sorte qu’il pouvait avoir l’espérance
de renouveler la campagne si heureusement terminée naguère au cap Telamone.
Enfin, à Trasimène, il ne fut pas l’assaillant ; mais il eut le tort, qu’il
paya de sa vie, de ne pas faire éclairer sa marche et de tomber étourdiment
dans le piège que lui tendit son habile adversaire.
Annibal avait laissé derrière lui les hautes murailles
d’Arretium et de Cortona, quand, à 7 milles au sud de cette dernière ville,
il se trouva, au détour d’un éperon de montagnes, sur le bord du lac
Trasimène (lago di Perusia), nappe d’eau sans
profondeur, mais large de 8 milles et longue de 10. Du côté par où passait la
route, les collines du Gualandro (montes Cortonenses) tracent un demi-cercle dont les
extrémités viennent tomber au lac, près des deux villages de Borghetto, au
nord, et de Tuore, au sud. C’est un cirque naturel qui enveloppe une petite
plaine qu’on ne peut apercevoir avant d’y être entré. La route longeant le
lac, Flaminius, qui suivait l’armée punique, allait nécessairement s’engager
dans ce piéger sans issue[37]. Annibal l’y
attendait. Il établit son infanterie pesante au fond de la plaine pour fermer
la porte du sud, dispersa ses frondeurs sur les hauteurs, dans les plis du
terrain, et cacha ses Numides et les Gaulois derrière les collines qui
dominaient la passe du nord.
Flaminius connaissait ces lieux qu’il avait traversés pour
rejoindre le camp d’Arretium ; mais l’instinct militaire lui manquait. Là où
Annibal avait trouvé un champ de bataille admirablement préparé, il n’avait
rien vu que de l’eau et des hauteurs qui gênaient la route. Au point du jour,
sans rien soupçonner du grand mouvement d’hommes qui se faisait autour de
lui, il entra dans la nasse. Un épais brouillard s’élevait du lac et couvrait
la plaine, tandis que sur les collines restées en pleine lumière, l’ennemi
prenait, sans être aperçu, ses dernières dispositions. Tout à coup de grands
cris retentissent en tête, en queue et sur le flanc de l’armée romaine, qui
est attaquée de toutes parts avant que le soldat ait pris ses armes et que
les légions eussent changé leur ordre de marche en ordre de bataille. Ce fut
une horrible mêlée : elle ne dura que trois heures, mais avec un tel
acharnement, que les combattants ne s’aperçurent pas d’un tremblement de
terre qui renversait en ce moment des montagnes. Flaminius fut tué par un
cavalier insubrien ; quinze mille des siens périrent, autant furent faits
prisonniers ; bien peu s’échappèrent[38]. Un ruisseau qui
traverse la plaine fatale garde encore le souvenir de ce grand massacre, le Sanguinetto. Annibal n’avait perdu que quinze
cent hommes, presque tous Gaulois[39]. Le lendemain,
quatre mille cavaliers ; envoyés par l’autre consul tombèrent encore au
milieu de l’armée victorieuse, et quelques jours après, une flotte de
transport qui portait des munitions à l’armée d’Espagne, fut enlevée près de
Cosa par des Carthaginois (217).
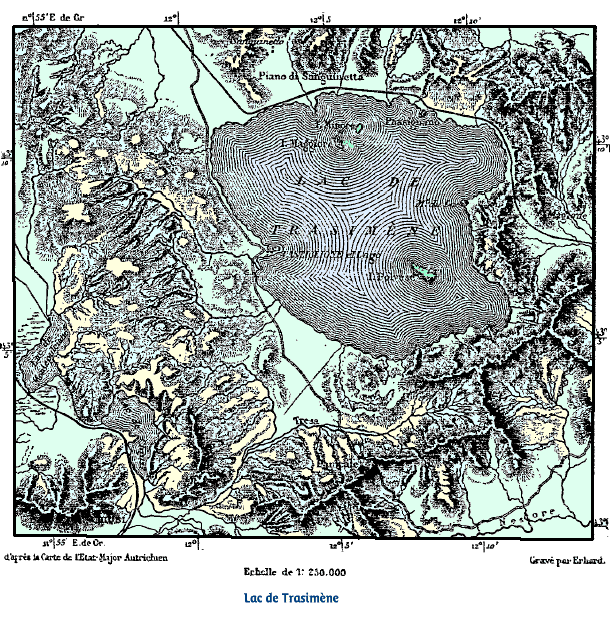
De Trasimène à Rome il y a seulement 35 lieues ; la route
était libre, car l’autre armée consulaire, qui venait de perdre toute sa
cavalerie, était encore bien en arrière des Carthaginois, et déjà les Numides
se montraient sous les murs de Narnia, à deux journées du Capitole. Cependant
Annibal ne se crut pas assez fort, malgré la destruction de deux armées, pour
risquer une marche sur la grande cité. Ses bons traitements envers les
prisonniers italiens, qu’il continuait à renvoyer sans rançon, ne lui avaient
encore rien rapporté. L’Étrurie ne donnait aucun signe d’affection à cet ami
des Gaulois ; et la première ville qu’il attaqua après Trasimène, la colonie
de Spolète, le repoussa victorieusement[40]. Depuis son
départ d’Espagne, ses troupes n’avaient pas eu de repos ; il traînait
beaucoup de blessés et de malades ; hommes et chevaux étaient couverts d’une
lèpre gagnée dans les campements malsains de la Cisalpine. Pour
refaire ses troupes, il les mena dans les fertiles plaines du Picenum, fit
laver ses chevaux numides avec du vin vieux[41], soigna ses
blessés et gorgea ses mercenaires de butin. Singulier hommage rendu par le
vainqueur de Trasimène à l’organisation militaire des Romains : il arma son
infanterie libyenne de la courte épée et du grand bouclier des légionnaires !
A Rome, après la
Trébie, on avait dissimulé l’étendue du désastre ; après
Trasimène, on n’osa rien cacher. Le préteur Pomponius assembla le peuple et
ne dit que ces mots. Nous avons été vaincus dans
un grand combat. Ces paroles, tombant sur la multitude, comme un
vent impétueux sur une vaste mer[42], y répandirent
la consternation. Pendant deux jours, le sénat délibéra sans quitter la curie
et pourvut à tout. Les ponts sur le Tibre furent coupés, les portes et les
murailles mises en état de défense, les projectiles entassés sur le rempart.
Pas un soldat ne fut rappelé de Sicile, de Sardaigne ou d’Espagne ; mais,
comme dans les moments de grand péril public, on résolut de concentrer tous
les pouvoirs dans les mains d’un chef unique. Le dictateur devait être nommé
par un consul : Flaminius avait péri, et l’on ne pouvait communiquer avec
Sempronius. Le sénat décida qu’il serait demandé au peuple de désigner un
prodictateur. De cette manière, on tournait la loi, on ne la violait pas, et,
comme c’était le souverain lui-même qui faisait la dérogation à la coutume,
les citoyens devaient au nouveau magistrat leur obéissance ; les dieux, leur
protection. Rome fut alors admirable de bon sens politique. Devant le danger
commun, les partis s’effacèrent : le peuple élut prodictateur le chef de la
noblesse, un membre d’une des plus glorieuses familles de Rome, Fabius
Maximus, et l’aristocratie accepta, comme maître de la cavalerie, Minucius,
un des favoris de la multitude. Il fallait persuader au peuple qu’il n’avait
été vaincu que par l’impiété de Flaminius : Fabius fit recommencer les
prières publiques et les sacrifices ; on célébra un lectisternium en l’honneur des douze dieux[43] ; on leur voua
un printemps sacré, on leur promit des jeux, des temples, et un préteur fut
exclusivement chargé de veiller à ces nombreuses expiations.
Pour le printemps sacré,
que les livres sibyllins avaient demandé, le souverain pontife ordonna que la
question suivante serait posée au peuple : Si
d’ici a cinq ans le peuple romain des Quirites sort heureusement de cette
guerre, voulez-vous, ordonnez-vous qu’il soit fait a Jupiter une offrande de
tout ce que le printemps aura vu naître de porcs, de brebis, de chèvres et de
bœufs, à partit du jour fixé par le sénat et le peuple ? La
proposition ayant été acceptée, chaque citoyen se trouva légalement tenu
d’accomplir ce vœu à l’époque déterminée. Du reste le grand prêtre eut soin
d’énumérer les cas où le sacrifice ne serait pas légitime, afin que le peuple romain ne
devint pas responsable de ces irrégularités vis-à-vis des dieux, et que
ceux-ci fussent obligés de tenir la convention que les prêtres venaient de
conclure en leur nom. Pour eux, des hommages, des honneurs ; pour Rome, la
victoire ; et ils auraient volontiers dit à leurs dieux, comme les Aragonais
à leurs rois : Sinon, non.
On s’étonne qu’Annibal, après Trasimène, n’ait pas essayé
d’en finir avec l’autre armée consulaire. Sur les bords du Pô, il n’avait pas
enlevé les forteresses qui gardaient pour Rome la Cisalpine. Content
de briser tout ce qui prétendait arrêter sa marche en avant, il n’avait nul
souci de ce qu’il laissait en arrière. C’est qu’il avait hâte de se trouver
dans l’Italie méridionale, au milieu de peuples qu’il croyait disposés à se
joindre à lui, prés de la
Sicile, qu’il pourrait soulever, à peu de distance de la Grèce, de l’Espagne et de
l’Afrique, avec lesquelles il voulait avoir de faciles et sures
communications. Tandis qu’il gagnait l’Adriatique, d’où il expédia à Carthage
un navire qui y porta la première nouvelle de ses étonnants succès,
Sempronius franchissait l’Apennin et descendait dans la vallée du Tibre
jusqu’à Ocriculum, où il fit sa jonction avec l’armée dictatoriale.
Fabius, à la tête de quatre légions, alla chercher
Annibal, qui avait suivi le bord de l’Adriatique jusqu’en Apulie, dans
l’espérance de soulever la
Grande-Grèce, comme il avait soulevé la Cisalpine. Sur
son passage, il avait exercé d’affreux ravages, sans détacher de home un allié
; car, à la tète de ses nombreux auxiliaires cisalpins, il paraissait
conduire lui-même une de ces invasions gauloises si redoutées des Italiens.
L’aspect sauvage de ses Africains épouvantait les populations. On l’accusait
de nourrir ses soldats de chair humaine[44], et on le voyait
faire aux dieux de l’Italie une guerre sacrilège[45]. Excepté
Tarente, trop humiliée pour ne pas désirer l’abaissement de Rome, tous les
Grecs faisaient des vœux pour la défaite des Carthaginois, leurs vieux
ennemis. Ceux de Naples et de Pœstum envoyèrent l’or de leurs temples au
sénat, qui n’en accepta qu’une très petite partie, afin que le trésor public
parût avoir des ressources inépuisables, et que cette confiance augmentât la
fidélité des alliés. Hiéron, sûr de la fortune de Rome, même après Trasimène,
offrit une statue d’or de la
Victoire, du poids de 320 livres, mille
archers ou frondeurs, trois cent mille boisseaux : de blé, deux cent mille
boisseaux d’orge, et promit d’envoyer des vivres en abondance partout où les
armées en auraient besoin.
Fabius s’était tracé un nouveau plan de campagne : faire
tout rentrer, hommes et provisions, dans les places fortes, ruiner soi-même
le plat pays et refuser partout le combat ; mais suivre pas à pas l’ennemi,
tomber sur ses fourrageurs, couper ses vivres, le harceler sans relâche, le
détruire en détail. Annibal, sans place de retraite, sans alliés, sans
argent, sans convois assurés, et avec des mercenaires qui, ne cherchant dans
la guerre que les plaisirs et le butin d’un lendemain de victoire, sont
toujours prêts à crier : Congé ou bataille[46]. Annibal
n’aurait pu résister longtemps à cette prudente tactique du Temporiseur.
Vainement il ravagea, sous ses yeux la Daunie, le Samnium et la Campanie ; Fabius le
suivait par les montagnes, caché dans la nue et les brouillards, impassible
aux insultes de l’ennemi comme aux railleries de ses soldats[47]. Un jour
cependant qu’Annibal, trompé par ses guides, s’était engagé du côté de
Casilinum, au fond d’une vallée dont l’extrémité était fermée par d’impraticables
marais, Fabius se saisit des hauteurs, tomba sur l’arrière-garde des
Carthaginois qui perdit huit cents hommes, et garda l’unique entrée avec un
corps nombreux. Annibal était pris. Au milieu de la nuit, il fit chasser vers
le haut de la montagne deux mille bœufs portant aux cornes des sarments
enflammés ; et la garde du défilé, croyant que l’ennemi fuyait de ce côté,
quitta son poste, dont Annibal aussitôt s’empara ; le péril était passé,
mais, avec la vigilance du Temporiseur, il pouvait reparaître. Heureusement
pour Annibal, les Romains s’indignèrent de ce qu’ils appelaient une timidité
honteuse, et, le Carthaginois épargnant à dessein les terres de Fabius, on
cria à la trahison.
En vain il mit ses biens en vente pour racheter des
prisonniers, le peuple, entraîné par un léger succès que le général de la
cavalerie remporta en son absence, donna à Minucius une autorité égale à
celle du prodictateur. Fabius partagea avec lui l’armée, et Minucius, trop
faible, fut battu à la première rencontre, près de Larinum. Il aurait péri,
si Fabius n’était descendu des hauteurs pour le sauver. Enfin, la nue qui couvrait la montagne a donc crevé,
dit Annibal, et donné la pluie et l’orage[48]. De lui-même,
Minucius vint se replacer sous les ordres de son ancien chef, et quand le
dictateur sortit de charge, au bout de six mois, les affaires de la
république semblaient dans un état prospère. A Rome, un de ses neveux dédia
un temple à une divinité nouvelle, l’Intelligence (Mens),
et Ennius consacra sa mémoire par le vers fameux que Virgile lui emprunta : Un seul homme, en temporisant, a rétabli nos affaires[49]. Un moment, on
avait redouté une coalition de tout l’Occident. Mais, en Espagne, une foule
de peuples passaient du côté des Romains ; dans la Cisalpine, les
Gaulois, satisfaits de se retrouver libres, oubliaient Annibal, comme
Carthage elle-même, qui n’envolait que quelques vaisseaux pirater sur les
côtes, d’où les chassaient bien vite les flottes de Sicile et d’Ostie. Une
escadre romaine, qui venait de les poursuivre jusqu’en Afrique, avait pris
l’île de Cossura (Pantellaria) et levé sur celle de
Cercina une grosse contribution de guerre. Partout, excepté en face
d’Annibal, les Romains prenaient l’offensive et des mesures hardies. Le
préteur de Sicile, Otacilius, avait ordre de passer en Afrique ; les Scipions
recevaient des secours ; Postumius Albinus, avec une armée, surveillait les
Cisalpins, et des ambassades étaient envoyées : à Philippe de Macédoine, pour
exiger l’extradition de Démétrius de Pharos, qui le poussait à la guerre ; au
roi d’Illyrie Pinéus, pour réclamer le tribut qu’il hardait à payer ; aux
Liguriens, pour leur demander compte du secours fourni par eux aux
Carthaginois[50].
Il y a de la grandeur dans cette activité du sénat portant, au milieu d’une
guerre formidable qui se fait aux portes de la ville, son attention sur les
pays les plus lointains, et ne permettant pas qu’on doutât un instant ni de
la fortune ni de la puissance de Rome. Ce sénat, si fier en face de
l’étranger, se montrait conciliant avec le peuple ; il rappelait à tous la
nécessité d’une mutuelle confiance, en faisant élever un nouveau temple à la Concorde, et il le
mettait dans l’enceinte de la citadelle[51], afin que chacun
comprit que la force de Rome dépendait des sentiments inspirés par cette
divinité.
Les consuls qui, après l’abdication de Fabius,
commandèrent l’armée dans les derniers mois de 217 suivirent la tactique du
dictateur, et cette sage temporisation aurait sans doute ruiné Annibal. Mais
les dominateurs de l’Italie pouvaient-ils, sous les yeux de leurs alliés et
avec des forces doubles, refuser toujours le combat ? On a condamné, après
l’événement, Sempronius et Varron. Le souvenir de la Trébie et de Cannes pèse
sur leur mémoire. Cependant le peuple, l’armée et peut-être la vraie
politique[52]
demandaient une bataille. Le sénat lui-même s’y décida ; mais il fallait un
chef habile, expérimenté, et si la noblesse put faire élire un élève de
Fabius, Paul-Émile, qui s’était déjà distingué dans les guerres d’Illyrie, le
parti populaire lui donna pour collègue son chef, le fils d’un boucher,
Terentius Varron, qui jamais n’avait vu de bataille. Il fallait l’union entre
les chefs, et Paul-Émile et Varron, ennemis politiques[53] continuaient à
l’armée leurs querelles, l’un voulant toujours combatte, l’autre toujours
différer. Comme le commandement alternait chaque jour entre les consuls,
Varron conduisit l’armée si près de l’ennemi, qu’une retraite fut impossible,
et le surlendemain il fit dès le matin déployer devant sa tente le manteau de
pourpre, signal du combat. Il avait quatre-vingt mille fantassins[54] et seulement,
malgré le souvenir des trois batailles déjà perdues, six mille chevaux. Sur
une armée de cinquante mille hommes, Annibal en avait dix mille[55]. Ses forces
n’étaient que la moitié de celles des consuls ; il n’avait pas moins amené
ceux-ci sur le champ de bataille qu’il avait choisi, à Cannes, en Apulie,
prés de l’Aufidus, au milieu d’une plaine immense, favorable à sa cavalerie,
et dans une position où le soleil, dardant ses rayons au visage des Romains[56], où le vent,
portant la poussière contre leur ligne, devaient combattre pour lui.
Dans cette plaine unie, une embuscade semblait impossible.
Mais cinq cents Numides se présentèrent comme transfuges, et, durant
l’action, ils se jetèrent sur les derrières de l’armée romaine. A Cannes,
comme à Trasimène, comme à la
Trébie, le plus petit nombre enveloppa le plus grand. Pour
opposer plus de résistance à la cavalerie, Varron avait diminué l’étendue de
sa ligne et augmenté sa profondeur. Par cette disposition, beaucoup de
soldats devenaient inutiles. Annibal, au contraire, donna à son armée un
front égal à celui de l’ennemi, et la rangea en croissant, de manière que le
centre, composé de Gaulois, faisait saillie sur la ligne de bataille. Derrière
eux, les vétérans africains étaient formés en une courbe rentrante dont les
extrémités allaient rejoindre la cavalerie établie aux deux ailes. Tandis que
les Romains attaquaient les Gaulois avec furie et que ceux-ci, guidés par
Annibal lui-même, reculaient peu à peu sur la seconde ligne, Asdrubal, avec
ses cavaliers africains et espagnols réunis en masses profondes, écrasait à
gauche, la cavalerie légionnaire, et Magon, à droite, avec les Numides,
dispersait celle des alliés. Laissant les numides poursuivre et achever ceux
qui n’étaient pas tombés au premier choc, Asdrubal attaqua par derrière
l’infanterie romaine dont les Africains, par le mouvement de recul des
Gaulois, débordaient déjà les ailes. Les quatre-vingt mille Romains,
enveloppés de toutes parts, ne formèrent bientôt qu’une masse confuse,
effrayée, haletante, où tous les coups portaient et qui n’en pouvait pas
rendre. Au compte de Polybe, soixante-douze mille Romains ou alliés[57], avec l’un des
consuls, Paul-Émile, qui avait refusé de se sauver, ses deux questeurs,
quatre-vingts sénateurs, des consulaires parmi eux Minucius et un des consuls
de l’annale précédente, vingt et un tribuns légionnaires, enfin une foule de
chevaliers restèrent sur le champ de bataille (2 août 216). La noblesse romaine payait
largement à la patrie la dette du sang. Annibal n’avait pas perdu six mille
hommes, dont quatre mille Gaulois : ce peuple était l’instrument de toutes
ses victoires. Plus tard on attribua à un devin fameux, Marcius, qui vivait
avant la seconde guerre Punique, une prédiction de cette grande
défaite :
Romain, fils de Troie, évite
le fleuve Canna ; garde que les étrangers ne te forcent à engager la bataille
clans le champ de Diomède. Mais tu ne m’en croiras point, jusqu’à ce que tu
aies rempli de ton sang les campagnes ; jusqu’à ce que tes citoyens soient
tombés par milliers, et que le fleuve les emportant loin de la terre féconde
les ait livrés en pâture aux oiseaux du ciel, aux fauves de ses rives et aux
poissons de la vaste mer. C’est ainsi que m’a parlé Jupiter.
Cette prophétie plus précise que ne le sont celles qui
précèdent l’événement donnait satisfaction à l’orgueil national et servait en
même temps la politique du sénat, qui avait intérêt à ce que l’on crût aux
oracles. Rome voulait voir dans sa défaite, non une défaillance de son
courage, mais un arrêt du Destin ; elle cédait la victoire aux dieux bien
plus qu’à Annibal, et elle fortifiait un instrument précieux de gouvernement,
la foi à la science divinatoire, en donnant à penser que le devin avait vu
l’avenir.
La bataille de Cannes enleva plus de force aux Romains
qu’elle n’en donna à Annibal. Quelques peuples de la Campanie et de la Grande-Grèce se
déclarèrent pour lui, avais à condition de lui accorder moins d’hommes et de
subsides qu’ils n’en fournissaient à Rome[58] ; et Carthage,
qui ne voyait dans cette expédition si hardie qu’une utile diversion,
l’abandonnait à ses propres ressources[59] ! Affaibli par
ses victoires mêmes, il sera obligé de diviser ses forces s’il veut protéger
les villes qui vont se donner à lui. Aussi aura-t-il une armée trop faible
pour renouveler la lutte de Trasimène et de Cannes. D’ailleurs, rendus
prudents par l’expérience, les consuls mettront le salut de la république à
suivre le système de Fabius. Chose étrange ! la grande guerre est terminée en
Italie après la bataille de Cannes. Ce ne seront plus désormais que des
sièges de villes, des stratagèmes, une foule d’attaques et de combats sans
résultat. Annibal se montrera dans cette guerre de positions le plus habile
capitaine de l’antiquité. Mais la lutte n’aurait plus qu’un intérêt
secondaire, sans la grandeur du spectacle que donne cet homme abandonné des
siens, au milieu d’un pays ennemi, en face du peuple le plus brave, le mieux
organisé, qu’il y eût alors, et qui pendant treize ans saura maîtriser
l’indiscipline de ses mercenaires, soutenir la foi chancelante des alliés,
occuper seul les meilleures troupes de Rome, et, encore, remuer le monde de
ses négociations, soulever Syracuse, la Sicile et la Sardaigne ; appeler
ses frères de l’Espagne, Philippe, de la Macédoine, jusqu’au cœur de l’Italie, où il les
attend pour accabler Rome du poids de l’Afrique et de l’Europe réunies contre
elle[60].
|
 Dès son arrivée au camp
d’Asdrubal
Dès son arrivée au camp
d’Asdrubal