HISTOIRE DES ROMAINS
PREMIÈRE PÉRIODE — ROME SOUS LES ROIS (755-510) – FORMATION DU PEUPLE ROMAIN
CHAPITRE III — RELIGION ET INSTITUTIONS RELIGIEUSES.
I. — Les dieux publics.
Diana et Jovino étaient les formes féminines de Janus et de Jovis ; l’une, la déesse de la nuit et des bois sombres ; l’autre, Junon, celle du jour et de la vie, la reine du ciel, mater regina et Juno Sospita, la protectrice des matrones qui gardaient la foi conjugale. Son sanctuaire de Lanuvium était fameux ; les prêtres y nourrissaient un serpent à qui, chaque année, épreuve redoutable, une vierge offrait un gâteau sacré. Le refusait-il, c’est que la jeune fille n’avait pas gardé sa pureté virginale. Diane, qui s’unira plus tard à l’Artémis grecque, était aussi une sorte de Lutine que les femmes invoquaient pour leur délivrance. Les hommes honoraient en elle la déesse des bois mystérieux, et, comme le Latium en était couvert, elle était une des grandes divinités des Latins. On a vu Servius lui élever un sanctuaire sur l’Aventin, quand il voulut unir les destinées de Rome à celles des cités latines. A une époque de philosophie raffinée, Plutarque expliquait
que le culte de Innombrables étaient ses surnoms et par suite ses temples : car chaque épithète qu’on lui donnait exprimant la grâce particulière attendue d’elle, il semblait y avoir autant de déesses de la fortune qu’on avait de motifs pour implorer le Hasard. Les Romains divisaient ainsi la divinité d’après les fonctions qu’ils lui donnaient à remplir et tous leurs dieux avaient plusieurs faces, comme si ce peuple eût été incapable de contempler une figure divine dans sa grandeur et sa sérénité. Les femmes mêmes voulurent avoir leur déesse de Les dieux du monde souterrain, Tellus, Terra-Mater, Cérès,
Dis-Pater, etc., faisaient germer les semences dans le sein de la terre silencieuse
et gardaient les morts. Ceux de la mer, si nombreux chez les Grecs, qui
passaient la moitié de leur vie sur les eaux, ne pouvaient avoir de crédit
auprès d’un peuple sans marine. Mais dans la région moyenne, habitaient les
déités de la terre, Medioxumi[8], dieux des champs
et des forêts, de la moisson et de la vendange, des sources et des rivières,
dieux populaires et choyés plus que les grands dieux qui vivaient trop loin.
Là régnaient Bona Dea ou Maia, Liber, le génie qui a le soin modeste d’assurer l’abondance sur la table de ses fidèles, héritera aussi de la riche légende du Dionysos thébain et du Bacchus de l’Inde ; comme Hercule, le gardien de l’enclos deviendra le glorieux fils de Jupiter et d’Alcmène, quand le flot de la poésie grecque aura fécondé le sol de la mythologie italienne[11].
A tous ces dieux on donnait le nom de père, qui eût fait
sourire un ami d’Horace, mais qui, dans le vieux Latium, était le titre le
plus auguste pour l’homme et pour la divinité. Éros, dont le rôle est si
grand dans Les dieux innombrables des Indigitamenta, c’est-à-dire dont les noms étaient écrits sur les registres des pontifes, formaient une classe à part. Ils avaient ce caractère singulier de préside à tous les actes de la vie, depuis la naissance jusqu’à la mort, même aux plus infimes, à tous les besoins de l’homme, nourriture, habillement, demeure, à tous ses travaux, etc., mais de telle sorte que chacun d’eux répondît à un seul de ces besoins. On ne les connaît que par l’épithète qui désigne leur fonction[12]. Le besoin satisfait ou l’acte accompli, on ne leur adresse plus de prière, et ils semblent n’exister plus. Les uns s’occupent de la conception ou de la grossesse ; d’autres, de la délivrance ; ceux-ci veillent à l’allaitement de l’enfant ; ceux-là lui font pousser son premier cri, et, ainsi de suite pour la vie entière. Étrange illusion de l’homme adorant les propres conceptions de son esprit ! Mais ce peuple d’une si terrible énergie, qui jamais ne connut les contemplations rêveuses ni les mystiques ardeurs, ces hommes d’action et de persévérance ne savaient rien faire tout seuls. Qu’il s’agit de ses intérêts privés ou de l’intérêt public, le Romain voulait avoir un dieu sous la main. Autre remarque caractéristique : les Grecs tenaient leurs assemblées politiques au théâtre, le sénat de Rome délibérait dans les temples. II. — Les dieux domestiques.Quelques-unes de ces divinités, qu’on peut dire officielles et qui avaient des temples, des prêtres, un culte public avec les hommages de la foule, étaient, en outre, honorées d’une façon spéciale dans les gentes, sacra gentilitia. Chacune des grandes familles avait son dieu protecteur, comme nos corporations du moyen âge se choisissaient au ciel un patron, et ce culte unissait étroitement tous les membres de la gens. Y renoncer, c’était périr : la gens ne survivait pas à l’abandon de son ancien autel. Tite Live raconte que les Potitii ayant remis à l’État le culte d’Hercule, particulier à leur race, moururent tous dans l’année (IX, 29). Chaque maison, même la plus pauvre, avait aussi ses dieux domestiques, humbles et modestes, quelques-uns invisibles, comme les Génies et les Mânes ; d’autres, les Pénates et les Lares, représentés par des figurines informes de terre à peine moulée et cuite au four, mais aussi honorés que le sont aujourd’hui les saintes images du paysan russe. Ils se distinguent mal les uns des autres, car ils représentaient tous, d’une manière plus ou moins nette, l’idée de protecteurs surnaturels, qui, du sein du monde invisible, continuaient à veiller sur la maison où ils avaient vécu. Nos anges gardiens et nos saints tutélaires sont comme un souvenir de ces antiques Pénates et de ces bons Génies. Mettons d’abord à part la foule innombrable des Génies. On connaît cette étrange doctrine qui dédouble l’homme, même le dieu, et lui donne de son vivant deux existences dont l’une continue après la mort[13]. Les Génies présidaient à tous les phénomènes de la vie physique et morale. Rien ne se faisait sans eux, et leur faveur ou leur inimitié s’étendait sur l’individu, la famille, la cité, la nation entière.
A une époque déjà sceptique, Plaute met sur la scène un Lare familier qui explique aux spectateurs le sujet d’une pièce du grand comique : Je suis le dieu lare de cette maison. Depuis bien des années j’en ai la garde et, de père en fils, je veille sur elle. Le grand-père du maître actuel m’a confié, avec force supplications, un trésor qu’à l’insu de tout le monde il a caché sous le foyer en me recommandant de le conserver. C’était un avare, et il est parti sans parler de cela à son fils. Lui mort, j’observai le fils pour m’assurer si j’en recevrais plus d’honneur que de son père. Je reconnus bien vite qu’il diminuait encore pour moi la dépense. Je l’en ai puni, car il n’a jamais connu la cachette. Son fils lui ressemble, mais sa fille ne manque pas un jour de m’offrir de l’encens, du vin et de bonnes prières ; aussi je lui ferai découvrir le trésor[15]. Ôtez le rire peu respectueux du poète qui fait du Lare familier une machine de théâtre, et vous retrouverez le dieu dont le culte fut la consolation et l’espérance de bien des générations. Au culte des. Lares était associé celui du feu domestique, et l’on peut dire que les deux assises qui portaient la société romaine étaient la pierre du foyer et la pierre du tombeau. La famille s’était formée autour de l’une et, malgré la séparation douloureuse, elle se continuait autour de l’autre. Qui n’avait pas ses pénates errait dans la vie, comme celui qui n’avait pas son tombeau errait dans la mort : aussi le foyer est un endroit sacré. Aux calendes, aux ides, aux nones, à tous les jours de fête, on y suspend une couronne de fleurs[16] et, à son entrée dans la maison, le père de famille salue avant tout les Lares du foyer[17]. La grande Vesta régnait au foyer public, flamme vivante qui ne donne ni ne reçoit aucun germe de vie[18] ; par conséquent, vierge immortelle qui ne veut avoir que des vierges pour compagnes. Chaque maison possède aussi une Vesta domestique. Le foyer est son autel et le feu qui y brûle est un dieu : le dieu qui entretient la vie dans la maison, comme le soleil dans la nature, qui cuit le pain, fait les outils, aide à tous les travaux ; mais aussi le dieu, qui purifie et n’est jamais souillé, qui reçoit les sacrifices et porte aux autres divinités la prière des mortels, quand la flamme, avivée par l’huile, par l’encens et la graisse des victimes, brille et s’élance vers le ciel. Ô foyer, dit un hymne orphique, toi qui es toujours jeune et beau, rends-nous toujours heureux ! Toi qui nourris, reçois de bon cœur nos offrandes et, au retour, donne-nous le bonheur et la santé. Avec moins de ferveur religieuse, mais avec une émotion qui fait comprendre ce culte éternel du foyer, Cicéron dira pus tard : Ici est ma religion, ici ma race et les traces de mes pères. Je ne sais quel charme je trouve en ce lieu qui pénètre mon cœur et mes sens. Et nous, modernes, nous parlons encore comme Cicéron, quand nous revenons nous asseoir au foyer paternel. III. — Les Mânes.Les âmes des morts, ou Lemures, étaient de deux sortes : celles des méchants, les Larves ; celles des bons, les Mânes. Les Mânes, les êtres purs, étaient les morts purifiés par
les cérémonies funèbres et devenus les protecteurs de ceux qu’ils avaient
laissés derrière eux dans la vie. À Rome, comme partout, on ne croyait pas que
le mort fût mort tout à fait. Il avait sa demeure comme le vivant ; son foyer
à lui était le tombeau. Là il recommençait une seconde vie, triste mais
calme, si les rites funéraires avaient été accomplis ; irritée et malheureuse,
quand les honneurs funèbres ne lui avaient pas été rendus. Séparé de sa
dépouille mortelle, l’être humain ne quittait pas la terre pour monter dans
les sphères éthérées, ou descendre aux enfers. Invisible, mais toujours
présent, il restait près de ceux qu’il avait aimés, leur inspirant les sages
pensées, protégeant leur demeure et leur fortune, à la condition toutefois
que les vivants rendissent au mort le culte des aïeux. A l’origine, ces
rites. étaient cruels, au moins pour le jour des funérailles, car on croyait
que les flânes aimaient le sang. Sur la tombe d’un roi ou d’un héros, on
immolait sa femme, ses esclaves, son cheval de guerre ou des captifs ; et de
cette coutume sont venus les combats de gladiateurs qui furent d’abord, ainsi
que l’a été l’auto-da-fé espagnol, un acte de dévotion. Mais, aux
anniversaires, les Mânes étaient satisfaits si les parents venaient orner le
tombeau de guirlandes en feuillage, comme nous y mettons des fleurs, y
déposer des gâteaux de farine et de miel, y faire des libations avec du vin,
du lait[19]
et le sang d’une modeste victime. Ils assistaient invisibles à ces cérémonies
pieuses et prenaient leur part des offrandes[20]. Un grand nombre
de bas-reliefs et de peintures représentent des morts faisant leur repas élyséen. Lucien, qui rit de tout, se
moque de cet appétit des morts[21] ; et de son
temps, en effet, même bien avant lui, c’étaient de pauvres diables, les bustirapi[22], qui jouaient le
rôle des morts, en enlevant la nuit les aliments déposés sur les tombeaux.
Mais les gens pieux croyaient qu’avec ces offrandes on s’assurait la
bienveillance des Mânes et que les oublier, c’était s’exposer à leur colère.
Alors, errant dans la nuit silencieuse, ils venaient épouvanter les vivants,
ou jetaient la maladie sur leur troupeau, la stérilité sur leur terre[23]. Aussi, même en
un temps ou le crédit de Jupiter avait singulièrement baissé, Cicéron
écrivait : Rendez aux dieux mânes ce qui leur est
dû et tenez-les pour des êtres divins, car nos aïeux ont voulu que ceux qui
étaient sortis de cette vie fussent au nombre des dieux[24]. Nous nous
signons en passant prés d’un tombeau ; le Romain disait au mort : Dors en paix, ou bien Sois-nous propice, et il le saluait du même
geste d’adoration dont il se servait pour adorer les dieux. Lors même qu’une
famille était obligée de vendre le champ où se trouvait son caveau funéraire,
la loi lui réservait un droit de passage, pour qu’elle pût aller accomplir
les rites sacrés[25]. Au retour des Feraha, le dernier jour de la fête des morts,
on célébrait dans chaque maison les Caristies, festin auquel tous les parents
prenaient part. On y rappelait les souvenirs glorieux de la famille, on
adorait en commun les Lares protecteurs de la maison paternelle et l’on se
séparait avec des souhaits de prospérité. A ce
banquet fraternel, dit Ovide, Cette religion de la mort est à la fois la plus ancienne et la plus touchante ; elle établit un lien entre les générations passées et celles qui leur survivent. L’âme des ancêtres était l’âme de la famille, et il y avait dans cette ferme croyance un grand principe de conservation sociale. Mais notons bien que cette fête des morts différait essentiellement de la nôtre, qui est une belle idée de charité universelle continuée par delà le tombeau : la prière par tous pour ceux qui n’en auraient de personne. Chez les Romains, le culte des morts était essentiellement domestique. Les proches seuls pouvaient faire les offrandes, et nul étranger n’avait le droit d’assister aux repas funéraires, représentation pieuse des banquets de la vie élyséenne, seule joie que le Romain et le Grec aient imaginée pour leurs morts. L’homme qui mourait sans laisser une famille derrière lui manquait donc de ces honneurs qui étaient le repos et la consolation des morts. Aussi, pour éviter ce malheur, le Romain sans enfant se créait, à défaut de la famille naturelle, une famille légale, et c’est à une croyance religieuse qu’il faut attribuer l’importance de cette coutume civile des adoptions, aussi fréquentes à Rome qu’elles sont rares chez nous. Les collèges funéraires sous l’empire seront une autre manière de se donner des proches qui puissent accomplir les rites nécessaires à cette seconde vie du sépulcre. Les Larves, messagers du sombre séjour, apportaient aux vivants les songes funestes, les visions menaçantes et les apparitions redoutables : c’étaient les fantômes qui peuplaient la nuit et dont on tâchait de conjurer la colère en jetant par-dessus son épaule des fèves noires ou en frappant sur un vase d’airain. Tous n’étaient pas aussi faciles à écarter, et, sur le compte de quelques-uns, il courait de lugubres histoires qui fortifiaient la croyance aux Génies malfaisants. Ulysse, disent Pausanias et Strabon, s’étant arrêté à Temesa sur la côte du Bruttium, un de ses compagnons, Politès, outragea une jeune fille et fut lapidé par les habitants. Ulysse ne fit rien pour venger ce meurtre et apaiser les mânes du héros, aussi le spectre de Politès revenait chaque nuit jeter l’effroi et la mort parmi les gens de Temesa. Afin d’échapper à sa colère, ils allaient abandonner leur ville, quand la pythie leur révéla qu’ils apaiseraient le héros s’ils lui construisaient un sanctuaire et lui livraient chaque année la plus belle de leurs filles. L’édicule fut élevé au plus épais d’un bois d’oliviers sauvages, et le dur sacrifice s’accomplit jusqu’au jour où un athlète fameux de Locres, Euthymos, entra dans le temple, vit la jeune fille, et, touché tout à la fois de compassion et d’amour, se résolut à combattre, la nuit suivante, le démon. II le vainquit, le chassa du territoire et le força de se précipiter dans les flots de la mer Ionienne. Depuis lors, oncques ne reparut le spectre fatal ; mais longtemps subsista le proverbe : Gare le héros ![27] IV. — Naturalisme de la religion romaine et dévotion formaliste.Il y a de la poésie dans les cérémonies pieuses accomplies auprès du foyer et autour des tombeaux. On en trouve encore, d’une autre sorte dans le culte des bois sacrés. L’Apennin était alors couvert de ces immenses forêts dont le silence et le mystère ont inspiré longtemps une religieuse terreur. Pour trouver une protection au milieu de ces périls inconnus et d’autant plus redoutés, on consacrait, dans une clairière, un groupe d’arbres qui devenaient un temple et un asile inviolable. Parfois, un seul arbre, celui que la foudre avait frappé, ou dont la tête dominait la forêt entière et qui ne laissait rien pousser sous l’épaisseur de son ombre, devenait un être divin. En 456, trois ambassadeurs de Rome viennent réclamer des Èques l’observation d’un traité. Le chef, assis sous un chêne immense, leur répond par dérision : Adressez-vous à cet arbre ; j’ai autre chose à faire que de vous entendre. — Eh bien ! s’écrie un des Romains, que ce chêne sacré et que le dieu, quel qu’il soit, qui l’habite, sachent que vous avez violé la foi promise ; qu’ils prêtent une oreille favorable à nos plaintes et nous assistent dans le combat[28]. Virgile, Lucain, voyaient les restes subsistants de ce vieux naturalisme. Ils parlent d’arbres vénérés, de l’olivier de Faunus, où les marins, au retour d’une navigation dangereuse, suspendaient leurs ex-voto, et du vieux chêne qui étend dans le ciel ses rameaux desséchés, mais porte toujours les dépouilles des victimes offertes par le peuple et les dons consacrés des chefs. Bien qu’autour de lui la forêt soit robuste et verdoyante, seul il est honoré. Exuvias
populi.... sacrataque gestans Dona
ducum.... Sola
tamen colitur. Les animaux jouaient naturellement un rôle dans cette religion de la nature. Au temple de Juno Sospita, Lavinium, un serpent recevait les offrandes. Le pic, qui, de son bec vigoureux, semble attaquer les plus gros arbres où il cherche sa nourriture, et le loup, le roi des forêts italiennes, étaient le symbole de Mars. Lorsque sous la feuillée, dans le silence et l’ombre, on entendait au loin le pie frapper ses coups secs et stridents, c’était le dieu rustique qui parlait, et l’augure donnait un sens à ses paroles.
Le Romain ne connaît pas l’amour divin : il tremble au contraire devant les innombrables divinités[30], capricieuses et vindicatives, qu’il se figurait embusquées partout sur le chemin de la vie ; et, selon le mot du plus religieux des païens[31], il entrait plein d’effroi dans leur sanctuaire, comme si leur temple était une caverne d’ours ou de dragon. Qu’il franchisse par mégarde du pied gauche le seuil de sa maison, qu’il entende le cri d’une souris ou que son regard tombe sur un objet réputé funeste, aussitôt il rentre éperdu dans sa demeure et ne se rassure qu’en offrant un sacrifice expiatoire. Il croyait au mauvais œil[32] comme l’Italien d’aujourd’hui, et, comme lui encore, il pensait s’en garantir par un fascinum[33] qu’il suspendait au cou de ses enfants, dans son jardin et à son foyer. On en fit le dieu Fascinus, dont le culte était confié aux vestales et qu’on plaça sols le char des triomphateurs pour détourner l’envie et conjurer la fortune contraire[34]. Cependant il y avait un préservatif certain contre les sortilèges, c’était de cracher dans le soulier de son pied droit avant de le mettre[35]. Caton l’Ancien est mort en 149 ; il a donc vécu à une époque où commençait le grand âge de la civilisation romaine ; combien, cependant, cet homme froid et qui calculait si bien est-il encore superstitieux ! Il croit aux charmes, aux paroles magiques, pour guérir les maladies. Voici sa recette, par exemple, contre les luxations. Prenez un roseau vert de quatre ou cinq pieds de long ; coupez-le par le milieu, et que deux hommes le tiennent sur vos cuisses. Commencez à chanter : daries dardaries astataries dissunapiter, et continuez jusqu’à ce que les deux morceaux soient réunis. Agitez un fer au-dessus. Quand les deux parties se seront réunies et se toucheront, saisissez-les, coupez-les en tous sens. Faites-en une ligature sur le membre luxé ou cassé, et il se guérira. Cependant chantez tous les jours sur la luxation : huat hanat huat ista pista sista, dorniabo damnaustra ; ou bien encore : huat haut haut zsta sis tar sis ordaunabon damnaustra. Et il a mis dans son de Re rustica quantité de recettes analogues ! Cependant Caton est un des plus grands personnages de Rome. On voit que, par certains côtés, ce peuple était bien petit. Des superstitions aussi grossières et une crédulité aussi aveugle se sont vues en d’autres temps même très civilisés, et en mille endroits il en subsiste qui les valent. Tous les Génies de la vieille Rome ne sont même pas morts : ils revivent sous d’autres noms, pour peupler cet infini des cieux dont le vide et le silence nous effrayent. Mais ce qui appartient plus particulièrement à la religion romaine, c’est son caractère formaliste. Point d’élan dans la piété et pas plus d’aspiration divine que de réflexion philosophique. Les paroles, l’attitude, le geste, sont commandés par le rituel. Sortir de la règle établie, même pour accorder davantage aux dieux, c’était aller au delà de ce qu’il faut, et tomber dans la superstition. Au temple, l’état le plus religieux de l’âme était le calme absolu : silence sur les lèvres, silence dans la pensée[36]. Pour les rites, tout était arrêté d’avance, même la prière, qui devrait ne sortir que du cœur, et bientôt l’on priera avec des formules que l’on ne comprendra plus. Au temps des Antonins, les frères Arvales répétaient des chants qui dataient peut-être de Numa. Et il fallait redire ces vieilles choses avec un soin religieux, car une vertu particulière était attachée aux expressions mêmes. Faute d’un mot, un sacrifice devenait inutile et une prière était vaine. Les jurisconsultes diront plus tard : qui virgula cadit, causa cadit, pour une virgule, on perd sa cause. On pensait qu’il en était de même avec les dieux. Lorsqu’un consul avait à prononcer une formule religieuse, il la lisait dans le rituel, de peur d’omettre ou de transposer un mot. Un prêtre suivait la lecture sur un second livre, afin de s’assurer que toutes les phrases sacramentelles étaient bien dites ; un autre faisait observer dans l’assistance un silence absolu ; enfin, un musicien couvrait, par les modulations de sa flûte, tout bruit qui aurait rompu le charme attaché aux paroles que l’officiant récitait[37]. L’esprit religieux a subi bien des servitudes ; jamais il n’a été enchaîné de liens aussi étroits. Ce serait à croire que Rome, comme un institut fameux, avait peur de l’exaltation religieuse, si l’on ne savait que, dans cet institut, la réglementation de la piété est le résultat de la réflexion et qu’elle fut, chez les Romains, le produit spontané du caractère national. Mais si cette crédulité puérile abaisse l’esprit de ce peuple, elle le rendra aussi très gouvernable, et cette rigoureuse discipline de la dévotion, qui n’a rien de commun avec le sentiment religieux, préparera des citoyens à qui le respect et la règle au temple inspirera longtemps le respect de la loi au Forum. Autre remarque : ces divinités de Rome nous ont paru moins belles, mais plus morales que celles du polythéisme grec, et les Pères de l’Église trouvent que la religion de Numa était une religion honnête[38]. Cependant les dieux romains ne demandent pas à leurs fidèles de pratiquer la justice. La pureté qu’ils exigent est celle du corps, castitas[39]. On peut venir à eux sans aucune repentance, mais point avec une souillure au visage, sur les mains ou sur les vêtements. Aussi une toge blanche est nécessaire pour les fêtes, et les ablutions, les bains, furent un acte pieux avant d’être une mesure d’hygiène. On pourrait dire que les thermes, la gloire architecturale de Rome, dérivent, comme ses théâtres et ses cirques, d’une idée religieuse. Entre ces dieux et l’homme, il n’y a qu’un rapport d’intérêt. Ils veulent, être honorés et, tels qu’un patron fier du grand nombre de ses clients, ils tiennent à ce que la foule entoure leurs autels ; ils demandent des victimes et des libations, des chants, et des danses sacrées, des couronnes de fleurs et de feuillage autour de leurs temples et de leurs autels, avec une nombreuse assistance, afin que leur dignité en soit relevée parmi les dieux, leur crédit parmi les hommes. En échange, ils promettent leur protection et, comme on les craint, on cherche à les apaiser ; comme on croit qu’ils peuvent donner la santé, la fortune, la victoire, on accomplit tous les actes qui doivent les contraindre à concéder ces biens. Le Romain n’aime pas ses dieux, et eux ne vivent pas en lui, ils ne purifient pas son cœur, ils n’élèvent pas son âme. La religion est un marché, et le culte, un contrat en due forme : donnant, donnant. Plaute le dit crûment : Celui qui s’est rendu les dieux propices fait toujours de bons profits[40]. Cette piété qui compte si bien montre dès maintenant qu’il manquait à ce peuple certaines qualités d’esprit : n’ayant pas eu le ressort religieux, il n’aura pas, plus tard, le ressort philosophique. Cependant Vesta avait mis en honneur la pureté virginale ; Junon et toutes les déesses nuptiales ou nourricières, la sagesse et le dévouement des matrones ; les Lares aimaient les vertus domestiques ; les Mânes, la concorde dans la famille ; Fides, la bonne foi dans les contrats ; Terminus, le respect de tous les droits, et, à l’exception de certaines divinités rustiques qui se plaisent à folâtrer et à rire, qui même permettront bien davantage, tous ces dieux ont la gravité romaine. Pourtant nous n’irions pas jusqu’à répéter ce qu’on a dit de cette religion, qu’elle a fait, comme la philosophie de Socrate, descendre la divinité sur la terre et l’a contrainte à régler la vie et les mœurs des hommes. La philosophie socratique a été un puissant effort de la réflexion ; la religion romaine, au contraire, naquit spontanément des mœurs, et aux âges primitifs, les mœurs précèdent les croyances qui, à leur tour, les conservent. Les populations latino-sabines, où la famille était si forte, ont créé des dieux domestiques qui ne peuvent jamais être mauvais, et leur vie agricole les forçait d’avoir des dieux qui protégeassent la propriété et les conventions. Avant d’être porté au bout du champ pour y servir de borne sacrée, Terminus était sorti du sillon ouvert par la charrue latine. V. — Collèges sacerdotaux.Ainsi la religion romaine est double. Il y a celle de l’État ou de la société tout entière et celle des particuliers ; mais elles vivent en fort bonne intelligence, parce qu’au fond c’est la même répondant à deux besoins différents. La famille a ses pénates, que l’État respecte ses dieux ; la cité, que les individus honorent non seulement en s’associant aux cérémonies publiques de leur culte, mais par des dévotions particulières à telle ou telle divinité, par des sacrifices à tel ou tel temple. Pour s’adresser à un des dieux de la cité, il n’est pas besoin d’intermédiaire : L’aruspice enjoint, dit Varron[41], que chacun sacrifie à sa coutume, suo quisqua rite sacri ficium faciat ; et ce principe a fait la tolérance religieuse des Romains, tant qu’ils n’ont pas cru l’État menacé par des religions particulières. Quand le père de famille, souverain pontife dans sa maison, recourait au prêtre, c’était afin de s’assurer qu’il accomplissait bien tous les rites et qu’il employait les formules nécessaires pour contraindre en sa faveur la volonté divine[42]. Il en résultait que les prêtres, quoique nommés à vie[43] et formant des collèges particuliers, demeuraient, comme sénateurs ou magistrats, membres actifs de la société et, comme citoyens, sujets de la loi et de ses représentants[44]. Si donc, à Rome, la religion et ses ministres furent liés à la politique, ce n’était pas en la dominant, mais en lui restant subordonnés. Cette dépendance dura autant que Rome païenne ; de là vinrent sa supériorité dans le gouvernement et son infériorité dans l’art et la poésie, qui sont nés, en Grèce, aux abords des temples. A ceux qui voulaient être prêtres, on ne demandait ni
connaissances spéciales ni vocation particulière. Si Rome eut un clergé, elle
n’eut point de classe sacerdotale possédant de grands biens ou levant la dîme,
et l’on n’y connut pas d’intérêt religieux distinct de l’intérêt de l’État.
Les augures ne pouvaient prendre les auspices que sur l’ordre des magistrats,
et il était interdit de révéler un oracle au peuple, si le sénat n’en avait pas
donné l’autorisation[45]. Nos aïeux, dit Cicéron, n’ont jamais été plus sages ni mieux inspirés des dieux,
que lorsqu’ils ont établi que les mêmes personnes présideraient à la religion
et au gouvernement de la république. Par ce moyen, magistrats et pontifes
s’entendent pour sauver l’État[46]. Il n’y avait
donc pas dépendance de l’une des deux puissances à l’égard de l’autre. L’État
et la religion, c’était tout un, et comme les différentes fonctions de ces
dieux innombrables pouvaient très logiquement devenir plus tard de simples
attributs de la divinité, l’État ne se sentait point menacé par
l’interprétation de croyances si élastiques, et on eut à Rome, quand la
pensée philosophique y fut apportée de Les plus honorés de ces prêtres étaient les trois flamines, ou allumeurs des autels de Jupiter, de Mars et de Quirinus, qui ne pouvaient paraître en publie ou en plein air, fût-ce dans la cour de leur maison, sans l’apex, signe de leur sacerdoce[47] ; les trois augures[48], interprètes sacrés des présages ; les vestales, gardiennes du foyer public, qui ne devait jamais s’éteindre ; les douze saliens ou sauteurs[49], gardiens des ancilia, qui, chaque année au mois de Mars, dansaient la danse des armes et, aussitôt la guerre déclarée, entraient dans le temple du dieu qui tue pour frapper de leurs piques sur son bouclier d’airain, en s’écriant : Mars, éveille-toi ! ; les douze frères Arvales ou frères des champs, prêtres de Dea-Dia, une divinité tellurique ; enfin les quatre pontifes[50], qui, libres de tout contrôle et ne rendant compte ni au sénat ni au peuple, veillaient, sous la présidence du grand pontife, au maintien des lois et des institutions religieuses, fixaient le calendrier, les jours fastes et néfastes, ce qui mettait, pour une certaine mesure, dans leur dépendance, l’administration de la justice et la tenue des comices. Le jour où la nouvelle lune montrait au ciel sa faucille d’or, un des pontifes convoquait (calare) le peuple au Capitole et lui apprenait combien il aurait de jours à compter des calendes aux nones[51]. Le jour des nones, un autre annonçait les fêtes qu’on devait célébrer dans le mois, annonce qui, chaque dimanche, est faite encore dans nos églises. Enfin les pontifes tenaient le recueil des actes sacrés des phénomènes et des événements qui semblaient avoir un caractère religieux : de là sont sorties les brandes Annales.
Les vierges de Vesta veillaient, à tour de rôle, à l’entretien du feu qui brûlait nuit et jour sur son autel. S’il venait à s’éteindre, c’était pour Rome un terrible présage ; aussi celle qui avait commis cette négligence était battue de verges, dans un lieu obscur, par le grand pontife, qui ensuite rallumait le feu en frottant l’un contre l’autre deux morceaux de bois pris à un arbre de bonheur, felix arbos ; plus tard, en concentrant dans un vase de métal les rayons du soleil[53]. Elles devaient faire des libations, des sacrifices et une opération étrange qui avait sans doute quelque rapport avec leur vœu de virginité. Lorsque, le 15 avril, les pontifes immolaient trente vaches pleines, les embryons retirés du sein des mères étaient remis à la grande vestale qui les brûlait et en conservant précieusement les cendres, que, le jour des Palilies, elle distribuait au peuple pour qu’il en fit des offrandes expiatoires[54]. Chaque matin elles lavaient le temple avec de l’eau puisée à la fontaine d’Égérie dans un vase à large ouverture et terminé en pointe, futile, de sorte qu’il ne pouvait être déposé à terre, sans que toute l’eau qu’il contenait ne se répandit. Elles avaient la garde de Fascinus, le dieu qui détourne les maléfices, et celle de saintes reliques, gages de la durée de l’empire, fatale pignus imperii[55] : ces reliques, conservées au lieu le plus secret du sanctuaire, étaient le Palladium, statuette informe de Pallas, et les fétiches qu’on disait avoir été apportés de Samothrace à Troie par Dardanus, et de Troie en Italie par Énée. La grande vestale, maxima virgo, pénétrait seule dans ce saint des saints. Leurs fonctions duraient trente années, au bout desquelles les vestales pouvaient rentrer dans le monde, même se marier ; mais bien peu profitaient de ce droit ; elles achevaient leur vie près de la déesse à qui elles avaient voué leur virginité. En compensation de ce sacrifice, elles étaient entourées de respect et jouissaient de grands honneurs. Libres de tout lien de parenté, c’est-à-dire soustraites à la puissance paternelle, patria potestas, et à la tutelle des agnats, elles pouvaient recevoir des legs et disposer de leurs biens par testament. En justice, elles déposaient sans qu’on leur déférât le serment. A leur rencontre, le magistrat faisait baisser les faisceaux et le criminel conduit au supplice était délivré, pourvu qu’elles déclarassent s’être fortuitement trouvées sur son passage. Mais aussi quelle horrible mort, si elles violaient leur vœu ! A l’extrémité du Quirinal, entre la porte Colline et l’endroit où seront les jardins fameux de Salluste, se trouvait le champ du malheur, campus Sceleratus. On y creusait une chambre souterraine où la prêtresse coupable devait être ensevelie vivante. Placée dans la civière des morts qu’entouraient d’épaisses couvertures pour étouffer ses cris, elle était portée avec une pompe lugubre, à travers le Forum et la foule silencieuse, jusqu’au caveau où l’on avait placé un lit, une lampe allumée, du pain, un peu d’eau, de lait et d’huile : provisions d’un jour pour une prison éternelle, et dérisoire assistance d’une piété qui ne voulait pas avoir à rendre compte à Vesta du meurtre d’une de ses vierges ! Quand le cortège funèbre était arrivé au lieu du supplice, le grand prêtre prononçait de secrètes prières ; puis la civière était ouverte, et, enveloppée de ses voiles blancs comme d’un linceul, la malheureuse descendait, par une échelle, dans sa tombe dont les esclaves se hâtaient de bouclier l’ouverture. Le sol était soigneusement égalisé, afin que rien ne révélât l’endroit où, dans la nuit et le froid du tombeau, la vestale expiait un sacrilège que peut-être elle n’avait pas commis. Personne ne venait y faire les libations que le plus pauvre offrait aux Mânes[56] : elle était retranchée à la fois du monde des vivants et du monde des morts. Le meurtre accompli, la foule s’écoulait lentement : quelques-uns profondément émus de cette fin terrible d’une belle et noble jeune fille, vouée avant l’âge à un sacerdoce redoutable ; le plus grand nombre convaincu qu’on avait détourné, par un sacrifice nécessaire, des maux dont Rome était menacée. Vesta n’abandonnait pas toujours ses prêtresses. Imilia allait être condamnée à mort pour avoir confié le soin d’entretenir le feu sacré à une novice qui l’avait laissé éteindre. Après avoir imploré la déesse, la vestale déchire un pan de sa robe, le jette sur la cendre refroidie, et le foyer se rallume[57]. Une autre, Tuccia, accusée d’inceste, s’écrie : Ô Vesta, si je me suis toujours approchée de tes autels avec des mains pures, accorde-moi un signe qui prouve mon innocence ; et, prenant un crible, elle descend au Tibre, le remplit d’eau et revient le répandre aux pieds des pontifes[58]. Une pierre gravée nous a conservé le souvenir de ce miracle, car chaque collège de prêtres tenait à avoir le sien ; et ces légendes, en attestant l’intervention divine, débarrassaient la conscience des Romains du remords d’avoir condamné une innocente à une mort affreuse, quand leur politique sans entrailles demandait une victime pour calmer les terreurs populaires. Les honneurs rendus aux vestales répondaient à l’importance religieuse du culte accompli autour de ce foyer public qui ne devait jamais s’éteindre[59]. Mais à l’idée religieuse qui avait d’abord déterminé les conditions imposées aux prêtresses s’était ajouté, comme conséquence, une idée morale. Cette flamme éternelle qui symbolisait la te même du peuple romain, des vierges seules pouvaient l’entretenir ; l’institution du collège des vestales était donc une glorification involontaire de la chasteté, et, en des temps de ferveur, cette croyance devait avoir une influence heureuse sur les mœurs. Les vingt féciaux, élus à vie et pris dans les plus nobles familles, formaient un collège à la fois politique et religieux qui présidait aux actes internationaux. Quand Rome croyait avoir à se plaindre d’un peuple, un fécial, qu’on appelait pour cette circonstance le pater patratus du peuple romain, lui était envoyé. Il partait, la tête ceinte d’un tissu de laine blanche et d’une couronne de verveine sacrée qu’il avait cueillie au Capitole. Arrivé à la frontière ennemie, il s’écriait : Entends-moi, Jupiter ! Entendez-moi, dieux des limites ! Et toi, oracle sacré du droit (fas), écoute, je suis le messager du peuple romain ; je viens en toute justice, et mes paroles méritent toute confiance. Puis il énumérait les griefs des Romains, attestant par de solennelles imprécations qu’ils étaient bien fondés. Si c’est contre le droit et ma conscience que je demande qu’on me livre ces personnes et ces choses, à moi le messager du peuple romain, que Jupiter ne nie laisse jamais rentrer dans ma patrie. En avançant sur le territoire ennemi, il adressait les mêmes paroles au premier habitant qu’il rencontrait, à ceux qu’il trouvait aux portes de la principale cité, enfin, sur le forum, aux magistrats. Si, au bout de trente-trois jours, satisfaction ne lui était pas donnée, il s’écriait : Écoute, Jupiter, et toi, Janus Quirinus et vous tous dieux du ciel, de la terre et de la région souterraine, je vous prends à témoin que ce peuple est injuste et viole le droit. Comment vengerons-nous le droit outragé ? Nos vieillards en décideront. Et il rentrait à Rome. Le sénat et le peuple décidaient-ils le recours aux armes, le fécial revenait à la frontière ennemie, portant un javelot dont le bout avait été brûlé et rougi dans le sang, et il y lançait cette menace d’incendie et de carnage, en annonçant l’ouverture des hostilités. Plus tard et jusque sous l’empire, quand l’ennemi était sur l’Elbe ou sur l’Euphrate, le fécial accomplissait les mêmes cérémonies, mais sans sortir de Rome. Au Champ de Mars, prés du temple de Bellone, s’élevait la colorante de la guerre qui figurait l’extrémité de la frontière romaine. Le fécial y lançait son javelot sanglant, et Rome croyait avoir consciencieusement accompli tous les rites qui obligeaient les dieux à lui donner la victoire. Au sacrifice fait pour la conclusion d’un traité, le fécial tuait la victime avec un caillou en silex, la pierre d’où jaillit l’étincelle et qu’à raison de cette propriété on mettait souvent dans la main de Jupiter au lieu des dards qui figuraient les éclairs[60]. La plupart des collèges sacerdotaux se complétaient par cooptation, c’est-à-dire que les survivants faisaient l’élection[61]. C’était un moyen d’assurer le secret des traditions conservées au sein de la corporation. Les flamines étaient, comme les vestales, désignés par le grand pontife. Aux prêtres étaient adjoints, pour les aider dans les
cérémonies saintes, des enfants de noble maison et de beauté parfaite à qui
l’on donnait le nom de camilles, que
portait Mercure, le messager des dieux[62]. Les divinités de
On subvenait aux frais du culte et à l’entretien des prêtres par une certaine étendue de terre assignée à chaque temple[63]. Plus tard l’État alloua même un traitement[64]. Le culte domestique de certaines familles faisait aussi partie du culte public de la cité, comme les Lupercales, dont les gentes Fabia et Quinctia avaient le sacerdoce héréditaire ; les sacrifices en l’honneur d’Hercule[65], qui devaient être accomplis par les Pinariens et les Potitiens. VI. — Fêtes publiques.Les fêtes étaient innombrables, comme les dieux, car l’Italien de tous les temps a aimé les pompes religieuses, qui étaient une diversion à la monotonie de la vie ordinaire, une occasion de cérémonies pieuses, de jeux bruyants et de repas où le plus pauvre dépensait les réserves d’une semaine entière. Il suffira de montrer ici quelques-unes de celles qui nous révèlent plus particulièrement les coutumes des vieux âges. Des fêtes qu’on célébrait encore à l’époque de César[66], et bien
longtemps après lui, rappelaient la vie rurale, les mœurs grossières et les
dévotions intéressées des premiers Romains. A Palés, ils demandaient ce que
leurs descendants demandent à saint Antoine, la santé de leurs troupeaux ; à
Lupercus, le dieu loup qui protégeait la ferme contre le terrible fauve dont
il portait le nom, leur multiplication ; à Dea-Dia, l’abondance de la
moisson. Le jour des Lupercales, les prêtres couraient à demi nus par la
ville, armés de fouets dont les lanières étaient faites avec la peau des
boucs et des chiens offerts en sacrifice au dieu de la fécondité, et ils en
frappaient tous ceux qu’ils rencontraient, surtout les femmes qui, en
s’offrant à leurs coups, croyaient échapper à l’opprobre de la stérilité ou
s’assurer une heureuse délivrance. Aux Palilies, les bergers sautaient trois
fois par-dessus des tas de foin enflammé et forçaient leurs bêtes à traverser
la fumée odorante : c’étaient les feux de la purification. Les Ambarvalia, ou lustrations des champs, étaient
accomplis au nom de l’État par les frères Arvales avant que le blé ne tombât
sous la faucille, et la fête se renouvelait autour de chaque domaine. Le
front ceint d’une branche de chêne, suivi de ses proches et de ses
serviteurs, le propriétaire faisait trois fois aussi le tour de son domaine
en dansant et en chantant des hymnes à Dieux de nos pères, nous purifions nos champs et ceux qui les cultivent. Chassez le mal de nos terres, que l’herbe mauvaise n’étouffe pas la moisson promise et que la lente brebis n’ait pas à craindre le loup rapide ![67] Des libations de lait et de vin miellé, un sacrifice et un festin où l’on mangeait la victime terminaient ces rogations païennes. Les Amburbalia étaient la lustration de la ville. Le long des murs se déroulait, conduite par les prêtres et précédée des victimes, la longue procession des citoyens qui, pour ce jour solennel, s’étaient revêtus de toges blanches et couronnés de feuillage. Quand les chants avaient cessé, que les victimes étaient tombées sous le couteau sacré et qu’on avait brûlé sur l’autel la part des dieux, ceux-ci devaient leur protection aux portes et aux murailles. Le peuple lui-même, à la clôture de chaque lustre, était purifié par un sacrifice expiatoire. Convoqué par le héraut, il se réunissait au champ de Mars, où le roi, parfumé de myrrhe et de plantes odoriférantes, s’était rendu dès l’aube avec les victimaires qui conduisaient un porc, une brebis et un taureau. Trois fois il tournait autour de l’assemblée en répétant des hymnes et des prières, puis il immolait les victimes, et le suovetaurile était accompli. Des chants, des prières, une offrande, ces dieux débonnaires n’en demandaient pas davantage pour rester en paix avec leur peuple. Dans les circonstances graves, durant une peste ou au milieu d’un malheur public, ils admettaient leur peuple à communier avec eux. On portait leurs statues devant une table servie ; les dieux étaient couchés sur des lits, comme dans les repas romains, les déesses assises, et l’imagination populaire, surexcitée par le péril, croyait les voir accepter le festin, ou parfois en détourner la tête avec colère[68]. Est-ce à un souvenir gardé par l’Espagne de ces convives de pierre qu’est due la terrible légende du Commandeur, el Convidado de piedra[69] ? De tels dieux et de telles fêtes montrent le Romain plongé, comme le Grec l’avait été, dans cette ivresse de la nature que la grande enchanteresse avait versée à toute la race aryenne : ivresse aimable et féconde pour les fils d1lomére et de Platon, pesante et stérile pour les fils de Romulus ; car les premiers y trouvèrent un idéal charmant et sublime que les autres ne connurent jamais et qu’ils entrevirent seulement le jour où ils cessèrent d’être Romains. |
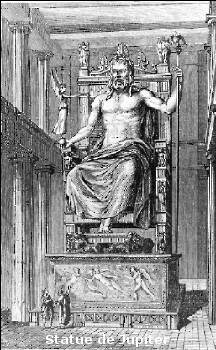 Comme on avait mis au compte de Romulus les institutions
civiles qui avaient été celles de l’Italie centrale d’où les Romains sont
sortis, on a fait de Numa l’auteur des coutumes religieuses apportées du
Latium et de
Comme on avait mis au compte de Romulus les institutions
civiles qui avaient été celles de l’Italie centrale d’où les Romains sont
sortis, on a fait de Numa l’auteur des coutumes religieuses apportées du
Latium et de  Au-dessus des naïades, des nymphes et de tous les génies
des eaux, s’élevait Pater Tiberinus, le fleuve puissant qui ne voulait pas
être enchaîné par un pont de pierre et ne toléra longtemps, au-dessus de ses
flots, que le
Au-dessus des naïades, des nymphes et de tous les génies
des eaux, s’élevait Pater Tiberinus, le fleuve puissant qui ne voulait pas
être enchaîné par un pont de pierre et ne toléra longtemps, au-dessus de ses
flots, que le  Les Pénates ou dieux intérieurs, que Virgile appelle les
dieux paternels
Les Pénates ou dieux intérieurs, que Virgile appelle les
dieux paternels Au fond, la religion des premiers Romains s’éloignait à
peine du fétichisme. Quirinus, figuré par une lance, Jupiter Lapis par une
pierre
Au fond, la religion des premiers Romains s’éloignait à
peine du fétichisme. Quirinus, figuré par une lance, Jupiter Lapis par une
pierre Les vestales furent d’abord au nombre de quatre, deux pour
chaque tribu ; il y en eut six après l’adjonction des
Les vestales furent d’abord au nombre de quatre, deux pour
chaque tribu ; il y en eut six après l’adjonction des 