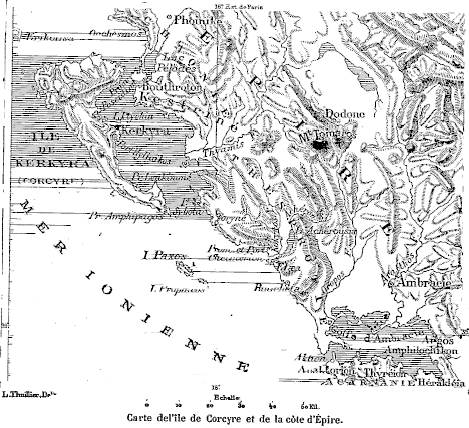HISTOIRE DES GRECS
CINQUIÈME PÉRIODE — LUTTE DE SPARTE ET D’ATHÈNES (431-404).
Chapitre XXIII — La guerre du Péloponnèse jusqu’à la mort de Périclès.
I. Guerre de Corcyre (434) et affaire de Potidée (432)La royauté, abolie dans tous les États de Tandis qu’Athènes ralliait autour d’elle les insulaires et la plupart des cités maritimes, Sparte retenait dans son alliance les peuples du continent. En face de l’empire athénien était la ligue du Péloponnèse. Plus du tiers de la presqu’île appartenait en propre à Lacédémone ; et, comme il n’y avait dans le reste que de petites cités, elle ne trouvait pas autour d’elle de rivale ; tous, moins Amos, acceptaient sa suprématie. Chez elle, sur les hilotes et les 1lesséniens, sa domination était sans pitié ; et sa vie n’offrait, au lieu de la féconde activité d’Athènes, qu’une oisiveté barbare, inutile au monde comme à elle-même. Mais, reconnaissons-le, au dehors son influence, à cette époque, était le légitime empire d’un peuple fort et modéré. Point de tributs, aucune vexation. Sparte était la tête d’une ligue volontairement formée, non la capitale d’un empire. Si une entreprise d’un intérêt général exigeait l’effort de tous, les députés de chaque cité se réunissaient ; on discutait, on votait, et chacun fournissait pour l’ouvre commune les hommes et l’argent nécessaires. La liberté d’aucun n’était blessée, et le concours de tous était bien plus assuré que dans cet empire athénien, où le maître avait à craindre la révolte des sujets. Au reste, les circonstances et la situation des deux villes, bien plus que le dessein prémédité de leurs habitants, avaient fait naître ces deux politiques contraires. L’ambition d’Athènes était, comme le désintéressement de Lacédémone, le résultat, d’une nécessité. La plupart des Péloponnésiens, peuple agriculteur, vivant de peu et demeurant volontiers dans leur rusticité native, sans industrie, sans commerce, sans arts, je dirais presque sans besoins, s’accommodaient d’une autorité qu’ils ne sentaient pas et qu’ils eussent repoussée si elle eût voulu peser sur eux. Qu’eût gagné Lacédémone à les traiter en sujets, à augmenter cette large plaie de l’hilotisme, qu’elle portait au flanc, toujours saignante ? N’avait-elle pas plus de terres qu’il ne lui en fallait ? et les guerres de Tégée et d’Argos n’avaient-elles pas prouvé que les Spartiates, confinés par la nature et par leurs moeurs dans le sud du Péloponnèse, n’en pouvaient sortir ? La déférence des alliés suffisait à leur orgueil militaire ; et leurs lois les condamnant à la pauvreté, au mépris du commerce et des arts, ils n’avaient pas besoin d’extorquer des richesses. Il ne faudrait pourtant pas prendre à la lettre cette indépendance des alliés de Sparte. Thucydide nous montre bien une diète générale réunie à Lacédémone; mais sur toute question les Spartiates délibèrent à part, et c’est leur résolution qui décide celle de l’assemblée. Bien plus, ils exigent des otages et les gardent dans des lieux fortifiés, de sorte que Périclès ut fondé à leur dire : Rendez, vous aussi, la liberté aux villes que vous tenez assujetties. Mais ces villes ne payaient point de tribut durant la paix, n’étaient pas contraintes de faire juger leurs procès à Lacédémone, et l’apparence de libre discussion laissée à la diète faisait illusion sur leur réelle dépendance.
Les Spartiates s’étaient sagement conduits lors de la trahison de Pausanias ; et ils s’étaient d’assez bonne grâce exécutés, quand les insulaires voulurent passer sous le commandement d’Athènes. Mais, lorsque s’éleva cet empire qu’ils n’avaient pas prévu, la vieille jalousie éclata. Chaque victoire de Cimon ou de Périclès leur retentit douloureusement au coeur; et bientôt ils ne tinrent plus à ce bruit importun qui se faisait autour du nova d’une rivale. Les peuples intéressés à l’abaissement des Athéniens ne laissèrent pas se dissiper cette colère. Athènes avait deux ennemis : ceux dont elle ruinait le commerce par sa concurrence, comme les Doriens d’Égine, de Mégare et de Corinthe, qui furent les provocateurs véritables de la guerre, et les Perses, qu’elle avait humiliés[1]. Vaincus sur terre et sur mer, menacés jusque dans leurs provinces maritimes, les Perses avaient renoncé à une lutte ouverte. Mais la trahison de Pausanias leur avait montré que ce qu’ils n’osaient tenter avec le fer, ils pouvaient l’accomplir avec l’or ; et dés ce jour il y eut toujours de l’or persique en Grèce. Nous avons vu un envoyé perse essayer, dits l’année 457, de pousser Sparte contre Athènes. Comme certains potentats d’une autre époque, Artaxerxés eut des agents d’une espèce différente. Plutarque parle d’une belle Ionienne, Targélia, qui s’était liée avec les citoyens les plus influents de chaque État grec. Sa fatale beauté et son esprit lui soumettaient tous ceux qui l’approchaient, et, une fois soumis, elle les donnait au grand roi. Ainsi, ajoute-t-il, se répandirent dans les cités les semences de la faction médique. C’était la contrepartie du règne d’Aspasie à Athènes, et de sa patriotique influence. On comprend que nous ne puissions suivre les progrès de cette double corruption si bien calculée ; mais on en jugera l’étendue par les effets qu’elle va produire. Sans doute, au fond des vives réclamations et de la colère des Péloponnésiens contre Athènes, il y avait de la jalousie pour sa puissance ; mais combien n’y avait-il pas de doriques royales ? Les 10 talents inscrits aux fonds secrets du budget athénien, είς τό δέον, ne suffisaient pas à neutraliser cette influence funeste du grand roi. La rivalité commerciale de Mégare, d’Égine et de Corinthe,
et la haine séculaire de Sparte, avivée par les intrigues de Ne cherchons pas d’autre origine à cette lutte fratricide.
Sparte, qui avait la prépondérance dans Elle commença au sujet de querelles particulières qui n’eussent
point dû, ce semble, amener un conflit général ; mais, dans l’état où
étaient les esprits, la moindre étincelle suffisait pour tout enflammer.
L’île de Corcyre, qui s’élève près des côtes occidentales
de. Corinthe envoya aux Épidamniens une garnison que Corcyre leur détendit de recevoir (434). Comme ils désobéirent, elle les lit attaquer par 40 vaisseaux sur lesquels se trouvaient les riches qu’ils avaient exilés. En même temps elle proposa à Corinthe de remettre cette affaire à l’arbitrage d’un tribunal neutre ou à la décision de l’oracle de Delphes. Les Corinthiens rejetèrent cette ouverture et, faisant appel à tous ceux qui voudraient s’établir à Épidamne, ils armèrent 2000 hoplites et 75 vaisseaux, dont beaucoup appartenaient à leurs alliés. Mais ces forces ne purent dépasser la hauteur d’Actium, où 80 galères des Corcyréens les arrêtèrent par une victoire. Le même jour Épidanine leur ouvrit ses portes. Les étrangers trouvés dans la place furent vendus, les Corinthiens mis aux fers, et la flotte corcyréenne resta maîtresse de la mer occidentale (343). Pendant deux années, Corinthe fit de grands préparatifs
pour venger cet échec : elle construisit des navires, amassa tout ce qu’il
fallait pour les armer et, à prix d’argent, engagea des rameurs chez tous ses
alliés. Cette menace d’une guerre redoutable finit par effrayer les
Corcyréens. Restés jusque-là en dehors des affaires et des traités des
peuples grecs, ils sentirent le besoin d’avoir un allié utile et comme ils ne
pouvaient recourir à la ligue du Péloponnèse, où leur ennemie tenait, après
Sparte, le premier rang, force leur fut de s’adresser à Athènes. Leurs
envoyés rencontrèrent dans cette ville ceux de Corinthe. Admis à parler
devant l’assemblée du peuple, les Corcyréens rappelèrent les sentiments
hostiles de Sparte contre Athènes, et les injustices des Corinthiens à leur
égard; ils firent valoir l’utilité de leur alliance pour une puissance
maritime et l’importance de leur position géographique sur le chemin de l’Italie
et de Le peuple athénien délibéra deux jours sur cette grande
question le premier fut favorable aux Corinthiens; au second, les Corcyréens
l’emportèrent. La guerre avec Sparte paraissant, comme l’avaient dit les
Corcyréens, inévitable, il importait de s’assurer l’appui de la seconde
puissance navale de Corinthe avait mis en mer 150 vaisseaux, et Corcyre 110. Les deux flottes se rencontrèrent près de l’île de Sybota. Ce fut, selon Thucydide, le combat le plus acharné qui eût encore été livré entre des Grecs. Les Corcyréens, fort maltraités, perdirent beaucoup de galères ; l’escadre athénienne, qui s’était tenue en observation depuis le commencement de la bataille, protégea leur retraite. Après quelques heures passées à recueillir leurs morts, les vainqueurs reprirent la poursuite. Ils atteignaient l’ennemi, et déjà des deux côtés on entonnait le pæan ; lorsque, tout à coup, les Corinthiens ramèrent en arrière : ils venaient d’apercevoir à l’horizon 20 vaisseaux athéniens qu’on avait envoyés ail secours des 10 premiers. De part et d’autre on dressa des trophées (432). Les Corinthiens, en se retirant, enlevèrent Anactorion, qu’ils avaient possédé jusque-là en commun avec les Corcyréens, et vendirent comme esclaves les prisonniers qu’ils avaient faits dans le combat, sauf deux cent cinquante des plus riches qu’ils gardèrent pour se ménager de grosses rançons. Avant de s’éloigner, ils avaient demandé si les Athéniens
essayeraient d’intercepter leur retour. Nous n’avons
pas rompu le traité, dirent ceux-ci, nous
sommes ici pour protéger nos alliés ; toute route vous est ouverte, hors
celle qui vous conduirait à Corcyre. Ainsi la paix ne semblait pas
rompue ; mais, après l’affaire de Corinthe, arriva, à l’autre extrémité
de Cette ville, construite sur l’isthme étroit de Pallène, la
plus méridionale des trois pointes de A cette nouvelle, les Athéniens ordonnèrent aux Potidéates
de détruire leurs murailles du côté de la mer, de donner des otages, et de
chasser les épidémiurges corinthiens. Potidée négocia à Athènes pour le retrait
de ce décret, et en même temps à Corinthe et à Sparte pour obtenir l’appui du
Péloponnèse, si Athènes persistait dans les ordres donnés. Athènes persista.
Aussitôt Potidée et, à son exemple, toutes les villes de Sparte avait promis aux émissaires de Potidée d’envahir l’Attique ; ainsi elle était la première à rompre la trêve de trente ans. Mais les Potidéates partis sur cette assurance et poussés par elle à la révolte, Sparte se tint en repos. Corinthe du moins leur envoya du secours. Athènes se débarrassa de la guerre de Macédoine par un traité avec Perdiccas, qui ne demandait pas mieux que de rester spectateur d’une lutte où les deux peuples useraient leurs forces à son profit. Toute la guerre se concentra autour de Potidée. Les Corinthiens voulurent dégager cette place : ils furent vaincus dans un combat où Socrate sauva Alcibiade blessé et prêt à tomber aux mains de l’ennemi. Le résultat de cette victoire fut l’investissement complet de Potidée ; il s’y trouvait une garnison corinthienne et beaucoup de Péloponnésiens. Battus de tous côtés, les Corinthiens poussèrent les
choses à l’extrême. Ils provoquèrent une réunion des alliés à Lacédémone, et
accusèrent les Athéniens d’avoir enfreint la paix, outragé le Péloponnèse[6]. Les Éginètes,
par crainte d’Athènes, n’envoyèrent pas ouvertement de députés ; mais ils
se joignirent en secret à ceux qui voulaient la guerre, se plaignant d’être
privés des libertés que les traités leur avaient garanties. Les Mégariens
parlèrent plus haut. Depuis quelque temps il y avait de graves démêlés entre
eux et Athènes. S’il faut en croire Aristophane et ceux qui se plaisent à trouver
des causes futiles aux grands événements, le premier grief des deux peuples
était l’enlèvement, par de jeunes étourdis, à Mégare et à Athènes, de femmes
de facile vertu. Ce qui est plus sérieux, c’est que les Mégariens, dont le
sol n’était que rochers arides ou landes pierreuses, avaient empiété sur le
territoire de l’Attique et qu’ils recevaient tous les esclaves fugitifs des
Athéniens. On n’avait pas oublié leur odieuse conduite en 446. Périclès
provoqua contre eut un décret qui leur ferma les ports d’Athènes et de ses
alliés. Les Lacédémoniens réclamèrent. contre cette loi, qui mettait un
peuple dorien au ban d’une moitié de Périclès se contenta d’envoyer un héraut porter à Sparte
les plaintes d’Athènes, en termes modérés,
dit Plutarque. Le héraut, à qui le droit grec reconnaissait un caractère sacré,
fut tué en chemin, et tout le monde accusa les Mégariens de ce meurtre que
condamnaient les plus vieilles coutumes de Cette affaire malheureuse, où le droit le plus strict
était du côté d’Athènes, décida de la guerre que les Corinthiens n’eussent
peut-être pas arrachée pour Corcyre et Potidée. Profitant des plaintes de Mégare,
ils représentèrent les Athéniens comme un peuple ambitieux, avide de
nouveautés, entreprenant, infatigable, et reprochèrent aux Spartiates une
politique qui tenait trop de l’antique simplicité, leur lenteur, leur
indifférence en face de cités grecques menacées ou asservies. Et ils ne craignirent
pas d’ajouter : Ces malheurs sont votre
ouvrage, vous qui d’abord leur avez permis, après la guerre des Mèdes, de
fortifier leur ville, et ensuite de construire les Longues murailles ;
vous qui, non seulement avez laissé détruire la liberté des villes qu’ils ont
assujetties, mais qui la laissez ravir aujourd’hui à vos propres alliés. Car
ce n’est pas l’oppresseur qui est le vrai coupable, c’est celui qui, pouvant
faire cesser l’oppression, ne veut pas même la voir, et cependant s’enorgueillit
de sa vertu et se donne pour le libérateur de Des députés athéniens se trouvaient à Sparte pour quelque autre affaire; ils se présentèrent dans l’assemblée, rappelèrent les services rendus par Athènes à la cause commune, justifièrent sa conduite envers ses alliés, qui étaient venus à elle offrant leur dépendance, bien plutôt qu’elle n’était allée à eus, imposant son empire ; qui avaient plus souffert auparavant sous les Perses, et souffriraient plus, après, sous Sparte, dont personne n’avait à vanter la modération. Puis ils montrèrent les maux qu’entraînerait une guerre générale, et conclurent en proposant de faire décider la querelle par des arbitres. C’était sagement terminer de fières paroles. Les étrangers entendus, les Spartiates firent retirer tout le monde, et délibérèrent entre eux. Le vieux roi Archidamos parla au nom de sa longue expérience et remontra les dangers d’une lutte pour laquelle Sparte n’aurait ni marine ni argent, tandis qu’Athènes avait abondamment l’une et l’autre. Il se prononça pour une intervention ferme, mais pacifique, en faveur des alliés, laquelle, si elle n’amenait pas une réconciliation générale, donnerait au moins le temps d’amasser de l’argent et des vaisseaux. Quant à cette circonspection dont on faisait un reproche aux Spartiates, il les adjura de ne s’en point départir, car c’était à elle qu’ils devaient toute leur puissance. Mais l’éphore Sténélaïdas entraîna l’assemblée par d’impétueuses paroles. Je n’entends rien, dit-il, aux longs discours des Athéniens. Ils se sont beaucoup loués eux-mêmes, mais ils n’ont pas prouvé qu’ils ne font pas de tort à nos alliés et au Péloponnèse. Si, après s’être bien conduits autrefois contre les Mèdes, ils agissent mal aujourd’hui envers nous, ils sont doublement punissables, puisqu’ils sont devenus mauvais de bons qu’ils étaient. Pour nous, ce que nous étions alors, nous le sommes encore. Si donc nous avons gardé notre sagesse, nous ne laisserons pas opprimer nos alliés et nous ne parlerons pas de marcher à leur secours dans l’avenir : car c’est maintenant et non pas dans l’avenir qu’ils souffrent. D’autres ont beaucoup d’argent, de navires et de chevaux. Nous avons, nous, de bons alliés, qu’il ne faut pas livrer aux Athéniens ni défendre par des discussions et des paroles, quand ce n’est pas en paroles qu’ils sont maltraités, mais qu’il faut secourir en toute hâte et de toutes nos forces. Et que personne ne prétende nous prouver qu’il convient de délibérer sous le coup d’agressions injustes : c’est à ceux qui les préparent que conviennent les longs discours. Votez donc, Lacédémoniens, d’une manière digne de Sparte, votez la guerre ; ne laissez pas les Athéniens accroître leur puissance ; ne trahissons pas nos alliés, et avec l’aide des dieux, marchons contre les agresseurs[9]. Après ces vives paroles, il mit la question aux voix et la guerre fut résolue, si Athènes ne donnait pas satisfaction (octobre ou novembre 432). L’oracle de Delphes fut consulté. Le dieu dorien fit une
réponse qui partit favorable, mais n’était point pour le compromettre : En combattant avec énergie, dit-il, on aura la victoire[10]. Quelques vaines
négociations précédèrent les hostilités, tant on entrait à regret dans cette
lutte, où Cependant les Corinthiens, inquiets, devenaient de plus en plus pressants. Les chances de victoire sont pour nous, dirent-ils dans un second congrès des alliés de Sparte ; nous avons le nombre et l’habitude des combats La marine fait leur force ; mais nous en formerons une avec les ressources de chaque ville et les trésors que nous emprunterons à Delphes et à Olympie. Par l’offre d’une solde plus élevée, nous débaucherons leurs matelots étrangers, car leur puissance est plus mercenaire que nationale, et une seule victoire navale les mettra à notre merci… Nous avons encore d’autres moyens de leur nuire ; en provoquant la défection de leurs alliés, nous tarirons la source de leur puissance… Eh quoi ! nous laisserions une ville s’ériger en tyran, nous qui nous faisons gloire de renverser aussitôt le citoyen qui affecte la tyrannie ! … Ce n’est pas vous qui violez le traité, puisque le dieu, en vous ordonnant de combattre, déclare lui-même la rupture de la trêve… Ne tardez donc pas à secourir les Potidéates. Songez qu’ils sont Doriens, et que des Ioniens les assiègent : c’est le contraire de ce qu’on voyait autrefois. Le peuple d’Athènes, sommé par les ambassadeurs spartiates de répondre définitivement s’il était résolut ou non à donner les satisfactions demandées, se réunit en assemblée générale. Périclès y prit la parole et se prononça avec tant d’autorité pour la guerre, que l’opinion contraire n’osa même pas se produire. II montra d’abord que les Lacédémoniens étaient décidés à combattre, que leurs demandes n’étaient qu’un moyen de gagner du temps, et qu’en accorder une seule, c’était céder lâchement, sans que cette concession profitât à la paix. Accordez ce peu qu’ils vous demandent, et vous verrez aussitôt arriver de nouvelles exigences… Ou il faut d’avance prendre le parti de nous soumettre à tout, avant d’avoir rien perdu de nos forces ; ou il faut faire la guerre résolument, sans rien abandonner de nos droits. Ensuite, passant à la comparaison de la puissance des deux États, il s’efforça d’inspirer aux Athéniens confiance dans leurs ressources. Les Spartiates n’ont d’autre argent que les trésors d’Olympie et de Delphes, ressource bientôt épuisée. Ils n’ont pas de vaisseaux, et l’on n’improvise pas une marine : ils ne feront point tout à coup de leurs laboureurs d’excellents matelots, surtout quand les flottes athéniennes les empêcheront de paraître sur la mer et de s’y exercer. S’ils occupent chez nous quelque forteresse, ils pourront s’en servir pour courir dans nos campagnes, ravager quelques parties de nos terres, donner asile à nos esclaves ou à nos mercenaires fugitifs ; mais quelle muraille élèveront-ils qui soit capable de nous investir, et qui nous empêche d’aller par mer ravager leur pays ? D’ailleurs leur ligue manque d’ensemble ; comme ils n’ont point de conseil unique, ils ne peuvent rien faire avec célérité. Ce sont différentes républiques qui, toutes également, ont droit de discuter et de voter ; et comme elles ne forment pas un seul peuple, chacun pense à ses intérêts, et, pour l’ordinaire, rien ne se termine. Quels avantages, au contraire, n’offre point la situation d’Athènes ! C’est une grande chose que l’empire de la mer. Si nous étions insulaires, qui serait plus que nous à l’abri des attaques ? Rapprochons-nous donc le plus possible de cet état : abandonnons nos terres et nos maisons de campagne, et gardons-nous d’engager follement le combat contre les Péloponnésiens, dont les troupes sont si supérieures en nombre. Vainqueurs, nous aurions à les combattre aussi nombreux qu’auparavant ; vaincus, nous perdrions le secours de nos alliés, qui font notre force. Car ils ne se tiendront pas en repos, si nous ne sommes pas en état de les y maintenir. Ne déplorez pas le ravage des campagnes et la destruction des édifices; pensez en hommes : ce ne sont pas ces choses-là qui possèdent les hommes, mais les hommes qui les possèdent ; et, si j’espérais être cru, je vous dirais d’aller vous-mêmes dévaster vos champs, et montrer aux Lacédémoniens que, pour de tels objets, vous ne consentirez pas à leur obéir… Nos pères, s’écria-t-il en finissant, étaient loin d’avoir notre puissance quand ils s’élancèrent pour arrêter les Mèdes; mais, abandonnant ce qu’ils possédaient, avec une sagesse supérieure à leur fortune, avec plus d’audace que de force, ils ont repoussé les barbares, et ont élevé jusqu’à ce haut point de gloire les destinées de l’État. Ne dégénérons point de leur vertu ; tâchons de ne pas laisser à nos neveux un empire moins puissant que nous ne l’avons reçu. Périclès avait raison de parler ainsi. Plus tard on a dit :
Qui tient la mer, tient la terre. Cette
pensée était vraie surtout pour Athènes rependit aux Lacédémoniens qu’elle ne ferait rien par obéissance, et qu’elle entendait traiter sur le pied de l’égalité. C’était assez faire connaître qu’elle était résolue à n’accepter que la décision des armes. Sur ces entrefaites, arriva l’affaire de Platée, qui, après celles de Corcyre et de Potidée, acheva d’engager la guerre, et, par son atrocité, contribua à lui donner un caractère inaccoutumé de violence. II. Surprise de Platée par les Thébains (431) ; funérailles des guerriers morts ; perte d’Athènes ; Mort de Périclès (429)Au printemps de l’année 431, par une nuit obscure, trois cents Thébains, commandés par deux béotarques, entraient à l’improviste dans Platée. Les habitants dormaient en pleine sécurité : ils furent réveillés par la voix d’un héraut, les appelant a se réunir à la ligue béotienne. D’abord pleins de stupeur, ils entrèrent en pourparlers avec les Thébains rassemblés sur la place du marché, mais, découvrant leur petit nombre, ils reprirent courage, se concertèrent secrètement, en ouvrant des passages à travers les murs intérieurs de leurs maisons, et peu à peu enveloppèrent l’ennemi de barricades. Accablés de traits lancés par des mains invisibles, les Thébains essayèrent vainement de fuir. Presque tous furent massacrés ou pris. Un corps de troupes, envoyé pour les soutenir, avait été arrêté par un débordement de l’Asopos. Cette nouvelle arriva rapidement à Athènes. Aussitôt les Athéniens arrêtèrent tous les Béotiens qui se trouvèrent en Attique, envoyèrent aux Platéens une garnison et des vivres, et donnèrent asile chez eux à leurs femmes, à leurs enfants et à leurs vieillards (fin de mars 431). Ils avaient aussi demandé qu’on ne décidât rien touchant les prisonniers, avant qu’il en eût été délibéré à Athènes. Mais quand ce message arriva, ceux-ci étaient morts. Les Platéens, indignés de cette violation impie du droit des gens et de cette attaque en pleine paix, les avaient tous égorgés ait nombre de cent quatre-vingts. Athènes, pour cette conduite généreuse, fut considérée comme avant commencé les hostilités. Elle n’avait fait pourtant que protéger une alliée fidèle et accomplir le serment prêté par tous les Grecs, le lendemain de la bataille de Platée, de défendre les Platéens contre toute agression, comme un peuple sacré. Sparte elle-même le reconnut plus tard. Ses hésitations à recommencer la guerre pendant l’expédition de Sicile provenaient, dit Thucydide, de la crainte où elle était que les dieux ne la punissent d’avoir rompu la seconde trêve, comme elle avait été punie par le désastre de Sphactérie, pour avoir rompu la première[11]. Dès le premier jour, Athènes, dont toutes les forces étaient prêtes, eût pu attaquer : elle préféra laisser à ses ennemis l’odieux de l’agression. Voici, dit Thucydide, les alliés qu’eurent les deux
partis. Ceux des Lacédémoniens étaient tous les peuples du Péloponnèse,
excepté, au début, les Achéens, et, pendant toute la guerre, les Argiens; en
dehors du Péloponnèse : les Mégariens, les Locriens, Thèbes, qui entraînait
avec elle toute Les alliés d’Athènes étaient : sur les frontières de l’Attique,
les habitants de Platée et d’Oropos, plus loin, les Messéniens de Naupacte,
la plus grande partie des Acarnanes[12], Argos des
Amphilochiens ; les îles de Chios, Lesbos, Corcyre. Zacynthe, toutes les
villes qui lui payaient tribut, et Mais les deux ligues différaient en un point capital : les alliés d’Athènes étaient soumis à un tribut annuel; Sparte n’en demandait pas aux siens. Aussi des défections se produiront parmi les premiers, et l’on n’en verra pas chez les Péloponnésiens. Quand Sparte appela enfin ses alliés aux armes, leur
promettant le pillage de l’Attique, les pauvres et avides paysans du
Péloponnèse accoururent de toutes parts à la curée, et Archidamos se trouva à
la tête d’une armée de 60 000 hommes. Avant de passer la frontière, le vieux chef
essaya encore de négocier. Les Athéniens firent une réponse romaine : Que Lacédémone rappelle son armée, et l’on verra ensuite à
traiter. En se retirant, l’envoyé d’Archidamos s’écria : Voilà un jour où commencent de grands malheurs pour Dès que Périclès connut l’approche de l’ennemi, il mit son plan à exécution. Tous les habitants de la campagne vinrent s’enfermer dans la ville avec leurs femmes, leurs enfants, leurs effets mobiliers : quelques-uns avaient emporté jusqu’aux charpentes de leurs maisons. Les troupeaux et Ies bêtes de somme furent envoyés dans l’Eubée. La plupart n’avaient dans la ville ni logements ni amis qui pussent les recevoir. Ils s’établirent sur les places, autour des temples et des monuments des héros, au Pélasgicon, qu’il avait été pourtant défendu avec imprécation d’occuper jamais, enfin entre les Longs Murs et au Pirée. Ce n’était pas sans douleur qu’ils abandonnaient ainsi leurs champs et leurs demeures, mais le salut de la patrie exigeait ce sacrifice : pour la sauver, leurs pères n’avaient-ils pas laissé à l’ennemi non seulement leurs campagnes, mais Athènes même et l’Acropole? Périclès donna l’exemple : Archidamos et lui étaient unis par les liens de l’hospitalité ; il déclara dans l’assemblée du peuple que si le roi de Sparte par égard pour ce souvenir, épargnait ses terres de ce jour il en ferait abandon à l’État. Archidamos assiégea le fort d’Œnoë et perdit beaucoup de
temps à cette opération, qui ne réussit pas; repoussé, il porta ses ravages
dans les champs de Thria et d’Éleusis, et s’avança jusqu’au bourg d’Acharnes
à il kilomètres d’Athènes, espérant que les Acharniens, qui fournissaient
jusqu’à 5000 hoplites à l’armée athénienne, ne pourraient voir d’un œil calme
le ravage de leurs propriétés et se laisseraient attirer au combat. Il y eut
en effet un moment où le désolant spectacle qu’on voyait du haut des
murailles faillit faire oublier la prudence. La jeunesse voulait combattre,
il se formait des groupes dans la ville: on y disputait la marche à suivre,
et le plus grand nombre se prononçait énergiquement pour qu’on sortit des
murs. Mais Périclès, malgré les cris et les sarcasmes, s’abstint de convoquer
l’assemblée et fit cesser les réunions tumultueuses. Laissez-les
couper vos arbres, disait-il aux campagnards, l’arbre
repoussera, les hommes ne repoussent pas[13]. Et ce peuple,
qu’on représente comme indocile, obéit à une prudence qu’il condamnait.
Quelques détachements de cavalerie furent seulement lancés au dehors, pour
harceler l’ennemi. Cette tactique réussit ; les Lacédémoniens, après
avoir saccagé plusieurs dîmes, se retirèrent par Oropos et Remarquons, dès le début de cette guerre, deux choses que nous retrouverons jusqu’à la fin des hostilités : d’une part, la répugnance des Athéniens à se mesurer sur terre avec les Spartiates, par conséquent la haute renommée militaire des soldats de Lacédémone ; de l’autre, l’impuissance des Péloponnésiens à forcer Ies remparts d’une ville. Pour l’art des sièges, les Grecs en étaient encore aux procédés de l’âge héroïque : on croyait qu’Agamemnon avait mis dix ans à prendre Troie ; Lysandre ne se fera ouvrir les portes d’Athènes que dans la trentième année de la guerre. Pendant que l’ennemi ravageait leurs terres, les Athéniens
avaient voté le décret suivant : Sur les sommes
déposées à l’Acropole, 9000 talents seront mis en réserve ; sera puni de
mort quiconque proposera d’y toucher, à moins que ce ne soit pour repousser
une invasion par mer ; et cent des meilleures trirèmes seront gardées au
Pirée, avec leurs commandants nommés d’avance, afin de parer à toute attaque maritime.
Puis, sans même attendre que les Péloponnésiens fussent sortis de l’Attique,
ils étaient entrés en campagne sur leur champ de bataille. Cent vaisseaux
partis du Pirée ravagèrent les côtes de Mégare, d’origine dorienne et maîtresse de trois routes
conduisant du Péloponnèse dans Dans le même temps une escadre de trente galères avait chassé les corsaires locriens du détroit de Chalcis et fait plusieurs descentes en Locride. Un fort, construit sur l’île d’Atalante, en face d’Oponte, surveilla cette côte et toute la mer Eubéenne. De l’autre côté de l’Attique, Égine fut définitivement occupée. Périclès poursuivait d’une haine implacable ces insulaires, qui avaient osé disputer la mer aux Athéniens, et rivaliser avec eux de gloire, de richesse et d’art. Il distribua leurs terres à des citoyens d’Athènes par la voie du sort, ce qui valut à Aristophane un petit domaine[15], et il en chassa tous les habitants, jusqu’aux femmes et aux enfants, que Lacédémone reçut dans Thyrée et les campagnes voisines[16]. Les approches de l’Attique par mer étaient ainsi bien gardées. A ces précautions, à celles que nous avons indiquées pour les réserves du Trésor et de la flotte, une diplomatie prudente en ajouta d’autres. Athènes se réconcilia avec Perdiccas de Macédoine, et fit alliance avec le roi de Thrace, Sitalcès. L’hiver de cette année vit une cérémonie imposante, l’éloge funèbre des guerriers morts en combattant pour la patrie. Les ossements renfermés dans des cercueils de cyprès furent exposés sous une grande tente, où chaque citoyen put venir pleurer un parent, un ami et faire les libations religieuses. Après trois jours donnés au deuil domestique, le deuil public commença. Les cercueils, placés sur des chars, dont le nombre était égal à celui des tribus, traversèrent lentement la ville jusqu’au Céramique, où l’on donnait les jeux funèbres. Après les chars venaient les femmes et les enfants des victimes. Derrière eux marchait la foule pressée des citoyens et des étrangers. Quand les morts, ensevelis dans un tombeau public, eurent été recouverts de terre, un orateur désigné par le peuple prononça l’éloge funèbre. C’était Périclès. Il avait déjà rendu un pareil hommage aux guerriers tombés devant Samos. Cette fois, il fit moins l’éloge des morts que celui d’Athènes, et il exhorta les vivants, avec tout ce que la parole peut avoir de grandeur et d’autorité, à aimer la patrie, à chérir ses institutions, qui, sans distinction de fortune ou de naissance, distribuaient les rangs selon le mérite ; et qui, bien différentes de la tyrannique constitution de Lacédémone, laissaient à chacun la plus entière liberté pour ses goûts et sa conduite, lie demandant à tous que le respect de la loi et des magistrats, ses interprètes. Puis il peignit, en les suppliant d’y rester fidèles, ce caractère national mêlé d’audace et de réflexion, de gravité et d’enjouement, ouvert et hospitalier pour les étrangers ; cette vie occupée d’œuvres sérieuses et de fêtes brillantes ; cette ville enfin devenue le modèle et l’institutrice de la Grèce[17]. C’est pour une patrie si glorieuse, ajouta-t-il, qu’indignés qu’elle leur pût être ravie, nos guerriers ont reçu généreusement la mort ; c’est pour elle que nous tous qui leur survivons nous sommes prêts à souffrir… Ils furent tels qu’ils devaient être. Que les autres, sans avoir moins de courage, fassent des voeux pour que leur vie soit plus heureusement préservée. Qu’ils ne se bornent pas à discourir sur ce qui est utile à l’État, qu’ils agissent. C’est en agissant pour la patrie qu’on accroît sa puissance et qu’on prouve son amour pour elle. Contemplez sa grandeur, mais en pensant que c’est par le courage, par l’ardeur à remplir les devoirs, par la honte de commettre une lâcheté que ces héros la lui ont donnée. Quand la fortune leur était contraire, ils ne se croyaient point en droit de priver l’État de leur vertu ; et le sacrifice d’eux-mêmes leur semblait un tribut qu’ils devaient à la patrie. Aussi ont-ils reçu des louanges immortelles et la plus honorable de toutes les sépultures, non pas celle où ils reposent, mais la mémoire des hommes. La tombe des héros est l’univers entier, et non sous des colonnes chargées de fastueuses inscriptions. Jusque dans les contrées étrangères, le souvenir de leurs exploits se gave dans les esprits, bien mieux que sur des monuments funèbres. Voilà ceux dont, vous devez être jaloux. Croyez que le bonheur est dans la liberté et la liberté dans le courage ; courez donc au-devant des périls de la guerre. Aux pères ici présents et qui ont l’espoir d’être consolés par d’antres fils, je dirai : que ceux-là sont heureux qui ont trouvé pour leur vie une fin brillante; aux vieillards qui ont fait une perte irréparable : que, dans l’infirmité du grand âge, le premier des biens est d’obtenir le respect accordé par la cité entière à ceux dont les enfants l’ont bien servie ; aux fils, aux frères de ceux qui ne sont plus : que je vois pour eux une grande lutte, une rivalité d’honneur à soutenir; aux épouses enfin tombées dans le veuvage et la douleur : que la plus grande gloire appartient à celle qui fait le moins de bruit parmi les hommes. J’ai rempli le voeu de la loi : j’ai dit ce que je croyais utile : nos illustres morts ont reçu l’hommage qui leur était dû. De ce jour leurs enfants seront élevés aux frais de la république jusqu’à ce qu’ils soient en âge de la servir[18]. C’est une couronne que la patrie décerne, et que l’on voudra mériter; car elle honore qui la reçoit et pour qui on la donne. Où les plus belles récompenses sont offertes à la vertu, là se trouvent les meilleurs citoyens. Payez un dernier tribut de larmes aux morts qui vous sont chers, et retirez-vous (431)[19]. Ainsi la grandeur de l’État devait être l’objet de la passion commune; et le courage, l’intelligence de chacun, la mutuelle estime du pauvre et du riche, le dévouement de tous, étaient les seuls moyens de rendre la patrie glorieuse et forte. Par ces nobles paroles, Périclès, ou Thucydide, qui les rapporte après les avoir sans doute lui-même entendues, répondait à ces amis forcenés de la paix, qui la voulaient à tout pris, même au prix de l’honneur et plus tard de la sécurité. Aristophane était de ce nombre; lirais son esprit et sa verve ne servent après tout qu’une morale ignoble. Qu’est-ce, dans les Acharniens, que son ami de la pais, son homme juste, Dicéopolis, ce citoyen qui fait seul son concordat avec les ennemis de la patrie, et qui nous est montré comme le plus heureux des hommes, parce qu’il établit sur la place publique un marché à son usage, fait le commerce avec les gens de Mégare et de Béotie, et se nourrit d’anguilles du lac Copaïs, tandis que Lamachos combat et revient couvert de blessures ? Après avoir ri des vives saillies du poète, demandez-vous si c’est là autre chose que le plus grossier égoïsme, satisfait aux dépens des nobles sentiments et de l’amour de la patrie. Malheureusement il y a de ces hommes justes dans tous les temps. Au printemps de l’année suivante, Archidamos reparut dans l’Attique. Cette fois il marcha droit sur Athènes, mais, n’osant l’aborder de front, tourna autour d’elle et porta ses ravages le long de la côte du sud-ouest jusqu’à Laurion ; de là il remonta vers Marathon, qu’il épargna, comme Décélie, à cause d’anciennes légendes. Au bout de quarante jours, il sortit de l’Attique. Il fuyait, non devant les Athéniens, mais devant un ennemi plus terrible. la peste, qui venait de se déclarer à Athènes, et que Thucydide et Lucrèce ont décrite avec une incomparable énergie (450). Ce mal avait parcouru l’Éthiopie, l’Égypte et Au milieu de tant de calamités, Périclès conservait la fermeté de son âme. Il conduisit par mer une expédition contre Épidaure, qui manqua tomber entre ses mains, ravagea les territoires de Trézène, d’Halia, d’Hermione et en Laconie enleva Prasies dont il lit une place pour Athènes : mais la peste, qui se mit dans son armée, le força de revenir. Elle venait de gagner aussi le camp athénien devant Potidée, qui résistait toujours sur 4000 hoplites, 1050 avaient péri en quarante jours. Le peuple, aigri par ses maux, en accusa Périclès, et le condamna à une amende de 15 ou même de 50 talents ; comme il ne put la payer, il se trouva, suivant la loi, privé de ses droits de citoyen. Au nombre de ses plus violents adversaires avait été Cléon. Périclès porta le malheur, comme la fortune, sans faiblir, malgré les coups qui chaque jour le frappaient, à l’agora ou dans sa maison. Sa sœur, quelques-uns de ses plus chers amis succombèrent. Il avait un fils nommé Xanthippos, qui se mêlait à ses ennemis et répandait contre lui les bruits les plus injurieux. Il l’aimait pourtant : la peste le lui enleva. Elle lui prit aussi son second fils, Paralos. Sa race allait s’éteindre, et les autels héréditaires rester sans sacrifices ; pour la première fois la douleur le brisa. Au moment où il plaçait la couronne funèbre sur le front de son dernier-né, il poussa un cri et fondit en larmes. Il n’avait plus d’enfant légitime ; le peuple, bientôt revenu de son ingratitude, lui accorda tous les droits des citoyens pour un fils qui lui était né d’Aspasie, et le replaça lui-même à la tête de l’État, en lui donnant, comme auparavant, une des dix places des généraux annuellement élus. Une députation envoyée à Lacédémone, pendant sa disgrâce, pour demander la paix, avait été renvoyée sans réponse, et la guerre reprit avec une nouvelle vigueur. Les Potidéates, chaque jour plus vivement pressés, en vinrent à se nourrir des cadavres de leurs morts, après quoi il fallut capituler. Les généraux leur accordèrent la permission de sortir, hommes, femmes et enfants, avec un manteau et quelque peu d’argent. Le peuple, qui avait dépensé 2000 talents à ce siège, leur fit un crime de cette douceur et faillit les mettre en jugement. Potidée fut repeuplée par mille familles athéniennes (429). Avant la chute de cette ville, des ambassadeurs envoyés par les Spartiates au grand roi pour solliciter son appui, et parmi lesquels se trouvait l’instigateur de la révolte des Potidéates, avaient été arrêtés en Thrace. livrés aux Athéniens et jetés au barathron. Cet appel aux barbares était un crime contre l’Hellade ; mais le droit public protégeait ces envoyés et Athènes renouvelait la faute de Mégare. En 429, Archidamos n’entra pas dans l’Attique désolée par
la peste, mais il vint mettre le siège devant Platée, afin d’enlever aux
Athéniens ce point d’appui hors de leur pays. Les Platéens invoquaient les
serments des Grecs après la défaite de Mardonius. Oui,
répondit Archidamos, nous avons juré de vous
défendre, mais tant que vous ne vous uniriez pas aux oppresseurs de Durant ces opérations, les Spartiates entreprirent de chasser les Athéniens de la mer d’Ionie. Une expédition dirigée contre Zacynthe et Céphallénie, en 430, n’avait pas réussi. L’année suivante un grand effort fut fait contre l’Acarnanie. Corinthe, Leucade, Anactorion et Ambracie fournirent des vaisseaux ou des soldats ; on appela à la curée les barbares du voisinage, Chaoniens, Molosses, Orestins. Perdiccas, allié d’Athènes, donna sous main mille Macédoniens, et ces forces, réunies à mille Spartiates, marchèrent sur Stratos, la capitale des Acarnanes. Cette armée si diverse et mal conduite arrivait en désordre ; une sortie heureuse la dispersa. Une victoire navale de Phormion acheva de ruiner l’entreprise. Ce général n’avait que vingt galères à opposer aux quarante-sept qui venaient du Péloponnèse ; aussi se tenait-il sous Naupacte en affectant une prudente réserve. Mais, au moment où la flotte ennemie traversa le détroit, il courut à elle. Les Péloponnésiens surpris se formèrent en cercle. Phormion ordonna à ses capitaines de courir autour de ce cercle et de le resserrer toujours davantage, en rasant les vaisseau, ennemis, sans en venir aux mains, avant que lui-même eût donné le signal. Il attendait un vent qui a coutume de s’élever en cet endroit au point du jour, et qui ne devait pas permettre aux Péloponnésiens de garder leur ordre. Dès qu’il souffla, les vaisseaux ennemis, serrés les uns contre les autres, se heurtèrent et s’embarrassèrent mutuellement ; l’inexpérience des matelots augmentait la confusion. La bataille était déjà gagnée pour Phormion quand il fit commencer l’attaque. Plusieurs galères furent coulées et l’on en prit douze (429)[21]. Les Lacédémoniens, étonnés d’un pareil échec, l’attribuèrent à l’impéritie de leur amiral. Ils envoyèrent trois Spartiates, au nombre desquels Brasidas, pour lui servir de conseil, et portèrent leur flotte à soixante-dix-sept vaisseaux. Phormion avait demandé des secours à Athènes : on lui expédia une escadre qui, s’étant détournée pour une expédition en Crète, arriva trop tard, de sorte qu’il fut obligé de tenir tête à la flotte ennemie avec les seules galères qui avaient défit combattu. Les Péloponnésiens parvinrent à en couper neuf, qu’ils forcèrent à s’échouer à la cite et que les Messéniens de Naupacte, accourus sur le rivage, sauvèrent en entrant tout armés dans la nier pour repousser les assaillants. Durant ce combat d’un genre nouveau, les onze autres galères athéniennes qui avaient attiré à leur poursuite vingt vaisseaux ennemis, firent volte-face soudainement et les obligèrent à fuir en abandonnant six de leurs bâtiments. Un des amiraux spartiates se tua pour n’être pas pris ; son corps fut porté par les flots aux Athéniens. Ainsi, malgré l’extrême inégalité des forces, la victoire restait, non pas aux plus nombreux, mais aux plus habiles, et Athènes ne perdait pas un seul de ses alliés de l’Ouest. Ces brillants succès ne sauvèrent pas Phormion du sort que
les démagogues commençaient à infliger aux meilleurs généraux. Il fut, nous
ne savons sur quel prétexte, condamné à une amende de 100 mines. Trop pauvre
pour la payer, il se retira dans Pour réparer les échecs répétés que Sparte venait de subir, Brasidas conçut un projet hardi. Il fit passer par terre l’isthme de Corinthe aux matelots de la flotte, chacun d’eux portant sa rame, avec ordre de mettre en mer quarante vaisseaux qui se trouvaient dans les chantiers de Nisée, et de voguer sur le Pirée sans défense. Au lieu d’y courir rapidement, ils s’arrêtèrent devant un fort de Salamine, qui, par ses signaux de feu, jeta l’alarme dans Athènes, dont toute la population descendit en armes au Pirée. On profita de cet avertissement et des chaînes furent tendues désormais à l’entrée des ports. Périclès ne put voir ces derniers succès. La peste, qui diminuait chaque jour et qui ne frappait plus que de rares victimes, l’atteignit à son tour[23]. Le mal ne l’abattit pas d’un coup, mais le mina peu à peu. Comme il allait expirer, ses amis et les principaux citoyens assis autour de son lit rappelaient ses vertus, ses talents, et les neuf trophées qu’il avait élevés pour autant de victoires. Ils parlaient ainsi, pensant que déjà Périclès ne les entendait plus ; mais le mourant, se redressant par un dernier effort, leur dit : Vous me louez de ce que tant d’autres ont fait comme moi, et sous oubliez ce qu’il y a de meilleur dans ma vie : jamais je n’ai fait prendre le deuil à un citoyen. Cette modération durant un si long pouvoir est son plus bel éloge ; et, comme ce fut sa dernière pensée, ce devrait être le dernier mot prononcé sur lui. Écoutons cependant Thucydide, un de ses adversaires politiques : Puissant par la dignité de son caractère, par sa sagesse et son incorruptible probité, il conduisait le peuple d’une main libre sans jamais se laisser conduire par lui. N’ayant pas acquis le pouvoir par d’indignes moyens, il ne sacrifiait rien pour être agréable au peuple, et au besoin il bravait son déplaisir. Voyait-il les Athéniens remplis d’une dangereuse confiance, il abattait leur fougue ; étaient-ils effrayés, inquiets, désespérés, il les relevait. Ce gouvernement était de nom une démocratie, de fait un empire, mais celui du premier citoyen de la république. (429) Son tombeau fut placé au Céramique, parmi ceux des hoplites qui avaient péri dans les combats[24]. N’était-il pas, en effet, tombé au milieu de la lutte et sur un champ de bataille ? Quelques mois plus tard, Athènes pleurait encore son grand citoyen, quand, au théâtre de Bacchus, Euripide faisait dire par Thésée : Ô terre illustre de Pallas, de quel homme tu es privée ! La peste, qui s’arrêta après qu’elle eut frappé Périclès,
avait enlevé beaucoup d’hoplites et de cavaliers[25], la meilleure
portion du peuple, celle qui faisait la force d’Athènes à l’armée et la
sagesse de ses résolutions à l’agora. Elle avait ébranlé bien d’autres choses
: la foi religieuse, autrefois la source du patriotisme, les mœurs sévères et
la discipline sociale dont ne se souciaient ni la foule oisive et mécontente
des paysans réfugiés dans la ville ni les matelots du Pirée, accoutumés, par
la permanence d’une guerre d’invasions aux violences, aux coups d’audace de
la vie militaire. Le désordre moral produit par le fléau se continua lorsque
le mal eut disparu. Aux hommes qui avaient connu Sophocle, Phidias, Périclès
et la paisible grandeur donnée par eux à la cité de Minerve, succédait une
jeunesse à la fois incrédule et superstitieuse qui désertera les autels d’Athéna,
de Déme4er et de Poséidon pour courir à ceux de divinités étrangères[26]. Périclès avait
été le grand modérateur de la république, le représentant, dans la politique,
de ce μηδέν
άγαν qu’Apollon conseillait aux sages. Lui
disparu, des oscillations, qui deviendront de plus en plus violentes,
ébranleront l’État, et la démocratie, que son glorieux chef savait si bien
contenir, glissera peu à peu dans une démagogie tracassière, ombrageuse et
féroce, qui envahira tout : délibérant pour le sénat, exécutant pour les
magistrats, et qui, oublieuse des aïeul, renversera l’autel qu’ils avaient
élevé à |
[1] Dés l’année 429,
Sparte envoya des ambassadeurs en Perse, et avant même que la guerre commençât,
Archidamos énumérait parmi les ressources de Lacédémone le secours qu’elle
pourrait tirer des Perses (Thucydide, I, 82). Le lendemain de sa défaite,
[2] I, 23. La division de l’ouvrage de Thucydide en livres a été faite, non par lui, mais par les grammairiens anciens.
[3] Je ne veux même pas indiquer cette opinion, que Périclès, suivant l’avis d’Alcibiade, aurait jeté Athènes dans cette guerre pour n’avoir pas à rendre ses comptes. Toute son administration et le jugement qu’en porte Thucydide protestent contre ces anecdotes, qui dispensent d’étudier et de réfléchir. Il faut laisser ces misères à Aristophane.
[4] Thucydide, I, 25.
[5] Les Corinthiens comparaient la situation de Corcyre, vis-à-vis d’eux, à celle des alliés vis-à-vis des Athéniens. La comparaison n’était pas juste. Corcyre avait depuis longtemps rompu avec sa métropole. Il y avait même eu guerre entre elles. Corinthe n’avait donc pas le droit d’invoquer, comme elle le fit, le principe de non-intervention dans les querelles d’un État confédéré, parce que les Corcyréens n’étaient pas pour elle προσήxοντες ξόμμαχοι (Thucydide, I, 11, 5).
[6] Thucydide, I, 70. Voyez le portrait du peuple athénien, fait par l’orateur de Corinthe ou plutôt par Thucydide, et qui se termine par ce trait : Si l’on disait qu’ils sont nés pour ne souffrir la tranquillité ni chez eux ni chez les autres, on donnerait une juste idée de leur caractère.
[7] Lettre de Philippe aux Athéniens, dans la collection démosthénique de Didot, p. 844.
[8] On a vu que les Éginètes avaient condamné à mort tout Athénien surpris dans leur île. Chez ces peuples, la haine entre voisins était sans merci.
[9] Thucydide, I, 86.
[10] Thucydide, I, 118.
[11] Thucydide, qu’Athènes a banni, ne l’accuse nulle part d’avoir violé la trêve de trente ans. Aristophane était dans son droit de faire rire les Athéniens, même à leurs dépens. Nous sommes dans le nôtre en préférant à la satire et à la caricature, tant de fois copiées, la vérité qui ressort de l’examen scrupuleux des faits.
[12] Les Acarnanes restèrent longtemps les fidèles alliés d’Athènes. Cf. Diodore XV, 36. Dans un fragment de décret récemment découvert, ils sont appelés πατρόθεν φίλοι τών Άθηνβίων (Beulé, l’Acropole, Append., n° 15, et Rangabé, Ant. Hell., t. II, n° 2279).
[13] Thucydide mettra un mot semblable dans la bouche de Nicias : Ce sont les hommes qui font la patrie et non pas des murailles ni des vaisseaux vides.
[14] Le mont Géraneion, qui couvrait une partie de l’isthme d’une mer à l’autre, était traversé par trois routes, toutes trois difficiles : celle de l’ouest, la plus longue et que cependant les armées suivaient ; celle de l’est, la plus courte et la plus fréquentée, où se trouvaient les roches scironiennes qui avaient bien mauvais renom ; enfin celle du centre par les crêtes, où l’on se hasardait rarement.
[15] Acharniens, 652.
[16] Thyrée fut prise
plus tard par les Athéniens, et ceux de ce malheureux peuple qui s’y trouvaient
furent exterminés (Thucydide, IV, 57). Lysandre, après Ægos-Potamos, rappela de
tous les coins de
[17] Thucydide, II, 12. Il faudrait citer tout entier cet admirable discours.
[18] Ce jour arrivé, le
peuple se réunissait au théâtre et le héraut lui présentait les enfants des
morts, revêtus d’une armure complète, en disant : Jusqu’à ce moment, le peuple les a nourris ;
maintenant il leur donne ces armes. Eschine, Discours sur
[19] Platon, dans son Ménéxène, a refait le discours de Périclès ; mais l’avantage reste à celui que Thucydide a rapporté.
[20] C’était une fièvre éruptive, différente de la variole, qui désola encore une fois le monde romain, sous Marc Aurèle, et qui est éteinte aujourd’hui (Littré, Œuvres d’Hippocrate, t. I. p. 122). D’autres médecins pensent que ce fut le typhus des armées on typhus exanthématique. La légende sur la présence d’Hippocrate à Athènes, en ce temps-là, est fausse. Cf. Littré, ibid., p. 39.
[21] L’Ion d’Euripide, qui est une glorification d’Athènes, a été peut-être représenté peu de temps après cette victoire, qui eut beaucoup de retentissement en Grèce.
[22] Les Acarnanes demandèrent, à Athènes, son fils Asopios pour général (Thucydide, III, 7 ; Pausanias, I, 23, 29).
[23] Les détails de la maladie accusent plutôt une fièvre lente.
[24] Thucydide, II, 34 ; Pausanias, I, 29.
[25] Cette perte était d’autant plus sensible que les cavaliers et les hoplites appartenaient aux classes riches ou aisées. Les thètes, on gens de la dernière classe, ne furent enrôlés dans les hoplites que vers 412. Cf. Harpocration, s. v. θήτες.
[26] Sur l’introduction dans Athènes des dieux étrangers, voyez Foucart, Des associations religieuses chez les Grecs, p. 56 et suiv. et, plus loin, notre chapitre XXIV.
[27] Platon, Politique, VIII et II, p. 156 (Didot). Voyez aussi le sombre tableau tracé par Thucydide au livre III, chap. 82-83.