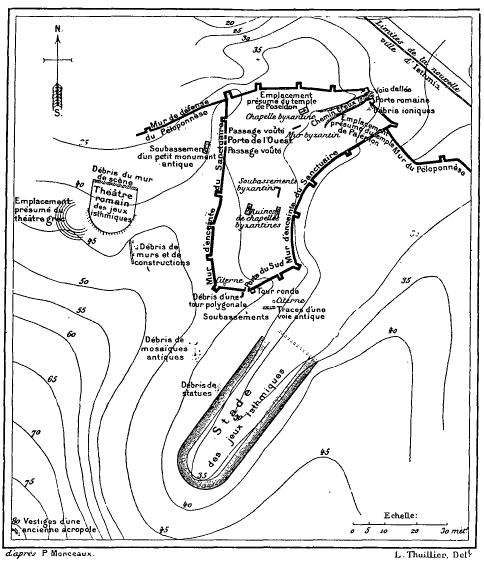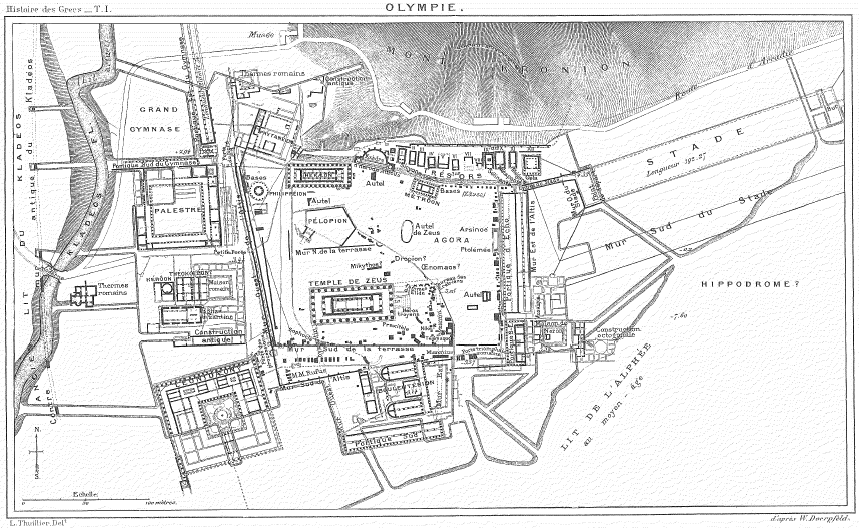HISTOIRE DES GRECS
DEUXIÈME PÉRIODE — DE L’INVASION DORIENNE AUX GUERRES MÉDIQUES (1104-490) — ISOLEMENT DES ÉTATS - RÉVOLUTIONS INTÉRIEURES - COLONIES.
Chapitre XV — Institutions générales.
I. Le corps hellénique et les AmphictyoniesNous venons de parcourir toute Les dieux sont aussi des divinités locales. Quand on
interrogeait Sans doute, entre le pâtre, adorateur grossier du Pan d’Arcadie, et l’élégant citoyen d’Athènes ou de Milet, les différences sont grandes ; mais plus grandes encore les ressemblances. Outre qu’ils ont même langue et mérite culte, il y a entre eux communauté morale. L’horizon de l’un est immense, celui de l’autre borné ; mais tous deux y voient des choses semblables, et ils repoussent, ce qu’on trouve chez les nations contemporaines : les sacrifices humains, les mutilations, la polygamie, la vente des enfants par le père, compte en Thrace et à Rome même, et la servile obéissance d’un Asiatique pour son Grand Roi. Tous deux vont combattre nus aux jeux publics, ce qui serait une honte, disent Hérodote et Platon, chez presque tous les barbares; et, dans un autre ordre de faits, tous deux, avec le sentiment d’une commune origine, se refusent à l’idée que leur ville ira se perdre dans un de ces vastes États, comme l’Asie en voit si facilement s’élever. Enfin les poèmes d’Homère, que l’on chante d’un bout à l’autre de l’Hellade, leur servent de livre sacré et font la même patrie idéale, celle que protège le Jupiter panhellénique. Il y a donc un peuple grec distinct des barbares, mais il y a aussi, comme dit Hérodote[4], un corps hellénique, τό Ελληνιxόν ; et ce mot, qui signifie alors la race grecque, signifiera plus tard la civilisation[5]. Cette commune manière de vivre et de sentir devait en effet conduire les Grecs, en dépit d’eux-mêmes, à reconnaître quelques institutions générales, qui eurent moins, il est vrai, une puissance coercitive qu’une certaine force d’attraction et de cohésion ; je veux parler des amphictyonies, des jeux publics et des oracles. Les amphictyonies étaient des associations à la fois
politiques et religieuses, que formaient, comme le nom l’indique, un certain
nombre d’États limitrophes, dans le but de régler à l’amiable leurs mutuelles
relations[6]. Jamais, si ce n’est
à leur dernier jour, les Grecs ne s’élevèrent à la pensée de se donner une
constitution fédérale qui doublât leurs forces en rassemblant comme en un
faisceau celles de toutes les cités. Mais l’idée d’une union fraternelle
régna toujours parmi eux, malgré les guerres qui ne cessèrent de les
déchirer. C’est à cet esprit qu’est dû l’établissement des amphictyonies.
Dans les anciens temps, ces ligues furent nombreuses. Il y en avait une pour Un temple était toujours le centre de ces confédérations, et une fête religieuse l’époque de la réunion des députés ou des peuples, car le culte commun d’une divinité et la participation aux mêmes sacrifices furent le seul lien que les anciens Grecs voulurent accepter. Jamais ces ligues n’eurent la plus importante des attributions souveraines, le droit d’administration. La plus célèbre de ces amphictyonies fut celle qui avait
lieu le printemps à Delphes, l’automne aux Thermopyles, dans la plaine d’Anthéla,
avant et après les travaux des champs[9]. La tradition
attribuait à Amphictyon, fils de Deucalion, l’établissement de ce conseil,
dont Strabon rapportait la fondation à Acrisios, roi d’Argos. Quelle que soit
son origine, cette institution est certainement ancienne, comme le prouvent
les noms des peuples qui en faisaient partie. Ils sont au nombre de douze :
Thessaliens, Béotiens, Doriens, Ioniens. Perrhæbes et Dolopes, Magnètes,
Locriens, Ænianes, Achéens-Phthiotes, Maliens, Œtéens, Phocidiens[10]. Sur douze, sept
de ces peuples habitent au delà du mont Œta, preuve que l’époque où se forma
la ligue fut celle de la puissance de Chacun de ces peuples avait deux voix; en tout
vingt-quatre suffrages’. Ce nombre resta le même jusqu’à Auguste; seulement,
le droit de voter fut quelquefois transmis d’un peuple à un autre, ou divisé
entre deux parties d’un même peuple. Ainsi, Sparte n’eut qu’une des deux voix
doriennes; Athènes, une des deux voix ioniennes; les deux autres
appartenaient aux montagnards de Les premiers semblent avoir été revêtus, comme leur nom l’indique, d’une sorte de caractère religieux; on croit qu’il leur appartenait de convoquer et de présider le conseil, de sauvegarder la fortune mobilière et immobilière d’Apollon[12], de réprimer les usurpations faites aux dépens des domaines du dieu, d’infliger des amendes à ceux qui les commettaient et de veiller à l’entretien des ponts et des routes qui menaient au sanctuaire[13]. Les pylagores ou orateurs étaient chargés de défendre, dans l’assemblée, les intérêts de leur peuple et d’éclairer de leurs conseils les hiéromnémons ; ceux-ci avaient voix délibérative et paraissent avoir été en nombre égal au chiffre des suffrages ; les pylagores n’avaient que voix consultative, aussi leur nombre était indéterminé : les uns et les autres prenaient le nom de synèdres, ceux qui siègent ensemble. A Athènes, les premiers étaient désignés par le sort, les seconds étaient élus. En entendant parler d’un conseil de Par ces faits, nous rentrons dans le véritable caractère des amphictyons. Décerner des récompenses nationales, ériger des statues, des tombeaux à ceux qui avaient bien servi la patrie commune, ou jeter la malédiction sur la tête coupable, voilà des actes véritablement amphictyoniques, soit par le genre même des châtiments et des récompenses, qui portaient l’empreinte de la religion, soit parce que cette haute dispensation des peines et des honneurs était le véritable apanage du tribunal suprême de la race hellénique, image du conseil des douze grands dieux. A ce même titre de tribunal religieux, le conseil des
amphictyons exerçait, dans l’intérieur de Ces règlements étaient mis sous la sanction de véritables anathèmes : Si quelques particuliers, ou ville, ou nation, commettent un attentat, qu’ils soient dévoués à Apollon, à Diane, à Latone, à Minerve-Pronæa. Puisse la terre ne porter pour eux aucun fruit; que de leurs femmes naissent des monstres affreux; que leurs troupeaux n’engendrent point suivant l’ordre de la nature; qu’ils soient malheureux à la guerre et dans toutes leurs affaires; qu’ils périssent misérablement, eux, leurs maisons et toute leur race ; enfin que leurs sacrifices à Apollon Pythien, à Diane, à Latone, à Minerve-Pronæa, offerts d’une manière illégale, soient toujours rejetés par ces divinités. Ces imprécations prononcées, l’amphictyon jurait d’employer sa voix, ses pieds, ses mains, à dénoncer, à poursuivre, à frapper le coupable. Malheur donc à qui violait les règlements amphictyoniques ! Pour le punir, le tribunal suspendait ses propres lois de clémence. Dans la première guerre Sacrée, au siège de Cirrha, les amphictyons, d’après le conseil de Solon, détournèrent la source dont la ville buvait les eaux, puis la lui renvoyèrent empoisonnée d’ellébore. Quand Cirrha fut prise, au bout de dix années (595), ils la rasèrent jusqu’au sol et, défendirent avec imprécations d’en cultiver jamais le territoire. Tout Grec était tenu de répondre au premier appel des amphictyons et de prêter ses mains à l’exécution de leurs décrets. Clisthénès de Sicyone, qui les seconda énergiquement devant Cirrha, reçut d’eux en retour un appui efficace dans ses projets contre la liberté de sa patrie. Quel était donc le crime de Cirrha ? Elle avait offensé Apollon Delphien par les exactions exercées sur les pèlerins qui venaient sacrifier à ses autels. La protection du temple, de son territoire et de ceux qui y apportaient des offrandes, appartenait en effet aux amphictyons. Quelques théores[15] du Péloponnèse traversant le pays de Mégare, pour se rendre à Delphes, avaient été renversés de leur chariot par des gens de la contrée et jetés dans un marais, où plusieurs avaient péri. Le tribunal amphictyonique exigea aussitôt la mort des plus coupables et le bannissement des autres. Quand le temple de Delphes fut consumé par les flammes, en 548, les amphictyons firent marché avec les Alcméonides pour sa reconstruction. C’étaient eux qui administraient les trésors du dieu et qui les prêtaient à intérêts aux villes ou aux particuliers[16]. Ils avaient nécessairement de l’influence sur l’oracle : souvent les débats concernant les autres temples leur furent soumis. Ainsi ils décidèrent entre Athènes et Délos, au sujet de la préséance dans le sanctuaire d’Apollon ; et les Samiens, pour conserver sous les Romains le droit d’asile dans le temple de Junon, s’appuyèrent d’un décret des amphictyons. Après la victoire de Platée, ils contraignirent Lacédémone à effacer l’orgueilleuse et mensongère inscription qu’elle avait gravée sur une offrande. Pourquoi, malgré ces prérogatives, l’influence de ce conseil fut-elle si bornée ? C’est que toute autorité centrale s’exerçant sur autre chose que les affaires religieuses effrayait les cités helléniques; c’est aussi que, en conséquence de l’antique répartition des voix, Sparte et Athènes, se trouvant. dans cette assemblée les égales de petites peuplades des environs du Pinde, n’avaient nulle affection pour une institution qui les mettait à un tel niveau. Il y eut un moment ou cette organisation faillit être réformée, quand Lacédémone, après Platée, proposa d’exclure de l’union les peuples qui n’avaient pas combattu contre les Perses. Thémistocle fit prudemment rejeter cette mesure qui eût fait du conseil amphictyonique, placé dans les mains de Sparte et relevé, agrandi par elle, un moyen puissant de domination. Pendant les guerres Médiques et dans les quatre-vingts
années que dure la prépondérance d’Athènes et de Lacédémone, l’assemblée de
Delphes reste inactive et obscure. Après Leuctres, quand le premier rôle
passe à une ville du nord de II. Les oracles et les fêtesD’autres institutions, qui tendaient moins manifestement à maintenir l’unité de la race hellénique, y contribuèrent certainement davantage : je veux parler des oracles, des fêtes et des jeux publics. Ce n’est pas aux Grecs qu’il fallait présenter ces liens fédératifs, tolérables seulement aux peuples dociles et disciplinés. Mais que grandisse la réputation d’un oracle, qu’un temple magnifique s’élève, que la pompe des cérémonies religieuses se déploie, que les jeux et les fêtes, que des concours et des luttes soient annoncés, et ces hommes crédules, curieux, amis des arts, des spectacles et de la gloire, pris à l’amorce de leurs goûts et de leurs plaisirs, quitteront ces petites cités qu’ils aiment tant pour accourir et s’asseoir à côté de ceux qu’ils combattaient hier, qu’ils combattront demain, et qui ne leur paraissent pour l’heure que des membres de la commune famille. Aux temps anciens, quand les phénomènes de la nature frappaient vivement l’imagination des hommes, l’art de lire dans les entrailles des victimes et d’interpréter les songes, le vol des oiseaux, les éclats de la foudre faisait partie de la religion et de la politique : Tirésias et Calchas étaient alors en grand crédit auprès des rois. Avec les progrès de la sagesse laïque, on s’occupa plus des affaires de la terre que de celles du ciel. C’est une loi de l’histoire que le surnaturel perde en proportion de ce que la raison gagne. Périclès et Épaminondas, Thucydide et Lysandre, Euripide et Aristophane, qui sentaient la puissance de leur esprit, croyaient à leur raison bien plus qu’aux paroles obscures d’un devin ou d’un prêtre ; mais, pour la multitude, la foi à la divination était encore si grande, que Plutarque la met au nombre des opinions qui tiennent du consentement universel un caractère d’absolue vérité ; et Platon disait (Timée, 47) : Dieu a donné la divination à l’homme pour suppléer à son défaut d’intelligence. Aussi n’était-ce pas à l’esprit le plus cultivé qu’on reconnaissait le privilège de lever les voiles de l’avenir. La manifestation de la volonté divine semblait d’autant plus éclatante que l’instrument était plus imparfait. L’aveugle, l’insensé, devenaient pour la foule des prophètes infaillibles avec lesquels devaient compter la sagesse de l’homme d’État et l’expérience du général. Les fontaines dont l’eau troublait l’économie du corps ou celle de l’esprit, les grottes d’où s’échappaient des gaz qui produisaient le délire et les hallucinations, furent regardées comme des lieux où la divinité était toujours présente. La source de Castalie, tombant limpide et pure des roches Phédriades était l’eau sainte où tous ceux qui venaient consulter l’oracle devaient se purifier[17]. Si l’on excepte les chênes prophétiques de Dodone en Épire, dont les prêtresses interrogeaient les bruits au milieu des vents et de la tempête[18], il n’y avait pas en Grèce d’oracles plus fameux que ceux de l’antre de Trophonios en Béotie, et du temple de Delphes en Phocide ; tous deux provenaient d’une même cause, l’exhalaison gazeuse reçue ici par une prêtresse, là par le consultant. Plutarque et surtout Pausanias[19] nous ont laissé le récit des scènes étranges dont le sanctuaire de Trophonios était le théâtre. La bouche de l’antre, souvenir de celui où Apollon avait tué le serpent Python, se trouvait dans une grotte haute de moins de trois mètres et qui n’en avait pas deux de large. Après de longues préparations et un examen rigoureux, on y descendait la nuit, à l’aide d’une échelle. A une certaine profondeur, il n’y avait plus qu’une ouverture extrêmement étroite par où l’on passait les pieds; alors on était entraîné avec une rapidité extrême jusqu’au rond du gouffre, au bord d’un abîme. Pris de vertige par la rapidité du mouvement, la peur et l’influence des gaz, on entendait des sons effrayants, des mugissements confus et des voix qui, du milieu de ces bruits, répondaient aux questions; ou bien l’on voyait des apparitions étranges, des lueurs traversant les ténèbres, des images qui, elles aussi, étaient une réponse. C’était l’imagination troublée par ces prestiges, qu’on remontait, relancé la tête en bas, avec la même force et la même vitesse qu’en descendant. Il fallait tenir dans chaque main des gâteaux de miel qui avaient la vertu, disaient les prêtres, de garantir de la morsure des serpents dont l’antre était rempli ; en réalité, pour empêcher le consultant de reconnaître avec ses mains les ressorts de toutes ces machines. Un des gardes du roi Démétrius, envoyé pour pénétrer ce mystère, entra dans la caverne, mais n’en sortit pas. On retrouva, quelques jours après, son corps rejeté par une issue secrète. Les prêtres l’avaient deviné et immolé. L’impression produite par ces apparitions, ou par l’effet de narcotiques puissants, était parfois telle, que la terreur éprouvée ne s’effanait pas complètement. Aussi, disait-on, des gens atteints d’une mélancolie incurable : Il a consulté l’oracle de Trophonios. Apollon était moins terrible. Pour ce dieu de la lumière,
interprète des volontés de Zeus, le souverain maître des hommes et des
immortels, tout se passait au grand jour : la prêtresse seule souffrait de la
présence du dieu. L’autorité de ses oracles s’étendait au delà des bornes du
monde hellénique, jusqu’en Lydie jusque chez les Etrusques et à Rome, où les
livres de Pour que l’action divine parût. plus manifeste, les réponses d’Apollon étaient rendues, dans l’origine, par une jeune fille simple et ignorante, presque toujours atteinte de quelqu’une de ces affections nerveuses qui semblent communes dans certaines parties de la Grèce[21], plus tard par une femme âgée au moins de cinquante ans; enfin, une seule Pythie ne suffisant plus à l’immense affluence des pèlerins, on en établit trois. Ces malheureuses étaient traînées languissantes, éperdues, vers une ouverture de la terre d’où s’échappaient certaines vapeurs[22]. Là, assises sur un trépied où des prêtres les retenaient de force, elles recevaient l’exhalaison prophétique. On voyait leur visage pâlir, leurs membres s’agiter de mouvements convulsifs. D’abord, elles ne laissaient échapper que des plaintes et de longs gémissements; bientôt, les yeux étincelants, la bouche écumante, les cheveux hérissés, elles faisaient entendre, au milieu des hurlements de la douleur, des paroles entrecoupées,
incohérentes, que l’on recueillait avec soin et où le prêtre chargé de mettre
cette réponse en vers s’ingéniait, dupe lui-même de sa foi dans l’oracle, à
trouver la révélation de l’avenir que le dieu y avait cachée. Grâce à l’immense
concours des pèlerins, les prêtres pouvaient se tenir au courant de toutes
les affaires des États, même des particuliers. Ce qu’ils avaient appris de
cette façon leur permettait de donner à des sons inarticulés une
signification que la crainte ou l’espérance acceptait, et que la foi
réalisait souvent ; car cette foi des Grecs n’était pas inerte comme le
fatalisme des Orientaux, et on est bien près du succès, alors qu’on croit
avoir les dieux pour complices. Ils furent aussi fréquemment les instruments
volontaires ou intéressés des chefs des États. Si Démosthène put accuser Les oracles furent encore, bien souvent, les gardiens de
la morale privée. Glaucos veut conserver un dépôt qui lui a été confié, Remarquons cependant que les oracles supposaient la
croyance à l’intervention directe des dieux dans les affaires humaines, par
conséquent à une action de Les Grecs aimaient les oracles. Peuple curieux et impatient, ils voulaient tout savoir, même l’avenir. L’énigme leur plaisait, elle exerçait la subtilité de leur esprit; mais ils aimaient aussi la pompe et l’éclat des fêtes, si brillantes sous leur beau ciel, et ils marquaient par des solennités religieuses les grandes phases de leur existence nationale, comme les phénomènes de la vie naturelle et morale qui leur semblaient un bienfait, un conseil ou une menace des dieux. Platon trouvait, pour ces solennités, à côté de la raison religieuse, un motif social : Les dieux, dit-il (Lois, II, 1), touchés de compassion pour le genre humain, que la nature condamne au travail, lui ont ménagé des intervalles de repos par la succession régulière des fêtes instituées en leur honneur. Les Grecs goûtaient si bien cette raison, qu’ils multiplièrent les intervalles au point d’égaler presque le repos au labeur. On a compté qu’à Athènes plus de quatre-vingts jours de l’année étaient remplis par des fêtes et des spectacles. Ces spectacles et ces jeux n’étaient pas l’inutile délassement d’une foule paresseuse comme la plèbe de Rome sous les Césars ; ils faisaient partie de la religion et du culte national[24] ; ils étaient la grande école du patriotisme et de l’art., même de la morale : Les Muses, dit Platon, et Apollon, leur chef, y président et les célèbrent avec nous. Le coupable en était banni ; mais le pauvre, même l’esclave, y assistaient. Aux grandes Dionysies d’Athènes, les fers des prisonniers tombaient pour qu’ils pussent, eux aussi, célébrer la fête joyeuse du dieu qui chasse les chagrins rongeurs et rend l’esprit libre comme la parole. Tant qu’elle durait, l’esclave n’avait pas de maître, ni le captif de gardiens. En Crète, le jour des Hermées, c’étaient les maîtres qui servaient à table leurs serviteurs. Chaque ville avait ses fêtes particulières et réservait pour ces solennités des places aux habitants d’une ville alliée, d’une colonie ou de la métropole. Dès que le service du dieu commençait, les affaires de la cité étaient suspendues : les tribunaux se fermaient ; on ajournait les payements, les exécutions des débiteurs ou des coupables, même à Sparte, les décisions qui importaient le plus à la sûreté de l’État. On ne voulait pas servir à la fois deux maîtres, le peuple et les dieux. Démosthène cite une loi d’Athènes qui punissait la violation du repos des jours fériés[25] et transformait en crimes contre l’État les délits commis envers ceux qui, ayant un rôle officiel dans ces l’êtes, y portaient la couronne signe de l’autorité publique[26]. Comme durant notre moyen âge, les corporations, les métiers, même l’âge et le sexe, avaient leurs patrons et leurs fêtes. Ainsi, à Athènes, les matelots, les forgerons, et sans doute bien d’autres ; à Sparte, les nourrices ; en divers lieux, les esclaves. Il y avait pour les jeunes gens, les jeunes filles, les femmes mariées, des dévotions particulières, et les familles avaient leurs saints, qu’on appelait les héros ou les démons, ce qui n’empêchait pas d’accomplir aux autels des dieux communs les rites ordinaires pour les naissances, les mariages et la mort. De même qu’au moyen âge encore, le clergé, pour amuser quelques instants le peuple des fidèles, ouvrait, à certains jours, les églises à des fêtes peu édifiantes. Délos avait des rites burlesques. Ses prières faites, le pèlerin devait tourner autour du grand autel d’Apollon, sous les coups de fouet des prêtres, et mordre à belles dents le tronc de l’olivier sacré, les mains derrière le dos. C’était, ajoute Callimaque[27], une nymphe de Délos qui avait imaginé ce jeu pour amuser l’enfance du jeune Apollon. Je ne parlerai que de trois de ces fêtes : l’une qui montre le côté honteux, orgiastique de l’ancien naturalisme ; l’autre, la magnificence des pompes religieuses; la troisième, les idées morales qui se mêlaient si rarement au culte païen. Ce sont les fêtes de Dionysos ou Bacchus[28], les grandes Panathénées et les Thesmophories. Autrefois, dit Plutarque[29], la fête de Dionysos avait une simplicité qui n’excluait pas la joie : en tête du cortège une cruche pleine de vin et, couronnée de pampres ; derrière, un bouc, puis un des assistants chargé d’un panier de figues ; enfin un autre portant le phallos, symbole de la fertilité. Dionysos présidait aux travaux champêtres, qui, dans un pays peu fertile en blé, étaient surtout les travaux des vignobles. Aussi était-il par excellence le dieu du raisin, et à chaque phase de la végétation de la vigne ou de la fabrication du vin répondait une Dionysie. L’approche des vendanges était annoncée par une procession et des jeux. Des jeunes gens, vêtus de la longue robe d’Ionie, portaient des ceps avec leurs grappes et des. branches d’olivier auxquelles étaient suspendus tous les fruits alors en maturité. Et ils chantaient : Branches divines, de vos rameaux découlent le miel, l’huile et le pur nectar qui remplit la coupe où l’on trouve le sommeil. La fête se terminait par des courses à pied : le vainqueur recevait pour récompense un vase rempli jusqu’aux bords. Autre fête quand le raisin était mis sous le pressoir. D’abord des libations de vin doux et le plus somptueux festin qu’on pût faire : on n’oubliait pas d’y honorer le dieu en usant largement de ses dons; ensuite une procession solennelle. On montait à demi aviné sur les chars qui avaient porté les vendanges, la tête cachée sous les pampres, le lierre ou le feuillage, le corps couvert de peaux de bêtes ou de vêtements bizarrement disposés, et l’on parcourait les bourgs en se lançant de gais propos, comme on faisait naguère encore durant nos jours de carnaval. Des femmes plus particulièrement dévotes au dieu de la fécondité et prenant son nom, les bacchantes ou ménades, formaient un groupe à part et tenaient à la main des thyrses ou des phallos. En de certains lieux, des tréteaux étaient dressés. Le cortège s’y arrêtait : un des assistants y montait pour réciter un dithyrambe qui célébrait les aventures du dieu du vin et de la joie. Des choeurs répondaient d’en bas, et les Pans, les sylvains, les satyres, dansaient à l’entour. Silène, sur son âne, lançait des brocards et buvait. Un bouc, l’animal lascif, était la récompense de celui qui avait composé les chants pour la fête, et il servait de victime sur l’autel du dieu[30]. De ces mascarades burlesques, de ces dialogues obscènes, de ces chants pieux et avinés, sortirent la comédie et la tragédie[31]. Thespis et Phrynichos confièrent le dithyrambe à un seul personnage et ajoutèrent à l’hymne saint des récits, Eschyle un dialogue et une action accomplie par plusieurs personnages : l’art dramatique était né ; Eschyle en est le père. Les Anthestéries, ou fête des fleurs qui durait trois jours, avaient lieu au printemps, après la fermentation, quand on ouvrait pour la première fois les vases qui renfermaient le vin nouveau. On en offrait aux dieux quelques gouttes en libations : aux voisins, aux journaliers, aux esclaves, on en versait à pleins bords[32]. A Athènes, on célébrait un festin public que présidait l’archonte roi, dont la femme avait un rôle important dans la cérémonie. Personnifiant la cité et épouse mystique de Dionysos, elle conduisait sur un char, au temple de Limnae, une vieille idole du dieu. D’autres femmes, costumées en Nymphes, Heures et Bacchantes, formaient le cortège nuptial qui entourait les deux époux jusqu’au sanctuaire où se célébrait l’union sainte , l’ίερός γάμος. de Bacchus et d’Athènes[33]. Ces fêtes étaient celles de la joie ; les Bacchanales
furent celles du regret et de la douleur. Elles avaient lieu la nuit, au
solstice d’hiver, quand la vigne desséchée et comme morte montrait le dieu
éloigné ou impuissant. Des femmes seules, les Ménades ou les Furieuses,
accomplissaient ces rites farouches sur les flancs du Parnasse et les cimes
du Taygète, ou dans les plaines de Ce culte orgiastique n’eut jamais, à Athènes, de
popularité. La solennité par excellence fut, dans cette ville, les grandes
Panathénées, qui duraient quatre jours, dans la troisième année de chaque olympiade,
du 25 au 28 du mois hécatombéon (juillet-août)[35]. C’était à la
fois la fête d’Athéna et de toutes les tribus de l’Attique, qui, au pied de
son autel, s’étaient unies en un seul peuple ; c’était aussi la fête de
la guerre et de l’agriculture, de toutes les qualités du corps et de tous les
doits de l’intelligence. En l’honneur de la déesse qui portait la lance, mais
qui avait aussi créé l’olivier et enseigné les arts, on célébrait une danse
armée, des courses de chars, des luttes gymniques, dont les récompenses
étaient, pour les vainqueurs, des vases peints remplis de l’huile fournie par
les oliviers sacrés ; des exercices équestres, où les cavaliers
portaient des flambeaux allumés à l’autel d’Éros, symbole de l’amour
éveillant l’intelligence rapide; ensuite la récitation de vers d’Homère ou de
quelque poète héroïque et des concours de musique ; enfin, ce qui
ajoutait une sainte et pure émotion à toutes celles qui naissaient de cette
belle solennité, le citoyen qui avait bien mérité de la patrie recevait une
couronne, aux yeux de la multitude accourue de La frise du Parthénon, le
temple de Dans un passage de sa tragédie d’Ion[36], Euripide décrit
la décoration intérieure du Parthénon, ce qu’on a appelé la chambre de Le jour de la fête de Minerve, les magistrats, gardiens des lois et des rites sacrés, ouvraient la marche; après eux venaient les vierges, chargées des vases nécessaires aux sacrifices, les jeunes filles portant les corbeilles sacrées, canéphores[39], puis les victimes aux cornes dorées, toujours nombreuses, car chaque colonie d’Athènes envoyait un boeuf, pour que ses concitoyens eussent le droit de s’associer à la fête et au festin sacré, suivaient des musiciens jouant de la flûte et de la lyre, un groupe de beaux vieillards ayant tous à la main une branche d’olivier; les cavaliers, les chars et la foule immense du peuple portant des rameaux de myrte. Ce jour-là, les captifs eux-mêmes étaient libres, afin qu’il n’y eût personne dans la cité qui ne pût fêter la déesse chaste et libre, puisqu’elle était restée vierge. Les Thesmophories ou la fête des législatrices, avaient un autre caractère. L’idée de la cité particulière y cédait la place à celle de la commune société des hommes, la publicité au mystère, la foule à une troupe choisie d’officiants. Les Panathénées étaient la fête de Minerve et d’Athènes, les Thesmophories, celle de la famille et de la vie sociale, gouvernées par les saintes lois que les grandes déesses avaient fondées sur l’agriculture et la propriété. L’idée si complexe de la fécondité avait, chez les anciens, bien des représentants. Tandis que Vénus avait été peu à peu réduite à n’exprimer que le plaisir, et Bacchus l’orgie, Déméter était restée la chasteté féconde, la déesse qui rendait les familles prospères par les moeurs honnêtes, et les champs fertiles par un travail réglé. Au fond de son culte se trouvait bien l’idée de la génération, mais selon la nature et la loi morale, non pour le désordre et l’emportement des sens. Son surnom par excellence était celui de législatrice. Les Thesmophories se célébraient en beaucoup de pays, nulle part avec autant d’éclat qu’à Athènes. Elles avaient lieu à l’époque des semailles d’automne; aussi les femmes mariées seules officiaient[40], après s’y être préparées, durant plusieurs jours, par le jeûne, l’abstinence et des purifications qui donnaient un caractère chaste et pieux à des rites qu’il eût été facile de faire dégénérer en licence[41] ; les hommes étaient rigoureusement exclus de certaines cérémonies qui s’accomplissaient la nuit. La course des torches était une fête plus simple, mais d’un
sens profond. Au feu de l’autel dressé à Prométhée dans l’Académie, on allumait
des flambeaux, et la victoire restait à celui qui, après une course rapide,
rapportait à l’autel sa torche enflammée. Cette fête rappelait que le Titan
avait donné aux hommes le feu, principe de tous les arts, et qu’ils ne
devaient pas le laisser s’éteindre. Il s’y mêlait un autre souvenir
mythologique, la légende qui attribuait au Titan, comme à Vulcain, le coup de
hache frappé sur la tête de Jupiter d’où était sortie Minerve ou l’Intelligence
qui éclaire. La foule n’y voyait qu’un spectacle, tout au plus un témoignage de
reconnaissance envers celui à qui l’humanité devait des dons plus précieux
que ceux de Cérès et de Bacchus[42] ; mais,
pour quelques-uns, c’était la lumière que III. Les mystères, l’orphismeCertaines de ces fêtes ont eu une longue popularité et sont encore l’objet d’études persévérantes; je veux parler des mystères, surtout de ceux de Samothrace et d’Éleusis, renommés comme les plus anciens et les plus vénérables. A Samothrace, on honorait les dieux Cabires, dont les vrais noms, cachés aux profanes, étaient révélés aux seuls initiés, pour que seuls ils pussent, dans le péril, invoquer ces divinités puissantes et secourables. Un ancien nous les a pourtant livrés[43] : Axiéros, Axiokersos et Axiokersa, qui formaient une triade sainte, plus un quatrième dieu, Kasmilos, probablement leur fils. Les trois premiers noms renferment les racines éros, l’amour, et kersos, forme archaïque de xόρος et de xόρη, jeune garçon et jeune fille. Axiokersos et Axiokersa étaient donc le principe mâle et le principe femelle, attirés l’un vers l’autre par l’amour, et leur culte, un de ceux au fond desquels se retrouve l’idée de génération et de production, qui a tant préoccupé l’antiquité païenne. L’enseignement donné aux initiés paraît avoir roulé sur des notions cosmogoniques où l’on s’efforçait bien plus de pénétrer la nature des choses que celle des dieux. C’est du moins l’avis de Cicéron[44]. Tout le monde pouvait être initié aux mystères de Samothrace, mais après des purifications qui expiaient les crimes et passaient pour garantir dans cette vie contre le danger, et pour assurer, au delà du tombeau, une existence meilleure. Une des conditions nécessaires était la confession faite au prêtre par le récipiendaire. Lysandre et Antalcidas s’y refusèrent. Le prêtre les ayant sommés de confesser le plus grand crime qu’ils eussent commis : Les dieux le savent, dit le second, c’est assez. Est-ce toi ou les dieux qui l’exigent ? dit le premier. — Ce sont les dieux. — Alors retire-toi ; s’ils m’interrogent, je répondrai. Les mystères d’Éleusis font involontairement penser à ces représentations théâtrales que le moyen âge appelait aussi, mais dans un tout autre sens, des mystères : car elles étaient la mise en scène de la belle et dramatique légende de Déméter et de Kora (Cérès et Proserpine) qu’un hymne homérique nous a conservée[45]. En voici le résumé : Proserpine, brillante de jeunesse et de beauté, jouait dans le champ Nyséen[46] avec les Nymphes, filles de l’Océan, et cueillait les fleurs parfumées de la prairie, quand soudain la terre s’entrouvre, et le dieu des Enfers paraît monté sur un char étincelant d’or. Il saisit, malgré ses pleurs, la vierge immortelle, et ses coursiers fougueux l’emportent à travers l’immensité. Sous leurs pas rapides, la terre fuit, et le ciel étoilé, et la mer profonde, et la route embrasée du soleil. En vain Proserpine fait retentir de ses cris le sommet des montagnes et toute l’étendue de l’Océan, nul dieu, nul mortel n’entend sa voix. Cérès l’a reconnue ; son cœur maternel est saisi d’un violent désespoir ; elle arrache les bandelettes qui ceignaient sa belle chevelure; elle jette sur ses épaules divines un manteau d’azur et se met à la poursuite du ravisseur. Mais, parmi les dieux et les hommes, personne ne peut lui indiquer la route qu’il a suivie : Hécate seule et le Soleil avaient vu la violence, et ils n’osaient la révéler. La déesse interrogea le vol des oiseaux : l’augure resta sans réponse. Ainsi le voulait le maître des dieux, qui avait autorisé cet hymen de Pluton. Durant neuf jours, la déesse vénérable parcourut la terre; durant neuf nuits, elle chercha sa fille, un flambeau à la main ; et ni le nectar ni l’ambroisie n’approchèrent de ses lèvres[47]. Cependant, lorsque brilla la dixième aurore, Hécate lui, dit enfin qu’elle avait vu passer Proserpine sur un char étincelant, mais sans pouvoir reconnaître le ravisseur. Le Soleil en savait davantage. C’est Pluton, dit-il à Cérès, qui, par la permission de Jupiter, a ravi votre fille. Mais le roi des Enfers n’est pas un gendre indigne de vous, car une des trois parties du monde obéit à ses lois. A cette révélation d’un destin inexorable, Cérès est pénétrée de douleur. Elle quitte l’assemblée des dieux et l’Olympe ; elle échange les traits d’une déesse contre ceux d’une vieille femme et descend sur la terre pour y chercher encore sa fille. Après de longues courses inutiles, elle s’arrête à Éleusis et s’assoit, abîmée dans ses pensées, à l’ombre d’un olivier, sur la triste pierre, au bord du chemin qui menait au puits de Parthénios, que Callimaque a chanté. Kéléos régnait alors à Éleusis. Ses filles en allant puiser de l’eau à la fontaine dans des vases d’airain, voient et interrogent l’inconnue, dont la tête est voilée en signe de deuil. Mon nom est Déo[48], répond la déesse. Des pirates m’ont enlevée en Crète ; je leur ai échappé pendant que, débarqués non loin de ces rivages, ils préparaient leur repas du soir. J’ignore où je suis. Prenez pitié de moi, chères enfants, et trouvez pour moi quelque charge à remplir dans le palais de votre père. Kallidice, la plus belle, lui répond avec bonté et lui montre la demeure des héros du pays, du sage Triptolème, du juste Eumolpos et de Kéléos, son père. Les épouses de ces héros, lui dit-elle, veillent avec diligence sur leur demeure ; aucune ne vous repoussera avec mépris. Notre mère, Métanire, vous donnera sûrement asile dans son palais, et vous garderez notre jeune frère, que nos parents ont eu dans leurs vieux jours. Métanire y consent. Quand, au seuil du palais, Cérès laisse enfin tomber son voile, un rayon divin brille à travers les traits que la vieillesse et la misère semblent avoir flétris. Métanire se lève instinctivement de son siège royal et veut y faire asseoir l’inconnue. Elle refuse et demeure triste, silencieuse, jusqu’à ce que la jeune Iambée lui ait présenté un siège couvert d’une blanche toison, et ait amené par de joyeux propos un sourire sur ses lèvres. Métanire lui offre alors une coupe de vin ; elle ne veut accepter que le breuvage consacré, le cycéon, mélange d’eau et d’un peu de farine, parfumé avec de la menthe. La reine lui confie son fils Démophoon. Elle ne le nourrit d’aucun des aliments que prend une bouche mortelle, ni lait ni pain ; mais elle oint son corps d’ambroisie, répand dans sa poitrine un souffle divin et le berce sur le sein d’une immortelle. La nuit, elle le plaçait au milieu d’un foyer ardent, pour détruire ce qui restait en lui de corruptible. Cependant Démophoon grandissait en force et en beauté. Sa mère veut surprendre le secret de cette éducation merveilleuse. Une nuit, elle voit son fils au milieu des flammes et jette un grand cri. La déesse aussitôt se révèle et punit le doute qu’elle inspire : Insensés et aveugles, qui ne connaissez ni les biens ni les maux que le destin vous réserve ! Je voulais affranchir Démophoon de la mort ; maintenant il mourra, et parce que vous n’avez pas eu confiance, la discorde et la guerre désoleront Éleusis. Je suis la glorieuse Déméter, la joie des dieux et des hommes. Qu’un temple s’élève ici pour moi, et j’y enseignerai les mystères qui permettront aux hommes de se racheter de la faute qui vient d’être commise. Le temple s’éleva, et la déesse y fixa sa demeure ; mais, toujours inconsolable et irritée, elle refusa sa bénédiction à la terre. Les germes restaient sans vie, les plaines sans moissons. Le genre humain allait périr. Zeus envoya, pour fléchir la déesse, Iris aux ailes d’or, sa messagère, puis tous les dieux. Elle demeura implacable. Alors Hermès descendit aux Enfers, et, au nom de Jupiter, demanda au sombre monarque de laisser sa jeune épouse revenir au ciel embrasser sa mère. Pluton y consent, et Proserpine s’élance avec joie sur le char étincelant de son époux. Arrivée au temple d’Éleusis, elle se jette dans les bras de sa mère qui, de bonheur, pleure et ne peut parler. Cérès craint que sa fille, retrouvée, ne lui soit encore ravie, car elle sait le secret terrible, inviolable : si Proserpine n’a pris aucune nourriture auprès de son époux, elle ne lui reviendra jamais, mais si elle a goûté, aux Enfers, à quelque aliment, elle appartiendra à Pluton un tiers de l’année, et ne pourra passer que les deux autres sur la terre et aux cieux. Symbole charmant du germe qui doit s’unir à la terre durant les sombres mois, pour reparaître et s’épanouir à la douce lumière de la saison chaude et féconde, sa première mère. Cérès interroge sa fille avec anxiété : Chère enfant, as-tu goûté à quelque nourriture ? Proserpine a mangé un pépin de grenade ; il faut donc que les destins s’accomplissent. Rhéa, l’antique déesse, descend, par l’ordre de Jupiter, à Rharios, champ autrefois fertile, où, par la colère de Cérès, le grain reste inerte dans les sillons, et elle annonce la volonté du dieu inexorable. La déesse se résigne. Elle rend aux campagnes leur fertilité ; elle enseigne à Triptolème et à Eumolpos les secrets de l’agriculture[49] et les rites sacrés par lesquels elle veut être honorée, puis remonte vers l’Olympe. Mais elle et sa fille veillent désormais sur la terre, et accordent une vie heureuse à ceux qui les invoquent après s’être fait initier à leurs mystères[50]. Les fêtes d’Éleusis étaient la mise en action de cette légende sous la direction des Eumolpides, à qui, dit le poète, était remise la clef d’or des mystères. Le 15 du mois boédromion, le premier pontife d’Éleusis, l’hiérophante, toujours choisi dans cette famille, et dont le sacerdoce était à vie, à condition qu’il gardât le célibat, se rendait au Poecile d’Athènes, la tête couverte du diadème, et y proclamait l’ouverture de la solennité, ainsi que les obligations imposées aux initiés et aux mystes : ceux-ci étaient les novices qui s’étaient longuement préparés, sous la direction d’un Eumolpide, à recevoir l’initiation[51]. Les barbares et les meurtriers, même involontaires, étaient exclus ; mais tout homme de sang hellénique qui avait l’âme et les mains pures pouvait être admis. Le lendemain, les mystes allaient faire à la mer des purifications qui étaient renouvelées plus tard sur la route d’Éleusis. Le 17, le 18 et le 19, ils préludaient à l’initiation par des sacrifices, des cérémonies expiatoires et des prières, selon un rituel soigneusement caché aux profanes, et par un jeûne d’un jour, qui n’était rompu que le soir. La plus touchante de ces cérémonies était celle où soit un jeune garçon, soit une jeune fille de pur sang athénien, et qu’on appelait l’enfant du foyer parce qu’il se tenait le plus près de l’autel et de la flamme du sacrifice, accomplissait certains rites d’expiation au nom de ceux qui demandaient à être admis aux mystères. Il semblait que ces supplications, passant par des lèvres innocentes, en seraient plus agréables aux dieux : c’était le rachat de tous par la prière d’un enfant. Le 20, la partie de la fête qui se passait à Athènes était finie, et par la voie Sacrée partait la grande procession qui portait à Éleusis l’image d’Iacchos, qu’on donnait pour fils à Cérès, et dont le nom était le cri d’allégresse des initiés. La route n’était que de cent cinquante stades[52] environ, mais on y faisait de nombreuses stations pour les sacrifices, les ablutions et les chants. Au pont du Céphise, de gais propos, échangés entre les pèlerins allant au temple et la foule courant aux fêtes, rappelaient ceux d’Iambé qui avaient un moment distrait la déesse de ses tristes pensées[53]. On n’arrivait à Éleusis que le soir, aux flambeaux, et on y demeurait plusieurs jours : la foule livrée aux divertissements qu’elle cherche dans ces solennités, les initiés tout entiers aux actes religieux qui s’accomplissaient pour eux seuls. Le héraut, avant de leur ouvrir les portes saintes, s’écriait : Loin d’ici les profanes, les impies, les magiciens et les homicides. Un de ceux-là, trouvé dans le sanctuaire, au milieu des initiés et des mystes, eût été puni de mort. La même peine, avec la confiscation des biens, frappait ceux qui révélaient les mystères. Le temple s’élevait au-dessus d’Éleusis, sur le penchant d’une colline. Un mur, qui renfermait un espace long de cent trente mètres et large de cent, interdisait aux profanes l’approche et la vue de l’enceinte sacrée[54]. Les initiés s’y rendaient vêtus de longues robes de lin, les cheveux relevés par des cigales d’or et ceints d’une couronne de myrte. Ils rappelaient, par des cérémonies symboliques, le rapt de Proserpine et son séjour aux Enfers, la douleur de Cérès et ses courses errantes. Les rites les plus saints se célébraient la nuit, temps propice aux choses mystérieuses et à cette ivresse de l’esprit qui naît de l’imagination surexcitée. Un des plus fameux était la course aux flambeaux. Ils sortaient de l’enceinte, marchant deux à deux sans bruit, avec une torche allumée, puis, rentrés dans le parvis sacré, couraient en tous sens, secouaient leurs torches pour en faire jaillir les étincelles qui purifiaient les âmes, et se les transmettaient de main en main, en signe de la lumière et de la science divines qui se communiquent et qui vivifient. Peu à peu les torches s’éteignaient ; alors du sein des ténèbres sortaient des voix mystérieuses et des images effrayantes, que montraient de rapides éclairs. La terre mugissait ; on entendait des bruits de chaînes et des hurlements de douleur. L’effroi descendait dans les cœurs. Après ces épreuves, qui constataient et affermissaient la foi des fidèles, le poème sacré continuait à se dérouler : Proserpine était retrouvée, et aux scènes de deuil succédaient les scènes d’allégresse, aux terreurs du Tartare les joies de l’Empyrée : les ténèbres s’illuminaient de mille feux ; le sanctuaire s’emplissait de lumière et d’harmonie. Des apparitions merveilleuses, des chants sacrés, des danses rythmiques, annonçaient l’accomplissement des mystères. Enfin les voiles tombaient, et Cérès apparaissait dans sa majestueuse beauté. Nous n’avons malheureusement que des révélations fort incomplètes, et nous ne pouvons suivre l’ordre des cérémonies, dont quelques-unes étaient comme des sacrements. Les purifications préliminaires, qui lavaient toute souillure, rappellent le baptême, et en buvant le cycéon ou breuvage sacré, l’initié communiait avec la nature et la vie. D’autres rites consistaient dans l’adoration de reliques et d’objets mystérieux qu’on prenait, en les baisant, et qu’on se passait de main en main ou que l’on replaçait dans la corbeille sacrée, kalathos. J’ai jeûné, disait la formule des mystères ; j’ai bu le cycéon ; j’ai pris de la ciste et, après avoir goûté, j’ai déposé dans la corbeille ; j’ai repris de la corbeille et j’ai mis dans la ciste. Les fêtes se célébraient à deux époques différentes de l’année, parce qu’il y avait trois degrés d’initiation, comme trois ordres de cléricature, car les initiés formaient bien, dans le sens primitif du mot, un clergé[55]. Les petites Éleusinies, qui étaient une préparation aux grandes, avaient lieu au mois des premières fleurs, anthestérion (février), lorsque la vie, se réveillant au sein de la terre, annonçait le retour de Proserpine à Éleusis ; les Grands mystères, au mois des courses sacrées, boédromion (septembre), quand la nature allait s’endormir et la fiancée d’Hadès retourner vers son époux, dans le sombre séjour. On n’était admis qu’au bout d’une année à la dernière initiation l’époptie ou contemplation suprême. L’homme a toujours fait cette offense au juge suprême de supposer qu’il réglerait sa sentence non sur les actes de la vie, mais. sur les dévotions du temple, et l’on s’est dit l’élu des dieux pour avoir rempli certaines pratiques que d’autres n’accomplissaient pas. Les initiés d’Éleusis comptaient résolument sur les béatitudes éternelles qu’Homère et Hésiode réservaient à quelques héros. Bienheureux, dit l’hymne homérique à Déméter, bienheureux les mortels qui ont vu ces choses ! Celui qui n’a pas reçu l’initiation n’aura pas, après la mort, une aussi belle destinée dans le royaume des ténèbres[56]. — Il y croupit, ajoute Pindare, dans le bourbier d’Hadès, tandis que l’homme purifié par l’initiation a connu avant d’être mis en terre le commencement et les fins de la vie ; après sa mort, il habite avec les dieux. Et Sophocle : Seuls, ils ont la vie éternelle. On croyait même que durant la célébration des mystères, l’âme des initiés participait à l’état des bienheureux[57]. Dans le tableau des Enfers peint à Delphes par Polygnote, deux femmes étaient représentées, qui, nouvelles Danaïdes, portaient des vases sans fond d’où l’eau s’échappait. Une inscription disait qu’elles n’avaient pas été initiées, ce qui signifiait que sans l’initiation la vie s’écoule et se perd. Ces idées n’étaient point très anciennes, car la question de l’immortalité de l’âme était toujours restée obscure, et les conceptions d’Homère et d’Hésiode avaient suffi aux besoins religieux du génie grec jusqu’au sixième siècle. Alors la voie où l’hellénisme s’avançait fut élargie par trois puissances nouvelles : les philosophes, qui agitèrent déjà de bien téméraires questions ; les poètes dramatiques, dont la main hardie remua profondément le vieux monde des légendes héroïques ; enfin de pieuses confréries, qui prétendirent donner satisfaction à des curiosités plus exigeantes que celles des temps passés. Il a été question précédemment des premières écoles de philosophie, et il sera parlé plus loin du drame. Mais, à la suite des mystères, viennent naturellement se placer les associations qui s’aventuraient, par delà le culte officiel, en des régions ténébreuses où l’homme cherchait ce qui pouvait calmer ses inquiétudes. Dans presque toutes les religions, en dehors du culte domestique, réglé par le père de famille, et du culte public, soumis à des rites traditionnels sous la surveillance des magistrats, il s’est pratiqué des dévotions particulières qui, croit-on, conduisent à une vie plus sainte et souvent mènent à de dangereux désordres. Dans la seconde moitié du sixième siècle, on commença à parler des livres d’Orphée contenant les révélations nécessaires pour arriver à la vie bienheureuse. Aristote, qui ne croit pas à l’existence de ce personnage mythique, attribue les vers qu’on faisait courir sous son nom à Cercops, un philosophe pythagoricien, et au poète Onomacritos, tous deux contemporains des Pisistratides[58]. Quelle qu’en fût l’origine, cette poésie qui répondait à certaines aspirations provoqua la formation de sociétés au sein desquelles les idées
religieuses plus étudiées, plus raffinées, se dégagèrent peu à peu des conceptions
grossières du culte populaire. Secte moitié philosophique, moitié religieuse,
l’orphisme, qui trouva dans Athènes un lieu d’élection, développa l’idée de l’harmonie
du monde, garantie par l’observance des lois morales et, pour la rémission
des fautes, par les actes expiatoires qui assuraient la jouissance, après la
mort, des plaisirs élyséens. Dionysos Zagréus, le dragon né, dans Les mystères avaient d’abord parlé aux yeux ; ils étaient une draine religieuse bien plus qu’un enseignement philosophique ou moral[63]. Mais l’esprit ne pouvait demeurer inerte en face de ces cérémonies émouvantes. Les uns n’allaient pas au delà de ce qu’ils avaient vu et s’arrêtaient pieusement à la légende; d’autres, en petit nombre, s’élevaient du sentiment à l’idée, de l’imagination à la raison, et, grâce à l’élasticité du symbole, y firent entrer peu à peu des doctrines qui n’y étaient certainement pas à l’origine ou ne s’y trouvaient que d’une manière bien confuse. Démophoon au milieu des flammes fut l’âme qui se purifie au milieu des épreuves ; Proserpine et Dionysos aux Enfers, la mort apparente de la moisson humaine ; leur retour sur l’Olympe, la résurrection de la vie et l’immortalité. Plus tard encore, ces idées se précisèrent davantage et il s’élabora, au sein des mystères, un polythéisme épuré qui se rapprocha, par certaines de ses tendances, du spiritualisme chrétien. Diodore de Sicile croit que l’initiation rendait les hommes meilleurs (V, 49, 6). N’était-ce pas un initié cet Athénien qui, en secret, dotait des filles pauvres, rachetait des prisonniers et enterrait des morts, sans demander à personne sa récompense[64]. Les héros d’Homère mettaient le bonheur dans la domination et la jouissance, les initiés devaient le chercher dans la modération et la piété. Voilà l’évolution morale qui s’était produite. Mais si les nouvelles croyances pouvaient porter quelques âmes dans les hautes régions, elles ne détachaient pas tous les esprits du vieux naturalisme qui, dans l’Orient, avait provoqué le désordre en le sanctifiant; et comme elles parlaient surtout à l’imagination, elles produisaient, même parmi les initiés, une surexcitation nerveuse qui pouvait dégénérer en discours licencieux et en scènes immondes. En outre, d’habiles charlatans, magiciens et faiseurs de miracles, exploitèrent les espérances données aux adeptes. Un siècle n’était pas écoulé depuis l’apparition de l’orphisme, qu’Euripide se moquait des entrepreneurs en rites expiatoires, les όρφεοτελεσταί, qui prétendaient enseigner aux riches timorés les moyens de contraindre la volonté des dieux et qui vendaient par les rues des amulettes pour protéger contre tous les maux, des indulgences pour effacer jusqu’aux péchés des aïeux[65]. Cette exploitation, parfois inconsciente, de la sottise humaine est de tous les temps; on trouve des devins et des sorciers chez les nègres, les Indiens d’Amérique et les sauvages de l’Océanie, comme il y en eut dans les sociétés policées de l’ancien monde. Heureusement pour les Grecs,. mysticisme impur et mysticisme sincère n’ont été longtemps qu’un incident de peu d’importance dans la religion hellénique qui, avec beaucoup de défaillances morales, garda son caractère de culte né sous le soleil, en pleine lumière et au souffle de l’inspiration poétique. V. Les jeux nationauxLes dieux, dit Pindare, sont amis des jeux.
Plan de l’acropole des jeux isthmiques[67]. C’est dans la riante plaine de Cirrha que se célébraient les jeux pythiques en l’honneur d’Apollon, vainqueur du serpent Python. Plus haut, Delphes se déroulait en amphithéâtre, dominé par le Parnasse et son double sommet, que tant de poètes ont chanté; on voyait le temple environné d’un peuple de statues de bronze et de marbre, répandu dans la vaste enceinte qui contenait les offrandes des nations, des rois et des particuliers. Statues, trépieds, bassins, vases magnifiques, métaux précieux, formaient une richesse considérable qui dépassait de beaucoup la somme de 10.000 talents (plus de 56 millions de francs) que les Phocidiens enlevèrent lorsque, au quatrième siècle, ils s’emparèrent du sanctuaire. Divers édifices appelés trésors recevaient ces richesses ; dans le trésor de Corinthe, on voyait les présents de Gygès et de Crésus, rois de Lydie. Les jeux pythiques, organisés en 586, revenaient tous les
quatre ans, la troisième année de chaque olympiade. Cette période semble avoir
été consacrée chez les Grecs : car elle était la même pour les fêtes de Délos
et d’Olympie; mais elle n’égala jamais en importance le retour périodique des
jeux olympiques qui servit de règle à la chronologie. A partir de l’année 776
avant on inscrivit sur le registre public des Éléens le nom de celui qui
remportait le prix à la course du stade. Cet usage continua jusqu’aux
derniers temps, et les noms de tous ces vainqueurs indiquèrent les
différentes olympiades. Ces jeux avaient aussi le privilège de suspendre les
guerres et. d’être pour Ces jeux consistaient en divers exercices, tous estimés des Grecs, quoiqu’ils nous semblent, à nous modernes, de mérites fort différents : tous aussi sanctifiés par la religion qui faisait présider à chacun d’eux une divinité ou un héros. On observait dans les cinq combats, pentathlon, l’ordre suivant : Pour le saut, les concurrents étaient en nombre indéterminé. Ceux qui avaient franchi l’espace réglementaire entraient en lice pour le javelot. Les quatre meilleurs champions à cette épreuve se présentaient pour la course qui éliminait un concurrent. Il en restait donc trois pour le disque et les deux derniers pour la lutte[69]. On y ajoutait des courses de chevaux et de chars, des concours de musique et de poésie, et tous excitaient également l’enthousiasme. La musique n’avait cependant à son service qu’un très petit nombre et de bien pauvres instruments. Mais elle était regardée comme un puissant moyen de culture, et l’on verra plus loin qu’il lui était attribué une grande influence morale, même politique. Ni l’or, ni l’argent, ni l’airain ne formaient le prix si vivement disputé ; une couronne de laurier ou d’olivier sauvage était la récompense du vainqueur. Le dieu, spectateur invisible de ces fêtes, ne voulait pas qu’une idée de lucre se mêlât à la joie d’une victoire gagnée en son nom. Mais à quelque jeu que ce fût, c’était un insigne honneur de vaincre, pour le vainqueur lui-même, et aussi pour la cité qui lui avait donné le jour. A son retour, il y rentrait porté sur un char magnifique ; on abattait des pans de murailles pour lui livrer passage ; on lui donnait l’immunité d’impôt et le droit de s’asseoir aux premières places dans les spectacles et les jeux ; son nom était dans toutes les bouches : les poètes les chantaient ; les peintres, les sculpteurs, reproduisaient son image pour orner les places publiques, les avenues ou les portiques des temples[70]. On vit des pères mourir de joie en embrassant leur fils victorieux. A Athènes, Solon avait établi qu’une somme de 500 drachmes serait donnée au vainqueur. De toutes les récompenses, il n’en était pas de plus héroïque que celle de Sparte : à la première bataille, on réservait au vainqueur d’Olympie le poste le plus périlleux, l’honneur de braver le plus de dangers pour la patrie. Rendons cette justice aux Grecs, qu’ils accordaient quelque chose de plus aux poètes qu’aux athlètes. Aux jeux pythiques, on vit Pindare, forcé par l’assemblée de s’asseoir sur un siège élevé, la couronne sur la tête, la lyre à la main ; soulever par ses chants d’enthousiastes acclamations; une part lui était réservée dans les prémices offertes aux immortels; et après sa mort, le trône où le poète s’était assis fut placé parmi les statues des dieux, dans le temple d’Olympie. Archiloque, Simonide, reçurent des hommages semblables. Quelquefois aussi un illustre spectateur détournait de l’arène les yeux du public et devenait lui-même l’objet du spectacle. Thémistocle, Pythagore, Hérodote et Platon eurent cet honneur ; le premier avouait qu’il avait goûté là les plus douces jouissances de sa vie[71]. A ces jeux on accoterait de Si quelque désordre était causé, les hellanodices le réprimaient aussitôt; le bâton des serviteurs des jeux tombait sur les épaules du noble comme sur celles du pauvre. Lichas, un des principaux personnages de Sparte, fut ainsi frappé. Les femmes étaient rigoureusement exclues sous peine d’être précipitées du haut du rocher voisin, le mont Typæon. Les fêtes olympiques commençaient avec la pleine lune. Les
plaisirs pouvaient donc continuer durant ces nuits de Tels étaient ces jeux si fameux dans l’antiquité. Ils
formaient un lien pour tous les peuples de Les jeux entretenaient parmi les Grecs le goût de ces
exercices salutaires au corps et à l’âme : au corps rendu souple et résistant
par cette gymnastique prolongée qui, développant la force et l’adresse, préparait
le soldat de Marathon et des Thermopyles ; à l’âme, qui est plus libre et
plus active en un corps sain et dispos que lorsqu’elle traîne péniblement une
enveloppe misérable et souffrante[73]. L’art aussi et
la morale y gagnaient. Platon cite divers personnages que le désir de
conserver leurs forces pour gagner ces couronnes préserva de tout excès, et
qui s’astreignirent à une chasteté volontaire[74]. La sculpture et
la peinture avaient là sous les yeux une race que cette vie avait faite la
plus belle du monde, et des encouragements tels que nul peuple n’en a jamais
donné : car on ne venait pas seulement pour assister aux luttes, mais aussi
pour admirer les productions des artistes. Dans l’Altis, vaste enceinte
autour du temple de Jupiter à Olympie[75], se dressaient
mille statues dont un grand nombre étaient des chefs-d’œuvre et qui toutes
réveillaient de glorieux souvenirs. Il n’y aurait pas trop d’exagération à
dire qu’à ces jeux s’est formé le génie de Une autre force de l’esprit, une autre gloire de Ce siècle, qui nourrissait. les esprits de fortes et religieuses pensées, préparait dignement celui où le sentiment du devoir patriotique allait produire des miracles, et où les bras exercés aux luttes du stade frapperont de si grands coups. Cependant la philosophie, commençant son œuvre de destruction, avait déjà dit, par la bouche de Xénophane[76] : Le plus glorieux vainqueur d’Olympie ne vaut pas un philosophe. Notre sagesse est plus précieuse que la vigueur des muscles, et celui qui aura gagné le prix au pentathle n’en saura pas mieux gouverner sa ville. C’est vrai ; mais, à Marathon et aux Thermopyles, les abstracteurs de quintessence de l’école d’Élée auraient-ils mieux fait que Miltiade et Léonidas ? Arrivé au terme de cette étude sur les institutions
générales de
|