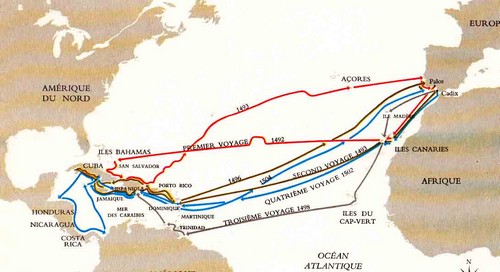CHRISTOPHE COLOMB
VU PAR UN MARIN
LA PREMIÈRE EXPÉDITION.
|
Le départ de Palos. Le 2 août C. Colomb et tous ses compagnons communièrent à une messe célébrée à la chapelle du couvent de la Rabida, messe suivie d'une procession. Cette cérémonie, à la veille d'un voyage de découverte, fut probablement plus émouvante que d'habitude, mais elle n'était pas exceptionnelle. En Espagne, à cette époque, les ordonnances concernant les navires armés avec l'intervention du gouvernement étaient formelles. Les hommes qui embarquaient devaient toujours partir en état de grâce parce qu'ils allaient à péril de mort ; ils devaient donc se confesser et communier avant le départ. Pendant le voyage, il était strictement défendu de blasphémer, de faire ou dire quoique ce soit contre le Service et l'Honneur de Dieu et du Roy. Nous verrons dans la suite quelles étaient les pratiques religieuses à bord. Le lendemain 3 août, une demi-heure avant le lever du soleil, la Santa Maria, la Pinta et la Niña appareillèrent du port de Palos, franchirent la barre de Salies et poussées par une forte brise gouvernèrent pendant 60 milles au Sud, puis au SW. et enfin au S. quart SW. pour gagner les Canaries. Les moines de la Rabida bénirent les trois navires au moment où ils disparaissaient sous l'horizon, tandis que Christophe Colomb, avec cette satisfaction grave et émue réservée à ceux qui, après des années de luttes et la fièvre de la préparation, partent enfin pour tenter la grande aventure de leur vie, commençait son journal de bord par : In nomine Domini Jesus Christi... Les quatre expéditions de ColombLe journal de bord de C. Colomb, son écriture et sa signature. Nous nous servirons, pour ce premier voyage, du texte écrit en entier par Barthélémy de Las Casas, évêque de Chiapa, rédigé d'après le journal de bord autographe de Christophe Colomb dont il était l'ami, et qui le lui avait communiqué. Malheureusement, une partie seulement de cette relation a été extraite littéralement de ce manuscrit, et Las Casas n'était pas un marin. M. de Navarette, directeur du dépôt hydrographique de Madrid, reproduisit en 1791 ce précieux document, trouvé dans les archives de M. le duc de Veragua, et le comprit dans ses Relations des Quatre Voyages entrepris par Christophe Colomb. Cet ouvrage fut traduit en français en 1828 par MM. F. T. A. Chalumeau de Verneuil et de la Roquette. C'est cette traduction devenue classique qui servira d'ossature à notre récit et dont nous reproduirons les extraits en italiques. Fidèle à notre programme, nous ne relèverons que les points nous paraissant les plus remarquables, surtout au point de vue maritime. De nombreuses traductions de la relation de Las Casas ont été données tant en français que dans d'autres langues. Citons ici celle de Sir Clément R. Markham C. B. F. R. S. The journal of Christoforo Columbus during his first voyage 1492-93. L'opinion de ce remarquable géographe, formulée en tête du volume, trouve tout naturellement sa place au début de notre chapitre et emprunte une grande valeur à l'incontestable compétence de son auteur sur les choses de la mer. Ce journal, dit-il, est le miroir de l'homme. Il montre à la fois ses défauts et ses qualités. Il met en valeur ses ambitions élevées, son inaltérable loyauté, ses sentiments profondément religieux, sa bonté et sa reconnaissance. Il nous donne la juste impression de son savoir et, de son génie de conducteur d'hommes, de son souci de la sécurité de ceux qui sont placés sous ses ordres et de la richesse de son imagination ! A cette appréciation du savant Anglais, je me permettrai seulement d'ajouter ceci ; la lecture attentive de ce journal prouve qu'il a été écrit non seulement par un homme possédant les qualités que lui attribue Sir Clément R. Markham, mais encore par un observateur curieux et avisé répondant bien à sa propre exclamation : Celui qui pratique l'art de la navigation doit vouloir connaître les secrets de la nature d'icy bas ! et enfin par un marin dans toute l'acception du mot. Bien que résumé par Las Casas, il n'y a pas un passage, pas une expression qui autorise à dire le contraire ; dans la simple exactitude des termes maritimes, employés avec discrétion, nous voyons une preuve flagrante que l'auteur est vraiment un marin et non pas quelqu'un qui cherché à se faire passer pour tel. Le document initial fut écrit, nous l'avons dit, de la main même de Christophe Colomb. Les manuscrits autographes du grand Navigateur, tant en espagnol qu'en italien, sont nombreux. Son écriture est donc bien connue, elle est nette et lisible ; nous savons d'ailleurs qu'il était habile à faire des cartes ; un dessin de sa main qui, fréquemment reproduit, est devenu classique, prouve de réelles qualités. Le fac-similé en a été pris par l'archéologue Jal à Gênes où l'original est renfermé dans une cassette avec trois lettres autographes en espagnol, et le recueil relié des cédules royales manuscrites que l'Amiral de l'Océan tenait de Ferdinand. La cassette ainsi garnie fut envoyée de Séville par Christophe Colomb, en 1502, aux nobles seigneurs de l'Office de Saint-Georges à Gênes. Le dessin rapidement jeté sur le papier est un projet devant servir à illustrer nous ignorons sous quelle forme — son propre triomphe. On y voit Colomb entouré de personnages allégoriques ; il est assis, à côté de la Providence, dans un char traîné sur la mer par la Constance et la Tolérance ; derrière et le poussant, est la Religion chrétienne ; dans les airs et au-dessus sont la Victoire, l'Espérance et la Renommée. Des monstres représentant l'Envie et l'Ignorance se montrent à peine au-dessus des flots. Le court texte qui accompagne ce dessin est en italien et la signature de Colomb, très nette, mérite de nous arrêter quelques instants. C. Colomb avait deux signatures ; l'une fort simple : Christobal Colon Almirante del Oceano, et l'autre compliquée dont il se servait plus volontiers et que voici : S. S. A. S. X. M. Y. Χρο FERENS. Ce mélange de grec et de latin dans le nom même étonne, mais à notre connaissance, tout au moins ne peut être expliqué que comme une originalité. Quant aux lettres qui le précèdent, la signification en est bien connue. Les Espagnols, au moyen âge, pour se distinguer des Juifs et des Maures qui vivaient fort nombreux parmi eux, faisaient précéder leurs noms d'initiales tirées d'un passage biblique ou de noms de saints. Ces lettres devaient être au nombre de sept, chiffre qui, suivant un préjugé admis, était considéré comme On croit que celles employées par C. Colomb se traduisent par Supplex, Servus Altissimi Salvatoris, Christi, Mariae, Josephi ou encore Supplex, Salvato, Sanctum Sepulchrum, Christe Mariae Josephi. Parfois, nous dit André de Hevesy, il ajoutait à cette signature la devise tirée des psaumes : Mirabiles elationes maris, mirabilis in altis Dominus[1]. Comment on naviguait du temps de C. Colomb. Pendant que les trois navires font route sur les Canaries, décrivons lés méthodes et instruments dont ils disposaient pour entreprendre ce qui fut le premier voyage au long-cours. Comme le dit très justement Clerc-Rampal dans une intéressante étude sur l'évolution des méthodes et des instruments de navigation, à laquelle nous empruntons largement, la pénurie des unes et des autres importait peu à C. Colomb dans son premier voyage à l'aller. Mais, si l'on songe qu'une fois les Terres-Neuves connues, ces hardis marins allaient et venaient, exécutant leurs randonnées à travers les océans avec l'aide seule des instruments primitifs que nous verrons plus loin, on est forcé de s'incliner devant tant de hardiesse et de tranquille audace. Il fallait posséder un sens marin joliment développé pour réussir d'une façon courante de pareils exploits. C'est d'ailleurs une constatation qui se fait dans tous les domaines : au fur et à mesure que progressent les instruments et les méthodes scientifiques, la valeur propre de l'homme décroît[2]. Avant l'apparition de la boussole, on ne pouvait se diriger en mer, une fois les côtes perdues de vue, que par la position des astres ; les pilotes de l'antiquité étaient des hommes mystérieux qui gardaient bien leur secret, consistant à connaître de mémoire la liste des étoiles qu'il fallait, heure par heure et suivant les saisons, conserver devant la proue pour se rendre de tel point à un autre. Il est à ce propos assez curieux de remarquer que les Phéniciens, les premiers, se rendirent compte de l'immobilité relative de la Polaire et furent les seuls, pendant longtemps, à l'utiliser. Ceci explique, d'ailleurs, l'importance de leurs navigations. Dans une mer fermée comme la Méditerranée, aux parcours peu étendus, où les courants sont en général faibles et le ciel clair, ces procédés ont pu suffire, mais la véritable navigation ne commença réellement qu'avec l'apparition et l'usage de la boussole. D'abord calamite, puis aiguille flottante, la boussole, mot qui vient du sicilien bussula pour désigner une petite boîte, devient vraiment pratique lorsque l'aiguille est placée sur un pivot. Cette invention est attribuée par les Italiens à un de leurs compatriotes Flavio Gjoia d'Almalfi et remonterait à 1302, par les Espagnols à Jaimes Ribes de Majorque avant qu'il ne vînt diriger l'Académie de Sagres sur la demande de Henri le Navigateur, par les Français à un Dieppois... etc. Il est fort probable que les uns et les autres n'ont pas tort et que cette invention se fit comme d'autres, séparément et simultanément dans ces divers lieux. C'est cependant Pierre Pélerin, né à Maricourt en Picardie, mieux connu sous le nom de Petrus Peregrinus, qui très probablement est le premier Européen à avoir écrit un traité sur le magnete. Dans une lettre adressée en août 1269 à son ami Sygerus de Faucaucourt, non seulement il expose très clairement les propriétés de l'aimant d'après ses propres expériences, mais encore il décrit l'avantage qu'il y a, dans la construction des boussoles, à substituer une aiguille aimantée, montée sur un double pivot, à celle flottant sur un bol d'eau, et à graduer le bord de la cuvette afin de pouvoir mieux mesurer l'azimut d'un astre[3]. En tous les cas, le passage de la boussole de la Méditerranée dans l'Océan est constaté vers 1417 ; elle y prend plus volontiers le nom de compas. Le Nord devint même fabricant de choix puisqu'on voit Philippe le Bon acheter dans le port de l'Ecluse plusieurs compaes, aiguilles et oirloges de mer. Il est amusant de remarquer, en passant, qu'au Moyen Age on attribuait à la pierre d'aimant puis à la calamite, en dehors de leurs propriétés physiques — comme on le fit plus tard à l'électricité — le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies telles que la goutte, les hydropisies, les hémorragies, le mal de dent, les convulsions, et même la vertu magique d'apaiser les querelles conjugales. Au début, l'aiguille était montée sur pivot au centre d'une-carte portant les aires ou rhumbs de vent, qui furent d'abord au nombre de vingt-cinq, puis de trente-deux ; division conservée jusqu'à nos jours, où petit à petit elle est remplacée par trois cent soixante degrés. Mais le compas ne devint pratique que lorsque l'aiguille fut fixée sous une carte portant les rhumbs de vent qui tournaient avec elle. Ces cartes de compas étaient artistement décorées, peintes en couleurs voyantes, souvent rehaussées d'or ; on en possède de belles collections et reproductions, mais il ne faut pas les confondre avec les roses des vents également très décorées qui figuraient en grand nombre sur les cartes de navigation et dont nous parlerons bientôt. Aiguille et carte montées sur le pivot étaient contenues dans une petite boîte en bois, fermée à sa face supérieure par une plaque de talc, remplacée plus tard par une vitre, lutée soigneusement avec de la cire. La boîte s'ouvrait par en dessous afin que l'on pût vérifier le pivot et régénérer l'aimantation de l'aiguille en la touchant. Elle était suspendue à la cardan et placée dans la bitacora (ou habitacle), sorte de meuble en forme de table de nuit solidement fixé sur le pont, en avant de la barre du gouvernail. Une disposition spéciale de la bitacora permettait d'éclairer le compas par un fanal, dès que la nuit tombait. Grâce à la boussole, les navigateurs de l'époque de Christophe Colomb pouvaient se diriger, mais il n'existait pas alors d'instrument donnant la vitesse du navire. Le loch n'apparut en effet qu'en 1677. Il fallait donc évaluer ce facteur primordial de la navigation à l'œil, et pour cela, en dehors de la connaissance parfaite de son bateau, tenir compte des éléments les plus divers, force du vent, effet de la houle et des vagues, modification des lignes d'eau du navire par l'épuisement graduel des vivres, etc., etc. Les résultats étaient extraordinaires, et on reste stupéfait devant l'habileté de ces navigateurs. Colomb, dès le début de sa première expédition, montrant une fois de plus ses qualités de chef, tenait, et sans doute faisait tenir par les capitaines des navires, deux registres ; sur l'un, qui était gardé secret, il consignait exactement les évaluations réelles des distances parcourues chaque jour ; sur l'autre, qui seul était communiqué à l'équipage, il portait des chiffres très en dessous des précédents, afin de ne pas l'effrayer par la longueur de la route. En ce faisant, il agissait contrairement aux habitudes admises ; dans les traversées ordinaires on comptait un peu plus que l'évaluation, afin de ne pas risquer d'atterrir brusquement, par temps bouché ou la nuit. Le poudrier, ampoulette ou sablier, était l'horloge du bord et point n'est besoin d'insister sur son importance. L'écoulement du sable était calculé pour une demi-heure et l'instrument devait être retourné immédiatement, dès que le réservoir supérieur était vide ; des grumetes très surveillés étaient chargés de cette besogne. Non seulement les évaluations de vitesse, mais tout le règlement de la vie à bord, dépendaient de l'ampoulette, surtout quand les observations d'astres devant rectifier l'heure n'étaient pas possibles. Le sablier est resté pendant très longtemps l'horloge sur les navires ; encore au XVIIIe siècle Duguay Trouin raconte qu'en poursuivant les baleiniers hollandais sur les côtes du Spitzberg par 810, pour nuire au commerce de leur pays, il fut mis en fort mauvaise posture par ce qu'il appelait les mangeurs de sable. A cette latitude, le jour était continu, mais une brume qui dura neuf jours empêchait d'observer le soleil ; or, les veilleurs de l'ampoulette, afin de réduire la durée de leur quart, la retournaient avant qu'elle ne fût complètement vidée, déréglant ainsi toute la vie à bord, de telle sorte qu'on mangeait quand on aurait dû dormir et que lorsque la brume se leva, on trouva sur tous les navires de la flotte sans exception, au moins onze heures d'erreur ! C. Colomb se servait également de la sonde ; le 19 septembre on sonda dans la mer des Sargasses, ne trouvant pas de fond avec deux cents brasses... nous pouvons en déduire qu'il utilisait des lignes ayant au moins cette longueur. L'évaluation de la vitesse et la direction donnée par la boussole, vérifiée par des relèvements de la polaire, permettent de naviguer à l'estime, mais les courants, la dérive, une erreur d'appréciation dans la marche, peuvent fausser les résultats, et une réelle précision ne peut être obtenue qu'en corrigeant la route faite à l'estime par la navigation observée. Nous allons voir quels étaient les moyens très primitifs dont disposaient pour ce faire les navigateurs de la fin du XVe siècle. Les Arabes, très en avance dans l'art de la navigation, utilisaient depuis longtemps l'astrolabe, l'arbalète, etc. mais l'astrolabe inventé par Ipparco et modifié par Toloméo, s'il fut utilisé par les marins à la fin du XIIIe siècle, ne prit toute son importance, pour les chrétiens, qu'après 1415, lorsque l'Académie navale de Sagres s'en occupa. Dès le XIVe siècle, on savait que la polaire décrit un cercle à très faible distance autour du pôle et qu'on pouvait donc obtenir la latitude en mesurant la hauteur de cette étoile au-dessus de l'horizon avec une légère correction qui, suivant la position des étoiles de la Petite Ourse ou gardes, ne dépasse jamais 2°25 ; mais cette observation n'était pas toujours facile ou même possible. Comme nous l'avons déjà dit, c'est Martin Behaim, appelé par Henri de Portugal, et deux médecins, qui instruisirent les pilotes auxquels ils montrèrent la façon de se servir sur mer de l'astrolabe[4]. Behaim s'attacha en effet aux observations solaires pratiquées avec cet instrument, et, répandant l'usage des tables de déclinaison du soleil publiées en 1473 par Jean de Kœnigsberg, dit Regiomontanus, il permit aux navigateurs de trouver la latitude par l'observation méridienne du soleil. L'astrolabe était un cercle gradué muni d'une alidade à pivot central, portant à ses extrémités deux pinnules percées de deux orifices, l'un assez grand pour l'observation des étoiles, l'autre de faibles dimensions pour celle du soleil. Pour observer à bord, il fallait accrocher l'astrolabe au centre du navire, plutôt au grand mât, où les mouvements avaient moins d'amplitude, ou le tenir à bout de bras, et l'on dirigeait l'alidade de manière à faire passer les rayons solaires à la fois par les deux pinnules ; la hauteur était alors lue sur le cercle ou limbe gradué. Cet instrument devait être lourd, pesant dix à douze livres, afin de mieux résister au vent et à l'agitation du vaisseau, aussi fut-il remplacé sur les navires par un quart de cercle plus léger et plus maniable. Ce quart de cercle ou quadrant était constitué par un quart de cercle en cuivre dont le limbe est divisé en 90 degrés. Sur le côté droit opposé au zéro de la graduation étaient fixées les deux pinnules de visée. Au sommet de l'angle droit formé par la rencontre des deux côtés de l'instrument, était attachée l'extrémité supérieure d'un fil à plomb qui pendait librement le long du limbe. Lorsque l'on voulait mesurer l'angle de hauteur d'un astre, le quadrant était placé verticalement, le bord du limbe gradué tourné contre l'observateur, et l'angle droit de l'instrument vers l'objet visé. La visée se faisait par l'observateur étant placé les œilletons des deux pinnules ; l'œil de au voisinage du degré 90 de la graduation lorsqu'il s'agissait d'une étoile. Quand on prenait le soleil, on faisait tomber le point lumineux projeté par la pinnule supérieure sur l'orifice de la pinnule inférieure, en inclinant, autant qu'il en était besoin, le bord supérieur de l'instrument. A ce moment, le fil à plomb marquait sur le limbe gradué l'angle que faisait la ligne de visée avec l'horizon. De plus le quadrant pouvait porter, gravées sur ses faces, toute une série d'indications permettant de résoudre les problèmes de la navigation de l'époque ; soit en dehors de la latitude, trouver les heures de jour et de nuit, la hauteur d'un édifice ou d'un lieu élevé, l'ascension droite et la déclinaison du soleil, les passages de certaines étoiles au méridien, l'heure du lever et du coucher du soleil et le déplacement du navire dans le Nord ou le Sud, et dans l'Est ou l'Ouest, pour une longueur de chemin parcourue, suivant un aire de vent déterminé. Ainsi constitué, cet instrument rassemblait dans un petit espace le résumé de la trigonométrie, de la mécanique céleste et de la connaissance des temps, et devenait le vade mecum de l'astronome et du navigateur[5]. Rien ne permet de supposer que d'autres instruments plus perfectionnés tels que l'arbalète, la ballestrilla, le bâton de Jacob, la verge d'or, le rayon astronomique, étaient utilisés par Colomb et ses contemporains ; il est très probable que leur usage ne se répandit parmi les navigateurs européens qu'après le voyage de Vasco de Gama. Peut-être avait-il encore un nocturlabe, petit instrument très simple dont on se servait pour trouver, à tous les moments de la nuit, de combien l'étoile du Nord était au-dessus ou au-dessous du pôle, et aussi pour trouver l'heure pendant la nuit. Le nocturlabe était, d'ailleurs, presque obligatoire pour calculer la latitude par la polaire avec l'astrolabe. Les navigateurs ne pouvaient obtenir la longitude par l'observation. C'est à peine si de très savants astronomes, par des méthodes compliquées, se risquaient, à terre, profitant de conjonctions d'astres et d'éclipses, à calculer une longitude, et leurs erreurs étaient souvent formidables. Amerigo Vespucci acquit avec l'astrolabe une notoriété qui lui fit dire en parlant de la latitude : Le quadrant astrologique me valut une pas petite gloire. Quant à la longitude — écrit-il le 4 juin 1501 — c'est une chose très autrement ardue et qu'entendent peu de personnes, excepté celles qui savent s'abstenir du sommeil et observer la conjonction de la terre et des planètes. C'est pour ces déterminations de longitude que j'ai sacrifié souvent le sommeil et raccourci ma vie de dix ans, sacrifice que je ne regrette pas dans l'espoir d'obtenir un renom pour des siècles, si je reviens sain et sauf de ce voyage. Ce manque de modestie ne doit pas étonner, car jadis on criait ses hauts faits pour les faire connaître. Personne n'y trouvait à redire. Maintenant, il est de bon goût de prendre des airs de violette, quitte à se rattraper par l'intermédiaire d'un tiers, quand on possède le moyen de faire parler les journaux. Rien ne nous permet, d'ailleurs, d'affirmer que cette satisfaction de lui-même, manifestée par A. Vespucci, était motivée en tant qu'astronome. Dans tous les cas, lorsque l'expédition de Magellan, quelques années après, eut atteint les Moluques par l'Ouest, des contestations s'élevèrent entre les Portugais et les Espagnols et l'on choisit vingt-quatre astronomes et pilotes pris dans les deux pays pour régler le litige par un calcul de longitude. Il y eut une conférence à Saragosse où l'on conclut qu'on ne pouvait trancher la question qu'à coups de canon ; heureusement, un compromis fut signé le 22 avril 1529. Pigaphetta, qui participa au premier voyage autour du monde, parle des différentes méthodes suivies pour chercher la longitude, mais reconnaît les difficultés qu'elles présentent ; il ajoute, ce qui sera notre conclusion, que les navigateurs et les pilotes se contentaient de connaître la latitude de leurs nouvelles découvertes et qu'ils étaient si orgueilleux qu'ils ne voulaient pas entendre des longitudes. Nous changerons orgueilleux en prudents et donnerons ainsi raison aux pilotes et navigateurs, rappelant finalement qu'en 1598, par conséquent un siècle après Colomb, une très sérieuse expédition batave, en voulant déterminer sa longitude par l'observation, fit une petite erreur de 500 lieues ! Il était donc raisonnable de s'abstenir. Actuellement on rectifie le point estimé par l'observation ; aux XVe et XVIe siècle, si on avait eu l'imprudence d'observer une longitude, on s'empressait de la vérifier et de la corriger par l'estime. Ainsi C. Colomb ne pouvait obtenir par observation que la latitude, et encore d'une façon approximative. La navigation se faisait donc à l'estime, rectifiée par une latitude observée chaque fois que cela était possible, et pour atterrir on choisissait à bonne distance le parallèle qui menait à destination et on le suivait jusqu'à l'arrivée ; c'est ce qui se fait encore de nos jours dans certains cas, lorsque les chronomètres sont avariés. En résumé, C. Colomb avait à sa disposition comme instruments : la boussole, l'astrolabe et surtout son dérivé, le quart de cercle, l'ampoulette d'une demi-heure, la sonde et presque sûrement le nocturlabe. Ses documents étaient : les éphémérides perpétuelles de la déclinaison du soleil, déduites des Tables Alphonsines, et une table permettant la résolution d'un triangle rectangle pour les calculs par l'estime. Enfin qu'avait-il comme cartes ? Les cartes de l'époque, utilisées pour la navigation, consistaient en une représentation très fictive des contours de la côte, puisqu'on plaçait les points importants de celle-ci sans se préoccuper de l'exactitude géographique, et uniquement de façon à savoir quelle route il fallait suivre au compas pour aller de l'un à l'autre. La carte marine, aux XIVe et XVe siècles, était établie sur deux axes formés par la ligne Nord-Sud et la ligne Est-Ouest. La surface même était partagée par des lignes équidistantes, parallèles à ces deux axes et constituant un treillis à mailles carrées dont les côtés valaient uniformément un certain nombre de milles ou de lieues. Au courant du XVe siècle, les lignes de latitude et longitude prirent la place des lignes équidistantes rectangulaires, en conservant la même disposition. A ces lignes rectangulaires s'ajoutaient des lignes obliques représentant les aires de la rose des vents. Une première rose des vents occupait le centre et chacun de ses rayons, en se prolongeant jusqu'aux limites de la carte, marquait la direction d'une aire de vent déterminée. D'autres roses de plus petites dimensions parsemaient la carte avec de semblables lignes partant de leurs différents rhumbs. De ce croisement de lignes résultait une sorte de canevas, le marteloïo (toile marine), le marteloire, qui est resté la caractéristique des cartes marines jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Les observations astronomiques n'entraient pour rien dans la détermination de la position des lieux marqués sur cette carte, et les distances qui les séparaient étaient supputées à l'estime, tout comme leurs situations respectives étaient indiquées par la boussole. La navigation pratiquée avait donné la carte, et celle-ci indiquait la route, ont dit très justement l'abbé A. Antheaume et le Dr Jules Sottas dans un remarquable travail où nous avons puisé de nombreux renseignements, tant sur cette question que sur celle du quadrant[6]. Pour aller d'un point à un autre, on choisissait la ligne rhumb de vent qui convenait pour faire la route projetée, tandis que les distances à parcourir étaient mesurées sur les échelles tracées sur un des côtés de la carte. L'ensemble, joint à des vues de côtes, constituait le Portulan. Il y en avait de nombreux, fort bien exécutés, pour la Méditerranée comme il y avait des cartes pour la mer Noire, l'Angleterre, les Flandres, les Canaries et les Açores ; quelques-unes avaient été également dressées pour représenter la mer Océane, mais elles étaient tout naturellement sans valeur réelle. Colomb, pour son expédition, ne disposait vraisemblablement que d'une reproduction du globe de Martin Behaim (qui d'ailleurs n'était pas une carte), de la carte que lui avait envoyée Toscanelli, et enfin de la sienne[7]. Il est fort probable que c'est de cette dernière dont il est question dans son journal de bord, mais on ne possédait jusqu'à présent aucune autre indication concernant cet important document. Or, le 4 avril 1924, M. de la Roncière, conservateur du département des imprimés de la Bibliothèque Nationale, faisait à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres une communication sur la découverte qu'il venait de faire dans les archives de la Bibliothèque Nationale. Il s'agissait d'une carte qu'il considérait comme étant celle dressée par C. Colomb, ou plus exactement sous sa direction, au moment où il se disposait à entreprendre le voyage qui aboutit à la découverte de l'Amérique[8]. Nous n'avions aucune raison pour ne pas nous incliner devant les preuves que donnait M. de la Roncière, établissant que cette carte était certainement inspirée par C. Colomb, et très probablement exécutée, sous sa direction, par son frère cadet Barthélémy qui n'était pas moins habile que lui en cosmographie et dans les arts qui en relèvent, comme dans la construction et la peinture des cartes marines, des sphères et autres instruments de cette sorte. De plus nous ne nous reconnaissions pas une compétence suffisante pour mettre en douté ces affirmations ; et l'idée que cette découverte, qui nous permettait de regarder et de toucher un document aussi émouvant, était due à la perspicacité d'un savant français, était trop séduisante pour que nous n'ayons pas plutôt tendance à appuyer qu'à infirmer ses arguments. Toutefois, nous nous croyions obligé, et cela dans l'intérêt même de la thèse soutenue par M. de la Roncière, de ne pas le suivre quand il prétendait que cette carte donnait entièrement raison à Henry Vignaud écrivant ceci : Colomb n'a jamais dit un mot de vrai sur ce qui le touche personnellement. Son grand dessein, né de méditations scientifiques sur la forme du monde, est du domaine de la légende ! et encore : Il sema ses écrits d'assertions inexactes, adroitement formulées, qui ont eu pour résultat de créer une sorte d'histoire conventionnelle de la formation de ses idées et des causes de sa découverte. Au contraire, il nous apparaissait clairement que si, comme nous le désirions, la carte présentée par M. de la Roncière était bien celle, ou une de celles, de Christophe Colomb, les affirmations de H. Vignaud étaient réduites à néant, alors que si elles étaient fondées, la carte en question n'avait plus du tout l'origine et la valeur qui lui étaient attribuées. En effet, tout en limitant notre discussion aux grandes lignes, nous remarquions par exemple que M. de la Roncière prenait comme preuve de tout premier ordre, en faveur de l'origine de cette carte, que des phrases entières retrouvées dans l'exemplaire de l'Imago Mundi du cardinal d'Ailly, conservé à la Colombine de Séville et annoté par Colomb, y étaient reproduites. Or, H. Vignaud, pour tomber Colomb, n'affirme-t-il pas que l'Amiral ne connut et n'annota le volume de Pierre d'Ailly qu'après sa découverte, c'est-à-dire postérieurement à 1494 ?[9] M. de la Roncière nous disait aussi que cette carte avait été dressée sûrement entre 1488 et 1492 et vraisemblablement par Barthélémy. Or, H. Vignaud nous affirme encore que Colomb ne revit son frère Barthélémy qu'à son retour, en 1494, après une séparation de dix ans ! et il n'y a entre 1488 et 1494 que six années. Mais quelque chose nous frappait davantage. M. de la Roncière, avec une très grande habileté, avait fait réapparaître sur cette carte les contours et le texte effacés concernant Antilia ou l'île des Sept Cités, cette île mystérieuse où sept évêques portugais, cherchant asile avec leurs ouailles lors de l'invasion musulmane, auraient fondé chacun une cité et brûlé leurs vaisseaux pour s'interdire tout esprit de retour ; cette île, suivant la tradition, aurait été retrouvée au temps de Henri le Navigateur par un navire portugais, et tellement riche, que la légende de la terre mêlée d'or pur était née. M. de la Roncière écrivit alors, toujours influencé par H. Vignaud : Antilia ou l'île des Sept Cités, tel était donc, indiqué sur la carte, presque dans les mêmes termes que sur ses mémoires, le but secret de l'expédition de Christophe Colomb, d'où le nom des Antilles ! Mais M. de la Roncière ne nous disait-il pas lui-même, (ce qui se voit d'ailleurs sur cette carte), que l'île est portée au large et à une grande distance de l'Irlande, au delà d'une île du Brésil ?... Or, pour l'atteindre, il eût fallu que C. Colomb, en quittant Palos de Moguer, fît route NW., tandis qu'il se dirigea au Sud-Ouest pour gagner les Canaries, puis de là mit le cap franchement à l'Ouest ! Si réellement son but secret était l'île des Sept Cités, M. H. Vignaud aurait raison de le traiter de marin sans expérience ; nous croyons préférable de considérer que cet américaniste se trompe, d'autant plus que ses propres connaissances maritimes, comme nous l'avons déjà remarqué au sujet des caravelles, sont certainement rudimentaires[10] ; elles le sont encore en ce qui concerne les routes et les caps qu'elles comportent, puisqu'il nous parle du Sud-Ouest-quart-Sud-Ouest[11], rhumb de vent que nous ignorons totalement et qui ne peut même pas être expliqué par la traduction erronée d'un texte étranger. Ne dit-il pas aussi que lorsque Colomb eut exposé ses projets, vers 1483 ou 1484, au roi Jean de Portugal et que celui-ci, clandestinement, envoya un navire à la recherche des terres promises, ce bâtiment porta également ses investigations dans le SW.[12], ce qui, avouons-le, était une singulière façon de vouloir trouver une île portée dans le NW. ? .Puisque H. Vignaud avait tort, c'était donc bien la carte de C. Colomb que M. de la Roncière avait retrouvée. Nous nous réjouissions de ce que ce document remarquable figurât dans nos collections nationales, et de connaître ce complément du bagage de navigation de l'Amiral des Océans. C'est donc avec une très grande satisfaction que nous avons vu M. de la Roncière, continuant ses recherches, ne pas hésiter, en véritable savant, à revenir sur ses premières affirmations, abandonner les accusations portées si légèrement par H. Vignaud sur C. Colomb, et même les réduire à néant. Il assoit maintenant sa belle découverte sur des preuves qui paraissent irréfutables, et tout dernièrement encore il rappela, un texte de 1479 en main, que C. Colomb était voyageur de commerce en sucre pour la maison génoise Centurione. Or, aux îles du Cap Vert — en italien Capo Verde et découvertes par un Génois — la légende de la carte dit : C'est ici qu'on trouve la meilleure des cannes à sucre. L'humble tisserand avait repris les directives de la puissante maison de Gênes, concernant la recherche d'une route vers le pays des épices et de l'or, et c'est avec raison que le savant archiviste écrit que cette carte consigne l'histoire de la vie de Colomb ; seule de celles de l'époque elle présente les caractéristiques que donnait de ses cartes le Génois : une sphère et une légende relative aux flottes de Salomon. La sphère est tracée d'après des livres de chevet et la légende de la carte est la reproduction, solécisme compris, d'une de ses phrases[13]. Le 6 août, une avarie survint au gouvernail de la Pinta ; elle fut réparée tant bien que mal par des moyens de fortune, et le 12 août dans la nuit, après avoir atterri à l'île Gomère, les caravelles se rendirent à la grande Canarie. En passant, C. Colomb nota sur son journal de bord que le volcan de Ténériffe était en activité, donnant ainsi la première date certaine d'une éruption de ce pic. Il est vraisemblable que les navires entrèrent dans la magnifique rade de la Luz, la seule réellement bonne de l'archipel. C'est là que furent exécutées différentes réparations, entre autres celles du gouvernail de la Pinta, et des mises au point comme la reprise de quelques coutures mal calfatées, nécessitées par un travail volontairement ou involontairement saboté. V. Y. Pinzon profita du temps qu'elles prirent pour modifier le gréement de sa Niña. Cette escale dura vingt-quatre jours et enfin le plein d'eau douce ayant été fait, les vivres complétées, la Santa Maria, la Pinta et la Niña appareillèrent le 6 septembre pour la Grande Aventure, mettant le cap à l'Ouest. La vie à bord. La vie à bord était réglée avec une sévère discipline. La description que nous avons donnée des locaux, dispositifs, etc. permet de se l'imaginer, mais quelques détails sont encore nécessaires. Il est fort probable que le service se faisait déjà par quarts, de quatre heures en quatre heures, le premier allant de 8 heures à midi, et il est à peu près certain que les hommes étaient partagés en deux bordées dont chacune était de quart à son tour. Les heures étaient comptées au sablier ; au premier quart du jour, les pages, en retournant l'ampoulette, récitaient l'Ave Maria et chantaient le Bonjour : Bénis soient la Lumière Et la Sainte Croix, Le Seigneur de la vérité Et la Sainte Trinité, Bénis soient notre âme Et le Seigneur qui nous la donna, Bénis soient le jour Et le Seigneur qui nous l'envoie. Puis tout le monde reprenait : Pater Noster, Ave Maria, Amen, et terminait en s'écriant : Dieu nous donne un bon jour, un bon voyage, une bonne traversée ! ! Aux changements des autres quarts on chantait : Les heures qui s'en vont furent bonnes, Que celles qui viennent soient meilleures encore ! Mais si les unes furent bonnes et que les autres soient mauvaises, Elles pourraient toujours être pires si Dieu le voulait ! Tandis qu'elles passent que le voyage soit bon. Veille devant et bon quart ! La diminution ou l'augmentation de voilure, nous l'avons vu, s'accompagnaient d'invocations à Marie Mère de Dieu et les prières étaient d'ailleurs très fréquentes. Le samedi, elles étaient récitées devant la statuette de la Vierge placée à l'entrée du château arrière, et en toutes occasions, moments de péril ou de victoire, découverte d'une terre, le Gloria in excelsis Deo, le Te Deum Laudamus, le Salve acostrumbrada étaient entonnés par tout l'équipage. A ce propos, le père Guevara s'écrie : Il y a 32 rhumbs de vent au compas, mais hélas ! l'équipage a aussi 32 tons différents pour chanter les prières et le résultat est affreux ! A la fin de la journée, les deux autres navires devaient, si le temps le permettait, passer à poupe de la nef de l'Amiral, rendre compte brièvement au porte-voix et prendre les ordres pour la nuit et le lendemain. Au crépuscule, le grumète chargé de veiller le sablier chantait : La garde est appelée, L'ampoulette tourne, Nous vous souhaitons bon voyage Si Dieu le veut. et on allumait dans la bitacora le fanal qui devait éclairer le compas. Cette lumière était, nous le répétons, la seule autorisée à bord, exception faite de celle qui brûlait dans la lanterne de poupe du navire Amiral. Lorsque la polaire apparaissait dans le ciel, le pilote, qui, en somme, était le navigating officer, vérifiait le compas en prenant un relèvement de cette étoile. Pour cela, il se tenait debout sur le pont, la boussole à côté de lui, et avec sa main droite ouverte, la paume tenue verticale au bout du bras tendu, il coupait à différentes reprises dans l'espace un plan fictif qui comprenait la polaire et passait par un rhumb de vent de la carte du compas. Ce geste répété plusieurs fois par cet homme important, debout et grave, était pittoresquement connu par l'équipage sous le nom de bénédiction du pilote. Ce moyen très simple de prendre un relèvement quelconque est encore fréquemment utilisé de nos jours par des voiliers pêcheurs qui ne possèdent pas d'alidades sur leurs compas, et se tirent ainsi merveilleusement d'affaire. Au premier quart de nuit, on chantait le Bonsoir : Bénis soient l'heure où naquit le Seigneur, Sainte Marie qui l'enfanta, Saint Jean qui le baptisa. Pater Noster, Ave Maria, Amen. Dieu nous donne une bonne nuit, un bon voyage, une bonne traversée ! Les hommes, nous le savons, couchaient à plat pont tout habillés sous la tolda afin d'être parés à la manœuvre, si elle exigeait l'intervention des deux bordées. A minuit, tout comme le veilleur de nuit, des villes et villages d'Espagne, le grumète de quart psalmodiait : La media de la noche... sereno ! En proie à l'insomnie, ou agités dans leur sommeil par les cauchemars, les plus braves des matelots étaient hantés par les épouvantes légendaires revenant avec les heures sombres — la Main Noire, qui est celle du diable, le Kraken, tête de cerf hideuse, aux cornes immenses et tentaculaires, interprétation monstrueuse d'une pieuvre géante — et bien d'autres..., au jour levant, le calme renaissait dans les cerveaux, les terreurs se dissipaient, et cependant les phénomènes naturels devaient se montrer aussi étonnants et plus troublants encore que les légendes. Le magnétisme terrestre. On savait depuis Peregrinus, en 1269, que la direction de l'aiguille du compas ne coïncidait pas exactement avec le relèvement de la polaire, et cet écart fut nettement indiqué sur une carte de Andrea Bianco en 1436. A l'époque de Colomb, l'angle ainsi formé était évalué à environ 160 à l'Est, mais il était considéré comme absolument normal et invariable. Or, le 13 septembre au soir, par 28° de latitude N. et environ 28° de longitude W. (Greenwich), on s'aperçut, sur les caravelles, que cet angle était devenu plus petit ; le lendemain matin, en relevant l'étoile polaire avant sa disparition, on constata qu'il avait encore diminué ! Ce phénomène alla en s'accentuant et il devint évident que l'aiguille déviait vers le Nord-Ouest (nordouestaban) ! A l'effroi des pilotes, toutes les boussoles consultées donnèrent le même résultat. Les équipages devinrent tristes et inquiets, le mot de retour dut être prononcé. Colomb ne fut pas le dernier à s'étonner et à s'alarmer, mais avec son esprit positif et cet amour inné de la science que l'on ne saurait trop mettre en relief, il vit qu'il s'agissait là d'un phénomène angoissant et cependant naturel. Le plus pressé était de rassurer pilotes et matelots, ce qu'il fit avec une rare ingéniosité sur laquelle ses détracteurs préfèrent garder le silence. La plupart des pilotes ignoraient que la polaire décrit dans l'espace un petit cercle de 2° et quelques minutes autour du pôle, mais Colomb le savait, et il fit relever cette étoile à l'aube, au moment où elle se trouvait le plus à l'Ouest. La déviation, sans être annulée, était ainsi diminuée et l'Amiral affirma que ce qui se passait devenait fort simple ; les aiguilles ne faisaient que suivre la polaire qui, elle, se mouvait, mais elles étaient toujours bonnes et conservaient leurs qualités de directrices. Pourtant lui-même ne croyait pas à cette explication, et influencé par la philosophie des stoïciens qui prédominait à cette époque où le terrain expérimental était bien peu exploré, il admet et recherche les sympathies et les antipathies de tous les corps de l'univers, invoque la douce température de l'air, la propriété des quatre points cardinaux, etc. Toutefois, observateur inné, il continue à marquer avec le plus grand soin les déviations observées sur la boussole et, marin averti, il modifie sa route en conséquence, tenant compte de cet angle mystérieux. Quand désormais nous entendrons affirmer que Christophe Colomb était un marin médiocre et un chef sans grande valeur, nous devrons nous contenter de hausser les épaules. De jour en jour, la déviation de l'aiguille vers la gauche s'accentuait ; à 100 lieues de l'île Florès, le 17 septembre, elle marquait exactement le Nord ; puis de NE. qu'elle était au départ, elle devint NW., bientôt, le 19 par 28° 20' de latitude Nord et 39° environ de longitude Ouest (Greenwich), elle atteignit un quart de vent au NW., c'est-à-dire 11°, et cet écart alla en s'augmentant. Colomb, pendant toutes ses navigations ultérieures, ne cessa, tant à l'aller qu'au retour, de noter avec le plus grand soin l'angle formé par la direction de l'aiguille avec le relèvement de la polaire, c'est-à-dire le Nord vrai. Le 13 septembre 1492 il avait tout simplement découvert la déclinaison magnétique. Cette découverte, non seulement ouvrait un champ nouveau aux recherches scientifiques, mais encore tournait une page dans l'art de la navigation. Désormais, la direction donnée par l'aiguille aimantée ne devra plus être considérée comme immuable, il faudra que les marins tiennent compte des écarts plus ou moins grands qu'elle peut faire avec le Nord vrai. Il est inutile d'insister sur les erreurs de route qui résulteraient d'un manquement à cette nécessité, et on peut se demander où Colomb aurait atterri s'il n'avait pas chaque jour et avec soin observé la polaire, ce que lui permettait le ciel clair de la région qu'il traversait. La déclinaison est l'angle fait par l'aiguille du compas soit à l'Est, soit à l'Ouest, sous l'influence du magnétisme terrestre. A l'époque de Colomb on savait qu'une masse de fer dans le voisinage de la boussole faussait celle-ci, que l'homme qui en approchait pour prendre la barre devait se débarrasser du couteau qu'il portait ; mais, tant que les navires furent construits presque exclusivement en bois, le seul écart sensible était celui de la déclinaison[14]. Plus tard, avec les constructions composites et surtout en fer, il fallut tenir compte de la déviation du compas, qui est l'angle fait, soit à l'Est soit à l'Ouest, avec le Nord, sous l'influence du magnétisme du navire La combinaison de la déclinaison et de la déviation, quand celle-ci existe, est connue sous le nom de variation. Mais, nous le répétons, Colomb et pendant longtemps les navigateurs qui lui succédèrent, n'avaient à se préoccuper que de la déclinaison magnétique qui constituait seule la variation. Colomb découvrit donc sans conteste la déclinaison et observa qu'elle variait sur les différents lieux de la terre, et qu'elle changeait de nom après avoir passé par un moment où l'aiguille marquait le Nord vrai ou 0°. Or, comme il retrouva le même phénomène tant à l'aller qu'au retour, bien qu'il naviguât à des latitudes différentes, il en conclut que le passage à 0° se produisait sur un méridien. Dans ses expéditions ultérieures le fait fût vérifié à nouveau, et de ses remarquables observations on a pu déduire plus tard que la ligne sans déclinaison était, à cette époque, orientée du NE. au SW., constituant le méridien magnétique 0°, et passant près de l'île Florès et entre l'île Margharita et le cap Codera. Mais Colomb croyait à l'immutabilité des lignes d'égale déclinaison ; il se réjouissait même d'avoir ainsi trouvé un moyen remarquable et simple de connaître sa longitude, et cette opinion, ses observations ayant été vérifiées par les navigateurs qui suivirent la même route que lui, fut partagée par savants et marins. Cependant il fallut bientôt reconnaître, non seulement que ce procédé était inutilisable, mais encore que le phénomène signalé par Colomb compliquait la navigation au lieu de la simplifier. Georges Hartmann, vicaire de l'église Saint-Sebaldus à Nuremberg, qui construisit un nombre considérable de cadrans solaires munis de boussoles, reconnut en 1510 que la déclinaison était de 6° Est à Rome et de 10° Est à Nuremberg, mais c'est surtout après que Mercator, en 1540, eut établi la différence de déclinaison simultanée dans deux lieux du globe, Dantzig et Walcheren, qu'on commença à étudier sérieusement la déclinaison. Si la cause même des phénomènes magnétiques reste encore bien obscure, on sait maintenant qu'elle présente dans tous les lieux du globe une variation séculaire, et comme il faut que les navigateurs en tiennent compte, on s'efforce de donner ces variations avec le plus d'exactitude possible. On sait également, mais ces variations n'intéressent pas la navigation habituelle, qu'il y en a d'annuelles (l'amplitude étant plus grande au solstice d'été, plus petite au solstice d'hiver), et même de diurnes (minimum vers l'Est vers 8 heures, maximum vers l'Ouest vers 13. h. 30). Toutes les cartes servant à la navigation portent la déclinaison donnée pour l'année de l'impression, avec l'augmentation ou la diminution annuelle ; sur les cartes routières embrassant une grande étendue, on trace les lignes isogones ou d'égales déclinaisons. Ces lignes aboutissent aux pôles magnétiques, qui, tout en se trouvant dans les régions polaires, n'ont rien à faire avec les pôles géographiques. Sans vouloir entrer dans de plus grands détails, il est intéressant de noter que nous connaissons maintenant les variations séculaires de la déclinaison à Paris depuis 1540. De 1540 à 1640 elle était NE. et atteignit un maximum Est en 1580 ; en 1640 elle était nulle, c'est-à-dire à 0°, puis devint NW. et atteignit son maximum Ouest en 1820 ; depuis cette époque elle diminue et redeviendra nulle (c'est-à-dire 0°) vraisemblablement vers 1980, pour revenir ensuite au NE. Remarquons incidemment que si, en 1493, la déclinaison magnétique, sur le trajet d'Espagne aux Antilles suivi par Colomb, avait été comme maintenant — c'est-à-dire toujours de même nom et NW. le phénomène eût été beaucoup moins frappant, et sans passer inaperçu, aurait pu ne pas retenir autant l'attention du grand navigateur. Ceci n'enlève rien au mérite de Colomb et on ne saurait trop répéter qu'il découvrit lui-même la déclinaison magnétique, ce qui fut d'une importance singulière, non seulement pour la pratique de la navigation, mais pour la science et la physique du globe. La portée de cette découverte a été mise en valeur, en même temps que l'explication du passage où C. Colomb la rapporte, par A. de Humboldt qui, dans son examen critique de la géographie du Nouveau Continent, a jeté de si grandes lumières sur l'histoire des sciences astronomiques au commencement de l'époque moderne. En terminant une étude des plus intéressantes, sur laquelle nous reviendrons pour montrer comment le méridien e a pu influencer le partage des terres océaniques entre l'Espagne et le Portugal, M. L. Lagrange[15], professeur à l'Ecole militaire de Belgique, dit avec raison : Colomb fut un des premiers adeptes de la philosophie expérimentale et à ce titre comme à celui de révélateur d'un nouveau monde, il a droit à tout notre intérêt et à toute notre admiration. La Mer des Sargasses. Nous avons déjà signalé que l'une des terreurs de la navigation dans l'océan ayant persisté jusqu'à l'époque de Colomb était celle de la mer gluante et couverte d'herbe. Cette appréhension était rationnelle, puisque des algues en abondance remarquable avaient été fréquemment rencontrées par les marins de tous les temps qui s'étaient aventurés à l'Ouest des Açores. L'exagération et l'imagination jouant leur rôle, la légende avait été créée. Les vieux marins d'alors ressemblaient singulièrement aux vieux marins d'aujourd'hui, survivants de la navigation à voile, qui nous parlent du temps de leurs pères et préfèrent l'extraordinaire à l'explication scientifique ; ils faisaient frissonner les grumètes en racontant que les herbes enserraient les navires, immobilisés par le calme absolu comme dans les mailles d'un filet, que la mer se coagulait et devenait une boue chaude et visqueuse. Si, disaient-ils, un tel avait pu échapper miraculeusement pour raconter la chose à un aïeul, par contre tel, tel ou tel navire, dont il n'était plus question, avait certainement disparu dans ces dramatiques circonstances ; le récit de l'un se renforçait par le témoignage des autres, qui, sincères d'ailleurs, ne voulaient pas rester en arrière dans le domaine de l'information merveilleuse. Or, le 16 septembre, à 900 milles environ des Canaries, par 28° de latitude Nord et 35° de longitude Ouest (estimée), les caravelles de Colomb naviguent, nous dit-il lui-même, au milieu de paquets d'herbes marines très vertes... Mais Colomb ajoute que l'air était tempéré, doux, exquis comme celui de l'Andalousie en avril, qu'il ne manquait que le chant du rossignol. Il écrit encore que ces paquets d'herbes marines étaient détachées depuis peu de temps de la terre, ce qui fit croire à tous que l'on était près de quelqu'île. Ces conditions physiques agréables, la perspective d'une découverte, vraisemblablement aussi la calme assurance de l'Amiral qui, religieux et même mystique, n'était pas un superstitieux et cherchait à expliquer les apparences surnaturelles par l'observation des phénomènes naturels, suffirent, sinon à détruire complètement la légende, tout au moins à en écarter la terreur. Colomb lui-même savait qu'il devait rencontrer ces espaces couverts d'herbes. La caractéristique de son œuvre est le soin minutieux qu'il prit aux préparatifs de son expédition et son souci d'information. Sa documentation devait donc être riche à, ce sujet, et nous savons qu'étant au couvent de la Rabida, Vasquez de la Frontera, un pilote réputé de Moguer, lui parla d'un voyage de découverte fait au service du Portugal dans l'Atlantique, voyage qui échoua parce qu'on n'osa pas s'engager dans des bancs de Sargasses qui entravaient la route. Sans doute était-il également au courant des écrits laissés par les anciens à ce sujet et sur lesquels nous reviendrons bientôt. Mais personne encore n'avait pu raconter ce qui se passait dans cette région et si elle avait un au-delà. Le 17 septembre, les herbes, écrit Colomb, sont en bien plus grandes quantités. On en vit beaucoup et très souvent ; c'était de l'herbe des rochers ; elles venaient du couchant... dès le matin, on en vit en abondance et elles paraissaient provenir de quelque rivière. On trouva dans ces herbes un cangréjo vivant que Colomb conserva. Chalumeau de Verneuil traduit cangréjo par écrevisse, c'est évidemment une erreur ; il s'agissait d'un crabe, probablement le nautilo grapsus minutus, très abondant dans la mer des Sargasses. Ce jour-là on prit aussi des thons. Le 19, C. Colomb sonda, croyant se trouver près d'une terre d'où provenaient ces algues et avec 200 brasses de ligne filées ne trouva pas de fond. Le 21, par 28° de latitude Nord, et 48°20' de longitude W. l'accumulation de sargasses devint si considérable que la mer paraissait coagulée. Christophe Colomb note avec le plus grand soin les aspects divers de la mer de varech, la forme des algues, les animaux qui s'y trouvent. Il distingue parfaitement les Sargasses des algues côtières des Açores. Le 3 octobre, il est frappé du mélange des sargasses mortes et des sargasses fraîches, garnies de flotteurs qu'il prend pour des fruits Herba muy vieja, otra muy fresca que trais como fruta. Il s'étonne de rencontrer des espaces d'eau libre entre les accumulations de fucus. Ce n'est que le 8 octobre que les herbes cessèrent, vraisemblablement par 72°20' de longitude W. Christophe Colomb avait donc osé, le premier, poursuivre une navigation dans la région des herbes et l'avait traversée. C'est également lui qui donna le premier sur son compte des notions précises, tout en dissipant les légendes qui s'y rattachaient. Au retour de sa première expédition, il retrouva cette mer des Sargasses et profita de toutes les occasions pour noter avec le plus grand soin ce qu'il observait. C'est ainsi que le 18 janvier il écrit qu'étant hier dans les herbes, la mer fut couverte de thons et on crut qu'ils devaient aller de là dans les madragues du duc de Corail, et le 2 février : la mer est si coagulée d'herbes marines que si je n'avais déjà vu ce phénomène, j'aurais craint de me trouver sur un bas fond. On ne rencontre plus d'algues du 3 au 6 février, mais elles reviennent abondantes le 7 pour disparaître complètement à l'approche des Açores vers le 10. Dans les traversées de retour de ses deuxième et quatrième voyages, il traverse encore la mer des Sargasses et dans les autres il en voit la banlieue. En octobre 1498, il écrit aux souverains d'Espagne que chaque fois qu'il allait d'Espagne aux Indes, à cent lieux à l'Ouest des Açores, il trouvait un changement dans le ciel, les étoiles, la température de l'air et de l'eau, et la mer tellement couverte d'une herbe qui ressemble à de petites branches de pin chargées de lentisques (pistachiers) que nous pensions, à cause de l'épaisseur de l'algue, être sur un bas-fond et que les navires viennent à toucher par manque d'eau. Don Fernand, fils de C. Colomb, dans sa Vie de l'Amiral, écrit que les marins virent vers le Nord, aussi loin que portait la vue, une accumulation d'herbes marines qui, tantôt leur faisait plaisir, parce qu'ils croyaient être près d'une côte, et tantôt leur inspirait des craintes. Il y en avait des masses si épaisses qu'elles entravaient jusqu'à un certain point la navigation. Ces quelques citations suffisent pour montrer quel fut le rôle de Colomb, et Louis Germain a parfaitement raison lorsqu'il assure, dans une remarquable étude[16], que la découverte de la Mer des Sargasses se confond avec celle de l'Amérique. Elle est due, comme celle du Nouveau Monde, à l'idée si répandue dans l'antiquité et le moyen âge qu'il existait, au delà de l'Océan, des terres où l'on parviendrait en naviguant vers l'Ouest. En empruntant à ce travail très documenté, nous pouvons résumer par la suite les principales connaissances des époques antérieures à C. Colomb sur cette mer d'herbes. De même que les anciens parlaient des terres transocéaniques où peut-être les Phéniciens, les Grecs, les Carthaginois et les Arabes avaient abordé, ils parlaient de la mer d'herbe et de la mer coagulée, qui, elle, avait été sûrement vue par des navigateurs de ces nationalités. Dans le Périple de Scylax de Caryande composé probablement
au temps de Darius Ier, il est dit qu'on ne peut
naviguer au delà de l'île de Cerné, car la mer est embarrassée par de la vase
et des herbes. Les Carthaginois de Gadès, naviguant au delà des
colonnes d'Hercule et poussés par un vent d'Est, constatent que la mer est
pleine de varech et y trouvent des thons en abondance qui, salés et enfermés
dans des vases, sont expédiés à Carthage. Le Carthaginois Hamilcon, dont le voyage est raconté par Festus Avienus, dit que dans l'Ouest et le Nord-Ouest de l'Atlantique il y a des algues nombreuses au-dessous des flots qui, par entrecroisement, forment mille obstacles. Aucun souffle ne pousse le navire en avant. Les flots restent immobiles et paresseux. Des algues sont semées en quantité innombrable sur l'abîme, et souvent elles arrêtent la marche des vaisseaux qu'elles retiennent comme avec des joncs. Avienus ajoute que ces algues diminuent la violence des vagues, effet plusieurs fois confirmé dans la suite et qui a dû contribuer à la croyance de la mer stagnante et gluante. Strabon constate comme les Carthaginois de Gadès et ; plus tard, Christophe Colomb, l'abondance des thons dans ces parages, et attribue la graisse très estimée de ces poissons à leur nourriture provenant d'un chêne dont les racines sont au fond de la mer et dont le feuillage porte de gros fruits. Théophraste écrit que l'algue croît dans la mer qui s'étend au delà des Colonnes d'Hercule et atteint des proportions gigantesques. Il distingue le fucus des côtes du fucus du large, c'est-à-dire la sargasse. En ce qui concerne les premiers siècles de l'ère chrétienne, Jornandès, historien des Goths, dit que si les régions lointaines de l'Océan ne sont pas connues, c'est parce que les algues arrêtent la marche des vaisseaux et que les vents n'ont pas de force. Mais les Arabes, grands et habiles navigateurs, voguaient sur la Mer Ténébreuse ; le géographe Edrisi a conservé le récit des huit Arabes, tous de la même famille, qui partis d'Aschbona (Lisbonne) à une époque antérieure à 1147, naviguèrent dans une mer épaisse, au large des Açores et au travers des herbes marines. Au XIIIe et au XIVe siècles, tous les navigateurs qui vont à la recherche d'Antila, des Sept Cités, de toutes les îles de Saint-Brandan, parlent des herbes qui recouvrent la mer à l'Ouest des Açores, leur point de départ habituel, et ce sont évidemment ces herbes qui entretenaient la croyance de la proximité de la terre. Ces connaissances que n'ignorait pas C. Colomb, ainsi que toutes celles plus récentes qu'il avait pu recueillir, ne semblaient pas faites pour encourager un navigateur ordinaire, mais l'Amiral des Océans devait prouver une fois de plus qu'il était un homme extraordinaire, et le voile mystérieux qui cachait la mer des Sargasses fut levé par lui. Il fallut cependant encore des siècles pour l'arracher définitivement et, de nos jours, cette région reste fertile en découvertes. Ce n'est que petit à petit que des notions précises vinrent compléter les remarquables observations de celui qui voulait connaître les secrets de la nature d'icy bas. Nous avons vu que Colomb sonda le 19 septembre 1493 et ne trouva pas de fond avec 200 brasses ; beaucoup des marins qui le précédèrent ou le suivirent sondèrent également sans plus de succès. Gonneville, en 1504, remarqua que la mer des Sargasses est si profonde que la sonde n'y trouve pas de fond : Jean de Léry, en 1555, fit la même constatation en employant une ligne de 500 aunes, c'est-à-dire 585 mètres. Cependant, comme nous l'avons déjà vu, des brisants, des vigies, des bas-fonds, voire même des îles figurèrent longtemps comme certaines, puis comme possibles, sur des cartes d'où elles ne disparurent qu'en 1860. Les premiers sondages vraiment scientifiques furent effectués en 1851 et 1852 par Lee sur le Dolphin, puis en 1855 par Leps sur le Méléagre, qui trouvèrent de grands fonds. Le Challenger, le Talisman en 1883, le Prince de Monaco sur la Princesse Alice en 1905, tranchent la question et reconnaissent un fond moyen de 4.000 mètres avec un minimum de 2.670 et un maximum de 7.000 mètres. Rennell, Alex. de Humboldt et Maury ont assigné des limites variables à la mer des Sargasses, mais on est à peu près d'accord aujourd'hui pour la comprendre entre 20° et 35° de latitude Nord, 35° et 75° de longitude Ouest et la considérer comme une vaste ellipse irrégulière au milieu de l'Atlantique, d'une superficie de 60.000 milles carrés ; les sargasses forment à sa surface des touffes plus ou moins étendues et serrées, séparées par des espaces de deux à trois mètres carrés d'eau libre, ou peuvent être au contraire clairsemées. Oviedo, en 1547, en donne une bonne idée générale en la comparant à une surface de lac garnie de plantes aquatiques. L. Germain, auquel nous empruntons ces détails, nous apprend que, contrairement à l'opinion courante, ces algues ne proviennent ni des côtes des Antilles ni de celles du continent américain Elles constituent une espèce spéciale que l'on ne rencontre que là, le Sargassum bacciferum. Voisines des fucus, leur appareil végétatif ou thalle est une longue tige portant des appendices foliacés et des vésicules rondes, pleines d'air et servant de flotteurs (raisins des tropiques). Les organes reproducteurs n'ont pas été trouvés et ces plantes se développent uniquement par bouturage naturel. La mer des Sargasses était généralement considérée comme formée par des algues, peut-être modifiées mais provenant d'une origine littorale, accumulées dans une zone de calmes et encerclées par des courants ; le savant que nous venons de citer, le professeur L. Joubin et Ed. Le Danois veulent que les sargasses flottantes soient les derniers débris des ceintures littorales d'un vaste continent disparu, l'Atlantide, et qu'elles végètent ainsi depuis un temps immémorial[17]. Pour ces auteurs, l'Atlantide de la période éocène joignait l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, au Nord de l'Afrique et au Sud de l'Europe. L'Atlantide miocène devint un continent vaguement trapézoïdale qui s'étendait des Bermudes aux Açores et aux îles du Cap Vert, et recouvrait la mer actuelle des Sargasses. A l'aurore du pléistocène, l'Atlantide n'est plus qu'un chapelet d'îles clairsemées, et une dernière commotion marquera sa disparition finale par la séparation des Canaries et de l'Afrique. C'est à cette Atlantide que Platon fait allusion dans les écrits célèbres du Critias et du Tinée[18] et parlant de l'Océan qui la recouvre, il écrit : Par cette raison aussi, la mer qui se trouve là n'est ni navigable, ni reconnue par personne, puisqu'il s'y est formé peu à peu un limon, provenant de cette fie submergée. Sans entrer dans les détails, que le lecteur curieux retrouvera avec intérêt dans le texte même de MM. Germain, Joubin et Le Danois, nous nous contenterons d'indiquer que les arguments qu'ils invoquent s'appuient sur l'analogie des faunes et des fossiles rencontrés à Madère, aux Açores, aux Canaries, au Cap Vert et un peu en Europe, aux Antilles et en Amérique centrale, mais pas du tout en Afrique équatoriale. Ils font également ressortir que les animaux que l'on retrouve vivants dans les sargasses sont essentiellement des individus de la faune littorale, Planaires, Nemertes, Bryozoaires, Crabes, etc. Tous ces animaux, comme le Nautilus grapsus minutus, conservé par Christophe Colomb, sont, avec les sargasses elles-mêmes, d'une espèce spéciale et sans affinités immédiates avec celles du littoral américain ou européen. C'est également dans la mer des Sargasses qu'on trouve le seul insecte marin connu, un hémiptère, l'Hallobathes Wullerstorf fi, qui court à la surface de l'eau comme les Hydromètres de nos lacs et rivières. Les très beaux travaux du célèbre biologiste et océanographe danois J. Schmidt ont prouvé que les anguilles de nos rivières accomplissent pendant six mois, sur le fond de l'Océan, le long voyage de nos côtes jusqu'à la région des Sargasses, pour se reproduire sous cette mer. Nos anguilles, disent MM.
Germain, Joubin et Le Danois, sont les descendantes
des anguilles tertiaires qui peuplaient le littoral et les estuaires des
fleuves de la côte Nord-Ouest du continent -Atlantide, plus particulièrement
dans la région où se trouvent actuellement les Bermudes. Par suite de
l'effondrement de- l'Atlantide de l'Ouest vers l'Est, ces anguilles ont
reculé vers l'Europe ; mais par habitude héréditaire, elles ont continué,
pour se reproduire, à se rendre dans les eaux traditionnelles, dans ces eaux
devenues mer des Sargasses, en faisant de siècle en siècle un voyage de plus
en plus long à mesure que l'effondrement de l'Atlantide s'accentuait. Enfin, les courants actuels auraient été créés à l'époque miocène de l'Atlantide et suivraient encore son ex-contour, qui est celui de la mer des Sargasses. Si l'hypothèse, d'ailleurs séduisante, de MM. Germain, L. Joubin et Le Danois est fondée, Christophe Colomb mériterait encore bien plus son titre de Descubridor, puisqu'en explorant la mer des Sargasses, avant de découvrir un Nouveau Continent, il aurait retrouvé l'Atlantide, le plus ancien des continents disparus ! Les Vents alizés. Donc, malgré les incartades de la boussole, malgré les herbes de la mer visqueuse, les trois caravelles poursuivent leur route et les milles transformés en lieues se succèdent et s'additionnent. Le journal de bord de Christophe Colomb, résumé par Las Casas, nous apprend que le 9 septembre, l'Amiral se décida à compter moins de lieues qu'il ne faisait afin que les gens de son équipage ne s'effrayassent pas et ne perdissent pas courage, si le voyage venait à être de long cours. A partir de ce jour, on lit à chaque instant que tant de milles furent parcourus, mais que seulement tant furent comptés, et le mercredi 25, il est écrit qu'Il (Christophe Colomb) feignait toujours en présence de l'équipage qu'on faisait peu de chemin afin que le voyage ne lui parût pas aussi long. A cet effet, l'Amiral en écrivit une double supputation, la moindre fut la supposée et la plus haute la véritable. Cette mesure était excellente et elle a généralement été jugée telle par tous les chroniqueurs. Cependant, un des détracteurs systématiques de C. Colomb s'élève avec violence contre ce procédé, s'écriant qu'il n'est pas coutume que ce soit l'Amiral qui fasse le point tous les jours... Il n'aurait pu tromper ainsi chaque jour ses officiers. Il est difficile de croire que les capitaines de la Pinta et de la Nia se soient livrés à la même supercherie ![19] La violence de cette sortie est si puérile, que nous ne nous serions pas donné la peine de la relever, si elle ne prouvait mieux que toutes les discussions à quels écarts de bon sens peut amener la passion du dénigrement. D'abord, les capitaines de la Pinta et de la Niña auraient eu tout à fait tort de ne pas se livrer à la même supercherie, car elle constituait une remarquable précaution ! De plus, le livre de bord de Colomb prouve qu'elle fut utilisée jusqu'au bout de la traversée ; or, nous savons que le soir avant le coucher du soleil, chaque fois que le temps le permettait, les deux caravelles correspondaient à la voix avec la Santa Maria, et les trois navires se donnaient évidemment leur point, comme cela s'est toujours fait pour des bâtiments naviguant de conserve ; il y eut même des communications par embarcations, de sorte que si les capitaines n'avaient pas été d'accord, cette supercherie n'aurait pu se faire sur un seul navire. D'ailleurs, la plupart du temps, il est écrit : on fit X lieues, mais on n'en compta que X', et ces on sont suffisamment explicites. Le mercredi 19 septembre, nous lisons : Ici, les pilotes firent leur point. Celui de la Niña se trouvait à 440 lieues des Canaries, celui de la Pinta à 420, celui du vaisseau de l'Amiral à 400 ni plus ni moins, et M. F. de Navarette, traducteur, fait observer que la distance marquée par l'Amiral est exacte. Donc, quand on fait le point, il n'y a plus de supercherie et celle-ci n'est utilisée que vis-à-vis de l'équipage. Cependant, il a pu arriver que la précaution prise par C. Colomb, qui, Amiral de la flottille, était aussi le capitaine de la Santa Maria, ait pu induire son pilote en erreur ; ceci a dû se produire le lundi 1er octobre, puisqu'à cette date le pilote de l'Amiral disait au point du jour avec l'accent de la crainte, qu'on avait fait depuis l'île de Fer jusque-là, 578 lieues à l'Ouest. La moindre supputation qui était celle que l'Amiral montrait à l'équipage était de 584 lieues ; mais le compte qu'il regardait comme véritable et conservait par devers lui s'élevait à 707. Ceci s'explique très facilement ; la vitesse devait être évaluée (comme encore aujourd'hui sur un navire à voile), à la fin de tout quart et chaque fois que la marche du bâtiment pouvait se trouver modifiée par une différence dans la force du vent, l'état de la mer, l'orientation des voiles, etc. Ces évaluations étaient faites pendant la durée de son service par ce que nous appelons aujourd'hui le chef de quart, puis remises au capitaine qui les consignait journellement. Celui-ci pouvait, et devait probablement, être seul à son bord à posséder la totalisation de ces évaluations, ce qui facilitait et favorisait l'intelligent et plus qu'excusable truquage. Il ne faut pas oublier que les seules observations astronomiques possibles ne donnaient que la latitude ; pour le calcul de celle-ci, une évaluation rigoureuse du chemin parcouru n'était pas nécessaire, et puisque les caravelles suivaient une direction générale Est-Ouest, l'observation de latitude ne pouvait ni confirmer, ni infirmer la distance parcourue donnée. Par excès de précaution, les capitaines pouvaient donc communiquer à leurs pilotes les supputations qui leur plaisaient, et il semble que C. Colomb, dans le cas cité, ait eu raison d'agir ainsi, puisque le pilote consignait la distance avec l'accent de la crainte. Rien d'ailleurs ne permet d'affirmer que Colomb ne détrompa pas aussitôt, avec un sourire, l'homme de confiance qu'était Juan de la Cosa, son pilote, qui, nous le verrons dans la suite, ne lui tint pas rigueur et manifesta d'une façon élégante son admiration pour son Amiral. En chiffres ronds, la distance entre les Canaries et l'île où atterrit Christophe Colomb est d'un peu plus de 3.000 milles marins actuels et elle fut parcourue en trente-six jours par l'escadrille. Ceci correspond à une moyenne de près de 4 milles ½ à l'heure, ce qui n'est pas mal pour des voiliers de petit tonnage et se rapproche de celle des goélettes terre-neuvas et islandaises. Les caravelles dépassèrent même des vitesses de 7 nœuds et devaient, tout comme les navires auxquels nous les comparons, pouvoir atteindre au moins 8 nœuds dans de bonnes conditions. En compulsant le journal de bord, on trouve des journées de 165 milles, ce qui ferait bien près de 7 milles à l'heure, et de 180 milles, soit 7 milles ½, mais, comme des inégalités de vitesse sont signalées, ces chiffres ne doivent indiquer qu'une moyenne et ils ont dû forcément être dépassés par moments pour pouvoir l'atteindre. Bien plus que les vents debout, qui furent rares et de courte durée, les calmes et les brises légères empêchèrent cette traversée, en somme très favorisée, d'être plus rapide. Mais la chance ne sert-elle pas exclusivement ceux qui savent la provoquer ? Une fois de plus Christophe Colomb mettra en évidence une manifestation de la nature, qu'il fut le premier à utiliser et qui jouera désormais un rôle primordial dans l'histoire des navigations. Nous voulons parler des vents alizés. La physique du globe nous apprend que les vents peuvent être classifiés en permanents, périodiques et variables. Les variables sont ceux qui, ayant une prédominance marquée pour une direction donnée, sont cependant fréquemment altérés par des causes essentiellement variables telles que : changement d'obliquité des rayons solaires suivant les saisons, configuration des côtes, relief du sol, etc. etc. A l'époque de Christophe Colomb, la navigation dans la Méditerranée, dans l'Atlantique européen et le canal des Flandres, toutes mers soumises à ces variétés, avait mis les marins au courant de ce type de vents. L'Amiral des Océans apprit encore mieux à le connaître, presque à ses dépens, lors de son premier voyage de retour. Les périodiques sont ceux qui soufflent six mois dans un sens et six mois dans un autre. Il fallut que Vasco de Gaina et Magellan ouvrissent à la navigation les portes de l'Extrême-Orient, pour que les moussons qui en sont le type fussent connues de la Chrétienté. Les permanents sont ceux dont la direction demeure sensiblement constante toute l'année et les alizés en constituent le type. Ce sont eux qui portèrent Christophe Colomb au Nouveau Monde. L'échauffement de l'atmosphère dans la région tropicale détermine une diminution de sa densité, d'où il résulte qu'elle tend à s'élever. En ce faisant, il se produit une diminution de pression qui entraîne, comme par un pompage, le mouvement des masses voisines venant rétablir la pression initiale. Les vents ainsi créés devraient se diriger vers l'équateur dans chaque hémisphère, mais comme par suite de la rotation de la terre, tous les corps en mouvement sont déviés vers leur droite dans l'hémisphère Nord et vers leur gauche dans l'hémisphère Sud, les masses d'air dans la partie inférieure de l'atmosphère prendront au Nord de l'équateur la direction des vents de NE. et au Sud de l'équateur celle des vents de SE. Ces vents, vents alizés, soufflent toute l'année avec la plus grande régularité. Les alizés du NE. et du SE. sont séparés par la zone des calmes équatoriaux, dus au mouvement ascendant de la masse atmosphérique échauffée. L'oscillation de cette zone suit tout naturellement le mouvement du soleil sur l'Ecliptique, de sorte que la limite de séparation des alizés Nord et des alizés Sud oscille de part et d'autre d'une position moyenne, très proche de l'équateur. Elle est cependant située dans l'hémisphère Nord, celui-ci étant essentiellement continental, comme l'hémisphère Sud est par contre essentiellement océanique, les terres plus chaudes que les mers assureront au premier un surcroît de chaleur. Nous donnons ci-après un tableau pratique et approximatif des limites des alizés de l'Océan Atlantique, les seuls qui nous intéressent actuellement.
Les navigateurs du XVe siècle d'avant 1493 qui, tous issus de l'Ecole du prince Henri de Portugal, fréquentaient comme explorateurs, ou comme successeurs de ceux-ci, la côte occidentale d'Afrique, savaient que sur la côte du Portugal ils avaient la plus grande chance de trouver des vents de NE. en été et des vents de SW. en hiver ; que depuis la latitude de Madère jusqu'au Cap Blanc, les vents dominants venaient des régions Nord ; qu'ils étaient variables, avec prédominance de vents du Nord au Sud en passant par l'Ouest, depuis le 20° de latitude Nord jusqu'au 10° de latitude Nord, et enfin que depuis cette latitude jusqu'aux limites alors connues du continent africain, on trouvait des vents de force et de direction à peu près régulières du Sud au SE. Les vents permanents de SE. en tant que côtiers d'Afrique étaient donc connus ; ce serait une exagération et une erreur de dire que les vents alizés, dans leur ensemble, furent découverts par Christophe Colomb. Cependant, ce fut lui qui utilisa le premier les alizés de NE. du grand large, et trouva la route des voiliers qui permit à ceux-ci, pendant les siècles suivants, de se rendre sûrement et presque avec un horaire prévu, de l'ancien au nouveau continent. En choisissant le 28° de latitude pour se diriger vers l'Ouest, Colomb agit-il au hasard, avec cette intuition que la Providence, pour arriver à ses fins, accorde aux hommes de génie, ou trouvons-nous encore là une preuve nouvelle de l'intelligente et minutieuse préparation qui présida à toute cette expédition ? Il est fort probable qu'il y eut un peu des deux. Les Canaries, qu'il gagna directement, étaient facilement atteintes grâce à la prédominance des vents du Nord, et constituaient une escale avancée, prudente pour le ravitaillement en vivres et en eau ; nous savons qu'elle fut même indispensable pour la réparation et la mise en état des navires. D'autre part, les vents alizés de NE., quoique encore irréguliers dans cette région, s'amorçaient sur les îles Canaries, et il était tout naturel que Colomb profitât de ces circonstances habituelles et favorables pour le début de sa traversée de l'inconnu. Cependant, il est curieux de constater qu'il choisit comme ligne de direction vers l'Ouest le 28° de latitude Nord ; qu'à mi-chemin, il inclina un peu vers le Sud et suivit ainsi, depuis le point de partance jusqu'au point d'arrivée, une route dans le champ d'action des alizés, un peu au Sud de leur limite Nord et parallèle à celle-ci. Au début du XIXe siècle, le célèbre hydrographe américain Maury établit le premier, d'après des milliers de rapports de capitaines, des cartes permettant de fournir aux navigateurs la probabilité des vents dans tel ou tel parage. Le lieutenant de vaisseau Brault, en 1874, réédita, en les complétant, les cartes de Maury. Dans ces cartes, la surface des mers est divisée en carrés de 5° en 5° de latitude et de longitude. Un cercle intérieur, toujours le même, contient le nombre des observations ; un cercle concentrique, parfois absent, permet de connaître la probabilité des calmes. Des segments de droites, extérieures à ces cercles et émanant du centre, indiquent la direction du vent probable et chaque segment est divisé en plusieurs parties, teintées différemment selon la force du vent. Nous nous sommes amusé à tracer sur une de ces cartes de Brault le trajet de la Santa Maria en choisissant, bien entendu, celle qui coïncidait avec les mois pendant lesquels s'effectua la traversée. Cette précaution était d'autant plus utile que le premier voyage de Christophe Colomb se fit en septembre et au début d'octobre, période de transition troublée par le changement de saison, surtout au point de départ comme au point d'arrivée et à la limite Nord des alizés. Suivre dans ces conditions le voyage du grand navigateur en portant les yeux de la carte de Brault à son journal, même atrophié par Las Casas et anémié par les traducteurs, est une occupation passionnante qui prouve à la fois la valeur des cartes des vents de 1874 et l'exactitude des détails consignés sur le livre de bord de 1492. On ne trouvera nulle part de description schématique plus exacte et plus parlante d'une navigation dans cette région : en voici le résumé. Le jeudi 6 septembre 1492, les caravelles appareillent de La Gomera. Ce jour-là et le 7, elles sont accalminées entre La Gomera et Teneriffe. Le 8, à 3 heures du matin, le vent de NE. commence à s'élever ; le cap est mis à l'Ouest, mais une assez grosse houle venant de cette direction empêche de faire une vitesse en proportion de la force du vent. Du 9 au 19, on est en plein dans le régime des alizés, avec vent régulier permanent ; l'Amiral répète que l'air fut extrêmement tempéré, que le temps était comme au mois d'avril en Andalousie, qu'on éprouvait un vrai plaisir à jouir de la beauté des matinées et qu'il n'y manquait que le chant des rossignols. Il ajoute que souvent la mer est aussi tranquille et aussi calme que dans le fleuve de Séville. Les moyennes journalières sont de 90 milles environ, mais cependant, le 16 septembre, 165 milles sont couverts. Le 19, on fit peu de route parce qu'il y eut du calme ; le 20 et le 21 encore du calme, avec quelques brises folles de directions différentes qui ne permirent de faire que du W. NW. et même du Nord demi-quart NW. Le 22, le vent s'établit nettement contraire et si nous examinons la carte de Brault, nous voyons en effet qu'à ce point exact, la possibilité de vents du SW. atteignant en force la jolie brise et même la forte brise, est prévue. L'Amiral à ce sujet dit : ce vent contraire me fut fort nécessaire parce que les gens de mon équipage étaient en grande fermentation, pensant que dans ces mers il ne soufflait pas de vent pour retourner en Espagne. Les caravelles, à ce moment, ayant remonté vers le Nord, sont à l'extrême limite des vents alizés et en sortent quelque peu. Le 23, le vent ne permet guère de faire route qu'au NW. et même au N. q. NW. ; cependant, il a tendance à changer et le cap peut quelquefois être repris à l'Ouest. L'équipage recommence à murmurer, disant que puisque les vents contraires ne duraient pas, ce qui était prouvé par l'absence de drosse mer dans ces parages, il n'y aurait jamais de vent permettant de retourner en Espagne. Mais bientôt, écrit l'Amiral, la mer s'éleva sans que le vent soufflât et devint si grosse que tous en étaient étonnés. Ainsi la grosse mer me fut très nécessaire, ce qui n'était pas encore arrivé, si ce n'est du temps des Juifs quand les Egyptiens partirent d'Egypte à la poursuite de Moïse qui délivrait les Hébreux de l'esclavage. Ce passage mérite d'arrêter notre attention pendant quelques instants. L'équipage a peur parce que les vents soufflent toujours de la même direction et qu'il n'y a aucun signe permettant de supposer qu'ils puissent venir avec quelque permanence d'une direction différente ; cette appréhension est, ma foi, assez compréhensible, elle prouve seulement que les compagnons de Christophe Colomb n'avaient aucune notion antérieure sur les vents alizés. L'Amiral, lui, ne s'en inquiète pas, il devinait sans doute qu'en remontant vers le Nord, il retrouverait les vents variables de l'Atlantique européen. Il est intéressant de remarquer que la douceur et la régularité des vents alizés et le temps merveilleux qui les accompagne toujours contribuèrent fortement à soutenir le moral des matelots pendant la première partie de la traversée, chassant mieux que tous les raisonnements l'effroi des légendes ; mais la mariée était trop belle ! l'exagération et la constance du phénomène météorologique finirent par engendrer la crainte. Ce fut certes là une des causes principales, sinon la seule qui occasionna à bord, des troubles sur lesquels nous devrons revenir. Dans ces conditions l'Amiral devait éprouver une grande satisfaction à voir s'élever une mer si grosse que tous en étaient étonnés, mais il a soin d'ajouter que c'est bien exceptionnellement qu'il s'en réjouit, se montrant une fois de plus un vrai marin : un terrien ou un bluffeur écrivant son journal n'eût pas fait cet aveu et eût plutôt insisté avec emphase sur la hauteur des vagues et les difficultés surmontées, tout en affectant de s'en soucier fort peu. Le vrai marin accepte le mauvais temps, lutte contre lui, mais ne l'aime jamais et ne craint pas de le dire. La grosse houle en question, se manifestant subitement dans le sens opposé au vent régnant, n'est point chose rare, et dans toutes les régions du globe, précède souvent un coup de vent provenant de même direction. Dans le cas actuel, cette houle venait d'un ouragan ou cyclone éloigné, qui passa sans autre manifestation loin de la route des caravelles, comme il arrive parfois, surtout dans cette région rapprochée des berceaux de ces formations tourbillonnaires. Le 24 septembre, le NE. souffla de nouveau et quelques centaines de milles au SW. parcourus à la recherche d'une illusion de terre enfoncèrent davantage les navires dans le cœur des alizés ; aussi, malgré du calme pendant les trois derniers jours de septembre, la route se fit rapidement à l'Ouest jusqu'au 7 octobre, puis au W. SW. jusqu'au 12 du même mois, et les navigateurs enregistrèrent une succession de journées couvrant de 180 à 199 milles. Ainsi, Christophe Colomb, en effectuant une belle traversée qui devait aboutir à la découverte du Nouveau Monde, trouvait en même temps pour s'y rendre la route la plus sûre et la plus rapide. Le groumage. Dans le résumé qui précède, nous venons de voir qu'il y eut des troubles à bord, troubles engendrés en grande partie par la crainte de ne pas trouver de vents favorables pour le retour. A cette raison, on peut joindre la longueur du trajet, le fait que la limite probable fixée par Colomb, au départ, pour la traversée totale, fut dépassée, et peut-être même la monotonie d'une navigation trop facile, outre les déceptions occasionnées par des illusions de terres répétées. Ces troublés furent-ils très graves, atteignant les proportions d'une révolte, ou se bornèrent-ils à des murmures, à cet état d'esprit particulier aux matelots de tous les temps et décrits dans la marine sous le nom de groumage ? Notons en passant, et c'est une chose assez amusante à relever, que cette expression essentiellement maritime de groumage date probablement de l'époque du grand navigateur. On désignait sous le nom de grumète les novices embarqués ; or, ces jeunes gens, bruyants, bavards, rouspéteurs pour se servir d'un jargon similaire de l'armée, querelleurs et querellés, ont pu donner naissance à l'expression courante entre matelots de : tu n'as pas fini de grumeter, d'où le verbe groumer. Nous offrons cette étymologie pour ce qu'elle vaut et sous toutes réserves, en remarquant seulement que groumer et groumage ne se trouvent dans aucun dictionnaire français, que ces mots ne sont pas utilisés dans l'argot habituel terrien, mais qu'ils sont, absolument courants dans le vocabulaire maritime. Tous ceux qui naviguent savent que le fait de groumer est un état psychologique du marin, qui peut être l'avant-coureur de désordres graves, mais qui, si les chefs agissent avec tact, devient une sorte de soupape de sûreté, se limitant à des gestes et à des paroles de mauvaise humeur, quelquefois à des .réclamations, créant une atmosphère pénible, mais n'empêchant ni le travail ni l'exécution du devoir. La gaieté, comme le beau temps après la tempête, succède au groumage, et nous connaissons des matelots, parmi les meilleurs, pour qui groumer de temps en temps est aussi nécessaire que de fumer ou de chiquer. Nous croyons volontiers que, sur la Santa Maria,
tout se limita à un fort groumage, car C. Colomb insista peu sur ces faits
dans son journal de bord et Las Casas se contenta, en dehors de ce que nous
avons rapporté pour les journées du 22 et 23 septembre, d'écrire le 10
octobre : Ici, les gens de l'équipage se plaignaient
de la longueur du voyage et ne voulaient pas aller plus loin. Mais l'Amiral
les ranima du mieux qu'il put en leur donnant bonne espérance des profits
qu'ils pourraient faire. Et il ajouta qu'au reste leurs plaintes ne leur
serviraient à rien parce qu'il était venu pour se rendre aux Indes et qu'il
entendait poursuivre son voyage jusqu'à ce qu'il les trouvât avec l'aide du
Seigneur. D'autre part, à la date du 14 février, pendant la tempête du retour, l'Amiral dit que Dieu l'avait délivré à l'aller, lorsqu'il avait tant de motifs de crainte dans les souffrances et les tourments que lui avaient fait éprouver ses matelots et son équipage, qui tous étaient résolus d'un commun accord à s'en retourner et voulaient se révolter contre lui, s'oubliant même jusqu'aux menaces... Mais, peut-être, ne fait-il allusion qu'à l'ensemble des incidents de détail ayant surgi au cours de toute la traversée, et dont, très susceptible, il s'affecta à l'excès. La journée la plus scabreuse semble avoir été celle du 10 octobre et les détracteurs les plus acharnés et les plus violents de Christophe Colomb, s'appuyant sur les vagues ragots de témoins, exhumés lors d'un procès de succession qui eut lieu des années plus tard et pris d'ailleurs, pour la plupart, parmi l'équipage qui participa à la félonie de Martin Alonso Pinzon, prétendent que cette révolte ne fut apaisée que par l'intervention — en paroles — du capitaine de la Pinta, toujours mis en opposition avec l'Amiral. La scène qu'ils déduisent de ces témoignages enlève toute espèce de valeur à cette supposition ; elle est si invraisemblable qu'elle ne mériterait qu'un haussement d'épaules, sans le côté tristement burlesque, voire même pénible, de ce procédé de dénigrement. Tout l'équipage est en pleine révolte ; l'Amiral est seul à se défendre contre lui ; avertis, on ne sait comment, les deux autres navires se rapprochent et Colomb tranquillement, enflant la voix, entame une petite conversation avec le capitaine de la Pinta ; puis il passe de l'autre bord et cause avec celui de la Niña. Enfin, il revient à la Pinta et reprend l'entretien avec Martin Alonso. Celui-ci profère alors des menaces, sur un ton qualifié par l'auteur de cette farce d'ironique et plaisant, mais dont l'ensemble nous apparaît comme les rodomontades et les vantardises de ce genre de méridionaux, existant dans n'importe quel pays. Aussitôt tout rentre dans l'ordre ! Pour notre part, nous ne voyons pas très bien un chef, seul contre tout son équipage, bavardant tantôt à droite, tantôt à gauche, avec les navires voisins, pas plus que ces matelots mutinés assistant sagement et patiemment à cette conversation. Ces propos sont échangés sans ménager les détails, en pleine mer, par bonne brise, puisque le journal de bord porte que l'on fila ce jour-là dix milles par heure, par moments douze milles, et d'autres fois sept ! Il nous est arrivé fréquemment d'avoir à parler d'un navire à un autre, notamment pendant la guerre, sur des vapeurs où les équipages, aussi disciplinés qu'habiles, tenaient la route avec le plus grand soin. Nous croyons que ceux qui se sont trouvés dans ces conditions, cependant favorables, reconnaîtront avec nous que supposer une conversation à trois, par belle brise, sur des voiliers dont l'équipage de l'un est en pleine mutinerie, est une... fantaisie, pour ne pas nous servir d'un mot grossier. Tout au plus, admettrions-nous, pour être conciliant, que le soir, au moment du passage à poupe habituel, lors du rendez compte, une allusion ait pu être faite au groumage en cours, et quelque très bref et violent propos proféré. En supposant même que l'acrobatie imaginée se soit effectuée, ou que l'intervention de Martin Alonso Pinzon ait eu lieu par un autre procédé, nous resterions sceptique sur son efficacité. Un mécontent et un vaniteux de son espèce, détracteur de son chef, méprisant son devoir au point de devenir un insoumis, comme nous le verrons dans la suite, n'est jamais estimé des hommes ; il peut susciter des révoltes, il n'est pas fait pour les apaiser. L'épopée de Christophe Colomb devait inspirer l'enthousiasme généreux du poète : Trois jours, leur dit Colomb, et je vous donne un monde ! Et son doigt le montrait, et son œil, pour le voir, Perçait de l'horizon l'immensité profonde. C'est en effet 48 heures plus tard que la terre fut aperçue. Mais rien ne prouve que cette transaction fut conclue entre Colomb et son équipage. Casimir Delavigne était cependant près de la vérité, sans le savoir, l'aventure étant arrivée à un autre explorateur, Barthélémy Diaz, qui, dans un voyage précédant celui de sa découverte du cap des Tempêtes, en 1497, demanda effectivement à son équipage révolté de lui accorder trois jours pour voir la côte d'Afrique remonter au Nord. Hélas ! les explorations ne présentent pas toujours les solutions rêvées par la littérature ; au bout de ce temps la côte descendant toujours vers le Sud, le navigateur Portugais dut virer de bord et revenir[20]. La Terre ! Il était naturel que la préoccupation constante de tous, à bord des caravelles, fût de voir la terre. C'était le but même de l'expédition et de plus, la reine Isabelle, avant le départ, avait promis à celui qui l'apercevrait le premier une rente de 10.000 maravédis prélevées sur les boucheries de Séville, soit 8.000 francs environ, ce qui était considérable pour l'époque. Par instructions écrites à ses capitaines le 6 septembre, Colomb avait fixé à sept cent lieues la distance à partir de laquelle la flottille devait ralentir pendant la nuit et la veille s'effectuer avec un soin particulier. Ceci suffirait à affirmer, malgré les assertions de H. Vignaud et autres, qu'il ne s'inquiétait pas beaucoup des îles supposées. Cependant, il ne pouvait les négliger, car tout le monde en parlait, et il admettait évidemment la possibilité de leur existence. Aussi, dès le départ des Canaries, on commença à chercher la terre. Colomb dit lui-même : Des Espagnols honorables, habitans de l'île de Fer, assuraient que chaque année ils apercevaient une terre à l'Ouest des Canaries, que d'autres habitans de la Gomera affirmaient aussi la même chose avec serment. Il dit également qu'il se rappelle qu'étant au Portugal en 1484 un particulier de l'île Madère vint trouver le Roi pour lui demander une caravelle, afin de se rendre à cette terre qu'il voyait chaque année toujours dans la même position et aussi qu'il se souvint qu'on répétait la même chose dans les îles Açores et que tous ces témoignages s'accordaient sur la direction, les signes et la grandeur. Pedro de Médina, dans son voyage Grandezas de Espafia, remarque avec Viera, en parlant de Madère, que ces terres ne purent jamais être trouvées, malgré les expéditions tentées, mais que de la certitude de leur existence vint l'usage de représenter, dans les cartes qu'on traçait, quelques îles nouvelles dans nos mers, spécialement la Antilia et San Borondon. La Santa Maria et ses compagnes ne virent pas ces îles, et pour cause, mais à partir du moment où elles pénétrèrent dans la mer des Sargasses, la hantise de la proximité de la terre s'affirma. Colomb seul résista au début et malgré tous ceux qui l'entouraient, Pinzon comme les autres, fidèle à son idée directrice, écrivit : Je calcule que la terre ferme est plus loin. Sa conviction, cependant, commença dès le lendemain à être ébranlée par des indices qui paraissaient indiscutables, tels que les herbes en quantité paraissant détachées fraîchement de la terre et le crabe en vie, qu'il conserva et qui lui fit dire, non sans un semblant de raison, que jamais on ne trouve de ces animaux à 80 lieues de terre. Nous savons que ces observations sont de celles qui ont permis à MM. Joubin, Germain et Le Danois d'établir leur théorie sur la corrélation, avec l'Atlantide, de la mer des Sargasses, Colomb est donc bien excusable d'avoir senti le continent englouti sur lequel il passait. Le 19, avisé et prudent, l'Amiral sonde et s'étonne de trouver pas de fond avec 200 brasses filées. La veille, Martin Alonso, le fameux remarquable marin, brouillon, impatient et plus emballé dans l'erreur que les autres, prend les devants avec sa caravelle qui est bon voilier parce qu'il espère voir la terre cette nuit même, ayant aperçu une grande multitude d'oiseaux vers le couchant. Comme il est inadmissible que Martin Alonso puisse se tromper complètement, le chroniqueur acharné, mais un peu léger, qui insiste sur cette fugue ajoute, ces terres sont des brisants qui ne furent découverts qu'en 1802. Malheureusement, il ignore que depuis déjà de longues années ces brisants, portés en effet sur les cartes à la date qu'il indique, ont été reconnus inexistants et ont été supprimés, depuis presque un siècle, des cartes françaises et anglaises qui les ont remplacés par l'indication de 5.150 mètres, fond de vase à globigérine, et depuis 1860 des cartes espagnoles qui furent les dernières à les conserver[21]. L'idée de terre est désormais tellement entrée dans les cerveaux que tout, de la brume sans vent, une baleine, des oiseaux connus, mal connus ou inconnus, seront prétexte à l'enfoncer davantage. Colomb y croit aussi, ou veut bien faire semblant d'y croire mais quoique persuadé qu'au Sud et au Nord il y avait des îles, il ne s'arrêta pas à louvoyer parce qu'il avait la volonté de poursuivre sa route jusqu'aux Indes. — Le temps est bon, dit-il, et s'il plaît à Dieu tout se verra au retour. Le 25 septembre, profitant du calme, Colomb se rendait sur la Pinta et s'entretenait avec Martin Alonso Pinzon au sujet d'une carte qu'il avait envoyée depuis trois jours à ce dernier, à sa caravelle, et sur laquelle il paraît qu'il avait représenté certaines îles dans cette mer... Etait-ce la carte de Toscanelli, était-ce celle retrouvée par M. de la Roncière ? Cette dernière ne porte pas trace de ces terres et Humboldt nie que ce soit la première, car la route adoptée eût été sur le parallèle de Lisbonne et non pas sur la latitude de Gomère. Y avait-il donc une troisième carte ? C'est possible, et peut-être y en avait-il encore beaucoup d'autres. Quoi qu'il en soit, plus tard, dans la journée, l'Amiral lui dit de lui renvoyer la dite carte et après que Pinzon la lui eut jetée avec une corde, il se mit à la pointer avec son pilote et quelques-uns de ses marins. Pour empêcher Pinzon d'envoyer la précieuse carte avec une embarcation, il avait fallu évidemment que le vent ait succédé au calme ; elle ne fut certes pas, comme dit le traducteur, jetée avec une corde — opération malaisée et risquée — mais transmise par un moyen dont nous nous sommes fréquemment servi dans le Nord, pendant la guerre, pour faire parvenir aux patrouilleurs britanniques qui nous étaient confiés des plis ou le courrier : les documents étaient soigneusement enfermés dans une boîte étanche, qui, par notre arrière, était filée au bout d'une ligne et que gaffait le patrouilleur auquel elle était destinée. Ce procédé est vieux comme la navigation elle-même et donne le maximum de sécurité et de facilité. Ce même jour, quand le soleil fut
couché, Martin Alonso monta à la poupe de son navire et avec de violentes démonstrations
de joie, il appela l'Amiral, lui criant bonne nouvelle, et lui disant de
partager son allégresse parce qu'il voyait la terre. Lorsque l'Amiral lui
entendit répéter cette nouvelle d'un ton affirmatif, il dit lui-même qu'il se
jeta à genoux pour remercier le Seigneur. Martin Alonso chantait le Gloria
in Excelsis Deo avec son équipage ; celui de l'Amiral en fit autant, et
les gens de la Niña montèrent tous sur le mât de hune et dans les
cordages, et tous assurèrent que c'était la terre. L'Amiral partagea leur
opinion et crut qu'on en était à vingt-cinq lieues : tous jusqu'à la nuit
affirmèrent que c'était la terre. L'Amiral donna l'ordre de quitter la route
suivie qui était à l'Ouest et de prendre la direction du Sud-Ouest, direction
dans laquelle la terre avait paru. Ce ne fut que le lendemain 26
septembre dans la soirée qu'on reconnut que ce qu'on
avait supposé être la terre ne l'était pas, et que ce n'était que le ciel. En citant ce passage, nous n'avons pas voulu, adoptant les errements des ennemis de Colomb, insister sur une nouvelle faute du fameux Martin Alonso Pinzon, mais montrer combien facilement, lorsque l'esprit est tendu vers un but — l'auto-suggestion collective peut agir avec force. Sur trois navires où se trouvent des marins et des navigateurs incontestablement expérimentés, observateurs de la nature d'autant meilleurs, qu'à cette époque les yeux et le raisonnement devaient suppléer à la pénurie instrumentale, il suffit de l'affirmation d'un seul pour que tous soient prêts à jurer qu'ils voient la terre et il faut 24 heures de route stérile pour reconnaître qu'il ne s'agit que d'un nuage. Loin de nous l'idée de critiquer, nous savons par expérience combien l'illusion peut être trompeuse. Que de fois, dans des régions où règne encore l'inconnu, semblable chose ne nous est-elle pas arrivée ? Ce fut au point que nous avions fini par verser dans l'excès contraire et nier à priori toute apparence de terre qui nous était signalée ! Que de fois aussi, dans des mers très connues, n'a-t-on pas affirmé la proximité d'une terre attendue, alors qu'il ne s'agissait que d'un nuage ? Oui n'a dit ou entendu dire : Si on ne savait pertinemment qu'il n'y a rien dans cette région du globe, on jurerait que la terre est là ? Nous nous souvenons d'une matinée où, stoppés en plein Atlantique par calme et longue houle à quelque 50o milles au large des côtes d'Ecosse, attendant le grand jour pour reprendre des travaux océanographiques, un de nos plus anciens et avisés matelots est. venu nous réveiller pour nous signaler des brisants devant ; nous les avons tous vus, quoique sachant parfaitement qu'ils ne pouvaient exister ; il a fallu pour dissiper cette vision, due à une sorte de mirage avec brume basse, que nous avancions prudemment à petite vitesse dans la direction indiquée. Le 3 octobre, Las Casas nous dit que l'Amiral croyait avoir laissé derrière lui les îles qui se trouvaient figurées sur sa carte, mais qu'il n'avait pas voulu courir des bordées, la semaine passée, malgré tous les signes de terre, parce que son but était de se rendre aux Indes et que perdre son temps en route eût été manquer de prudence et de jugement ; on continua donc à l'Ouest, mais le 6 octobre Martin Alonso voulut que l'on naviguât à l'W. quart SW. pour découvrir des îles ; il fit cette réflexion[22], que les caravelles naviguaient entre les terres, ce qui, la suite l'a montré, était une grosse et nouvelle erreur. L'Amiral répéta qu'il valait mieux aller d'abord à la terre ferme et revenir ensuite aux îles. Le 7 octobre, au lever du soleil, la Niña, qui était devant, arbora un pavillon au mât de hune et fit une décharge, moyens convenus pour signaler la terre. Cependant, l'équipage ne la voyait pas encore, mais seulement une multitude d'oiseaux qui volaient du N. au SW., ce qui pouvait faire croire qu'ils allaient passer la nuit à terre ou fuyaient peut-être l'hiver qui ne devait pas être éloigné dans les pays qu'ils quittaient. Les oiseaux jouaient un très grand rôle dans les signes de l'approche de la terre et l'Amiral savait que les Portugais durent à l'observation du vol des oiseaux la découverte de la plupart des îles qui sont en leur possession. Peut-être, savait-il aussi que les oiseaux constituèrent un procédé de navigation usité par les Vikings. On raconte en effet qu'au Ve siècle, Grim Kamban, fuyant la Norvège tombée sous la tyrannie de Harald Haarfager, s'avançant vers l'Ouest, naviguait avec un panier rempli de corbeaux. Il lâchait un de ces oiseaux de temps à autre. Si le volatile partait vers l'arrière, la terre la plus rapprochée était celle que l'on venait de quitter ; s'il s'élevait dans le ciel, hésitait, puis revenait à bord, on était éloigné de tout ; si enfin il partait droit devant lui, il n'y avait qu'à suivre la direction qu'il prenait et on trouvait une terre. L'Islande aurait été découverte ainsi. Quoi qu'il en soit, à ce moment, Christophe Colomb, cédant enfin aux instances de Martin Alonso, consent, un peu plus d'une heure avant le coucher du soleil, peut-être pour avoir la paix, à donner le cap au WSW. Il ne fit en cela que devancer Dumont d'Urville qui écrit : Il est d'ailleurs certaines occasions où je crois qu'un chef doit sacrifier ses propres opinions au vœu général, même au risque des plus grands malheurs. L'apôtre de Pinzon et le dénigreur de Colomb, parlant de ce changement de route, s'écrie qu'un fait considérable se produisit ainsi[23]. Le qualificatif de considérable n'a rien d'exagéré, mais dans le cas particulier nous préférerions celui de déplorable. Même sans être un navigateur de profession, il suffit, en effet, de regarder une carte pour se rendre compte que si Martin Alonso avait laissé la paix à son chef et que l'Amiral ait continué, comme il le voulait, sa route primitive à l'Ouest, il avait de bien grandes chances pour tomber, non pas sur une petite île des Antilles, mais sur la Floride, et découvrir le continent du premier coup ; il n'avait que 250 milles de plus à parcourir, soit 50 heures de navigation à 5 nœuds. Les événements vont maintenant se précipiter. Le 11 octobre, on vit des damiers et un jonc vert tout près du navire amiral. L'équipage de la Pinta aperçut un roseau et un bâton, et on pêcha un autre bâton qui paraissait travaillé avec du fer, un morceau de roseau, une herbe de terre et une petite planche. Les gens de la Niña virent d'autres signes de terre et un petit bâton chargé de sapinettes. Devant l'accumulation de ces symptômes, la veille devint de plus en plus sérieuse. Cependant, revenant à son idée première, Colomb, après la chute du jour, ordonna de reprendre la route directement à l'Ouest, et nous ne pouvons mieux faire que de laisser la parole à Las Casas. On fit douze milles par heure et
jusqu'à deux heures après minuit on fila quatre-vingt-dix milles qui font
vingt-deux lieues et demie. Et comme le navire la Pinta était meilleur
voilier et allait devant l'Amiral, il aperçut la terre et fit les signes que
celui-ci avait ordonnés. Un marin nommé Rodrigo de Triana fut le premier qui
vit cette terre, car si l'Amiral étant à dix heures du soir sur le gaillard
de poupe, vit bien une lumière, ce fut au travers d'une masse si obscure
qu'il ne voulut pas affirmer que ce fit la terre. Il appela néanmoins Pedro
Gutierrez, tapissier du Roi, et lui dit que ce qu'il voyait lui paraissait
être une lumière, qu'il regarda à son tour. C'est ce que celui-ci fit, et il
vit une lumière. L'Amiral en dit autant à Rodrigo Sanchez de Ségovie, que le
Roi et la Reine avait envoyé sur la flotte en qualité de contrôleur. Ce
dernier ne vit pas la dite lumière, parce qu'il n'était pas dans une position
d'où il pat rien voir. Après l'avertissement de l'Amiral on la vit une fois
ou deux ; c'était comme une chandelle dont la lumière montait et baissait, ce
qui eût été pour peu de personnes un indice de proximité de terre, mais
l'Amiral regarda comme certain qu'il en était près. Aussi, quand on dit le Salve
que les marins, qui se réunissaient tous à cet effet, ont coutume de réciter
et de chanter à leur manière, Amiral les avertit et les pria de faire bonne
garde au gaillard de poupe, et de bien regarder du côté de la terre, et leur
promit de donner un pourpoint de soie à celui qui dirait le premier qu'il la
voit, et cela sans préjudice des autres récompenses promises par le Roi et la
Reine à celui qui la verrait le premier ; ces récompenses consistaient
spécialement en dix mille maravédis de rente. Enfin, à deux heures après minuit, la terre parut ; elle n'était plus qu'à deux lieues. On ferla toutes les voiles, ne laissant que la treou, qui est la grand voile sans bonnettes et on mit en panne pour attendre jusqu'au jour du vendredi ! On arriva ainsi le lendemain à une petite île, où Christophe Colomb se rendit dans une barque armée avec Martin Alonso et Vicente Yanez Pinzon, capitaines des autres caravelles. Il avait lui-même en main la bannière royale et les deux autres, les bannières à croix verte surmontées d'une couronne et encadrées des lettres F et Y, initiales de Ferdinand et d'Isabelle. Rodrigo Descovedo, écrivain de toute la flotte, et Rodrigo Sanchez de Ségovie les accompagnaient. L'Amiral leur dit, devant les naturels accourus en grand nombre, qu'il les appelait en foi et en témoignage de ce que par devant eux tous il prenait possession de la dite île, comme de fait il prit possession au nom du Roi et de la Reine leurs seigneurs, faisait les protestations que de droit, suivant le détail contenu dans les actes qui se dressèrent là par écrit. C'est ainsi que le Nouveau Monde fut découvert par Christophe Colomb entre le 11 et le 12 octobre 1492. Est-ce l'Amiral lui-même qui fut le premier à voir la terre ? ou est-ce Rodrigo de Triana ? De nombreuses discussions surgirent à ce propos ; nous ignorons si le pourpoint de soie fut donné au matelot de la Pinta, mais en tous cas la rente de 10.000 maravédis revint à Colomb qui la transféra à Béatrix de Arana, la mère de son fils Fernando. On prétend que Roclrigo de Triana, furieux qu'on ait contesté sa priorité, passa en Afrique au retour de l'expédition et se fit musulman. H. Harrisse suppose que cet homme était peut-être un Maure rallié au christianisme et que le très religieux Amiral ne voulut pas que ces terres nouvelles aient été officiellement vues pour la première fois par un converti ! Christophe Colomb donna à cette île le nom de San Salvador et nous apprit que les Indiens l'appellaient Guanahani. H. Harrisse, qui a fouillé tout ce qui concernait Colomb, et volontiers agrémente sa documentation si sérieuse d'un peu de gaieté, rapporte qu'il a retrouvé dans une communication du Bulletin de la Real Acad. de la Historia, tome XIX, année 1891, page 361, l'explication suivante. Des Juifs auraient fait partie de l'équipage de la Santa Maria. Deux d'entre eux étaient appuyés sur le bastingage quand la terre apparut et l'un dit à l'autre en hébreu ; Ii (tiens, la terre), Waana ? (où cela), répond l'autre ; Hen i ? (tu ne vois pas la terre ?), reprit le premier. Un matelot surprenant cette conversation comprit Waana-hen-I et répéta à ses camarades que la terre en vue devait s'appeler ainsi puisque les deux Juifs se la désignaient par ce nom, devenu Guanahani. Henry Harrisse ajoute avec humour qu'il y a donc beaucoup de chance pour que les dix tribus d'Israël perdues soient retrouvées aux Lucayes, où les habitants parlent hébreu. La découverte du Nouveau Monde. Les géographes et les historiens ont longuement discuté et discutent encore pour savoir à laquelle des Îles Bahama atterrit Christophe Colomb. L'imperfection des moyens employés à son époque pour mesurer la vitesse et aussi la variation de l'aiguille aimantée, comme le dit très justement A. de Humboldt, ne permettent guère de déterminer, d'une manière précise, la route suivie par l'illustre Génois. D'autre part, la description qu'il laissa de cette première ne, soit parce qu'elle fut écrite dans l'émotion de la réussite, soit parce que ses manuscrits ont été mal interprétés, manque de netteté et de précision. Certains détails s'appliquent bien à l'une ou à l'autre des îles supposées, mais tous ne peuvent se grouper sur la même. En nous limitant à la longue note que M. de la Roquette publie à la suite de sa traduction de M. F. de Navarette[24], nous voyons que le premier est d'avis qu'il s'agit de San Salvador Grande ou île du Chat, située par 24°30' de lat. Nord, d'accord en cela avec Jean Ferrer et l'Amiral de Rossel, tandis que le second, avec Humboldt, inclinent pour la Grande Saline, une des îles turques, située par 21°30' de lat. Nord. Munoz, dans son Hist. del Nuevo Mundo, complique encore la question en soutenant que Guanahani est l'île Watelin qui se trouve à 45 milles dans le SE. de l'île du Chat. L'opinion de Washington Irving met d'accord les partisans de l'île Watelin et de l'île du Chat, en admettant que la lumière vue par Colomb se trouvait sur la première, mais que ce fut sur la seconde qu'on débarqua le lendemain. Cependant à ces trois îles San Salvador Grande, la Grande Saline et Watelin, Varnhagen en 1864 ajoute l'île Mariguana et en 1882 le capitaine G. V. Fox opine pour Samana. Dans une récente et fort documentée communication, le Lnt. Commander R. T. Gould, de la Marine Britannique, plaide éloquemment en faveur de l'île Watelin et son opinion est d'ailleurs partagée par les Services Hydrographiques Britannique et des Etats-Unis[25]. Ces discussions et celles qui suivirent furent en général des plus courtoises, déplorant simplement la perte de manuscrits ou la pénurie de documentation. Mais, dans un livre récent[26] que nous citons trop fréquemment, pour contrebalancer l'impression produite sur des lecteurs attirés par le titre de l'ouvrage, l'allure change, et l'auteur s'oublie au point d'accuser Colomb d'avoir inventé cette île ! San Salvador n'existe que dans l'imagination de Colomb ; son nom n'a pu être inscrit sur les cartes. Les contemporains et la postérité sont bernés[27] ! ! ! Nous finirons par croire que Colomb a tout inventé et que le Nouveau-Monde lui-même n'existe pas. C'est simplement grotesque ! Ces opinions étranges ne trouvent leur excuse que dans une grande ignorance, déjà relevée, et dont le passage suivant qui se rattache au même sujet, donne la preuve la plus navrante... ou la plus égayante. Le découvreur d'une terre, un simple navigateur trouvant, une ile inconnue, détermine, à l'aide de ses instruments, sa longitude et sa latitude et marque sa place exacte sur la carte. Or, l'amateur qu'est Colomb ne sait pas. Les frères Pinzon, et Juan de la Cosa qui est un grand professionnel, savent. Il pourrait demander à l'un d'eux de faire cette opération ; mais il n'y pense pas, ou ne le veut pas[28]. Hâtons-nous de dire que Christophe Colomb a aussi bien fait de s'abstenir, car, s'il avait donné cet ordre à ses subalternes, c'est alors avec raison qu'on se serait moqué de lui. L'auteur en question ignore qu'en 1492 et longtemps après, les navigateurs ne possédaient pas d'instruments permettant de déterminer la longitude. Après ceci, nous croyons avoir le droit de tirer l'échelle et nous limiterons à cette dernière perle les citations empruntées à ce pamphlet tendancieux. En ce qui nous concerne, n'ayant trouvé aucun élément nouveau d'appréciation, nous nous abstiendrons de toute opinion ferme, tout en penchant plutôt pour la Grande Salvador. Il est regrettable, peut-être plus au point de vue sentimental qu'au point de vue historique, de conserver une incertitude sur le point exact où Christophe Colomb mit le pied pour la première fois sur le Nouveau Monde ; cela ne constitue cependant pas un désastre et, si l'on veut admettre que l'Amiral des Océans ait pu, dans cette circonstance, agir légèrement et ne pas songer assez aux exigences de la postérité, les regrets seront effacés et la légèreté pardonnée, devant l'abondance des précisions qu'il donne sur l'énorme chapelet de découvertes qu'il fit ultérieurement. Les limites assignées à notre étude ne comportent, pour la suite de ce premier voyage, comme pour les parties non maritimes des autres, qu'un résumé encadrant les quelques points que nous croyons devoir mettre en valeur, ou qui nécessitent une attention plus particulière ; nous renvoyons ceux de nos lecteurs qui voudraient connaître dans leurs détails les expéditions de Colomb, à l'ouvrage écrit avec tant d'enthousiasme et de charme par J. P. Alaux qui, tout en restant dans le cadre de l'histoire, a su donner à ce récit la forme passionnante d'un roman, agréablement et artistement présenté par son cousin G. Alaux[29]. Une curiosité plus exigeante trouvera en outre satisfaction dans la lecture des traductions ou adaptations du journal lui-même de Christophe Colomb, présenté par Las Casas[30]. Les trois caravelles atterrirent donc aux Lucayes ou Bahama, le 12 octobre. Elles firent route ensuite tantôt au Sud, tantôt à l'Ouest, découvrant diverses îles dans cet archipel et donnant des noms comme Santa Maria de la Concepcion et Fernandina. Après avoir visité cette dernière, le 17 octobre, Christophe Colomb décrit les maisons indigènes : Leurs lits et les meubles sur lesquels ils se reposent sont à peu près semblables à des filets de coton. Il est évident qu'il désigne ainsi les hamacs, qui devaient, peu de temps après, suggérer aux navigateurs le genre de couchage à l'usage des gens de mer universellement adopté encore aujourd'hui dans toutes les marines. L'Amiral séjourna ensuite plusieurs jours dans une île qui doit être la Grande Inague et qu'il appela Isabelle. De là, après avoir mouillé aux petites îles, probablement les Caies orientales et méridionales du grand banc de Bahama, qu'il nomma les îles de Sable, il fit route pour la grande Ile que les Indiens lui désignèrent sous le nom de Cuba et qu'il pensa bien être celle de Cipango. Cette navigation dans une région totalement inconnue, au milieu des bancs de coraux, des récifs et des îles, comme celle qui suivit sur la côte NE. et N. des grandes Antilles, met bien en évidence les capacités de marin et d'explorateur de Christophe Colomb. Les difficultés étaient accrues du fait que nos navigateurs se trouvaient — c'est bien le cas de le dire — à l'autre bout du monde et qu'ils ignoraient les conditions météorologiques qu'ils devaient rencontrer. Deux saisons se partagent l'année dans la région des Antilles. Celle connue sous le nom de hivernage comprise entre juin et novembre est chaude et insalubre ; la pluie, le tonnerre, les éclairs sont extrêmement fréquents et les vents ont une tendance générale à souffler du SE., mais si les périodes de calme sont nombreuses, il passe parfois de très violentes bourrasques. La saison sèche est comprise entre novembre et juin ; c'est la période salubre et agréable. Les vents alizés du NE. se font sentir presque constamment. Quelquefois, les vents du Nord ou de NW. soufflent avec violence, ils sont alors précédés par des vents d'Est tournant au Sud puis à l'Ouest ; ces coups de vents, subits, dangereux et violents, plus habituels de novembre à mars, sont connus dans le Golfe de Mexique sous le nom de nortès. Les vents alizés passant sur les Antilles ont des variations diurnes, occasionnées par les brises du large et les brises de terre. Les premières commencent de 9 heures à Io heures du matin, forcissant jusqu'à la plus grande chaleur du jour, puis décroissent jusqu'au coucher du soleil pour cesser complètement. Les secondes prennent à leur tour, après une période de calme qui disparaît un peu avant minuit, forcissent jusqu'à 2 heures du matin, puis diminuent ensuite progressivement pour aboutir de nouveau au calme. Les grandes perturbations atmosphériques, d'intensités différentes, sont des grains plus ou moins violents, généralement arqués et orageux, les nortès dont nous venons de parler, et enfin les cyclones qui se forment surtout en août, septembre et octobre. Ceux-ci furent épargnés à Colomb pendant le séjour aux Antilles de sa première expédition, mais nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard. Les mois limites qui séparent les deux saisons sèche et d'hivernage sont des mois de transition ; l'Amiral des Océans parvint dans cette région justement en octobre, aussi, tout en se félicitant d'un temps agréable et doux, signale-t-il au début de sa randonnée de fortes pluies presque journalières. Le 28 octobre, il atterrit sur la côte NW. de Cuba, mouilla et débarqua dans la baie de Nipe, qu'il nomma San Salvador, puis entra dans la baie du Rio de Mares, dont il donne la latitude très exacte de 21° Nord, prise au quart de cercle, remonta jusqu'au 22° qu'il atteignit le 31 octobre et revint au Rio de Mares. Il croyait alors être dans une île au voisinage de la terre ferme et du royaume de Cathay où régnait le Grand Khan. Dans son opinion, les indigènes de Cuba n'étaient pas assujettis à ce puissant monarque, mais au contraire se trouvaient en guerre avec lui. L'Amiral voulut profiter de la magnifique baie que forme
le fleuve à son embouchure, ayant de chaque côté une
plage bien boisée et très commode où échouer ses navires pour les caréner.
Mais il prit la précaution de ne pas les immobiliser tous
ensemble de façon qu'il en restât toujours deux pour la sûreté de l'équipage.
Pendant ce temps, il résolut d'envoyer à terre deux Espagnols : Rodrigo de
Jerez qui demeurait à Aya Monte, et Luis de Torre, qui avait vécu avec le
gouverneur de Murcie, et savait, dit-on, l'hébreu, le chaldéen et même un peu
l'arabe ; il leur adjoignit deux Indiens, dont l'un avait été embarqué à
Guanahani, l'autre sur la rive du Rio de Mares. Colomb donna à cette équipe
de la pacotille pour se procurer des vivres le cas échéant, des échantillons d'épicerie pour voir s'ils en
trouveraient quelques-unes, avec des instructions sur ce qu'ils devaient
faire pour obtenir des informations sur le Roi de ce pays, et sur ce qu'ils
devaient lui dire de la part du Roi et de la Reine de Castille, et comme quoi
ils envoyaient l'Amiral pour lui remettre de leur part leurs lettres et un
présent, afin de connaître l'état de son empire et sa puissance, pour lier
amitié avec lui et lui rendre tous les services qu'il pourrait désirer d'eux,
etc. Ces émissaires avaient six jours pour remplir leur mission. Ils revinrent le 6 novembre, ayant atteint un village de près de mille habitants, où ils avaient reçu le meilleur accueil, sans trouver cependant le Roi qu'ils cherchaient. Par contre, ils rapportaient un renseignement qui devait
avoir une grande répercussion en Europe. Les indigènes qu'ils rencontrèrent
revenant à leurs villages portaient à la main un
charbon allumé et des herbes pour prendre les parfums, ainsi qu'ils en
avaient coutume. Las Casas, dans son Histoire des Indes,
s'étendant sur ce sujet, ajoute : C'étaient des
herbes renfermées dans une certaine feuille également sèche, et de la forme
de ces catapultes dont les enfants se servent le jour de la Pentecôte. Ils
étaient allumés par un bout, tandis qu'ils humaient l'autre et l'absorbaient
endormait et les enivrait pour ainsi dire : par l'aspiration par les narines,
cette fumée baient ; et, buvant intérieurement la fumée de cette manière, ils
ne sentaient presque pas la fatigue. Les espèces de catapultes que nous
appellerons ainsi, se nommaient dans leur langue tabacos ; telle est
l'origine de nos cigares. Le tabac, dont le nom est dû, soit à cette dénomination de tabacos donnée à la plante par les indigènes, soit à l'île de Tabago où elle se trouve en profusion, fut donc introduit en Espagne par Christophe Colomb. Son usage cependant ne se généralisa qu'en 1560, quand Jean Nicot, ambassadeur de France à Lisbonne, envoya à Catherine de Médicis de la poudre à tabac destinée à guérir ses migraines. L'engouement fut excessif en Amérique pour ce que l'on appelait le petun, en Europe l'herbe sainte, l'herbe de la reine, l'herbe à l'ambassadeur, là panacée antarctique. Une réaction violente succéda ; Louis XIII en interdit la vente ; Jacques Ier d'Angleterre écrit le Misocapnos contre les fumeurs ; le pape Urbain VIII n'y va pas par quatre chemins et les excommunie. Mais devant l'échec des persécutions, le gouvernement français en fait une source de revenus et dès 1674 Colbert, avisé, afferme le monopole des tabacs. Dieu sait où l'on s'arrêtera dans cette voie ! Christophe Colomb et Las Casas remarquent que les femmes faisaient usage des tabacos tout comme les hommes, Le beau sexe de cette époque fumait donc ; il était fort court vêtu, les danses étaient... agitées, les figures peintes de couleurs voyantes, cela se passait chez les femmes de la nature, sur l'autre rive de la Mer Ténébreuse longtemps avant 1492 plus de quatre siècles après, ces coutumes ont fait leur apparition sur notre rive européenne. Ce phénomène, du temps où nous faisions de la neuropathologie, s'appelait de la dégénérescence rétrograde... Colomb, retenu par des vents contraires, séjourna jusqu'au 12 novembre dans la baie du Rio de Mares, puis revint jusqu'à la hauteur de Nipe. Il avait appris des Indiens que dans le NE. se trouvait une île remarquable du nom de Babèque et il décida de s'y rendre, mais des vents contraires, quelquefois forts avec de grosses pluies, le retinrent sur cette côte Nord de l'extrémité Est de Cuba jusqu'au 4 décembre. La désertion de Martin Alonso Pinzon. Cependant, le 21 novembre : Martin
Alonso Pinzon, avec la caravelle Pinta, qu'il commandait, se sépara ce
jour-là des deux autres bâtiments, non seulement sans en avoir reçu l'ordre,
mais même contre la volonté de l'Amiral. Suivant ce dernier, Pinzon agit
ainsi par avarice, et parce qu'il avait conçu l'espoir de trouver une grande
quantité d'or avec l'assistance d'un Indien que l'Amiral avait fait embarquer
à bord de la Pinta. Il partit ainsi sans attendre, sans être forcé de
s'éloigner par aucun mauvais temps, mais seulement parce qu'il le voulut bien
et de propos délibéré. De plus, l'Amiral dit ici : Pinzon m'a fait et dit
bien d'autres choses... Le lendemain 22 novembre on lit : Cette nuit Martin Alonso Pinzon suivit la route de l'Est
pour aller à l'île Babèque où les Indiens disent qu'il y a beaucoup d'or. Il
naviguait en vue de l'Amiral dont il n'était guère éloigné que de seize
milles. Pendant toute la nuit, l'Amiral ne perdit pas de vue la terre ; il
fit plier ou ferler quelques-unes de ses voiles et tenir toute la nuit le
fanal allumé, parce qu'il lui parut que Pinzon venait à lui, ce qu'il aurait
fort bien pu faire s'il l'eût voulu, car la nuit était très belle et très
claire, et il faisait un vent doux et frais. Cet inqualifiable abandon de son poste et de son chef par Martin Alonso Pinzon à 3.000 milles du monde civilisé, en pleine expédition, est indigne d'un marin, quel que soit le siècle auquel il ait vécu. Il ne répond pas au caractère espagnol dont la marine, comme la nôtre, est fière de sa devise d'honneur et il ne peut être admis par un marin français. Il se passe de tout commentaire, mais explique bien des choses survenues au cours de cette expédition et bien des bruits colportés ensuite. Christophe Colomb ne méprisait pas l'or, car il reconnaissait sa puissance ; il le cherchait même avec une fébrilité qui peut ressembler à de l'âpreté ; mais en ce faisant il accomplissait son devoir, puisque c'était le but et la raison avoués de la mission qu'on lui avait confiée. Après avoir soigneusement étudié sa vie, ses exploits, nous gardons la conviction que, semblable à beaucoup de marins de tous les temps, dominé par l'attrait de l'inconnu, il accepta ou aurait accepté n'importe quel prétexte lui donnant les moyens d'accomplir l'œuvre camouflée sous le but officiel. Christophe Colomb avant tout était un explorateur. Martin Alonso Pinzon n'était qu'un aventurier, dans le mauvais sens du mot. La France eut des corsaires : tous étaient de courageux marins ; quelques-uns d'entre eux mirent leurs qualités uniquement au service de leurs propres intérêts, d'autres, heureusement la majorité, comme Surcouf, firent aussi des fortunes en combattant l'ennemi, mais chez ceux-ci l'amour de le Patrie, le souci de l'honneur dominaient tous les actes. Malgré les services qu'ils rendirent indirectement au pays, les premiers sont méprisables, alors que nous nous inclinons très bas et avec une admiration reconnaissante devant les autres. Exploration de Cuba. Colomb découvrit de nombreuses baies et pénétra dans trois d'entre elles. Dans le port qu'il appela puerto del Principe, il trouva 15 ou 16 brasses de profondeur et partout un fond de sable sans aucune roche, ce que désirent beaucoup de marins, parce que les rochers coupent les câbles des ancres des vaisseaux. Les navires de cette époque ne se servaient en effet, pour leurs ancres, que de gros câbles ; les câbles-chaînes ne furent adoptés que vers 1840. Avec les chaînes actuelles dont la solidité est considérable et qui agissent en même temps que les ancres par leur poids même et par leur adhérence au sol, on considère qu'il faut filer une longueur de trois fois la profondeur pour obtenir une tenue convenable ; encore faut-il être paré à filer davantage si le fond est médiocre, le courant violent, le vent fort ou la mer grosse. On peut donc imaginer la longueur considérable de câble qu'il fallait posséder à bord et envoyer dehors, pour parvenir au même résultat, ce qui compliquait singulièrement le choix d'une rade ainsi que le mouillage et l'appareillage. On devait en outre compter avec la fragilité relative de ce cordage qui risquait toujours de s'user ou de se couper, soit sur le fond même, soit par frottement, lors du passage à bord, sur les différents appareils servant à sa manœuvre. Maintenant que le progrès a simplifié la navigation dans tous ses détails, il est bon de temps à autre de se souvenir des conditions dans lesquelles naviguaient les caravelles, non seulement pour comprendre des textes comme celui que nous venons de citer, mais plus encore pour apprécier à leur juste valeur l'immense travail qu'elles accomplirent. Colomb séjourna dans la baie de Santa Catalina, évidemment celle de la Caye de Moa, et en la parcourant en embarcation son attention fut attirée par les grumètes qui jetèrent des cris en disant qu'ils voyaient des forêts de pins. Il reconnut aussi des chênes et se réjouit de voir qu'on pourrait construire des navires en ce pays et qu'il y avait de quoi y faire des planches et des mâts pour les plus grands vaisseaux d'Espagne... C'est là qu'il prit une antenne et un mât de misaine pour la Niña. Plus merveilleuse encore est la rade où il se rendit ensuite, et qui doit être celle où se trouve Baracoa, nommée Puerto Santo par lui. Son enthousiasme pour cette région est si débordant qu'il lui attribue des vertus inattendues. Elle est, écrit-il, bien différente de la Guinée dont les rivières n'engendrent que la maladie et la contagion, car, grâce à Notre-Seigneur, pas un seul des gens de mon équipage n'a éprouve jusqu'à ce jour le moindre mal de tête, aucun n'a été couché pour cause de maladie, à l'exception d'un seul qui souffrait de la pierre, qui en avait souffert toute sa vie, et qui s'est trouvé guéri après les deux premières journées de notre séjour dans ce pays. Colomb, évidemment, n'était pas aussi bon médecin que bon marin. Son admiration n'est pas toute littéraire et platonique ; il décrit avec soin caps, rades et ports et donne, pour les navigateurs qui lui succéderont, quantité de précieux renseignements, en particulier sur les passes à prendre pour entrer dans cette dernière rade et le bas-fond du milieu à éviter. Dans cette partie de son résumé, Las Casas s'attache plus strictement au texte original de Colomb et à diverses reprises cite les remarques qu'il fit sur les marées, les observations de latitude qu'il effectua avec le quart de cercle, et sa préoccupation de l'exactitude de son instrument. C'est la réponse à ceux qui l'accusent d'avoir négligé, par incapacité, de décrire les terres découvertes et de déterminer leurs positions. Aussi se gardent-ils bien de citer ces passages. Avant de quitter Cuba avec Colomb, notons que le 28 novembre il raconte qu'étant dans le port de Baracoa, les gens de l'équipage descendirent à terre pour laver leur linge. Cette remarque peut sembler insignifiante ; tout navigateur, lisant ce passage du journal de l'Amiral des Océans, reconnaîtra que l'importance attachée à ce fait, en apparence minime, dénote un véritable marin. Laver son linge à terre, dans l'eau douce, abondante et courante ! quelle joie pour le matelot, quelle volupté attendue, souhaitée, rêvée pendant les longues randonnées sur cette mer où il y a de l'eau, de l'eau partout, mais pas une goutte à boire et où celle du bord est sévèrement rationnée et jamais gaspillée pour le lavage ! Nous ne craignons pas d'être ridiculisé par ceux qui ont, comme nous, connu la vieille marine, en avouant l'émotion que nous donnent ces deux lignes et l'image qu'elles évoquent ! La découverte d'Hispañola et la perte de la Santa Maria. La Santa Maria et la Niña appareillèrent de Puerto Santo le 4 décembre et reconnurent que la côte de Cuba, après s'être dirigée vers le Sud, tournait au SW. Elles cherchèrent ensuite à remonter au NE. pour atteindre la fameuse Babèque (qui d'ailleurs n'a jamais existé), mais le vent debout persistant et forcissant, elles durent se contenter de faire de l'Est, ce qui les conduisit à la grande île que les Indiens appelèrent Bohio, que Colomb baptisa Hispañola (île Espagnole) et qu'on nomme depuis Saint-Domingue ou Haïti. L'Amiral atterrit le 5 au port de Saint-Nicolas, qu'il déclare encore supérieur à tous ceux qu'il avait vus précédemment. Il découvrit l'île de la Tortue, devenue célèbre au XVIIe siècle comme repaire des flibustiers, et mouilla dans le port de Conception. Contrarié par les vents debout et les calmes, il dut séjourner dans la baie d'Acul où il entra en relations très amicales avec le cacique ou Roi, Guacanagari. Pendant toute cette période, il étudia soigneusement les rades où il pénétra, les explorant à la sonde, désignant les points remarquables pouvant servir d'amers et il en donna des descriptions détaillées, qui sont une excellente ébauche d'instructions nautiques. Il quitta la baie d'Acul le 24 décembre et navigua vers l'Est. Le lendemain, jour de Noël, se produisit le plus dramatique incident de tout le voyage et nous ne croyons pouvoir mieux faire que de laisser ici la parole à Las Casas. Naviguant avec peu de vent, dans la journée d'hier (24 décembre), depuis la mer de Santo-Tomé jusqu'à la Punta Santa, la flottille en était à une lieue à la fin du premier quart, et il était onze heures du soir lorsque l'Amiral résolut de se coucher, car il y avait deux jours et une nuit qu'il n'avait pas reposé. Comme il faisait calme, le marin qui tenait le gouvernail prit aussi le parti de dormir et remit la barre à un novice, ce que l'Amiral avait toujours défendu pendant tout le voyage, soit qu'il y eût du vent ou du calme, c'est-à-dire que dans aucun cas on n'abandonnât pas le timon aux novices. L'Amiral était d'autant plus tranquille, quant aux bancs
et aux récifs, que toute la côte et les bas-fonds avaient été reconnus, ainsi
que les passes, sur une étendue de trois lieues. De plus la mer était calme comme dans une écuelle. Le courant entraîna le
vaisseau sur un des bancs. Quoiqu'il fût nuit on les
voyait et on entendait les brisans de plus d'une lieue ; le vaisseau toucha
si doucement, qu'on s'en aperçut à peine. Le novice, qui sentit le gouvernail
engagé et qui entendit le bruit des flots, se mit à crier. L'Amiral se leva à
ses cris avec tant de promptitude que personne ne s'était aperçu qu'on était
échoué. Le maître du navire qui en avait la garde se leva aussi ; l'Amiral
donna à tous l'ordre de mettre à la mer l'embarcation qu'on portait à la
poupe, d'y charger une ancre et de la mouiller sur l'arrière du vaisseau au
large. Le maître et plusieurs autres ayant sauté dans l'embarcation, l'Amiral
crut qu'ils faisaient ce qu'il leur avait commandé ; mais ils ne songèrent au
contraire qu'à se sauver à bord de la caravelle qui était à une demi-lieue au
vent, et la caravelle ne voulut pas les recevoir, en quoi elle fit très bien.
Alors ils revinrent au vaisseau, mais l'embarcation de la caravelle y arriva
avant eux. Lorsque l'Amiral s'aperçut que ses gens fuyaient, que la marée
baissait et que le vaisseau penchait d'un côté, il ne vit d'autre remède que
de couper le grand mât et d'alléger le navire autant que possible, pour voir
si on pourrait le remettre à flot et le tirer de là ; mais comme les eaux
continuaient à baisser et que le bâtiment penchait de plus en plus du côté de
la mer, il n'y eut aucun moyen d'y parvenir, et la mer étant très calme, les
coutures seules s'ouvrirent, mais le bâtiment resta en son entier. L'Amiral
se rendit à bord de la caravelle pour y mettre son équipage en sûreté ; et
comme il s'élevait déjà un petit vent
de terre, que la nuit n'était pas très avancée et qu'on ne savait pas au
juste jusqu'où s'étendaient les bancs, il mit en panne en attendant le jour,
et alors il passa à bord du vaisseau et y entra du côté du banc. Ce clair récit du drame ne demande aucun commentaire. Parce qu'il faisait beau et calme, peut-être parce que c'était le jour de Noël, la discipline se relâcha et le pire survint comme cela arrive souvent en mer, lorsqu'on s'y attend le moins. Cependant, si l'ordre donné par l'Amiral de porter immédiatement une ancre à jet — ainsi s'appellent les ancres légères destinées à être jetées avec des embarcations dans de semblables circonstances — sur l'arrière du navire avait été exécuté, on aurait peut-être pu déhâler la Santa Maria de sa fâcheuse position. Malheureusement, l'armement du canot, pris de panique, se sauva vers l'autre caravelle, en panne à une assez grande distance, et quand celle-ci envoya du secours, il était trop tard, la mer baissait, la nâo était condamnée. Plus d'une heure avait dû s'écouler depuis l'accident jusqu'au retour du canot, or la réussite d'une opération de déséchouage peut être compromise par quelques minutes, voire même quelques secondes d'hésitation. Des exemples nombreux pourraient appuyer cette affirmation et pour notre part, nous ne pouvons oublier que pendant la guerre nous échouâmes au petit jour, par brume blanche, notre patrouilleur-corsaire dans des parages particulièrement dangereux. Une inspection rapide fut faite à l'avant et à l'arrière, avec des espars — reliquat de nos expéditions-polaires et qui font toujours partie de nos armements — le navire dépoussé avec vigueur et habileté des roches qui le retenaient, un coup d'hélice donné prudemment et nous nous sommes retrouvés à flot, sans avarie d'importance. A peine dix minutes s'étaient-elles écoulées depuis le premier choc d'échouage ; mais, ainsi que nous l'apprit l'Annuaire des Marées, si nous avions hésité ou patachonné pendant seulement cinq minutes, la mer aurait commencé à baisser et notre bateau était irrémédiablement perdu. Il est vrai de dire que nous étions puissamment secondé par un équipage d'élite, comprenant d'ailleurs quelques hommes habitués, par la navigation dans les glaces, aux décisions promptes. Le jour même du naufrage, le cacique Guacanagari, informé, envoya tous ses sujets avec de très grandes pirogues pour décharger le vaisseau ; cela se fit avec beaucoup de célérité, par suite du zèle et des bonnes dispositions que le prince y apporta... L'Amiral certifie à ses Altesses qu'en aucune partie de la Castille, on ne pourrait mettre tant de soin pour tout conserver, et qu'on ne perdit pas même un bout d'aiguillette. La Niña était trop petite pour tout le personnel de la Santa Maria et l'Amiral décida en conséquence de construire un fortin en un lieu qu'il appela la Navidad ou la Natalité en souvenir de la date de ce débarquement forcé. Il y déposa des provisions de pain et de vin pour plus d'un an, des graines pour semer, de la pacotille pour les échanges : la chaloupe du vaisseau, beaucoup d'artillerie, et 39 hommes parmi lesquels des ouvriers, un calfat, un charpentier, un arquebusier, un tonnelier, un médecin, un tailleur et le secrétaire de la flotte Rodrigo Descovedo, natif de Ségovie, tapissier du Roi et officier du premier maitre d'hôtel, sous le commandement de Diégo de Arana, natif de Cordoue, avec Pedro Guttierez comme lieutenant. Il transmit à ces derniers tous les pouvoirs qu'il avait reçus du Roi et de la Reine. Avant de partir, bien qu'on eût toute confiance dans les Indiens, on tira le canon et on fit un simulacre de petite guerre, pour montrer la valeur des armes des européens et imposer la crainte et le respect. Sans vouloir anticiper sur les événements, remarquons que, sans la désertion de la Pinta, le personnel de la Santa Maria aurait pu être réparti entre les deux caravelles. Martin Alonso Pinzon et ceux de ses compagnons qui, de bonne volonté, souscrivirent à sa défection, portent sur leurs épaules la lourde responsabilité du drame qui s'en suivit ; de notre temps, ils seraient passés en conseil de guerre et la loi, après l'opinion publique, les aurait condamnés. Or, au cours des procès interminables que les héritiers de Colomb durent faire à l'Etat pour revendiquer sa succession, on entendit de très nombreux témoins, parmi lesquels se trouvaient des marins, des parents, des amis de Pinzon. C'est dans ces dépositions que puisèrent les critiques, dénigreurs de Colomb. Par principe, ils récusèrent ses amis ou ses parents, Las Casas ou Fernando, même les indifférents, mais ils retinrent les témoignages tendancieux des Pinzon et autres, qui, avec Martin Alonso, avaient trahi par simple esprit de lucre. Je crois et j'espère que cette méthode démoralisante est unique dans les annales de la critique historique. La construction du fortin et l'installation des premiers colons du Nouveau Monde furent terminés le 30 décembre. On employa le lendemain à faire le plein d'eau et de bois pour se rendre le plus tôt possible en Espagne ; il ne paraissait pas raisonnable à l'Amiral de s'exposer aux périls des découvertes avec un seul bâtiment. Cependant, la Niña n'appareilla que le 4 janvier 1493 au lever du soleil et, remorquée par sa chaloupe, suivit la passe que Colomb avait étudiée à la sonde et qu'il décrit minutieusement. Le soir, il mouilla au large d'une montagne remarquable qu'il nomma Monte Cristi, et prit soin dans son journal de prévenir celui qui voudrait se rendre à la Nativité qu'il doit aller reconnaître auparavant cette montagne à la distance de 2 lieues, réfutant une fois de plus l'accusation d'avoir voulu tenir secrètes les routes de ses découvertes. Il mouilla plusieurs fois dans les environs de Monte Cristi et, le 6, il fut rejoint par la Pinta. Martin Alonso, déçu par son propre insuccès et peut-être tardivement effrayé de son acte, vint, tout penaud, à bord de la Niña et chercha à s'excuser. L'Amiral en fut d'autant moins dupe qu'il reçut confirmation des intentions de M. A. Pinzon par un membre de son équipage, mais il désirait que l'expédition se terminât sans de nouveaux et inutiles incidents ; il pouvait craindre aussi que le succès même de son entreprise ne fût noyé au retour dans les controverses nées des scandales dont l'opinion publique s'empare avec joie pour discuter et diminuer les mérites d'un chef. Il dissimula donc et il eut raison. Le 8 janvier, de nouveau, on fit de l'eau et du bois ; Colomb continua à suivre la côte Nord de Hispañola, en mouillant fréquemment, et les caravelles parvinrent au Golfe des Flèches, ainsi nommé parce qu'il y eut là quelques difficultés avec des Indiens munis de cc s armes, Trois heures avant le lever du jour, il appareilla avec les brises de terre, puis fut favorisé par du vent d'Ouest. La fièvre de l'exploration reprenant le dessus, sa première idée fut de gagner l'ile Cario (Porto-Rico) qui lui avait été signalée par les Indiens, mais le vent qui s'éleva était favorable pour le retour ; ayant remarqué que ses gens commençaient à s'attrister de ce qu'on s'écartait du droit chemin, il alla reprendre le NE. q. E. qui menait directement en Espagne. La traversée du retour commençait. La traversée du Retour. Pendant les sept jours suivants, le temps resta beau, mais comme il fallait le prévoir, les vents soufflèrent de l'ESE., de l'Est et même de l'ENE. Les deux caravelles, en louvoyant ou en naviguant au plus près, n'arrivèrent à faire qu'une route générale NE. q. N. Leur marche fut en outre retardée car l'Amiral attendait souvent la Pinta parce qu'elle allait mal à la bouline (au plus près) et s'aidait peu de la misaine, le mât d'avant n'étant pas bon. Il dit que si son capitaine qui est Martin Alonso Pinzon avait eu autant de soin de se pourvoir d'un bon mât dans les Indes, où il y en a tant et de si beaux, qu'il en eut de se séparer de lui dans l'espérance de remplir d'or son bâtiment, il l'aurait mis en bon état. Ils atteignirent le 65°30' de longitude Ouest (Gr.) par 30° de latitude Nord vers le 23 janvier ; se trouvant déjà dans une zone de vents plus variables qui soufflèrent depuis l'ESE. jusqu'au SW., ils purent faire une route générale assez bonne au NE. q. E. Cette direction était suivie intentionnellement, puisque du premier au 4 février, c'est avec bon vent en poupe, c'est-à-dire du WSW., que l'on fit route à l'ENE., alors que le vent de cette aire du compas eût facilement permis, si Colomb l'avait jugé bon, de mettre le cap directement à l'Est. L'Amiral décrit bien le moment où il sort nettement et définitivement des alizés, signalant lés changements de vent fréquents, les alternances de calme, le ciel chargé. Aussi, malgré la mer qui resta belle ces signes le décidèrent à faire tous les essais et prendre toutes les précautions que les bons marins ont coutume de prendre et doivent prendre en prévision du mauvais temps possible. Pendant cette période, nous l'avons vu, il traversa à nouveau une petite partie de la mer des Sargasses et y continua ses observations. Le 4 février, l'escadrille se trouvait environ par 53° de longitude Nord (Gr.) et 37° de latitude W. ; la Niña et la Pinta étaient en pleine zone de vents variables, mais avec prédominance marquée de ceux de la région Ouest, elles firent bonne route à l'Est jusqu'au 12, contrariées seulement du 8 au 9 par des vents debout qui les obligèrent à louvoyer. La route qui fut ensuite reprise et continuée était excellente et eut, sans le mauvais temps qui survint, mené Colomb et ses compagnons directement au Cap Saint-Vincent. Ceci est remarquable, car l'Amiral signale le 3 février, veille du jour où l'on mit le cap franchement à l'Ouest, qu'il ne put prendre la hauteur du soleil ni avec l'astrolabe, ni avec le quartier de réduction, parce que la houle ne le lui permit pas, et les jours suivants il dut se trouver dans la même impossibilité puisque le ciel était très couvert, chargé et pluvieux. Cette habileté du marin amateur à calculer la route à l'estime seule est vraiment extraordinaire. Le 12 février, le temps se gâta ; l'Amiral commença à avoir la grosse mer et à éprouver la tempête, et il dit que si la caravelle n'avait pas été si bonne et en si bon état, il aurait craint de périr. Les jours qui suivirent furent affreux et la merveilleuse aventure fut bien près de se terminer par un drame. Les caravelles furent assaillies par une formation cyclonique nous obligeant à entrer de nouveau dans quelques explications météorologiques, qui compléteront celles que nous avons données à propos des alizés, et nous serviront d'ailleurs pour la compréhension de certains épisodes des autres expéditions de Christophe Colomb. Les cyclones et les bourrasques. Un cyclone est un coup de vent d'une violence exceptionnelle, qui prend naissance dans la zone torride. C'est une immense masse d'air, animée d'un mouvement giratoire autour d'un centre déterminé, et qui se déplace suivant une direction sensiblement parabolique. Les dimensions de ce tourbillon à surface circulaire augmentent au fur et à mesure qu'il avance. Le mouvement de rotation du vent qui le constitue est indirect, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans les cyclones de l'hémisphère Nord, et au contraire direct, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, dans ceux de l'hémisphère Sud. Au centre du tourbillon se trouve une zone de calme d'un diamètre variable. Le baromètre baisse d'autant plus qu'on se rapproche du centre. Les cyclones de l'hémisphère Nord, les seuls qui nous intéressent, prennent naissance un peu à l'Est des Antilles vers 10° de longitude Nord, sur le bord Nord de la bande des calmes, puis se déplacent vers l'Ouest jusqu'à atteindre la limite Nord des alizés ; là, leur trajectoire s'arrondit et s'infléchit ensuite vers le NE. et le tourbillon continue sa route sur l'Europe en s'élargissant. La rotation du tourbillon dans l'hémisphère Nord se faisant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on comprendra facilement que pour la partie du tourbillon où le vent souffle dans une direction semblable à celle de la route ou trajectoire, les deux forces de rotation et de translation s'ajoutent. Cette partie de la masse de fixation qui est. à main droite de la trajectoire est ainsi soumise à un déplacement d'air d'une violence inouïe et constitue la zone dangereuse ; celle qui est à gauche est par contre la zone maniable, puisque les vitesses de translation et de rotation se trouvant agir en sens inverse l'une de l'autre se retranchent. Sur l'Atlantique Nord, les cyclones, dans la proportion de go pour zoo, se développent en août, septembre et octobre, époque où les alizés sont faibles et interrompus par des calmes fréquents. Dès que le cyclone a éclaté, le vent souffle avec une fureur extrême ; souvent une pluie torrentielle accompagne l'ouragan et le baromètre baisse de plus en plus[31]. Au bout de 10, 12, 15 heures, si le centre passe sur le navire, le vent tombe brusquement et le calme est parfois alors si complet, qu'une bougie tient allumée sur le pont. Ce cercle de calme peut avoir 10, 15, 30 milles de diamètre. Généralement, les navires y restent 2 ou 3 heures, mais certains y ont séjourné jusqu'à 12 heures ; cette durée dépend du diamètre du calme central et de la vitesse de translation de l'ouragan. La mer, déjà très grosse, formée de houles aux directions différentes, devient effroyable ; c'est un monstrueux clapotis sans direction déterminée, et les vagues, n'étant plus soumises à l'action du vent, se dressent pyramidales dans un désordre impressionnant. Bientôt la pluie cesse, le ciel s'éclaircit au zénith, un cercle bleu apparaît ; c'est l'œil de la tempête, ou suivant l'expression pittoresque des marins anglais, the bull's eye, l'œil du taureau. Mais brusquement, le vent qui a sauté au cap opposé souffle de nouveau ; la tempête, comme un coup de fouet, reprend avec encore plus de violence que précédemment, et le navire, s'il a échappé à la mer affreuse de la zone de calme, est soumis aux mêmes fureurs. Le baromètre pourtant remonte et le vent finit par s'apaiser. L'épreuve du cyclone fut épargnée à Christophe Colomb lors de son premier séjour aux Antilles, mais il n'y échappa pas plus tard et apprit à en connaître la violence et les signes précurseurs. Nous anticipons donc par cette description, mais ces détails sont indispensables pour comprendre le genre de coup de vent que les caravelles eurent à subir du 13 au 15 février 1493. Cette manifestation météorologique aurait pu être un cyclone provenant des Antilles ; cette hypothèse doit être écartée, d'abord à cause de la saison où s'y trouvaient les caravelles, et surtout parce que la description de l'Amiral ne coïncide pas avec celle de cyclone classique, tandis qu'elle s'adapte bien au phénomène dont nous allons nous occuper maintenant. Dans les régions tempérées, au Nord de la bande occupée par les alizés, l'équilibre général de l'atmosphère est instable par suite de causes multiples, parmi lesquelles se placent en première ligne la température variable des continents et le contact de l'air avec les eaux à température élevée et également variables du Gulf Stream. Aussi, surtout aux changements de saison, doit-on s'attendre à des dépressions barométriques considérables en différents points de cette zone. Lorsqu'une dépression se forme par exemple sur l'Amérique du Nord, un tourbillon analogue — mais non similaire — aux cyclones peut se créer. Il sera d'autant plus violent que les parois de la dépression seront plus abruptes et plus creuses, ou en d'autres termes que le gradient barométrique sera plus considérable. Une fois formé, il sera entraîné par le déplacement général de l'atmosphère vers l'Ouest et viendra attaquer les côtes d'Europe, en commençant généralement par l'Irlande, puis l'Angleterre et les côtes occidentales de France. Pour la même raison que les cyclones dans l'hémisphère Nord, ces tourbillons qui prennent alors le nom de bourrasques ont à leurs origines un mouvement propre de rotation en sens inverse des aiguilles d'une montre. Ces bourrasques sont accompagnées d'une forte dépression barométrique qui s'accentue en approchant du centre. Leur forme générale est circulaire au début, mais elles sont plus étendues en surface que les tourbillons des cyclones et ont un caractère giratoire moins régulier. La vitesse de translation, d'abord faible, augmente au fur et à mesure de leur avance ; la vitesse de rotation est peu différente de celle-ci et peut lui être supérieure. Il en résulte que dans la partie qui représente la zone dangereuse, la direction du vent restera sensiblement celle de la trajectoire, c'est-à-dire SW., tandis que dans la partie Nord, qui serait la zone maniable, les deux vitesses peuvent s'annuler, au point qu'il n'y ait que peu d'effet produit, et que la bourrasque se réduise à un coup de vent de SW. La zone de calme central n'existe généralement pas, mais le centre existe et la direction SW. du vent perçu par le navire qui se trouvait dans la zone dangereuse ne changera pas pour lui avant le passage de ce centre. Alors, dans les cas ordinaires, le baromètre remontera et le vent sautera au NW. La dépression se comblant progressivement, la bourrasque se désorganise. Les dimensions de ces bourrasques sont souvent considérables et peuvent couvrir un espace comprenant de 15 à 20 degrés de latitude. Si les cyclones prennent toujours naissance dans la même zone de la région torride, les origines des bourrasques sont en des points très divers des régions tempérées. Effets de causes analogues, moins nettes, elles sont aussi moins brutales. Les cyclones sont des types schématiques ; les bourrasques en sont les formes frustes et généralement atténuées. Elles-mêmes varient à l'infini comme étendue, violence, rapidité de déplacement, fréquence, forme. Elles peuvent se suivre en chapelet, parfois deux bourrasques voisines se rapprochent et se confondent ; la masse en mouvement peut être circulaire, irrégulière, boursouflée, ellipsoïdale, et sa marche d'une extrême lenteur ou d'une rapidité extraordinaire. Ces bourrasques sont les coups de vent habituels, plus ou moins violents, que nous subissons en France. Le vent souffle pendant quelque temps du Sud, quelquefois même du SE., puis prend de la force en venant du SW. avec ciel chargé et pluie ; après un temps plus ou moins long, parfois dans un grain violent, la saute au NW. se produit en même temps que le ciel claircit. Ceci, comme dans les cyclones, est l'œil de la tempête, mais cette clarté du ciel peut ne pas coïncider exactement avec le centre du phénomène. Le vent souffle alors avec violence dans la nouvelle direction, tandis que le baromètre remonte. Si le vent tourne au Nord puis au NE., le beau temps revient, tandis que si, suivant l'expression des marins, le vent recule, c'est-à-dire retourne vers le Sud, en passant par l'Ouest, une nouvelle dépression arrive et le mauvais temps recommence. On pourrait appeler ces bourrasques des formations cycloniques, mais, confondant la cause avec l'effet, on les nomme généralement des dépressions. Les signes précurseurs sont d'ailleurs identiques ; si, dans les vrais cyclones, ils sont schématiques comme le phénomène lui-même, ils sont frustes pour les bourrasques et peuvent se résumer ainsi : une houle souvent en sens opposé de la direction du vent régnant, ou nullement en rapport avec sa force, précède tout autre signe, en créant quelquefois une mer étrange et tourmentée ; le baromètre cesse son mouvement régulier et baisse rapidement, le ciel prend un aspect particulier et le phénomène éclate au bout d'un temps plus ou moins long. Tonnerre et éclairs sont rarement observés dans le corps même d'une formation cyclonique, alors qu'ils sont au contraire fréquents dans les faubourgs de la masse tourbillonnaire. Dans les régions tempérées, les éclairs, au NW. ou au NE., sont les signes à peu près certains d'un coup de vent qui pourra venir du cap opposé. La Niña dans la tempête. Or, après avoir éprouvé la grosse mer, c'est-à-dire la houle prémonitoire, le 12 février, l'Amiral nous dit que des éclairs partirent trois fois du NNE. et que c'était l'annonce d'une grande tempête qui devait venir de ce côté ou du côté opposé. Il eut à lutter contre l'impétuosité des vents et des vagues d'une grosse mer agitée par la tempête... la mer devint terrible et les ondes, qui se croisaient, tourmentaient (atormentaban) les navires. Ce croisement des houles, soulevées par la proximité de l'action des différents vents, est bien caractéristique des formations cycloniques. Pendant la nuit du 13 au 14 février, le vent augmenta encore, les vagues étaient épouvantables ; venant des deux côtés opposés, elles se croisaient et paralysaient la marche du vaisseau, qui ne pouvait ni avancer ni sortir du milieu d'elles. Après avoir fui la veille à mats et à cordes, c'est-à-dire à sec de toile, devant cette mer affreuse, l'Amiral avait fait réduire, autant que possible, la grand'voile afin qu'elle ne pût produire d'autre effet que celui de retirer son bâtiment du milieu des flots. Ceci équivaut à dire que la Niña prit la cape. On se résout à adopter cette allure quand le vent et la mer sont devenus tellement forts que l'on ne peut plus conserver les voiles habituelles ni continuer sa route sans danger. Prendre la cape, c'est tenir le navire à peu près vent de travers en ne conservant que quelques voiles résistantes, de telle sorte que par l'action du vent sur ces voiles, sur la coque et sur le fardage, le navire ne fasse guère que dériver latéralement avec une vitesse en avant presque nulle. En dérivant ainsi fortement, il crée au vent à lui un remous protecteur et les lames en venant se briser dans ce remous n'atteignent pas le bâtiment. Si la cape est insuffisante pour sauver le navire, il ne reste plus que la ressource de la fuite. Or, la mer devenait de plus en plus grosse et le vent de plus en plus violent. Voyant le danger aussi imminent, la Niña se mit à courir en poupe où le vent la portait, parce qu'il n'y avait pas d'autre tarti à prendre. Mais un navire en fuite doit conserver assez de voilure pour avoir un peu de vitesse propre, non seulement afin de pouvoir gouverner et prendre convenablement la lame par l'arrière ou la hanche, mais encore, par sa marche dans le même sens, diminuer d'autant la violence de l'attaque du vent. Aussi, l'Amiral tenait toujours sa grande voile établie afin que le vaisseau pût sortir du milieu des flots qui le couvraient en se croisant, et qui menaçaient de le submerger. Lorsque la Niña mit en fuite, la caravelle Pinta, que montait Martin Alonso Pinzon, se mit à courir aussi ; mais elle disparut bientôt quoique toute la nuit l'Amiral lui fit des signaux, et qu'elle lui répondit jusqu'à ce qu'elle en fut empêchée probablement par la force de la tempête et par son éloignement de la route que suivait l'Amiral. Nous ne voulons pas insinuer que Martin Alonso Pinzon abandonna volontairement son chef une seconde fois, dans le danger, bien que sa conduite antérieure autorise cette accusation ; nous admettrons qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de faire autrement, étant parti des Antilles — par sa faute — avec un mât en mauvais état. Par suite de la consommation des vivres, de l'eau et du vin, le vaisseau était très lège ; ce mal fut réparé en remplissant d'eau de mer, aussitôt que cela fut praticable, les pipes vides. Ayant ainsi tenté tout ce qui était au pouvoir des hommes, l'Amiral s'adressa à Dieu et ordonna de tirer trois pèlerinages individuels au sort, avec des pois chiches dont l'un était marqué d'une croix ; on fit ensuite un vœu général par lequel l'Amiral ainsi que tout son équipage s'engageait, dans la première terre où ils arriveraient, à aller tous en chemise et processionnellement, faire une prière dans une église sous l'invocation de Notre-Dame. Outre les vœux généraux, ou faits en commun, chacun faisait en particulier son vœu parce que personne ne croyait échapper. La grande et toute naturelle préoccupation de Christophe Colomb était que sa découverte ne pérît pas avec lui. Plein de cette pensée, il chercha les moyens d'apprendre à Leurs Altesses la victoire que le Seigneur lui avait fait remporter en lui faisant trouver dans les Indes tout ce qui était le but de son voyage... A cet effet il prit un parchemin et y écrivit tout ce qu'il put sur les découvertes dont il était l'auteur et pria instamment celui qui le trouverait, quel qu'il fût, de le porter au Roi et à la Reine. Il enveloppa ce parchemin dans un grand morceau de toile cirée, ferma hermétiquement ce paquet, l'attacha solidement, se fit apporter une grosse barrique de bois et l'y mit. Il le fit ainsi jeter à la mer. Une autre barrique contenant un document semblable fut placée sur le château-arrière et fixée à une longue ligne, pour être retrouvée au cas où la Niña viendrait à chavirer sans couler. Ces barriques ne furent jamais repêchées... mais H. Harrisse, toujours avec humour, cite José Maria Asensio, racontant sérieusement en 1892, dans sa Vie de Christophe Colomb, que le navire Chieftain, de Boston, qui draguait le 27 août 1852, vers midi, sur la côte du Maroc pour prendre du lest (?), trouva un coffret renfermant une noix de coco ; cette noix contenait le parchemin relatant la découverte des Indes, de la main de Christophe Colomb. Un libraire de Gibraltar en aurait offert 100 dollars, mais le matelot d'Auberville qui le détenait les refusa et a peut-être encore le document, s'il est toujours de ce monde. D'autre part, un quotidien de Mexico, paru il y a environ un an, annonçait que M. Angel Delmote, habitant les faubourgs de Mexico, possédait le journal de Christophe Colomb trouvé en mer dans une bouteille. Ce parchemin enluminé, écrit en lettres gothiques, très détérioré, avait été acheté par son propriétaire actuel à un Juif de La Havane. Le professeur J. Barnouw, de l'Université de Colombia, appelé à l'identifier, constata que la forme des lettres ainsi que les termes employés correspondaient au XVIIIe siècle et que cet ersatz-document était écrit en... allemand. Mais revenons à la Niña, toujours en fuite devant la tempête. Les averses et les bourrasques (évidemment le grain classique) qui survinrent quelque temps après changèrent le vent, qui se tourna à l'Ouest. Ayant amené la vergue de grand'voile qu'il craignait de voir tomber en bas, l'Amiral remit en fuite dans la direction nouvelle sous la misaine, qui est certainement la meilleure voilure pour cette allure. Peu de temps après, le ciel commença à se montrer serein vers la partie occidentale de l'horizon : c'était l'œil de la tempête et la Niña passait dans la zone maniable. Le vent se leva de ce côté : la mer était encore très grosse et très agitée, cependant elle s'abaissait un peu et on put faire un peu plus de voilure. Le vent continua à tourner classiquement par le Nord et il ne tarda pas à passer à l'Est Nord-Est par la proue, et la mer venait toujours très grosse du côté de l'Ouest. L'équipage aperçut bientôt la terre et trois jours après, le 18, en tirant des bordées, on y parvint enfin. Il s'agissait, comme le croyait bien l'Amiral, d'une des Açores, l'île Sainte-Marie, la plus Sud du groupe. Dans l'Atlantique Nord, revenant du Groenland il y a de cela fort peu de temps, nous fûmes assaillis par une dépression qu'une annonce du bulletin météorologique britannique, lancée par la T. S. F., nous avait fait prévoir et que la chute de nos baromètres enregistreurs avait d'ailleurs confirmée. Ce sont là deux moyens qui manquaient à Christophe Colomb, mais si nous avions à raconter ce coup de chien, nous pourrions nous servir de la description qu'il donna, jusque dans le détail des manœuvres. Cette dépression, ni la première ni la plus violente que nous ayons traversée, nous intéressa par sa similitude avec celle que subit l'Amiral des Océans. Bien que notre navire, trois-mâts barque à faible machine auxiliaire, fût beaucoup plus un voilier qu'un vapeur, nous bénéficiions des progrès accomplis pendant cinq siècles et d'un matériel ultra-solide, mais nous avons pu nous rendre compte de ce que devait être l'épreuve supportée par la petite Niña, et de quelle trempe étaient les hommes qui affrontaient ainsi les colères de la Mer Ténébreuse. L'arrivée aux Açores puis à Lisbonne. Sainte-Marie des Açores ne possède aucun port sérieux et le temps n'était toujours pas beau ; la Niña, cependant, mouilla en rade foraine. La Castille étant en paix avec le Portugal, il n'y avait aucune raison de craindre un mauvais accueil, et la moitié de l'équipage débarqua pour accomplir son vœu, tandis que Colomb attendait son retour pour faire de même avec le reste. Le Capitaine de l'île, Juan de Castaneda, retint cependant les pèlerins prisonniers et tenta, heureusement sans succès, de faire débarquer l'Amiral. Obligé de dérader, Colomb chercha en vain un abri dans le voisinage et n'ayant plus que trois vrais marins à bord, il dut revenir à son précédent mouillage. Après menaces et discussions, on finit par s'entendre avec les Portugais, et les prisonniers furent relâchés. Le 24 février, l'Amiral mouilla dans un endroit qu'il croyait convenable pour prendre des pierres afin de lester son navire, mais la houle ne permit pas à la chaloupe d'aller à terre. Le vent étant favorable pour se rendre en Castille, la Niña appareilla comme elle était et gouverna à l'Est. Elle fit bonne route pendant trois jours, puis fut bafouée par des vents contraires et variables pendant trois autres. Du 2 au 3 mars, on marcha en direction, dans de bonnes conditions, mais ce dernier jour, une nouvelle dépression tomba sur la caravelle, emportant toutes les voiles établies et la mettant dans un péril imminent. On fuyait de nouveau, à sec de toile, quand la terre apparut droit devant, et l'on fit tant bien que mal un peu de voilure pour capeyer jusqu'au jour. L'Amiral reconnut alors la terre qui était la roche de Cintra, située près du fleuve de Lisbonne, dans lequel il se détermina à entrer parce qu'il n'avait pas d'autre voie de salut, tant était terrible la tourmente qui avait lieu sur la ville de Cascaes, située à l'embouchure du fleuve. Christophe Colomb mouilla donc le 4 mars dans le Tage, devant Rastelo, où il apprit, des gens de mer qui s'y trouvaient, qu'il n'y avait jamais eu un hiver si fécond en tempêtes ; que vingt-cinq bâtiments avaient péri sur les côtes de Flandre, et qu'il y en avait d'autres dans les ports de cette province qui, depuis quatre mois, n'en pouvaient sortir. Le lendemain, Bartolomé Diaz, patron du grand vaisseau
portugais mouillé lui aussi dans le Tage et jouant évidemment le rôle de
stationnaire, arraisonna la Niña et voulut exiger que Colomb vint rendre compte à bord. Celui-ci refusa, excipant de
sa situation d'Amiral ; la discussion s'engagea et les choses allaient mal
tourner, quand il fit enfin ce qui aurait tout arrangé dès le début : il
montra ses papiers, satisfaisant ainsi aux exigences des règlements et de l'administration,
qui sont de tous les siècles et de tous les pays. Aussitôt Alvaro Dance, le
capitaine du navire de guerre portugais, informé par son subordonné, se rendit à la caravelle dans le plus grand ordre, au son
des timbales, des trompettes et des fifres, pour rendre les honneurs à
l'Amiral des Océans de Castille, et se mit entièrement à sa disposition. Que
de fois, mouillant devant un port militaire étranger, n'avons-nous pas reçu
la même visite et entendu la même déclaration, courtoise et sincère, après
les mêmes formalités remplies ! Colomb fut désormais traité comme les explorateurs de tous temps ; les visiteurs en grand nombre envahirent la Niña, qui devint un but de promenade pour la population. Tout le monde voulait voir les Indiens, les perroquets, les bibelots rapportés ; des questions nombreuses et souvent oiseuses durent être posées, permettant à l'équipage de donner libre cours à son imagination. Chacun s'émerveilla qu'un bateau aussi petit ait pu traverser une mer aussi grande. Le Chef de l'Etat, le Roi Joâo II, ordonna que ses arsenaux donnassent à l'Amiral tout ce qu'il pouvait désirer, le considérant, avec tous ceux de son navire, comme ses hôtes pendant leur séjour, Oubliant les différends survenus huit ans auparavant, il fit venir Colomb à la Cour et lui ménagea une magnifique réception. La Reine à son tour tint à le recevoir au monastère de Saint-Antoine, près du village de Villafranca où. elle se trouvait. Les souverains lui offrirent enfin de le faire conduire par terre et à leurs frais en Castille. En vrai marin, Colomb, désireux de revenir sur son navire, refusa et appareilla le 13 à huit heures du matin. Le retour en Espagne et le triomphe de Colomb. Après une traversée sans incident, le 15 mars, au lever du soleil, il était à la hauteur de Salies, et il entra vers midi, avec la marée montante, jusque dans ce port, d'où il était parti le 3 août de l'année précédente. L'absence totale de l'expédition avait donc été de huit mois et douze jours. La traversée d'aller avait nécessité quarante-trois jours de mer et celle de retour en demanda quarante-quatre. Par un de ces hasards comme on en rencontre quelquefois, la Pinta disparue depuis le 13 février arriva à Saltès quelques heures après la Niña [32]. Poussée par la tempête, elle avait atterri au port galicien de Rayonna près de Pontevedra. De là, M. A. Pinzon avait écrit aux Rois Catholiques. Ni sa lettre, ni la réponse que lui fit la Reine n'ont été conservées. Nous remarquerons simplement que son débarquement passa inaperçu et que ce lieutenant transfuge et de mauvaise foi, comme le dit le très impartial H. Harrisse, mourut peu de temps après de dépit... à moins que ce ne fût simplement de maladie ; peu importe, d'ailleurs. Certains, nous l'avons déjà dit, ont voulu opposer M. A. Pinzon à C. Colomb. Les uns, affligés de ce triste état d'esprit poussant à haïr tout ce qui est grand, cherchent à rabaisser l'Amiral dont on a trop parlé à leur gré ; d'autres s'imaginent satisfaire l'amour-propre de l'Espagne en prouvant que le Nouveau Monde a été découvert par un Espagnol. C'est bien mal connaître le caractère chevaleresque de ce pays généreux et c'est même lui faire injure. N'est-ce pas d'ailleurs un magnifique titre de gloire pour une nation d'avoir justement reconnu la valeur extraordinaire de cet homme, de l'avoir compris, accueilli, soutenu, alors qu'il était un étranger ? M. A. Pinzon aurait toutefois pu trouver place dans les plus belles pages de l'Epopée de Colomb et tant que nos connaissances se limitaient aux récits classiques, nous rapprochions assez volontiers dans notre admiration les noms du chef et du lieutenant. Mais les détracteurs qui ont voulu abaisser Colomb pour élever M. A. Pinzon ont eu le tort de trop attirer l'attention sur ce dernier. Sans exhumer les ragots, sans se livrer à des hypothèses gratuites ou à de l'acrobatie psychologique, les faits reconnus et admis suffisent amplement à justifier une mauvaise opinion. Martin Alonso Pinzon avait, nous affirme-t-on, les connaissances professionnelles, l'influence, l'autorité, l'argent, les navires, le personnel, suffisants et au delà, pour armer lui-même cette expédition. Il avait trouvé au Vatican, prétend-on encore, des renseignements et une carte qui semblaient devoir le conduire aux îles inconnues et à Cypango. Il avait donc tout — mais il n'est pas parti, sinon à la remorque du Génois qu'il méprisait tant et dans lequel il n'aurait jamais eu confiance ! Pendant la traversée d'aller, il ne commit que des erreurs et des fautes et empêcha son chef de découvrir directement le continent du Nouveau Monde. Il fut une cause perpétuelle de discorde. En pleine expédition, devant l'inconnu des hommes et des éléments, par simple esprit de lucre, il abandonna ses compagnons, déserta son poste, courut à l'insuccès et revint tout penaud — mais à cause de cette fugue honteuse, 42 hommes abandonnés sur la côte d'Hispañola trouvèrent la mort. Au cours de la traversée de retour, il ne sut pas rester auprès de la Niña surchargée de monde et en danger. On nous rabâche que c'était un admirable marin ; nous voulons bien le croire, mais il n'a guère montré ses qualités pendant cette expédition et il apparaît plutôt comme un aventurier intéressé, brouillon, égoïste et sans scrupules. Tous les pays du monde ont leur M. A. Pinzon et ne s'en vantent pas, mais un seul peut s'enorgueillir d'avoir adopté Christophe Colomb. Le nom de ce grand navigateur et celui de l'Espagne rayonneront dans l'histoire, toujours indissolublement unis, pendant les siècles et les siècles. En débarquant à Palos, où la population l'accueillit avec une sorte de délire, Colomb qui, pendant la tempête du 14 février, avait tiré le pois-chiche marqué d'une croix, alla, en conséquence, accomplir le vœu en portant un cierge de cinq livres à la Très Sainte et Benoiste Vierge du Couvent de la Rabida. Il s'enferma pendant sept jours avec ses amis le Prieur Juan Perez et le Père Marchena. Il fit ainsi une sorte de retraite conforme à ses goûts religieux, et trouva le meilleur moyen de mettre de l'ordre dans ses rapports et dans toutes les affaires concernant son retour, protégé derrière les murs inviolables du monastère des visites officielles ou officieuses des curieux et des importuns. Par lettre adressée à Don
Christoforo Columbo notre Amiral de la Mer Océane Vice-Roi et gouverneur des
Iles découvertes dans les Indes, il fut appelé d'abord à Séville afin
de rendre compte de ses découvertes et recevoir des ordres pour une nouvelle
expédition ; mandé à Barcelone, il y fut le héros d'une réception émouvante.
Après avoir assisté à un Te Deum laudamus, le Roi et la Reine le
comblèrent d'honneurs et de faveurs. En même temps que le traité de Santa-Fé fut confirmé, souverains lui accordèrent, le 20 mai 1493, des lettres de noblesse[33]. Son blason contenait au premier, le château de Castille sur champ de sinople ; au second, le lion de Léon pourpre sur champ d'argent avec langue de sinople ; au troisième, des ondes d'azur parsemées d'îles d'or ; le quatrième champ restait réservé à vos armes que vous aviez coutume de porter. Colomb, fort embarrassé parce qu'il n'avait jamais porté d'armes, bien qu'il l'ait laissé supposer, présenta un écusson des plus fantaisistes, composé d'une bande d'azur coupant diagonalement de droite à gauche un champ d'or au chef de gueules. Les origines plébéiennes de Christophe Colomb ne lui ayant pas infusé le respect absolu du blason, il modifia plus tard naïvement et puérilement celui qui lui avait été octroyé. Dans le frontispice du cartulaire original, dressé sous ses yeux à Séville en 1502, on le retrouve arrangé à sa façon ; quelques couleurs sont modifiées pour donner à l'ensemble un aspect royal : le château est sur champ de gueules, le lion est brun sans langue verte ; au troisième, les côtes d'une terre ferme sont ajoutées aux îles et au quatrième sont cinq ancres d'or sur champ d'azur, emblème de l'Amiral de Castille, tandis que ses armes propres sont en pointe dans un écu renversé. En ce qui concerne la jolie devise que tout le monde connaît Par Castillo y por Leon, Nuevo Mundo halo Colon — Pour Castille et pour Léon, Nouveau Monde trouva Colomb — si l'Amiral des Océans la rêva peut-être, il ne la connut jamais et moins encore transformation ultérieure de hallo en dio, c'est-à-dire de trouva en donna. Colomb était l'homme illustre du jour, il subit les fatigues et les obligations des interviews, des réceptions et des banquets ; les uns l'invitaient par curiosité et en témoignage d'admiration sincère, les autres par snobisme, pour offrir à leurs invités le plat à la mode. Les femmes lui faisaient mille agaceries, les petits garçons le regardaient avec des yeux ronds, un peu déçus de le voir habillé comme tout le monde, sans plumes de perroquet ou d'aigle sur la tête et sans anneau dans le nez. C'est à un solennel banquet, donné en son honneur par Son Eminence le Grand Cardinal de Mendoza, que se place l'incident de l'œuf, trop classique pour que nous le relations à nouveau. Le banquet chez le Cardinal eut certainement lieu, et peut-être aussi l'histoire de l'œuf, celle-ci, en tous cas, n'est pas une invention Colombienne. Bien avant 1493, c'était une blague de rapin attribuée à un des plus célèbres d'entre eux, Brunelleschi, mort en 1444, après avoir construit entre autres merveilles Santa Maria del Fiori et le palais Pitti à Florence. ***Les découvertes de Colomb devaient forcément créer des complications diplomatiques entre le Portugal et le Royaume de Castille. Une bulle du pape Martin V avait donné à la couronne de Portugal toutes les terres qu'elle découvrirait depuis le Cap Bojador jusqu'aux Indes, et le Roi et la Reine de Castille s'étaient engagés en 1479 à respecter ces droits. Le Roi de Portugal Joâo II argua de ce traité, et il s'ensuivit des négociations avec Ferdinand qui menacèrent de se prolonger, chacun tenant à ses points de vue. A cette époque, le Pape jouait le rôle de la Société des Nations et les Rois Catholiques hésitèrent d'autant moins à s'adresser à lui, qu'Alexandre VI, né à Valence, avait été sujet de la couronne d'Aragon. Le Saint-Père, le 4 mai 1493, par la bulle In cœna Domini, mit fin aux contestations en traçant une ligne idéale joignant le Pôle Nord au Pôle Sud en passant à 100 lieues à l'Occident de l'île Florès (Açores). Tout ce qui se trouvait à l'Ouest de cette ligne devait revenir à l'Espagne, tout ce qui était à l'Est au Portugal. Or, ainsi que le fait remarquer le professeur belge L. Lagrange[34], cette ligne passait justement par le point de déclinaison 0° de l'aiguille aimantée, relevé pour la première fois par Christophe Colomb. Comme le Pape, avant de rendre son arrêt, correspondit avec le grand Navigateur, celui-ci ne manqua certes pas d'attirer son attention sur ce phénomène étrange ; cela explique le choix, autrement un peu arbitraire, qu'il fit des cent lieues à l'Ouest des Açores. Finalement, le 7 mai 1494, les rois des deux nations s'entendirent à l'amiable et reculèrent cette ligne de démarcation à 370 lieues plus à l'Ouest, ce qui devait, six ans après, permettre aux Portugais de profiter des découvertes de Cabral. Ce navigateur, en effet, voulant doubler le Cap de Bonne-Espérance, poussa à l'Ouest sur le conseil de Vasco de Gama et le 22 avril 1500, en abordant à Itacolumi (Brésil), aurait découvert par hasard l'Amérique si C. Colomb ne l'avait fait avant lui. ***La période qui s'écoula depuis le retour de la Niña à Palos jusqu'au départ de Cadix de la 2e expédition, fut le moment de la grande gloire de Christophe Colomb ; sa popularité dura juste 5 mois et dix jours. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||