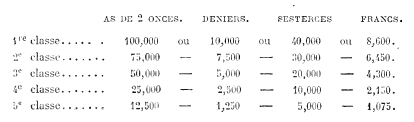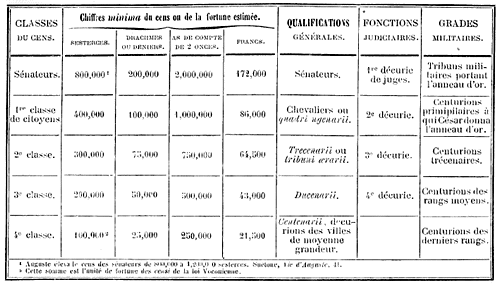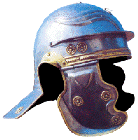HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS
TOME II
LIVRE PREMIER. LES CHEVALIERS ROMAINS DEPUIS LE TRIBUNAT DES GRACQUES
JUSQU'À LA DICTATURE DE
CÉSAR.
CHAPITRE V. LES CHEVALIERS ROMAINS DANS LES TRIBUNAUX. - HISTOIRE DES
LOIS JUDICIAIRES DEPUIS LE TEMPS DES GRACQUES JUSQU'À LA DICTATURE DE CÉSAR.
|
III. Causes publiques. La souveraineté judiciaire et le droit de condamner à mort appartenaient, en principe, à l'assemblée des centuries qui, depuis l'an 240 av. J.-C., étaient réparties également entre les trente-cinq tribus[1]. Le même droit semble avoir appartenu à l'assemblée proprement dite des tribus, non divisée en centuries, et où la distinction des classes n'existait pas. Car il suffisait que la dix-huitième tribu n'eût pas encore voté la mort, pour que le condamné pût y échapper par un exil volontaire[2]. C'étaient là les deux tribunaux suprêmes, et même quand le Sénat jugeait les causes criminelles qui lui étaient réservées, ses sentences de mort ne pouvaient être exécutées sans un décret du peuple[3]. Il n'y avait qu'une seule exception à cette règle : Le Sénat pouvait faire mettre à mort les empoisonneurs, sans débats contradictoires devant une assemblée générale des citoyens[4]. Plus tard, lorsque les tribunaux des enquêtes perpétuelles furent constitués, Cicéron disait encore : Ce sont les sénateurs, les chevaliers, les tribuns de la solde qui jugent, mais ce sont les trente-cinq tribus qui condamnent[5]. Ainsi tout jugement rendu dans une cause publique reposait en principe sur une délégation plus ou moins explicite faite aux juges, de la souveraineté judiciaire du peuple, des centuries ou des tribus. L'assemblée centuriate conserva le droit de juger, par appel de la sentence des duumvirs, les cas de perduellion[6] qui pouvaient aussi, comme les cas de lèse-majesté, être portés directement par un tribun ou par un édile devant l'assemblée des tribus[7]. Enfin, avant les Gracques, le peuple jugeait encore les litiges d'une grande importance, comme les réclamations d'argent élevées contre les anciens magistrats[8]. Mais l'impossibilité de se réunir très-souvent, et de rester plusieurs jours en permanence, obligea les assemblées populaires à laisser la plus grande partie de la justice criminelle aux sénateurs. Du temps de Polybe, le sénat jugeait les cas de trahison, de conjuration, d'empoisonnement, d'assassinat, quand les crimes avaient été commis en Italie[9]. On lui déférait aussi le jugement des violences commises dans les provinces contre les magistrats ou les envoyés de Rome[10]. Le sénat déléguait souvent ses fonctions judiciaires, soit à des magistrats qu'il faisait nommer par un plébiscite, soit à une commission de sénateurs[11]. Les commissions du sénat se composaient souvent de dix membres, et cette assemblée elle-même était dès l'origine divisée en décuries[12]. Pour l'une ou l'autre cause, les commissions judiciaires du sénat s'appelèrent décuries, et plus tard ce nom s'appliqua même aux listes des juges qui n'étaient pas sénateurs[13]. Mais les procès politiques, et les crimes se multiplièrent si vite, qu'il ne fut plus possible d'attendre, pour chaque cas particulier, qu'un plébiscite ou un sénatus-consulte ordonnât une enquête, nommât une commission et désignât un magistrat pour la diriger. De là vint l'établissement des enquêtes perpétuelles, c'est-à-dire l'habitude de désigner, par un tirage au sort, fait au commencement de l'année, le préteur qui, pendant toute sa magistrature, devrait recevoir les dénonciations, et diriger les enquêtes sur tous les crimes d'une nature déterminée. Ce fut L. Calpurnius Pison[14], surnommé l'honnête homme (Frugi) qui, pendant son tribunat de l'an 149 av. J.-C., sous le consulat de Manilius et de Censorinus, organisa la première enquête perpétuelle, celle qui était dirigée contre les exactions des gouverneurs de province (de pecuniis repetundis). Bientôt, comme nous l'avons vu[15], furent établies les enquêtes perpétuelles sur les crimes de péculat, de brigue, de lèse-majesté. Alors les simples particuliers acquirent le droit de se porter accusateurs devant le magistrat désigné, et c'est pour cela que les causes publiques furent plus tard définies, celles où l'action appartient à celui qui se présente pour l'exercer[16]. Pour que la justice soit bien rendue, il ne suffit pas que les tribunaux soient organisés ; il faut que les juges soient impartiaux. Les sénateurs qui composaient les jurys des enquêtes perpétuelles, fermaient les yeux sur les fautes des coupables de leur ordre. En 140 av. J.-C., Q. Pompée, fils d'Aulus, accusé d'exactions par Cn. et Q. Cæpion, par L. et Q. Metellus, fut absous, malgré sa culpabilité et malgré sa qualité d'homme nouveau[17]. Le sentiment de la solidarité entre les gouverneurs de province anciens et futurs, rendait les juges-sénateurs insensibles aux souffrances des provinciaux. Le peuple n'avait pas les mêmes raisons d'indulgence. Il avait conservé, concurremment avec les tribunaux publics nouvellement établis, son ancienne juridiction. En 137 av. J.-C., le tribun de la plèbe, L. Cassius, celui dont le tribunal fut appelé plus tard l'écueil des accusés, proposa une loi tabellaire, pour rendre secrets les votes du peuple, quand il aurait à juger les causes des grands[18]. C'était enlever aux accusés leurs moyens d'influence ou d'intimidation. Aussi le consul Æmilius Lepidus, et le tribun de la plèbe Antius Briso, combattirent la proposition. Mais Scipion Emilien, qui voulait rendre les sénateurs dignes du pouvoir, pour les y maintenir, appuya et fit passer la loi du tribun réformateur. Le beau-frère de Scipion, Tibérius Gracchus, ne se faisait aucune illusion sur la corruption des juges de l'ordre du sénat. Il fut le premier qui songea à leur enlever le privilège de la judicature. Quelque temps avant sa mort, il avait préparé une loi pour partager les places de juges entre les sénateurs et les chevaliers[19]. Dion Cassius dit même qu'il s'agissait de remplacer entièrement, dans les tribunaux, les membres du sénat par ceux de l'ordre équestre[20]. Quoi qu'il en soit, ce ne fut là qu'un projet, dont Tibérius légua l'accomplissement à son frère Caius. Il est bien question d'une loi judiciaire de Tibérius[21] ; mais elle n'avait pour objet que d'assurer l'exécution de la loi agraire, en attribuant aux triumvirs, chargés de distribuer des lots de terre, la décision de toutes les contestations relatives aux changements des possessions et des propriétés[22]. Scipion Emilien, qui était un ennemi de la loi agraire, fit enlever cette juridiction aux triumvirs, et la fit attribuer au consul Tuditanus, 129 av. J.-C.[23] C'est à ce propos qu'il fit devant le Sénat une sortie véhémente contre la corruption précoce de la jeune noblesse[24]. La réforme tentée par Scipion Emilien fut beaucoup plus morale que politique. Malgré la politesse grecque qu'il dut à son éducation[25], il fut bien plus grand par le caractère que par l'esprit. En tout, il se montra l'opposé de ce que fut César. César eut les vices élégants de l'aristocratie, et les idées larges des grands tribuns de la plèbe. Emilien, au contraire, eut toutes les vertus plébéiennes, mais il resta aristocrate et patricien par la pensée. Disciple de Panætius, il attaqua les vices des nobles avec cette rigueur stoïcienne et inflexible, qu'il avait mise à discipliner ses soldats et à écraser les ennemis de sa patrie. Pour lui, la pitié était une faiblesse, el la douleur n'était pas un mal. Ni la corruption, ni les défauts, ni les ridicules des Romains ne trouvaient grâce devant cet esprit que Fannius surnommait l'ironique. Il ne se contenta pas d'avoir été, dans sa censure, aussi sévère que Caton (142 av. J.-C.) ; il employa pour châtier les vices des grands, le fouet satirique d'un de ses amis, du chevalier romain Lucilius de Suessa[26]. En politique, fort attaché aux privilèges et aux traditions du patricial, et dédaigneux dé la foule comme un sage du Portique, il n'aimait pas les novateurs. Il blâma la loi agraire et il approuva le meurtre de Tibérius Gracchus. Son ami Lælius dirigea ces tribunaux de sang qui exercèrent les vengeances de la noblesse et de l'ordre équestre contre les partisans du tribun[27]. Si Emilien accueillit les réclamations des italiens, qui l'avaient servi devant Numance, contre la loi agraire, qui les privait de la possession des terres publiques, dans ses démarches en leur faveur, il n'y a aucun plan arrêté de créer une nation italien rie. Général, il se faisait le patron de ses soldats[28]. Patricien, il coalisait, contre les lois agraires, le patriciat, de Rome, les chevaliers romains et l'aristocratie des villes de l'Italie[29]. Cette politique était celle que le Sénat avait de tout temps pratiquée, et dont Cicéron, panégyriste de Scipion Emilien, fit dans son consulat un dernier essai. Scipion eut bientôt des ennemis partout, dans la plèbe,
qu'irritaient sa hauteur et son opposition à la loi agraire, dans le Sénat,
où sa gloire blessait les jaloux, où sa rigidité et ses sarcasmes faisaient
trembler les vicieux et les coupables. Il y eut dans Cependant les amis de Scipion parlaient de le nommer dictateur[33]. Ses ennemis préparèrent contre lui une accusation de tyrannie. Scipion, indigné, vint au Sénat protester contre l'ingratitude de ses concitoyens[34]. Il rentra chez lui pour composer un discours qu'il voulait adresser au peuple pour sa défense. Le lendemain, on le trouva mort. Ses tablettes étaient à côté de lui[35]. La vie se brisa-t-elle en lui comme un ressort trop tendu ? On peut le croire, car La3lius, dans son oraison funèbre, avait parlé du mal qui l'emporta[36]. Ses ennemis, qu'on a accusés d'un crime, eussent préféré son humiliation à sa mort. Peut-être Scipion fit un choix contraire, et le stoïcien quitta librement la vie, sans avoir subi un affront, sans avoir fait une concession aux passions de son temps, qu'il ne partageait pas[37]. Après la mort de Scipion Emilien, la corruption des nobles s'étala sans pudeur. On vit. Cotin, Salinator, M'. Aquilins, accusés d'exactions par les peuples qu'ils avaient gouvernés, acheter leur acquittement des sénateurs leurs juges[38]. Déjà C. Gracchus avait fait contre les sénateurs une loi pour punir les cabales judiciaires, les accusations concertées et de mauvaise foi[39]. Leur indulgence pour les coupables devenait aussi dangereuse que leurs complots contre les innocents. On ne pouvait plus laisser les provinciaux à la merci de ces trois cents sénateurs, presque tous enrichis par des rapines semblables à celles qu'ils étaient chargés de punir. Rome retentissait des plaintes des provinciaux qui n'avaient pu obtenir justice. C. Gracchus profita de cette occasion pour jeter la division parmi les ennemis de la loi agraire. Il enleva la judicature au Sénat ; des chevaliers il fit des juges. Par là, il troubla la bonne intelligence qui existait auparavant entre les sénateurs et les chevaliers, et rendit la plèbe plus puissante pour combattre les uns et les autres[40]. C. Gracchus savait que la loi agraire n'intéressait que les paysans romains[41], qu'elle laissait la plèbe de la ville fort indifférente[42], et qu'elle blessait les intérêts du Sénat, de l'ordre équestre et des Italiens. Isoler le Sénat, en dédommageant la populace de Rome par des distributions de blé à prix réduit, les Italiens, par la concession du droit de cité, les chevaliers, par l'attribution du droit de juger, telle fut la politique puissante, mais dangereuse, de C. Gracchus. Sa loi judiciaire faisait donc partie d'un vaste système de compensations accordées à tous ceux qui s'étaient faits les alliés du Sénat, parce que la loi agraire atteignait leur fortune ou ne leur procurait aucun avantage. Par malheur, en excitant les ambitions et les appétits de toutes les classes de la société, C. Gracchus ne s'aperçut pas qu'il élargissait le champ de la guerre civile ; qu'après lui, Romains et Italiens se livreraient de sanglantes batailles, non seulement pour le partage des terres publiques, mais pour l'extension du droit de cité, pour l'avantage d'être nourris aux dépens du trésor, et surtout pour la possession des tribunaux[43]. On a peu de détails sur cette grande loi judiciaire de C. Gracchus. Plutarque eu a même altéré la principale disposition[44]. Il prétend que C. Gracchus fit entrer trois cents chevaliers dans le Sénat, jusque là composé seulement de trois cents sénateurs ; partagea le droit de juger entre les six cents membres de l'assemblée, qu'il venait de doubler, et que le peuple lui confia le choix des chevaliers qui seraient appelés à la judicature. Une telle loi eût été l'uvre d'un partisan de l'aristocratie. Elle eût renforcé le Sénat et privé l'ordre équestre de tous ses chefs. Ce fut là le projet, non de C. Gracchus, mais d'un tribun ami de la noblesse, de Livius Drusus. Ce fut Sylla, dictateur, qui convertit en une loi ce projet aristocratique[45]. La méprise de Plutarque s'explique par la connaissance imparfaite qu'il a eue d'un plan de C. Gracchus, dont nous trouvons la mention dans l'abrégé du soixantième livre de Tite-Live. C. Gracchus, pour corrompre l'ordre équestre qui s'entendait alors avec le Sénat, proposa une loi pour que six cents des chevaliers fussent élevés au rang des sénateurs. Comme le Sénat de ce temps là ne comptait que trois cents membres, ces six cents chevaliers se seraient mêlés avec eux de façon à donner à l'ordre équestre, dans le Sénat, la majorité des deux tiers. Puis, s'étant fait accorder le tribunat pour une seconde année, C. Gracchus proposa plusieurs lois agraires afin d'établir beaucoup de colonies en Italie[46]. Il résulte de ce passage que le projet de C. Gracchus pour augmenter le nombre des sénateurs, n'avait point trait à une réforme de la judicature. Il appartient à la première année de son tribunat, tandis que c'est clans la seconde année que fut votée sa loi judiciaire[47]. Gracchus ne porta point le nombre des sénateurs à six cents, comme le dit Plutarque, mais il eut l'intention de le porter à neuf cents. En réalité, le Sénat, pendant quarante ans encore, ne compta que trois cents sénateurs. Ce fut Sylla, dictateur, qui, le premier, éleva le nombre des sénateurs à six cents, par l'adjonction de trois cents chevaliers[48], et il n'y eut jamais neuf cents sénateurs avant la dictature de César[49]. Plutarque s'est donc complètement trompé. C. Gracchus avait renoncé à son projet, auquel il substitua sa loi sur la judicature. Son but était de triompher de l'opposition que le Sénat faisait à la loi agraire. Il songea d'abord à changer brusquement la majorité dans le Sénat par une promotion de six cents chevaliers-sénateurs, qu'il eût désignés lui-même. Mais il s'aperçut que ce coup d'état serait tout à fait inutile, et que les deux ordres mêlés ensemble dans la curie n'en seraient pas moins unis contre la loi agraire par la communauté de leurs intérêts. Il abandonna donc sa première idée et il songea à créer un conflit entre l'ordre sénatorial et l'ordre équestre. Il fit sa loi judiciaire. Appien dit que les tribunaux étant déshonorés par la corruption, C. Gracchus transféra la judicature des sénateurs aux chevaliers[50]. Tous les auteurs latins ont parlé comme lui de cette loi. Cicéron[51], Asconius[52], Velleius[53], Florus[54], Pline[55], Tacite[56], la considèrent comme un coup terrible porté à la puissance du Sénat, comme une substitution complète des chevaliers aux sénateurs dans les tribunaux. Les paroles de Plutarque ne peuvent balancer l'autorité de tant d'écrivains. Nous devons donc croire qu'en 122 av. J.-C., l'ordre équestre fut investi par la loi de Gracchus de tout le pouvoir judiciaire. Mais l'exercice des fonctions judiciaires, n'était-il pas, pour un chevalier, subordonné à certaines conditions d'âge ou de fortune ? La loi Servilia de repetundis[57], qui fut faite de l'an 105 à l'an 100 av. J.-C., défend d'inscrire sur le tableau annuel des 450 juges un citoyen ayant moins de trente ans ou plus de soixante. A trente ans, un chevalier pouvait avoir achevé ses dix ans de service et il pouvait briguer la questure[58]. Au-delà de soixante ans, on n'était plus requis pour le service militaire, ni pour le service judiciaire. On comprend par là un mot du Ps. Asconius sur les chevaliers-juges, de l'époque qui vient après le tribunat des Gracques. Le peuple romain, dit-il, fut dépouillé, pendant les dix ans qui suivirent la victoire de Sylla, du droit de juger, qu'il avait exercé par l'intermédiaire des chevaliers ayant fait le service militaire (per eq. Romanos militaris[59]). Le mot militaris désigne des hommes qui ont servi, et qui n'ont pas encore passé l'âge du service. Il s'applique bien à des juges âgés de trente à soixante ans. L'analogie autorise à supposer, dans la loi judiciaire de C. Gracchus, une disposition semblable à celle de la loi Servilia, sur l'âge des juges. Il était naturel que la trentième année, oui ouvrait aux chevaliers la carrière des magistratures, leur ouvrît aussi l'accès des tribunaux, et qu'à soixante ans on fût dispensé de juger comme de porter les armes. Des inductions encore plus certaines nous amènent à déterminer le cens judiciaire, qui n'était autre que le cens équestre ou de la première classe, celui de 400.000 sesterces (86.000 francs). Cicéron combat ainsi dans sa première Philippique la proposition, faite par Antoine, d'instituer une troisième décurie de juges composée de centurions[60]. Quelle est cette troisième décurie ? Celle des centurions, dit Antoine. Quoi donc ? La loi de Jules César, celle de Pompée, celle d'Aurelius Cotta n'ouvraient-elles pas à des centurions l'accès des tribunaux ? Oui, dit Antoine, mais à condition de posséder un cens déterminé[61]. Cette condition n'était pas imposée seulement au centurion, mais même au chevalier romain. Aussi des hommes très-braves et très-honorables, qui ont été centurions, sont et ont été juges. Je n'ai pas besoin de ceux-là, dit Antoine, que quiconque a été centurion d'une compagnie, soit appelé à la judicature. Mais si vous proposiez de nommer juge quiconque aurait fait le service de la cavalerie, qui est plus distingué que celui du centurion, vous ne persuaderiez personne ; car, pour choisir un juge, il faut avoir égard à la fortune autant qu'au mérite personnel. Ce cens judiciaire, que tous les chevaliers n'avaient pas et sans lequel ils ne pouvaient être juges, c'était le cens équestre lui-même, celui de la première classe. Beaucoup de chevaliers, qui avaient perdu ou dissipé leur fortune, n'en conservaient pas moins le titre de chevaliers, héréditaire dans leur famille. Cicéron en cite plusieurs exemples[62]. Mais ils n'étaient plus inscrits par les censeurs, parmi les citoyens de la première classe, et ils n'avaient plus le droit de siéger dans les tribunaux. Ils n'avaient plus ce que le législateur considérait comme la garantie de l'indépendance judiciaire. Il y avait donc, dans la loi d'Aurelius Cotta de l'an 70 av. J-C., une disposition qui exigeait que les juges-chevaliers eussent réellement le cens de la première classe, c'est-à-dire une fortune évaluée 400.000 sesterces (86.000 fr.). Nous avons trouvé déjà cette disposition dans la loi agraire de Thorius, qui est de l'an 111 av. J.-C.[63] Comme à cette époque la loi judiciaire de C. Gracchus était dans toute sa vigueur, on ne peut douter que les récupérateurs de la loi Thoria ne fussent choisis d'après les mêmes principes qui réglaient alors le choix de tous les juges. La loi de C. Gracchus exigeait donc que le juge de l'ordre équestre eût réellement la fortune d'un citoyen de la première classe, et qu'il ne fût pas, comme Cicéron le dit du pauvre Rabbins Postumus, l'ombre d'un chevalier. Les effets de la loi judiciaire de C. Gracchus ne furent pas ceux d'une véritable réforme. Le droit de juger éleva les chevaliers au rang de maîtres, et fit descendre les sénateurs au rang de sujets. Les nouveaux juges se mirent du côté des tribuns de la plèbe dans les votes et, en échange de leurs suffrages, reçurent des tribuns tout ce qu'ils voulaient. Ils ne se contentèrent pas de la domination politique. Dans les tribunaux, ils commirent ouvertement des injustices contre les sénateurs. Ils s'habituèrent à la corruption, et dès qu'ils eurent goûté au plaisir de gagner beaucoup, ils en usèrent d'une manière plus honteuse encore que les anciens juges. Ils lançaient contre les riches des accusateurs apostés. Bientôt on ne sut plus ce que c'était que d'être traduit en justice comme juge prévaricateur[64]. Ces abus ne se produisirent pas en un jour. Pendant les dix ans qui suivirent la mort de C. Gracchus, la loi agraire continua de bouleverser les propriétés et les fortunes, et les juges-chevaliers ménagèrent les sénateurs. Il y avait dans les deux ordres des possesseurs de terres publiques. Mais dès que la loi Thoria de l'an 111 av. J.-C., eut fixé les droits des propriétaires, toute solidarité disparut entre le Sénat et l'ordre équestre, et la vieille haine reprit sou cours avec toute la violence d'un sentiment longtemps contenu. La querelle de ces deux aristocraties était celle de la plèbe contre la noblesse. Car Cicéron, pour prouver que la loi de C. Gracchus contre les cabales judiciaires, s'appliquait aux sénateurs et non aux chevaliers, dit qu'elle était faite pour la plèbe et non contre la plèbe[65]. Du reste, si jamais les rigueurs judiciaires furent provoquées par l'insolence des coupables, ce fut quand la faction des nobles se vendait à Jugurtha[66]. En 109 av. J.-C., le tribun Mamilius fit nommer une commission d'enquête contre ceux qui avaient trafiqué avec l'ennemi de la paix et de la guerre. La plèbe vota cette proposition avec une ardeur passionnée, où il entrait plus de haine contre la noblesse que de souci du bien public[67]. Les juges nommés en vertu de la loi de Gracchus, s'associèrent aux sentiments des plébéiens. Ils frappèrent de sentences d'exil un prêtre C. Sulpicius Galba et quatre consulaires L. Calpurnius Beslia, C. Porcins Caton, Sp. Postumius Albinus et L. Opimius, l'assassin du second des Gracques[68]. En même temps Marius, sorti d'une famille équestre d'Arpinum, était élevé au consulat par la faveur des publicains[69]. Son rival Metellus le Numidique fut traduit devant un tribunal de chevaliers comme coupable d'exactions. Mais, lorsqu'il présenta ses livres de comptes, les juges détournèrent les yeux, de peur qu'on ne crût qu'ils avaient douté de la probité de Metellus[70], 108-107 av. J.-C. Il y avait encore d'honnêtes gens parmi les chevaliers. Les sénateurs n'en subissaient pas moins avec indignation la tyrannie du nouvel ordre judiciaire. En 106 av. J-C., Q. Servilius Cæpion proposa de rendre les tribunaux au Sénat. Un mot de Julius Obsequens, compilateur du IVe siècle[71], a fait croire à quelques historiens que Cæpion obtint le partage de la judicature entre le Sénat et les chevaliers. Mais Tacite affirme qu'il la fit simplement restituer au Sénat[72], et Cicéron place le premier partage de la judicature entre les deux ordres, au temps de la loi Plotia, qui est de l'an 89 av. J.-C.[73] L. Crassus prononça en faveur de la loi Servilia de Cæpion un discours qui fut longtemps appris dans les écoles romaines, comme un modèle d'éloquence. Il y attaquait avec énergie la faction des juges et des accusateurs : Arrachez-nous, s'écriait-il, à la cruauté de ces bêtes de proie, qui ne peuvent se rassasier de notre sang[74]. Si Servilius Cæpion et Crassus firent rendre aux sénateurs seuls tout le pouvoir judiciaire, ce ne fut pas pour longtemps. L'interruption de la judicature des chevaliers a paru presque insensible aux écrivains romains. Cicéron dit que, jusqu'à la dictature de Sylla, l'ordre équestre a jugé pendant prés de cinquante ans consécutifs[75]. Depuis 122 jusqu'à l'an 80 av. J.-C., il n'a pu occuper les tribunaux que pendant quarante-deux ans. Le commentateur de Cicéron dit, avec moins d'emphase et plus d'exactitude chronologique, que les chevaliers, depuis le temps de C. Gracchus rendirent honorablement la justice pendant quarante ans[76]. Enfin, Velleius, rappelant l'injuste condamnation de Rutilius, qui est de l'an 92 av. J.-C., fait remonter aux lois de Gracchus, l'origine du pouvoir dont les chevaliers s'étaient si mal servis[77]. Ce fut la loi de repetundis de Servilius Glaucia qui ôta une seconde fois aux sénateurs, pour la rendre aux chevaliers, la partie la plus importante de la judicature politique[78]. Glaucia périt en l'an 100 av. J.-C., pendant sa préture, pour s'être mêlé aux partisans de Saturninus. L'ordre équestre lui restait si obligé pour sa loi judiciaire, quelques mois avant sa mort, qu'il l'eût nommé consul, si la candidature d'un préteur au consulat eût été légale[79]. La loi de Glaucia de repetundis est placée par le savant Drumann, en l'an 104 av. J.-C.[80], et il n'est pas impossible qu'elle soit de l'an 105. Elle laissa donc à peine à la loi de Cæpion le temps de s'appliquer. On a conservé de nombreux fragments de la loi Servilia de repetundis[81]. Nous en citerons ici les articles principaux. Rien n'est plus propre à faire comprendre l'organisation judiciaire de Rome : Tout dictateur, consul, préteur, maître de la cavalerie, censeur, édile, qui se sera fait donner, par un citoyen romain, par un allié, par un ami ou par un sujet de Rome, en un an plus de...[82] sesterces, sera soumis à cette loi. Il en sera de même de tout tribun de la plèbe, questeur, triumvir capital, triumvir chargé d'assigner des lots de terre, ou tribun militaire de l'une des quatre premières légions, qui aura reçu en un an plus de...[83] sesterces. La loi fixait aussi une limite particulière pour les cadeaux que pourraient recevoir les fils de ces magistrats, si leurs pères étaient déjà sénateurs[84]. Pour l'année où la loi sera
faite, le préteur, chargé de régler les procès des étrangers (peregrinus), choisira dans les dix jours qui suivront le vote de la
loi, quatre cent cinquante juges qui jugeront cette année-là. Ne pourra être
choisi au nombre de ces quatre cent cinquante juges, quiconque a été ou est
tribun de la plèbe, questeur, triumvir capital, tribun militaire de l'une des
quatre premières légions, sénateur, ou rétribué, ou frappé d'une condamnation
qui lui ferme l'entrée du sénat, ou âgé de moins de trente ans, ou de plus de
soixante, ou domicilié hors de Rome et à plus de cinq milles de ses murs, ou
père ou frère ou fils d'un sénateur, ou en voyage au-delà de la mer. Le
préteur marquera le nom du père, celui de la tribu, et le nom de la famille
de chacun des juges qu'il aura choisis. Il conservera leurs noms écrits à
l'encre sur un tableau blanc (in albo), où il
les aura rangés par tribus. Il gardera ces noms affichés sur le tableau. Il
en lira la liste devant l'assemblée, et jurera qu'il a choisi ceux qu'il a
cru devoir juger consciencieusement. Les noms des quatre cent cinquante juges
qu'il aura choisis, seront inscrits dans les archives publiques, pour être
toujours conservés[85]. A l'avenir, chaque année un des préteurs désigné par le sort, sera chargé de présider l'enquête de repetundis conformément à cette loi. Il choisira pour l'année quatre cent cinquante juges, en observant les incompatibilités indiquées dans l'article précédent, et les mêmes formalités pour l'inscription et la publication du nom des juges[86]. Le demandeur traduira celui qu'il
accuse, devant le président de l'enquête. Le préteur prendra le nom de
l'accusé, quand le demandeur aura juré qu'il ne cherche point une chicane.
Puis, sur les quatre cent cinquante juges, choisis pour l'année, le demandeur
en proposera cent à son adversaire. Le président de l'enquête les admettra à
l'exception[87] de ceux qui, proposés par le demandeur, seraient parents
ou alliés du défendeur au degré de cousin germain ou à un degré plus
rapproché, membres de la même société ou du même collège que le défendeur. Le
demandeur, de son côté, jurera que parmi les juges qu'il a proposés, il n'y
en a aucun qui, à sa connaissance, soit uni par aucun de ces liens avec son
adversaire. Dans les vingt jours qui suivront la citation, le défendeur
désignera à son tour cent des quatre cent cinquante juges. Le préteur les
recevra pourvu qu'il n'y en ait aucun qui soit uni par aucun lien de famille
ni de corporation, avec le demandeur, ni qui occupe ou ait occupé une des
charges incompatibles avec les fonctions judiciaires, ni qui se trouve dans
aucune des conditions qui empêchent d'être juge, pourvu encore qu'il n'y ait
pas deux juges proposés qui soient de la même famille et qu'aucun d'eux n'ait
été traduit devant un tribunal, en vertu des lois Calpurnia et Junia, ou en
vertu de la présente loi de repetundis. Le défendeur jurera à son
tour, que dans ses choix il a cru sincèrement se conformer aux prescriptions
légales. Lorsque les deux adversaires auront ainsi proposé chacun cent juges
et fait leurs serments, le défendeur en choisira cinquante parmi les cent
proposés par le demandeur, et le demandeur cinquante parmi les cent proposés
par le défendeur. Les cent ainsi choisis seront constitués juges du procès[88]. Les sommes détournées ou prises
indûment avant la présente loi, seront restituées simplement. Celles qu'on
aura prises ou détournées depuis, seront payées au double[89]. Si l'accusateur n'est pas citoyen romain, et qu'il fasse
condamner l'accusé par le jugement de repetundis, il aura le droit de
cité, et avec lui, sa femme, ses enfants, et ses petits-fils, nés de son
fils, l'auront aussi. Ils auront le droit de commerce et de mariage d'après
la loi des Quirites. Les mâles de sa famille
auront le droit d'arriver aux charges publiques, le droit de suffrage dans
une tribu, on ils seront inscrits par les censeurs, l'exemption du service
militaire. Toutes leurs campagnes leur seront comptées comme finies[90]. Cette loi nous apprend ce qu'étaient au temps de La loi de Glaucia n'enleva aux sénateurs que le jugement des causes politiques les plus importantes, celles des gouverneurs de province, ou des magistrats qui auraient commis des exactions. La loi sur les crimes de lèse-majesté, faite par Saturninus, diminua aussi leur compétence[95]. En l'an 101 av. J.-C., les sénateurs avaient encore le droit de juger les cas de violences et d'injures. Mais le récit de Diodore qui nous en parle, nous montre aussi comment ils le perdirent[96] : Les envoyés du roi Mithridate
vinrent à Rome avec des sommes d'argent considérables pour gagner les
sénateurs. Saturninus saisit cette occasion d'attaquer le sénat, et fit à l'ambassade une injure
signalée. Les ambassadeurs, excités par les membres du sénat, mirent Saturninus
en accusation. La cause était publique et importante, à cause de l'inviolabilité
des ambassadeurs. Saturninus, se voyant en butte à une accusation capitale,
dirigée par les sénateurs, qui étaient aussi juges en ces sortes de causes,
fut très-effrayé des dangers qu'il courait. Il implora la pitié de toute la
classe pauvre. Il déposa ses vêtements somptueux, en prit de tristes et de
communs, laissa pousser sa barbe et, s'adressant à
ceux qu'il rencontrait, tombant aux genoux des uns, serrant la main des autres,
il les suppliait de le secourir. Il montrait dans le sénat une faction qui
l'attaquait injustement, et dans son malheur une suite de sa fidélité aux
intérêts du peuple. Mes ennemis, disait-il, sont en même temps mes accusateurs
et mes juges. L'émotion populaire produite par ses supplications, fit
accourir des milliers d'hommes autour du tribunal et, contre toute attente,
l'accusé fut absous. Ayant la faveur du peuple, Saturninus fut nommé pour la
seconde fois tribun de la plèbe. Les derniers restes du pouvoir judiciaire du sénat devenaient ainsi le jouet des émeutes populaires. Il suffisait d'une motion tribunitienne, pour effacer de la loi un droit dont la violence rendait l'usage illusoire et dangereux pour les sénateurs. Cicéron nous dit, qu'en l'an 100 av. J.-C., l'ordre équestre tenait une grande place dans le gouvernement et remplissait tous les tribunaux[97]. Toute trace de la loi judiciaire de Servilius Cæpion était donc effacée au moment où les chevaliers se réconciliaient avec le sénat, pour combattre Saturninus. La cause de cette réconciliation était une loi agraire, une de ces lois, dont l'effet invariable était de rapprocher les deux ordres et de leur faire oublier quelque temps leurs querelles au sujet des tribunaux. Marius avait été élevé au pouvoir par la faveur des publicains. Mais il avait dû chercher dans les classes inférieures sa clientèle militaire et politique. La race des propriétaires libres de la campagne étant presque épuisée, il fut obligé de prendre pour soldats de pauvres journaliers, inscrits sur les registres des censeurs au-dessous des prolétaires et qu'on appelait capite censi[98]. Ce furent ces malheureux, qui transformèrent les légions romaines en bandes mercenaires prêtes à marcher contre leur patrie pour satisfaire l'ambition de leurs chefs. Si Marius eut recours à de si dangereuses recrues, ce fut la faute des sénateurs et des chevaliers, qui, en repoussant avec violence les lois agraires avaient empêché le renouvellement de la population libre des propriétaires. Il était encore temps de guérir le mal. Après la victoire de Verceil, Marius avait confisqué les terres que les Cimbres avaient occupées en Cisalpine. Un de ses amis politiques, le tribun Apuleius Saturnines, proposa de distribuer ces terres aux vétérans qui les avaient reconquises. Cette loi agraire fut combattue avec une opiniâtreté absurde par la noblesse dont Metellus était le chef. De ces soldats qui avaient sauvé l'Italie, et qui n'avaient pas encore perdu le goût de l'agriculture, on pouvait faire, sans dépouiller personne, un peuple d'honnêtes cultivateurs. On préféra les réduire, par une cruauté imprévoyante, à la misère et à la vie d'aventures. Comme leurs pères, au temps des Gracques, les vétérans de Marius, accoururent en foule de la campagne, pour voter la loi agraire[99]. Les hommes de la ville, nobles, affranchis et esclaves des nobles, employèrent tous les moyens pour les en empêcher d'abord les formalités religieuses, puis, comme dernière ressource, les coups de bâton. Les paysans dispersés allèrent chercher des bâtons à leur tour, chassèrent du Forum la populace de la ville, votèrent la loi agraire et condamnèrent Metellus à l'exil[100]. Par malheur, ils entraient dans les luttes civiles, avec la fougue des malheureux qui n'ont rien à perdre, et avec la discipline des soldats qui ne savent qu'obéir. Saturninus qui, malgré son intelligence, était un fort méchant homme, leur fit commettre des assassinats, et, à la tête d'une de leurs bandes il occupa le Capitole. Marius était alors consul pour la sixième fois. ll ne voulut pas se laisser compromettre par les crimes de ses partisans, et cédant à l'influence de l'ordre équestre d'où il était sorti, il vint avec les sénateurs, avec les chevaliers, avec les ennemis de la loi agraire, assiéger la citadelle où s'étaient enfermés avec Saturninus le questeur Saufeius et le préteur Glaucia. Servilius Glaucia, naguère encore favori de l'ordre équestre à cause de sa loi judiciaire, Saufeius et Saturninus qui avaient travaillé à maintenir Marius dans le consulat, crurent pouvoir sans danger se rendre au consul. Marius les enferma dans le temple du sénat comme dans un asile inviolable. Mais la populace de la ville ne se laissa pas dérober sa proie. Excités par les nobles, Scva esclave de Q. Croto, et quelques autres partisans de l'aristocratie, grimpèrent sur le temple, en arrachèrent les tuiles, en démolirent la toiture et assommèrent dans l'enceinte sacrée les trois magistrats encore revêtus de leurs insignes[101]. Scva, pour cet exploit, reçut la liberté, et la plèbe urbaine s'accrut d'un nouveau citoyen. Les corps des trois magistrats furent traînés par les rues de la ville[102]. La tête de Saturninus fut coupée, plantée au bout d'une pique et C. Rabirius, chevalier romain[103] originaire de l'Apulie, promena dans Rome cet horrible trophée. Rabirius devint plus tard sénateur. Pendant deux ans, sénateurs et chevaliers s'entendirent pour exterminer les derniers partisans de la loi agraire. P. Furius s'étant opposé au retour de Metellus le Numidique, et ayant résisté aux larmes de Metellus Pius, fils de l'exilé, fut accusé l'année suivante par un tribun ami des nobles. Il fut assassiné et son corps fut mis en pièces par la populace de Rome[104]. C. Decianus, pour avoir exprimé un timide regret de la mort de Saturninus, fut condamné à une énorme amende[105]. Enfin, Sextus Titius, tribun de la plèbe en 99 av. J.-C., sous le consulat d'Antoine l'orateur et de Postumius, osa faire une loi agraire qui rétablissait une redevance due au trésor par les possesseurs des terres publiques. On lui fit un procès de tendance. Il fut accusé d'avoir eu chez lui un buste de Saturninus, et il fut condamné à l'exil. Les chevaliers romains décidèrent par ce jugement que c'était faire acte de mauvais citoyen et mériter d'être exclu de la cité que de conserver l'image d'un factieux déclaré ennemi public, soit qu'on voulût par là honorer sa mort, soit qu'on essayât d'exciter la pitié et les regrets des gens peu éclairés, soit qu'on manifestât une tendance à imiter un si mauvais modèle[106]. Mais quand tous les auteurs des lois agraires eurent été punis, lorsque la charge de questeur, nommé en vertu de la loi Titia, fut devenue une sinécure[107], les chevaliers et les sénateurs n'ayant plus d'ennemis communs, revinrent à leur vieille querelle suspendue depuis deux ans. La loi Servilia de Glaucia, en réservant la judicature aux chevaliers qui habitaient Rome ou la banlieue de Rome, avait substitué dans les tribunaux l'oligarchie des publicains à celle des sénateurs. Aussi les plus avides gouverneurs de province entouraient d'égards les publicains et même les simples commis des compagnies de fermiers. Apercevaient-ils un chevalier dans leur province, ils le comblaient de présents et de bienfaits. Cette habitude était fort utile aux magistrats coupables. Mais elle fut nuisible à ceux qui contrarièrent les intérêts ou les désirs de l'ordre équestre. C'était une règle observée alors et comme établie d'un commun accord que celui qui oserait faire affront à un chevalier romain fût jugé digne de châtiment par l'ordre tout entier[108]. L'affaire de Rutilius fut celle où le nouvel ordre judiciaire s'abandonna avec le moins de retenue à toutes les passions de l'esprit de corps. En l'an 98 av. J.-C., Q. Mucius Scævola fut envoyé comme propréteur pour gouverner l'Asie. Il choisit pour questeur P. Rutilius Rufus, un des plus vertueux citoyens de Rome[109]. Les prédécesseurs de Scævola en Asie, s'étant assuré la complicité des publicains, qui dans Rome jugeaient les causes publiques, avaient multiplié les illégalités dans leur province. Mucius Scævola se mit à rendre une exacte justice. Il fut incorruptible et délivra l'Asie de la chicane. Les publicains durent payer les fautes dont ils s'étaient rendus coupables[110]. Rutilius Rufus avait secondé son préteur dans cette uvre de réparation. Aussi les publicains vouèrent à l'un et à l'autre, une haine irréconciliable. Mais ils n'osèrent d'abord s'attaquer à de si honnêtes gens. En 95 av. J.-C., C. Norbanus accusa Q. Servilius Cæpion, celui qui, en l'an 106 av. J.-C., avait fait rendre les tribunaux aux sénateurs[111]. En vain l'orateur Crassus défendit l'accusé comme il avait défendu sa loi judiciaire. En vain deux tribuns, T. Didius et L. Cotta, essayèrent de s'opposer au jugement. La plèbe s'insurgea à l'appel de Norbanus. Didius et Colla furent renversés de la tribune aux harangues. Scaurus, prince du sénat fut atteint d'une pierre et Cæpion condamné alla mourir en exil à Smyrne. La noblesse essaya de prendre sa revanche. Sulpicius accusa Norbanus d'avoir attenté à la majesté de la plèbe et invoqua contre lui la loi Apuleia. Mais l'orateur Marc Antoine défendit l'accusé. Il raviva dans l'âme des chevaliers juges tous leurs ressentiments contre Cæpion. Comment faire devant eux un crime à Norbanus d'avoir dirigé une émeute contre cet ennemi de l'ordre équestre[112]. Les chevaliers renvoyèrent Norbanus absous. Si leur indulgence était acquise à tous les ennemis de la noblesse, ils étaient impitoyables pour les sénateurs[113]. La condamnation de Rutilius ne laissa plus à l'innocence aucune sécurité[114]. L'intègre stoïcien dédaigna de s'abaisser aux prières[115]. Il ne consentit même pas à laisser Antoine ou Crassus employer en sa faveur les artifices de l'éloquence. Il se défendit lui-même. C. Cotta son neveu, Q. Mucius son ancien préteur parlèrent aussi pour lui, mais avec cette simplicité austère, qui seule paraissait digne d'un disciple de Panætius[116]. Rutilius condamné se retira à Mitylène, puis à Smyrne où il vécut entouré du respect des populations qu'il avait gouvernées[117]. Dix ans après, Sylla vainqueur de la faction des publicains offrit à l'exilé de le rappeler dans Rome. Rutilius aima mieux obéir aux lois de sa patrie, que de profiter de ses malheurs. Il mourut en exil[118]. Il était temps pour les publicains de mieux employer leur
pouvoir judiciaire, s'ils voulaient le conserver. Mais ils attaquèrent Æmilius
Scaurus, et ce procès devint l'occasion d'une nouvelle guerre civile et du
soulèvement de l'Italie. Rome, dit Florus[119], était, depuis la loi judiciaire de C. Gracchus, comme une
ville à deux têtes. Les chevaliers, maîtres de la vie et de la fortune des plus
nobles citoyens, pillaient impunément le trésor de l'État. Les deux partis
ressemblaient à deux camps. Des deux côtés les aigles, les drapeaux étaient
prêts. Servilius Cæpion se mit à la tête des chevaliers, Drusus, à la tête
des sénateurs. Cæpion le premier attaqua les positions du Sénat en accusant
de brigue les chefs de la noblesse Æmilius Scaurus et Philippe. Livius
Drusus, fils de l'ancien adversaire de C. Gracchus, avait marié sa sur Livia[120] à Servilius Cæpion,
probablement fils de celui qui avait été condamné par les chevaliers. Les
deux beaux-frères, longtemps amis et attachés au même parti, à celui de la
noblesse, se fâchèrent, dit-on, après s'être disputé un anneau précieux dans
des enchères publiques[121]. Soit pour
cette raison frivole, soit pour soutenir une autre branche des Servilii dans
ses inimitiés contre les familles de Metellus et de Lucullus[122], Cæpion changea
de parti. Il attaqua le prince du Sénat, Scaurus, devant le tribunal de
repetundis. Scaurus, pour retarder le jugement de son procès, intenta une
accusation semblable à son accusateur, et demanda un délai plus court pour
recueillir les preuves[123]. Ce n'était là
qu'un artifice de chicane pour forcer son adversaire à se mettre sur la
défensive et pour gagner du temps. Livius Drusus était alors tribun de la plèbe.
Il était devenu l'ennemi de Cæpion. Scaurus s'entendit avec lui et lui
suggéra l'idée de proposer des lois pour enlever la judicature à l'ordre
équestre. Comme les lois de Livius Drusus devinrent l'occasion du soulèvement
des Italiens, Pline, toujours curieux des effets oratoires, ne manque pas de
dire qu'un anneau fut la cause de la brouille de Drusus et de Cæpion, de la
guerre sociale et de la ruine de Parmi les lois de Drusus, il faut distinguer celles qui furent le but de sa politique, de celles qui n'en étaient que les moyens. Drusus malgré ses lois agraires ne fut nullement un continuateur des Gracques. Il n'a pas été non plus un conciliateur bienveillant et maladroit[125]. Son intention principale était de rendre la judicature politique au Sénat[126]. L'historien Velleius, pour flatter Livie, qui comptait ce tribun parmi ses ancêtres, s'est fait son admirateur. Il blâme la noblesse d'avoir méconnu la profonde politique de son défenseur, et de n'avoir pas vu que ses concessions à la multitude étaient des amorces trompeuses destinées à faire oublier au peuple les avantages beaucoup plus grands réservés au Sénat[127]. Cicéron et Asconius, comme Tite-Live et Velleius, n'ont vu dans Livius Drusus qu'un partisan de l'aristocratie[128]. Le grand avocat de l'ordre équestre va même jusqu'à dire que sa seule pensée avait été de préparer les représailles des sénateurs contre les chevaliers. Il loue hautement les chefs de la chevalerie d'alors, C. Flavius Pusio, Cn. Titinius, C. Mæcenas d'avoir protesté contre l'application que Livius Drusus voulait leur faire de la. loi contre la corruption des juges[129]. Ainsi, partisans et adversaires de cet homme d'Etat, tous s'accordent à reconnaître en lui l'héritier de la politique de son père, de ce Drusus qui avait mérité le surnom de patron du Sénat[130]. Le premier Drusus avait dérobé à C. Gracchus sa popularité en exagérant ses réformes. Le second Drusus les imita sans plus de franchise, et un jour qu'il se croyait sûr du succès de son pessimisme politique il s'écria : Je n'ai laissé aux autres tribuns rien qu'ils puissent distribuer au peuple, excepté le ciel et la boue[131]. L'ensemble des lois de Livius Drusus a été exposé par Appien[132]. Il voulait que le Sénat, réduit alors à moins de trois cents membres, admît dans son sein trois cents des chevaliers les plus distingués, et que ce corps, ainsi recomposé, fût investi de la judicature politique. Drusus rétablissait l'accusation de corruption contre les juges, avec l'intention avouée de donner à sa loi un effet rétroactif contre les chevaliers. Par là, le tribun décapitait l'ordre équestre et le livrait aux vengeances de l'aristocratie. Pour l'attaquer avec plus de force. il essaya de l'isoler comme C. Gracchus avait isolé le Sénat. Comme C. Gracchus, Drusus joignit à sa loi judiciaire one loi qui donnait le droit de cité aux Italiens, une loi agraire qui ordonnait de faire à la plèbe rustique les distributions de terres votées dés le temps de Saturninus[133], enfin des lois frumentaires pour gagner cette plèbe urbaine, toujours prête à voter pour le gouvernement du pain à bon marché[134]. Ainsi la coalition d'intérêts, imaginée contre le Sénat par le second des Gracques, était retournée contre l'ordre judiciaire qu'il avait fondé, contre l'aristocratie des chevaliers. Le Sénat fut d'abord séduit par la grandeur apparente et par la hardiesse des plans de Drusus. Mais le consul L. Martius Philippus en comprit le danger. Soulever toutes les passions de l'Italie potin triompher d'une coterie de 450 chevaliers-juges, n'était-ce P as recourir à des remèdes plus redoutables que le mal, et se jeter dans la politique d'aventures ? Avec un Sénat susceptible de pareils entrainements, Phi-lippus déclara qu'il était impossible de gouverner. L. Crassus prononça à cette occasion son dernier discours. Il se joignit à Drusus et protesta éloquemment. au nom du Sénat qui n'avait jamais failli à ses devoirs[135]. Les assemblées applaudissent toujours ceux qui les flattent. Mais Crassus avait montré ici plus d'imagination oratoire que de sens politique. Drusus était un brouillon ambitieux qui se prenait pour un grand homme. La grandeur de ses desseins lui semblait la justification de toutes les violences. Les chevaliers romains, qu'il dépouillait de la judicature, les Ombriens et les Etrusques, à qui il allait enlever des terres publiques pour y fonder des colonies[136], accoururent en foule à Rome, pour seconder l'opposition du consul Philippus. Drusus de son côté appela des bandes d'Italiens, à qui il promettait le droit de cité. Le jour du vote fut un jour de combat. Le consul Philippus résistait au vote en invoquant les auspices, Drusus le saisit à la gorge et le serra avec tant de violence que le sang lui jaillit par le nez. Il menaça un consulaire de le précipiter de la roche Tarpéienne[137]. Les lois furent votées contre[138] les auspices et sans qu'il y eût un vote distinct pour chacune d'elles[139] C'étaient là deux causés de nullité. Dès le lendemain du vote, le sénat se sépara de Drusus. Il
trouvait qu'on lui avait fait payer cher la restitution du pouvoir judiciaire
et parlait de revenir sur les concessions faites aux Italiens et à la plèbe.
Drusus se mit alors à traiter le sénat avec une hauteur blessante[140]. Il prenait
avec cette assemblée le ton d'un docteur politique dont les sénateurs
devaient un jour, mais trop tard, comprendre les leçons : Je pourrais, leur disait-il, m'opposer à tous vos décrets, les annuler par mon veto.
Mais je ne le veux pas. Je sais que votre faute politique sera promptement
punie comme elle mérite de l'être. En abolissant mes lois, vous abolissez ma
loi judiciaire. Alors ceux d'entre vous qui auront tenu une conduite irréprochable
échapperont, il est vrai, aux tribunaux. Mais ceux qui auront pillé les
provinces, s'irriteront de ce qu'on leur demande compte des sommes qu'ils
auront indûment reçues. Le vote par lequel mes envieux veulent ternir ma
gloire aura été de leur part une imprudence et presque un suicide[141]. On ne pouvait
avouer avec une vanité plus cynique le but de la nouvelle loi judiciaire, qui
était d'assurer aux gouverneurs des provinces l'impunité de leurs pillages.
Mais Drusus n'était pas moins inconséquent que les sénateurs. Il avait voulu
relever la noblesse et abaisser les chevaliers. Or, en faisant entrer les
Italiens dans la cité romaine, il allait accroître l'ordre équestre de tous
les Italiens possédant une fortune de 400.000 sesterces. Pourtant Drusus
était fier de cette loi qui faisait sa force et il prévint, avec plus
d'ostentation que de générosité, son rival le consul Phi-lippus, que, s'il se
rendait aux féries du mont Albain, il serait assassiné par les Latins[142]. Ce ne fut pas
le consul, ce fut le tribun qui reçut un coup de poignard. Drusus mourut,
persuadé que Rome perdait en lui le plus grand de ses citoyens, et n'en
retrouverait plus de semblable. Philippus vint aussitôt demander au sénat l'abolition de ses lois. Augure et consul, il avait qualité pour dénoncer les irrégularités commises le jour du vote[143]. Pour décider les sénateurs, il lut devant eux une pièce singulière, probablement saisie chez Drusus, et qui autorisait à l'accuser d'avoir aspiré à la tyrannie. C'était une formule de serment par laquelle les Italiens devaient s'engager personnellement à servir Drusus et à l'honorer comme le plus grand de leurs bienfaiteurs[144]. L'emphase avec laquelle cette pièce est rédigée, dénote la main du vaniteux tribun, qui s'y décernait une sorte d'apothéose. Les lois de Drusus furent abolies par un simple sénatus-consulte, comme votées d'une façon irrégulière. Les chevaliers rentraient ainsi en possession des tribunaux. Ils abusèrent cruellement de leurs avantages, et la haine les rendit inintelligents. Pour triompher du sénat, ils n'avaient qu'à s'approprier la politique dont ils lui firent un crime. Les Italiens, en devenant citoyens, auraient triplé la force de l'aristocratie municipale et de l'ordre équestre. Mais Drusus avait faussé toutes les situations, interverti tous les rôles. Egaré par son chef, et devenu infidèle à sa tradition[145], le sénat avait provoqué lui-même l'ambition des Italiens. Les chevaliers, qui avaient tout intérêt à la favoriser, ne virent dans les promesses faites par Drusus aux Italiens, qu'un prétexte pour accuser les sénateurs de trahison. A leur instigation, le tribun de la plèbe, Q. Varius de Sucrone, surnommé Hybrida parce qu'il était né d'une mère espagnole, proposa une enquête contre tous ceux dont les intrigues avaient déterminé les alliés à prendre les armes[146]. Plusieurs tribuns voulurent s'opposer au vote. Mais les chevaliers romains tirèrent leurs épées et la loi Varia fut votée. Aussitôt les chevaliers commencèrent à tenir des assises, où chaque accusé était condamné d'avance. Le sénateur Bestia, traduit devant eux en vertu de la loi Varia, s'exila sans obéir à la citation. C. Cotta comparut, mais pour insulter publiquement les chevaliers et il sortit de Rome sans attendre leur sentence. Mummius fut aussi condamné à l'exil par des juges de l'ordre équestre, qui avaient promis de l'absoudre. Æmilius Scaurus, l'hypocrite conseiller de Livius Drusus, sut échapper à l'incendie qu'il avait allumé. Accusé par Varius lui-même d'avoir provoqué la révolte italienne, il traita son accusateur d'espagnol et le prit de si haut avec Varius, que le tribun humilié se désista de l'accusation[147]. La guerre sociale ramena, par la gravité même du danger, chaque classe de la société romaine à son vrai rôle et au sentiment de ses intérêts. Sylla et les nobles de Rome furent impitoyables pour les Italiens. Marius, sorti d'une famille équestre d'Arpinum, fit la guerre avec une froide prudence, qui le fit soupçonner de sympathiser avec les ennemis. L'historien Velleius nous montre l'intérêt que les chevaliers romains auraient dû prendre au succès des révoltés, s'ils avaient compris la situation. Sorti d'Æculanum, chez les Hirpins, d'une famille qui n'était même pas romaine avant la guerre sociale, et qui, depuis, figura à la tête de l'ordre équestre, cet écrivain dit que les Italiens combattaient pour la plus juste des causes[148]. Mais ne pouvant s'élever jusqu'à ce sentiment de la justice politique, qui leur eût révélé l'avenir de leur parti, les 450 juges publicains constitués à Rome par la loi Servilia, ne songeaient, au milieu de la conflagration de l'Italie, qu'à assouvir leurs vengeances. Un sénatus-consulte, proclamant qu'il y avait tumulte, interrompit à peine un an l'action malfaisante de leurs tribunaux. Dès que les victoires de Julius César sur les Samnites, de Pompée Strabon sur les Picentins eurent fait déposer au peuple de Rome l'habit militaire et terminé le justitium, les publicains se hâtèrent de remettre en vigueur la loi Varia[149]. Déjà C. Curion et bien d'autres étaient accusés d'avoir excité les Italiens à la guerre[150]. Les banquiers de Rome, protégés par cette magistrature partiale, avaient massacré en plein jour, près du temple de Vesta, le préteur Sempronius Asellio, pour avoir essayé de faire respecter les lois sur l'usure. Personne n'avait osé dénoncer les coupables. Ce fut le tribun Plotius Sylvanus qui mit fin à cette domination insolente d'une coterie de publicains (89 av. J.-C.). Plotius Sylvanus était ce tribun qui, d'accord avec Papirius Carbon, avait étendu aux étrangers domiciliés en Italie, le bénéfice de la loi Julia, par laquelle le droit de cité était accordé aux Italiens[151]. Sa loi judiciaire fut aussi sage que sa loi sur le droit de cité, et c'est à Plotius que revient l'honneur d'avoir, le premier, essayé de constituer à Rome une judicature impartiale. Pour atteindre les meurtriers du préteur Asellio[152], qui étaient des banquiers, il fallait ôter le droit exclusif de juger aux publicains de Rome et des environs de Rome. Plotius fit une loi d'après laquelle chacune des, trente-cinq tribus devait choisir, chaque année, quinze juges parmi les citoyens qui la composaient[153]. Ce jury annuel et électif de 525 juges, représentant les différentes parties du territoire, et les quatre quartiers de Rome, ne pouvait pas aussi facilement se transformer en une faction politique, que les 450 juges de la loi Servilia, tous domiciliés à Rome ou à moins de cinq milles de ses murs. Combien de temps dura la loi Plotia, et quels en furent les effets ? M. Duruy a supposé qu'elle a pu être abolie au commencement de l'an 88 av. J.-C., par le tribun Sulpicius[154]. Mais Cicéron nous dit que ce fut d'après les règles de la loi Plotia que fut formé le tribunal qui jugea Cn. Pompeius Strabon, accusé de lèse-majesté en vertu de la loi Varia[155]. Or Pompée Strabon, consul en 89, proconsul en 88, fit ou laissa assassiner dans son camp, par des Italiens, le consul Pompéius Rufus, à la fin de l'année 88, et ce crime décida Sylla à partir pour l'Orient[156], Le procès de Strabon, où s'appliqua la loi judiciaire de Plotius, ne peut donc avoir eu lieu avant le commencement de l'an 87 av. J.-C.[157] Une indication d'Asconius nous montre que la loi Plotia ne fut abolie que par Sylla, dictateur en 80 av. J.-C. Le peuple romain, nous dit ce commentateur, pendant les dix ans qui suivirent la dictature de Sylla, fut privé de l'autorité des tribuns, du droit de juger, qu'il avait exercé par l'intermédiaire des chevaliers romains qui avaient fait leur temps de service, et du droit de nommer les prêtres, les sénateurs et les juges[158]. Or le peuple des trente-cinq tribus avait exercé la judicature par ses élus, en vertu de la loi Plotia, et aucune autre loi n'avait confié au peuple la nomination du jury. La loi Plotia a donc été abolie par Sylla, et elle a duré neuf ans, 89-80 av. J.- C. Les effets de la loi Plotia nous sont connus par ce que nous en ont dit Cicéron et Asconius. Le droit accordé aux trente-cinq tribus d'élire un jury où chacune d'elles serait représentée par quinze juges, conserva aux chevaliers, chefs naturels des municipes et des tribus rustiques, la plus grande partie du pouvoir judiciaire[159]. L'élection désigna aussi, pour siéger à côté d'eux dans les tribunaux, un certain nombre de sénateurs, et même quelques hommes de la plèbe, c'est-à-dire qui n'étaient ni sénateurs ni chevaliers[160]. L'ordre équestre n'en conservait pas moins sa prépondérance dans les tribunaux, et c'est par mesure de vengeance contre cet ordre, que Sylla abolit la loi Plotia. Sylla détestait les chevaliers à plusieurs titres, comme banquiers, comme publicains, comme chefs du parti des municipes, enfin comme juges ennemis du Sénat. On peut suivre à travers les guerres civiles les progrès de cette haine qu'il fit éclater dans les proscriptions. Le tribun Sulpicius, qui voulut enlever à Sylla le commandement de l'armée d'Orient, s'était entouré d'une garde de six cents jeunes chevaliers qu'il appelait son anti-Sénat[161]. Pour faire voter le peuple en faveur de Marius, il avait répandu dans les trente-cinq tribus les nouveaux citoyens, qui étaient plus nombreux que les anciens[162]. L'ordre équestre, qui n'était autre chose que la première classe des citoyens, se trouva renforcé de toutes les familles riches de l'Italie. Tant d'hommes nouveaux, envahissant la cité, inspiraient à Sylla un mépris et une colère sans bornes. Il prit Rome, il fit tuer Sulpicius. Pour affaiblir l'ordre équestre, il voulut réaliser une pensée du plan aristocratique de Drusus. Il fit entrer au Sénat trois cents des chevaliers les plus distingués et en même temps, par la loi unciaire[163], il diminua les dettes d'un dixième, et obligea les banquiers à se contenter du taux légal d'un pour cent par mois. Puis il partit pour l'Asie où il fit la guerre en même temps à Mithridate et aux publicains[164]. Avant de partir, il avait proscrit Marius. Lorsqu'on lit avec attention le récit de la fuite de Marius à Minturnes, on s'aperçoit que ce n'est point un hasard, un- cri de terreur poussé par un esclave Cimbre, qui lui sauva la vie. Ce fut la vénération dont les habitants des petites villes italiennes entouraient la vieillesse du vainqueur de Verceil. Les décurions de Minturnes saisirent ou même créèrent un prétexte pour ne pas exécuter le décret de proscription. D'ailleurs Minturnes n'était qu'à huit ou neuf lieues d'Arpinum, patrie de Marius. Le proscrit n'était pas seulement, pour le Sénat de la petite colonie qui délibérait sur son sort, le sauveur de l'Italie, le favori des dieux de la grande patrie. Il était aussi un compatriote, un voisin illustre, le héros du pays, le glorieux enfant de la vallée de Liris[165]. Issu d'une famille équestre d'Arpinum, Marius fut donc sauvé par les sympathies de ce parti municipal qui soutenait les chevaliers contre les patriciens et les nobles de la grande ville[166]. Ce furent les capitalistes de Rome, les publicains et quelques femmes riches qui firent rappeler Marius de l'exil[167], et qui conseillèrent à Cinna de répandre une seconde fois les nouveaux citoyens dans les trente-cinq tribus. Les anciens citoyens, jaloux de leurs privilèges, chassèrent, pour quelque temps, Cinna de Rome. Le consul implora le secours des villes nouvellement admises au droit de cité, de Tibur, de Préneste, et des villes de Campanie. Il se présenta à elles comme une victime de son dévouement à leur cause, et, redevenu maître de Rome, il y resta trois ans tout Puissant par la faveur des nouveaux citoyens. 86-83 av. J.-C. L'ordre équestre avait fini par s'apercevoir de l'avantage que lui donnait, dans sa lutte contre le Sénat, le secours de cette plèbe de 500.000 Italiens nouvellement annexée à la cité romaine. Il est probable que, dans la première classe, comme dans les autres, les nouveaux citoyens avaient la majorité sur les anciens. Aussi les chevaliers appuyèrent-ils de toutes leurs forces Marius et Cinna. Par malheur, cet appui ne fut pas désintéressé, et, soit comme banquiers, soit comme publicains, soit comme juges, ils gagnèrent tant d'argent qu'ils furent flétris, dans Rome, du surnom de Saccularii[168]. Quelle tentation pour Sylla de s'enrichir en se vengeant ! Il n'y résista pas. Avec quarante mille vétérans, gorgés d'or et de butin, il attaqua plus de deux cent mille hommes de nouvelles recrues, que lui opposaient Cinna et Scipion, Carbon et le jeune Marius. L'Italie, dans cette guerre civile, présente le douloureux spectacle d'une nation tout entière mal conduite et mal organisée, qui devient la proie d'une bande de mercenaires, dirigée par un chef habile. Tous les nouveaux citoyens, usurpateurs sacrilèges du nom romain aux yeux de Sylla, furent horriblement traités. Les municipes italiens, patrie de tant de chevaliers romains, furent en grand nombre détruits ou dévastés. Tous les Prénestins furent exterminés. Les habitants de Norba se jetèrent dans les flammes, pour ne pas tomber aux mains d'un vainqueur détesté. Florence, Spolète, Interamna, les municipes les plus riches de l'Italie, furent vendus à l'encan. Ordre fut donné de détruire de fond en comble Sulmone, berceau de la famille équestre des Ovide[169]. Des peuples entiers disparurent. De grandes villes, Bovianum, Æsernia, Patina, Telesia dans le Samnium, descendirent au rang de bourgades[170]. L'Etrurie, la patrie des Cæcina, des Seii, des Salvii, des Mécène, de tant d'autres familles de chevaliers, l'Etrurie qui avait résisté à Livius Drusus, et abrité, prés de Clusium, les armées de Carbon, fut entièrement bouleversée. Les sciences, la littérature, la langue même d'une nation savante et amie des arts, furent frappées de mort[171]. Cortone perdit sa population de Pélasges, dernier et curieux débris d'une civilisation évanouie[172]. On exhume aujourd'hui l'Etrurie, rendue muette et comme pétrifiée par la tête de Méduse du dictateur patricien, et, malgré le cri d'horreur qui s'est élevé dans l'antiquité contre cet exterminateur[173], nous persistons à chercher en lui les pensées profondes d'un politique. Sylla pourtant a dit son secret. Il ne fut qu'un joueur heureux, un adorateur du hasard, un favori de Vénus, déesse des bonnes fortunes et des beaux coups de dés. Il crut avoir gagné la vie et les biens de ses adversaires comme l'enjeu d'une immense partie, et il en disposa. Averties par les calamités de tant de municipes[174], Arretium[175], Volaterra, Nole[176], résistèrent presque jusqu'à la fin de sa dictature. Il put enlever aux nouveaux citoyens de Rome une partie de leurs champs. Mais il ne put les priver du droit de cité[177], dont il leur interdisait l'usage[178]. L'élite de cette plèbe rustique[179] des municipes, c'étaient les chevaliers romains. Seize cents membres de l'ordre équestre furent inscrits sur les premières listes de proscriptions[180]. Mais, jusqu'à la fin de la dictature de Sylla, 9.600 chevaliers furent mis à mort ou exilés[181]. C'est par l'assassinat des Titinii, des Tantasii, des Ninnii, des chefs de ces riches maisons, dont l'éclat offusquait les yeux des nobles, que Catilina débuta dans la carrière politique[182]. La richesse des chevaliers les désignait assez aux poignards des spadassins de Catilina[183]. Mais leur plus grand crime aux yeux de Sylla était leur titre d'anciens juges. C'est contre la faction qui, si longtemps postée dans les tribunaux comme dans une forteresse, avait de là menacé et tyrannisé les sénateurs, que les proscriptions les plus cruelles furent dirigées[184]. C'est pour arracher ce poste aux chevaliers, que Sylla abolit la loi Plotia, et fit une loi judiciaire nouvelle. Il donnait toute la judicature politique aux sénateurs[185]. La loi Cornelia, en appelant seulement des sénateurs à siéger dans les huit tribunaux où se jugeaient les causes publiques, obligea le dictateur à doubler le sénat. Il l'avait déjà fait avant son départ pour l'Asie[186]. Mais les proscriptions ou les lois de Cinna avaient de nouveau réduit ce grand corps à trois cents membres à peu près. Le dictateur ordonna donc que les 35 tribus fissent choix de trois cents chevaliers, pris parmi les plus distingués, et qui deviendraient sénateurs[187]. Depuis ce temps-là, il y eut six cents sénateurs, jusqu'au temps où César en porta le nombre à neuf cents[188]. Pour maintenir le nombre des sénateurs-juges à six cents, Sylla ordonna qu'au lieu de huit questeurs, on en nommât vingt chaque année[189]. Mais les occupations judiciaires, les voyages, les missions diplomatiques, le gouvernement des provinces réduisaient à quatre cents ou quatre cent vingt au plus, le nombre des sénateurs présents aux séances du sénat[190], dans les circonstances les plus solennelles. La loi de Sylla divisait le sénat en deux décuries judiciaires[191], entre lesquelles le sort partageait sans doute les affaires des huit tribunaux. Le préteur, chargé d'une enquête, mettait dans l'urne les noms des sénateurs de la décurie qui devait juger, et faisait tirer au sort le nombre de jurés qui était nécessaire[192]. Puis, l'accusateur et l'accusé exerçaient le droit de récusation ; mais les sénateurs seuls pouvaient récuser plus de trois juges[193]. Le préteur tirait alors de l'urne les noms des jurés suppléants (subsortiebatur). Les juges qui n'avaient pas été récusés, et, par extension, les suppléants de ceux qui l'avaient été, étaient appelés judices selecti ou delecti[194]. Leurs noms étaient inscrits sur les tablettes du préteur et publiquement affichés. Dans une cause publique de l'an 74 av. J.-C., on trouve un jury composé de 33 membres[195], et, si l'on suppose un jury aussi nombreux dans chacun des sept autres tribunaux, on voit que 264 sénateurs pouvaient se trouver occupés en même temps à juger les causes publiques[196]. La loi Cornelia ouvrait la porte à de nombreux abus. Le tirage au sort des juges était dépourvu de garanties. Le préteur dirigeait souvent le hasard. Il s'entendait quelquefois avec un préteur, président d'un tribunal voisin, pour le débarrasser, par ce moyen, des jurés de la décurie qui lui paraissaient pouvoir être gênants[197]. Le préteur, soit qu'il présidât le tribunal, soit qu'il fût de connivence avec le juge de la question présidant à sa place, altérait même les listes du jury déjà formées. Les honnêtes gens, ne trouvant dans la judicature que des ennuis sans compensation, avaient quelquefois la faiblesse coupable de laisser effacer leurs noms d'une liste, et l'on y substituait des juges vendus d'avance à l'accusateur ou à l'accusé[198]. Dans le procès d'Oppianicus (74 av. J.-C.), le tribun de la plèbe, L. Quintius, amena au tribunat le sénateur Stalenus, après avoir interrompu un procès civil où Stalenus était avocat. Ce sénateur avait reçu de l'accusé 640.000 sesterces, à répartir entre seize jurés, ce qui mettait le prix de la conscience de chacun d'eux à 40.000 sesterces (8.600 fr.). Stalenus, pour tout garder, fit condamner Oppianicus au lieu de le faire absoudre[199]. Mais il manquait une voix pour former contre l'accusé la majorité de 17 juges sur 33 ; on introduisit au dernier moment dans le jury, le sénateur Fidiculanius Falcula, qui n'appartenait même pas à la décurie d'où les juges du procès devaient être tirés. Falcula déposa une sentence de condamnation, sans avoir assisté aux débats[200]. La loi semblait autoriser la corruption. Elle laissait l'accusé libre d'imposer à ses juges le vote secret ou le vote public[201], pour qu'il pût, ou dissimuler la vénalité des juges, qu'il aurait payés, ou s'assurer qu'ils gagnaient bien leur argent. Térentius Varron étant accusé d'avoir pillé la province d'Asie, son avocat Hortensius, pour contrôler le vote des juges, sans le rendre tout-à-fait public, fit distribuer des tablettes de cire de couleurs différentes, les unes pour condamner, les autres pour absoudre[202]. Tant d'impudence semblait sans danger depuis que la censure était supprimée et le tribunat affaibli. Le tribunat de la plèbe était presque la seule garantie de la régularité des procédures. Sylla, pour introduire l'arbitraire dans les tribunaux, y rendit impuissante l'intervention tribunitienne. La loi judiciaire de Sylla avait, comme nous l'avons vu, laissé aux chevaliers l'aptitude à être choisis comme juges des causes civiles. Aussi les tribuns de la plèbe gardèrent le droit d'auxilium, celui d'intervenir dans les affaires d'intérêt privé[203]. Mais, les causes publiques étant réservées aux sénateurs, Sylla interdit aux tribuns de la plèbe, sous peine d'amende, d'y interposer leur veto[204]. Du tribunat, il ne restait plus que l'ombre[205], et Cicéron nous dit que ce fut le chagrin de n'avoir plus de véritables juges, qui fit réclamer par le peuple, avec tant d'instances, la restitution de l'autorité politique de cette magistrature[206]. La censure n'avait pas été seulement diminuée. Elle fut supprimée, depuis l'an 86 jusqu'à l'an 70 av. J.-C.[207], comme un contrôle importun sur la conduite des sénateurs[208], et, pendant seize ans, il n'y eut pas un sénateur condamné pour malversations dans les provinces, qui ne fût accessoirement condamné pour avoir vendu sa voix dans un tribunal[209]. Ce dernier crime échappait à la justice, lorsqu'il n'était pas accompagné d'un crime plus grand. Que signifiait, sous un tel régime, la loi de Sylla contre la connivence des juges avec l'accusateur ?[210] Elle n'était qu'une garantie d'impunité accordée aux sénateurs accusés. Ainsi, toute la législation Cornélienne semble inspirée par une étrange préoccupation, déjà avouée par Livius Drusus, celle de sauver les coupables. Lorsqu'elle fut supprimée, lorsque la censure et le tribunat furent rétablis, en 70 av. J.-C., soixante-quatre sénateurs furent chassés du Sénat[211]. L'ordre équestre profita des fautes et de l'impopularité des sénateurs. Trois hommes revendiquèrent pour ' les chevaliers romains la suprématie politique. Ce furent Pompée, Cicéron et L. Aurelius Cotta. Pompée, d'une famille équestre du Picenum, si riche que, sur ses domaines, il pouvait recruter une armée ; a été, toute sa vie, un chef de bandes qui prétendait ne rien devoir à Rome de sa grandeur personnelle et héréditaire. ll servait sa patrie en réservant toujours son indépendance, et avec l'ostentation si naturelle plus tard aux grands seigneurs féodaux. Il n'eut jamais d'autre général que lui-même, ni d'autre parti que le sien. Il commença par combattre à côté de Sylla contre le parti de Marius. Mais malgré ses services et sa gloire précoce, il ne fut pour les nobles de Rome qu'un italien, un homme nouveau. On traita en parvenu, celui qui n'avait pas besoin de parvenir. Aussi toute la carrière de ce syllanien fut un démenti à la législation de Sylla. Le dictateur, pour retarder l'élévation des hommes nouveaux, avait défendu de briguer la préture avant la questure et le consulat avant la préture. Or, Pompée n'était encore qu'un simple chevalier de 24 à 25 ans, lorsqu'en 81 av. J.-C., il dirigea en Afrique la guerre contre Juba et revint triompher à Rome, en dépit du dictateur[212]. Cinq ans après, il n'avait encore exercé aucune magistrature curule, et il n'avait d'autre titre que celui de chevalier, lorsque le Sénat l'envoyant contre Sertorius, le décora du pouvoir consulaire[213]. Le chef des bandes italiennes vint à bout du chef des bandes espagnoles et, de retour à Rome, à l'âge de 34 ans, il obtint, malgré toutes les lois, le consulat, la première charge qu'il eût jamais demandée[214]. Pompée, consul, rétablit les droits du tribunat et de la censure, et, pour montrer aux Syllaniens que les magistratures romaines n'ajoutaient rien à sa puissance, il vint, le jour de la revue des centuries équestres, se présenter au tribunal des censeurs en tenant son cheval par la bride comme un simple chevalier equo publico[215]. Cette orgueilleuse démonstration de force fut un triomphe pour l'ordre équestre, qui crut reconnaître son véritable chef dans ce consul venu du Picenum. Mais la plus éclatante revanche des chevaliers contre le Sénat, ce fut le vote de la loi judiciaire, proposée Par le préteur L. Aurelius Cotta, 70 av. J-C. Le procès de Verrès porta au comble l'indignation déjà soulevée contre les sénateurs. Les deux premiers discours de Cicéron contre Verrès, qui seuls furent prononcés, étaient moins la mise en accusation du propréteur de Sicile devant ses juges, que celle des juges eux-mêmes devant le peuple romain[216]. Verrès s'exila, mais le but politique de l'orateur n'était pas atteint, tant que les tribunaux n'étaient pas rendus aux chevaliers. Les dernières Verrines furent des pamphlets destinés à justifier la loi judiciaire du préteur L. Aurelius Cotta. La loi Aurelia abolit la loi faite l'année précédente par M. Cotta sur les causes privées[217], et, ôtant aux sénateurs le monopole de la judicature politique, partagea le droit de juger les causes publiques et privées, entre les sénateurs, les chevaliers ayant le cens équestre de 400.000 sesterces, et une classe de citoyens, appelés tribuns de la solde (tribuni æris ou tribuni ærarii)[218]. Depuis l'an 70 av. J.-C. jusqu'à la dictature de César, 46 av. J.-C., nous voyons ces trois ordres de juges siéger, à peu près en nombre égal, dans chacun des huit tribunaux des enquêtes perpétuelles. Nous ne pourrions nous faire une idée exacte de l'ensemble des lois judiciaires à Rome, si nous ne déterminions ce qu'étaient les tribuns de la solde. Un des principaux résultats, où nous sommes arrivé dans l'histoire des chevaliers romains, étant d'identifier l'ordre équestre avec la première classe des citoyens inscrits sur les registres du cens, ce résultat ne peut avoir toute sa valeur, que si nous le plaçons à la tête d'une série de faits analogues, qui le complètent et l'expliquent. Ce sera d'ailleurs nous conformer au plan général de cet ouvrage, que de montrer les rapports de la classe des chevaliers avec les autres classes de la société romaine[219]. Nous essaierons de prouver que les tribuns de la solde étaient les citoyens de la seconde classe du cens, et les juges ducénaires établis plus tard, les citoyens de la troisième classe[220]. Malgré la distinction établie par la loi Aurelia,
entre les chevaliers et les tribuni ærarii,
deux passages de Cicéron et un de Velleius semblent les confondre. Cicéron,
défendant Fonteius contre Induciomar et les Gaulois, en 69 av. J.-C., un an
après le vote de la loi Aurelia, cherche à éveiller les susceptibilités
patriotiques des juges : Quoi ! ne serait-ce pas,
dit-il, une honte pour cet empire, qu'on allât dire
en Gaule que des sénateurs, des chevaliers, émus, non du témoignage de ces
Gaulois, mais de leurs menaces, ont jugé selon le caprice des témoins[221]. Les tribuni ærarii, qui siégeaient certainement
parmi les juges de Fonteius, sont-ils donc ici compris sous le nom de
chevaliers romains ? Cette supposition est inutile. Cicéron, qui dans
d'autres passages[222] distingue les chevaliers
des tribuni ærarii, ne se proposait pas
ici d'énumérer les trois sortes de juges. Il voulait produire un effet
oratoire, et le nom modeste des tribuns de la solde eût été mai placé dans sa
phrase emphatique, à côté de ceux des sénateurs et des chevaliers romains.
Dix ans après, défendant L. Flaccus contre les Asiatiques, Cicéron cherche
encore à donner le change aux membres du tribunal. Il présente les plaintes
des opprimés, non plus comme des menaces, mais comme des attaques indirectes
contre son fameux consulat, parce que L. Flaccus avait été un de ses amis
politiques. Il ne s'agit point ici de Mysiens, ni de
Lydiens. C'est de la situation intérieure de notre pays que vous allez
décider. Tous les soutiens de Aucun de ces trois passages n'autorise donc à supposer que ces tribuns fissent partie de l'ordre équestre. Pour savoir à quelle classe ils appartenaient, au lieu de tirer des inductions de quelques phrases détachées, il vaut mieux consulter le sens général de la loi Aurelia, et des lois judiciaires qui l'ont suivie. Aurelius, renversant la loi judiciaire de Sylla, devait naturellement prendre pour modèle la loi précédente, c'est-à-dire celle de Plotius. Or la loi Plotia ordonnait que chaque tribu choisît dans son sein quinze juges, et nous avons vu que le, résultat de cette élection avait été de partager la judicature entre les sénateurs, les chevaliers et même quelques citoyens de la plèbe[225]. La loi Aurelia ne confiait pas au peuple l'élection des juges. C'était au préteur urbain de dresser, tous les ans, le tableau des juges appelés selecti, où il devait inscrire les plus honnêtes gens des trois ordres[226]. Le troisième ordre, celui des tribuni ærarii, qui perdit le droit de siéger dans les tribunaux politiques au temps de César[227], se composait, selon Dion Cassius, de plébéiens[228], c'est-à-dire de juges qui n'avaient pas le cens équestre[229]. Ces tribuns se rencontraient en grand nombre dans les petites villes et dans les tribus rustiques de l'Italie romaine. Cicéron nous montre beaucoup de tribuns de la solde, venant avec des chevaliers romains d'Atina, ville de la tribu Térentine, pour appuyer son client Cn. Plancius[230]. Le plaidoyer pro Plancio nous prouve aussi que le préteur urbain devait choisir des juges des trois ordres dans chacune des 35 tribus. La loi Licinia de sodalitiis de l'an 55 av. J.-C., sans déroger aux dispositions générales de la loi Aurelia, sur le choix des juges, ordonnait que l'accusateur désignât à l'accusé quatre tribus, dont les juges pourraient siéger au tribunal, et que l'accusé put écarter, par voie de récusation, une de ces tribus. C'est en vertu de cette loi que Cn. Plancius d'Atina fut accusé d'avoir corrompu au moyen de confréries politiques, les tribus Terentina et Voltinia, pour se faire nommer édile. L'accusateur Juventius Laterensis proposa à Plancius les juges des tribus Lemonia, Veientina, Crustumina et Mæcia. Plancius récusa la tribu Mæcia[231] : Il devait donc y avoir dans chaque tribu des juges des trois ordres, des sénateurs, des chevaliers et des tribuns de la solde. Ces tribuns étaient des plébéiens, rangés dans la classe inférieure à celle des chevaliers romains, et répandus, comme l'ordre équestre, dans les villes romaines de l'Italie. Cette conclusion est d'accord avec celles où sont arrivés les plus savants critiques, dont les travaux nous ont guidés dans cette recherche, et elle les concilie. D'après M. Madwig[232], avant que la
solde fût payée par le trésor public, chaque tribu romaine entretenait les
soldats de son contingent. Dans chaque tribu, la solde était levée ou payée
par des personnes responsables du paiement. Les soldats avaient le droit,
s'ils n'étaient pas soldés, de prendre des gages sur la fortune de ces payeurs,
comme les chevaliers romains, sur la fortune des veuves et des orphelins qui
leur devaient l'æs hordearium. Ces
payeurs de solde devaient donc avoir une certaine fortune déterminée, pour
servir de garantie. M. Madwig définit ainsi les tribuni
ærarii du premier siècle de Quand la fonction de payer la solde, passa aux questeurs militaires, les tribuni ærarii continuèrent à former une classe du cens. C'est à ce titre qu'Aurelius Cotta les appela, en l'an 70 av. J.-C., à partager la judicature avec les sénateurs et les chevaliers. Selon M. Mommsen[233], les tribuni ærarii, chargés dans chaque tribu de payer la solde, n'étaient pas de simples particuliers. Ils formaient une magistrature élective, renouvelée tous les ans, et s'appelaient aussi curatores tribuum. Ils avaient rang de centurions civils, et, les jours de vote, ils conduisaient au Champ de Mars les centuries des cinq premières classes. Comme, depuis l'an 240 av. J.-C., il y eut dix centuries par tribu, on devait élire chaque année dans ces cinq classes 350 nouveaux centurions civils, qui, en sortant de charge, entraient dans l'ordre des tribuni ærarii. M. Marquardt[234], après avoir rappelé les opinions de MM. Madwig et Mommsen, établit qu'au premier siècle de la république, les tribuni ærarii étaient chargés du paiement de la solde[235], que de 70 à 46 av. J.-C., ils formèrent la troisième décurie de juges, mais qu'entre ces deux époques, il existe une vaste lacune qui ne permet pas de suivre leur histoire[236]. Toutes ces opinions s'accordent ensemble. Les tribuni ærarii furent d'abord choisis dans une classe déterminée de citoyens et chargés du paiement de la solde. Lorsque ces fonctions passèrent aux questeurs militaires, la classe d'où avaient été tirés les tribuni ærarii garda cet ancien nom, tandis que les magistrats successeurs de ceux qui l'avaient porté, étant chargés de fonctions plus restreintes, s'appelaient curatores tribuum. M. Marquardt cite les passages qui prouvent qu'au moins depuis l'an 70 av. J.-C., la classe des tribuni ærarii avait une fortune déterminée par la loi[237], et il conclut ainsi : Dans ces passages, il n'est pas affirmé que ces tribuni fussent une classe du cens ; mais c'est ce qu'on doit conclure de l'analogie qu'ils avaient avec les chevaliers romains. Comment donc des savants de premier ordre ont-ils pu voir que les tribuni ærarii était une classe du cens, sans pouvoir déterminer quelle était cette classe, et quel était le chiffre de ce cens ? Comment de si beaux travaux, faute de conclusion précise, restent-ils inutiles pour l'intelligence de la constitution romaine ? C'est qu'une théorie erronée, en faussant toutes les idées sur la situation économique de la société romaine, a frappé d'avance de stérilité toutes les recherches de détail sur les différentes classes de cette société. M. de Savigny avait déjà réfuté cette théorie dans son beau mémoire sur la loi Voconienne[238], lorsque dix-huit ans après, M. Bckh, fit revivre cette erreur et la fortifia de l'autorité de son nom[239]. M. Bckh détermine ainsi le cens des classes après la révolution économique de 240 av. J.-C.
Ce tableau où l'on ne reconnaît guère les grandes fortunes des contemporains des Scipions et de Cicéron, n'est que la transcription de celui que Tite-Live nous a donné des chiffres du cens de l'époque du roi Servius Tullius. M. Bckh, voulant corriger Tite-Live, a supposé que ces chiffres convenaient, non au cens de l'époque des rois, mais à celui de l'époque des dernières guerres puniques. Pour justifier cette correction malheureuse, il a adopté la traduction fautive que donne Denys d'Halicarnasse des chiffres du cens du temps des rois, en supposant que les as de Servius étaient de deux onces et qu'ils étaient représentés par des valeurs en argent. Il n'y a aucun rapport entre l'hypothèse de M. Bckh et les faits réels. Les chevaliers romains avaient une fortune estimée au moins 400.000 sesterces, c'est-à-dire dix fois plus grande que celle qui, d'après M. Bckh, rangeait un citoyen dans la première classe. Les tribuni ærarii, qui sont toujours nommés immédiatement après les chevaliers romains[240], ne trouvent pas plus facilement leur place dans les cadres des classes que ce savant a tracés. Au-dessous des tribuni ærarii, fut instituée au temps d'Auguste une quatrième décurie de juges pris parmi les citoyens d'un, cens inférieur, et qui jugeaient les procès civils de médiocre importance[241]. Ces juges de paix s'appelaient ducenarii, parce que leur fortune était de deux cent mille sesterces[242]. Dion Cassius, racontant les événements qui précèdent la bataille d'Actium, mentionne une loi concernant certains affranchis dont le cens était aussi de 50.000 drachmes, ou de 200.000 sesterces[243]. La loi Papia faite en l'an 9 ap. J.-C., parle d'une catégorie d'affranchis, dont le cens était de cent mille sesterces, et que Justinien, pour cette raison, appelle centenarii[244]. Ce cens de cent mille sesterces était aussi exigé du temps de Pline le jeune pour être décurion de la petite ville de Côme[245]. Quand on admet, avec M. Bckh, que 40.000 sesterces suffisaient pour élever un citoyen à la première classe, on est assez embarrassé pour classer les ducenarii et les centenarii qui n'étaient certes pas à la tête de la société romaine. C'est le même embarras qui a empêché MM. Madwig et Marquardt de classer les tribuni ærarii. Mais quand on admet l'évaluation des fortunes que nous
avons établie[246], celle qui
attribue à la première classe une fortune au moins de 400.000 sesterces ; (86.000 francs), à la seconde classe une
fortune de 300.000 sesterces (64.500 francs),
à la troisième classe une fortune de 200.000 sesterces (43.000), à la quatrième classe une fortune
de 100.000 sesterces (21.500 francs),
toutes les catégories connues de citoyens romains des deux derniers siècles
de Les centurions civils qui conduisaient au vote du Champ-de-Mars, les centuries de l'Assemblée, avaient un rang analogue à celui des centurions qui conduisaient les files de soldats. L'armée urbaine des électeurs et l'armée des combattants, quoique tout-à-fait distinctes, avaient des cadres correspondants. Comme dans le tschinn de Russie[247], les grades des deux hiérarchies étaient équivalents. La mesure commune de leur valeur, c'était la fortune inscrite sur les listes du cens d'après lequel on classait les citoyens et les soldats. C'est le cens, dit Sénèque, qui élève un homme à la dignité de sénateur. C'est le cens qui distingue le chevalier romain de la plèbe. C'est le cens qui dans le camp amène les promotions. C'est d'après le cens qu'on choisit un juge au Forum[248]. La hiérarchie militaire des Romains et même celle des fonctions publiques doivent donc nous offrir des grades équivalents au rang des tribuni ærarii ou des centurions civils. Les tribuni rarii, dans la hiérarchie judiciaire, sont placés entre les chevaliers romains, qui furent appelés juges quadringénaires à cause de leur cens de quatre cent mille sesterces[249], et les juges ducenaires nommés par Auguste. Ils étaient donc des trecenarii comme citoyens de la seconde classe et nous devons retrouver un grade de l'armée et un échelon des fonctions publiques qui porte ce nom. Dans l'armée, le grade de centurion était, en général,
inférieur au rang du simple cavalier romain[250]. Mais l'égalité
s'établit entre la dignité de chevalier equo publico
et certains grades élevés. Dès l'an 152 av. J.-C., les tribuns militaires
portaient l'anneau d'or, comme la chevalerie sénatoriale des six premières
centuries[251].
En 70 av. J.-C., trois sénateurs ou chevaliers pédaires, nommés sénateurs par
Sylla, sans avoir exercé une charge curule, sont élevés par les comices au
rang de tribuns militaires[252], et, dans la
loi Servilia de repetundis, le titre de tribun d'une des quatre
premières légions est mis sur le rang des magistratures sénatoriales[253]. César désigne
plusieurs fois les tribuns militaires et les préfets de son camp sous le nom
de chevaliers romains[254]. Au-dessous de
cette chevalerie sénatoriale, les centurions de primipile acquirent aussi au
temps de César le rang équestre, et même, par un abus qui flattait la vanité
militaire, le droit de porter l'anneau d'or[255]. Un capitaine
gagnait à la fois au prix de son sang la fortune et le titre de chevalier[256]. Le général
accompagnait chaque promotion d'une libéralité qui élevait la fortune du
centurion au niveau du grade obtenu. Ces cadeaux étaient pris, au temps de D'un autre côté, on ne trouve dans l'histoire militaire de Rome ni cohorte, ni centurie[262] qui se soit composée de 300 hommes. Les centurions trécenaires s'appelaient donc ainsi, parce qu'ils possédaient le cens de trois cent mille sesterces jusqu'au moment où, par un don impérial de cent mille sesterces, ils seraient promus à la fois au rang de citoyens de la première classe, aux honneurs de la chevalerie romaine, et au grade de primipilaires. La fortune des trécenaires les mettait dans la hiérarchie romaine au niveau des citoyens de la seconde classe et des anciens tribuni ærarii. L'usage des dons de 100.000 sesterces ( Dans la hiérarchie civile on trouve aussi des procurateurs impériaux portant, les titres de centenarii, ducenarii, trecenarii[268], et passant par avancement d'une classe à l'autre. Mais un passage de Dion Cassius autorise à supposer que ces titres désignent des traitements annuels, quoique des traitements de cent à trois cent mille sesterces paraissent énormes pour des fonctionnaires dont les uns étaient chevaliers, mais dont un grand nombre étaient des affranchis[269]. Laissant de côté ici cette dernière question, nous donnerons un tableau de ces hiérarchies parallèles fondées sur les catégories du cens et qu'on pourrait appeler le tschiniz romain.
Cette classification générale était nécessaire pour comprendre la loi judiciaire d'Aurelius Colla. Cicéron nous dit que les lois judiciaires d'Aurelius, de Pompée et de César n'excluaient pas les centurions des tribunaux, pourvu qu'ils eussent un cens déterminé[270]. En effet d'après ces trois lois, les anciens centurions primipilaires, ayant le titre et la fortune des chevaliers romains, pouvaient faire partie de la seconde décurie de juges. La loi Aurelia ouvrait même la troisième décurie judiciaire aux centurions trécenaires, qui appartenaient à la seconde classe des citoyens, à celle des tribuni ærarii. Ainsi, d'après la loi d'Aurelius Cotta, dans les huit tribunaux politiques, siégeaient en nombre égal[271], les sénateurs, les chevaliers ou citoyens de la première classe, et les tribuns de la solde en citoyens de la seconde classe. Il y avait ordinairement dans chaque tribunal 50 juges-chevaliers choisis sur une liste de 125 jurés de leur ordre, désignés pour siéger dans ce tribunal[272]. Comme il y avait huit tribunaux permanents, qui pouvaient siéger en même temps[273], la liste annuelle des jurés de l'ordre des chevaliers, dressée par le préteur, urbain[274], devait comprendre au moins mille jurés[275]. Il y a même des raisons de croire qu'elle en comprenait 1050. Les sénatus-consultes ou les lois particulières, surtout celles contre la brigue électorale (de ambitu)[276], faisaient varier à chaque instant l'application de la loi Aurelia. Tantôt les juges étaient désignés par le sort, tantôt ils étaient désignés par l'accusateur à l'accusé, qui avait droit d'eu récuser un certain nombre[277]. Or, nous voyons que d'après la loi Licinia, de l'an 55 av. J.-C., l'accusateur proposait les juges de quatre tribus[278]. Pour que cette proposition fût à peu près aussi large que celle où il y avait eu 125 juges de l'ordre équestre[279] désignés par l'accusateur, chacune des quatre tribus avait dû compter, sur l'Album de l'année, au moins trente chevaliers-juges, ce qui en suppose 1050 pour les trente-cinq tribus. Il faut admettre, par conséquent, qu'il y avait aussi, sur l'Album des juges de l'année, 1.050 tribuni ærarii choisis et inscrits par le préteur urbain. C'étaient là les deux dernières décuries. Quant à la décurie sénatoriale, elle se composait naturellement des 400 à 420 sénateurs habituellement présents à Rome[280]. Le préteur urbain n'avait pas à en dresser la liste, mais, comme dans les procès politiques il y avait ordinairement cinquante juges de chacun des trois ordres, le préteur pouvait faire tirer au sort les noms de cinquante sénateurs, pour chacun des huit tribunaux politiques. La judicature, ainsi partagée d'une façon équitable entre les trois ordres supérieurs de la société romaine, semblait promettre une justice impartiale. Mais la violence des passions politiques et la vénalité devenue universelle, rendirent inutile la sagesse de la loi Aurelia. L'expulsion de soixante-quatre sénateurs du parti de Sylla, par les censeurs L. Gellius et Cornelius Lentulus, avait changé le sens de la majorité dans le Sénat, où les séances ordinaires réunissaient à peine deux cents sénateurs[281]. Crassus, Catulus, Hortensius, tous ceux qu'avaient enrichis les bienfaits du dictateur, se virent réduits à l'impuissance dans la curie elle-même, tandis que les tribuns de la plèbe, rétablis dans la possession de leurs droits politiques, s'en servaient en faveur des chevaliers romains. En 67 av. J.-C., le tribun L. Roscius Otho fit voter une loi qui réservait aux chevaliers romains possédant 400.000 sesterces, les XIV bancs du théâtre placés derrière l'orchestre où prenaient place les sénateurs[282]. Cicéron prétend que cette loi était alors réclamée par les plébéiens comme l'avait été la loi judiciaire d'Aurelius[283]. Ce fut encore l'ordre équestre qui, par l'intermédiaire des tribuns Gabinius et Manilius fit décerner à Pompée le commandement des guerres contre les pirates et contre Mithridate, avec une puissance presque royale. En vain Catulus et Hortensius dénonçaient un monarque dans ce général, à qui on confiait la moitié du monde romain. Ils ne pouvaient plus se faire écouter. Rome était trop grande et courait de trop grands dangers pour que ses chefs fussent de simples citoyens. La lutte politique n'était plus, à vrai dire, entre les classes de la société romaine, entre les chevaliers et les sénateurs, mais entre des hommes plus puissants que leur patrie. Cicéron, dans le pro lege Manilia, idéalisait Pompée,
son héros politique. Son imagination d'artiste et d'orateur lui préparait
toujours un désenchantement, après une illusion presque volontaire[284]. Pompée n'était
nullement l'homme des chevaliers romains. Il n'était pas plus dévoué à leur
cause qu'à celle de sa patrie elle-même. Auteur de sa propre fortune, il
croyait être plus nécessaire à Rome que Rome ne l'était au grand Pompée. Son
orgueil était froid, son ambition, immense et cachée comme celle d'un
Waldstein, son esprit médiocre. Timide et comme dépaysé dans la ville, il
retrouvait ses rares facultés au milieu des soldats. Crassus, le riche
Crassus, était jaloux de Pompée. Lui qui spéculait sur les incendies pour
acquérir des maisons à vil prix, lui qui semblait l'acheteur prédit par
Jugurtha à la ville vénale, il trouvait que la gloire de Pompée faisait
hausser les enchères de la toute-puissance. Plus habile que l'un et l'autre,
C. César empruntait des millions à Crassus, et soutenait ceux qui décernaient
à Pompée des pouvoirs extraordinaires. De l'un, il faisait un banquier
intéressé à sa fortune politique, de l'autre, un précurseur de sa puissance.
Une popularité restreinte à une classe de citoyens, ne suffisait pas à César.
Il lui fallait la faveur du peuple tout entier. Quand il revint d'Espagne, en
67 av. J.-C., il promit le droit de cité romaine aux colonies latines de On devine quels sentiments devait inspirer, à des hommes
qui roulaient dans. leur esprit des projets immenses, cette royauté du
barreau et de la tribune circonscrite dans l'enceinte du Forum, et qui était
le rêve de Cicéron. Ce fut la gloire du grand orateur, de défendre contre des
forces écrasantes une liberté condamnée à périr. Mais cette lutte, qui
commença et finit si tragiquement, par le plaidoyer pour Roscius et par les
Philippiques, n'offre souvent, dans les détails, qu'un intérêt médiocre.
Comme avocat, Cicéron songeait plus. à faire admirer son talent, qu'à donner
une haute idée de son caractère. Il était plus préoccupé du succès que de la
vérité, et de l'avenir de son parti que du sort de son client. L'accusateur
de Verrès tit absoudre Fonteius, qui avait pillé Aussi, deux fois en cette même année, le tribun Manilius interrompit par la violence le cours de la justice. Il obligea par des menaces les frères Cominii à renoncer à une accusation contre l'ancien tribun Cornélius, et sa bande de spadassins dispersa les juges[287]. A la fin de l'année, Manilius lui-même fut cité à comparaître devant le tribunal de Cicéron. Cédant aux conseils de Catilina, il lança de nouveau ses bandits contre les juges[288]. Cicéron déplorait ces atteintes portées à l'autorité des tribunaux constitués par la loi Aurélia. Les seuls, en effet, qui pussent profiter de ces violences étaient ceux qui les inspiraient, quelques vieux Syllaniens qui voyaient dans la faute de Manilius une occasion de prendre leur revanche contre le tribunat[289], et quelques jeunes nobles comme Sylla, Autronius, Pison, qui avaient des raisons personnelles de craindre la justice. A la tête de cette jeunesse corrompue, était L. Sergius Catilina, patricien déchu, et devenu dans Rome le porte-étendard du désordre, de la misère[290] et du crime. Il avait, jeune encore, servi Sylla comme chef d'assassins. Il ne rêvait que dictature et proscriptions, et jetait avec dédain le nom de liberté comme un appât à toutes les passions sauvages qu'il appelait au service de son ambition. Il portait dans sa politique malfaisante quelques-unes des fortes qualités de sa race : une bravoure sans frein, un esprit souple et vigoureux capable de créer toutes les ressources[291], une âme de feu fournissant à un corps épuisé par les excès des forces toujours nouvelles. Il descendait de ce M. Sergius, qui avait remplacé par une main de fer sa main droite coupée. Ce vieux héros des guerres puniques, atteint de vingt-trois blessures dans un seul combat, fut fait prisonnier par Annibal. Il brisa deux fois ses chaînes et continua à combattre du bras gauche[292]. A l'énergie de son bisaïeul, Catilina joignait une grâce superbe et séduisante[293], qui trompa quelque temps Cicéron. L'aristocratie le traitait en enfant perdu, mais l'aimait encore en le désavouant. Les patriciens n'avaient pas besoin de se concerter pour s'entendre. Ils se croyaient tous nés pour la domination. Ils y marchaient sans scrupule et sans crainte, comme si le génie de Rome les eût marqués d'un signe qui les fit reconnaître pour les chefs prédestinés de l'empire. Aussi quelle ne fut pas la fureur de Catilina, lorsque le consul plébéien Volcatius le raya, sur l'avis des sénateurs, de la liste des candidats au consulat pour l'an 65 ! Il excita les consuls désignés, Sylla et Autronius, à disperser le tribunal qui devait les juger. Malgré un attroupement, malgré tes pierres qui leur furent lancées[294], les juges condamnèrent les deux accusés comme coupables de brigue et d'achat de suffrages. Autronius et Sylla furent privés de l'espérance du consulat. Catilina s'entendit alors avec eux pour assassiner les deux nouveaux consuls, Manlius Torquatus et L. Aurelius Cotta. Mais le coup fut manqué, et Catilina se mit de nouveau sur les rangs parmi les candidats au consulat pour l'an 64, av. J.-C. Hortensius, de concert avec Manlius Torquatus, fit accuser Catilina d'exactions. Claudius Pulcher le cita devant le tribunal de repetundis, pour avoir pillé la province d'Afrique. La candidature de Catilina était encore une fois ajournée. Comme pour lui montrer qu'on l'éconduisait par mépris et sans aucune haine, sitôt que les élections furent terminées, Manlius Torquatus se rapprocha de lui. L'accusateur Claudius Publier s'entendit avec lui et sans doute avec le préteur, pour composer le tribunal de juges faciles à corrompre. Cicéron même promit de défendre Catilina. Son éloquence ne fut pas nécessaire, et l'on n'insista pas pour qu'il tint sa promesse. L'argent fut prodigué aux juges et un verdict scandaleux renvoya Catilina absous[295], 65 av. J.-C. Les sénateurs qui avaient siégé au tribunal, pour détourner le soupçon de vénalité, prétendirent avoir condamné le coupable et rejetèrent sur les chevaliers et sur les tribuns de la solde la responsabilité de cet acquittement[296]. Asconius, commentant un mot de Cicéron prononcé devant le Sénat où cette supposition était admise, a commis un anachronisme et parlé de trois urnes où les trois ordres de juges auraient, dès cet époque, voté séparément[297]. Mais c'est là une fausse interprétation de la pensée de Cicéron et de la loi Aurélia. Dans tous les pays où les partis sont livrés à des luttes ardentes, une publicité trop retentissante donnée aux jugements qui excitent les passions politiques, devient un danger pour la liberté. Elle transforme les jurés en flatteurs timides et vaniteux de l'opinion, ou du parti bruyant qui usurpe le droit de l'exprimer. Au lieu d'écouter leur conscience, ils n'entendent plus que le cri populaire qui leur dicte les sentences du tyran anonyme, du monstre à dix mille têtes. La loi Aurélia avait prévu ce danger. Elle avait ordonné que les tablettes des juges fussent déposées et confondues dans une seule urne pour que le vote secret garantit l'indépendance de chaque juré. Mais il n'est pas de loi si sage, dont la faiblesse ou les passions des hommes ne puissent détruire l'effet. Les jurés, pour aller au devant des soupçons, ou pour se créer une popularité de mauvais aloi, donnaient à leurs sentences une publicité illégale et souvent mensongère. Chacun des trois ordres de juges s'attribuait, dans le verdict, voix qui étaient selon le vu de l'opinion dominante, et rejetait sur les deux autres ordres la responsabilité des jugements impopulaires. Ce fut pour mettre un terme à cet abus, qu'en Fan 59 av. J.-C, le préteur Fufius Calénus fit passer une loi, qui ordonnait que, dans chaque jury, les sénateurs, les chevaliers, les tribuns de la solde, votassent dans trois urnes distinctes. Ainsi le vote restait secret pour chaque juré. Mais chaque ordre de juges ne pouvait plus désavouer le vote de la majorité de ses membres[298]. Cette séparation des trois urnes n'existait pas encore au temps du procès de Catilina, et l'assertion des sénateurs ; qui prétendaient l'avoir condamné, ne pouvait être contrôlée et ne méritait aucune confiance. Elle prouve seulement qu'ils étaient soupçonnés de corruption, et qu'ils sentaient le besoin de se défendre, 65 av. J.-C. Le mépris indulgent de la noblesse exaspérait Catilina bien plus que ne l'eût fait la défiance de ses ennemis. Ceux même qui l'avaient absous rougissaient de lui, et le reniaient publiquement. Il ne s'en présenta pas moins comme candidat pour le consulat de l'année 63. Il rencontra parmi ses compétiteurs celui qui devait s'immortaliser en déjouant ses projets, M. Tullius Cicéron d'Arpinum. Cicéron était le seul des six candidats an consulat, qui fût sorti d'une simple famille équestre, et il s'en vantait[299]. Aussi chercha-t-il à se faire une popularité spéciale parmi les chevaliers, dans cette première classe des citoyens, qui dirigeait les municipes italiens[300], et pendant son consulat, il constitua définitivement l'autorité de l'ordre équestre[301]. Dix ans après, lorsque, revenu de toutes les illusions politiques, il cherchait encore un dernier point d'appui sur ceux qui avaient soutenu ses premiers efforts, il disait aux juges de Rabirius Postumus[302] : Ecoutez-moi, chevaliers romains. Vous savez que je suis sorti de vos rangs, que j'ai toujours pris à cur tous vos intérêts. C'est ma grande sollicitude, ma profonde affection pour votre ordre, qui me fait parler. D'autres ont pu s'attacher à d'autres classes, à d'autres ordres. Pour moi, c'est vous seuls que j'ai toujours aimés. Aussi, dans sa candidature, Cicéron eut pour lui ce qu'avaient eu les hommes nouveaux, tous les publicains, presque tout l'ordre équestre et un grand nombre de municipes[303]. Le titre de patron des publicains, et de chef de l'ordre équestre, aurait pu être, aux yeux des nobles de la ville si jaloux de fermer les abords du consulat aux hommes nouveaux, un motif d'exclusion[304]. Mais alors César et Catilina faisaient trembler les nobles et les chevaliers, pour leur liberté et pour leur fortune. La crainte fit taire l'envie[305], et les nobles eux-mêmes portèrent Cicéron au consulat. Catilina échouait pour la troisième fois. Furieux, ruiné par les frais de ses candidatures malheureuses, il commença alors à préparer cette conjuration célèbre, qui éclata l'année suivante. Esprit pénétrant, mais sans étendue, n'ayant que l'art de manier les passions, sans être capable d'aucun projet politique, il s'obstinait dans l'idée fixe d'arriver à la dictature par le consulat. Pâle, les yeux troubles et injectés de sang, tantôt hâlant, tantôt ralentissant sa marche, comme une bête fauve dans sa cage, Catilina semblait se heurter à chaque pas contre un nouvel obstacle. Avant la fin de l'année 64, il fut traduit par Lucceius devant le tribunal de César qui, à titre de judex qustionis, dirigeait alors les enquêtes contre les assassins. Des consulaires s'intéressèrent à Catilina, et vinrent faire son éloge devant les juges[306]. L'accusé fut encore une fois absous. La noblesse le regardait comme un enfant perdu, qu'il fallait surveiller, et César, comme un insensé, utile pour occuper Cicéron, et qu'on enfermerait le jour où sa folie deviendrait dangereuse. César avait trop d'esprit pour se salir au contact de cette fange sanglante où s'agitaient les chefs de la conjuration. Tandis que Catilina ramassait autour de lui tous les débris du vieux parti de Sylla, César se mettait résolument à la tête du parti de Marius, pour réaliser les meilleures pensées des Gracques et devenir le maître de Rome. Il avait fait condamner à son tribunal L. Bellianus, oncle de Catilina, qui, sur l'ordre de Sylla, avait assassiné Lucretius Ofella[307]. Puisque les auteurs des proscriptions étaient coupables, les lois contre les fils des proscrits devaient être rapportées. César voulut leur faire rendre le droit d'aspirer aux magistratures. Les biens confisqués qui avaient servi de récompense aux partisans de Sylla, pouvaient devenir un sujet de réclamations et de discordes. Déjà ces biens étaient dépréciés comme nos biens nationaux après la révolution française. César prépara, de concert avec le tribun Servilius Rullus, une loi agraire qui eût permis de racheter, avec l'argent que les généraux auraient rapporté de leurs conquêtes, ces biens mal acquis, pour les distribuer à des colons, avec beaucoup d'autres terres. Toute loi agraire, nous l'avons déjà vu, rapprochait, par le sentiment d'un danger commun, les sénateurs des chevaliers. Aussi ce fut par l'accord des deux ordres[308] que Cicéron espéra contenir l'ambition de César et les désirs de la plèbe. C'était la politique autrefois employée avec succès par Scipion Emilien et par le sénat contre les Gracques ; mais comme Rullus gardait des ménagements pour les intérêts de la noblesse, on peut dire que ce fut surtout l'intérêt des publicains que Cicéron défendit en attaquant sa loi agraire[309]. Aux nobles, il montra César prêt à envahir la tyrannie[310], lorsque Rullus aurait mis à sa disposition tant de riches territoires. Chez la plèbe des tribus de la ville, il suscita un sentiment de basse jalousie contre la plèbe des tribus rustiques à laquelle Rullus avait naturellement promis les meilleures terres[311]. La loi agraire fut repoussée. Mais le succès du grand orateur n'empêchait pas sa situation d'être fausse et son langage plein de contradictions. Etait-ce bien au consul qui s'opposait au rétablissement des fils des proscrits dans tous leurs droits, qu'il convenait de combattre la loi de Rullus comme trop favorable aux Syllaniens, usurpateurs des biens des proscrits[312] ? Tenait-il le langage d'un homme d'Arpinum porté an pouvoir par le suffrage du parti municipal et des tribus rustiques, lorsque, pour faire repousser la loi agraire, il flattait la fainéantise des citadins, leur goût pour les jeux, pour les distributions, pour le trafic des votes électoraux, et pour les autres plaisirs de la ville[313] ? Enfin, lorsque, pour soutenir l'autorité du Sénat[314], il défendait contre Labienus, ami de César, le vieux Rabirius, un des meurtriers du tribun Saturninus, ne pouvait-on pas se souvenir que l'avocat qui justifiait ce meurtre, avait aillé Pompée à rétablir le tribunat et défendu dans la personne de Cornélius cette institution plébéienne, avec toute l'ardeur d'un tribun ? Aussi, on s'aperçut que la politique de César représentait la tradition permanente île Renie toute en Gère, et celle de Cicéron, seulement l'intérêt variable d'une classe. L. Roscius Othon, qui avait fait accorder aux chevaliers quatorze rangs de bancs réservés fut sifflé, dans le théâtre même. Les chevaliers faillirent en venir aux mains avec les plébéiens, placés derrière eux, et il fallut la prodigieuse habileté oratoire de Cicéron, pour obtenir du peuple, qu'il fît réparation à Roscius par des applaudissements[315]. Pourtant la concorde du sénat et de l'ordre équestre, fondée plutôt sur des intérêts que sur des sympathies, cette concorde qui, depuis un siècle et demi arrêtait l'expansion de la cité romaine et la colonisation, elle était alors le dernier moyen par où l'on pût échapper à la royauté intelligente de César et à la dictature brutale de Catilina. Catilina a occupé les six derniers mois du consulat de Cicéron ; sa conjuration touche par plusieurs côtés à l'histoire des lois judiciaires. Il s'était présenté une quatrième fois aux comices consulaires. Cicéron était résolu à combattre énergiquement sa candidature. Sur la demande de Servius Sulpicius, et pour se conformer à un vu du Sénat, il avait fait passer une loi contre la brigue (de ambitu), plus sévère que les précédentes. Elle ne le fut pas tant que l'aurait voulu Sulpicius. Celui-ci avait proposé de confier, dans les procès de ce genre, le choix des juges à l'accusateur[316]. Le Sénat écarta du projet cette disposition qui eût opposé à une corruption générale une répression passionnée. Ces judices edititii furent établis plus tard par la loi Licinia contre les confréries politiques ; 55 av. J.-C.[317] Pendant les comices de l'an 63 av. J.-C., on songeait déjà à une accusation contre Catilina. Caton l'en menaçait en plein sénat. Le pouvoir n'était donc plus pour le chef de la conjuration qu'un refuge nécessaire. C'était pour échapper aux tribunaux politiques et civils, aux accusateurs et aux créanciers qu'il briguait la première magistrature de l'État[318]. Il voulait être le consul des misérables, le dictateur de la banqueroute[319]. Sa première promesse aux conjurés fut celle d'abolir les dettes[320], la seconde, celle de renouveler les proscriptions. Aussi tous les riches, nobles et chevaliers, soutinrent énergiquement Cicéron. Le consul se flatte en plusieurs endroits d'avoir été le sauveur du crédit, le protecteur du droit des créanciers et des caisses des banquiers et des publicains[321]. César ne professait pas le mépris ni la haine pour les
gens ruinés. Il l'était lui-même, seulement il avait bien choisi son banquier
et loin d'en vouloir faire sa victime, il en avait fait son ami politique.
Lorsqu'aux nones de décembre, on délibéra sur le sort des complices de
Catilina, il blâma froidement la conjuration, vota contre la peine de mort,
et refusa d'y laisser ajouter la confiscation des biens, qu'il avait d'abord
proposée pour épargner aux coupables le dernier supplice. Les passions
violentes ne pardonnent pas la tiédeur. Celle de César parut la preuve d'une
complicité secrète avec les conjurés. Les chevaliers romains qui s'étaient
rangés en armes sur la pente du Capitole, quoiqu'ils fussent sous la conduite
du sage Atticus[322], ne purent
dominer leur colère, et lorsqu'après la séance du Sénat, César sortit du
temple de Quant à César il résolut de briser cette coalition des sénateurs et des chevaliers, uvre si pénible, si chère et si fragile de la politique de Cicéron. Le procès de Clodius lui en fournit l'occasion et le moyen. P. Clodius Pulcher était un jeune patricien, ami du désordre et de l'indiscipline, et qui avait rapporté de l'Orient les murs efféminées et les parures de la Syrie[325]. Au mois de décembre de l'an 62 av. J.-C., il fut surpris dans la maison de César, où il avait pénétré sous le déguisement d'une danseuse, pendant que Pompeia, femme de César, célébrait avec les dames romaines les mystères de la Bonne Déesse[326]. Q. Cornificius dénonça au Sénat cette intrigue sacrilège, et bientôt Hortensius, pour satisfaire sa haine personnelle contre le coupable, Caton, par rigidité de principes, demandèrent que Clodius fut jugé[327]. Un des plus graves défauts de la loi judiciaire d'Aurelius, avait été de laisser au préteur urbain le soin de composer, selon sa conscience ou selon son gré, les listes annuelles du jury[328]. Les décuries des chevaliers et des tribuns de la solde pour l'année 61 av. J.-C., ne contenaient guère d'honnêtes gens. Le cens de 400.000 et de 300.000 sesterces, exigé des juges, n'était pas non plus une garantie absolue d'indépendance. Car on pouvait, clans l'intervalle d'un cens à l'autre, dissiper sa fortune, et tel propriétaire pouvait posséder de grands biens et n'être pas moins chargé de dettes et obéré par les emprunts. On s'aperçut que si on laissait tirer au sort sur les listes des décuries, les noms des juges de Clodius, et que l'accusé fût admis à 'faire les récusations légales, il y avait beaucoup de chances pour que le tribunal fût mal composé. Le Sénat chargea donc les deux consuls, Valerius et Pupius Pison, de rédiger un sénatus-consulte qui serait proposé à l'acceptation du Sénat, pour composer d'une façon spéciale le tribunal chargé de juger Clodius. D'après le sénatus-consulte, les juges, au lieu d'être tirés au sort, devaient être choisis par le préteur président du tribunal. Ni l'accusateur, ni l'accusé ne pourraient faire de récusations, et le nombre des juges serait réduit de 150 à 56. On supposait que sur les listes des décuries, contenant 420 sénateurs, 1.050 chevaliers et 1.050 tribuns de la solde, un préteur honnête pourrait découvrir 56 honnêtes gens. C'était l'arbitraire corrigeant l'insuffisance de la loi. Devant l'assemblée du peuple, Pison ne soutint pas le sénatus-consulte, dont il était chargé de demander l'approbation, et le tribun Fufius Calénus, le combattit comme une dérogation à la loi commune. Le Sénat maintenait sa proposition. Mais comme Calénus menaçait d'y opposer son veto, Hortensius fit accepter du Sénat un compromis proposé par le tribun. Le nombre des juges devait être réduit à 56, mais le tirage au sort et les récusations auraient lieu comme à l'ordinaire. Il eût bien mieux valu ne rien changer à la loi, que d'étendre ainsi la faculté de récuser. L'accusateur Lentulus récusait, il est vrai, les jurés les moins dignes de siéger. Mais Clodius faisait le contraire. Lorsque le tribunal fut formé, la majorité des juges se composait de sénateurs tarés, de chevaliers mendiants et de tribuns de la solde qui n'avaient pas un sou dans leur bourse[329]. Cicéron, blessé dans sa vanité par Clodius qui se moquait du fameux consulat[330], excité d'ailleurs par sa femme Térentia qui était jalouse d'une des surs de Clodius, fit contre l'accusé une déposition qui l'empêcha d'établir qu'il était à Interamne pendant la fête de la Bonne Déesse[331]. On croyait Clodius perdu. Mais César, interrogé par l'accusateur, déclara que pour lui rien n'était 'prouvé et qu'il avait répudié Pompeia, parce que la femme de César ne devait même pas être soupçonnée[332]. Les juges affectaient d'abord une grande rigidité et avaient demandé une garde pour se protéger contre les coups de mains de la populace, Mais Crassus intervint. Il était irrité contre Cicéron qui l'avait soupçonné de complicité avec Catilina. Il était las d'entendre le grand orateur recommencer sans cesse l'histoire de son consulat, comme un peintre qui abuse de sa riche palette pour recopier toujours le même tableau. Il acheta les voix des juges, et lorsque l'on compta les tablettes déposées dans l'urne, il y eu avait 25 pour la condamnation et 31 pour l'acquittement. C'était donc pour mieux protéger votre argent, disait Catulus aux juges, que vous aviez demandé des gardes[333] ? Le procès de Clodius ne fit pas seulement de ce personnage
dangereux un ennemi de Cicéron, et un obligé de César. Il amena la séparation
du Sénat et de l'ordre équestre. Caton, esprit ferme mais étroit, aussi
obstiné dans le bien que Catilina dans le mal, ne se prêtait à aucune des
concessions que les murs de son temps exigeaient de son stoïcisme. Les publicains font une demande. Prenez garde, disait Caton,
de laisser le moindre accès à la faveur[334]. Cette demande,
c'était celle de la compagnie Asiatique qui s'était laissé entraîner dans la
dernière adjudication des impôts de l'Asie à pousser trop loin les enchères.
Elle demandait une résiliation de bail, ou une remise sur ce qu'elle devait
au trésor. Sa cause, Cicéron l'avoue, était un peu honteuse, mais les
publicains étaient encouragés par Crassus qui espérait les détacher du Sénat.
Aussitôt, Cicéron plaida en faveur de la demande des publicains et de l'union
des deux ordres (1er déc. 61 av. J.-C.)[335]. Mais Caton fut
inflexible. Il désespéra les publicains par la rigueur[336] de ses refus,
et ce fut plus tard César qui, pendant son consulat, donna satisfaction à la
compagnie en lui faisant remettre le tiers du prix de ses fermages[337]. Le même parti
aristocratique dont Cicéron essayait en vain d'éclairer l'intelligence
politique et d'adoucir l'orgueil, vota un sénatus-consulte pour qu'on fît une
enquête contre les juges suspects de s'être laissé corrompre dans le jugement
de Clodius[338].
L'ordre équestre se crut attaqué, et se sépara entièrement du Sénat. Ainsi, s'écrie Cicéron avec douleur, cette année[339] a renversé les deux remparts que seul j'avais élevés pour
soutenir Ainsi les triumvirs César, Pompée, Crassus avaient maintenant le champ libre. Cicéron fit comme son parti. Il essaya de se rapprocher des triumvirs et surtout de Pompée. Mais César, devenu consul 59 av. J.-C., n'avait pas besoin de l'appui de Cicéron. En se conciliant l'ordre équestre dans l'affaire de la compagnie Asiatique, il avait retiré à l'avocat des publicains toute sa puissance, et il fit passer une loi agraire fort sage, la première qui n'ait pas provoqué une coalition du Sénat et des chevaliers. Le consulat de César fut aussi remarquable par des réformes judiciaires. Les juges de Clodius, abusant du secret des votes, avaient rejeté les uns sur les autres la honte de son acquittement, comme ils l'avaient déjà fait lors du premier procès de Catilina. Ce fut, comme nous l'avons vu, en 59 av. J.-C. que le préteur Fufius Calénus, pour imposer à chaque ordre de juges la responsabilité collective de son verdict, fit voter une loi pour que les sénateurs, les chevaliers, les tribuns de la solde déposassent leurs sentences dans trois urnes séparées[341]. Mais les sentences n'en étaient pas moins comptées toutes ensemble, et les accusés, condamnés ou absous à la simple majorité, comme on le voit par le cent-unième chapitre de la loi Julia de Repetundis[342]. Cette loi était un des monuments de la législation de Jules César, consul. Elle étendait aux juges la pénalité appliquée jusque là seulement aux exactions des magistrats[343]. Mais il n'est pas bien certain qu'elle s'appliquât comme loi pénale aux chevaliers romains ; car cinq ans après, Cicéron plaidait encore pour prouver que l'ordre équestre en était exempt[344]. Mais ce qui est sûr, c'est que cette loi Julia déterminait les règles d'après lesquelles le préteur devait tirer au sort les noms des juges, et Dion nous dit qu'en l'année 54 av. J.-C. Caton, devenu préteur, faisait encore ce tirage d'après la loi Julia, mais sans vouloir l'appeler par son nom à cause de sa haine pour César[345]. Enfin, c'est encore à l'influence de César qu'il faut attribuer la loi du tribun Vatinius qui permettait à l'accusateur et à l'accusé de récuser à tour de rôle tout le conseil de juges tiré au sort ou choisi par le préteur[346]. Cette loi, en étendant la faculté de récusation, semblait favorable à la défense. Cicéron l'approuve, quoique Vatinius, par un article spécial, eût privé C. Antonins, alors accusé d'exactions, du bénéfice de cette disposition nouvelle. Une des conséquences de la loi était de diminuer le nombre des juges de chaque jury, de rendre la corruption plus facile, et de multiplier les tirages au sort dont les préteurs faisaient tourner la chance à leur gré. Aussi on trouve depuis ce temps-là des procès où il n'y a que cinquante juges en tout[347]. César et les autres triumvirs qui voulaient corrompre le peuple avaient besoin de désarmer les tribunaux, surtout ceux qui auraient dû punir la brigue électorale. Aussi, depuis le consulat de César, les tribunaux furent d'une indulgence scandaleuse ou d'une honteuse faiblesse en face des émeutes populaires et des triumvirs. Le tribun Vatinius lui-même avant été, l'année suivante, 58 av. J. -C., cité devant le tribunal de P. Memmius, son ami politique, le tribun C. Clodius, à la tête d'une bande d'hommes armés, envahit le tribunal, renversa le préteur Memmius, brisa les urnes, dispersa les juges, et alla même dans les tribunaux voisins chasser plusieurs présidents d'enquêtes[348]. On sent depuis lors dans les affaires intérieures de Rome le poids de la puissance des triumvirs et de la populace mercenaire de la ville qui oppriment toutes les libertés, surtout celle des tribunaux. Clodius enrégimente les spadassins de Rome, ouvriers politiques payés pour insulter le Sénat, pour intimider les juges, pour figurer au' Forum la souveraineté populaire sous la forme d'une bande de brigands. Clodius les répartit dans ces collèges déjà une fois dissous en 68 av. J.-C.[349], et qui se multiplièrent dix ans plus tard comme autant de sociétés parasites[350] sur le tronc décomposé de la société romaine. C'est au moyen de cette populace urbaine, organisée par décuries, que Clodius parvint à faire exiler Cicéron, 58 av. J.-C. Lorsque les vux de l'Italie entière eurent fait rappeler à Rome le chevalier d'Arpinum, chef de l'aristocratie municipale, et de l'ordre équestre[351], le démagogue patricien essaya de s'en venger sur Pompée. L'instrument du désordre blessait la main qui l'avait employé. Le tribun Racilius proposait-il au sénat de faire tirer au sort par le préteur urbain les noms des juges devant qui Clodius aurait à répondre de ses violences ? La bande du démagogue venait vociférer jusque sur l'escalier de la curie. Les sénateurs effrayés se séparaient sans rien décider. Clodius échappait à la justice, en se faisant nommer édile[352]. Le condottiérisme politique se propageait comme une lèpre de la ville à la campagne. A l'imitation des associations ouvrières de Rome, les confréries religieuses qui, comme les anciennes Ghildes germaniques, fêtaient leurs réunions par des banquets (sodalitates)[353], se transformèrent en sociétés d'émeutiers, et en agences électorales. Milon devint le digne rival de Clodius qui l'accusa de violences. Pompée voulut défendre l'accusé. Les clameurs de la bande de Clodius couvrirent sa voix. La bande de Milon répondit par une chanson obscène contre Clodius et sa sur. Tout finit par une bagarre, où Clodius fut jeté par terre, et d'où Cicéron se sauva comme il put. Milon ne fut pas plus jugé que ne l'avait été Clodius, et les sénateurs firent un sénatus-consulte inutile, ordonnant la dissolution des confréries et autres sociétés politiques[354]. Au fond, les sénateurs qui détestaient Clodius, n'étaient pas fâchés de ce qui arrivait à Pompée, son ancien patron. En même temps la basse et ignoble populace de la ville lui gardait rancune d'avoir défendu Milon. Dans le procès de Sextus Clodius on soupçonna Pompée d'avoir inspiré l'accusation. C'en fut assez pour que l'accusé frit absous. Dans l'urne des sénateurs, on trouva une grande majorité pour l'acquittement, dans celle des chevaliers, un nombre égal de sentences favorables et défavorables, Les tribuns de la solde l'avaient condamné[355]. Cette justice qui n'obéissait plus qu'à la crainte et aux passions personnelles, demandait une réforme. Ce furent Pompée et Licinius Crassus, consuls en 55 av. J.-C., qui l'entreprirent. Cette tentative était-elle bien sérieuse ? C'est ce qu'on est forcé de se demander, quand on voit que les réformateurs sont deux de ces triumvirs qui, depuis quatre ans, achetaient pour eux ou pour leurs partisans toutes les magistratures. Le trafic des votes électoraux avait fini par s'organiser publiquement. Il avait dans chaque tribu ses courtiers, ses consignataires, ses distributeurs d'argent. Les corporations ouvrières de Rome, les confréries soi-disant religieuses (collegia et sodalitates) fournissaient à ces entreprises les cadres de leurs décuries, leurs agents et leurs bureaux. Pour arrêter ce mal devenu chronique, Crassus imagina de faire choisir les juges par l'accusateur dans les procès contre la brigue électorale, où il était question de confréries[356]. L'accusateur devait désigner quatre tribus, dont les juges siégeraient au tribunal et l'accusé ne pouvait en récuser qu'une seule[357]. Si l'accusation était sérieuse, les juges étaient des ennemis de l'accusé[358]. Aussi le tribunal, corrigeant la rigueur de la loi, permit dans une affaire de ce genre, à Cicéron, qui était défenseur, de récuser encore cinq juges dans chacune des trois tribus, qui étaient entièrement au choix de l'accusateur[359]. Si l'accusation n'était qu'un moyen de prévariquer, l'accusateur désignait les tribus qui s'étaient laissé corrompre par son adversaire, c'est-à-dire qu'il faisait juger le coupable par ses complices. La loi de Pompée sur les tribunaux semblait plus sérieuse,
mieux calculée pour assurer l'indépendance et l'impartialité des juges.
Pourtant elle est liée, comme toutes les lois judiciaires de Rome, à une
réaction politique. Cicéron, rappelé de l'exil, en 57 av. J.-C., s'était
rapproché de Pompée, contre lequel Clodius s'était retourné. Les consuls de
l'an 58 av. J.-C., qui avaient secondé Clodius contre Cicéron, Pison et
Gabinius, s'étaient fait donner, le premier le gouvernement de Ne vois-tu pas, ne sens-tu pas, disait-il à Pison dans sa célèbre invective[361], quels juges nous donnera désormais la loi judiciaire qui est proposée ? On ne mettra plus indifféremment sur le tableau des juges quiconque voudrait y être inscrit ; on ne dispensera plus des devoirs de juré quiconque désirera cette dispense. Il n'y aura plus ni intrus envahissant l'ordre judiciaire[362], ni jurés rayés du tableau. On ne groupera plus dans un tribunal les amis de l'accusé pour lui faire grâce, ni ses ennemis pour le perdre par un semblant de justice. Les juges qui siégeront seront ceux que la loi, et non le caprice des individus, aura désignés. Asconius a donné sur ce passage un commentaire, qui n'a pas encore été suffisamment expliqué[363]. Le préteur Aurelius Cotta fit voter une loi judiciaire au temps où Verrès fut accusé par Cicéron. Par cette loi, les places de juges furent partagées entre les sénateurs, les chevaliers romains et les tribuns de la solde. Puis Pompée, dans son second consulat, pendant lequel fut prononcé le discours contre Pison, promulgua une loi pour que les juges fussent pris parmi les citoyens ayant le cens le plus élevé en suivant la division des centuries, et choisis par un procédé différent de celui qu'on employait auparavant, mais pourtant toujours parmi les trois ordres que nous avons nommés. Le passage de Cicéron signale les principaux abus qui s'étaient introduits dans l'application de la loi d'Aurelius Cotta. En quoi consistait le remède qu'y apportait Pompée ? Les juges, selon Asconius, devaient désormais être tirés des centuries ou choisis d'après la division des centuries. Le même commentateur nous dit autre part, en parlant des décuries judiciaires du Sénat, que le mot de décurie s'appliquait aux juges les plus distingués, et celui de centuries, à ceux d'un ordre inférieur[364]. Les centuries, dont il était question dans la loi de Pompée, étaient donc celles où l'on prenait, non les juges sénateurs, mais les juges chevaliers ou tribuns de la solde. Les chevaliers formaient la première classe, les tribuns de la solde, la seconde classe du cens. Chacune des trente-cinq tribus était divisée en cinq classes, et chaque classe d'une tribu, subdivisée en deux centuries, une de seniores, une de juniores[365]. Choisir les juges chevaliers et tribuns de la solde d'après la division des centuries, c'était, comme nous l'allons voir, les prendre parmi les centuries des seniores de la première et de la seconde classe du cens. Etablissons d'abord quel était l'âge où l'on passait des centuries des juniores dans celles des seniores. Si l'on s'en tient à la tradition conservée par Denys[366] Aulu-Gelle[367] et Varron[368] on admettra que l'âge des seniores, au temps du roi Servius, était celui de 45 ans. Mais cette tradition ne peut être considérée comme indiscutable. Dans chaque classe, les centuries de juniores étaient aussi nombreuses que celles des seniores et rien n'autorise à croire qu'il y eût des nombres inégaux de citoyens dans les centuries des fantassins de la même classe. Les Romains de 17 à 60 ans étaient portés sur les listes du cens et du service militaire. Or, d'après les lois constantes de la population, l'âge qui partage en deux parties égales les hommes de 17 à 60 ans, est celui de 35 ans et non celui de 45 ans. Dans le recensement de la population française de 1851, les hommes de 17 à 35 ans révolus étaient au nombre de 5.178.174 et ceux de 35 à 60 ans au nombre de 5.185.347[369]. Comment donc a pu s'établir l'usage de reculer jusqu'à 45
ans révolus l'âge des seniores ? Au
temps d'Annibal et des Scipions, les guerres devenant plus grandes et plus
lointaines, on dut augmenter le nombre des combattants et répartir le plus
également possible le fardeau du service. On employa un procédé semblable à celui
par lequel Un Romain pouvait faire ses premières armes à 17 ans. Mais ordinairement il commençait, comme chez nous, le service militaire à 20 ans[371] Au bout de six ans de service les soldats étaient remplacés à l'armée par les jeunes gens de la levée nouvelle, et passaient en quelque sorte dans la première réserve[372]. C'est pour cela que les censeurs de l'an 209 av. J.-C. punirent les jeunes gens qui avaient atteint l'âge de 26 ans sans avoir encore servi[373], et que la loi municipale de Jules César exigeait six ans de service dans l'infanterie ou trois dans la cavalerie, de tout candidat aux charges municipales ayant moins de trente ans[374]. La première réserve se composait des hommes de 26 à 35 ans ; la seconde, des hommes de 35 à 45 ans ; les deux dernières limites sont clairement indiquées par les lois annales. Nous avons montré[375] que l'âge de la questure[376], qui était le premier degré des honneurs[377], était celui de trente ans[378]. On briguait chaque magistrature un an avant de l'exercer. On exerçait la questure à 31 ans, comme le fit Cicéron qui, lié en l'an 106 av. J.-C., fut questeur à Lilybée en l'an 75. Il fallait un an d'intervalle entre la fin de la questure et la candidature à l'édilité curule[379]. On pouvait donc briguer cette édilité à l'âge de 33 à 34 ans, et l'exercer à l'âge de 34 à 35 ans, comme fit César qui, né en l'an 100 av. J.-C., fut édile en 65 av. J.-C. Or, l'édilité, qui était la première des charges curules, donnait à celui qui l'avait exercée un siége au Sénat[380]. Trente-cinq ans était donc l'âge des sénateurs et par conséquent, celui où l'on passait parmi les seniores. Nous en verrons tout à l'heure d'autres preuves. Entre la fin de l'édilité et la candidature à la préture, il fallait un intervalle de deux ans[381]. On pouvait donc exercer la préture à 39 ans. Entre la fin de la préture et la candidature au consulat, il fallait encore deux ans d'intervalle, aussi l'on ne pouvait être consul qu'à 43 ans[382]. Après le consulat et le proconsulat, c'est-à-dire à 45 ans, un homme entrait dans cette catégorie de citoyens, de qui l'on lie pouvait plus exiger le service militaire et que Varron ; Aulu-Gelle et Denys appellent pour cela seniores. Mais l'âge de 35 ans est nettement marqué dans toutes les institutions d'Auguste, comme une limite entre les citoyens de la première et de la seconde réserve. Lorsqu'Auguste voulut venger la défaite de Varus et que les Romains refusèrent de s'engager dans les légions, Auguste, pour punir leur lâcheté, fit tirer au sort les noms de la cinquième partie des citoyens au-dessous de 35 ans, et seulement de la dixième partie de ceux qui avaient dépassé cet âge, pour frapper d'infamie et de confiscation les personnes et les biens de ceux que le sort désignait[383]. Pourquoi décimait-il plus sévèrement les hommes au-dessous de 35 ans C'est qu'ils appartenaient aux centuries des juniores et qu'ils formaient deux réquisitions, celle de 17 à 26 ans et celle de 26 à 35, tandis que les hommes de plus de 35 ans, c'est-à-dire les seniores, ne comprenaient qu'une seule réquisition, celle de 35 à 45 ans, les seniores de 45 à 60 ans étant exempts du service militaire. Pour la même raison, Auguste permit aux chevaliers equo publico, qui avaient plus de 35 ans, de rendre, s'ils le voulaient, le cheval donné par l'Etat[384], et même, aux sénateurs qui avaient plus de 35 ans, de ne pas assister régulièrement aux séances du Sénat[385]. Car l'indifférence politique égalant alors la lâcheté militaire, on n'était plus ni soldat, ni chevalier equo publico, ni même sénateur, que par vanité ou par contrainte. Comme il fallait aussi employer une sorte de réquisition pour forcer les juges à siéger, Auguste abaissa à trente ans l'âge de la judicature, et choisit ainsi des juges de cinq ans plus jeunes que ceux qui étaient choisis habituellement[386]. Avant son règne, quelle loi judiciaire avait fixé à 35 ans l'âge de la judicature ? Ce ne pouvait être que celle de Pompée de l'an 55 av. J.-C., puisque ce fut cette loi qui ordonna de choisir les juges d'après la division des centuries et autrement qu'on ne le faisait auparavant. Or, les centuries de seniores contenaient tous les citoyens de plus de 35 ans, et, avant la loi de Pompée, l'âge de trente ans était celui de la judicature, comme on le voit par la loi Servilia de Glaucia[387]. Choisir les juges chevaliers et tribuns de la solde d'après la division des centuries, c'est-à-dire parmi les hommes de plus de 35 ans, c'était donc les choisir parmi les centuries des seniores de la première et de la seconde classe du cens. Or, il n'y avait dans chaque tribu qu'une centurie de seniores de chaque classe. Chaque centurie de la seconde classe, c'est-à-dire de la classe des tribuns de la solde était subdivisée en dix sous-classes, représentant des degrés de fortune séparés par une différence de 10.000 sesterces[388]. Or, la loi de Pompée, d'après Asconius, ordonnait de choisir les juges dans chaque classe parmi ceux qui avaient le cens le plus élevé. Un tribun de la solde de la première ou de la seconde subdivision de la seconde classe, dont la fortune était de 380.000 ou de 390.000 sesterces, différait si peu d'un chevalier qui en avait 400.000, que la loi de Pompée peut être considérée comme un acheminement vers la loi judiciaire de César[389], qui enleva la judicature aux tribuns de la solde pour la réserver aux chevaliers et aux sénateurs. De plus, comme il fallait choisir aussi les juges chevaliers parmi les centuries de seniores de la première classe dans les 35 tribus, et parmi les chevaliers les plus riches de ces centuries, on peut dire[390] que la formation du tableau annuel du jury était si bien déterminée par loi de Pompée qu'elle ne laissait plus de place à l'arbitraire. La loi contenait sans doute des règles précises sur le tirage au sort des juges de chaque tribunal et sur les droits de récusation. Tout ce qu'on sait, c'est que le nombre des juges de chaque jury fut augmenté et porté à soixante-quinze[391]. Il y en avait sans doute 25 de chaque ordre. Mais dans deux procès politiques de l'an 54 av. J.-C., on trouve seulement 70 juges[392] peut-être parce que cinq juges s'étaient abstenus ou de juger ou d'assister au jugement. Les illusions que Cicéron s'était faites sur les heureux effets que devait produire la loi judiciaire de Pompée ne durèrent pas longtemps. Jamais de plus tristes scandales n'annoncèrent l'inutilité des lois, et la fin de la liberté, que ceux de l'an 55 av. J.-C. Æmilius Scaurus, fils du prince du Sénat, avait dépensé sa fortune à donner des jeux au peuple pendant son édilité[393]. Il la refit aux dépens des Sardes qu'il pilla pendant sa propréture. Accusé par Triarius devant le tribunal de repetundis, il brigua le consulat pour l'année 53 av. J.-C., et, avec l'argent volé aux Sardes, se mit à acheter les suffrages des tribus[394]. Son palais devint un marché où les électeurs venaient se vendre[395]. La brigue faisait doubler le taux de l'intérêt[396]. La cause de Scaurus semblait tellement perdue[397], que Cicéron, son défenseur, avouait qu'elle ne lui inspirait aucune confiance, à moins que l'accusé ne fût élu consul. Mais la noblesse s'intéressait au sort du fils d'un prince du Sénat. Clodius, Marcellus, Calidius, Messala, Hortensius se joignirent à Cicéron pour le défendre. Neuf consulaires firent son éloge. Le plèbe, qui se souvenait des jeux donnés par Scaurus, et surtout des libéralités récentes de ce candidat, montrait le poing aux accusateurs[398]. Sur soixante-quinze juges, soixante-dix donnèrent leur sentence, vingt-deux sénateurs, vingt-trois chevaliers et vingt-cinq tribuns de fa solde. Il n'y eut que quatre sénateurs, deux chevaliers et deux tribuns de la solde qui osèrent juger selon leur conscience. Les autres juges cédèrent à l'influence des grands ou aux menaces du peuple. Æmilius Scaurus fut absous. La même année, tous les candidats au consulat furent accusés d'avoir corrompu les électeurs. L'accusation atteignait le corps électoral tout entier, c'est-à-dire le peuple. Aussi, quand on eut tiré au sort les noms des juges, quelques-uns refusèrent de siéger, à moins d'un vote de l'assemblée des centuries, et pour couvrir leur lâcheté ils firent appel aux tribuns de la plèbe[399]. Cicéron, qui s'était chargé de la cause des coupables, écrivait à Atticus : Que je meure si je sais comment les défendre ! Ils seront tous absous. Mais désormais on ne condamnera que les assassins. Gabinius, accusé de lèse-majesté, ne fut pas traité plus sévèrement. Cicéron avoue qu'il- n'a pas osé se porter accusateur, de peur de se brouiller avec Pompée[400]. Il n'en accuse pas moins de timidité les juges qui, sous l'influence de Pompée, ont prononcé l'acquittement de Gabinius par 38 voix contre 32[401]. Le sénateur Domitius s'en prenait aux publicains qui, en Syrie, avaient comblé d'honneurs Gabinius, et aussi aux juges de l'ordre équestre. C'est votre faute, disait-il aux chevaliers romains ; vous êtes des juges trop lâches. A quoi le chevalier Lamia fit cette virulente réplique : Nous jugeons comme vous plaidez[402]. C'est un bien misérable état que celui d'un pays où chaque parti peut confondre ses adversaires. A Rome tout le monde était coupable, les juges, qui se laissaient corrompre ou intimider, les accusés, qui avaient pillé les provinces et acheté les suffrages, les avocats indifférents à la vérité et la justice, le Sénat patronnant les criminels par esprit de corps, le peuple, soutenant contre les tribunaux ceux qui le payaient. Pompée, qui n'était pas innocent de ce désordre, espérait
la dictature, sans oser la prendre. La brigue électorale arrêtait l'action
des tribunaux ; la mise en accusation des candidats arrêtait les élections.
Tout devenait impossible. Au mois de novembre 54, les consuls de l'année 53
n'étaient pas encore élus. En 53 le désordre devint effrayant. Il y eut six
mois d'interrègne. Milon et Clodius, à la tête de leurs bandes mercenaires,
ensanglantaient Rome. Clodius fut assassiné. On sentait que l'homme puissant,
qui du fond de Maintenant que Pompée était le gouvernement, il fallait bien qu'il réprimât le désordre. Hautain, froid, impopulaire, il dut se mettre sérieusement à la tête du parti de l'oligarchie. Sur l'avis du Sénat, il proposa, au commencement de l'année 52, deus. lois judiciaires, une pour établir une enquête extraordinaire contre ceux qui avaient assassiné Clodius, incendié la curie ou attaqué la maison de l'interroi M. Lepidus, une autre, pour rendre plus sévère la pénalité contre la brigue (de ambitu). Les deux tribunaux devaient suivre une procédure nouvelle et plus expéditive, et se composer de juges tirés au sort sur une liste que Pompée lui-même formerait[403]. Le tableau du jury qu'il fit afficher contenait les noms les plus illustres ou les plus respectables[404]. Cicéron, dans une lettre de l'an 49 av. J.-C.[405], dit que les 850 juges qui semblaient n'aimer que Pompée, se tournent du côté de César. On a cru que c'était là le nombre total des juges de l'album de Pompée. Mais il ne comprend que les chevaliers et les tribuns de la solde. Toute la lettre de Cicéron explique en effet la défection du parti municipal qui abandonne Pompée pour son rival. Cælius, dans une lettre écrite quelques mois auparavant, avait exprimé l'espoir que ces mêmes juges resteraient fidèles à Pompée pendant la guerre civile, et il les distingue nettement des sénateurs, qui pourtant siégeaient aussi dans les tribunaux[406]. Sur ces 850 juges, chevaliers et tribuns de la solde, il y avait, comme on sait, 360 chevaliers, que l'on désignait. alors comme les juges par excellence, judices, parce qu'ils exerçaient dans les tribunaux la principale influence[407]. L'aïeul de l'historien Velleius, chef d'une grande famille équestre du pays des Hirpins, figurait à un rang honorable parmi ces trois cent soixante juges-chevaliers[408]. Sur les 850 juges mentionnés par Cicéron, il y avait donc 490 tribuns de la solde, c'est à dire que chacune des 35 tribus[409] avait fourni à l'album de Pompée, 14 juges choisis parmi les premières subdivisions de la seconde classe du cens. Maintenant, si l'on calcule qu'il y avait, au plus, de 400 à 420 sénateurs présents à Rome, qu'il en fallait 200 dans certaines questions pour délibérer, et que le plus souvent l'Assemblée était moins nombreuse[410], on peut supposer que Pompée n'avait inscrit que 200 sénateurs sur le tableau de la première décurie. L'album judicum de l'an 52 av. J.-C., dressé par Pompée, seul consul, devait donc contenir les noms de 200 sénateurs, de 360 chevaliers, de 490 tribuns de la solde, ou en tout de 1,050 juges comme l'album de chaque décurie de l'an 70 av. J.-C., c'est à dire de l'année du premier consulat de Pompée. Voici quelle était la nouvelle procédure ordonnée par la loi Pompeia. Dans chaque procès cent juges de chacun des trois ordres étaient tirés au sort. C'était devant 300 juges[411] que le procès s'ouvrait par l'audition et l'interrogatoire des témoins. Cette disposition semble encore une réminiscence du premier consulat de Pompée ; car elle rappelle le moyen employé par Cicéron, dans la première action contre Verrès, pour abréger la procédure. Cet interrogatoire des témoins devait durer seulement trois jours. Le quatrième jour, en présence de l'accusateur et des 300 juges, on écrivait sur autant de boules les 300 noms. On les répartissait également dans trois urnes, en séparant les noms des juges des trois ordres (quabantur sortes). Ces urnes étaient sans doute laissées sous la garde de quelques-uns de ceux qu'on appelait les nongenti[412]. Le lendemain, on tirait au sort les noms de 81 juges, dont 28 sénateurs, 27 chevaliers, 26 tribuns de la solde. Ils entraient immédiatement en séance. Alors, la parole était donnée à l'accusateur qui avait deux heures pour parler, puis, à l'accusé ou à son avocat, qui en avaient trois pour repousser l'accusation. Les éloges de l'accusé faits de vive voix ou par écrit (laudationes) qui n'étaient qu'un moyen de faire agir sur le tribunal les influences extra-judiciaires et de prolonger les débats, étaient interdits par la loi. Après leurs discours, l'accusateur et le défenseur pouvaient récuser chacun cinq juges de chaque ordre, il en restait donc cinquante et un, 18 sénateurs, 17 chevaliers et 16 tribuns de la solde, pour prononcer le verdict. Les trois ordres votaient dans trois urnes séparées, comme l'avait voulu la loi Fufia. Telle fut la procédure suivie dans le fameux procès de Milon et dans celui de Sanfeius, complice de Milon, que Cicéron fit acquitter[413]. Cette loi était en somme fort sage et bien calculée pour empêcher la corruption des juges. Comme on ignorait, jusqu'à la fin du procès, quels seraient les juges appelés à porter la sentence, les corrupteurs pouvaient craindre d'acheter des voix inutiles. Pompée se conduisit dans le procès de Milon avec la fermeté impartiale d'un podestat Italien appelé à donner des lois à une ville étrangère. Milon, auquel Cicéron essaya d'intéresser son propre parti, les chevaliers, les municipes, l'Italie[414], n'était plus qu'un condottiere au service de l'oligarchie, et dont le grand avocat soutenait l'innocence sans y croire[415]. Milon fut justement condamné. Les soldats de Pompée dont l'aspect troubla Cicéron, avaient été envoyés à la demande de l'accusé lui-même[416]. Mais l'impartialité de Pompée venait de l'indifférence. Il établissait la justice entre les partis parce qu'il ne partageait pas leurs passions. Pour les autres, il voulait bien faire et appliquer de bonnes lois, mais à la condition de ne pas s'y soumettre lui-même, ou avec l'arrière-pensée de s'en servir pour fortifier sa domination. Q. Metellus Scipion, son beau-père, ayant été accusé d'avoir acheté les suffrages dans sa candidature au consulat pour l'an 52 av. J.-C., Pompée fit venir chez lui les 360 juges-chevaliers et leur demanda, comme une faveur personnelle, l'acquittement de Scipion[417]. Les juges cédant à cette influence, lorsqu'ils descendaient de leurs siéges, reconduisaient l'accusé à sa maison. L'accusateur Memmius renonça à l'accusation, et Pompée, pour en prévenir le renouvellement, fit de son beau-père son collègue dans le consulat pour les cinq derniers mois de l'an 52 av. J.-C. Dans le procès de Munatius Plancus Bursa, son intervention ne fut pas moins illégale et Tacite l'appelle à ce propos le destructeur des lois qu'il avait faites lui-même[418]. Plancus, ancien chef du parti de Clodius, sortit du tribunat le 10 déc. 52 av. J.-C., et il fut accusé d'avoir incendié le palais du Sénat ; mais Pompée s'intéressa à lui et en dépit de sa loi contre les éloges prononcés devant les tribunaux, il vint devant les juges faire celui de Plancus[419]. Caton qui avait protesté contre cette illégalité fut récusé ; mais les autres juges ne voulurent pas s'incliner devant la grandeur de Pompée. Plancus fut condamné[420]. Pompée voulut au moins profiter de la sévérité des honnêtes gens, qu'il avait appelés à la judicature, pour fonder sa puissance et atteindre César, son rival. Il avait introduit, dans sa loi contre la brigue, une disposition dangereuse, qui donnait à cette loi un effet rétroactif, s'étendant jusqu'à l'année de son premier consulat (70 av. J.-C.). En vain Caton, toujours franc et vrai avec ses amis comme avec ses ennemis, et plus habile ici par honnêteté que les fins politiques, s'opposa à cette extension injuste du droit de punir[421]. En vain les amis de César firent observer que le consulat de César était compris dans cette période, à laquelle allaient s'étendre les recherches des accusateurs. Pompée, avec une indignation hypocrite, protesta contre tout dessein de mettre César en cause, et le déclara au-dessus de tout soupçon[422]. La loi votée, le conquérant des Gaules se crut ou feignit de se croire menacé. Peut-être n'avait-il pas tort de supposer chez son rival une arrière-pensée. De ce jour, il n'eut plus qu'un but : n'abandonner son armée et son proconsulat que pour devenir consul et échapper ainsi à l'action des tribunaux. Sur le champ de Pharsale, il s'écria, si l'on en croit Asinius Pollion : Ils l'ont voulu : après tant d'exploits, moi, C. César, j'aurais été condamné, si je n'avais eu recours à mon armée[423]. Ce fut une loi judiciaire mal faite qui fut, sinon la cause, du moins l'occasion de la guerre civile. C'était une grande imprudence à Pompée et au Sénat de la provoquer, et de mettre un homme aussi puissant et aussi ambitieux que César, en demeure de choisir entre l'exil et la tyrannie. Mais avant de s'attaquer à lui, l'aristocratie, conduite par quelques hommes plus honnêtes qu'intelligents, fit comparaître devant les tribunaux tous ceux que la violence populaire, ou la timidité des juges, avaient soustraits, en 54 av. J.-C., à la punition de leurs fautes. Gabinius fut exilé, pour avoir conduit en Egypte une armée romaine, malgré les livres Sibyllins. Sextus Clodius, pour avoir incendié la maison de l'interroi, Hypsus et Memmius pour avoir acheté, en l'an 54 av. J.-C., les suffrages du peuple. Scaurus, coupable du même crime, fut défendu par une manifestation populaire en sa faveur. Pompée, pour délivrer le tribunal, lança ses soldats sur les émeutiers ; Scaurus fut condamné[424]. Bientôt, tous ceux qui avaient éprouvé, tous ceux qui craignaient la sévérité des tribunaux, se réfugièrent au camp de César[425], à l'exemple de Munatius Plancus[426]. Antoine, agent de César, osa se plaindre devant le Sénat du sort des condamnés[427]. Leur réhabilitation devint un des prétextes dont le nouveau maître essaya de couvrir son ambition[428]. La fin prévue, inévitable de tant de désordres, était donc arrivée. Au mois de janvier 49, César passa le Rubicon. Il n'y a pas de déclamations plus vaines et plus fausses que celles qu'on fait souvent contre la tyrannie. Elles ne corrigent pas les tyrans, et elles trompent les peuples. Elles supposent qu'un droit abstrait, imprescriptible, peut sauver la liberté des conséquences naturelles des excès populaires. César était coupable, en marchant contre les lois de son pays. Mais, était-il innocent, ce peuple qui, depuis plus d'un demi-siècle, assiégeait les tribunaux, lançait des pierres aux juges, renversait les urnes des suffrages et enseignait à ses chefs ou apprenait d'eux le mépris des lois ? César ramenait au milieu de ses légions des condamnés, qui avaient, dans une brigue électorale, payé des suffrages. Mais de quoi pouvaient se plaindre ceux qui tant de fois s'étaient vendus ? Ceux qui avaient encouragé, soudoyé, ou soutenu la vénalité ? Corrupteurs et corrompus avaient trouvé leur maître, aussi vicieux que chacun d'eux, et plus intelligent qu'eux tous. De tant d'émeutes était sorti, comme toujours, le tyran, c'est-à-dire le grand révolté, plus fort que le gouvernement de son pays. Les fautes de Pompée, en amenant la défection du parti municipal des chevaliers romains, aplanirent la route de l'usurpateur. Cicéron, qui était un homme intelligent, avait prévu le succès de César[429] avant le passage du Rubicon. Pompée n'avait rien prévu, rien préparé. Il se croyait toujours au temps où, jeune encore, il avait, en frappant du pied le sol de l'Italie, fait lever des légions. Mais alors il avait combattu contre des soldats nouveaux et des généraux inhabiles, à côté de Sylla et des vétérans de Chéronée et d'Orchomène. Maintenant il avait contre lui les vétérans, conduits par un grand général. Il dut abandonner Rome, puis l'Italie, entraînant avec lui les sénateurs vers cet Orient, où son nom avait remplacé celui de Rome. Son égoïsme le perdit et le poussa du côté de Pharsale, quand il aurait dit ou demeurer en Italie ou y revenir. Les Italiens, qui ne se sentaient ni conduits ni aimés par ce grand aventurier sans patrie, se donnèrent à César. Déjà avant la guerre civile, César avait pour lui les Transpadans, nombre de municipes de l'Italie centrale, et les publicains[430]. Les intérêts matériels se mirent sous la protection du plus fort, dés qu'on vit Pompée fuir sans combat. Les banquiers, les riches qui craignaient la confiscation, les bourgeois des municipes de la campagne, qui ne songeaient qu'à leurs petits écus[431], furent bien vite du parti de César. Il y avait d'honnêtes gens qui, restant prudemment en Italie, mettaient leur héroïsme à s'indigner que Cicéron n'en fût pas encore parti[432]. Mais ces faiblesses, communes à toutes les bourgeoisies dans les temps de crise, où elles ne sont pas guidées par un chef énergique, ne suffisent pas à expliquer le succès de César auprès du grand parti municipal, dont les chevaliers étaient les chefs. Il valait mieux que son rival par le cur comme par l'esprit. Lui, da moins, il confondait sa gloire avec celle de Rome, sa tradition domestique, avec celle du patriciat, sa tradition politique, avec celle des tribuns de la plèbe. Vainqueur, il né parlait que de clémence, tandis que Pompée fugitif et ses compagnons n'avaient à la bouche que les mots de proscription et de dictature[433]. Le nom seul de Sylla, évoqué comme une menace, par une aristocratie imprudente, et par les affranchis grecs de Pompée, suffisait pour assurer à César, au neveu de Marius, les sympathies des municipes italiens et celles de l'ordre équestre. Bientôt les 850 juges eux-mêmes, ces chevaliers, ces tribuns de la solde, qui dans les 35 tribus formaient l'élite de la première et de la seconde classe, passèrent un à un du côté de César, et oublièrent l'honneur que leur avait fait Pompée[434]. Enfin, Cicéron voyait trop bien que la liberté était perdue, quel que fût le vainqueur, pour prendre facilement son parti[435]. Entre deux rois, il eût voulu ne pas choisir. Il n'eût pas hésité, s'il avait eu le cur bas ou l'esprit étroit. Il inclinait aussi vers César. Le vainqueur de Pharsale, devenu le seul maître du monde, n'avait donc aucun sujet de haine contre les chevaliers, qui depuis C. Gracchus dominaient dans les tribunaux. Les jugements, lui écrivait Salluste, sont, comme auparavant, livrés aux trois ordres. Mais c'est une coterie, celle de Pompée qui les dirige[436]. Ôte d'abord à l'argent son privilège ; que le droit de décider de l'exil ou du droit d'un citoyen à exercer une magistrature ne se mesure pas sur la fortune... Faire choisir les juges par un petit nombre d'hommes, est une tyrannie. Les choisir, en ne tenant compte que de l'argent, c'est une indignité. C'est pourquoi je ne trouve pas mauvais que tous les citoyens de la première classe soient aptes à la judicature, mais je voudrais que ceux qui sont appelés à l'exercer, fussent en plus grand nombre[437]. C'est là une critique fort intelligente des lois judiciaires de Pompée[438], et il semble que César ait suivi le conseil de Salluste. Nous avons déjà remarqué flue, d'après la loi de 55 av. J.-C., les juges tribuns de la solde, étant choisis parmi les plus riches centuries de seniores de la seconde classe, avaient une fortune très-peu différente de celle des plus pauvres chevaliers romains. César ne réserva pas, comme Pompée, les droits judiciaires de l'ordre équestre aux 360 citoyens les plus riches de la première classe. Il fit participer à l'exercice de ces droits un plus grand nombre de chevaliers pris dans la première classe toute entière. En même temps, comme il suffisait de 400.000 sesterces de fortune pour être appelé à siéger dans les tribunaux politiques, il priva de ce droit les tribuns de la solde[439]. Or, depuis le second consulat de Pompée, les seuls tribuns de la solde choisis pour juger étaient ceux qui avaient 380.000 ou 390.000 sesterces de fortune. Il suffisait donc à ceux-ci d'un faible accroissement de fortune de 10.000 ou de 20.000 sesterces pour rentrer dans leur droit. Il n'y avait rien d'aristocratique dans la lui judiciaire de Jules César. Toute la première classe, comme le voulait Salluste, et non plus l'élite seule de la première classe, était destinée à prendre part la judicature politique. Nous avons déjà remarqué[440] que les tribuns de la solde, les hommes de la seconde classe, exclus désormais des huit tribunaux des enquêtes perpétuelles, où étaient portées les causes publiques, n'en restèrent pas moins aptes à être choisis comme juges des causes privées, et continuèrent à former, à ce titre, une classe de l'ordre judiciaire, 46 av. J.-C.[441] Le plus grand changement que subit l'ordre judiciaire, sous la dictature de César, n'était pas de ceux qui s'inscrivent dans une loi. La judicature politique fut amoindrie, comme tous les pouvoirs publics, par la perte de la liberté. Elle se renferma peu à peu, à mesure que la monarchie se constitua, dans le rôle modeste d'une administration réglée par le maître de l'Etat. Les procès ne furent plus des duels judiciaires où les chefs politiques achevaient, comme en champ clos, les batailles de la guerre civile. Les discours des avocats, qui avaient été l'écho des discussions du Sénat et du peuple, perdirent leur retentissement, quand ces grandes discussions cessèrent. L'histoire des chevaliers romains depuis la dictature de César est encore celle de la première classe des citoyens romains. Mais il n'y faut plus chercher le secret de la vie politique du peuple tout entier. Ce secret est désormais enfermé dans lé palais des Jules. La liberté avant de s'éteindre jeta sa dernière flamme. César ayant été assassiné (15 mars 44), Antoine, consul, affecta d'abord quelque déférence pour le Sénat ; mais, à partir du premier juin, il s'entoura de soldats. Maître des papiers de César, dont il avait fait confirmer les actes, il voulut publier comme des lois les projets qu'il lui plaisait d'y trouver. Cette tyrannie posthume du dictateur, exercée par son grossier lieutenant, n'avait plus pour elle ce prestige qui avait entouré le conquérant des Gaules. C'était la domination toute pure de la soldatesque, sans qu'on pût se consoler en pensant au génie et à la gloire du dominateur. Cicéron n'hésita plus. Il dénonça au Sénat dans sa première Philippique les menaces de la tyrannie militaire[442]. Au nom de César, Antoine avait ramené encore des exilés et infirmé les jugements des tribunaux[443]. Il voulait détruire pour l'avenir l'autorité de la justice. Il proposait d'accorder le droit d'appel au peuple à tous ceux qui auraient été condamnés comme coupables de violences ou de lèse-majesté[444]. On appelait alors peuple, les bandes organisées, les sociétés populaires qui en usurpaient le nom. Y aurait-il rien de plus honteux, disait Cicéron, que de voir un homme, condamné pour crime de violence contre la majesté du peuple, recourir en appel à cette même violence ? Quel accusateur insensé ira faire condamner un accusé pour être jeté en proie à la colère d'une multitude payée ? Quel juge osera porter une sentence de condamnation pour être traîné aussitôt lui-même devant un tribunal d'ouvriers mercenaires ? Cette loi n'est pas une loi d'appel, c'est le renversement des deux tribunaux qui nous protègent[445]. Pour être plus sûr d'avoir la justice à sa discrétion, Antoine avait songé à altérer la composition du jury. Il proposait d'ajouter aux deux décuries des sénateurs et des chevaliers, une décurie de centurions qui ne seraient pas astreints à la condition d'un cens déterminé, requise des juges par toutes les lois judiciaires et même par celle de César[446]. Cette loi fut votée. De simples soldats de la légion de l'Alouette, élevés au rang de centurions, des vétérans qui avaient mangé leur fortune et qui cherchaient à la refaire en trafiquant de leur verdict, enfin des joueurs, des grecs, des danseurs[447] servirent à recruter cette troisième décurie[448]. Ces juges sans fortune, sans capacité et sans indépendance allaient bientôt recevoir, dans l'enceinte même de la justice, le mot d'ordre des chefs militaires, comme, autour de cette enceinte, les bandes de la plèbe urbaine recevaient des entrepreneurs d'émeutes le signal des clameurs ou des violences. Les tribunaux étaient à la fois assiégés et envahis. Cicéron s'adressa encore aux chevaliers romains. L'ordre
équestre vint une dernière fois, comme au temps de Catilina, prêter son
concours à Cicéron, et se ranger sur les degrés du temple de la Concorde[449]. La guerre fut
décidée contre Antoine, ses lois furent révoquées, comme votées contre les
auspices[450].
La décurie des centurions fut supprimée. Mais peu de temps après, le centurion
Hérennius, sur l'ordre des triumvirs, égorgeait le dernier défenseur des
lois. Là tête du grand orateur était suspendue à la tribune aux harangues.
Cicéron avait essayé de fonder un gouvernement sage, en appelant aux affaires
les chevaliers romains, les chefs de la bourgeoisie municipale de l'Italie. |