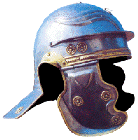HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS
TOME I
LIVRE II. HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS DE 400 À 133 AVANT JÉSUS-CHRIST.
CHAPITRE III. HISTOIRE POLITIQUE DE LA CHEVALERIE ROMAINE
ENTRE L'AN 400 AV. J.-C. ET L'ÉPOQUE DES GRACQUES DÉTERMINATION DU CENS DES CHEVALIERS
AUX DIVERSES ÉPOQUES.
RÉVOLUTION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE À ROME DE 269 À 220 AV. J.-C.
|
§ I. QUE LES CHEVALIERS EQUO PUBLICO ET EQUO PRIVATO
ONT TOUJOURS EU LE MÊME CENS QUE Les chevaliers des dix-huit centuries equo publico ont toujours eu le même cens que les citoyens de la première classe, et fait partie de cette classe. Pour les douze dernières centuries, nous le savons par le témoignage direct de Tite-Live. Dans le récit du procès de l'an 169 av. J.-C.[1], il nous dit que le censeur Claudius fut condamné par huit des douze centuries de chevaliers, et par beaucoup d'autres centuries de la première classe. On s'est appuyé sur ce passage pour avancer que les six premières centuries équestres étaient étrangères à cette classe. Mais on ne peut tirer cette conséquence du silence de Tite-Live sur le vote des six centuries dans le procès de Claudius. L'auteur, comme nous l'avons montré[2], voulait faire ressortir le nombre des centuries qui condamnèrent l'accusé. Il est naturel qu'il n'ait rien dit des six suffrages sénatoriaux, qui évidemment furent en sa faveur. D'ailleurs, Denys et Cicéron rangent expressément dans la première classe les dix-huit centuries. Denys décrit ainsi l'assemblée centuriate[3] : On appelait et l'on faisait voter en premier lieu la classe de ceux qui avaient le cens le plus élevé, et qui prenaient le premier rang dans les batailles. Parmi eux on comptait dix-huit centuries de chevaliers, et quatre-vingts de fantassins. Le cens le plus élevé était donc le même pour les chevaliers et pour les quatre-vingts centuries de la première classe. C'était celui de cent mille as que Denys traduit par cent mines[4]. Tous les citoyens de la première classe avaient le cens équestre. Mais, avant le siège de Véies, tous n'étaient pas chevaliers. Car il n'y avait encore que des chevaliers equo publico, et le nombre des membres des dix-huit centuries étant fixé à deux mille quatre cents, les plus nobles jeunes gens de la classe riche trouvaient seuls place dans ces corps d'élite. Denys dit fort exactement, que Servius choisit[5] les chevaliers parmi les citoyens qui joignaient à une fortune de première classe, les avantages d'une naissance illustre. Ceux qui n'avaient que les cent mille as[6] de cens, mais à qui un cheval payé par l'État n'avait pas été assigné, restèrent dans les quatre-vingts centuries des fantassins de la première classe : Ce furent eux qui, en l'an 400 av. J.-C., devinrent les chevaliers equo privato. Les dix-huit centuries étaient si bien aux yeux de Denys une partie intégrante de la première classe, qu'il décrit ainsi l'élection de Cincinnatus au consulat, en l'an 459 av. J.-C.[7] : Lorsque le temps des élections fut arrivé, et que le héraut appela la première classe, les dix-huit centuries de chevaliers, et les quatre-vingts de fantassins qui avaient le cens le plus élevé, entrèrent dans le lieu désigné (septa ou ovile), et choisirent pour consul Lucius Quintius Cincinnatus. Cicéron désigne aussi les chevaliers equo publico sous le nom de dix-huit centuries,
qui ont le cens le plus élevé[8] ; et la
description qu'il nous donne de l'élection de Dolabella (43 J.-C.), prouve qu'au dernier siècle de Ce détail des opérations du vote ne laisse de place aux dix-huit centuries que dans la première classe. Si, en dehors de cette classe, les six suffrages avaient eu un vote séparé, on l'eût annoncé séparément, puisque chaque classe était appelée tout entière par le héraut, et qu'après son vote on en annonçait le résultat collectif. Tous ces passages de Denys et de Cicéron prouvent que, depuis l'époque de Servius jusqu'à celle de César, les dix-huit centuries équestres equo publico ont toujours fait partie de la première classe. Il eu fut de même des chevaliers equo privato, depuis leur institution, en l'an 400 av. J.-C., jusqu'au temps de César. En effet, Tite-Live nous dit que les citoyens qui, depuis l'an 400 av. J.-C., servirent sur des chevaux achetés à leurs frais (equis suis), étaient ceux qui avaient le cens équestre, sans avoir le cheval donné par l'État[11], c'est-à-dire les citoyens de la première classe qui n'avaient pas été rangés dans les dix-huit centuries equo publico. Depuis cette époque, la première classe ne se composait donc que de chevaliers equo publico et de chevaliers equo privato. Un témoignage ancien va nous faire voir qu'au temps de César elle ne contenait, comme par le passé, que des chevaliers. On sait que depuis la loi d'Aurelius Cotta (en 70 av. J.-C.), trois ordres de juges siégeaient dans les tribunaux : les sénateurs, les chevaliers et les tribuns de la solde. César enleva le droit de juger aux tribuns, et le réserva aux deux premiers ordres[12]. Ce n'est pas que tous les chevaliers equo privato fussent admis à remplir les fonctions judiciaires. Le titre de chevalier étant devenu héréditaire, plusieurs de ceux qui le portaient, et qui servaient dans la cavalerie romaine, n'avaient pas le cens équestre, soit parce qu'ils avaient dilapidé leur fortune, soit parce. qu'ils avaient partagé la fortune de leurs parents avec des cohéritiers. Aussi les lois judiciaires de César, de Pompée, d'Aurelius Cotta, n'admettaient dans les tribunaux que les chevaliers qui avaient le cens équestre[13]. Les juges, sous la dictature de César, étaient donc les sénateurs et les chevaliers qui possédaient la fortune équestre de 400.000 sesterces. Mais Salluste, qui a écrit les lettres à César[14], appelle les tribunaux de ce temps-là, tribunaux où siège la première classe (judicia primæ classis[15]) ; et voici le conseil qu'il donne au dictateur pour les réformer[16] : Il me semble bon que tous les citoyens de la première classe soient juges ; mais il faudrait que les juges fussent plus nombreux qu'ils ne sont. La première classe, au temps de César, se composait donc des juges, c'est-à-dire de tous ceux qui avaient au moins le cens équestre, sénateurs ou chevaliers. Ainsi, depuis leur institution en l'an 400 av. J.-C. jusqu'à César, les chevaliers equo privato, qui, au temps des Gracques, composèrent l'ordre judiciaire, ont constitué avec les chevaliers equo publico toute la première classe. Le cens de la première classe a toujours été identique au cens équestre. L'identité de la chevalerie romaine et de la première classe nous fournit l'explication d'un passage de la République[17] de Cicéron qu'on n'est pas encore parvenu à comprendre. Nous allons l'expliquer, sans y changer un mot, ni un chiffre, et démontrer que les changements que l'on a proposé ou que l'on pourrait proposer d'y faire sont inutiles[18], et qu'il faut s'en tenir au texte tel que l'a publié Angelo Maï. Voici les premières lignes de ce fragment[19] : ...duodeviginti censu maximo. Deinde, magno equitum numero ex omni populi summa separato, reliquum populum distribuit in quinque classes. Angelo Maï complète ainsi la première phrase, qui est tronquée : scripsit centurias equitum ; cette restitution est d'une exactitude peu contestable. Car Cicéron, décrivant dans ce passage la constitution de Servius, suit le même ordre d'idées que suivit plus tard dans une description plus complète Denys d'Halicarnasse, et Denys[20] emploie même des expressions tout à fait semblables à celles de Cicéron : Tὸ δὲ τῶν ἱππέων πλῆθος ἐπέλεξεν ἐκ τῶν ἐχόντων τὸ μέγιστον τίμημα καὶ κατὰ γένος ἐπιφανῶν· συνέταξε δ´ εἰς ὀκτωκαίδεκα λόχους καὶ προσένειμεν αὐτοὺς τοῖς πρώτοις τῶν φαλαγγιτῶν ὀγδοήκοντα λόχοις. Traduisons littéralement le passage de Cicéron avec la restitution d'Angelo Maï : Servius enrôla dix-huit centuries de chevaliers ayant le cens le plus élevé. Ensuite, ayant séparé de tout l'ensemble du peuple un grand nombre de chevaliers, il distribua le reste du peuple en cinq classes. Ces nombreux chevaliers dont parle Cicéron, il les distingue d'abord des dix-huit centuries équestres, puisqu'il fait, suivre les mots duodeviginti censu maximo de l'adverbe Deinde qui marque nettement la formation d'une nouvelle catégorie de citoyens. Il ne les distingue pas moins des cinq dernières classes, puisque ces classes formaient, après que Servius eut mis à part ce grand nombre de chevaliers, tout le reste du peuple, reliquum populum. Pour résoudre cette difficulté, il faut nous reporter au passage de Denys qui pour les idées et pour les expressions correspond celui de Cicéron. Denys[21] compte en tout six classes et cent quatre-vingt-treize centuries. Cicéron, comptant le même nombre de centuries[22], doit aussi admettre le nombre de six classes, sans exclure la dernière classe comme l'a fait Tite-Live[23]. Ces nombreux chevaliers qu'il place entre les citoyens des dit-hait centuries équestres et ceux des cinq dernières classes, en les distinguant des uns et des autres, ne peuvent être que les hommes de la première classe, qui avaient, comme dit Tite-Live, le cens équestre, sans avoir reçu un cheval payé par l'Etat[24]. Mais comment Cicéron pu appeler du nom de chevaliers (equitum),
ces hommes de la première classe qui, selon Tite-Live et Denys, formaient, au
temps de Servius, quatre-vingts centuries de fantassins phalangites ? N'est-il pas certain, d'ailleurs,
que, jusqu'à l'an 400 av. J.-C., il n'y eut à Ruine d'autre cavalerie que
celle des dix-huit centuries équestres ? C'est que les fantassins de la
première classe, en cette année 4.00 av. J.-C., avant tous le cens équestre
de 100.000 as, avaient offert de servir sur des chevaux qu'ils achèteraient à
leurs frais (equis
suis ou privatis).
Depuis ce temps-là, la première classe tout entière ne se composait plus que
des chevaliers equo publico des dix-huit
centuries, et des chevaliers equo privato.
Pour un homme du siècle de Cicéron, les dénominations de chevalier romain et d'homme de la première classe étaient devenues
synonymes. Cicéron, tout préoccupé du jeu de la constitution de son temps, et
faisant d'ailleurs une analyse très-rapide[25] de celle de
Servius, s'est figuré la première classe da temps de Servius, telle qu'il la
voyait au dernier siècle de
Cicéron, tout en admettant le total bien connu des 493 centuries pour l'époque de Servius a, par inadvertance, supposé que la première classe du temps de Servius, était composée comme elle le fut depuis la seconde guerre punique, c'est-à-dire de 18 centuries de chevaliers equo publico, de 70 centuries de chevaliers equo privato, et d'une centurie de charpentiers ; ce qui donne en tout 89 centuries pour la première classe. Voici donc la traduction avec commentaire explicatif des premières lignes de ce fragment tant controversé. Servius enrôla dix-huit centuries de chevaliers (equo publico), ayant le cens le plus élevé (le cens équestre de 100.000 as). Ensuite, ayant séparé de toutes les tribus un grand nombre de chevaliers (c'est-à-dire 70 centuries de chevaliers equo privato, qui composaient la première classe, et formaient deux centuries par tribu), il distribua en cinq classes le reste du peuple (ce qui donne en tout six classes, conformément au compte de Denys). On hésiterait à reconnaître que Cicéron a, par mégarde, transporté la première classe de son temps au siècle de Servius, et commis ainsi un grave anachronisme, si la même erreur ne se trouvait répétée dans le même passage, quelques lignes après. Nous reproduisons ci-dessous le texte, parce qu'il a été souvent altéré par ceux qui voulaient le corriger[33]. Nous traduisons littéralement : Maintenant vous voyez que le système de cette constitution est tel, que les centuries de chevaliers avec les six suffrages et la première classe, en y ajoutant la centurie qui, à cause de sa grande utilité pour la ville, a été assignée aux charpentiers, forment quatre-vingt-neuf centuries ; et, si huit seulement des cent quatre centuries qui restent, viennent à se joindre à elles, la majorité du peuple entier est formée ; de telle sorte que les autres centuries, au nombre de quatre-vingt-seize, bien supérieures par la multitude des citoyens qu'elles renferment, ne sont ni exclues des suffrages, ce qui serait tyrannique, ni trop puissantes, ce qui serait dangereux. Cicéron compte évidemment dans ce passage, comme dans les premières phrases du fragment, 193 Centuries en tout. Il en met 89 dans la première classe, ainsi composée : 18 centuries de chevaliers equo publico, comprenant les six suffrages, 70 centuries de chevaliers equo privato, formant la première classe proprement dite, et une centurie de charpentiers. En retranchant ces 89 centuries du total des 193, il en reste 104, et si, dans l'assemblée centuriate, les 89 centuries votent dans le même sens, et que, des 104 qui restent, 8 seulement se joignent à elles, la majorité est formée, celle de 9/ centuries contre 96 (97 + 96 = 193). Ce raisonnement est tout à fait clair, et ce qui l'a fait rejeter par plusieurs critiques, ce n'est pas la difficulté de le comprendre, c'est la difficulté d'en admettre les données qui sont fausses. Il est faux, en effet, qu'au temps de Servius il y ait eu 89 centuries dans la première classe. Il y en avait 98, comme le témoignent Tite-Live et Denys, et elles se partageaient en 80 centuries de fantassins et 18 de chevaliers. Pour mettre le langage de Cicéron d'accord avec la vérité historique, on a fait subir au texte des changements de plusieurs sortes. Mais ils sont tous condamnés d'avance par leur inutilité. Quand meulé on parviendrait, en substituant un texte imaginaire au texte réel, à faire dire à Cicéron ce qu'il n'a point dit, à quoi réussirait-on ? A rendre inintelligibles les deux premières phrases du même fragment, qui ne s'expliquent pas, si l'on suppose que Cicéron n'a pas commis l'erreur que l'on veut corriger. S'il n'a pu oublier un instant que la première classe de Servius comprenait 80 centuries de fantassins et 18 de chevaliers, que voudrait-il dire en parlant de ce grand nombre de chevaliers, pris par Servius dans toutes les tribus, et qui n'étaient, ni des dix-huit centuries, ni des cinq dernières classes ? L'erreur de Cicéron est la même dans les deux passages du
fragment, et, loin de nous en plaindre, il faut en faire notre profit.
L'homme d'État qui parle d'histoire a quelquefois des préoccupations plus
intéressantes que son sujet, et il est heureux que Cicéron ait, par
inadvertance, antidaté une partie de la constitution de son temps : sans cela
nous la connaîtrions mal. Denys a assisté sous Auguste. aux réunions des
assemblées centuriates. Il a vu le jeu de la constitution que Cicéron avait
pratiquée, et il ne l'a pas compris. Il en est revenu avec l'étonnement d'un
érudit, que la vue des choses présentes embarrasse, parce qu'elles ne sont
plus d'accord avec les livres anciens qu'il connaît[34]. Pour Cicéron,
c'était tout le contraire. Le sentiment si vif qu'il avait de la réalité
contemporaine lui faisait quelquefois oublier le passé ; et ce qu'il a écrit
au livre II de Nous arrivons donc avec Cicéron au même résultat où nous
ont conduit Tite-Live[36] et Salluste[37] : à
l'identification de la chevalerie romaine avec la première classe de
citoyens, depuis la fin du premier siècle de Cette vérité historique a tant de conséquences, qu'à cause
des doutes qu'on pourrait élever à tort sur l'authenticité des lettres de
Salluste ou sur le sens du passage de Tous les écrivains de l'antiquité, lorsqu'ils parlent des
derniers siècles de Horace dit aussi[39] : Des quatre cent mille sesterces qui donnent le droit de s'asseoir au théâtre, dans quatorze rangs réservés aux chevaliers , qu'il vous en manque six ou sept mille, et vous serez de la plèbe. Cicéron oppose aussi la plèbe à l'ordre équestre : C. Servilius Glaucia eût été nommé consul, pendant qu'il était préteur, si l'on eût jugé sa candidature légale. Car la plèbe était pour lui, et l'ordre équestre était attaché à lui par la loi dont il lui était redevable[40]. Enfin, lorsque Tite-Live nous raconte que les citoyens ayant le cens équestre, offrirent de faire le service de la cavalerie avec des chevaux achetés à leurs frais, il ajoute que la plèbe rivalisa de dévouement avec eux, et promit de faire aussi un service extraordinaire dans l'infanterie[41]. Dans tous ces passages, les mots plèbe et plébéiens
ne forment plus, comme dans l'histoire du premier siècle de Maintenant, si nous relisons dans Tite-Live le récit du procès de Claudius, en 169 av. J.-C.[43], nous voyons que c'est entre à vote de la première et celui de la seconde classe de l'assemblée centuriate, que les nobles quittent leurs anneaux d'or, pour implorer l'indulgence des classes qui n'ont pas encore voté, et Tite-Live désigne cette démarche par ces mots : Ils faisaient en suppliant le tour de la plèbe. Le mot plèbe, en cet endroit, ne peut recevoir le sens général et indéterminé d'assemblée populaire. Car il s'agit d'un vote par centuries, et non par tribus ; et l'assemblée centuriate s'appelle populus. Il s'applique donc spécialement à l'ensemble des quatre dernières classes. Or, comme le mot plèbe désigne aussi tous ceux qui n'ont pas le cens équestre, il faut en conclure que la première classe était composée des citoyens qui le possédaient. Si nous avons tant insisté sur cette preuve, c'est que l'identité qu'elle établit pour toutes les époques de l'histoire romaine, entre le cens équestre et le cens de la première classe, confirme tous les résultats que nous avons déjà obtenus par nos recherches et en prépare d'autres. L'histoire militaire nous avait amené à induire du nombre des légions qui seraient en 212 av. J.-C., que les chevaliers equo privato devaient être dix mille en 218[44]. L'histoire politique nous montre qu'il ne pouvait pas en être autrement, puisqu'ils formaient avec les 2.400 chevaliers equo publico toute la première classe. En expliquant ce qu'étaient les ærarii[45] ; nous avons dit que les légionnaires du temps de Polybe, qui avaient dix mille drachmes ou cent mille as de cens[46], n'étaient pas les hommes de la première classe, mais ceux de la première sous-classe (infra classem). En effet, s'ils avaient appartenu à la première classe, ils auraient possédé le cens équestre, et servi dans la cavalerie et non dans l'infanterie, au rang assez peu considéré des hastats, où Polybe les range. Le cens de la première classe était, depuis Servius jusqu'aux guerres puniques, de cent mille as. C'était aussi, comme Denys le dit expressément, le cens équestre. Or, le cens équestre était, au temps de la loi de Roscius Othon (67 av. J.-C.) ; de quatre cent mille sesterces[47] ou d'un million d'as de deux onces[48]. Il avait donc décuplé en valeur nominale, comme le prix de l'equus publicus, qui avait été porté de mille as à dix mille, entre les deux premières guerres puniques. Si le chiffre représentant en as le cens de la première classe s'éleva de cent mille à un million, le cens de la cinquième classe a dû s'élever de douze mille cinq cents as à cent vingt-cinq mille. Nous avons donc eu raison de dire qu'Aulu-Gelle[49] s'était trompé en prenant ce dernier chiffre, pour celui du cens de la première classe. C'était bien réellement, au temps de la loi Voconia (168 av. J.-C.), la limite inférieure du cens des classici, c'est-à-dire des citoyens des cinq classes. A quelle époque faut-il faire remonter ces changements ? Ils ne peuvent avoir eu lieu qu'après la transformation de l'as d'une livre en as de deux onces, c'est-à-dire après la fin de la première guerre punique[50]. Mais, dès l'an 220 av J.-C., nous trouvons le cens équestre d'un million l'as (decies æris), mentionné dans Tite-Live[51]. Essayons donc de décrire cette révolution monétaire et économique qui eut lieu à Rome, entre l'an 269 et l'an 220 av. 3.-C. Tons les droits des citoyens romains, et surtout ceux des chevaliers, étaient attachés au cens. Ne pas se faire une idée exacte de la fortune privée des Romains et des évaluations des censeurs aux différents siècles, ce serait risquer de ne rien comprendre à l'histoire politique de Rome, ou du moins, de confondre, comme on l'a fait souvent avec Aulu-Gelle, la constitution antérieure aux guerres puniques avec celle du temps des Scipions. Nous examinerons d'abord la valeur des chiffres du cens équestre ou de la première classe qui nous sont donnés par Denys, par Tite-Live et par Pline, pour l'époque antérieure aux premiers changements monétaires, qui eurent lieu à Rome, en 269 av. J.-C. Puis, nous décrirons la révolution économique et monétaire, qui se place entre les années 269 et 220 av. J.-C. ; enfin, la révolution politique qui en fut la suite, et qui changea la constitution de l'assemblée centuriate et de celle des tribus. Ces développements sont nécessaires pour faire comprendre l'influence politique des chevaliers aux différentes époques, et leur manière de voter, qui a varié avec l'ensemble de la constitution. § II. QUE LE CENS DE Trois[53] auteurs anciens nous ont parlé du cens de la première classe, c'est-à-dire du cens équestre de l'époque de Servius Tullius : ce sont Pline, Denys d'Halicarnasse et Tite-Live. Pline, avec son érudition immense et toujours curieuse de détails, est plus propre à nous instruire sur un sujet spécial qu'aucun autre écrivain latin. Dans le passage[54] où il fait l'histoire des monnaies romaines de cuivre et d'argent, il rappelle que le roi Servius, le premier, fit une monnaie de cuivre dont l'empreinte portait des têtes de bétail. Aussi fut-elle appelée pecunia : Le cens le plus élevé était sous ce roi de cent dix mille as ; et ceux qui le possédaient formaient la première classe[55]. On ne peut douter que, dans l'esprit de l'auteur, cette somme ne se soit composée d'as d'une livre. Car il nous dit quelques lignes plus haut, qu'au temps de la guerre de Pyrrhus, c'est en as d'une livre que se faisaient les paiements ; et il ajoute un peu plus loin, que ce poids de l'as (librale pondus æris) ne fut diminue qu'au temps de la première guerre punique. Denys est moins instruit et moins exact que Pline. Ce Grec, qui essayait de prouver à ses compatriotes que les Romains n'étaient pas des barbares, ne s'est même pas douté qu'aux premiers siècles de Rome la drachme attique y fût inconnue. Si Pline eût vécu de son temps, il aurait pu lui apprendre[56] que les Romains ne se servirent de monnaie d'argent qu'après la défaite de Pyrrhus, et qu'ils n'en frappèrent qu'en 269 av. J.-C., cinq ans avant la première guerre punique. L'ignorance de Denys à cet égard s'explique par sa préoccupation constante de retrouver les usages grecs dans les usages romains, et par la limite qu'il s'était prescrite dans la composition de son ouvrage sur les Antiquités de Rome. Son récit s'arrêtait à 264 av. J.-C., et les changements monétaires à Rome ne datent que de la première guerre punique. Denys traduit donc en mines et en drachmes d'argent les sommes marquées en as dans le cens de Servius. Pour lui, cent mille as valent cent mines ou dix mille drachmes[57], soixante-quinze mille as valent sept mille cinq cents drachmes ou soixante-quinze mines ; et il traduit ainsi en monnaies d'argent toutes les valeurs du cens exprimées en monnaies de cuivre, en prenant la drachme pour l'équivalent de dix as. Comment Denys a-t-il été conduit à adopter cette
traduction ? La drachme attique se confondit peu à peu au troisième siècle
av. L-C. avec le denier d'argent[58] et elle pesa A côté de ces as réels, on conserva dans les estimations
légales l'ancien as de deux onces, qui avait été une monnaie réelle de 243 à
217 av. J.-C. et qui devint une monnaie de compte servant à traduire les
sommes composées effectivement de deniers d'argent. C'est ainsi que, d'après
Pline, on paya toujours aux légionnaires un denier pour dix as. Pour la solde
de 1.200 as par an, chaque légionnaire recevait deux oboles par jour, c'est-à-dire
par an 120 drachmes[64] ou deniers. Que
fait donc Denys lorsqu'il traduit les cent mille as de la première classe ou
du cens équestre par cent mines, c'est-à-dire par dix mille drachmes ? Il
suit l'exemple des questeurs militaires des derniers siècles de Mais, si la traduction que fait Denys de cent mille as par
cent mines ou dix mille drachmes est conforme à un usage du troisième siècle
av. J.-C., maintenu malgré les changements monétaires dans tous les registres
publics par le sénatus-consulte de l'an 217 av. J.-C. ; elle n'en est pas
moins doublement inexacte. Elle contient une erreur de fait : car elle
suppose qu'au temps de Servius on se servait à Rome des mêmes monnaies d'argent
qu'à Athènes[66],
quand Pline nous affirme qu'on n'y connaissait aucune pièce d'argent, et
quand Tite-Live, dans toute sa première décade, ne mentionne presque jamais
l'emploi d'une monnaie autre que l'æs grave
composé d'as d'une livre de cuivre[67]. Elle contient
aussi une erreur d'évaluation : car, en admettant que les monnaies d'Athènes
auraient eu cours dans Tite-Live[69] fixe à cent
mille as le cens de la première classe au temps de Servius, et nous avons
démontré[70]
que c'était le même qu'il appelle, à l'an 400 av. J.-C., cens équestre[71]. On ne peut
soupçonner l'historien latin d'avoir ignoré, comme Denys, la nature et le
poids des anciennes monnaies romaines. Il sait qu'aux deux premiers siècles
de Mais, si l'on ne peut taxer Tite-Live d'ignorance, ne peut-on lui imputer une méprise ? Les cent mille as du cens de la première classe ne seraient-ils pas le cens de l'époque des guerres puniques exprimé en as de deux onces, ce qui en ferait l'équivalent de dix mille drachmes ? Cette méprise est d'autant plus vraisemblable, dit-on, que dans le malle chapitre Tite-Lige porte l'æs equestre à dix mille as ; or, il est avéré que ce prix du cheval fourni par l'État est exprimé en as de deux onces, et doit se traduire par mille drachmes ou deniers[74]. Ce raisonnement spécieux est faux dans son principe, et il
aurait des conséquences toutes inadmissibles. Il est faux que cent mille as
de deux onces aient été le cens de la première classe au temps des dernières
guerres puniques. Car Polybe[75] place ceux qui
ont cette fortune dans les rangs des hastats,
le moins considéré des trois rangs de l'infanterie ; or, nous avons démontré
que tous les citoyens de la première classe servaient, depuis l'an 400 av.
J.-C., dans la cavalerie. De plus ; si l'on veut, pour être d'accord avec la
logique grammaticale, traduire dans le chapitre 43 du livre Ier de Tite-Live,
centum millium æris, qui est le
chiffre du cens de la première classe, de la même manière que dena millia æris, qui est celui du prix d'un
cheval, on n'est plus guère d'accord avec la logique des faits. Car il
résulterait de là, qu'au temps de la seconde guerre punique, le peuple
conquérant qui avait soumis la grande Grèce, De tous les érudits allemands qui ont admis que le cens de
cent mille as était celui de la première classe au temps d'Annibal ; et qu'il
valait dix mille drachmes, M. Zumpt a été le plus conséquent avec lui-même[76]. Il ne s'est
trompé que dans la donnée qui servait île point de départ à son raisonnement.
Il a fort bien vu ce que nous avons démontré par des chiffres précis[77], que, si le
cheval donné par l'État (equus publicus), a valu dans les temps
anciens mille as d'une livre, et dix mille as de deux onces après les guerres
puniques, ce changement doit tenir à une révolution générale dans les
chiffres des valeurs exprimées en as. Il attribue, comme nous, ce changement
d'abord à l'opération qui consista à couper l'as d'une livre en six as sextantario pondere ; puis, à l'affluence de
l'argent à Rome. Le cheval donné par l'État, ayant valu mille as d'une livre,
aurait dit valoir six mille as de deux onces ; mais, l'augmentation du
numéraire ayant fait croître le prix de toutes choses dans la proportion de 3
à 5 ou de 6 à L'invraisemblance de la supposition devient encore plus
forte, si l'on remarque qU'en l'an 416 av. J.-C.[81], deux
dénonciateurs reçurent, par ordre du Sénat, dix mille as d'une livre. Le
Sénat eût-il récompensé un service de ce genre, par le don d'une fortune de
première classe ? Il est vrai que Tite-Live dit qu'à cette époque on était
riche avec dix mille as. Mais Tite-Live, comme tous les écrivains du siècle
d'Auguste, se plaît à opposer la pauvreté des temps anciens à la richesse de Ainsi, l'hypothèse de M. Zumpt, qui porte à cent mille as de deux onces la fortune de la première classe au temps d'Annibal, et qui la réduit à dix mille as d'une livre au temps de Servius, a pour point de départ une erreur démontrée, et aboutit à plusieurs conséquences inconciliables avec des faits certains. L'opinion de M. Bckh[84] s'appuie sur la même hypothèse erronée, et, si elle ne mène pas à des résultats aussi invraisemblables, elle ne les évite qu'au prix d'une inconséquence. M. Bckh admet que le cens de la première classe était de cent mille as de deux onces au sixième siècle de Rome (240-140 av. J.-C.). Il n'en réduit la valeur nominale que dans la proportion de 5 à 1 pour l'époque de Servius, et il suppose qu'il était, sous ce règne, de vingt mille as d'une livre. Voici comment il raisonne[85] : Les citoyens de la première classe avaient un cens de vingt mille as d'une livre, depuis le règne de Servius jusqu'à la première guerre punique. Pendant cette guerre, on coupa l'as de douze onces en six as de deux onces. Le bien qui valait vingt mille as anciens, en dut valoir cent vingt mille nouveaux. Mais de plus, la richesse publique et privée s'étant accrue, le prix de toutes choses s'éleva dans la proportion de 3 à 5 ou de 6 à 10. Le cens de la première classe, qui, par le seul fait de la nouvelle taille des monnaies de cuivre, se serait élevé de vingt mille à cent vingt mille as, aurait dû, par cette seconde cause d'élévation, être porté jusqu'à deux cent mille, si le cuivre n'eût doublé de valeur depuis Servius. Mais on remarque qu'il l'époque de Servius, vingt mille livres de cuivre valaient un peu plus de soixante-quatorze livres d'argent, et, qu'au temps des guerres puniques, elles en valaient un peu moins de cent quarante-trois[86]. Le cuivre avait donc doublé de prix à peu près ; et le bien qui, sans cela, aurait valu deux cent mille as de deux onces, n'a dû être estimé qu'à cent mille. Ce raisonnement contient dans sa dernière partie une évaluation arbitraire, et une inconséquence. L'égalité de valeur établie entre vingt mille livres de cuivre et soixante-quatorze livres d'argent pour l'époque de Servius n'est pas prouvée. Les valeurs relatives des deux métaux à Syracuse au temps de Servius Tullius, ne peuvent autoriser aucune induction applicable à l'histoire des monnaies romaines. Car, au temps de Servius, les Romains ne connaissaient pas l'argent. Pline dit expressément qu'ils ne se servirent de monnaie d'argent qu'après la défaite de Pyrrhus[87], ' c'est-à-dire vers l'époque de la prise de Tarente (272 av. J.-C.). Nous trouvons dans l'épitomé du livre XV de Tite-Live, après le résumé de la guerre de Tarente, et avant le commencement de la guerre punique, la mention du premier emploi de l'argent par les Romains[88]. Tite-Live dit qu'il n'y en avait pas à Rome en l'an 403 av. J.-C.[89]. A ces témoignages précis et concordants, il n'est pas
possible d'opposer, comme on l'a fait, le témoignage de Varron, qui
attribuerait à Servius la fabrication du premier denier d'argent[90]. Le savant
polygraphe ne fait, dans ce passage, que rapporter un bruit populaire (dicunt),
sans se donner pour garant de l'exactitude du fait supposé. Nous avons montré
qu'il y a des raisons de croire que ce denier, attribué à Servius et qui dut
peser Il n'y a donc pas eu de monnaie d'argent à Rome sous
Servius ; ni même pendant les trois siècles qui suivirent son règne. Le
cuivre seul avait alors cours chez les Romains. Quant à l'argenterie, elle y
était si peu connue, qu'en l'année 275 av. J.-C. , l'année même de la
victoire de Bénévent remportée sur Pyrrhus, les deux censeurs C. Fabricius
Luscinus et Q. Æmilius Papus, notèrent d'infamie et chassèrent du Sénat P.
Cornelius Rufinus, qui avait été dictateur et deux fois consul, pour avoir
réuni dans sa maison dix livres pesant, c'est-à-dire Il est bien vrai qu'au temps des guerres puniques, le
cuivre devint plus cher relativement à l'argent. Ainsi, à la tin de la
première guerre punique, ce métal valait seulement 1/140 de son poids d'argent, et à partir de 217 av. J.-C.,
quand le denier de Il est évident que c'est l'effet contraire qui a dei se produire. Lorsque les Romains de 269 à 24.1 av. J.-C. fabriquèrent les premiers deniers d'argent, ils fixèrent la valeur du denier à dix as. Les as d'argent entrèrent dans la circulation concurremment avec les as de cuivre, et cette multiplication des espèces monétaires augmenta dans la proportion de 3 à 5 le prix de toutes les valeurs exprimées en as. Il est contradictoire de supposer avec M. Bckh, que la même cause ait produit à la fois une augmentation du prix du cuivre, et une baisse du prix des propriétés. Aujourd'hui, l'or fait concurrence à l'argent et s'y substitue en France, comme à Rome, au troisième siècle av. J.-C., l'argent fit concurrence au cuivre et le remplaça même dans son rôle d'étalon monétaire. On paie aujourd'hui en francs d'or comme eu francs d'argent, et le nombre des francs qui sont dans le commerce, depuis la découverte des mines d'Australie et de Californie, étant de plus en plus grand, le prix des propriétés, estimé en francs, au lieu de baisser, augmente de jour en jour. Par la même raison le métal d'argent, dont le franc se composait à l'origine, enchérit par rapport à l'or qui abonde, absolument comme au temps des Scipions, le cuivre enchérissait à Rome par rapport à l'argent accumulé en Italie par les conquêtes romaines. Si donc on admet, comme M. Bckh, que le cens de la première classe était de 20.000 as d'une livre avant les guerres puniques, les as ayant été coupés en six,. il faut d'abord porter ce cens à 120.000 as de deux onces ; puis, le prix des propriétés ayant monté dans la proportion de 3 à 5 par suite de l'abondance du numéraire, il faut multiplier encore le chiffre 120.000 par la fraction et l'on arrive nécessairement à 200.000 as de deux onces, chiffre qu'il n'y a plus aucune bonne raison de réduire. Si l'on veut arriver, comme se le proposent MM. Bckh et Zumpt, à 100.000 as de deux onces pour représenter le cens de la première classe au temps d'Annibal, il faut partir du chiffre de 10.000 as d'une livre représentant le cens de cette classe au temps de Servius, et le multiplier par six, puis par 5/3, c'est-à-dire par dix. C'est ce qu'a fait M. Zumpt dont le calcul est seul logique. Mais nous avons démontré qu'il était faux dans les données comme dans les résultats. Les hypothèses fausses de l'érudition allemande sur les chiffres du cens de Servius étant écartées, il n'y a plus qu'à reconnaître que Tite-Live[95], instruit comme il l'était de l'histoire des monnaies romaines, en fixant à cent mille as le cens de la première classe de Servius, a simplement voulu parler, comme Pline, de cent mille as d'une livre. Il serait bien étrange qu'il s'y fût trompé ; car, de l'aveu de tous les critiques, les changements dans la valeur du cens n'ont Ni avoir lieu que par suite des changements monétaires du temps de la première guerre punique. Il suffisait donc à Tite-Live, pour ne pas confondre les chiffres du temps de Servius avec ceux de l'époque de la seconde guerre punique, d'avoir consulté un seul des registres des censeurs antérieurs à l'an 264 av. J.-C. Supposer qu'il ne l'a pas fait, c'est le considérer comme plus ignorant que Denys, qui cite ces registres[96], et qui a consulté aussi les mémoires conservés dans la famille d'un ancien censeur sur un fait antérieur de deux ans à la prise de Rome par les Gaulois[97]. Ces mémoires se trouvaient, au temps d'Auguste, chez un grand nombre de familles qui comptaient des censeurs parmi leurs ancêtres, et ils se transmettaient de père en fils comme un héritage sacré. Il y avait aussi des registres publics des censeurs (tabellæ censoriæ)[98] gardés avec
d'autant plus de fidélité, que les censeurs étaient, depuis la loi même de
leur institution, conservateurs des archives de l'État[99]. Le principal
dépôt de ces archives fut, depuis la seconde guerre punique[100], le portique du
temple de Avec de telles sources d'information, Tite-Live eût montré une négligence incompréhensible, s'il eût ignoré les véritables chiffres du cens des classes avant les guerres puniques. Tout porte donc à croire qu'il les a connus, et que le cens de la première classe avant 264 av. J.-C. était, non de dix mille as d'une livre comme le croit M. Zumpt, non de vingt mille comme le conjecture M. Bckh, mais de cent mille, comme Tite-Live l'a écrit. Reste à expliquer comment un si excellent écrivain a pu,
dans le même chapitre[103], désigner par centum millium æris cent mille as d'une livre,
et par dena millia æris dix mille as
de deux onces, prix du cheval donné par l'État. Cette inadvertance s'explique
par la différence des sources où Tite-Live puisait en même temps. Sur les
registres des censeurs les citoyens étaient divisés en catégories dont
chacune différait de la précédente par un cens moins élevé de vingt-cinq mille
as. Les différents chiffres de 100.000, 75.000, 50.000 as devaient être
marqués en tête de chaque catégorie, pour la distinguer ; et il était presque
impossible de s'y tromper. Au contraire l'æs equestre,
ou prix du cheval donné par l'État, était une somme fixe et connue de tous.
Composée de mille as d'une livre jusqu'à la première guerre punique, de dix
mille as de deux onces après cette guerre, elle n'avait pas besoin d'être
reproduite chaque année en tête de la liste des chevaliers equo publico. Elle n'était certainement pas
inscrite par les censeurs. Tite-Live ne l'a pas empruntée à un document
officiel, mais à quelque livre de seconde main, comme l'histoire de Fabius Pictor.
Cet historien romain, qui écrivait en grec au temps où l'æs equestre, était de mille deniers ou
drachmes, l'aura porté à cette somme pour l'époque de Servius. Tite-Live, qui
avait sous les yeux les Annales de Fabius[104] en composant
les chapitres 43 et 44 de son livre premier, a dû traduire, selon l'usage,
mille drachmes par dix mille as, sans songer que, pour établir une distinction
nécessaire, il aurait dû ajouter un peu plus haut l'épithète de gravis après
les mots centum millium æris. Il vaut
mieux imputer à Tite-Live cette légère omission que de lui faire dire des
choses contraires à l'évidence. Car si par scrupule grammatical on voulait
traduire les deux expressions analogues, centum
millium æris et dena millia æris,
de la même manière, et composer les deux sommes d'as de même nature et de
même poids, il faudrait se réduire à croire que, pendant tous les siècles de CONCLUSIONS.Résumons cette longue discussion : Les cent mille as du cens de la première classe, c'est-à-dire du cens équestre, depuis le règne de Servius jusqu'à la première guerre punique, sont des as de cuivre dont chacun pesait une livre romaine. Pline le dit expressément. Tite-Live, quoique moins explicite, ne peut être interprété dans un autre sens. Les critiques allemands qui lui ont imputé une méprise et qui ont essayé de corriger ses chiffres, se sont eux-mêmes égarés dans des calculs illogiques et dont les résultats sont en contradiction avec les faits. Quant à Denys d'Halicarnasse, s'il a traduit cent mille as par dix mille drachmes, ç'a été pour suivre un usage conservé dans les comptes officiels, depuis que l'as avait été réduit à deux onces. Le narrateur grec, ignorant l'histoire des monnaies romaines, n'a pas calculé la différence des as de deux onces et des as d'une livre. Nous allons voir que le cens équestre de cent mille as d'une livre fut transformé, par la révolution économique et monétaire du temps de la première guerre punique, en un cens d'un million d'as de deux onces ou de quatre cent mille sesterces. § III. QUE LE CENS ÉQUESTRE OU DE Jusqu'à la défaite de Pyrrhus, les Romains ne connurent
pas l'usage de la monnaie d'argent[105]. Ils se
servaient d'as de cuivre pesant chacun une livre, et la lourde monnaie était
entassée sur des chariots lorsqu'on portait au trésor (ærarium) la solde
militaire[106].
La conquête de la grande Grèce et, bientôt après, celle de Un siècle auparavant, la première rencontre entre les pauvres vainqueurs du Samnium et les Grecs enrichis des dépouilles de l'Asie, avait été suivie d'un étonnement réciproque dont le souvenir se conserva dans la tradition historique ou légendaire. L'imagination patriotique des Romains a peut-être embelli de récits poétiques la vie d'un Curius ou d'un Fabricius. Il n'en est pas moins certain que le contraste entre ces derniers héros de la simplicité antique, et Cinéas, le Grec raffiné, prodigue de présents et de paroles corruptrices, forme le trait le plus saillant et le plus vrai de l'histoire de cette époque de transformation. L'argent, quoique bien plus rare que chez les peuples modernes[109], devint cependant d'un usage de plus en plus commun à Rome. Les censeurs qui, en 275 av. J.-C., chassèrent Rufinus du Sénat pour avoir possédé dix livres d'argenterie[110], en avaient eux-mêmes chacun une livre[111]. Mais ce n'était pas de la vaisselle de table comme chez Rufinus[112]. C'étaient des vases sacrés, la salière et la soucoupe dont ils se servaient pour faire les offrandes aux dieux[113]. Au temps de la seconde guerre punique, les sénateurs avaient tous, outre la salière et la soucoupe de l'autel domestique, une certaine quantité d'argent travaillé ou monnayé ; et ceux des sénateurs qui avaient occupé les magistratures curules faisaient faire pour leurs chevaux des phalères d'argent[114]. En 269 av. J.-C., sous le consulat de O. Ogulnius et de C.
Fabius, le Sénat avait fait fabriquer les premiers deniers d'argent, dont chacun valait dix livres ou dix as[115] de cuivre. Le quinaire valait cinq livres de cuivre, et le
sesterce, deux livres et demie. Mais le denier d'argent, qui probablement
pesait à l'origine de On devine quelle révolution économique durent produire de
pareilles sommes versées tout d'un coup dans le trésor d'un petit peuple de
moins de trois cent mille citoyens, qui, quarante ans auparavant, connaissait
à peine le métal d'argent. De plus, les Romains avaient conquis L'accroissement des fortunes des particuliers suivit, pendant l'intervalle des deux premières guerres puniques, le progrès rapide de la fortune publique. Les sénateurs et leurs fils se mirent à trafiquer par mer avec les provinces auxquelles ils étaient chargés de donner dus lois. Ils y devinrent propriétaires et négociants en même temps que législateurs, proconsuls ou préteurs ; et ce cumul de l'exploitation commerciale avec les fonctions politiques amena de tels abus, qu'en l'an 218 av. J.-C., on fut obligé, pour les réprimer, de voter la loi Claudia[127]. Elle défendait à tout sénateur ou fils d'ancien sénateur d'avoir en mer un vaisseau de plus de trois cents amphores. Un navire de ce tonnage parut suffisant pour que chaque famille pût y transporter les fruits de ses propriétés. Toute opération lucrative parut au-dessous de la dignité des sénateurs. A côté de cette riche noblesse sénatoriale, qu'une loi de dérogeante excluait du trafic maritime, s'étaient élevées. à la même époque, les fortunes des publicains. Nous trouvons, au commencement de la seconde guerre punique, leurs compagnies d'entrepreneurs déjà constituées, riches et puissantes. En l'an 215 av. J.-C., trois compagnies de publicains, qui déjà avaient grossi leurs patrimoines dans l'administration des vivres[128], prennent l'adjudication de la fourniture du blé et des vêtements pour les armées d'Espagne, en se faisant garantir par l'Etat contre les risques de la mer. Un de ces fournisseurs, Postumius de Pyrgi, voulant exploiter frauduleusement celte assurance, s'entend avec ses associés pour simuler de faux naufrages[129]. Ils mettent sur de mauvais navires quelques marchandises sans valeur, les font couler bas, et demandent des indemnités comme pour de riches cargaisons. La fraude est dénoncée par le préteur Atilius au Sénat, qui n'use la punir, de peur d'offenser l'ordre des publicains. Enfin, deux tribuns du peuple citent Postumius de Pyrgi devant les tribus, pour faire prononcer contre lui une amende de deux cent mille as. Mais les publicains se jettent en masse sur le Forum et dispersent l'assemblée. L'on ne vient à bout de l'insolence de ce corps que par un sénatus-consulte suivi de plusieurs accusations capitales intentées aux auteurs de cette violence. La loi Claudia et l'affaire de Postumius en disent assez sur l'énorme accroissement des fortunes des sénateurs et des chevaliers après la victoire des îles Ægates et le traité de 241 av. J.-C. Si l'époque de la première guerre punique fut celle d'une révolution monétaire, elle fut donc suivie d'une révolution économique qui, en augmentant brusquement la richesse publique et privée, dut changer les valeurs de toutes choses relativement au numéraire. Calculons d'abord rationnellement l'effet que dut produire sur le chiffre du cens de la première classe cette double révolution. Lorsqu'au temps de la première guerre punique, le Sénat coupa l'as d'une livre en six as de deux onces[130], cette nouvelle taille do la monnaie de cuivre ne fit rien perdre aux biens de leur valeur réelle. Une fortune d'un citoyen de la première classe, estimée avant l'an 264 av. J.-C. cent mille as d'une livre, dut valoir, après cette opération, six cent mille as nouveaux. Cette variation du prix des biens était purement nominale. Mais, après la guerre, le numéraire en argent afflua en si grande quantité à Rome, qu'un cheval qui coûtait autrefois mille as d'une livre, et qui aurait dû s'acheter six mille as de deux onces, en valut dix mille, représentés par mille drachmes ou deniers d'argent[131]. La valeur relative de toutes choses fut donc augmentée dans la proportion de six à dix, ou de trois à cinq, comme l'ont conjecturé avec raison MM. Zumpt et Bckh ; le bien d'un citoyen de la première classe qui, sans cette hausse générale des prix, eût été porté sur les registres des censeurs pour une valeur de six cent mille as de deux onces, dut y être évalué un million d'as (decies æris). Cette conjecture rationnelle se trouve vérifiée par les chiffres réels que nous voyons inscrits sur les registres des censeurs des années 220-219 av. J.-C. Ces registres sont cités en trois endroits par Tite-Live, qui en a conservé avec précision les dispositions les plus intéressantes[132]. Voici ce qu'il nous raconte d'un tribut extraordinaire levé en 214 av. J.-C., pour l'équipement et l'entretien de la flotte romaine : Comme on manquait de matelots, les consuls, après avoir pris l'avis du Sénat, ordonnèrent que quiconque, sous la censure de L. Æmilius et de C. Flaminius, aurait eu un cens de cinquante mille à cent mille as, lui-même ou son père, et quiconque aurait acquis depuis une fortune pareille, fournirait un matelot avec six mois de solde ; que celui qui aurait été inscrit pour un cens de cent mille à trois cent mille as, donnerait trois matelots avec la solde année ; pour le cens de trois cent mille as à un million d'as, on fournirait cinq matelots ; pour un cens au delà d'un million d'as (supra decies æris), sept matelots ; enfin, chaque sénateur fournirait huit matelots avec la solde d'un an[133]. On remarque d'abord que ces chiffres étaient inscrits sur des registres qui remontent au moins à l'an 219 av. J.-C. Car les censeurs C. Flaminius et L. Æmilius, sont ceux qui rejetèrent les affranchis dans les quatre tribus urbaines[134], et leur censure est mentionnée à la fin de l'épitomé du livre XX[135] de Tite-Live, un peu avant le commencement de la seconde guerre punique, qui s'ouvre avec le livre XXI. Or, les as d'une once de cuivre ne furent taillés qu'en 217 av. J.-C., sous la dictature de Q. Fabius Maximus[136], et pendant qu'Annibal serrait de près Marcus Minucius. Les as marqués sur les registres des censeurs de l'an 219 av. J.-C., sont donc des as de deux onces, dont chacun valait la dixième partie d'un denier d'argent. Par le cens d'un million d'as (decies æris), ils entendaient une valeur de cent mille deniers ou de quatre cent mille sesterces ; c'est précisément le cens équestre de l'époque de Cicéron[137]. Tite-Live nous fait comprendre du reste que, pour les censeurs Æmilius et Flaminius, comme pour les consuls de l'an 214 av. J.-C., l'expression decies æris (un million d'as) ne représentait pas autre chose que le cens équestre lui-même. Il raconte qu'en l'an 21.0 av. J.-C., on eut recours au même expédient qu'en 214, pour compléter et entretenir les équipages de la flotte, et il s'exprime ainsi : On commença à s'occuper du recrutement des rameurs et comme on n'avait en ce temps-là ni assez d'hommes, ni assez d'argent dans le trésor à pour s'en procurer et leur donner une solde, les consuls firent un édit, pour que les simples particuliers donnassent des rameurs, selon leur fortune inscrite au registre du cens et des ordres, comme cela s'était fait auparavant (Ut privati ex censu ORDINIBUSQUE, sicut antea, remiges darent)[138]. Les mots sicut antea ne peuvent être qu'une allusion à la contribution de l'an 214 av. J.-C., puisque jamais auparavant les particuliers n'avaient fait les frais des équipages de la flotte[139]. Tite-Live nous dit qu'alors plusieurs ordres avaient contribué. Mais, si l'on se reporte au chapitre xi du livre XXIV, on ne trouve mentionné dans ce passage qu'un seul ordre, celui du Sénat, dont chaque membre avait fourni huit matelots. La plus forte contribution, après celle des sénateurs, est celle des citoyens ayant plus d'un million d'as de cens, et dont chacun donna sept matelots[140]. Il faut donc, pour expliquer le pluriel ex ordinibus, que les citoyens possédant cette fortune aient représenté aux veux de Tite-Live et des consuls qui firent l'édit de l'an 210 av. J.-C., le second ordre de l'État, l'ordre équestre. Si l'on doutait que ce fût la pensée de Tite-Live, on n'aurait pour s'en convaincre, qu'a lire jusqu'au bout le récit de la contribution de l'an 210 av. J.-C. Le peuple s'irrita des exigences toujours renouvelées du trésor, et avec d'autant plus de raison, que la répartition du tribut de 214 avait été fort injuste, les deux ordres supérieurs avant moins donné proportionnellement que les classes moins riches. Le Sénat s'aperçut qu'il fallait donner l'exemple du désintéressement, et les sénateurs portèrent aux trésoriers de l'État tout leur or, leur argent et leur cuivre monnayé : Ce mouvement unanime du Sénat, dit Tite-Live, entraîna l'ordre équestre, et l'ordre équestre fut imité par la plèbe[141]. Ainsi les ordres qui, d'après cet auteur, contribuèrent en 214 av. J.-C., doivent être les mêmes qu'il nous montre en 210, dans une occasion toute semblable, apportant les premiers leur don patriotique au trésor ; ce furent l'ordre équestre et l'ordre sénatorial. Dans le récit de la contribution de 214, le chiffre d'un million d'as (decies æris) ou de quatre cent mille sesterces, représentant le cens le plus élevé après celui des sénateurs, ne peut convenir qu'au cens des chevaliers. Il suffirait du reste pour arriver à cette conclusion d'admettre qu'un million d'as était en 219 av. J.-C. le cens de la première classe[142]. Car nous avons démontré que ce cens et le cens équestre furent toujours identiques. Ainsi le cens de quatre cent mille sesterces, ou d'un million d'as de deux onces, était déjà celui des chevaliers ou de la première classe, en 219 av. J.-C., au temps de la censure de C. Flaminius et de Lucius Æmilius. On peut en conclure que, les sénateurs fournissant en 214 huit matelots, tandis que les chevaliers, qui avaient plus d'un million d'as (supra decies æris), n'en fournissaient que sept, le cens sénatorial devait être, dès la seconde guerre punique, celui de deux millions d'as ou de huit cent mille sesterces. C'est le chiffre qu'il ne dépassa qu'au temps d'Auguste[143]. Ce prince éleva le cens des sénateurs à douze cent mille sesterces en y ajoutant le troisième million d'as que Juvénal appelle[144] tertia quadringenta (sestertium). CONCLUSIONS.Le cens équestre ou de la première classe était, avant 264 av. J.-C., de cent mille as d'une livre. Par suite de la révolution monétaire qui accompagna la première guerre punique, et de la révolution économique qui la suivit, ce cens fut multiplié par dix, comme le prix de l'equus publicus ; il devint, avant l'an 219 av. J.-C., le cens d'un million d'as de deux onces ou de quatre cent mille sesterces. Les chiffres du cens des antres classes durent s'élever de même, et celui du cens de la seconde classe dut être porté :
Nous allons voir tous ces résultats confirmés par les
dispositions de la loi Voconia. Cette loi fut faite en l'an 168 av.
J.-C., sur la proposition du tribun O. Voconius Saxa, que Caton appuya dans
un discours resté célèbre[145]. Elle était
toute en faveur des hommes et fort injuste à l'égard des femmes[146]. Il y était
défendu à tous ceux que les censeurs auraient rangés au nombre des censi, de choisir pour héritière une femme ou
une jeune fille[147]. Mais ceux qui
n'étaient pas dans cette catégorie des censi
pouvaient prendre leur fille pour héritière[148]. Asconius,
expliquant un des passages de Cicéron où il est question de la loi Voconia[149], dit que le citoyen qui n'était pas census était celui qui
ne possédait pas cent mille sesterces ; car, selon l'usage des anciens,
étaient appelés censi ceux qui avaient déclaré aux censeurs pour cent mille
sesterces de propriétés. C'était cette fortune qu'on appelait un cens.
Cent mille sesterces, c'est-à-dire vingt-cinq mille deniers d'argent ou
drachmes, avaient pour équivalent légal sur les registres des censeurs 250.000
as de deux onces. Ce commentaire d'Asconius est conforme à une disposition de
la loi Voconia, qui nous a été conservée par Dion Cassius, et d'après
laquelle les femmes ne pouvaient hériter d'un bien de plus de vingt-cinq
mille drachmes ou de cent mille sesterces[150]. En effet, les
cens ; étant, selon Asconius, ceux qui possédaient au moins cette valeur, et
se trouvant seuls assujettis à la loi, ceux qui avaient une fortune moindre,
eût-elle été de 90.000 sesterces, c'est-à-dire de deux cent vingt-cinq mille
as de deux onces, pouvaient constituer leur fille héritière[151]. Il paraît même
que la somme de cent mille sesterces ou 250.000 as de deux onces était la
part qui pouvait être léguée à la fille d'un citoyen census. Cicéron nous parle d'un Fadius, qui,
pour éluder la loi Voconia, avait remis son héritage à titre de fidéicommis
à un de ses amis nommé Sextilius. Mais Sextilius qui, d'après sa promesse
mentionnée au testament de Fadius, aurait dît rendre tout l'héritage à Fadia,
la fille du défunt, niait cette promesse, et se disait au contraire engagé
par serment à respecter la loi Voconia. Ses amis, qui ne doutaient pas
que Sextilius ne fit un mensonge, furent obligés de lui conseiller de suivre
la légalité, et de donner à Fadia tout ce qui pouvait lui revenir d'après la
loi Voconienne. Fadia eut donc, comme le dit avec raison Perizonius[152], cent mille
sesterces ou 250.000 as de deux onces, et Sextilius garda le reste qui
formait un héritage considérable[153]. Cette faculté
de faire un legs en faveur d'une fille, était encore bornée par un autre
article de la loi, qui défendait à un citoyen census
de laisser plus à ses légataires qu'à ses héritiers[154] ; de sorte que
le père, qui aurait eu précisément la fortune de cent mille sesterces, n'en
pouvait léguer à sa fille que la moitié. La loi Voconia devient très-claire lorsqu'on admet les chiffres que nous avons établis pour le cens de l'époque des deux dernières guerres puniques. Un citoyen de la première classe qui avait un million d'as ou quatre cent mille sesterces, ne pouvait léguer à sa fille que le quart de sa fortune, s'il avait un autre enfant. Un citoyen de la seconde classe qui avait sept cent cinquante mille as ou trois cent mille sesterces, ne pouvait lui en léguer que le tiers. Un citoyen de la troisième classe qui avait cinq cent mille as ou deux cent mille sesterces, ne pouvait lui en léguer que la moitié. Un citoyen de la quatrième classe qui avait deux cent cinquante mille as ou cent mille sesterces, ne pouvait lui en léguer que la moitié, parce que sa fille était légataire et non héritière, et que, dans la succession d'un census, les légataires ne pouvaient avoir plus que les héritiers. Dans aucun cas la fille d'un census, c'est-à-dire d'un citoyen d'une de ces quatre premières classes, ne pouvait être héritière. Le legs qu'elle pouvait recevoir ne devait dépasser ni la moitié de l'héritage total, ni la somme fixe de cent mille sesterces[155] si elle n'était pas fille unique. Quant aux citoyens de la cinquième classe, qui ne possédaient qu'un bien de cent vingt-cinq mille à deux cent cinquante mille as, c'est-à-dire de cinquante initie à cent mille sesterces, ils n'étaient regardés que comme possesseurs d'une demi-fortune[156], d'un demi-cens ; ils n'étaient pas censi, quoiqu'ils fussent hommes des classes (classici)[157]. Ils n'étaient pas soumis à la loi Voconia et pouvaient instituer leur fille héritière de tout leur bien, quand même ce bien eût été estimé 90 mille sesterces. Si l'on suppose au contraire ; comme MM. Bckh et Zumpt, qu'au temps des deux dernières guerres puniques, le chiffre du cens de la première classe était seulement de cent mille as de deux onces, ou de quarante mille sesterces, nième si on l'élève avec Aulu-Gelle à cent vingt-cinq mille as ou à cinquante mille sesterces[158], la loi Voconia, faite en l'an 168 av. J.-C., devient tout à fait incompréhensible. Comment un législateur, qui voulait restreindre les héritages des femmes, qui même, selon Cicéron, avait été à leur égard d'une révoltante injustice, leur aurait-il permis d'hériter jusqu'à vingt-cinq mille deniers oh deux cent cinquante mille as de deux onces, si cette somme eût été au moins double de la valeur d'une fortune de première classe ? A qui d'ailleurs cette loi s'appliquait-elle ? aux censi, c'est-à-dire, d'après Asconius, à ceux qui avaient plus de cent mille sesterces ou de deux cent cinquante mille as. Ceux qui avaient moins en étaient exempts. Dans l'hypothèse des érudits allemands, les quatre dernières classes et même une grande partie de la première eussent échappé à la loi. La fille unique étant favorisée, la loi ne s'appliquait dans sa plus grande rigueur qu'aux successions à recueillir par plusieurs enfants[159]. Un père qui avait cinq cent mille as de fortune à partager entre un fils et une fille, n'était pas fort embarrassé pour rétablir entre eux l'égalité. Il en était quitte pour léguer à sa fille cent mille sesterces, comme la loi le permettait. Ainsi la loi Voconia, si le cens de la première classe eût été de cent mille as, n'eût produit d'effet possible que dans le partage des successions qui eussent valu plus que le double du cens de la première classe, et d'effet certain, que dans le partage de celles qui auraient été plus de cinq fois plus considérables. On ne peut supposer que Caton cid dépensé sou éloquence pour faire voter une loi qui n'aurait obligé presque personne, et dont l'application eut été un fait exceptionnel, comme le serait en France, celle d'une loi qui dérangerait l'égalité, des partages entre les enfants de millionnaires. Expliquons comment Aulu-Gelle a fait, sur le discours de
Caton pour la loi Voconienne, un contresens qui a obscurci toute une partie
de l'histoire romaine. Dans ce discours ; il devait être question des censi, c'est-à-dire des citoyens des quatre premières
classes qui étaient soumis à la lui ; des classici,
c'est à-dire des citoyens des classes y compris ceux de la cinquième que la
loi Voconia n'obligeait pas parce qu'ils n'étaient pas censi ; enfin des citoyens infra classem, c'est-à-dire des ararii placés dans les
sous-classes[160]
et qui étaient aussi exemptés de cette loi. La signification des mots classicus et infra
classem était oubliée à l'époque d'Adrien, et dans les écoles, où
l'on expliquait le discours de Caton, les grammairiens avaient l'habitude
d'agiter celte question (quæri solet)[161]. Aulu-Gelle
était personnellement fort ignorant de l'histoire de l'ancien droit romain,
et, dans ses promenades, il s'adressait pour comprendre la loi des
Douze-Tables, à des jurisconsultes qui ne la comprenaient pas plus que lui,
et qui s'excusaient en disant que, pour l'interpréter, il faudrait avoir
étudié le droit des Faunes et des Aborigènes[162]. C'est au
milieu d'un siècle si étranger aux vieilles institutions de Les hommes des classes (classici) n'étaient pas tous ceux qui étaient dans les classes, mais seulement ceux de la première classe, qui avaient un cens de cent vingt-cinq mille as ou plus. On appelait infra classem ou citoyens placés en sous-classe, ceux de la seconde classe et de toutes les autres classes, qui avaient un cens moindre que celui que je viens d'indiquer. J'ai écrit cette note sommaire, parce que dans le discours de M. Caton par lequel il soutint la loi Voconia, on a l'habitude de se demander ce que signifient classicus et infra classem. Ce contre-sens a passé de là dans tous les historiens modernes de Rome, et jusque dans le livre de M. Mommsen[164], et l'on s'en aperçoit à l'embarras de toutes les traductions du mot classem. On ne voit pas pourquoi ce terme qui signifie les citoyens classés, se serait appliqué en particulier à la première classe et non aux autres. Cette restriction du sens n'est point naturelle ; elle a été imaginée par Aulu-Gelle, et l'analyse de la loi Voconia nous a prouvé qu'elle n'était pas exacte. Aulu-Gelle lui-même, lorsqu'il n'a pas à expliquer un
passage embarrassant, rend au mot classicus
son sens naturel et véritable. Il emploie[165] les expressions
classicus assiduusque[166] aliquis scriptor, non proletarius pour désigner
un auteur d'une assez bonne latinité ; et l'on pourrait traduire ainsi cette
comparaison : Un écrivain qui appartienne au moins aux
classes ou aux sous-classes, et non au prolétariat de la littérature.
Festus[167]
définit aussi les témoins nommés classici,
non pas des témoins de la première classe, mais des témoins qui ont quelque
fortune et qui sont dignes de foi. Le mot classici s'appliquait donc aux citoyens des cinq classes, et 125.000 as, minimum de la fortune d'un classions en 168 av. J.-C., étaient la limite inférieure du cens de la cinquième classe. Comme l'erreur d'Aulu-Gelle est venue d'une confusion entre les chiffres de l'époque antérieure à la première guerre punique, et ceux de l'époque qui l'a suivie, nous avons distingué dans deux tableaux successifs, les classes, sous-classes et catégories inférieures des citoyens, et nous avons mis en regard les différents chiffres représentant à chacune de ces deux époques, la moindre fortune des citoyens qui s'y trouvaient rangés[168]. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||