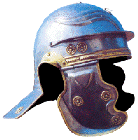HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS
TOME I
INTRODUCTION.
|
QUATRIÈME ÉPOQUE. — 400-366 ANS AVANT JÉSUS-CHRIST. Malgré l'indépendance légale que le tribunat assurait à la
plèbe, on ne voit pas que la puissance politique des patriciens en ait été
diminuée an premier siècle de Mais les conquêtes des Romains allaient bientôt rompre l'équilibre en faveur de la plèbe de la campagne. A mesure que le territoire romain s'agrandit, le nombre des tribus rustiques augmenta, et ce qui honore le tribunat, ce qui justifie sa puissance, c'est que ses intérêts fussent liés à ceux de la- grandeur romaine. Les tribuns de la plèbe[1] provoquaient l'extension du droit de cité que le Sénat cherchait à restreindre, parce qu'ils sentaient que tous les nouveaux citoyens accroissaient la force de la plèbe rustique et le nombre des rivaux de l'aristocratie urbaine. Aussi les progrès de la puissance politique des plébéiens ont-ils suivi de près la première conquête importante des Romains, celle de Véies et de son territoire. Quatre nouvelles tribus rustiques sont formées, en 386 avant Jésus-Christ, sur le territoire véien, et en 376 avant Jésus-Christ, arrivent au tribunat Licinius Stolon et L. Sextius qui, après dix ans de lutte, finissent par obtenir le partage du consulat. Il faut observer ici que ces tribuns connaissaient trop bien l'organisation aristocratique de l'assemblée centuriate, pour se contenter de la simple éligibilité au consulat. Ils obtinrent qu'un des deux consuls fût toujours un plébéien. Autrement on n'eût donné aux chefs de la plèbe, en les admettant au nombre des candidats, que le droit de s'exposer à des échecs certains. La constitution de 509, œuvre des patriciens, eût suffi pour empêcher leurs rivaux de parvenir. Le siège et la prise de Véies, qui préparaient pour l'avenir la prépondérance de la campagne sur la ville, de la plèbe sur le patriciat, furent accompagnés d'une tentative remarquable de sécession, et d'une révolution à la fois politique et, militaire dans l'organisation de la chevalerie. La proposition de transporter la capitale politique de Rome à Véies fut faite deux fois aux tribus par les tribuns de la plèbe, en 393 et en 387 avant Jésus-Christ. Elle n'eut pas pour cause la difficulté de reconstruire Rome, incendiée par les Gaulois, puisqu'elle fut discutée pour la première fuis sur le Forum, deux ans avant la bataille de l'Allia. Que pouvait donc signifier un tel projet, quand Rome entière était debout ? Proposa-t-on jamais à tout un peuple de quitter ses foyers, ses temples, ses champs, ses tombeaux, toutes ses habitudes civiles. politiques, religieuses, pour se transporter dans une ville conquise, lût-elle beaucoup plus belle que la sienne ? Oui eût réglé tant de mutations de domicile et .de., propriété ? Et qu'eut-on fait de la ville abandonnée ? L'idée de cette émigration en masse suppose de plus que Véies était restée entièrement vide depuis la prise de cette ville par Camille (395), et que les Romains en avaient exterminé ou vendu tous les habitants. Comme la proposition fut renouvelée, en 387 avant Jésus-Christ, cette magnifique solitude de Véies alliait été inoccupée pendant huit ans. Les pauvres de Rome et de Mutule se seraient abstenus pendant huit ans de s'emparer de tant de maisons sans propriétaires et de tant de champs ut de jardins abandonnés. Ils auraient attendu pour le faire que le peuple romain, régulièrement convoqué, ou bien adoptât le plan du tribun Sicinius, ou se laissât persuader par les arguments du dictateur Camille. Enfui, le plan d'un partage égal de la population et du Sénat de Rome entre les deux villes réunit, à toutes les impossibilités d'une émigration en masse, celle du maintien de l'unité politique dans des conditions où elle devait être infailliblement brisée. Un récit qui mène logiquement à des hypothèses absurdes ne peut pas titre admis dans l'histoire. Les tribuns de la plèbe connaissaient trop bien les
patriciens pour leur demander de quitter leur Capitole, leurs trente curies,
leurs cultes privés et publics, tous les souvenirs de leur race, toutes les
traditions qui étaient le fondement de leur puissance ; et si Camille eût
voulu démontrer au peuple, comme il le fait dans Tite-Live, que cette
désertion était impossible, il eût pris une peine superflue. Les tribuns ne
songeaient pas à enlever à la ville de Rome sa population de Quirites. Les
Fabius auraient pu continuer à sacrifier sur le Quirinal, les féciaux romains
à cueillir les verveines sacrées du Capitole. Mais la plèbe rustique,
étrangère au peuple quiritaire, et au droit religieux des gentes, aurait transporté à Véies son marché
des nundines, et reconnu la protection de Le Sénat, d'ailleurs, avait trouvé moyen, pendant le siège de Véies, de s'attacher par des liens nouveaux les chefs de la plèbe. Tous ceux qui avaient le cens équestre sans avoir reçu un cheval de l'État, c'est-à-dire les citoyens des quatre-vingts centuries de fantassins de la première classe dont la fortune était estimée cent mille livres de cuivre[3], vinrent offrir de servir avec des chevaux achetés à leurs frais (400 avant Jésus-Christ). Désormais, les quatre-vingt-dix-huit centuries[4] de la première classe ne se composèrent plus que de chevaliers. Les dix-huit premières étaient les dix-huit centuries de chevaliers equo publico ; les quatre-vingts dernières étaient les centuries de chevaliers equo privato. Les chevaliers equo privato
remplacèrent les chevaliers equo publico
comme cavaliers légionnaires. La solde venait d'être instituée. Chaque
cavalier romain en reçut une triple de celle du fantassin. Elle était par
jour d'un as d'une livre de cuivre, ou de 365 as par an. Le questeur
fournissait encore au cavalier romain pour son cheval un modius d'orge par jour (dix litres, un à deux décilitres), c'est-à-dire par an 372
décalitres. Enfin, comme le cavalier avait le droit de mener à la guerre avec
lui deux esclaves, sa ration de blé était triple de celle du fantassin. Le
fantassin recevait par mois de 9.9 à Cette libéralité du trésor envers les chevaliers equo privato disposait toute la première classe à favoriser les intérêts du Sénat. A la solidarité des intérêts se joignit bientôt celle de l'orgueil aristocratique. Une noblesse équestre se forma depuis l'an 400 avant Jésus-Christ à côté de la noblesse sénatoriale, parce que le titre de chevalier, attaché désormais à la fortune de cent mille as d'une livre, devint héréditaire comme elle. Si, le fils d'un chevalier equo privato n'avait plus autant de fortune que son père, il conservait l'honneur et l'avantage de servir dans la cavalerie. Il ne perdait que les privilèges politiques attachés à la possession réelle du cens équestre de cent mille as, c'est-à-dire le vote dans la première classe. Les dix-huit centuries de chevaliers equo publico, depuis l'an 400 avant Jésus-Christ, cessèrent d'être divisées en escadrons de trente hommes (turmæ), et de faire le service régulier des légions. Elles devinrent un état-major dont, les membres s'attachaient individuellement à la personne des consuls, des lieutenants des consuls, et des tribuns des soldats. Sur le champ de bataille ils se tenaient hors des rangs avec la cohorte qui entourait le chef de guerre. Dans le camp, une place était réservée à cette chevalerie d'élite auprès de l'élite de la cavalerie extraordinaire des alliés. Les chevaliers equo publico étaient aussi désignés sous le nom d'amis et de compagnons de tente des généraux et des tribuns militaires. Leur service, depuis l'an 400 avant Jésus-Christ, étant
devenu en quelque sorte volontaire, les trois cents sénateurs purent,
quoiqu'ils eussent tous achevé les dix ans de service exigés par la loi,
garder le cheval que l'État leur avait payé, pour faire de temps en temps une
campagne extraordinaire. En conservant le titre de chevaliers equo publico, les sénateurs s'assuraient
l'avantage politique de voter personnellement à côté de leurs fils dans les
six premières centuries équestres, qui étaient les six prérogatives. A
l'époque de la mort de Scipion Émilien, en 129 avant Jésus-Christ, ils
conservaient encore le privilège de garder leur cheval, qui semble leur avoir
été enlevé par Caïus Gracchus. Les six centuries, ou les six suffrages,
portaient pour cette raison le nom de suffrages du Sénat (suffragia Senatus),
et les douze cents chevaliers qui les composaient ; appartenant tous à la
noblesse sénatoriale, se distinguaient par l'insigne sénatorial de l'anneau
d'or. C'est seulement au dernier siècle de Les chevaliers des dix-huit centuries n'étant pas comptés, depuis l'an 400 avant Jésus-Christ, dans les cadres réguliers des légions, ne recevaient point de solde. L'État continuait, comme il avait fait depuis Servius, à leur donner mille as d'une livre de cuivre pour acheter un cheval, et deux cents as par an pour le nourrir. Ces deux subventions, appelées æs equestre et æs hordearium, étaient fournies par les biens des veuves et des orphelins qui étaient inscrits à part sur les registres du cens. Les tributs ordinaires étaient employés à la solde des troupes faisant le service régulier. Le service dans les dix-huit centuries était donc plutôt un honneur qu'un avantage matériel, ne convenait qu'aux riches, qui allaient à la guerre pour satisfaire un goût noble, ou aux jeunes gens, qui entraient dans les rangs d'une milice brillante pour s'ouvrir la carrière des hautes magistratures. |