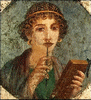LA FEMME ROMAINE
SECONDE PARTIE. — LA FEMME PENDANT LES DERNIERS TEMPS DE LA RÉPUBLIQUE ET SOUS L'EMPIRE
CHAPITRE QUATRIÈME. — QUELQUES MOTS SUR LE RÔLE LITTÉRAIRE, ARTISTIQUE ET SCIENTIFIQUE DES FEMMES ROMAINES.
|
Influence de la Romaine sur les œuvres de l'intelligence. — Pourquoi il y eut peu de poétesses et d'artistes à Rome. — La muse au foyer. Cornificia, Périlla, Argentaria Polla. — Les hétaïres romaines. Lesbie, Cynthie, Corinne, Délie. — Sempronia. — Sulpicia. — Romaines artistes, médecins, philosophes. — Marcia. — Femmes orateurs. Amæsia Sentia. Hortensia. — Les compagnes des orateurs. Calpurnie, femme de Pline le Jeune. Il est une sphère cependant on, même à l'époque de la décadence morale, la Romaine parait avoir exercé une influence plus souvent salutaire que nuisible : c'est cette sphère des œuvres intellectuelles qui, lorsque les passions mauvaises ne la troublent pas, dégage rame de ses liens terrestres, et l'élève, sans qu'elle le sache toujours, vers le Dieu principe des idées éternelles. Disons tout d'abord que les filles du Tibre n'apparaissent que rarement dans les annales littéraires ou artistiques. Nous pourrions en trouver une raison dans le caractère romain qui était essentiellement pratique, et qui ne s'éleva jamais à l'idée du beau que par l'imitation des modèles grecs : or la femme est plus souvent entrainée aux œuvres intellectuelles par l'imagination que par l'étude ; et l'imagination de la Romaine n'était pas naturellement inspirée. Mais là toutefois ne fut pas le principal motif qui éloigna la femme romaine du champ des lettres et des arts. Les quelques familles qui gardaient le vieil esprit romain ne devaient pas se plaire à voir leurs filles attirer sur elles l'attention publique. Quant aux femmes qui avaient été élevées au milieu des idées nouvelles et initiées aux arts de la Grèce, la plupart d'entre elles n'avaient dû recevoir qu'une instruction superficielle qui ne les prémunissait pas contre les envahissements du luxe et les entraînements d'une vie frivole et souvent coupable. Le plaisir était leur unique occupation. Quelques-unes de ces femmes légères eurent, il est vrai, le goût de la poésie ; mais nous verrons bientôt de quelle nature fut alors leur influence littéraire. Les Romaines qui, tout en se distinguant par leurs talents, furent aussi de dignes matrones, doivent donc être cherchées dans les rares maisons où la pratique des anciennes vertus n'excluait pas ce que les progrès de la civilisation avaient de meilleur. Au sujet des poétesses, nous remarquerons toutefois que, de même que l'ancienne matrone n'agissait sur les affaires de l'État que par son influence domestique, de même aussi la muse féminine n'apparait le plus souvent chez les Romains qu'à l'ombre du foyer, soit qu'elle célèbre les tendresses de la famille, soit qu'elle s'associe aux poétiques labeurs d'un frère ou d'un mari. Peut-être n'était-ce qu'à l'une ou à l'autre de ces conditions que l'honnête femme pouvait se faire un nom dans les lettres... Les documents originaux nous manquent malheureusement pour apprécier les œuvres de ces poétesses. Quelques vers de Sulpicia, c'est là tout ce qu'elles nous ont laissé. Nous ne connaissons généralement ces femmes que par les rares détails que l'histoire littéraire nous a transmis sur elles. L'une des plus anciennes poétesses dont les traditions romaines nous aient gardé le souvenir est Cornificia, sœur d'un vaillant guerrier qui vécut au temps d'Auguste. Lui aussi était poète, et l'on dit que les chants médités par lui avaient reçu de sa sœur la forme à laquelle ils durent de figurer parmi les meilleurs poèmes contemporains. Cornificia produisit sous son nom de remarquables épigrammes. Elle avait coutume de dire que l'instruction était la seule chose dans laquelle la fortune ne pût enfoncer ses traits[1]. Cornificius était fier de sa sœur. Comme un opulent citoyen lui reprochait de n'avoir qu'un mince patrimoine, le poète-soldat, ne paraissant se souvenir ni de la valeur ni du talent qui le distinguaient et qui étaient de précieuses richesses, répondit avec un fraternel orgueil : Je prétends que mon nom est celui d'un heureux, parce que j'ai une sœur très-honorée dans toute l'Italie, tandis que tu as une femme très-déshonorée dans toute la ville[2]. Une autre poétesse nous est révélée par Ovide : son élève Périlla qui, dit-on, fut sa fille, ou même, sa femme[3], et dont il célèbre la vertu et le génie poétique. Exilé, il l'exhorte à ne pas abandonner le culte des Muses, ce culte qui survit à la jeunesse, à la beauté, à la fortune. Ce bien, du moins, lui restera au jour fatal où elle entendra dire : Elle fut belle ![4] Mais quelle direction morale Ovide donna-t-il au talent de Périlla ? Sans doute, s'il était le père de son élève, il dut respecter au moins ce titre sacré que l'être le plus pervers craint souvent de profaner. Du fond de son exil, Ovide engage même la jeune poétesse à ne jamais écrire de ces chants d'amour qui lui ont été si funestes à lui-même. Seulement nous avons le regret de constater que ce n'est pas l'horreur du mal qu'il cherche à lui inspirer ici : c'est la crainte du châtiment. Nous ne pouvons donc savoir quelles furent les tendances morales que manifesta, dans ses vers, une élève d'un maître aussi peu scrupuleux qu'Ovide. La femme de Lucain, Argentaria Polla, nous est mieux connue que Périlla. Issue d'une noble maison ; possédant, avec la beauté, la grâce qui est à celle-ci ce que le parfum est à la fleur ; unissant à l'instruction, la simplicité qui en dénote l'étendue et en redouble la valeur, Polla se servit de la langue poétique et composa des épigrammes. Mais, s'oubliant elle-même, elle donna son talent à l'époux qui avait déjà son cœur et sa vie : elle aida Lucain à corriger les trois premiers chants de la Pharsale[5]. Le poète reconnut-il ce service dans les vers qu'il consacra à sa femme[6] et qui sont aujourd'hui perdus ? Lucain était bien jeune encore lorsqu'il fut ravi à l'affection de Polla. Il avait conspiré contre Néron ; et bien que, pour se cramponner à la vie, il eût indignement dénoncé sa propre mère, il avait retrouvé, à l'heure de la mort, le courage de ses héros[7]. Polla demeura fidèle au souvenir de son mari. Ce fut à sa prière que Stace chanta le jour natal de Lucain ; et ce fut probablement aussi pour lui complaire que Martial écrivit de petits poèmes sur le même sujet[8]. Quelle que puisse être la sévérité de la critique pour la Pharsale, ce monument littéraire que déparent souvent la fausseté du jugement et du goût, la déclamation et l'emphase de la forme ; cependant les nobles pensées que contient aussi cette œuvre tant discutée ne nous font pas regretter qu'une main féminine y ait travaillé. Ce labeur n'était pas indigne d'une chaste matrone au style élégant et grave. Polla dont Martial redoutait à bon droit la sévérité pour la licence de ses vers, Polla à qui il donnait le titre majestueux de reine[9], Polla n'eût sans doute pas voulu apporter à de voluptueux peules le concours de son talent. Certaines autres conseillères des pates latins, la Lesbie de Catulle, la Cynthie de Properce, cette brillante Cynthie qui, toutefois, poète elle-même, eut la gloire d'être consultée non-seulement par Horace et par Properce, mais encore par le chaste Virgile ; la Corinne d'Ovide et la Délie de Tibulle, ne durent, en général, dicter à leurs adorateurs que les chants de l'amour païen ; mais aussi ces femmes, toutes ou presque toutes Romaines cependant, n'étaient que les rivales des hétaïres grecques, tandis qu'Argentaria Polla était une austère matrone. Jusqu'à présent, nous avons vu dans la poétesse romaine, ou la sœur, ou la fille, ou la femme d'un autre poète ; ou bien, — et ceci n'est pas son aspect le plus favorable, — l'inspiratrice de l'homme aimé. Une patricienne, Sempronia, se présente à nous sans aucune de ces poétiques alliances. Nous ne nous arrêterons pas ici devant cette femme, instruite dans les lettres grecques et latines, mais dont nous ne connaissons les productions littéraires que par ces mots de Salluste : Elle savait faire des vers[10]. Nous retrouverons au chapitre suivant cette Romaine qui eût mieux fait de cultiver ses facultés poétiques que de devenir par ses crimes la complice de Catilina. Il aurait fallu toutefois alors que les œuvres de Sempronia fussent dignes d'une matrone, d'une patricienne, d'une Romaine ; et nous ne savons si, avec des penchants tels que les siens, elle eût pu devenir facilement une muse du foyer. Une vertueuse matrone, Sulpicia, la plus célèbre femme-poêle de Rome, nous apparaît aussi sans que nous voyions auprès d'elle un autre poète aux travaux de qui elle se soit associée. Calénus, sou mari, était philosophe. Mais Sulpicia consacra surtout son talent à l'expression de l'amour conjugal ; et si, un jour, elle parut s'abandonner à une autre inspiration que celle du foyer domestique, ce fut pour flétrir Domitien, le tyran qui chassait de Rome les philosophes : c'était donc encore la femme qui parlait ici en Sulpicia, c'était l'épouse de Calénus. La satire que composa alors Sulpicia, étant le seul ouvrage authentique d'après lequel nous puissions juger son talent, et cet ouvrage étant le seul qui nous soit resté des poétesses romaines, nous ne pouvons omettre de le traduire dans un livre consacré à la femme. Muse, permets-moi de faire un récit à l'aide de quelques-uns de
ces mots par lesquels tu passes en revue les nombreux héros et leurs combats.
Car je me suis réfugiée en toi ; avec toi, repassant mystérieusement un
dessein dans mon esprit. Donc plus de rapide vers phaleuce, plus de trimètre
ïambe, plus de ce vers qui, en brisant son pied, apprit du prince de
Clazomène[11] à s'irriter fortement.
J'abandonne à jamais aussi ces mille jeux par lesquels, la première,
j'enseignai aux Romaines à lutter avec les Grecques et à varier de nouvelles
railleries. Et toi, la première et la plus éloquente des Muses, je viens vers tes sentiers ; descends aux prières de ta cliente et exauce-les. Dis-moi, Calliope ; que prépare le maître des dieux ? Veut-il
changer la terre et le cours des siècles dévolus à la patrie ? Ces arts
qu'autrefois il nous donna, nous les arrachera-t-il quand nous allons mourir
? Et, tels que nous nous levâmes dans le premier âge du monde, nous
ordonnera-t-il d'être muets, et encore privés de raison ; et de nous courber
de nouveau sur les glands et l'oncle pure ? Demeurera-t-il un ami pour le
reste de la terre et les autres villes, mais bannira-t-il la race des
Ausoniens, les nourrissons de Romulus ? Que médite-t-il donc ? Il est deux causes par lesquelles Rome éleva sa tête superbe : la
force dans la guerre et la sagesse dans la paix. Mais cette force, exercée à
l'intérieur et dans les guerres sociales, se répandit dans les mers de Sicile
et sur les remparts de Cartilage, et emporta les autres empires et le monde
tout entier à la fois. Ensuite, comme le vainqueur qui, seul dans le stade
achéen, languit et consume sa force immobile ; ainsi, la main romaine, dés
qu'elle eut cessé de lutter et qu'elle eut retenu la paix par de longues
rênes, elle-même révisant chez elle les lois et les inventions grecques,
demandant à dessein tous les fruits des guerres, à la terre et à la mer, elle
régna par la sagesse et la douce raison. C'est par celles-ci qu'elle se
maintenait ; sans celles-ci elle ne pouvait subsister ; ou Jupiter
eût été jugé menteur pour avoir dit autrefois à une épouse trompée[12] : Je leur ai donné
l'empire du monde. Maintenant donc celui qui gouverne les affaires romaines.....
tout pâle de
gloutonnerie, chasse l'étude, le savant renom et la race des sages, et leur
ordonne de sortir de la ville. Qu'allons-nous faire ? Nous avons abandonné
les Grecs et les villes des sages, afin que la cité romaine fût, plus que
celles-ci, instruite par les maîtres. Maintenant, comme devant l'impétueux
Camille Capitolin les Gaulois s'enfuirent en laissant leurs glaives et leur
balance, ainsi l'on dit que, de notre patrie, sont dispersés des vieillards,
et qu'eux-mêmes détruisent leurs livres comme un fardeau funèbre. Donc le
Scipion des Numantins et des Lybiens s'est trompé quand il a grandi sous le
maître qui l'a formé à Rhodes ; et ainsi des autres, cette troupe d'hommes
éloquents, heureux à la guerre ? Parmi ceux-ci, la sagesse divine du vieux
Caton se demandait si la race romaine ne subsisterait pas bien plutôt par les
revers que par les succès. Certes, par les revers. Car, lorsque l'amour de la
patrie, une épouse captive au sein de ses Pénates, invitent les hommes les
défendre par les armes, ceux-ci se réunissent comme,
sous la voûte du temple de Monéta, la foule de ces insectes dont les
corselets fauves sont hérissés de dards. Mais l'abeille recommence-t-elle à
être tranquille, le peuple et la mère, oublieux de leurs rayons, succombent à
un épais sommeil. De même une longue et lourde paix est la mort des fils de
Romulus. Ainsi cessa mon récit. Muse excellente, sans laquelle il n'y aurait pour moi aucun plaisir à vivre, avertis nos sages que, de même qu'autrefois, alors que Smyrne tomba sous les coups des Lydiens, ils veuillent maintenant émigrer ; ou, en ta qualité de déesse, cherche-leur quelque autre ressource. Seulement éloigne de l'esprit de Calénus les murailles romaines, et, en même temps, l'agréable pays sabin. Tel fut mon discours. Alors la déesse me jugea digne de quelques mots, et commença ainsi : Renonce à ces justes plaintes, mon adoratrice. Une somme de haine menace le tyran, et, à mon honneur, il périra. Car j'habite avec Égérie au milieu des lauriers et des sources de Numa, et je me ris de ses vaines entreprises. Vis, adieu ; cette noble douleur est réservée à la renommée : le chœur des Muses te le promet ainsi que l'Apollon romain[13]. Sous une plume masculine, la généreuse indignation qui inspire l'épouse de Calénus eût peut-être trouvé une expression plus virulente ; mais il ne nous déplaît pas de voir qu'une femme ne se soit pas complètement abandonnée à l'allure d'un Juvénal, et qu'elle ait manié avec quelque modération le fouet de la satire. Cette revendication des droits de l'intelligence opprimée ne manque d'ailleurs ni de fierté, ni d'énergie. C'est avec un véritable sentiment patriotique que Sulpicia comprend ce que les salutaires labeurs de l'esprit ajoutent à la grandeur d'une nation. Elle caractérise avec une éloquente précision les traits auxquels la Rome antique dut sa puissance : la force dans la guerre, et la sagesse dans la paix. Rien de mieux trouvé que l'image de cette main romaine qui cesse de lutter et retient la paix par de longues rênes. Nous en dirions volontiers autant de la comparaison de l'athlète qui dévore sa force dans l'inaction : mais elle ne nous semble pas tout à fait ici à sa véritable place, puisque Sulpicia la rapporte à un temps où, pour employer les expressions de la poétesse, Rome devait encore sa puissance à la sagesse dans la paix, et fécondait par son travail les fruits des guerres. Sulpicia interpréta dignement Caton l'Ancien lorsqu'elle dit après lui que les Romains s'amolliraient par les victoires qui endorment souvent la vigilance nationale, mais qu'ils se fortifieraient par les défaites qui réveillent si puissamment l'amour de la patrie et du foyer menacés. Il y a dans les vers de Sulpicia une consolation et un enseignement pour les peuples en deuil. Quant au poème de Sulpicia sur l'amour conjugal, nous ne le connaissons que par l'éloge que Martial en a fait dans l'épigramme suivante : Qu'elles lisent toutes Sulpicia, les jeunes filles qui ne désirent plaire qu'à un seul époux. Qu'ils lisent tous Sulpicia, les maris qui ne veulent plaire qu'à une seule femme. Elle ne chante pas la fureur de Médée ; elle ne raconte pas le barbare repas de Thyeste ; elle ne croit pas que Scylla et Byblis aient existé. Mais elle enseigne les chastes et pieuses amours, leurs jeux, leurs délices, leurs badinages. Celui qui estimera ses chants à leur juste valeur, dira que nulle ne fut plus espiègle, que nulle ne fut plus chaste. Tels, je crois, furent les jeux d'Égérie sous l'antre humide de Numa, Avec cette condisciple ou cette maîtresse, tu eusses été plus instruite, Sappho, et tu eusses été pudique. Cependant si le dur Phaon vous avait vues au même temps et ensemble, il eût aimé Sulpicia ; mais en vain. Car, ni pour être la femme de Jupiter, ni pour être l'amante de Bacchus ou d'Apollon, elle ne survivrait à Calénus si celui-ci lui était enlevé[14]. Sulpicia n'eut pas à subir l'épreuve du veuvage. Après une union de quinze années, elle mourut avant Calénus, et Martial put dire au veuf : Tu as vécu trois lustres, Calénus : la somme de toute ta vie est là ; car tu ne comptes que les jours vécus par le mari[15]. Suivant Ausone, Sulpicia aurait été moins pudique dans ses écrits que dans sa vie. La satire qui nous reste d'elle ne peut nous renseigner à cet égard. Martial, il est vrai, fait de Sulpicia le poète des chastes et pieuses amours mais Martial qui dédie aux matrones et aux vierges le cinquième livre de ses Épigrammes, livre moins indécent que les autres, mais non pas exempt de souillures, Martial n'a point la qualité requise pour délivrer à un écrit un certificat de chasteté. Nous pourrions mime conjecturer, d'après l'éloge qu'il fait de cet ouvrage, que si la célèbre poétesse ne parla que de l'amour conjugal, ce ne fut pas toujours avec cette sévérité et cette réserve que commandait chez les vieux Romains le respect du foyer. Mais ce n'est là qu'une induction qui ne peut nous faire accepter avec certitude le témoignage d'Ausone. Nous voudrions même que celui-ci se fût trompé, et nous aimerions à ce que la vertueuse Sulpicia eût gardé dans les lettres l'attitude si réservée avec laquelle Marcia, fille de Varron, se présente dans le domaine des arts. Marcia qui, versée dans la littérature, était à la fois peintre et sculpteur, ne voulut jamais, dit-on, peindre les hommes, ni sculpter les nudités qui eussent révolté sa pudeur féminine[16]. A Rome, aussi bien qu'en Grèce, la lyre accompagnait le chant du poète. L'harmonie musicale et l'harmonie poétique se confondaient ici. Nos poétesses étaient donc citharistes. Quelques Romaines furent initiées à la science médicale[17]. La philosophie eut aussi à Rome ses adeptes féminines. Cornélie, mère des Gracques, cette grande Cornélie dont l'imposante figure historique nous occupera bientôt ; et une autre Cornélie, la dernière épouse de Pompée, étudièrent les sciences spéculatives. Cérellia, amie de Cicéron, aimait avec une telle passion les ouvrages philosophiques, que fût-ce au prix d'une indiscrétion, elle se procurait ceux de l'illustre Romain avant qu'ils ne fussent livrés à la publicité[18]. D'autres femmes s'illustrèrent sous le titre de stoïciennes ; toutefois elles paraissent avoir plutôt mérité ce nom par les exemples de leur vie et de leur mort que par leurs études ou leurs méditations. A Rome d'ailleurs le stoïcisme fut moins considéré comme une doctrine philosophique que comme un parti politique ; et ce fut sous ce dernier aspect qu'il obtint les honneurs de la persécution. Nous ne parlerons donc des stoïciennes que dans le chapitre suivant, qui traitera du rôle historique joué par les matrones. Parmi les annalistes de Rome, nous trouvons une femme : Agrippine, mère de Néron. Cette princesse avait écrit, sur sa vie et sur les malheurs de sa famille, des Mémoires que Tacite consulta[19], mais qui sont malheureusement perdus pour nous. Nous ne devons pas oublier ici la généreuse femme à qui les Romains durent la préservation d'une œuvre historique, également perdue pour nous. Dans ses Annales, Crémutius Cordus avait loué Brutus, et nommé Cassius le dernier des Romains. Accusé de lèse-majesté par Séjan, son ennemi, Cordus se laissa mourir de faim. Son œuvre fut condamnée à être brûlée. Cordus avait une fille qui tenait de lui le goût des lettres. Elle se nommait Marcia. Alors que pleurer une victime de Séjan était considéré comme un crime, Marcia ne cacha pas sa tristesse. Mais elle ne se borna pas à. de stériles regrets. Elle déroba aux flammes l'œuvre paternelle ; et quand des jours meilleurs vinrent à luire, la fille de Crémutius Cordus rendit aux Romains le livre sur lequel avait veillé sa piété filiale[20]. Marcia a un double titre pour figurer dans cette rapide étude du rôle intellectuel que jouèrent les Romaines : ce fut pour chercher à, la consoler d'une immense douleur maternelle que Sénèque composa son célèbre traité : Consolation à Marcia. Quelques Romaines auraient pu prendre place parmi les orateurs. Cornélie, mère des Gracques, la noble matrone qui unissait à ses connaissances philosophiques l'éloquence qu'elle transmit à ses fils ; Lælia, fille de Lælius, douée de l'élégante parole que l'on admirait en son père et dont elle légua l'héritage aux deux Mucia, ses filles, et aux deux Licinia, ses petites-filles[21] ; toutes ces femmes ne donnèrent probablement cours à leur brillante élocution qu'au milieu de leurs familles ou de leurs amis. Mais, comme nous l'avons vu plus haut, Amæsia Sentia et Hortensia, fille de l'orateur Hortensius, déployèrent jusque dans le Forum leur habileté oratoire. Elles ne le firent que dans des circonstances exceptionnelles. Aussi échappèrent-elles au blâme qui flétrissait si justement une Afrania ; et n'eurent-elles droit qu'à la respectueuse admiration de leurs concitoyens. Accusée devant le tribunal du préteur, Amæsia Sentia se défendit elle-même avec une clarté, une précision, une force qui décelaient le caractère viril que lui reconnaissaient ses contemporains. En une seule audience elle vit se terminer son procès, et fut acquittée presque à l'unanimité des suffrages[22] (77 ans avant Jésus-Christ). Ce fut au péril de sa vie qu'Hortensia parut au Forum. Les seconds triumvirs avaient fait peser sur les matrones un écrasant impôt. A ce temps de proscriptions et de sanguinaires vengeances, nul homme n'osa se présenter pour défendre la cause des Romaines. Ce fut alors qu'au nom des matrones, Hortensia prit la parole : et, par un remarquable discours, gagna leur procès et le sien. L'âme d'Hortensius avait passé dans sa fille. Quintilien rapporte que, de son temps, cette plaidoirie était encore lue non-seulement par honneur pour le sexe d'Hortensia, mais encore pour la valeur intrinsèque de ce discours[23]. Le père d'Hortensia était ce Romain que nous avons vu demander à Caton d'Utique la main de Marcia, la propre femme de celui-ci. Saint Sidoine Apollinaire nous dit que Marcia inspira le talent oratoire de son second mari. D'après le pieux écrivain, Térentia, femme de Cicéron, prêta aussi à son époux les lumières de son esprit ; niais les lettres de Cicéron, qui nous parlent si souvent de Térentia, ne nous permettent pas de définir l'ascendant intellectuel qu'elle put avoir sur lui. Nous ne faisons donc qu'enregistrer, sans la développer, l'assertion de saint Sidoine Apollinaire. Nous remarquerons toutefois que les goûts littéraires de Térentia semblent confirmés par les mariages successifs qui, après l'avoir unie à un homme- de génie comme Cicéron, l'associèrent à un historien illustre comme Salluste, et à un orateur renommé comme Messala. Le savant évêque de Clermont place aussi au rang des femmes inspiratrices, Calpurnie, épouse de Pline le Jeune. Les lettres de celui-ci témoignent en faveur de ce renseignement, non pas toutefois que Pline ait mentionné l'aide littéraire que lui aurait prêtée Calpurnie ; mais le noble et aimable Humain a retracé, dans des pages émues, le prix que sa femme attachait à ses travaux ; il ajoute même qu'elle chantait ses vers en les cadençant sur la lyre. Mais laissons-le parler lui-même, alors qu'il remercie de son bonheur conjugal Hispulla, tante de Calpurnie : Pline à son Hispulla, salut. Comme tu es l'exemple de la piété ; que tu as aimé d'un amour pareil au sien un frère excellent et très-tendre
; que tu regardes sa fille comme tienne, et que tu représentes en vérité pour
elle non pas tant l'affection de la tante que celle du père mort. je ne doute
pas que ce ne soit pour toi une grande joie que de la savoir devenue digne de
son père, digne de toi, digne de son aïeul. Grande est sa pénétration ;
grande sa frugalité ; elle m'aime, ce qui est l'indice de sa chasteté. Elle
aborde ces études littéraires qu'elle conçoit pour l'amour de moi. Elle a mes
livres, les lit et les relit, les apprend même par cœur. De quelle
sollicitude elle est émue quand je dois plaider ; et de quelle joie quand
j'ai plaidé ! Elle poste des messagers qui lui annonceront quels
applaudissements, quelles clameurs, j'ai excités, quel résultat du jugement j'ai
entrainé. Elle-même, quand je fais une récitation publique, s'asseoit,
discrète, derrière un voile, et recueille mes louanges dans de très-avides
oreilles. Même elle chante mes vers, et les cadence au son de la lyre,
instruite non par quelque artiste, mais par l'amour qui est le meilleur
maître. Ces motifs me donnent la plus certaine espérance que, dans l'avenir,
la concorde sera perpétuelle entre nous, et toujours plus grande. Car ma
femme aime, non mon âge ou ma personne physique qui peu à peu se détruira et
vieillira, mais ma gloire. Il ne devait pas en être autrement de celle qui a
été élevée par tes mains, formée par les préceptes ; qui, dans ta compagnie,
n'a rien vu que d'honnête et de saint ; qui enfin a été habituée à m'aimer
d'après l'éloge que tu faisais de moi. Car, de même que tu as vénéré ma mère
comme la tienne ; moi aussi, dès mon enfance, tu as eu l'habitude de me
représenter à ton esprit, de me louer et de me voir dans l'avenir, tel que je
suis vu maintenant de ma femme. C'est pourquoi nous te rendons grâces à
l'envi l'un de l'autre ; moi, parce que tu me l'as donnée ; elle, parce que
tu m'as donné à elle ; de même, tour à tour, nous te remercions de nous avoir
choisis l'un pour l'autre. Adieu[24]. Nous sentirons encore mieux ce que dut être pour ces deux époux la communauté morale et intellectuelle, quand, par d'autres lettres, Pline nous aura montré le vide que creusait autour de lui une absence, même momentanée, de la femme qui était vraiment sa compagne. Lisons les lettres qu'il écrivait alors à la chère absente, lettres tout imprégnées d'une tendre sollicitude, et d'une affection aussi délicate que passionnée : Pline à sa Calpurnie, salut. Jamais je ne me suis plus grandement plaint de mes occupations que
lorsqu'elles ne m'ont pas permis soit d'aller avec toi en Campanie, alors
que, pour cause de maladie, tu te mettais en route ; soit de suivre de près
tes pas, après ton départ. Car, à ce moment surtout, je désirais que nous fussions
ensemble, afin de voir par le témoignage de mes yeux ce que tu acquérais pour
tes forces, pour ce faible. corps ; et enfin (pour voir) si tu jouissais sans
obstacle des charmes de ta retraite et de l'abondance de cette région. En
vérité, fusses-tu même bien portante, ce ne serait pas sans souci que je te
regretterais. Car c'est être en suspens et dans l'anxiété que de vivre sans
parfois rien savoir de la personne que l'on chérit le plus ardemment.
Maintenant, en vérité, la pensée de ta maladie, aussi bien que celle de ton
absence, me met hors de moi par une inquiétude incertaine et variée. Je
crains tout, je m'imagine tout ; de tout ce qui est à redouter dans la
nature, ce qui l'est le plus pour moi, ce que j'ai le plus en abomination, je
me le figure. C'est pourquoi je te prie très-vivement de veiller chaque jour
à mon inquiétude par une lettre et même par deux. Je serai plus tranquille,
tant que je lirai ; et quand j'aurai lu, de nouveau je craindrai. Adieu[25]. Pline à sa Calpurnie, salut. Tu m'écris que je ne t'affecte pas médiocrement par mon absence, et que tu n'as qu'une consolation, celle de
tenir mes ouvrages au lieu de moi, et même, de les mettre souvent à ma place.
Il m'est doux que tu aies besoin de moi, que tu trouves du repos dans ces
calmants. Pour moi, je lis et relis tes lettres ; et, à diverses reprises, je
les prends en main comme si elles étaient nouvelles ; mais par cela je rends
plus brûlant encore le regret de ton absence. Car combien de douceur n'y
a-t-il pas dans les paroles de celle dont les lettres ont tant de suavité !
Toi cependant, écris-moi très-souvent, bien que cela me charme d'une manière
telle que cela me torture. Adieu[26]. Pline à sa Calpurnie, salut. Il est incroyable à quel point j'éprouve le regret de ton
absence. Ce qui en est cause, c'est d'abord l'amour, ensuite l'habitude que
nous avons de ne pas nous quitter. De là vient que je passe la plus grande
partie des nuits en veillant avec ton image ; que, pendant le jour, aux
heures où j'avais coutume de te voir, mes pieds, comme on le dit très-bien,
me conduisent d'eux-mêmes à ton appartement ; qu'enfin, souffrant et triste,
et comme si je n'avais pas été admis, je m'éloigne de ce seuil vide. Un seul
temps est libre de ces tourments : celui que je dépense au Forum et aux procès
de mes amis. Juge quelle vie est la mienne, moi pour qui
le repos est dans le travail, et la consolation dans le souci et dans les
affaires. Adieu[27]. Devant ce tableau de l'amour nuptial qui s'appuie, non sur la beauté périssable, mais sur les charmes à jamais vivants du cœur et de l'esprit, ne se souvient-on pas involontairement qu'à l'époque où vécut Pline, l'on vit à Rome le philosophe grec qui, formulant les Préceptes du mariage, exalta cette tendresse conjugale dont la flamme douce et pure se garde encore sous la neige des cheveux blancs ? Mais comment ne pas nous rappeler aussi que Plutarque et Pline avaient tous deux reçu, sans le remarquer peut-être, l'influence de la religion divine qui venait de se manifester à Rome, et qui fit du mariage l'union des âmes ? |