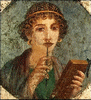LA FEMME ROMAINE
PREMIÈRE PARTIE. — LA FEMME SOUS LA ROYAUTÉ ET PENDANT LES TROIS PREMIERS SIÈCLES DE LA RÉPUBLIQUE
CHAPITRE TROISIÈME. — LA FIANCÉE, LA MARIÉE, LA MATRONE - LES MATRONES CÉLÉBRES.
|
Les premiers mariages romains. La femme conquise par la lance. Sort de cette captive de guerre. — Les justes noces. Le connubium et l'étranger. Israël et Rome dans le plan divin. Le connubium entre les patriciens et les plébéiens, etc. — Les fiançailles. La demande en mariage. — La dot. Les deux conventions matrimoniales. — La manus. La confarréation. La coemption. L'usus. — Coutumes nuptiales. — La communauté des biens sacrés. La maîtresse de maison et les Lares. La matrone aux sacrifices domestiques. La Reine des sacrifices et la Basilissa athénienne. La Flaminica. — La communauté des biens terrestres. Pouvoir du mari. Tribunal domestique. Vertu de la matrone. La Pudicité patricienne et la Pudicité plébéienne. Quelques coutumes grossières. La matrone à son foyer. Sa vie rurale. Un souvenir biblique. Amour et respect du Romain pour sa femme. La monogamie. Le divorce. La première répudiation. Droits civils de la matrone. — Le tuteur de la veuve. — La mère. — Une mère antique, d'après Virgile. La reine Amata. — L'obéissance du fils à l'égard de sa mère. Encore un ancien type maternel, d'après Virgile. La mère d'Euryale. — La mère romaine et la mère spartiate. — Le patriotisme des matrones. Les Romaines devant l'invasion. Deuils patriotiques des matrones. — Rôle des matrones dans les affaires publiques. Les matrones célèbres. La reine Tanaquit, Tullie, Lucrèce, Véturie, Volumnie. Les deux héroïnes du Coriolan de Shakespeare. Fabia. — La matrone devant le droit et devant les mœurs. — Symptômes de démoralisation. Loi Oppia. Les vieilles races qui habitent l'Italie centrale au moment de la fondation de Rome ont refusé de s'allier par le mariage au peuple qui vient du naître sur les bords du Tibre. Mais les fêtes du dieu Consus[1] ne tardent pas à attirer à Rome les habitants des cités voisines, Céniniens, Crustuminiens, Antemnates et surtout Sabins. Pendant que les jeux attirent l'attention des étrangers, Romulus se lève et se drape dans les plis de sa robe de pourpre. C'est un signal. Ses soldats, l'arme à la main et poussant une clameur semblable à un cri de guerre, se précipitent au sein de la foule et ravissent les filles de leurs hôtes[2]. Ils ont conquis leurs épouses, ils les ont conquises par la lance. Ce sont là les premiers mariages romains. Dans cette tradition se trouve l'origine légendaire de ce pouvoir absolu qui, à Rome, soumet l'épouse à l'époux, et qui applique dans le sens le plus rigoureux la convention matrimoniale suivant laquelle la femme est placée in manum mariti, sous la main du mari[3]. La Romaine sera-t-elle donc traitée par son époux comme une captive de guerre ? Le titre d'épouse et celui d'esclave seront-ils donc synonymes ? Le vieux récit, que nous allons poursuivre, nous permettra de répondre à cette question. Ravies à leurs parents qui fuient loin d'elles avec désespoir, les jeunes étrangères se livrent à leur douleur, à leur indignation ; mais le roi vient lui-même relever leur courage. Il leur promet qu'elles seront avec leurs époux en pleine communauté de tous les biens, de tous les droits de cité, et de ce qu'il y a de plus cher au monde : les enfants. Que celles-ci fassent donc fléchir leur ressentiment. Qu'elles donnent leurs âmes à ceux à qui la force a donné leurs personnes. Souvent, à la suite de l'injure, est né le pardon[4]. Romulus ajoute que leurs ravisseurs seront pour elles les meilleurs des époux, et que, ne se bornant pas à remplir les devoirs que prescrit le mariage, ils s'efforceront de leur faire oublier leurs parents et leur patrie. Et ces hommes qui entouraient les jeunes filles désolées,
ce n'étaient plus ces farouches ravisseurs qui, la lance à la main, avaient
fondu sur elles. C'étaient des amis, c'étaient des suppliants qui les
consolaient avec tendresse, et qui, au nom de leur amour, s'excusaient de
leur faute ; prières
toutes-puissantes sur l'esprit de la femme[5], dit avec un
sourire le grave Tite-Live qui ajoute : Déjà les sentiments des femmes enlevées
étaient presque adoucis, alors que
leurs parents, avec des vêtements de deuil, des larmes et des plaintes, excitaient
puissamment les villes[6]. En ravissant les filles de leurs voisins, les compagnons de Romulus ont préludé à ces guerres de conquête qui feront de Rome la maîtresse du monde. Les Céniniens et les Antemnates, qui se sont levés pour venger leurs filles, deviennent les premiers sujets de Rome. Mais déjà la matrone est puissante à son foyer : et, par ses supplications, elle obtient que les vainqueurs reçoivent parmi leurs concitoyens les membres des cités conquises. La défaite des Antemnates suit celle de leurs alliés. Mais alors seulement la grande guerre va commencer avec l'irruption des Sabins sur les terres romaines. La trahison de Tarpéia a livré le Capitole aux envahisseurs. C'est dans Rome même que la lutte s'engage entre les Sabins et les compagnons de Romulus. Soudain des femmes aux cheveux épars, aux vêtements lacérés, se précipitent au milieu des combattants. Le devoir et l'amour ont vaincu dans leurs cœurs la timidité de leur sexe, et elles affrontent les traits qui volent au-dessus de leurs têtes. Elles supplient d'un côté, leurs pères, de l'autre, leurs. époux, de ne pas se couvrir du sang défendu d'un beau-père ou d'un gendre, de ne pas souiller d'un parricide les enfants qu'elles ont conçus, les fils de ceux-ci, les petits-fils de ceux-là. — Si la parenté qui existe entre vous, si cette alliance par le mariage vous déplaît, tournez contre nous vos ressentiments, nous, qui sommes cause de la guerre, nous, qui sommes cause des blessures et du massacre de nos époux et de nos parents. Il vaut mieux que nous périssions que de vivre, veuves ou orphelines, sans les uns ou les autres de vous[7]. L'émotion rend muets les combattants. Après un silence solennel, les chefs des deux armées s'avancent, et scellent une paix qui fait de deux peuples un seul peuple, une famille agrandie. Pendant la conclusion du traité, les Sabines présentaient à leurs pères, à leurs frères, leurs époux, leurs enfants. Après avoir déployé le courage de l'héroïne, elles ne laissaient plus voir que le dévouement de la femme. Elles portaient des provisions à ceux qui en avaient besoin, et recueillant dans leurs demeures ceux qui étaient tombés pour leur cause, elles les pansaient elles-mêmes. Aux Sabins qu'elles abritaient ainsi sous leur toit, elles montraient que, maîtresses dans leurs maisons, elles étaient traitées par leurs époux avec une respectueuse sympathie. Plus que jamais Sabins et Romains entourèrent de leur tendresse les femmes à qui ils devaient les bienfaits de la paix et de l'union. A ce redoublement d'affection, les Romains joignirent les hommages d'une vénération particulière. Si, avec Plutarque, l'on peut clouter que Romulus ait donné les noms de trente Sabines aux curies entre lesquelles il partagea son peuple[8], du moins l'on peut accepter d'autres traditions. Ainsi les Romains devaient céder le côté d'honneur aux femmes qu'ils rencontraient dans la rue. Il leur était prescrit de ne jamais prononcer, devant les chastes Sabines, une parole contraire aux bienséances. Même accusées d'un crime, les femmes ne pourraient être citées devant les juges ordinaires. Enfin leurs enfants auraient le privilège de porter au cou l'ornement nommé bulla[9], et de revêtir la robe prétexte à la bordure de pourpre. Dans le traité qu'avaient conclu les Sabins et les Romains, il avait été expressément stipulé que les femmes de ceux-ci ne seraient obligées ni de faire la cuisine, ni de moudre le grain, et qu'elles ne seraient astreintes qu'au filage de la laine[10]. Toute la destinée de l'épouse romaine est contenue en germe dans ce récit. Devant le droit, la femme est presque toujours, dans les premiers temps de Rome, sous la main du mari. Ici, comme dans l'antique Orient, l'épouse subit la condamnation prononcée par le Seigneur alors que, par la femme, le péché entra dans le monde : Tu seras sous la puissance de ton mari. Mais, aussi bien à Rome qu'ailleurs, la Providence permit que les mœurs vinssent adoucir les lois humaines qui avaient gardé l'empreinte de la sentence divine. Nous avons vu que c'est surtout chez le peuple de Dieu que la femme fut honorée. Parmi les autres nations antiques, Rome conserva à un haut degré, avec le respect de la femme, le souvenir des mœurs patriarcales. D'ailleurs les compagnons de Romulus ne pouvaient que reconnaître la supériorité morale qu'avaient sur eux les Sabines, filles d'une civilisation qui leur était étrangère[11] et à laquelle elles durent les initier. C'est là sans doute qu'il faut surtout chercher le secret de cette autorité morale qui fit d'une captive de guerre, la maîtresse du foyer. Si la loi était dure, la coutume en corrigeait l'âpreté. Si l'époux avait dans sa main la vie et la fortune de l'épouse, il n'abusait pas de cette toute-puissance ; et si la légende des Sabines nous a montré les premières femmes romaines conquises par la lance, cette même tradition nous a fait voir en elles, par la suite, des conseillères écoutées, des amies vénérées. Les unions si brusquement conclues par les premiers Romains, n'avaient pu être précédées des formalités qui devinrent les préliminaires du mariage, et que nous allons étudier ici. Disons d'abord que pour les Romains, aussi bien que pour les Spartiates, le mariage était une obligation. Une ancienne loi ne permettait pas que l'homme demeurait célibataire après un certain âge[12]. De même que Rome n'avait dû sa naissance qu'à une réunion de bannis d'origine différente, les fondateurs de cette ville n'avaient pu s'allier qu'à des femmes étrangères. Sous ses rois, alors que Rome s'agrandit plus d'une fois en ouvrant son sein à divers peuples de l'Italie, ses citoyens purent encore s'allier à leurs voisins par le mariage. C'est ainsi que Tarquin le Superbe donna sa fille à Mamilius, prince des Latins[13]. Mais plus tard, lorsque le droit de cité, soit dans son entier, soit dans l'une de ses parties, ne fut plus donné aux étrangers que comme une récompense, les Romains ne purent contracter de justes noces qu'avec les étrangers qui avaient obtenu le connubium, c'est-à-dire la faculté de conclure un mariage produisant tous les effets du droit civil et donnant ainsi le jour à des citoyens romains[14]. Cependant les mariages que le connubium ne sanctionnait pas entre les Romains et les étrangers, ces mariages étaient valides. Ils n'appartenaient pas au droit romain, mais on peut les rattacher au droit des gens[15]. Les enfants issus de ces alliances suivaient la condition de l'époux étranger[16]. Bien que la loi fût généralement plus douce à Athènes qu'a, Rome, le vieux droit quiritaire est ici, par exception, plus humain que la jurisprudence de la brillante cité grecque. Chez les Athéniens, l'esclavage attendait les étrangers qui avaient osé s'allier à leur race, et menaçait même les enfants issus de ces unions. Souvenons-nous qu'il était aussi défendu aux Israélites de se marier avec les étrangers. Mais ici, ce n'était point une loi humaine, c'était une loi divine. Et celle-ci avait pour but de sauvegarder, avec la pureté de la race, l'intégrité des croyances religieuses que le Seigneur avait confiées aux Hébreux[17]. Bien différente sera, dans le plan divin, la mission de Rome. Le trésor qu'Israël doit conserver jusqu'à la venue de Jésus-Christ, Rome le répandra dans le monde racheté par le sang du Rédempteur ; et c'est pourquoi la Rome païenne, préludant à son insu au rôle que la Providence a tracé à la Rome chrétienne, ouvrira peu à peu son sein aux étrangers. Lorsqu'elle sera devenue la cité universelle, elle sera prête à devenir la cité du Christ. Même entre Romains, le connubium ne put toujours exister. Une des deux dernières lois des Douze Tables le défendit expressément entre les patriciens et les plébéiens. Il ne semble pas que cette prohibition ait existé primitivement[18]. Il eût été difficile de l'établir alors que la société romaine était en voie de formation et que les castes n'étaient pas définitivement constituées. Disons toutefois qu'un célèbre jurisconsulte a assigné déjà au temps des rois la coutume de proscrire les justes noces entre les deux classes[19]. La loi qui prohibait ces mariages n'aurait donc fait que sanctionner un usage établi. Cette loi ne demeura du reste en vigueur que cinq ans après sa promulgation. Elle fut abolie par les efforts du tribun Canuléius, non sans une lutte ardente contre les patriciens, qui sentaient que les alliances mixtes bouleverseraient les rites religieux particuliers à chaque famille, et, en amenant la confusion des castes, feraient perdre à l'aristocratie sa prépondérance politique[20] (an 309 de la fondation de Rome, 444 ans avant J.-C.). Quant aux unions entre les personnes libres et les esclaves, même affranchis, elles étaient proscrites[21]. La parenté était aussi un obstacle aux justes noces. L'oncle ne pouvait épouser sa nièce, ni la tante son neveu. A l'origine, le mariage était même défendu entre le cousin et la cousine ; mais cette prohibition ne fut pas maintenue. Il était alors permis au beau-frère de s'unir à sa belle-sœur[22]. Pour que le mariage fût légitime, il fallait aussi que les époux et les chefs de leurs familles y eussent apporté leur consentement. Ce consentement n'était jamais demandé à la mère[23] ; il n'en était pas ainsi à Athènes. Remarquons qu'à Rome, la mariée devait accepter volontairement son union, et qu'elle pouvait de cette manière, sinon choisir elle-même son époux comme dans l'Inde, du moins refuser, comme chez les Hébreux, le prétendant qui lui déplaisait. Nous ne savons si la femme grecque jouissait de cette faculté. La jeune Romaine était-elle orpheline de père, elle disposait librement de sa main. L'intervention de ses tuteurs ne lui était nécessaire que pour la constitution de sa dot ou pour la conventio in manum, la convention qui mettait son patrimoine sous la main de son mari[24]. L'âge était encore une condition indispensable pour qu'il y eût connubium. Les premiers législateurs ne l'avaient pas fixé. Plus tard le marié dut avoir au moins quatorze ans ; et la mariée, douze ; mais tous deux pouvaient avoir été fiancés auparavant[25]. Nous avons vu ailleurs que pour les Hébreux, pour les Hindous et les Athéniens, les fiançailles étaient le véritable mariage légal[26]. A Rome, cette cérémonie n'était pas nécessaire à la validité des conventions matrimoniales. Cependant les fiançailles avaient en elles-mêmes une certaine valeur légale. Tant que ce nœud subsistait, les fiancés ne pouvaient sans opprobre s'engager dans de nouveaux liens[27], et la fiancée infidèle était méprisée comme l'épouse adultère. Il semble même que les mœurs romaines primitives aient laissé subsister une coutume qui appartenait à l'ancien droit latin et suivant laquelle celui des fiancés qui, pour une cause futile, manquait à sa promesse, était redevable d'une certaine somme à la partie lésée[28]. Lorsque le Romain recherche une jeune fille en mariage, il la demande à ceux dont elle dépend. Si le prétendant est encore sous la puissance paternelle, c'est le chef de sa famille qui s'acquitte de cette démarche. L'un des auteurs les plus rapprochés du temps qui nous occupe, Plaute, nous fait connaître les formules usitées dans ces circonstances. A quelques variantes près, il les répète dans plusieurs de ses comédies, avec une fidélité qui nous prouve que ces formules étaient traditionnelles. Je demande ta sœur pour mon fils. Puisse cette chose réussir ! En ai-je la promesse ?... Pourquoi ne pas répondre ? Que les dieux fassent réussir cette chose ! Je promets. Spondeo[29]. Et plus loin : Je demande ta sœur pour mon fils. Puisse cette
chose réussir ! — Que les dieux la fassent réussir ! Je promets. Spondeo[30]. Ici c'est un frère qui, pendant une longue absence de son père, vient de fiancer sa sœur. Mais le père revient, et c'est lui qui sanctionne le pacte : J'apprends que ma fille t'est promise, dit-il au fiancé. — A moins que tu ne le veuilles pas, répond le jeune homme. — Je ne refuse assurément pas. — Tu me promets donc ta fille pour épouse ? — Je te la promets, et avec une dot de mille philippes d'or. — Je ne me soucie pas de la dot. Si ma fille te plaît, la dot qu'elle te donne doit aussi te plaire. Enfin tu n'emmèneras pas ce que tu veux, à moins que tu n'emportes ce que tu ne veux pas (c'est-à-dire, tu n'emmèneras pas ma fille sans emporter la dot). — ... A cette condition, me promets-tu ta fille pour femme ? — Je te la promets. — Oh ! salut à vous, mes parents par alliance ![31] L'Aululaire, le Curculion, le Pœnulus, nous livrent des scènes analogues à celle que nous venons de traduire. Du rapprochement de tous ces textes, se détachent en substance les formules suivantes : Puisse cette chose réussir ![32] Je te demande ta fille pour épouse[33]..... Me la promets-tu ? Spondesne ?[34] — Je te la promets. Spondeo[35]. Que les dieux fassent réussir cette chose ![36] Du verbe spondeo, je promets, la fiancée se nomme sponsa, promise, le fiancé sponsus, promis, toute la cérémonie enfin, sponsalia, les promesses. La sponsa s'appelle aussi pacta, mot qui réveille la même idée ; dicta, consacrée ; sperata, espérée. Espérée, salut à toi ![37] dit à l'Adelphasie de Plaute le jeune homme qui a obtenu sa main. Nous remarquerons les paroles d'heureux augure qui, dans les pièces de Plaute, accompagnent les propositions matrimoniales : Puisse cette chose réussir ! — Que les dieux fassent réussir cette chose ! C'est aussi avec ce dernier souhait que l'annonce d'un mariage est accueillie par la personne qui reçoit cette nouvelle[38]. Même dans les comédies où nous avons trouvé ces vœux expressifs, ceux-ci sont empreints d'un caractère de gravité religieuse attestant la ferveur avec laquelle les Romains mêlaient la Divinité à tous les actes de leur vie, et l'importance qu'ils attachaient aux promesses solennelles qui allaient enchaîner deux existences l'une à l'autre. Pour les contemporains de Plaute, trop souvent corrompus et sceptiques, de semblables souhaits ne devaient être bien des fois que des formules qu'ils répétaient machinalement, mais que leurs pères ne prononçaient sans doute qu'avec une émotion profonde et recueillie. Un anneau de fer qui, à une époque postérieure, put être remplacé par un anneau d'or, était mis par le fiancé au doigt de la fiancée[39]. Dans les temps primitifs, alors que la femme se préparait à être la digne compagne d'un héros, elle donnait à son époux futur un habit qui était l'œuvre de sa main laborieuse et qu'il portait à la guerre[40]. Un banquet terminait les sponsalia, cette fête de famille pendant laquelle les maisons les plus assombries par le deuil reprenaient un aspect joyeux[41]. Les regrets du passé, les douleurs même du présent, se taisaient devant les espérances de l'avenir. Parmi les textes que nous citions au sujet des fiançailles, il en est un qui mentionne la fixation de la dot. A Rome, en effet, aussi bien que chez les Hindous et les Grecs, la femme apportait une dot à son mari. Mais autrefois cette dot était digne de la noble pauvreté romaine, et se composait de cette lourde monnaie d'airain qui se pesait et ne se comptait pas. Si le patricien ne pouvait assigner de douaire à sa fille, ses clients avaient le devoir de suppléer à son insuffisance. Comme à Athènes, il arrivait que l'État lui-même dotait les filles de ses grands hommes morts sans fortune[42]. La femme que le mariage mettait sous la main de son époux était-elle dotée par ses proches ? C'est là une question qui a été discutée et qu'il ne nous appartient pas de résoudre. En commençant ce chapitre, nous montrions dans l'enlèvement des Sabines les premiers mariages romains, et nous rattachions à cette légende des femmes conquises par la lance, la coutume essentiellement locale qui plaçait l'épouse sous la main de l'époux. Cet usage était la plus ancienne des conventions matrimoniales. Une semblable union arrachait complètement la jeune femme à sa famille, et l'épouse prenait auprès de son mari la place d'une fille (loco filiæ). Si, au moment de son mariage, elle vivait sous la puissance paternelle, elle perdait tous ses droits à la succession de son père ; mais si ce dernier était mort, la femme apportait tous ses biens à son époux[43], et n'était privée que de ses droits éventuels à la succession de ses agnats. Ce mariage soustrayait même en partie l'époux à la puissance de son père : celui-ci ne pouvait exercer sur lui le droit redoutable qu'il gardait sur ses fils, même figés : le droit de les vendre[44]. La loi épargnait ainsi à la femme libre la honte de voir son existence rivée à celle d'un homme dégradé par une servitude voisine de l'esclavage. Qu'on se souvienne de Regulus, qui n'était cependant que captif de guerre, et qui, néanmoins, plus soucieux de la dignité de la matrone que de la tendresse de l'épouse, refusa le baiser de sa femme, alors qu'après une longue absence il ne la revoyait que pour aller mourir loin d'elle[45] ! C'est une antique loi royale que celle qui ne permettait pas que le chef de famille pin vendre son fils quand celui-ci s'était marié sous le régime de la manus. Cette convention matrimoniale était sans doute, à cette époque, la seule que connussent les Romains. Quand s'établit la convention sans la manus, l'époux qui avait contracté une alliance de cette nature échappait-il aussi à la perspective de servitude qui pouvait lui être réservée par son père ? Quant à la femme mariée sous ce dernier régime, elle demeurait soumise à la puissance paternelle, qui s'exerçait sur elle en même temps que l'autorité maritale. La matrone héritait de son père, mais ne jouissait de ses biens que sous la tutelle de ses agnats. Son mari ne disposait que de la dot qu'elle recevait certainement dans cette convention. Les deux époux n'avaient aucun droit sur leur succession réciproque. La matrone et ses agnats héritaient mutuellement de leurs biens. Dans les premiers temps, le mariage sans la manus fut très-rare, bien qu'il appartint aussi aux justes noces. Le titre de mère de famille (mater familias) n'était accordé qu'aux épouses qui se trouvaient sous la main du mari. Mais le nom de matrone désignait indistinctement toutes les femmes mariées, quelle que fût la convention qui eût présidé à leur hymen[46]. L'époux acquérait la manus de trois manières : par la confarréation, par la coemption, par l'usage[47]. La confarréation est la plus ancienne et la plus importante de ces formes matrimoniales : c'est la seule qui convînt aux mariages des pontifes. Les patriciens l'employaient le plus souvent lorsqu'ils s'unissaient entre eux. Toujours la confarréation demeura interdite aux plébéiens. Dans le premier chapitre de ce livre, nous rappelions que le noble Père Perreyve reconnaissait une base sacramentelle à la virginité de la Vestale. Au sujet du mariage romain, nous ferons une réflexion analogue. Les Romains considéraient comme un sacrement la plus antique des formes nuptiales. La confarréation n'était pas pour eux une simple cérémonie sacrée qui accompagnait un contrat civil : c'était un acte religieux qui avait en lui-même une valeur légale, et qui non-seulement scellait le mariage, mais plaçait l'épouse sous la main de l'époux. Souvenir de l'Éden, l'institution divine du mariage se retrouve dans la confarréation : c'est ainsi qu'au temps des Védas, les Aryâs de l'Inde contractaient leurs mariages sous les auspices de la religion. Malgré le rôle que remplissent les pontifes dans le mariage sacré des Romains, cet acte solennel paraît avoir eu lieu dans la maison de la fiancée, ainsi que le sacrifice qui accompagnait les autres mariages[48]. Tout nous dit que la confarréation était célébrée dans l'atrium. Là brûlait le feu domestique, là se voyaient les images des Pénates et des Lares, là se groupaient et les membres vivants de la famille, et les portraits de cire modelés sur le visage des ancêtres morts : c'était ce sanctuaire domestique qui devait voir les noces sacrées des vieux Romains. Le grand Pontife et le Flamen Dialis, prêtre de Jupiter, président à la confarréation, et sont assistés de jeunes servants qui doivent avoir encore en vie leurs pères et leurs mères. Dix témoins représentant soit les dix curies d'une tribu, soit les dix familles d'une curie, sont nécessaires pour attester que les rites prescrits ont été accomplis et que les mots solennels ont été prononcés. Pendant que les fiancés se dirigent vers l'autel domestique, on porte devant eux un gâteau de far, c'est-à-dire d'épeautre. Ce far, qui a été préparé par les mains des Vestales, les chastes gardiennes du foyer public, ce far est le symbole de cette communauté de vie, de biens et de pieux sacrifices, qui va donner naissance à un nouveau foyer privé. Aussi les fiancés mangent-ils en commun le gâteau de far, et c'est pourquoi le mariage sacré se nomme confarréation. Dans les noces athéniennes, les époux se partageaient un gâteau d'orge. Seulement, ce qui n'était en Grèce qu'un symbole, était de plus, chez les Romains, le signe sacramentel de leur mariage le plus auguste. Après le sacrifice d'un porc ou d'un mouton, les mariés se placent sur deux sièges que recouvre la peau de la victime qui a été immolée. Ces deux sièges, ainsi réunis en un seul, ne semblent-ils pas un nouvel emblème du lien qui fait de deux vies une vie à la fois double et unique ? On ignore si c'était à ce moment que se disaient les paroles solennelles qui ne nous sont point parvenues, et qui étaient essentielles à la validité de la confarréation. Si la foudre grondait pendant cette solennité, la cérémonie entière était à recommencer. La confarréation ne pouvait être dissoute par le divorce ordinaire. Pour rompre ce lien sacré, il fallait un acte spécial, la diffarréation[49]. La coemption et le mariage sans la manus étaient généralement aussi accompagnés de cérémonies religieuses ; mais celles-ci étaient alors facultatives. La coemption n'était qu'un contrat civil. Bien que les patriciens s'en servissent également, ainsi que de l'usus dont nous parlerons plus loin, ces cieux formes étaient les seules qui pussent effectuer la manus dans les mariages que les plébéiens contractaient, soit entre eux, soit, après la loi Canuléia, avec les membres de la classe aristocratique. Il semble qu'il y ait eu, dans l'acte de la coemption, une réminiscence d'un temps où la femme aurait été achetée par son mari. La coemption n'est pas, il est vrai, une vente réelle, ce n'est qu'une vente fictive. En présence de cinq témoins, qui représentent peut-être les cinq classes censitaires[50], les mariés se tiennent près d'un sixième citoyen romain qui porte une balance. A cette interrogation de l'époux : Veux-tu être ma mère de famille ? la femme répond : Je le veux. Et à son tour elle demande au marié s'il veut être son père de famille[51]. Lorsque s'établit plus tard la convention sans la manus, convention suivant laquelle, les fiancés réunissant d'ailleurs toutes les conditions requises pour les justes noces, il suffisait que l'épouse fût conduite dans la maison de l'époux, la femme qui s'était mariée sous ce régime pouvait passer sous la main de son mari en se donnant à lui par la coemption. Ainsi, la coemption pouvait conférer la manus à un autre moment que celui des noces ; elle servait même, en dehors du mariage, à l'émancipation de la femme[52]. L'épouse qui n'était pas sous la main de l'époux avait la faculté de s'y mettre par un autre moyen que la coemption. Il suffisait que, dans une année entière, elle ne quittât point, pendant trois nuits consécutives, la maison de son époux. Celui-ci acquérait alors la manus par l'usus, l'usage : c'était une espèce de prescription[53]. Ainsi, le mariage et la manus ne se trouvent indissolublement liés que dans la confarréation. Dans la coemption ils peuvent être séparés, et dans l'usas ils le sont toujours. Quant aux usages nuptiaux, ils sont communs à tous les mariages. Nous allons les décrire ici. Pour les noces, comme aussi, semble-t-il, pour les fiançailles[54], les Romains évitent les jours de mauvais présage. Les calendes, les nones, les ides, le lendemain de ces jours de prière et de repos[55], les fêtes des Saliens[56], consacrées au dieu guerrier qui fait couler le sang des hommes et les larmes des veuves le mois de mai, si fatal à la vie des jeunes épouses, qu'un dicton populaire souhaite que les méchantes femmes se marient à cette époque[57] ; la première partie du mois de juin, alors que l'on purifie le temple de Vesta la fête des Mânes[58], les jours pendant lesquels on ouvre le mundus, ce gouffre qui est le centre de la cité et dont le fond est dédié à ces funèbres divinités ; tels sont les temps où ne doivent pas briller les flambeaux d'hyménée[59]. Le soleil, le beau soleil d'Italie, éclaire de ses rayons naissants le vert feuillage qui orne la porte d'une maison. Une autre lumière brille dans les carrefours où se réunissent les rues tortueuses de Rome : ce sont les feux qui ont été allumés sur les autels des Lares compitales[60], les protecteurs du quartier. Rome résonne d'un joyeux tumulte ; et la foule se presse devant la maison dont la parure a attiré nos regards : là demeure une fiancée qui aujourd'hui sera épouse ; et c'est pour appeler sur un nouveau couple la faveur divine, que la flamme de Vesta illumine les autels des Lares compitales. Un autre Lare, le plus important de ceux qui protègent le foyer de la fiancée, reçoit aussi des hommages, et l'avare même lui a offert des couronnes et un peu d'encens pour le rendre favorable au mariage de sa fille. La foule curieuse voit entrer chez la fiancée les nombreux invités. Ceux-ci ne peuvent y pénétrer qu'en fendant le flot populaire qui froisse jusqu'à la toge prétexte du magistrat[61]. Ainsi que nous le disions plus haut, c'est probablement dans l'atrium qu'a lieu la première partie de la fête nuptiale. Entrons dans cette salle pour voir la mariée. Par-dessus la toge blanche, commune alors à l'homme et à la matrone[62], la jeune épouse porte un autre vêtement blanc, la regilla, tunique que maintient à la taille une ceinture de laine dont le nœud se nomme herculéen[63]. Mais le trait distinctif du costume de la mariée est le flammeum, le voile couleur de feu[64]. C'est le voile que porte la Flaminica, prêtresse dont nous parlerons plus loin ; c'est aussi le voile dont se couvraient les premières Romaines lorsqu'elles sacrifiaient auprès de leurs époux[65] et qu'elles s'approchaient de ce feu sacré dont le flammeum reproduisait la teinte ardente. Rappelons-nous ici la femme des Aryâs tout illuminée par le feu du sacrifice et recevant par là le nom de dévî, brillante, féminin du mot déva, qui qualifiait les dieux et les sacrificateurs[66]. Le flammeum retombe sur une couronne de verveines. Ainsi qu'en Grèce, la fiancée elle-même a cueilli les fleurs de la couronne nuptiale[67]. La chevelure de la mariée romaine a été partagée de chaque côté en trois divisions auxquelles s'enroulent des bandelettes semblables à celles des Vestales. Ce n'est point le peigne qui a ainsi séparé les cheveux de la fiancée : c'est la lance ; la lance, l'arme par laquelle les premières épouses furent conquises ; la lance, le symbole de la puissance maritale[68]. Tout, du reste, est emblématique dans la toilette de la mariée. Si ses vêtements blancs témoignent de sa pureté virginale, il nous semble aussi que la couleur de feu qui distingue et son voile, et ses bandelettes de Vestale, et ses souliers même[69], désigne en elle la future prêtresse du foyer. Le fiancé est revêtu de blanc. Il est couronné de fleurs, ainsi que les invités[70]. Une couronne de tours nous fait reconnaître la première des Pronubæ, ces chastes matrones qui, présidant à l'hyménée, ne doivent avoir été mariées qu'une seule fois et n'avoir pas connu les douleurs du veuvage. Quand le nom de Pronuba est employé au singulier, il désigne sans doute la première de ces matrones. Le même titre est l'une des épithètes sous lesquelles Junon, la protectrice du mariage, veille aux cérémonies nuptiales[71]. Les augures, appelés chez les parents de la fiancée, prononcent des paroles qui permettent d'espérer que les dieux sont favorables à l'alliance préparée. On se souvient qu'en Grèce les auspices étaient pris aussi ayant l'hyménée. Si la jeune Romaine est dotée, le contrat de mariage est dressé en présence des augures[72]. Les bas-reliefs romains montrent fréquemment les tablettes nuptiales que tient l'époux, au moment on sa main est unie à celle de l'épouse par la Pronuba que semble plus d'une fois représenter Junon elle-même[73]. Après la jonction des mains, un sacrifice est offert, soit par les mariés, soit par un prêtre[74]. Précédés d'un assistant qui porte le feu et l'eau nuptiale, les fiancés s'approchent de l'autel, et chacun d'eux, se tournant vers sa droite, décrit un cercle[75]. Un nouveau rapprochement nous frappe ici : chez les Hindous, dans le rite nuptial des Créateurs, les époux décrivent autour de la flamme sacrée le cercle nommé pradakshina[76]. Suivant une superstition romaine, si à ce moment la flamme ne s'élève pas pure et brillante, si les vapeurs de l'encens ne se fondent pas avec harmonie, la foi conjugale ne traversera pas l'épreuve du temps ; les époux seront désunis[77]. Pendant le sacrifice, un jeune servant, un Camillus, porte une petite corbeille contenant probablement les grains de far qui doivent être jetés dans le feu[78]. L'union des mains, qui se retrouve chez les Aryâs de la péninsule gangétique, le sacrifice religieux que les Grecs conservèrent aussi bien que les Hindous[79], sont les seules coutumes nuptiales dont l'art purement romain nous ait laissé la représentation. Ainsi qu'on l'a remarqué[80], ces deux cérémonies, qui montraient l'union des époux et la bénédiction de leur alliance, étaient celles où se lisait le mieux cette communauté des choses divines et humaines qui était l'essence du mariage romain[81]. Nous ne savons de quelle manière les rites particuliers à la confarréation, et que nous avons décrits plus haut, venaient se fondre avec les coutumes religieuses qui pouvaient être usitées dans tous les mariages. A cette époque, le festin nuptial, véritable repas de sacrifice, a lieu chez les parents de la mariée[82]. Alors aussi, sans doute, les mustacea, gâteaux de mariage, sont distribués au dessert[83]. Après ce banquet, une violence simulée, qui semble rappeler l'enlèvement des Sabines, arrachera la jeune femme du sein maternel[84] ; et, sous la protection de Junon Iterduca[85] ou Domiduca[86], l'épouse sera conduite à la maison de l'époux. En dehors de la confarréation, c'est cette dernière coutume qui constitue le mariage légal[87]. Aussi, tandis que, par une allusion au flammeum, le verbe nubere, se voiler, désigne le mariage de la femme, de la nupta ; l'expression uxorem ducere, conduire une femme, s'applique au mariage de l'homme. La foule, toujours avide de spectacles, surtout chez les Romains, la foule attache ses regards sur la porte qui va s'ouvrir pour livrer passage au cortège de la mariée[88]. Au temps de Juvénal, des estrades, placées sur le parcours de la procession, encombreront même les rues toujours étroites[89] ; mais nous ignorons s'il faut reporter cet usage à la période primitive que nous étudions. L'étoile de Vénus s'est levée[90]. Il fait nuit. Soudain l'obscurité s'éclaire. Comme chez les Hébreux, comme chez les Hellènes, les flambeaux guident la marche du cortège nuptial, et les chants d'hyménée accompagnent la procession. De même aussi qu'en Grèce, la flûte mêle sa voix à la voix humaine[91]. Talassio ! crie-t-on, soit pour appeler un dieu de l'hymen, soit pour exhorter l'épouse au travail de la laine, soit encore pour évoquer une tradition relative à l'enlèvement des Sabines[92]. Si cette pompe nuptiale nous a fait souvenir de la Palestine, combien nous en éloigne la signification des chants qui retentissant[93], ces vers fescennins dont la grossièreté forme un frappant contraste avec le caractère grave et religieux des cérémonies que nous avons décrites ! Comment accorder cet immoral usage avec l'antique tradition qui défendait aux Romains de prononcer devant la femme une parole malséante ? C'est ainsi que le paganisme posait son empreinte sur les coutumes même qui se rattachaient le plus fortement aux saintes origines de l'humanité. Les vers fescennins étaient-ils aussi chantés pendant la pompe nuptiale qui suivait la confarréation ? Les Romains profanaient-ils à ce point un acte dont le caractère demeura toujours sacré ? Suivant une coutume particulière à la confarréation[94], la jeune femme était conduite par deux des enfants qui avaient participé à la cérémonie du matin. Un troisième précédait l'épouse et portait une torche d'épine blanche, allumée au foyer même que quittait la mariée. N'y a-t-il pas là un emblème de cette vie domestique qui, après avoir éclairé la jeune fille sous le toit paternel, guide maintenant l'épouse vers le toit conjugal ? Les autres flambeaux qui, au nombre de cinq, se retrouvaient dans tous les mariages, étaient en bois de pin[95]. Quelle que soit, sans doute, la forme matrimoniale qui a présidé à son changement d'état, la jeune femme est précédée d'un Camillus portant une corbeille. Elle-même tient une quenouille chargée de laine et un fuseau muni de fil[96]. Ici encore c'est un symbole analogue à celui que nous citions tout à l'heure. L'épouse continuera, auprès de son mari, l'existence laborieuse commencée sous le regard de sa mère. Chez les Grecs aussi, lorsque la mariée est conduite à la demeure conjugale, elle est entourée d'ustensiles domestiques. Seulement ces derniers sont de ceux qui s'emploient pour piler, triturer et griller les grains[97] ; tandis qu'à Rome, où la femme ne s'occupe point de ces préparations alimentaires qui sont attribuées à l'épouse grecque, la mariée n'apporte dans sa nouvelle habitation d'autres instruments de travail que ceux qui sont nécessaires au filage de la laine. Pendant la procession, l'époux jette des noix aux jeunes garçons : il a renoncé aux amusements puérils[98], et les devoirs du chef de famille vont succéder aux jeux de l'adolescent. Le cortège est arrivé à la maison nuptiale dont la porte est décorée de rameaux et de tentures. Le seuil même est jonché de feuillage[99]. Alors la mariée fait une onction sur les montants de la porte, et les décore de bandelettes de laine[100] : le premier de ces usages nous redit qu'une femme laborieuse va entrer dans la maison ; le second nous annonce qu'elle y répandra l'onction de sa douceur. Soit parce que le seuil, de la porte est consacré à Vesta, soit comme un nouveau souvenir de l'enlèvement des Sabines, soit pour toute autre cause, il ne faut pas que le pied de la mariée touche ce seuil. Aussi, pour le lui faire passer, les Pronubæ la soulèvent-elles dans leurs bras[101]. L'époux, venant à la rencontre de l'épouse, lui demande qui elle est. Elle répond fièrement : Où tu seras Caïus, je serai Caïa[102] ; c'est-à-dire, suivant Plutarque : Où tu seras maître et père de famille, là je serai maîtresse et mère de famille[103]. Ce dernier nom n'étant donné qu'aux femmes qui étaient sous la main du mari, la formule que nous avons citée ne pouvait être employée dans le mariage sans la manus[104]. Les titres qui expriment la souveraineté domestique sont ici partagés entre l'époux et l'épouse. C'était une tradition des temps védiques, si rapprochés du commun berceau des races humaines. La Grèce avait aussi conservé à la femme ces titres d'honneur ; mais ceux-ci avaient perdu, dans la race ionienne du moins, leur haute signification. Il n'en fut pas de même chez les Romains où la matrone eut une autorité semblable à celle de l'épouse hébraïque[105]. Comme pour reconnaître une fois de plus la communauté de la vie conjugale, le Romain recevait sa jeune femme avec l'eau et le feu[106]. Rien de très-précis n'est connu : sur la manière dont se pratiquait cet usage. Mais, d'après le rapprochement de divers textes, l'archéologue a pu conclure que le flambeau qui, dans la confarréation, et plus tard dans les autres mariages, avait été porté devant l'épouse, était plongé dans une pure eau de source, et que l'époux aspergeait sa compagne avec cette eau[107]. C'était là comme une bénédiction dont le signe avait été consacré par le feu allumé chez les parents même de la mariée, et à laquelle se rattachaient ainsi pour la jeune femme les souvenirs du foyer paternel et les espérances du foyer conjugal. Ce feu domestique qui se rencontre plus d'une fois dans les cérémonies du mariage, l'épouse le retrouvera encore quand les Pronubæ l'auront amenée dans la chambre nuptiale, qui n'est autre que l'atrium où s'élève l'autel de Vesta[108]. C'est à cet autel que, le lendemain de leur mariage, les époux offrent ensemble un sacrifice que suivra une nouvelle fête[109] ; et le jeune couple inaugure ainsi la communauté des biens sacrés. Comme nous le remarquions au début de ce livre, la pierre du foyer est l'autel qui réunit les époux, et c'est la matrone qui en est la prêtresse. Aux calendes, aux ides, aux nones, aux autres jours de fête, l'épouse couronne ce foyer sacré et prie les Lares[110]. Longtemps après l'époque que nous étudions dans ce chapitre, Horace dira encore : Si, à la lune naissante, rustique Phidylé, tu élèves au ciel tes mains suppliantes, si tu honores les Lares par de l'encens, par les fruits de la saison et par une truie avide, ni ta vigne féconde ne sentira le vent pestilentiel de l'Afrique ; ni tes moissons la rouille stérile ; ni ton jeune bétail[111] le poids du temps, lors de la saison fertile en fruits. En effet, que la victime consacrée qui paît sur l'Algide neigeux entre les chênes et les yeuses, ou qui croit dans les pâturages albains, teigne de son sang[112] les haches des pontifes. A toi, il ne t'importe pas de chercher à séduire, par beaucoup de sacrifices de brebis, les humbles dieux que tu couronnes de romarin et de frêle myrte. Si une main innocente a touché l'autel, une luxueuse victime n'apaisera pas plus agréablement les Pénates opposés que l'orge sacrée et le sel pétillant[113]. L'homme veut-il que le Lare familier le suive dans une maison qu'il vient d'acheter, il fait accomplir par sa femme, à son ancien foyer, les rites qui doivent lui rendre propices les dieux domestiques. Même à une époque de décadence morale, Plaute fera suivre cette coutume à l'un de ses personnages : Je veux que notre Lare soit décoré d'une couronne. Femme, prie-le pour que cette habitation nous devienne bonne, favorable, heureuse et fortunée... Et que je te voie morte le plus tôt possible[114]... ajoute ici l'époux. Mais ce charitable souhait appartient au temps où les mœurs commençaient à se corrompre. Ne nous y arrêtons pas maintenant. Lorsque le Romain des vieux jours, c'est-à-dire le laboureur, sacrifie aux dieux après la moisson, il a près de lui sa fidèle compagne et ses enfants. Il immole une victime à la Terre qui a fait fructifier ses sueurs. Sylvain, l'antique génie des forêts, le protecteur des pâturages et du bétail, reçoit du laboureur le lait dont les troupeaux se sont gonflés en broutant l'herbe qu'il donne. Au génie qui veille sur son existence, l'homme des champs offre des fleurs et du vin[115], les fleurs, emblème des joies passagères de la vie, le vin, dont la sève généreuse soutient le travailleur. Chaque gens ou famille patricienne avait ses rites et ses sacrifices particuliers, et les conserva même après l'organisation du sacerdoce officiel. Là aussi, la matrone assistait le chef de famille. Comment ne pas nous rappeler ici les scènes que nous décrivions ailleurs : la femme des temps védiques officiant auprès de son mari ; et plus tard, chez les Hellènes primitifs, l'épouse participant au sacrifice que fait l'époux[116] ? A Rome, sous la monarchie, des sacrifices étaient offerts aux dieux pour le bien de l'État. Le roi et la reine présidaient à ces solennités qui avaient lieu à la Regia, l'ancien palais des rois, le cloitre des Vestales. Après l'établissement de la république, un pontife fut spécialement chargé des attributions sacerdotales du souverain. On l'appela Rex sacrorum, roi des sacrifices ; et sa femme, associée à s'es fonctions religieuses, fut nommée Regina sacrorum, reine des sacrifices[117]. Il y a là une frappante analogie avec ce qui se passa chez les Athéniens. Lorsque la royauté fut abolie parmi ces derniers, l'un des archontes hérita du pouvoir sacerdotal qu'exerçaient les souverains, et reçut le nom d'archonte-roi. Sa femme porta le titre des anciennes reines de l'Attique : Basilissa, et nous l'avons vue célébrer un sacrifice annuel pour le bonheur de l'État[118]. Le premier jour de chaque mois étant consacré à Junon, la Regina sacrorum se rendait à la Regia, dès que le croissant de la lune avait reparu au ciel. La prêtresse offrait à Junon un mouton ou un porc. Son mari sacrifiait en même temps à la déesse dans un autre édifice : la Curia Calabra. Au-dessous du roi des sacrifices, il y avait un pontife dont l'institution datait de Numa, le fondateur du culte officiel : c'est le Flamen Dialis, le prêtre de Jupiter. Par une association qui n'est pas rare dans la religion des Romains, et suivant laquelle le culte de deux époux célestes est confié à deux époux terrestres, la compagne du Flamen Dialis, la Flaminica, est la prêtresse de Junon[119]. Vêtue d'une robe teinte[120], les cheveux enroulés autour d'une bande de pourpre et se dressant en cône, la Flaminica pénètre, à chaque nondine[121], dans la Regia, et immole un bouc à Jupiter. C'est alors sans doute qu'elle se voile du flammeum. Les Romains, qui attachaient un soin méticuleux à la pureté extérieure du culte, restreignirent, par une foule de prescriptions, la liberté du Flamen et celle de la Flaminica. Outre les interdictions qui lui étaient communes avec son mari, il était défendu à la prêtresse de se peigner pendant une solennité expiatoire des Saliens, pendant la fête des Argiens et la purification du temple de Vesta. Quand s'accomplissait ce dernier rite, la Flaminica avait les cheveux coupés et laissait croître ses ongles. Cette prêtresse ne devait avoir été mariée qu'une seule fois. Il fallait que la confarréation eût présidé à son hymen, hymen indissoluble ! La Flaminica mourait-elle la première, le Flamen ne pouvait se remarier. Mais certaines des fonctions religieuses ne devant être remplies que par la Flaminica, le Flamen, devenu veuf, se trouvait contraint de renoncer à son ministère[122]. Dans le culte officiel comme dans le culte domestique, nous venons de voir entre les époux la communauté des biens sacrés. Passons maintenant à la communauté des choses humaines. Au premier abord, cette communauté n'est qu'un nom ; et si l'on rie regarde qu'à la lettre du droit romain, au lieu d'une association dont l'homme est le chef, l'on trouve un gouvernement despotique dont la femme est la victime. En pensant que l'épouse peut être vendue ou tuée par son mari, l'on s'effraye de cette puissance souveraine attribuée à l'époux, et qui lui confère les pouvoirs d'un maître, d'un juge et d'un exécuteur. Ce n'est pas seulement lorsque sa compagne lui est infidèle que le Romain a le droit de la faire mourir. N'eût-elle commis d'autre crime que de boire du vin, il lui est permis de la tuer. Cependant une institution vient prévenir et corriger les excès du pouvoir marital : c'est la formation d'un tribunal domestique qui, réunissant les cognats des deux époux, sauvegarde dans une certaine mesure les intérêts de l'épouse. Il est vrai que ce tribunal n'a aucune valeur légale ; mais ses décisions sont revêtues d'une autorité morale que l'époux ne saurait braver sans encourir le blâme de l'opinion publique[123]. D'ailleurs la vertu des Romaines ne dut pas alors souvent permettre à l'époux d'exercer ses droits les plus redoutables. La sévère pureté de la matrone la protégeait plus sûrement que le tribunal domestique ; et nous verrons bientôt que l'épouse sacrifia sa vie même à son honneur. La Pudicité, cette vigilante gardienne de la matrone, la Pudicité recevait de celle-ci des honneurs particuliers. Sous le nom de Pudicité patricienne, elle avait naguère une chapelle à Rome. Pour qu'une femme y fût admise, il fallait qu'elle n'eût été mariée qu'une fois, et qu'elle joignit à la chasteté des mœurs la pureté d'un sang aristocratique. La matrone plébéienne n'y était pas admise. L'an 296 avant Jésus-Christ, pendant des supplications publiques qu'avait ordonnées le Sénat, une femme se vit repousser de cette chapelle. Cependant cette femme était pure, et le sang des vieilles races coulait dans ses veines ; mais elle était mariée au consul plébéien Volumnius, et, suivant les matrones nobles, c'était là une mésalliance qui la rendait indigne de pénétrer dans l'enceinte consacrée à la Pudicité patricienne. Une vive querelle suivit l'affront que reçut Virginie. La noble femme protestait qu'elle avait eu le droit d'entrer dans la chapelle. N'était-elle pas née dans une famille aristocratique ? n'avait-elle pas été mariée une seule fois ? Et quant à l'époux qui avait eu son premier amour, elle ne rougissait ni de lui, ni des honneurs et de la gloire qu'il avait mérités. Loin de là elle était fière de cette alliance. Après cette généreuse revendication, la femme du consul se retire. Elle se dirige vers la rue Longue où est sa maison. Rentrée chez elle, Virginie sépare de sa demeure un espace suffisant pour un lieu sacré, et dresse un autel dans cette enceinte. Alors elle réunit les matrones plébéiennes. Après leur avoir dit l'outrage que lui ont infligé les femmes des patriciens, elle ajoute : Je dédie cet autel à la Pudicité plébéienne, et je vous exhorte à ce que, comme dans cette ville la lutte du courage oblige les hommes, il en soit ainsi de la pudeur entre les matrones ; et à ce que vous fassiez en sorte qu'il soit dit que cet autel, si c'est possible, soit honoré plus saintement que l'autre, et par de plus chastes adoratrices[124]. La demeure d'une vertueuse matrone était digne de donner un nouvel autel à la Pudicité. De même que le culte de Vesta, le culte de la Pudicité ne pouvait que contribuer à maintenir la chasteté de l'épouse. Il en était probablement ainsi du culte de Junon, la protectrice du mariage. Mais tout n'était pas aussi pur dans la vieille religion romaine, et plus d'une coutume étrange devait révolter la pudeur de la matrone. Que dire du rôle que jouaient les femmes pendant les Lupercales, et les fêtes de Flore, et celles de Liber, la divinité associée, comme Bacchus chez les Grecs, à Cérès et à Proserpine ? Bona Dea même, cette déesse agricole que l'on adorait aussi comme une protectrice de la dignité féminine, Bona Dea était l'objet de légendes dont l'immoralité ne préparait que trop bien les scènes scandaleuses qui, plus tard, souillèrent ses fêtes[125]. Certes, il fallait que Dieu eût bien profondément imprimé dans le cœur de la femme la notion de la pureté, il fallait que les mœurs patriarcales fussent bien vivaces chez les Romains, pour que la matrone pût conserver sa chasteté au milieu de semblables cultes. Comme nous l'avons déjà remarqué à propos des usages nuptiaux, ces traditions présentent une véritable opposition avec le soin que devaient prendre les Romains de ne prononcer devant leurs femmes aucune parole malséante. Nous avons dit que la vertu de la matrone était déjà une sauvegarde contre la puissance absolue que le vieux droit quiritaire attribuait au mari. Pour savoir quelle fut en réalité la situation de l'épouse devant l'époux, faisons reparaître une image que nous avons déjà saluée au commencement de ce livre : la matrone à son foyer, ou, pour mieux dire, au foyer domestique, car ici la femme n'est pas, comme à Athènes, reléguée dans un gynécée ; elle habite la grande salle de la maison, l'atrium[126]. Il fait nuit. Tout repose, excepté la main de la femme laborieuse. Une torche éclaire l'atrium, et jette ses reflets sur la pourpre et l'or dont la matrone est couverte[127], parure royale qui convient merveilleusement au caractère majestueux et sculptural de sa beauté. La maîtresse de maison occupe la place d'honneur. Elle est assise sur son lit, en face même de la porte d'entrée. Le mobilier est pauvre. Fussions-nous chez un sénateur, nous sommes dans une chaumière ; et le feu de Vesta, les Pénates, les Lares, les masques de cire moulés sur les visages des ancêtres morts, les archives de la famille, sont les seuls trésors que la femme ait sous sa garde dans l'atrium[128]. Il y a une singulière opposition entre le luxe personnel de la matrone et la rustique simplicité de sa maison. C'est que le Romain veut adoucir pour sa compagne les austères devoirs de l'existence[129], et que, sans doute aussi, il aime à voir rayonner, sous une éclatante parure, le plus doux ornement de sa maison. D'ailleurs les riches vêtements de la matrone ont été faits sous ses yeux et avec sa coopération. Car ce n'est pas une femme inactive que nous voyons dans l'atrium. C'est une reine, il est vrai, mais une reine d'abeilles qui donne à ses sujettes l'exemple du fécond labeur. Comme la femme de l'Écriture, elle file la laine et distribue la tâche à ses servantes. Auprès d'elle, ses esclaves font tourner le fuseau ou courir la navette[130]. C'est une patricienne qui prolonge ainsi dans la nuit le
travail du jour. Écoutons maintenant Virgile lorsque, chantant les antiques
souvenirs du Latium, le doux poète contemple, avec un tendre respect,
l'humble plébéienne qui commence dans la nuit son labeur quotidien : Quand, la moitié de la nuit s'étant écoulée, le premier
repos a chassé le sommeil, dès ce moment la femme à qui il est imposé de
gagner sa vie par la quenouille et les délicats ouvrages de Minerve, ranime
la flamme assoupie sous la cendre, et ajoute la nuit à son travail. A la
lumière, elle exerce ses servantes à une longue tâche, afin de se garder
chaste à la foi conjugale et de pouvoir élever ses petits enfants[131]. Mais la maîtresse de maison n'est pas toujours dans l'atrium. A cette époque, comme nous le disions plus haut, le Romain passe aux champs la plus grande partie de sa vie. D'abord pasteur, puis agriculteur, il unit l'élevage des troupeaux à la culture de la terre. Tandis que ses bœufs, ses vaches, ses brebis, paissent l'herbe touffue, s'abreuvent aux sources pures, et que ses chèvres, bondissant sur les collines, broutent le feuillage des forêts, il s'étend à l'ombre des chênes verts. Fût-il patricien, lui-même il conduit la charrue, lui-même il porte la houe. Les blés qui couvrent les plaines ; les vignes que le soleil dore sur les collines et qui s'enlacent aux ormeaux ; les oliviers qui servent de tuteurs aux ceps, et sont, eux aussi, l'une des richesses du sol italien ; les saules et les peupliers dont le feuillage se reflète dans Fonde, tontes ces productions de la belle nature sont cultivées par la même main qui asservit les nations. Columelle nous dit que la matrone primitive remplissait elle-même les fonctions qui, plus tard, furent abandonnées à la métayère. En nous initiant aux labeurs de la seconde, Columelle, et avant lui, Caton, nous apprennent ainsi quelles furent les occupations de la première[132]. Avec ces guides précieux, suivons la matrone dans la villa rustique, non dans ces élégantes demeures que virent naître les siècles de luxe et de corruption, mais dans la petite ferme qui abritait les austères vertus d'autrefois. La maîtresse de maison a sous sa garde les objets nécessaires au culte domestique, les armes du guerrier, les vêtements de la famille, les meubles et les ustensiles du ménage. Elle veille à la conservation de toutes ces choses. Recevant les provisions du ménage, elle en examine la qualité et en règle l'emploi[133]. Elle scelle de son anneau ou ferme à clé les armoires, les coffres, le garde-manger[134]. La mère de famille va à l'étable quand les pâtres s'occupent de traire les vaches, les brebis, les chèvres, ou de faire allaiter les petits des animaux. La tonte des bêtes à laine se fait sous ses yeux, et la matrone vérifie le compte des toisons. Elle ne néglige pas non plus la basse-cour qui doit être peuplée de coqs, de poules et de poulets, et qui doit fournir une grande quantité d'œufs. La maîtresse envoie les esclaves aux champs, et retient à la maison ceux qui y sont nécessaires. Lorsque ses gens sont partis, elle visite la métairie pour s'assurer que nul paresseux n'y est resté contrairement à ses ordres. Mais si la maladie ou la fatigue a retenu un esclave à la ferme, la mère de famille doit le soigner ou lui prescrire le repos. Le temps est-il froid ou pluvieux, la matrone n'emploie pas ses servantes aux rustiques labeurs ; elle les retient à la maison, et partage avec ces femmes le travail de la laine. La matrone demande à chaque temps de l'année. les provisions qui doivent km préparées dans la métairie même. Elle fait confire les herbes, les haricots, la laitue, les oignons, les raves, les olives, les raisins, les prunes, les poires et les pommes ; elle fait aussi sécher ces deux dernières espèces de fruit, ainsi que les figues. Sous son active surveillance, les raisins, les grenades, les coings, les noix, sont conservés ; le miel que les abeilles ont déposé sur l'entablement du toit[135] est mis en œuvre et donne aussi la cire et l'hydromel ; le porc salé sèche sur la claie, les fromages sont livrés par le berger. Grâce aux précautions qu'a prises la mère de famille, les ustensiles nécessaires à la vendange et à la cueillette de l'olive ne manquent pas aux travailleurs. La matrone surveille aussi ces deux importantes récoltes, ainsi que la préparation du vin et de l'huile. Par ses soins, ces deux produits sont gardés dans des celliers ; les grains des céréales s'entassent dans des greniers secs, et fournissent une délicate farine[136]. Nous comprenons maintenant toute l'étendue des devoirs que remplissait la matrone, et nous savons de quelle manière la femme partageait avec son mari le gouvernement de la maison et l'administration des affaires domestiques. Columelle le fait justement remarquer : chacun des époux ne travaillait que pour les intérêts communs du ménage ; l'action extérieure du mari et l'action domestique de la femme convergeaient au même but : la prospérité du foyer ; et la matrone, elle aussi, enrichissait le fonds commun par son activité et son exactitude. Devant ce salutaire et fortifiant exemple que nous avons voulu admirer dans les plus humbles détails, comment ne pas nous rappeler encore la femme forte achetant une vigne avec le produit de son labeur ? C'est ainsi que l'épouse défendait l'honneur du toit conjugal, pendant que l'époux défendait l'honneur de la patrie. En s'armant pour son pays, le Romain combattait aussi pour son foyer ; et l'image de la femme, qui gardait celui-ci, enflammait encore la valeur du soldat[137]. Après les dangers des batailles, les luttes du Forum ou les travaux des champs, le Romain se reposait dans la demeure où sa femme faisait régner jusqu'à l'harmonie matérielle[138]. Il y respirait la paix et la joie que répandent la vertu et le travail. Cette épouse chérie et vénérée était vraiment la compagne du Romain. Il l'initiait à ses pensées, à ses desseins, et nous ne tarderons pas à voir combien fut grande dans les affaires publiques l'action de la matrone, action latente, mais souveraine ! L'homme respectait tant sa compagne que, pour éviter de lui témoigner une jalousie injurieuse, il ne revenait jamais de voyage sans la faire prévenir de son retour. Ce n'étaient que les habitudes de la matrone qui la retenaient à son foyer. Mais, libre de ses mouvements, elle a le droit de sortir, et la légende des Sabines nous a déjà appris quels hommages attendent la Romaine hors de sa demeure. Le magistrat même lui cède le pas ; et si son mari se trouve auprès d'elle dans un char, il n'est pas obligé de descendre de voiture pour saluer un consul qui passe. La maîtresse de maison peut, lorsqu'elle est seule chez elle, retenir un parent sous son toit et l'admettre à sa table[139]. Son mari est-il présent, elle fait avec lui les honneurs de la maison[140]. Simples étaient alors ces repas des Romains. Eût-il été trois fois consul, eût-il commandé les armées ou exercé la dictature, celui qui était attendu à un festin de famille ne s'y rendait qu'après les travaux champêtres qu'il quittait cependant plus tôt que de coutume. On le voyait descendre de la montagne en tenant sa houe[141]. Les convives réunis se plaçaient autrefois sur des bancs, devant le foyer même, et croyaient que les dieux assistaient à leurs repas[142]. Plus tard, mais encore à l'époque primitive, ils se mirent sur des lits d'ailleurs fort simples et dont le chevet de bronze portait seul un ornement, un emblème rustique, la tête d'un âne couronnée[143]. Mais la matrone avait alors des habitudes trop sévères pour adopter l'usage de ce lit. Elle continua de s'asseoir aux repas[144]. Sur une table de noyer, à trois ou quatre pieds, paraissaient les légumes cultivés par le chef de famille, et la bouillie que l'on servait dans un plat étrusque. Si le dîner avait lieu à l'occasion d'une fête, qui pouvait être le jour natal du maître de céans, la pièce de porc, détachée de la claie, donnait un plat de lard ; et si un sacrifice avait été offert, la viande fraiche figurait au festin[145]. La matrone présidait donc avec son époux aux rites religieux du foyer, aux travaux de la maison, aux affaires domestiques, et même à ces paisibles et joyeuses fêtes de famille après lesquelles on reprend avec plus de force et de gaieté les occupations journalières. Mais il est entre les époux une communauté de plus, et celle-ci est la plus importante, la communauté des enfants. Avant de dire ce que fut la mère, ajoutons encore quelques traits au rôle de l'épouse, et disons comment la femme était la seule maîtresse du logis, et comment la possession de cette place d'honneur lui était assurée. Aucun peuple de l'antiquité ne garda aussi sévèrement que le peuple romain le principe de la monogamie, tel que Dieu l'avait institué dans l'Éden. Alors aussi les liens du mariage étaient indestructibles, du moins par le fait. Limité par la loi, le divorce est repoussé par les mœurs. La loi permet à l'homme de répudier sa compagne si celle-ci a trahi la foi conjugale, ou empoisonné ses enfants, ou possédé de fausses clés. Après que le mari de cette femme aura pris l'avis du tribunal domestique, la loi l'autorise à prononcer la formule du divorce, cette redoutable formule qui est gravée dans les Douze Tables : Reprends ce qui est à toi[146]. Et la femme, qui jusqu'alors a été maîtresse de la maison, doit rendre à celui qui n'est plus son époux les clés dont elle avait la garde. L'homme, dont la respectueuse affection l'entourait naguère, lui fera entendre cette brève et dure parole : Va dehors, femme[147]. Et c'est ainsi qu'elle sera ignominieusement chassée de ce foyer où elle était reine. Si le mariage de la femme répudiée a été contracté avec la manus, d'autres formalités seront nécessaires. La confarréation, qui produit en même temps le mariage et la manus, sera dissoute par une cérémonie spéciale qui abolira, en même temps aussi, le lien nuptial et la puissance de l'époux : c'est la diffaréation, à laquelle doivent concourir les pontifes et les témoins qui ont présidé à la confarréation[148]. Quant à la coemption et à l'usus, formes matrimoniales qui ne fondent pas essentiellement dans le même acte le mariage et la manus, la formule du divorce ne suffira que pour déchirer le lien nuptial ; mais la puissance du mari subsistera encore. Pour détruire la coemption, il faudra une remancipation ; c'est-à-dire que, par une vente simulée, l'époux rendra l'épouse à ceux dont elle dépendait avant son mariage. L'usus demandera aussi une formalité qui nous est inconnue[149]. Si, en dehors des causes autorisées par la loi, le Romain renvoie sa compagne, il sera voué aux dieux infernaux ; ses biens seront confisqués ; la moitié de ceux-ci sera dévolue à l'épouse répudiée, et l'autre sera consacrée à Cérès, protectrice du mariage. Telle est la loi. Mais pendant cinq cent vingt années, non-seulement les Romains ne bravèrent pas ses défenses : ils ne recoururent mime pas à ses permissions. Et, dans cette longue période, Rome ne vit pas un seul divorce[150]. Ce fait ne prouve pas que toutes les matrones aient été vertueuses alors. Mais l'époux ayant les droits suprêmes d'un justicier, il ne chassait pas sa femme : il la tuait. Spurius Carvilius fut le premier Romain qui répudia sa compagne. Il jura devant les censeurs que c'était le désir d'avoir des enfants qui lui faisait quitter une épouse stérile. Néanmoins les Romains ne lui épargnèrent pas leur indignation[151]. Les froissements qui peuvent se produire dans les ménages les 'mieux unis avaient-ils troublé l'harmonie conjugale, les époux se rendaient à une chapelle située sur le Palatin, et consacrée à la déesse Viriplaca, celle qui apaise les maris. Tous deux se donnaient alors réciproquement les motifs de leur conduite, et, après cette loyale explication, ils se réconciliaient[152]. La mort seule rompait les liens du mariage. Pour attester une fois de plus que, dans le mariage avec la manus, l'homme et la femme ne formaient qu'une seule existence, l'époux survivant héritait de l'autre[153]. Si le mari laissait des enfants, la veuve recevait une part égale à celle de chacun d'eux. Sinon, elle était héritière universelle. Quant à la femme mariée sans la manus, elle n'avait aucun droit sur la succession ab intestat de son mari ou de ses enfants ; et réciproquement, ni son mari, ni ses enfants ne pouvaient lui succéder si elle était morte sans avoir testé. Mais l'époux et l'épouse, la mère et l'enfant, pouvaient-ils, comme dans le régime de la manus, être les héritiers testamentaires l'un de l'autre[154] ? Après sa douzième année, la femme aurait été apte à faire un testament, mais elle devait y être autorisée par ses tuteurs ; et ceux-ci étant, comme nous l'avons déjà vu, ses héritiers naturels, ne lui accordaient pas facilement, sans doute, une pareille autorisation. Il n'en était plus de même si la femme avait fait une coemption en dehors du mariage, ou bien si elle avait reçu de son père ou de son mari un tuteur testamentaire. Un tuteur qui n'avait aucun droit sur sa succession n'avait pas plus d'intérêt à la contrarier dans la destination de ses biens que dans la gestion de ceux-ci, et la pupille pouvait alors s'instituer des héritiers[155]. La femme non émancipée qui s'était mariée sans la manus, demeurant, après son veuvage, sous la puissance de son père ou la tutelle de ses agnats, ce n'était que sous le régime de la manus que l'époux avait le droit de donner à l'épouse un tuteur testamentaire, soit qu'il le lui désignât, soit qu'il lui permit de le choisir elle-même une fois ou plus. Si l'époux avait négligé cette formalité, la veuve tombait sous la tutelle des agnats de son mari. Ce dernier avait-il laissé des enfants, ceux-ci devenaient les tuteurs naturels de leur mère ou de leur belle-mère ; mais les Romains comprirent ce qu'une pareille situation aurait eu d'humiliant pour la dignité maternelle ; ils permirent donc à la mère de demander un tuteur aux magistrats[156]. Ainsi, à Rome, la veuve n'était pas contrainte, comme chez les Hindous et les Grecs, à subir le pouvoir de son fils. Loin de là Elle exerçait sur le mineur, non sans cloute une tutelle juridique, mais une surveillance dont la légitimité était reconnue par l'opinion[157]. Un passage de Tite-Live prouve même que, dans le vieux droit du Latium, la tutelle de la mère pouvait être exercée dans sa plus haute expression, la régence. L'historien nous apprend que Lavinie fut investie de ces fonctions, Lavinie, la timide jeune fille que nous a fait connaître Virgile, et qui, devenue matrone, est considérée par Tite-Live comme une femme d'un grand caractère. Avec une autorité qu'elle sait faire respecter, elle exerce la régence à Lavinium, ville à laquelle son époux a donné son nom. Devenu majeur, Ascagne, son fils ou son beau-fils, la laisse régner à Lavinium, et va fonder Albe-la-Longue[158]. Certes, elles eussent été dignes de tous les droits maternels, ces femmes qui n'avaient pas seulement mis des enfants au monde, mais qui les avaient nourris, et de leur lait, et de leurs vertus ; ces, femmes qui avaient donné à la patrie, dans leurs fils, de grands citoyens, dans leurs filles de chastes matrones ; ces femmes qui tiraient leur principale gloire de leur dévouement maternel joint à leur vigilance domestique[159]. Les droits mémos que la loi lui refusait et que la nature lui donnait cependant, la mère savait les revendiquer. Souvenons-nous de cette femme de l'antique Latium, cette Amata que Virgile a dépeinte avec un si énergique relief. C'est elle qui choisit l'époux de sa fille ; c'est elle qui s'oppose à ce que Lavinie épouse un étranger. Elle chérit Turnus, le fiancé que, dans son cœur, elle a donné à sa fille ; et d'ailleurs elle ne veut pas que cet Énée, ce Troyen, puisse un jour lui ravir son enfant et l'entrainer au-delà des mers. C'est la douleur qui parle d'abord en elle, et ce n'est que par ses larmes qu'elle essaie d'abord de fléchir son époux. Mais quand celui-ci lui résiste, son désespoir devient de la fureur. Comme la lionne qui emporte ses petits, elle prend sa fille, la cache dans les forêts qui couvrent les montagnes. Ici, par un anachronisme, Virgile place dans l'antique Latium ces Bacchanales qui ne s'introduisirent à Rome que très-tard, et il livre Amata à tous les transports des Bacchantes. N'importe, ne nous arrêtons pas à ces libertés de la poésie, et ne nous occupons que de la vérité avec laquelle Virgile a su faire protester cette reine et cette mère contre l'atteinte que reçoit son autorité maternelle. Amata insuffle sa rage à toutes les matrones latines, et c'est devant celles-ci qu'elle en appelle au droit des mères[160]. La reine est l'âme de la lutte guerrière que les Latins soutiennent contre les Troyens, et dont Lavinie est l'enjeu. Mais quand les revers accablent ses sujets et leurs alliés, quand Turnus va proposer à Énée ce duel qui décidera du sort de Lavinie, ce ne sont plus les transports de la colère qui animent la souveraine. Déjà la réaction a commencé, et de nouveau les pleurs couvrent ce visage que contractait une passion violente. La reine prend dans ses bras celui qu'elle aime comme un fils ; elle le supplie de ne point hasarder une vie sur laquelle reposent les destinées du Latium. Si Turnus meurt, elle mourra : jamais elle ne sera la captive d'Énée. Dans ce dernier sentiment respire encore la fierté de la matrone ; mais lorsque Amata croit que Turnus a succombé, lorsqu'elle voit approcher l'ennemi qui déjà incendie Laurente, la reine mesure toute l'étendue des malheurs qu'elle a causés. En recourant au suicide, elle obéira, non plus à la crainte de servir un étranger, mais au remords d'avoir fait verser le sang de ses amis, et d'avoir provoqué la ruine de son royaume. C'est en s'accusant qu'elle se tue. Combien ce type énergique, passionné, contraste avec la muette image de Lavinie ! Admirons l'art avec lequel le poète a su demeurer fidèle à la réalité en laissant dans une ombre modeste la vierge du foyer pour mettre en pleine lumière la matrone, la mère de famille. Le droit maternel, que revendiquait la matrone, était moralement reconnu. Bien que son consentement ne fût pas légalement demandé pour le mariage de sa fille, celle-ci écoutait sa voix pour choisir un époux. Quant au respect que le fils témoignait à sa mère, l'histoire et la poésie nous disent ce que fut ce sentiment. Le Romain était exercé, sous le toit paternel, à cette sévère discipline qui était alors la force de sa patrie, et qui, en le courbant sous les lois de son pays, lui apprenait à commander aux nations. Gémissant des vices de ses contemporains, Horace dira : Elle n'était pas née de tels parents, la jeunesse qui teignit du sang punique la plaine liquide, et battit et Pyrrhus, et le grand Antiochus, et le redoutable Annibal ; mais, mâle descendance de rustiques soldats, elle avait été instruite à retourner la glèbe avec le hoyau sabellique ; et, d'après les ordres d'une mère sévère, à apporter le bois coupé, quand le soleil change l'ombre des montagnes et que, amenant par la disparition de son char l'heure propice, il enlève le joug aux bœufs fatigués[161]. Couvert des plus hautes dignités, le Romain d'alors incline son pouvoir devant l'autorité maternelle. Nous ne tarderons pas à en rappeler le plus célèbre exemple. La mère tempérait par sa tendresse la souveraine puissance qu'elle exerçait sur son fils. Elle n'eût jamais la cruauté de la mère spartiate. Certes, lorsque son fils sortait de l'enfance, et que, devant les dieux, elle lui retirait l'ornement du jeune âge, la bulla, et le revêtait de la toge virile[162], elle devait être fière d'avoir donné un homme à sa patrie. Elle savait envoyer son fils à la bataille et l'armer de sa main[163]. Ses leçons avaient contribué à former le citoyen et le soldat. Cependant, que d'angoisses lorsqu'elle voyait partir le guerrier ! Et quel désespoir s'il était tué ! Virgile n'a pas craint de placer aux plus lointaines origines de Rome l'une de ces inénarrables douleurs. C'est dans l'admirable épisode de Nisus et d'Euryale. Seule de toutes les mères troyennes, la mère d'Euryale a suivi dans le Latium son fils, le plus beau des enfants d'Ilion. Elle aurait pu demeurer en sécurité dans l'asile offert aux Troyennes par un prince de Sicile ; mais elle n'aurait pu vivre sans son fils ! Elle a donc bravé, pour l'accompagner, les hasards des batailles et la rude, vie des camps. L'image de cette tendre mère n'empêche pas le bouillant jeune homme de vouloir suivre, dans une périlleuse expédition, Nisus, le plus cher de ses amis. Un rejeton de cette vieille race qui allait être la souche du peuple romain devait savoir immoler à la gloire des armes les résistances mêmes de l'amour filial. Et cependant Euryale n'a pas eu la force d'annoncer à sa mère son généreux dessein, ni de lui faire un adieu qui pouvait être le dernier... En prenant congé d'Ascagne, fils d'Énée, il lui dit : Je prends à témoin et la Nuit, et ta main, que je ne pourrais supporter les larmes de ma mère[164] ; et il confie à son prince cette mère bien-aimée. Que, pendant l'absence de son fils, elle trouve en Ascagne un consolateur, un appui ; et le jeune soldat partira avec plus de courage. L'accent de la piété filiale n'a pas été vainement entendu d'Ascagne, le fils pieux séparé de son père. Son cœur s'est serré, ses larmes ont jailli, et il a promis à Euryale d'être un fils pour la mère de celui-ci. Nisus et Euryale ont trouvé la mort dans leur glorieuse entreprise ; et le lendemain matin leurs tètes, fixées au bout de deux lances, sont montrées aux Troyens. La mère d'Euryale tissait alors des vêtements pour le fils chéri qui jamais ne devait les porter. Elle entend l'horrible nouvelle, et la navette échappe à sa main défaillante. La mère se précipite, elle court, râlant de douleur et lacérant sa chevelure. Les soldats qui se battent, les traits qui volent au-dessus de sa tête, rien ne peut l'arrêter. La voici au premier rang de la bataille ; et voici devant elle le sanglant trophée. Alors elle parle à ce fils qui ne peut plus l'entendre. Plaintes et reproches s'exhalent de son cœur torturé. Retrouver ainsi celui dont elle n'a pas reçu l'adieu, et dont elle ne pourra même ensevelir les restes épars ; penser que c'est pour contempler cet horrible spectacle qu'elle a suivi son fils sur terre et sur mer, toutes ces déchirantes impressions lui font implorer comme une grâce la mort libératrice. A ses cris répondent les gémissements des soldats qui l'entourent. Les guerriers sentent même fléchir leur courage. Devant cette vieille femme privée de son unique appui, peut-être songent-ils qu'eux aussi ils pourront manquer à leurs mères. Ascagne, tout en pleurs, fait emporter loin du champ de bataille la femme dont il a promis d'être le fils. Dans cet épisode écrit par Virgile avec le cœur d'un fils et les entrailles d'une mère, à quelle distance nous sommes de cette Spartiate que réjouit la mort glorieuse de son fils ! Et quel plus vif contraste dans ces deux faits produits par une même situation : la mère lacédémonienne tuant son fils qui a survécu a une défaite de l'armée spartiate ; et ces deux mères romaines qui meurent de joie en voyant revenir leurs fils qu'elles croyaient morts Trasimène ! C'est qu'à Rome, nous l'avons dit plus haut, la femme savait allier les tendresses de la famille à l'amour de la patrie. Brutus faisant mourir dans ses propres fils les affidés de Tarquin ; Manlius Torquatus condamnant dans son fils, le soldat qui s'est battu sans son ordre et qui cependant a triomphé ; ces hommes au cœur inflexible qui sacrifiaient ainsi la vie de leurs enfants à la liberté civique et à la discipline militaire, ces héros n'ont pas eu de pendants parmi les mères romaines, rendons-en grâces au ciel. Si, à l'époque primitive, nous considérons le rôle collectif de la femme au milieu des événements historiques, nous sentirons toujours battre dans le sein de la matrone un cœur à la fois romain et féminin. En deux occasions, elle sauva la ville éternelle, soit qu'elle réconciliât les Romains et les Sabins, soit qu'elle fit arrêter, par les larmes d'une mère et celles d'une épouse, la marche triomphale et vengeresse de Coriolan exilé. Quand les guerriers combattent et que Rome est en danger, les matrones remplissent les temples et demandent aux dieux le salut de la patrie[165]. Au bruit d'une défaite, ces femmes, qui sortent si rarement de leurs maisons, courent dans les rues, se tiennent même aux portes de la ville, et cherchent avidement à connaître, non pas seulement, comme la Spartiate, le résultat de la bataille, mais le sort des combattants. Rome fût-elle vaincue, la matrone peut encore ressentir l'émotion du bonheur en revoyant les guerriers qui lui sont chers : nous en citions plus haut un touchant exemple. Mais quelle double ivresse lorsqu'elle apprend à la fois le triomphe de Rome et le salut des combattants aimés ! Tite-Live nous apprend ce que fut cette joie délirante. Dans une guerre contre les Volsques, l'infanterie a fléchi ; mais, par un suprême effort, les cavaliers, bien que peu nombreux, ont tenté de sauver l'honneur du nom romain. L'armée et la ville croient qu'ils ont péri dans leur noble entreprise, et déjà leurs familles les pleurent. Soudain un grand cri retentit à Rome : Vivants et victorieux, les cavaliers reviennent[166]. Tremblantes, éperdues, les mères et les femmes des héros se précipitent hors de leurs maisons, courent au-devant des vainqueurs, et, oubliant, dans cet ineffable transport, qu'à Rome surtout l'ombre seule du foyer doit abriter les plus légitimes épanchements, elles se jettent dans les bras de leurs époux et dans ceux de leurs fils. A l'heure d'une victoire nationale, les matrones savent rendre aux dieux de magnifiques actions de grâces. Elles ne se bornent pas à remplir les temples. Après une défaite des Véiens, elles apportent leur or et leurs bijoux à l'État pour que Rome puisse envoyer au temple de Delphes l'offrande que Camille a promise à Apollon en échange de la victoire. Tite-Live rappelle que rien ne fut plus agréable au Sénat que cet élan spontané. Aussi l'auguste assemblée ne se contenta-t-elle pas de payer en argent aux matrones le prix de leur offrande. A cette époque où la circulation des voitures était interdite dans les rues si étroites de Rome, le Sénat décerna, dit-on, aux matrones, le droit de se rendre aux sacrifices et aux jeux publics dans les pilenta, chars magnifiques, ouverts sur les côtés ; et le Sénat permit aussi qu'aux jours fériés et non fériés, les compagnes des Romains se servissent des voitures couvertes nommées carpenta[167]. Quant à l'or qu'elles avaient donné, l'on en fit un objet spécial, un cratère[168]. Le moment approchait où le patriotisme des matrones allait être mis à une plus grande épreuve. Voici que les enseignes de l'armée gauloise apparaissent aux portes de Rome. Les jeunes Romains vont monter au Capitole et y conduire les femmes et les enfants, pour sauvegarder le plus longtemps possible, avec le dernier asile de leur indépendance, les seuls biens qui restent aux vaincus : l'honneur de la cité, la pureté des femmes, et ce suprême espoir de la patrie : les berceaux ! Les matrones ont le cœur déchiré par un cruel combat. Suivront-elles les jeunes guerriers dont elles sont ou les femmes ou les mères ? Demeureront elles auprès des vieillards qui restent, ces vieillards, époux de celles-ci, pères de celles-là et qui vont être exposés à toutes les horreurs d'une invasion barbare ? Les malheureuses femmes errent des premiers aux seconds. De chaque côté elles laisseront une partie de leur cœur. Enfin, suivant sans doute la voix de leurs plus impérieuses affections, les unes montent au Capitole, les autres, qui sont les moins nombreuses, restent dans la ville. L'ennemi entre. Aucune violence ne signale d'abord la prise de Rome ; mais, à la suite d'un incident célèbre, les sénateurs sont massacrés, ainsi que leurs compagnes d'infortune ; les maisons sont pillées et incendiées ; et, du haut du Capitole, les derniers Romains voient brûler leur ville, leurs foyers ; ils entendent les clameurs de l'ennemi, le fracas des toits qui s'écroulent, et un autre bruit, le plus sinistre et le plus horrible de tous : les cris des femmes et des enfants que l'on égorge[169], ces cris dans lesquels plus d'un assiégé de la citadelle croit peut-être distinguer la vibration d'une voix aimée. La famine qui, à toute époque, est lapins sûre alliée des assiégeants, la famine affaiblit les assiégés. Les envahisseurs le savent et s'en réjouissent ; ils disent que ce manque de vivres leur ouvrira la citadelle, et, suivant une tradition, les assiégés leur répondent en leur jetant, avec une dédaigneuse pitié, des morceaux de ce pain qui est devenu si rare[170]. Et néanmoins le moment fatal approche, le moment psychologique, dira-t-on en d'autres temps, hélas ! trop connus de nous ! Il faut payer la rançon de Rome. Pour qu'il ne soit pas touché aux trésors sacrés qui, des temples, ont été transportés au Capitole, les matrones offrent leur or. Des actions de grâces sont rendues aux généreuses Romaines, et la patrie, reconnaissante, leur accorde un privilège jusqu'alors réservé aux hommes : celui d'être célébrées après leur mort par une oraison funèbre[171]. La rançon de Rome se pesait sous le regard de l'ennemi, lorsque l'arrivée de Camille vient annuler le traité. Le dictateur ordonne aux Romains de reconquérir leur patrie, non par l'or, mais par le fer, en ayant sous les yeux, et les temples divins, et leurs femmes, et leurs enfants, et le sol de la patrie ravagé par les maux de la guerre, et tout ce qui doit être défendu, et repris, et vengé[172]. Rome s'était délivrée, non rachetée. Les matrones auraient pu chercher à reprendre leur don, elles ne le firent pas. L'or qu'elles avaient offert s'étant trouvé confondu avec les trésors des temples, le tout fut déclaré sacré, et déposé sous le trône de Jupiter[173]. Par une de ces étranges vicissitudes qui sont les grandes leçons de l'histoire, nous avons vu, de nos jours, les filles des Gaulois suivre l'exemple que leur avaient donné les Romaines. Idée généreuse, mais impraticable, car la rançon de la France était moins aisée payer que la rançon de Rome. C'est l'or même de notre nation qui a dû être pesé dans la balance ; et cette balance, nul Camille, hélas ! n'a pu la renverser. Pour employer, en la retournant, l'admirable expression que rapporte Tite-Live, c'est par l'or, non par le fer, que nous avons dû reconquérir la patrie, ou, pour mieux dire, ce qui nous restait de la patrie ! Mais revenons à Reine. Ces matrones, qui aimaient tant leur pays, savaient l'honorer dans ses grands hommes. Elles portèrent, aussi longtemps que pour leurs proches parents, le deuil de Brutus, de Valérius Publicola, de Ménénius Agrippa, de Coriolan[174]. Les femmes avaient un titre particulier pour rendre cet hommage aux vengeurs de Lucrèce et au fils de Véturie ; et quant Ménénius Agrippa, le médiateur de Rome pendant les discordes civiles, n'était-il pas naturel aussi de le voir publiquement pleuré par les femmes, ces doux ministres de paix et de réconciliation ? Les antiques matrones demeuraient donc toujours femmes en se montrant Romaines : elles étaient encore fidèles à ce double titre quand elles comblèrent de fruits le gouffre dans lequel s'était jeté Curtius pour sauver sa patrie[175]. La matrone prenait une part considérable au gouvernement de l'État. Mais ce n'est point d'une manière directe qu'elle intervenait dans les affaires publiques. Alors que l'on trouvait si extraordinaire de voir une femme plaider elle-même sa cause, que, lorsque cet exemple se produisit, le Sénat fit demander à l'oracle de Delphes ce qu'annonçait à la république un semblable précédent[176], il eût paru bien plus anormal encore qu'une matrone se mêlât ostensiblement aux luttes du Forum. C'était par son influence domestique que la femme agissait sur la direction de l'État. Deux reines apparaissent ici, Tanaquil et Tullie. Tanaquil est de race étrusque et de haute naissance. Elle a épousé Lucumon, fils d'un opulent exilé de Corinthe, réfugié à Tarquinium. Les Étrusques méprisent en Lucumon le fils d'un marchand, le fils d'un étranger proscrit. Tanaquil se révolte de ce dédain. Elle n'a pu faire de son époux un vrai citoyen de Tarquinium : elle en fera un roi des Romains. Rome, cette ville nouvelle, Rome sur laquelle déjà ont régné des étrangers, Rome ne refusera pas de se laisser gouverner par un fils de la Grèce. C'est pourquoi Tanaquil conseille à son époux de quitter Tarquinium pour la cité de Romulus. Lucumon cède aux exhortations de sa femme et tous deux montent dans un carpentum. Une suite nombreuse les accompagne. Les voyageurs sont arrivés au Janicule, et déjà Rome déploie devant eux ses lignes majestueuses et vraiment royales. Tout à coup un aigle enlève le bonnet de feutre que porte l'époux de Tanaquil, et après avoir volé avec grand bruit au-dessus du char, remet cette coiffure sur la tête de Lucumon. Habile dans cet art augural que possédaient les Étrusques, Tanaquil reçoit, dit-on, avec joie ce qu'elle considère comme un présage. Devant cet horizon romain que remplira la gloire de son époux, elle embrasse l'élu des dieux. Elle lui annonce qu'il sera roi ; elle lui demande d'élever son âme à la hauteur de ce titre, et fait passer dans son esprit les grands desseins qu'elle a formés[177]. A Rome, l'ancien habitant de Tarquinium prend deux noms dont le principal est un souvenir de la ville qu'il a quittée : il s'appellera désormais Tarquin[178]. Sa femme adopte les noms de Caïa Cécilia, mais les historiens continuant de l'appeler Tanaquil, nous suivrons cet exemple. Le nouvel habitant de Rome devient l'ami du roi Ancus Martius et le tuteur de ses enfants, enfin son successeur. Il est permis de penser que Tanaquil ne fut pas étrangère aux moyens que son époux employa pour arriver au trône. Du reste, la harangue qu'il adressa aux Romains, pour solliciter leurs suffrages, reproduisait les mêmes arguments dont Tanaquil s'était servie pour l'entraîner dans la cité nouvelle[179]. Tanaquil est reine ; mais il ne lui suffit pas d'avoir fait monter son époux sur le trône : elle veut encore de ses mains pétrir une âme royale. Dans le palais était né le fils d'une captive. Cet enfant
se nommait Servius Tullius. Il dormait quand une flamme mystérieuse vint
entourer sa tête. Les cris d'étonnement que fait jeter ce spectacle attirent
le roi et la reine. Tanaquil s'oppose à ce que l'on apporte de l'eau pour
éteindre ce feu, et défend aussi de réveiller Servius. Le sommeil abandonne
le fils de la captive, et la flamme s'éteint. La reine conduit son époux à
l'écart : Vois-tu, lui dit-elle, cet enfant que nous élevons dans un si humble genre de vie
? L'on peut compter qu'un jour à venir, il sera une lumière dans nos affaires
douteuses, un soutien pour notre royauté ébranlée. Nourrissons clone de toute
notre sollicitude cet objet d'une grande gloire pour le peuple et pour notre
maison[180]. Tanaquil avait reconnu dans cette flamme mystérieuse le rayonnement du génie[181]. Son mari et elle s'efforcèrent d'alimenter ce noble feu. Une haute culture intellectuelle éleva le jeune homme à la conception des plus vastes desseins politiques. Cependant le roi et la reine avaient un fils. En préparant au trône un homme qui n'était pas de leur sang, savaient-ils que l'héritier immédiat de leur nom ne vivrait pas assez longtemps pour briguer, à la mort de son père, une royauté qui était élective ? Ou bien, plus attachée aux intérêts de l'État qu'à ceux de sa maison, Tanaquil s'était-elle dit que, sur le front de son enfant, ne resplendissait pas l'auréole qui lui avait désigné, dans le fils d'une captive, le futur roi de Rome ? Tarquin et sa compagne marièrent Servius à Tarquinie, l'une de leurs filles[182]. Cette princesse aima son époux ; et cette tendresse, qui survécut à la durée d'une longue union, accompagna Servius jusque dans le tombeau. Après un règne dont les entreprises militaires, les institutions politiques et les grands travaux d'édilité durent plus d'une fois être inspirés par Tanaquil, Tarquin fut assassiné. Les auteurs du complot étaient les fils même d'Ancus Martius, les anciens pupilles de Tarquin. Ceux-ci pouvaient alors se rendre maîtres du trône. Tanaquil le comprit. Pour cette nature énergique, ce n'était pas le moment des larmes, c'était celui de l'action. Aux cris qui retentissent dans la résidence royale lorsque
le souverain a été frappé, le peuple accourt. La reine fait fermer les portes
du palais, et a soin d'écarter les témoins gênants. Elle secourt le moribond.
Ces soins peuvent sauver le roi, sinon faire croire au peuple que cet espoir
n'est pas perdu. Tanaquil mande alors son gendre. Lui prenant la main, elle
lui montre le roi agonisant ; et, devant ce corps qui bientôt sera un cadavre,
elle l'adjure de venger son père adoptif et de la défendre elle-même. A toi, Servius, la royauté, si tu es homme,
dit-elle, non à ceux qui, par des mains étrangères,
ont commis un détestable attentat. Relève-toi, obéis aux dieux qui, par ce
feu divin enveloppant ta tête, annoncèrent que tu serais illustre.
Maintenant, que cette flamme du ciel t'excite ! Maintenant, réveille-toi
véritablement. Nous aussi, étrangers, nous avons régné. Tiens compte de ce
que tu es, et non d'où tu es né. Si ces avis imprévus paralysent ton action,
du moins laisse-toi conduire par moi[183]. La reine entend le redoublement des clameurs populaires. Paraissant à une fenêtre supérieure du palais, elle rassure le peuple, lui annonce que le roi est hors de danger, et que, d'après les ordres de celui-ci, Servius remplira les fonctions royales jusqu'à ce que Tarquin puisse les reprendre lui-même[184]. Déjà Servius avait assuré son pouvoir lorsque les Romains connurent la mort du roi. Son règne, sage et libéral, fut digne de l'élève de Tanaquil. Suivant une tradition, un moment vint où Servius voulut résigner le pouvoir et laisser à la nation le gouvernement d'elle-même. Mais Tanaquil, alors mourante, lui fit jurer de conserver à l'État la forme monarchique et de garder la couronne[185]. Tel aurait été le dernier acte de cette femme extraordinaire qui, pour remplir ses grands desseins politiques, s'exila de sa terre natale, et qui, plus tard, pour assurer l'avenir de ses puissantes conceptions, sacrifia jusqu'à l'ambition maternelle. Selon le mot d'un vieil auteur français, Tanaquil fut un véritable homme d'État. Cependant cette femme qui avait été la créatrice de deux rois, et sans doute aussi l'âme de leurs règnes, cette femme tint, à son foyer même, les rênes du gouvernement ; cette femme fut le type de la bonne ménagère, le modèle des fileuses ; et c'était probablement en souvenir de sa mission domestique que l'un de ses deux noms latins était donné à la mariée dans une coutume nuptiale. Le rouet, la quenouille et les sandales de Tanaquil se conservèrent dans le temple où s'élevait sa statue de bronze : c'était le temple de Semo Sancus, demi-dieu sabin paraissant avoir représenté cette lumière céleste qui préside ici-bas à l'ordre et à la justice[186]. C'était rendre à Tanaquil un cligne hommage que de poser dans un sanctuaire de la lumière immatérielle l'image de la femme qui avait reconnu, dans l'auréole d'une haute intelligence, la place d'une couronne à venir. La quenouille et le rouet de la souveraine, ses sandales, chaussure de maison, nous disent aussi que la femme ne doit entrer sur la scène de l'histoire qu'avec les modestes attributs de son sexe et sans quitter le foyer domestique. Petite-fille de Tanaquil par sa mère Tarquinie, Tullie, fille cadette de Servius, n'hérita de son aïeule que la soif du pouvoir, sans y joindre la grandeur d'âme qui ne permet à l'ambition de triompher que par des moyens honnêtes. Unie à Aruns Tarquin, petit-fils du dernier roi, Tullie méprise ce doux et paisible jeune homme qui ne s'associe pas à la haine qu'elle a vouée à son père. Elle n'estime que le fougueux Lucius Tarquin, frère aîné de son époux et mari de sa sœur. Tullie reconnaît en ce prince l'ambition qui la dévore elle-même ; et, dans cette passion dominante de Lucius, elle croit reconnaître le bouillonnement d'un sang royal. Cependant l'aîné des Tarquins, malgré l'ardent désir qu'il éprouve de détrôner son beau-père, ne trouverait peut-être pas en lui-même la force d'accomplir ce crime. Il fait même céder ses ambitieux desseins aux larmes et aux prières de sa compagne, Tullie l'aînée, qui, bien différente de l'autre Tullie, observe avec amour le culte de la piété filiale. Mais la plus jeune fille de Servius prend entre ses mains l'âme de Lucius, la façonne à l'image de la sienne, et un jour vient où un double fratricide fait du beau-frère et de la belle-sœur deux époux dignes l'un de l'autre[187]. Après l'adultère et le fratricide, le parricide ! Tarquin
voudrait encore s'arrêter sur cette pente fatale ; mais nuit et jour Tullie
le pousse en avant. Ce qui lui manquait,
disait-elle, ce n'était pas un homme dont elle fût
l'épouse et avec qui elle servit en silence : ce qui lui manquait, c'était un
homme qui s'estimât digne du ; trône ; qui se souvint d'être le fils de
Tarquin l'Ancien[188] ; qui aimât mieux avoir le royaume que de l'espérer.
— Si tu es celui auquel j'ai jugé bon de me marier,
je te nomme et mon époux et mon roi. Autrement mon sort est changé contre un
pire, attendu qu'ici le crime se joint à la lâcheté. Que ne te prépares-tu ?
Il ne t'a pas été nécessaire, comme à ton père, de venir de Corinthe ou de
Tarquinium pour conquérir avec effort un trône étranger. Tes dieux pénates et
ceux de ta patrie, et l'image de ton père, et la résidence royale, et dans
cette demeure le trône royal et le nom des Tarquins, te créent et te nomment
roi. Ou si pour cela tu as peu de courage, pourquoi trompes-tu le citoyen ?
Pourquoi te laisses-tu regarder comme un royal jeune homme ? Il faut
maintenant agir en Tarquin ou en Corinthien[189]. Plus semblable à ton frère qu'à ton père, retourne
immédiatement à ta première extraction[190]. En irritant l'amour-propre de Tarquin, cette mordante ironie surexcitait également son ambition, mais non pas assez vite au gré de Tullie. Elle ne pouvait supporter l'idée que son aïeule, l'étrangère Tanaquil, avait fait deux rois, tandis qu'elle, née de sang royal, n'avait pas la faculté de disposer d'un trône. Enfin elle triomphe des dernières irrésolutions de Tarquin[191]. Elle apprend un jour que son mari occupe au Sénat le trône de son père. Montée sur un char, elle parait au Forum pour saluer la première, du nom de roi, l'homme qu'elle a fait monter sur le trône par un échelon d'exécrables forfaits. A l'appel de sa compagne, Tarquin sort de la curie pour venir à elle. Cependant il ne peut voir sans déplaisir la démarche qui, au mépris des anciens usages, a conduit Tullie au lieu des assemblées publiques. Il ordonne à la nouvelle reine de s'éloigner. Mais, avant de se retirer, l'horrible créature a probablement pu dire à son époux qu'il ne suffisait pas d'avoir enlevé la couronne à son père, et que la vie de ce vieillard était encore- un danger pour le nouveau roi... Parvenu à l'extrémité du Vicus Cyprius, le carpentum de Tullie tournait à droite pour s'engager dans le Vicus Urbius quand soudain les mules s'épouvantent. Le conducteur pâlit Cet homme montre à la reine qu'un obstacle arrête la course du char : c'est un cadavre, le cadavre de Servius. Mais la femme qui, pour monter sur le trône, n'a reculé ni devant l'adultère, ni devant le fratricide, ni devant le parricide, cette femme ne laissera pas entraver sa course vers la résidence royale par le corps de son vieux père. Elle ordonne au conducteur de faire passer sur le cadavre les roues de son char. Le sang de son père rejaillit sur elle[192], et lorsque Tullie entre dans le palais, une autre pourpre que celle de la royauté rappelle que la reine des Romains est la fille parricide de Servius. C'était de ce même palais que, vingt-cinq ans plus tard, Tullie devait s'enfuir, tandis que, sur son passage, hommes et femmes la chargeaient d'imprécations et la vouaient aux Furies qui vengent les parents[193]. Toujours le nom de Tullie fut exécré des Romains, qui nommèrent le Vicus Cyprius, la Voie Scélérate. Une autre malédiction que celle du peuple frappa la parricide : la malédiction de sa mère, cette malheureuse Tarquinie il laquelle il ne restait plus qu'un enfant : le monstre qui lui avait ravi une autre fille et un époux. Ce fut en proférant des imprécations contre les meurtriers de Servius que la royale veuve enterra elle-même l'ami de ses jeunes années, le compagnon de sa vieillesse. Elle mourut la nuit suivante, tuée soit par le chagrin, soit par un nouveau parricide[194]... Une légende raconte que Tullie ayant osé se présenter dans un temple où s'élevait une statue de Servius, la statue porta la main devant ses yeux et dit : Voilez mes traits ; que les regards sacrilèges de celle qui est née de moi ne les voient pas ![195] Depuis ce temps, des toges superposées couvrirent à jamais la tête de la statue. Ce n'était pas sous de tels auspices que Tanaquil était entrée au palais des rois. Ainsi que le remarque un pieux auteur[196], quel contraste entre l'aïeule et la petite-fille ! L'une n'emploie que des moyens honnêtes pour faire parvenir son mari à une royauté élective ; l'autre, pour atteindre au même résultat, commet les crimes les plus atroces. Tanaquil fait servir ses grands desseins aux intérêts du pays, et les Romains se souviendront toujours avec reconnaissance qu'ils lui doivent deux de leurs meilleurs rois ; Tullie donne aux anciens sujets de son père un despote en qui périra l'institution de la royauté ; elle est encore ou la mère, ou du moins la digne belle-mère de ce Sextus qui, par un attentat que nous allons rappeler, provoque l'écroulement du trône paternel et l'exil de ses parents. Pendant le siège d'Ardée, Sextus réunissait à un repas ses amis, les jeunes princes de la maison royale. Les convives parlent de leurs femmes absentes, et la séparation rendant sans doute celles-ci plus attrayantes, chacun des maris évoque sous un séduisant aspect l'image de sa compagne. Mais l'un d'eux, Tarquin Collatin, déclare que, bien mieux que des paroles, des actes prouveront combien sa Lucrèce l'emporte sur les autres femmes. Que ses amis et lui montent à cheval, qu'ils arrivent inopinément auprès de leurs épouses, et surprennent celles-ci dans les occupations auxquelles elles seront livrées[197] ! Avec l'élan de la jeunesse, et sous l'influence d'une boisson capiteuse, les princes volent à Rome sur leurs rapides coursiers. De là ils se rendent à Collatie, ville qui déploie sur les collines son doux paysage[198]. Il fait nuit, et cependant les brus de Tarquin le Superbe et leurs amies, réunies à un splendide festin, prolongent les plaisirs de la table. Il fait nuit, et cependant Lucrèce et ses femmes, groupées dans l'atrium, prolongent les pures joies du travail. La jeune et belle compagne de Collatin file de la laine : elle triomphe avant de savoir qu'elle a combattu. L'heureux époux, ravi de cette victoire qui est aussi la sienne, invite ses amis à passer la nuit sous son toit. Le lendemain il repart avec ses hôtes. Sextus n'a pu voir impunément Lucrèce. Ce ne sont pas les charmes seuls de la princesse qui l'attirent : la vertu de la jeune matrone, cette vertu qui devrait arrêter Sextus, devient, pour l'amour-propre de cet homme dépravé, un aiguillon de plus[199]. Pour conquérir cette belle et chaste femme, rien ne le fera reculer, ni le respect des liens de famille, ni les lois de l'hospitalité. Peu de jours après le départ des princes, Lucrèce voit revenir Sextus arec un seul compagnon. Elle le reçoit avec bonté ; et, après le repas, le fait conduire dans la chambre qui lui est destinée. La nuit est profonde. Personne ne veille plus dans la maison, personne si ce n'est le traître qui va y jeter le déshonneur. Lucrèce est livrée à ce doux sommeil qui suit une journée de vertueux labeur, et que ne connaîtront jamais ni les corps oisifs ni les âmes troublées. Mais la jeune femme se réveille en sursaut. Un homme est devant elle : Tais-toi, Lucrèce, dit l'apparition, je suis Sextus Tarquin ; le fer est dans ma main : si tu profères une parole, tu es morte[200]. Ce n'est pas une semblable menace qui peut ébranler la victime : elle préfère la mort à la honte. Sextus le comprend. Aussi n'est-ce plus cette alternative qu'il offre à Lucrèce. Elle n'aura à choisir qu'entre deux espèces de déshonneur. Si elle ne consent pas à subir l'outrage qu'il veut lui infliger, il ne se bornera pas à la tuer : il mettra auprès de son cadavre le cadavre d'un esclave égorgé ; et le lendemain Rome saura que la vertueuse Lucrèce a subi, avec un complice, le châtiment qu'aura infligé à deux coupables Sextus, vengeur de Collatin. Lucrèce n'a pas la force d'accepter cette suprême ignominie. Elle ne supporte pas l'idée que son père, son époux, croiront qu'elle est morte infâme[201]. Le religieux auteur que nous avons déjà cité[202] fait remarquer combien ici l'attitude de Suzanne est supérieure à celle de Lucrèce. Lorsque les vieillards menacent la sainte Israélite de la calomnier si elle demeure innocente, Suzanne reste inébranlable. Le mépris de son époux et de ses parents ; la lapidation, ce supplice hébraïque de l'épouse infidèle, Suzanne accepte tout plutôt que de pécher devant la face du Seigneur ! Oui, Suzanne fut plus héroïque que Lucrèce ; mais disons aussi qu'elle devait à la religion du vrai Dieu une force surnaturelle que la plus vertueuse des Romaines ne pouvait demander au culte de ses faux dieux. Sextus est parti. Lucrèce fait mander en toute hâte Lucrétius, son père, et Tarquin Collatin. La jeune femme est assise dans sa chambre. Elle médite une mâle résolution ; et cependant, lorsqu'elle voit entrer son père et son mari, ses larmes coulent. Te portes-tu bien ?[203] lui demandent-ils avec sollicitude. — Nullement, répond-elle, car, qu'y a-t-il de sauf dans une femme qui a perdu sa pudicité ?[204] Et elle leur dit qu'elle est déshonorée, mais que son âme du moins est demeurée pure : Ma mort l'attestera[205], ajoute-t-elle. La princesse demande que son père et son époux lui jurent, en lui donnant la main, que l'attentat dont elle est victime ne restera pas impuni. L'auteur de ce crime, elle le nomme : c'est Sextus Tarquin, l'homme qui a été son hôte. Devant le désespoir de Lucrèce, le père et le mari
oublient leur propre affront pour essayer de rendre à la malheureuse femme la
paix du cœur. Eux aussi, ils lui disent ce que sa conscience lui a déjà crié
: elle n'est pas coupable ! Où l'intention n'existe
pas, la faute est absente. — Vous,
leur réplique-t-elle, voyez ce qui est dû à cet
homme ; moi, quand bien même je m'absous du crime, je ne m'affranchis pas du
châtiment. Que désormais nulle femme coupable ne s'autorise de l'exemple de
Lucrèce pour vivre[206]. Et, tirant un
couteau qu'elle tenait caché sous sa robe, la fière Romaine se perce le cœur,
et tombe morte aux pieds de ces êtres chéris qu'elle a involontairement
déshonorés, mais dont elle lave la honte dans son sang. Terrible réparation
qui ne venge leur honneur que pour déchirer leurs âmes, et qui leur fait
jeter des cris de désespoir[207]. Mais un spectacle imprévu fait céder un moment leur
chagrin à un autre sentiment : la surprise. Ils n'étaient pas venus seuls ;
deux de leurs amis les accompagnaient : Brutus et Valérius. Brutus, le prince
qui devait son nom à l'apparence d'une stupide folie, Brutus arrache de la
plaie le couteau de Lucrèce, et élevant ce fer d'où ruisselle le sang de la
matrone : Par ce sang si pur avant l'injure royale,
dit-il, je jure, et je vous prends à témoin, ô
dieux, que je poursuivrai par le fer, par le feu, par quelque moyen qui dorénavant
soit en mon pouvoir, Tarquin le Superbe avec sa scélérate compagne et toute
la race de ses enfants, et que je ne souffrirai pas que ni eux, ni quelque
autre, règnent à Rome[208]. Il passe le couteau à l'époux, puis au père, enfin à Valérius. Tous répètent le serment de Brutus ; et lorsque les conjurés portent au Forum le corps de la victime, le peuple indigné exécute le vœu de leur vengeance. Ainsi que les douleurs de l'oppression présente, les lugubres souvenirs du passé, le meurtre de Servius, les forfaits de Tullie, incitent de leur aiguillon la colère des Romains[209]. Jusqu'alors, ceux-ci ont courbé la tête sous le joug. Mais ce peuple qui s'est laissé gouverner par les meurtriers, à la fois régicides et parricides, d'un de ses meilleurs princes ; ce peuple autrefois si fier et qui a supporté pendant vingt-cinq années une tyrannie aussi cruelle qu'ignominieuse, ce peuple se lève pour venger l'honneur d'une chaste matrone. C'est qu'il est une chose à laquelle on ne pouvait toucher impunément à Rome : le respect du sanctuaire domestique ; et l'on a justement remarqué que Rome accomplit ses deux plus grandes révolutions pour châtier les profanateurs de ses foyers[210]. Pour Lucrèce, home chasse ses rois, comme plus tard, pour Virginie, elle dépose ses décemvirs. Aux yeux des Romains, l'action de Lucrèce demeura un éternel exemple d'héroïsme. Il a fallu la lumière de la religion chrétienne pour que l'homme comprit une vérité qu'il avait déjà entrevue au sein du paganisme : c'est qu'il n'a pas le droit de disposer d'une vie qu'il ne s'est pas donnée. Comme le dit saint Augustin, Lucrèce se tua afin qu'elle ne fût point soupçonnée d'avoir été la complice de Sextus[211]. Ajoutons qu'elle obéissait en cela au même sentiment qui, la nuit précédente, lui avait fait préférer un déshonneur réel au déshonneur apparent dont Sextus l'avait menacée. Cette dernière honte aurait été éternelle parce qu'elle eût suivi la mort de la victime, et que, du fond de la tombe, Lucrèce n'eût pu attester son innocence. En acceptant au contraire l'outrage de Sextus, elle pouvait, avant de mourir, sauvegarder sa mémoire. Lucrèce sacrifia non-seulement sa vie, mais son honneur, à sa réputation. Quoi qu'il en fût, le type de Lucrèce est d'une austère beauté : il est digne de l'ancienne Rome ; il est digne de ces temps où la femme exerçait, d'une manière directe ou indirecte, une influence sociale qui ne rayonnait que du foyer domestique. Cette influence était, par sa douceur même, la plus irrésistible de toutes. Quelque impérieux que fût le Romain, il la subissait avec amour. Voyez Coriolan, ce fier patricien qui a toute la hautaine dureté de la vieille race sabine. Caractère indomptable, il a néanmoins, dès ses premières années, plié sous un pouvoir : l'autorité de sa mère Véturie[212], la noble veuve qui l'a élevé. Sa fougueuse valeur suffirait pour l'entraîner sur les champs de bataille ; mais, en cédant à ce généreux instinct, il a un but encore plus délicat que la gloire des armes : le bonheur de sa mère ! Il sait que, vraiment Romaine, Véturie sera fière de ses succès. Et lorsque, vainqueur, il revient à Rome, le front ceint de la couronne de chêne, et que sa mère l'embrasse en pleurant de joie, le jeune héros a reçu sa récompense : Rome ne peut plus lui en offrir qui soit digne de lui. Pour plaire à cette mère adorée, il a pris une compagne, la douce Volumnie[213]. Marié, il est resté sous le toit maternel, et deux fils sont nés dans cette patriarcale demeure. La gloire du chef de famille, les vertus de sa mère et de sa femme, le sourire de deux enfants et tous les amours du foyer, telles étaient les richesses qui, sous la sauvegarde de l'antique honneur, s'abritaient dans cette maison. Mais la gloire a ses revers, et le bonheur a son lendemain. Coriolan l'éprouva. En s'opposant à des mesures populaires, le patricien souleva la colère de la plèbe. Banni de sa patrie, banni de son foyer, il vint un jour faire ses adieux à sa mère, à sa femme. Toute la fermeté de Véturie abandonna la vieille Romaine ; et, comme sa belle-fille, elle pleura et cria. Trop ulcéré pour se livrer à l'attendrissement, l'exilé demeura maître de lui. Il embrassa les deux femmes désespérées, les exhorta à la résignation, leur recommanda ses enfants, et partit. Quatre ans plus tard, Véturie et Volumnie étaient dans la maison où le banni n'était pas revenu, où il ne devait jamais revenir. L'aïeule tenait dans, ses bras ses deux petits-fils. Une foule de femmes pénètre dans cette demeure où règne toujours le morne aspect du deuil. Tout à l'heure encore, ces Romaines remplissaient de leur foule le temple de Jupiter. La patrie est en danger ! Celui qui a été son plus ferme soutien est devenu son plus terrible ennemi ; et Coriolan amène aux portes de Rome les Volsques qu'il a naguère refoulés sur leur territoire. En vain Rome s'est-elle humiliée, en vain a-t-elle envoyé à son fils rebelle les députations de ses consulaires et de ses prêtres. L'exilé est demeuré inflexible, et voilà pourquoi les femmes, ces Romaines qui, après l'exil de Coriolan, ont eu l'intuition prophétique de grands malheurs futurs, viennent de prier et de pleurer dans les temples des dieux. C'est alors que l'une d'elles, Valérie, sœur du consul Valérius Publicola, a puisé dans l'ardeur de sa prière une inspiration soudaine. La noble matrone a pensé que si l'intraitable vainqueur devait se laisser fléchir, ce ne serait que par les êtres chéris qu'il avait laissés à Rome. Valérie a communiqué cet espoir à ses compagnes, et toutes ces femmes sont venues avec elle pour remettre entre les mains de Véturie et de Volumnie le salut de Rome, et leur rappeler l'exemple des Sabines. Le lendemain, le jour commençait à poindre, mais la nuit régnait encore, une nuit de décembre. Une longue procession de femmes, drapées dans les blancs vêtements du deuil, portant des flambeaux et entourées de leurs enfants, se dirige vers la maison de Véturie : ce sont les Romaines qui viennent chercher la mère, la femme et les enfants de Coriolan. Lorsqu'elles sortent de cette demeure, elles ont à leur tête la famille de l'exilé. Les consuls accompagnent les ambassadrices, et leur ont fait préparer des chars et des mulets. Les sénateurs et de nombreux citoyens escortent et acclament les courageuses matrones qui ont quitté l'ombre du foyer et s'exposent au tumulte des camps, pour que, suivant la belle expression de Tite-Live, cette ville, que les armes de l'homme ne pouvaient plus défendre, le fût par les prières et les larmes des femmes[214]. Les matrones et leurs enfants sortent de la ville par la porte Capène et suivent la voie Latine. A l'horizon, le soleil levant dore les cimes des montagnes. De loin les Volsques voient s'avancer le triste défilé, et l'on annonce à Coriolan qu'une foule de Romaines s'approche du camp. Il demeure impassible ; mais un homme de sa maison voit, en tête du cortège, une femme ragée, accablée de douleur et se tenant près d'une jeune femme et de deux petits enfants. Si mes yeux ne me trompent pas, dit-il à Coriolan, ta mère, ta femme et tes enfants sont là[215]. Alors cet homme d'airain fléchit. Éperdu, il se lève et ne peut résister à l'élan qui l'entraine vers la famille bien-aimée qu'il n'a plus revue depuis quatre ans. Selon Denys d'Halicarnasse, ses licteurs le précèdent, et, obéissant à ses ordres, abaissent leurs faisceaux devant Véturie, et rendent ainsi à la majesté de la mère l'honneur qui, chez les Romains, appartient aux magistratures suprêmes. D'après l'auteur grec que nous venons de citer, Coriolan embrasse en pleurant la noble Romaine défaillante entre ses bras, et qui ne le repousse point. Suivant Plutarque, Véturie ne se dérobe pas non plus aux étreintes de l'exilé, qui couvre de ses caresses et de ses larmes sa mère, sa femme et ses enfants. Plus fidèle sans doute à l'esprit des vieilles mœurs romaines que les deux écrivains helléniques, Tite-Live nous dit que la mère romaine arrêta cet élan avec de sévères paroles. Ainsi que l'a remarqué M. Ampère, il dut vraiment en être ainsi chez le peuple qui avait à un si haut degré le sentiment de l'autorité maternelle ; et, ici surtout, nous ne pouvons autrement nous imaginer une scène où figurent une mère telle que Véturie, un fils tel que Coriolan. Ne suivons donc pas non plus les deux auteurs grecs lorsque, avec une inspiration plus hellénique que romaine, ils mêlent des prières aux reproches que Véturie adresse à Coriolan, et font enfin tomber la mère aux pieds du fils[216]. La Véturie de Tite-Live ne supplie pas : elle juge et reste debout. Écoutons cet austère langage où perce néanmoins une exquise sensibilité. Ne saurai-je pas, avant de
recevoir tes embrassements, dit-elle, si je
suis venue à un ennemi ou à un fils ; si, dans ton camp, je suis captive ou
mère ? J'ai donc traîné une longue vie et une malheureuse vieillesse pour te
voir exilé, puis ennemi ? Peux-tu ravager cette terre qui t'a enfanté et
nourri ? Quel que soit le sentiment hostile et menaçant dans lequel tu es
venu ici, ta colère n'est pas tombée en marchant sur nos frontières ? A
l'aspect de Rome, il ne t'est pas venu cette pensée : Dans ces murailles sont
ma maison et mes pénates, ma mère, ma femme et mes enfants ? — Donc, si moi je n'avais pas mis d'enfant au monde, Rome ne
serait pas assiégée ; si je n'avais pas de fils, je mourrais libre dans ma
patrie libre. Mais je ne peux plus souffrir de rien qui soit plus honteux
pour toi que malheureux pour moi ; et quelque malheureuse que je sois, je ne
le serai pas longtemps. Quant à ces enfants, c'est à toi de décider : si tu
persistes, il leur est réservé ou une mort prématurée ou une longue servitude[217]. Remarquons ici le rôle muet de Volumnie. Une matrone encore jeune n'aurait pu, sans violer les convenances, élever la voix dans un camp, ni blâmer hautement l'époux n qui la loi la soumettait. La mère seule avait, par son âge, la faculté de parler, et, par son autorité, le droit de se faire entendre. Après que lanière s'est tue, l'épouse et les enfants embrassent le chef de famille. Les reproches de sa mère, les caresses de sa femme et de ses fils, les pleurs de toutes les Romaines, émeuvent l'homme implacable. Il épargne Rome, et cependant il n'ignore pas que les Volsques pourront se venger de l'exilé qui a fait grâce à sa patrie aux dépens de la leur. S'il faut en croire Denys d'Halicarnasse, Véturie et Volumnie ne se méprennent pas non plus sur le péril que va courir le général, mais elles acceptent à l'avance tous les sacrifices que leur imposent ici la vertu et l'honneur[218]. Le banni embrasse les êtres aimés qui vont s'éloigner. D'après Plutarque, ce fut à la prière de sa mère et de sa femme que Coriolan les renvoya à Rome. Peut-être espéraient-elles l'y revoir bientôt. Le soleil se couchait lorsque les Romains virent rentrer parmi eux leurs ambassadrices triomphantes. Dans cette ivresse de bonheur qui suit le danger passé, ils acclament leurs libératrices, leur prodiguent les hommages de leur gratitude, et, comme l'oiseau qui chante après l'orage, ils font voler dans les airs l'hymne de la joie[219]. Peut-être ce bonheur, qui appartient plus à des vainqueurs qu'à des vaincus épargnés, ne semble-t-il pas digne de nos fiers Romains. A de telles humiliations conviennent mieux la dignité du silence et la tristesse de l'attitude ; mais souvenons-nous que si Rome avait subi un vainqueur, ce vainqueur avait été l'un de ses fils. L'orgueil romain pouvait trouver là encore une satisfaction. Le Sénat ordonne qu'une inscription immortalise le dévouement des Romaines. L'auguste assemblée offre aussi aux matrones de choisir elles-mêmes leur récompense. Elles ne demandent d'autre privilège que la permission d'élever un temple à la Fortune des femmes. Elles y prieront pour Rome ; et, sous la présidence de Valérie, elles y offriront ensemble des sacrifices annuels, le jour anniversaire de la retraite de. Coriolan. Les généreuses matrones proposent même de faire élever à leurs frais le temple et la statue de la déesse ; mais le Sénat, bien que touché de ce vœu patriotique, décide que l'État se chargera de ces dépenses. L'année suivante, au premier anniversaire de leur douce victoire, les matrones se réunissent autour d'un autel qui a été élevé au lieu même où Coriolan écoula leurs prières : c'est le futur emplacement du temple. Valérie inaugure alors ses fonctions de prêtresse. Lorsque le temple a été édifié, les matrones y apportent une seconde statue à laquelle elles ont consacré la somme qu'elles avaient primitivement destinée au sanctuaire de la déesse. Et, suivant une légende, la statue déclare aux femmes que celles-ci l'ont dédiée suivant les rites[220]. A cette époque, les matrones avaient sans doute déjà porté le deuil de Coriolan, s'il faut ajouter foi à la tradition suivant laquelle les Volsques auraient tué le général à son retour dans leur pays. D'après une autre version, Coriolan aurait vieilli et serait mort dans un exil sans doute volontaire[221]. Quelle que soit l'opinion à laquelle on s'arrête, Véturie et Volumnie durent être malheureuses. Si Coriolan avait été tué, elles devaient se dire qu'en sauvant leur patrie, elles avaient perdu leur bien-aimé soutien. Elles avaient pu accepter avec courage la perspective de ce malheur ; mais en accueillirent-elles de même la réalisation ? Il est permis d'en douter : celles dont le foyer avait gardé pendant quatre ans le deuil de l'exilé ne se consolèrent probablement jamais de sa mort, cette mort que leur héroïsme avait préparée..... Si, au contraire, Coriolan vécut encore de longues années, sa mère et sa femme durent ou le pleurer comme mort en vivant loin de lui, ou perdre leur chère patrie en le rejoignant. Shakespeare qui, avec l'intuition du génie, a écrit, dans son drame de Coriolan, l'une des pages les plus vivantes de l'histoire romaine, a, croyons-nous, mieux su peindre l'épouse de Coriolan que la mère de celui-ci. Chez lui, comme chez Tite-Live, comme chez les auteurs grecs, nous retrouvons la jeune et modeste matrone qui ne sait fléchir son époux que par un éloquent silence. Mais lorsque le poète anglais met en scène la mère de Coriolan, c'est, dans cette première apparition, plutôt une Spartiate qu'une Romaine. Quand son fils court les dangers des batailles, elle se réjouit même des blessures qu'il peut recevoir. Nous ne reconnaissons pas à ce trait la mère romaine qui, certes, nous l'avons vu, a le fier courage d'armer elle-même son fils, mais qui pleure et qui prie en l'attendant. Dans la suite de ce rôle, Shakespeare a suivi Plutarque, et nous montre ainsi, devant le général banni et victorieux, une femme qui, tout en blâmant la conduite de son fils, sait encore mieux solliciter la pitié de celui-ci qu'affirmer son autorité maternelle. Après avoir exagéré au début la fermeté de la Romaine, le tragique anglais l'a trop atténuée plus tard. Il y a néanmoins, dans le rôle dessiné par Shakespeare, des traits dignes d'une Romaine, parce qu'ils sont à la fois héroïques et maternels. Le tragique du Nord nous fait vraiment reconnaître la mère de Coriolan, lorsque celle-ci déclare qu'elle n'éprouva pas un plus vif élan de joie en sachant qu'elle avait mis au monde un fils, que le jour où elle vit le jeune guerrier prouver qu'il était un homme[222]. Deux fois les Romains ont dû à une intervention féminine le salut de leur ville. C'est une femme qui leur a donné deux de leurs meilleurs rois. Pour venger l'honneur d'une matrone, ils ont aboli la royauté et plus tard, pour venger l'honneur d'une vierge, ils ont déposé leurs décemvirs. C'est encore par une femme que les plébéiens acquerront le droit de parvenir au consulat. Fille du patricien Fabius Ambustus, Fabia est mariée au plébéien Licinius Stolo. Elle est venue visiter sa sœur aînée, femme de Sulpicius, l'un de ces tribuns militaires qui ont remplacé les consuls. Un licteur vient frapper à la porte de la maison avec sa baguette. La jeune Fabia s'effraye, et sa sœur sourit. C'est que la femme du plébéien ignore que, par un honneur rendu au pouvoir suprême, un licteur précède le tribun militaire et frappe à la porte de sa demeure pour annoncer que l'un des chefs de l'État rentre du Forum. Le sourire de sa sœur aînée jeta dans le cœur de Fabia l'aiguillon de l'envie. Femme d'un de ces plébéiens qui avaient, il est vrai, le droit d'être nominés tribuns militaires, mais qui n'en bénéficiaient plus depuis longtemps, la patricienne regrettait le mariage qui l'avait fait entrer dans une maison à la porte de laquelle ne frapperait jamais la baguette du licteur. Elle devint triste, et son père s'en aperçut. Fabius craignit qu'elle ne fût malade et l'interrogea. Elle n'osait avouer le sentiment de jalousie qui lui blessait le cœur. Enfin, cédant aux affectueuses instances de son père, elle lui révéla le motif de son chagrin. Fabius consola sa fille et lui annonça qu'un jour viendrait où elle verrait aussi chez elle l'appareil du pouvoir. Le père et l'époux se concertèrent, et, après une lutte de plusieurs années, la jeune Fabia, si elle vivait encore, fut plus que la femme d'un tribun militaire : la femme d'un consul[223]. Le droit d'être élu à la première magistrature de la république, ce droit si longtemps réclamé par les plébéiens, leur était enfin acquis, et ce résultat était dû à la plus puérile des influences : la bouderie d'une jeune femme vaniteuse. Ici cependant encore la femme avait, sans sortir de la famille, provoqué une révolution qui, du moins, fut pacifique. Pour résumer ce long chapitre, nous dirons que la condition de la matrone, chez les Romains de la première époque, présente ces deux aspects d'un si frappant contraste : en principe, l'épouse est asservie à l'époux ; en réalité, elle le domine. Suivant le droit, c'est une esclave ; suivant la coutume, c'est une reine. Le Romain, comme le Spartiate, reconnaît ce pouvoir ; et, ici comme ailleurs[224], nous remarquerons avec Aristote que c'est chez les peuples guerriers que la femme a le plus d'influence. Là où l'homme est fort, il est moins jaloux de son autorité, et c'est la craintive mollesse des Orientaux qui a inventé le gynécée. Nous allons entrer dans une période où l'ascendant de la femme s'exercera le plus souvent d'une manière néfaste. Sans doute, à l'époque même que nous venons d'étudier, toutes les matrones n'étaient pas des Tanaquil, des Lucrèce, des Véturie. Mais une femme criminelle comme Tullie, ou dissipée comme les brus de Tarquin le Superbe, n'était qu'une exception. Cependant, plus d'un siècle en deçà de la limite que nous allons franchir, il y a des symptômes d'une démoralisation générale. L'an 328 avant notre ère, une effrayante mortalité vient désoler Rome. Une esclave révèle que cette épidémie n'est autre que le poison, et que ce poison est préparé par des matrones. Vingt de ces femmes, chez lesquelles on a saisi des préparations vénéneuses, sont amenées devant le peuple par un officier public, le viateur. Deux d'entre elles, deux patriciennes, prétendent que les breuvages trouvés dans leurs demeures sont des remèdes bienfaisants. Alors l'esclave dénonciatrice les somme de boire ces liqueurs salutaires. Les deux patriciennes se concertent avec leurs compagnes ; les vingt femmes acceptent l'épreuve... et en meurent. Cent soixante-dix matrones sont condamnées par le jugement du peuple. Les Romains virent dans le forfait des empoisonneuses, non pas un crime prémédité, mais un acte de démence. On renouvela, à cette occasion, pour guérir les esprits malades, une pratique superstitieuse qui, suivant une ancienne prescription, aurait dû avoir lieu tous les ans, mais que l'on ne faisait plus revivre que dans les grandes calamités : un dictateur fut nominé pour fixer dans le temple de Jupiter un clou dont la signification symbolique est incertaine[225]. En racontant ce fait, Tite-Live voudrait ne pas y croire, tant ce crime contraste avec la vertu des antiques matrones. Mais, trente-trois ans plus tard, un autre incident trop significatif vint à se produire : un consul put ériger un temple de Vénus avec les amendes que le peuple avait imposées à quelques matrones adultères, dit Tite-Live[226] qui, cette fois encore, semble se refuser à voir, dans les faits qu'il raconte, les signes avant-coureurs de la décadence morale dont il fut le témoin. Quel que fût le nombre de ces épouses infidèles, il n'en est pas moins vrai que les amendes payées par elles suffirent pour la construction d'un temple. Il était bizarre de consacrer à Vénus un monument dû aux expiations des fautes qu'elle-même avait fait commettre. Et c'était dans cette même ville que, l'année précédente, une chaste matrone avait élevé un temple à la Pudicité plébéienne ! Vers le milieu du troisième siècle avant notre ère l'on vit, pour la première fois-, une femme accusée du crime de lèse-majesté. Par un mot aussi impudent et cruel qu'anti-national, elle avait outragé l'honneur de Rome. Sœur de Claudius Pulcher, qui avait perdu une flotte romaine, et qui alors n'existait plus, Claudia revenait des jeux publics, et c'était avec peine que son carpentum se frayait un passage à travers la foule. Alors cette Romaine, cette patricienne, cette sœur d'un général vaincu, ose exprimer tout haut le vœu que son frère ressuscite et perde une nouvelle flotte pour diminuer la foule qui arrête son char. La voix du peuple répondit à Claudia en la condamnant à une amende de 25.000 as[227]. Pendant la seconde guerre punique, l'introduction des richesses du Samnium dans la ville de Romulus, l'influence des mœurs grecques, développèrent d'une manière latente les germes corrupteurs qui, jusqu'alors, ne s'étaient manifestés que de loin en loin. L'accroissement de la fortune publique donna particulièrement un plus libre essor au goût que, dès la plus haute antiquité, les femmes romaines montrèrent pour la parure. Il fallut alors qu'une loi somptuaire restreignit cette tendance. D'après la loi Oppia, promulguée 213 ans avant notre ère, les femmes ne devaient ni posséder plus d'une demi-once d'or, ni porter des vêtements aux couleurs variées. Il leur était également interdit, excepté pour les sacrifices, de se faire traîner en voiture, soit à Rome, soit dans d'autres villes, soit encore à un mille de distance d'une cité[228]. Alors néanmoins les immenses périls qui menacent Rome ne permettent pas que la mauvaise semence s'étende sur une vaste surface ; et le poète pourra encore dire de ces temps : Jadis une humble fortune rendait chastes les Latines ; le travail, de courts sommeils, et des mains fatiguées et endurcies par la laine étrusque, et Annibal près de la ville, et les maris en faction dans la tour de la porte Colline, ne permettaient pas aux vices d'atteindre les pauvres toits[229]. C'est toutefois vers la fin de la deuxième guerre punique que, d'après un oracle sibyllin, Rome croira se délivrer d'Annibal en ouvrant son sein au culte de la Mère des dieux, ce culte dont l'infamie ajoutera un nouveau ferment à la dissolution morale qui se prépare ! Et les plus nobles des matrones, et les jeunes filles, et les gardiennes du feu sacré, vont recevoir la statue d'une déesse dont le culte comporte des actes monstrueux et des paroles qui auraient dû empourprer de honte le visage de la vierge, et même le front de l'épouse ! Et, suivant une tradition fabuleuse, une matrone, Claudia Quinta, témoigne de sa chasteté méconnue en tirant avec sa ceinture le vaisseau qui contient le simulacre de l'impure déité, et qui vient de s'engager dans les bas-fonds du Tibre ! Et, à tour de rôle, les matrones portent jusqu'au temple de la Victoire l'image d'une telle déesse[230] ! Rome s'ouvrira désormais à tous les cultes, quelque abjects qu'ils puissent être. Puis, en face de toutes les superstitions locales ou étrangères, se dresse déjà l'incrédulité qui se joint à la soif des jouissances matérielles pour faire perdre à Rome cette force morale qu'elle devait naguère à l'austérité de ses habitudes et même à des croyances, fausses sans doute, et qui parfois contribuèrent à la ruine des mœurs, mais qui cependant n'étaient pas toujours dépourvues de sens moral, et qui offraient à l'homme ce frein que nul pouvoir humain ne peut remplacer : la crainte de la Divinité. Dangereux fut le paganisme ; mais plus funeste encore le scepticisme. |