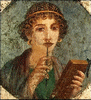LA FEMME ROMAINE
PRÉFACE.
|
Fidèle au plan que nous nous sommes tracé nous exposons aujourd'hui la situation de la femme chez le peuple auquel se rattachent le plus étroitement nos origines sociales. Nous avons nommé le peuple romain. Nous étudions ici la vie domestique et religieuse de la femme romaine, sa condition sociale, son influence intellectuelle et son rôle historique. La Vestale, la jeune fille, la matrone, ont tour à tour passé devant nos yeux. La Vestale, la plus haute personnification de la Romaine, est le seul aspect religieux sous lequel nous ayons considéré isolément les filles du Tibre. C'est que, chez les Romains, qui mêlaient leurs dieux à tous les actes de leur existence, les attributions religieuses dévolues à la femme, en dehors du sacerdoce de Vesta, se confondaient avec ses devoirs domestiques. En nous occupant de ceux-ci, nous avons donc parlé de celles-là. Nous suivons la femme aux deux grandes périodes de la vie romaine : les beaux temps de la vertu antique et l'époque de la corruption morale. Il était difficile d'établir ici le point précis où commenta la décadence. Tout en notant les symptômes alarmants qui signalèrent la fin de la période primitive, nous avons cru pouvoir assigner la limite de celle-ci à la fin de la deuxième guerre punique. Jadis une humble fortune rendait chastes les Latines ; le travail, et de courts sommeils, et des mains fatiguées et endurcies par la laine étrusque, et Annibal près de la ville, et, les maris en faction dans la tour de la porte Colline, ne permettaient pas aux vices d'atteindre les pauvres toits[1]. Notre livre se trouve ainsi divisé en deux parties : la femme sous la royauté et pendant les trois premiers siècles de la République ; — la femme pendant les derniers temps de la République et sous l'Empire. Nous avons éprouvé par nous-même combien il est peu aisé d'étudier l'époque primitive des mœurs romaines. Les documents contemporains font défaut ; et c'est dans les écrits de la seconde période que l'on doit chercher ce qui concerne les coutumes de l'âge précédent. Tantôt, c'est quelque loi, quelque tradition, quelque débris littéraire, recueillis par des écrivains postérieurs ; tantôt, c'est un retour du poule ou du moraliste vers des temps bien éloignés de lui. Mais ces renseignements épars n'auraient pu nous suffire pour faire revivre la Romaine des premiers siècles ; et nous avons dû chercher, parmi les coutumes qui subsistaient au second fige de Rome, celles qui, par leur caractère antique, pouvaient être rapportées à une époque antérieure. Toutefois, lorsqu'il s'est agi de mettre en scène nos héroïnes, nous n'avons pu que placer sur leurs lèvres les paroles que leur attribue Tite-Live, et dont l'harmonieuse élégance ne dut pas être familière à une Lucrèce, à une Véturie[2]. Combien alors nous eussions désiré que le récit d'un vieil annaliste nous dit permis de recueillir les propres paroles de nos antiques Romaines, et de leur entendre parler une langue rude et naïve, mais qui ne dut jamais être dépourvue de force ni de grandeur ! Si, pour dépeindre la période primitive de la vie romaine, les documents contemporains nous manquaient, c'est au contraire la multiplicité des matériaux qui devenait un embarras pour l'étude de la seconde époque. L'historien, le jurisconsulte, le moraliste, le poète, nous apportaient ici nue foule de notions auxquelles venaient s'ajouter encore les précieuses découvertes de l'épigraphie et de l'archéologie. Le classement de ces innombrables matériaux n'a pas été la partie la moins pénible de notre travail. Si nous avions dit les employer tous, notre ouvrage aurait eu plusieurs volumes, et n'aurait que difficilement conservé cette unité morale et littéraire que nous avions en vue. Tel détail qui, pris isolément, nous paraissait avoir une certaine valeur, n'avait plus qu'une importance secondaire en se rattachant à l'ensemble de notre travail ; et les matériaux dont nous nous servions ne pouvaient être que groupés avec de justes proportions, dans le modeste édifice que nous tentions d'élever. Nous nous sommes rappelé, ici avec grand profit la juste observation qu'en couronnant la Femme grecque, l'Académie française avait bien voulu nous adresser par l'organe de son secrétaire perpétuel, M. Patin, le maître illustre et vénéré dont nos regrets honoreront toujours la mémoire. Nous avons indiqué certaines difficultés de notre œuvre. Ajoutons que notre fiche a été rendue plus lourde par les nombreuses traductions que nous avons faites. Chaque fois que nous avons cédé la parole à un écrivain latin, nous l'avons fait d'après nos propres versions. Nous ne pouvions du reste agir autrement pour les inscriptions que nous avons citées, et qui n'avaient point encore passé dans notre langue. Quant aux textes historiques et littéraires, nous n'ignorons pas combien les traductions de nos savants latinistes eussent été préférables aux nôtres ; mais nous avons désiré conserver à notre travail, depuis la première ligne jusqu'à la dernière, un caractère tout, personnel. Nous dirons aussi que, dans une œuvre qui est non-seulement une étude d'histoire morale, mais encore un essai de restitution archéologique, il nous a semblé utile de pouvoir attribuer à telle expression du texte latin, la valeur qu'elle nous semblait avoir dans les recherches spéciales que nous poursuivions. Avouons enfin que c'était avec un attrait tout particulier que nous nous plaisions à interpréter nous-même les accents de nos héroïnes ; et après nous être excusée d'une tentative assurément bien téméraire, invoquons ici toute l'indulgence du latiniste ! Nous n'avons pas négligé de consulter les ouvrages modernes qui ont pour objet l'antiquité romaine. Historiens, jurisconsultes, critiques, archéologues, épigraphistes, aussi bien en France qu'à l'étranger, nous ont souvent guidée par leurs œuvres et leurs découvertes. Nous venons de nommer les jurisconsultes. Qu'il nous soit permis de solliciter d'eux la même indulgence que nous réclamions tout à l'heure des latinistes. Puissent-ils se souvenir que, femme, nous sommes étrangère à la langue du droit ; et que cependant, sous peine de ne pouvoir bien définir la situation sociale de la femme romaine, nous ne pouvions passer sous silence sa situation légale. Malgré l'âpreté de notre travail, la tâche que nous avons essayé de remplir avait pour nous un charme austère et vivant. C'est surtout aux nations héritières de la civilisation latine, que l'étude des mœurs romaines offre un enseignement utile et un attrait toujours nouveau. Il semble que nous recueillions, dans une telle étude, ces traditions domestiques qui nous apportent à la fois le souvenir et les leçons des ancêtres. Sans doute, ce souvenir est trop souvent voilé par l'ombre des erreurs païennes ; ces leçons nous ont été bien souvent données par les Romains à leurs propres dépens ; mais, non moins que l'exemple de leurs vertus, le spectacle de leurs vices est pour nous un avertissement. Rome nous instruit, et par l'austère pureté de sa jeunesse, et par la corruption de son âge mûr. En esquissant le plan de notre ouvrage, nous disions tout à l'heure que les Romains mêlaient leurs dieux à tous les détails de leur existence. N'y pas déjà une leçon utile à tirer de ce spectacle, qui nous est surtout donné par la Rome primitive ? Certes les Romains se trompaient en appelant au milieu d'eux des divinités qui n'existaient pas ; mais, du moins, l'instinct qui leur faisait sentir la nécessité d'une puissance surnaturelle, cet instinct n'était pas une erreur : t'était un souvenir du commun berceau des races humaines, c'était un besoin de ce lait dont la révélation primitive avait, nourri l'humanité naissante. Oui, l'homme a naturellement faim et soif de la présence de Dieu. Pour que cette aspiration soit étouffée en lui, il faut que son âme ait bu le poison des plus funestes doctrines. Ce venin, ils le connaissent, les hommes qui voudraient aujourd'hui chasser Dieu de tout ce qu'il vivifie et sanctifie : l'union des époux, la naissance et l'éducation de l'enfant, la vie entière de l'homme et sa fin dernière. Nés au sein du christianisme, ils sont tombés au-dessous de ces païens qui, du moins, avaient compris que l'homme ne se suffit pas à lui-même. Cet enseignement n'est pas le seul qui nous soit donné par la Rome primitive. Au sein de cette société naissante, nous avons aimé à suivre la femme laborieuse, et dans l'atrium où elle file entourée de ses servantes, et dans la villa rustique où elle surveille les travaux de ses esclaves. Puissent ces simples tableaux de la vie domestique rappeler à nos contemporaines que le bonheur est au foyer ! Mais il est encore nu aspect sous lequel nous nous sommes plu à considérer l'ancienne matrone : c'est dans son rôle patriotique. La Femme romaine est le premier ouvrage que nous ayons écrit depuis nos calamités nationales ; et, plus d'une fois, nous retrouvions dans les scènes que nous esquissions l'image des cruelles épreuves que nous avions nous-mêmes traversées. La vieille Rome, elle aussi, connut la douleur et la honte des invasions ; mais elle possédait alors les talismans qui la relevèrent : une foi, erronée, il est vrai, mais sincère ; l'esprit de discipline, l'habitude du sacrifice, l'austérité des mœurs. Ici encore la matrone peut nous donner de généreux exemples. Non pas qu'elle ait eu le barbare héroïsme de la Spartiate ! Trop souvent ce dernier type a été confondu avec le sien. Avant de commencer ce livre, nous subissions aussi quelque peu l'influence de cette dernière idée. Mais, à mesure que nous avancions dans nos recherches, nous nous étonnions de voir se modifier dans notre esprit le type de la Romaine. C'était avec ravissement que nous sentions battre en elle un cœur de femme ; et c'est pourquoi nous nous plaisons à proposer comme un modèle le patriotisme de la matrone, ce patriotisme dont la Romaine donna à ses fils le précepte et l'exemple, mais qui n'étouffa pas ses affections domestiques. Non moins que par la grandeur morale de leur premier âge, disions-nous plus haut, les Romains nous instruisent par la corruption de leur maturité. C'est que leur société nous offre alors avec la nôtre une frappante analogie. Le scepticisme, la soif des jouissances matérielles, l'amour effréné du luxe, le goût particulier des Romaines pour les œuvres littéraires peu morales, tout nous reporte ici au XIXe siècle. Nous y sommes encore ramenée par la question du divorce, cette question que Rome avait résolue par la ruine complète de ses mœurs et de son état social, cette question que le souffle révolutionnaire agite néanmoins encore aujourd'hui dans notre France catholique. Ce n'est donc pas sans motif que nous nous sommes longuement étendue sur cette plaie sociale de la Rome déchue. Oui, la corruption qui travaille la société contemporaine, c'est encore le paganisme[3] ; non ce paganisme qui avait gardé la crainte des dieux antiques, mais ce paganisme qui n'adorait plus guère que ses passions triomphantes. Ce dernier paganisme, qui a perdu Rome, a aussi amené, par la ruine des mœurs, notre abaissement national. Mais nous, du moins, nous avons au cœur même de notre cher pays ce principe de vie qui, manquant à l'ancienne Rome, ne put ni soutenir ses vertus primitives, ni guérir les vices de sa décadence : nous avons l'Évangile, l'Évangile que nous devons à la Rome nouvelle, la Rome apostolique et pontificale ! En s'éloignant de ce divin principe, les nations s'étiolent et meurent. En y revenant, elles y puisent la régénération et la vie. Les Vertus qu'enfante le christianisme ont fait la gloire et le bonheur de l'ancienne France ; et, pieusement conservées dans bien des familles encore, elles sont pour nous la consolation du présent en attendant qu'elles deviennent la force de la France future. Immortelles sont ces vertus, et l'avenir appartient à ce qui ne périt pas. |