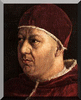HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XLI. — DERNIERS ÉVÈNEMENTS. - MORT DE LÉON X. - 1521.
|
Les Ordres
d’Allemagne se rassemblent à Nuremberg pour donner un successeur à Maximilien
Ier. - Charles d’Autriche et François Ier briguent l’empire. - Conduite
politique du saint-siège. - Charles est élu. - Rivalité des deux princes. -
Etat des esprits dans le duché de Milan. - Schinner reparaît sur la scène. -
Léon X écoute les propositions de Charles-Quint. - Les hostilités éclatent. -
Les Français sont chassés de Milan. - Parme et Plaisance rentrent sous la
domination de l’Eglise. - Le pape quitte la Magliana pour aller à Rome et
rendre grâces à Dieu du triomphe des confédérés. - Il tombe malade et meurt. Après la mort de Maximilien, les Ordres se rassemblèrent à Nuremberg, conformément à la Bulle d’or, pour élire un empereur. Jamais l’Europe n’avait paru aussi attentive à un spectacle électoral donné par l’Allemagne : c’est que jamais, non plus, deux semblables rivaux n’avaient été en présence le roi de Naples, Charles, et le roi de France, François Ier. L’Allemagne était elle-même agitée sérieusement ; le nouveau maître qu’on allait lui imposer pouvait lui ravir au dedans ses franchises, au dehors compromettre son repos. Et pourtant ce trône germanique, si envié, donnait à l’élu plus de splendeur que d’autorité réelle : au delà du Rhin, souverain ayant la préséance sur tous les autres monarques ; en deçà, instrument ou esclave d’une foule de ducs et de princes, d’évêques et de cités, de marchands et de nobles qui lui laissaient le titre, mais exerçaient les prérogatives de la royauté. Cet état de servitude avec les apparences du pouvoir n’a point échappé aux historiens ; l’un d’eux, Pierre Martyr d’Anghiera, a peint la fastueuse misère de celui qui s’appelait le roi des Romains. Voyez, demande-t-il, qu’est-ce donc que cette dignité impériale à l’ombre d’un arbre gigantesque ; un rayon de soleil qui perce le vitrage pour illuminer l’appartement ; essayez d’arrêter au passage un de ces rayons lumineux, puis d’en faire un habit de soie, ou de vous en servir à table en guise de mets ! C’est cependant pour cette ombre stérile tombant de la cime d’un arbre, pour cette gouttelette de lumière qui ne peut servir à aucun besoin de la vie commune, que tant d’ambitions s’agitaient en Europe. La politique de Rome se dessina nettement en cette conjoncture. Léon X ne pouvait, sans danger, soutenir les prétentions de l’un des deux compétiteurs à l’empire ; ce qu’il devait essayer, c’était de les faire échouer l’un et l’autre. En Allemagne, quelques électeurs d’une grande influence étaient disposés à refuser leurs votes aux deux rivaux, et à choisir pour maître un homme de race germanique. Ce projet souriait au pape, qui envoya Robert des Ursins, archevêque de Reggio, à François Ier, pour l’engager, afin de faire manquer l’élection de Charles, à soutenir de son crédit un prince teuton incapable d’inquiéter ou le saint-siège ou la France. Le projet, dit Roscoë, était admirablement conçu, mais il devait échouer. L’ambition eut sur François Ier plus d’empire que la voix de l’envoyé du saint-siège : il voulait à tout prix la couronne impériale. Les deux prétendants prirent, pour négociateurs auprès des électeurs, des ministres d’une rare habileté. François Ier choisit Bonnivet, esprit souple et délié, qui avait fait ses preuves de diplomate en Angleterre ; et Fleuranges, qui connaissait les affaires d’Allemagne, maniait la phrase avec autant d’adresse que l’épée, et à table buvait comme un Allemand. Charles jeta les yeux sur Érhard de La Mark, évêque de Liège, à qui François avait fait manquer le chapeau de cardinal, et qui joignait à la prudence du serpent, comme on le disait alors, l’astuce du renard ; et sur le comte Henri de Nassau, un des beaux seigneurs de l’époque. Les ministres du roi de France voyageaient avec des chariots remplis d’or, et les poches chargées de lettres de change qu’ils espéraient escompter à Nuremberg. Les chariots furent bientôt vides ; mais quand les lettres furent présentées au comptoir des marchands, personne ne voulut les accepter. Les Fugger, qui avaient plus de confiance en Charles qu’en François Ier, avancèrent cent trente mille florins au roi d’Espagne, qui ne leur donna pas même sa signature pour garantie. C’est qu’Allemands de sang et de cœur, ils préféraient au monarque français un prince qui parlait leur Langue et avait été élevé en Allemagne. Le nonce du pape à la diète était Thomas de Vio, dominicain versé dans les sciences théologiques, et que le pape avait élevé récemment à la dignité de cardinal. Son rôle était bien simple : il devait observer attentivement les mouvements des deux prétendants, et traverser leur élection. Robertson admire ici la politique de la cour romaine : seul de tous les monarques, Léon lisait dans l’avenir. Il y avait un égal danger pour l’équilibre européen dans le triomphe de l’un des deux rivaux : le premier, déjà roi d’Espagne et du Nouveau Monde ; le second, duc de Milan et seigneur de Gênes. Le pape avait prédit que l’élection de l’un de ces souverains compromettrait la liberté de l’Europe, l’indépendance du saint-siège et le repos de l’Italie. Avec François Ier, plus de barrières de glace pour séparer l’Italie de la France ; avec Charles, maître de l’Espagne et de Naples, plus de mer entre les Etats de l’Eglise et les possessions de ce monarque. Cajetan, fidèle aux instructions de sa cour, dut rappeler aux électeurs la constitution qui excluait du trône impérial les rois de Naples, et le danger qu’il y aurait à donner le titre de roi des Romains à un jeune prince maître du Milanais. Un moment on crut que la politique de Rome l’emporterait. La plupart des électeurs, justement alarmés des périls que signalait le nonce du pape, étaient décidés à repousser les deux compétiteurs. L’électeur de Trèves, n’ayant pu réussir à faire nommer son candidat, le roi de France, proposa aux, membres de la diète de porter leurs voix sur l’un des grands vassaux de l’Empire. Les Etats offrirent la couronne à Frédéric, descendant de Witikind, qui si longtemps avait défendu contre Charlemagne les dieux et la liberté de son peuple. Frédéric refusa. Tous les historiens ont célébré le désintéressement de ce prince, qui rejette une couronne que se disputent les plus puissants monarques du monde ; mais peut-être dans ce refus entrait-il moins de générosité que de sagesse. Frédéric ne possédait en Saxe que le cercle électoral et une partie de la Thuringe. Mieux qu’un autre il connaissait le prix rée d’une couronne, la vie agitée qu’avait menée Maximilien Ier, ses luttes avec les ordres germaniques, ses querelles avec la France et ses combats en Italie. Le char funèbre que ce prince, sur la fin de ses jours, traînait à sa suite, était un symbole trop éloquent de l’instabilité des choses de ce monde, pour qu’un homme qu’on appelait du nom de sage se laissât prendre au piége de la royauté. Comment soutenir la guerre qui éclaterait après l’élection, avec des revenus bornés comme les siens, quand Maximilien, qui tirait des subsides si abondants de ses possessions der la Bourgogne, n’avait pas même de quoi payer la solde arriérée des Suisses ? Il paraît que, frappés de la générosité de Frédéric, les électeurs le prièrent d’une commune voix de nommer au trône vacant. Frédéric opina pour le roi d’Espagne. Le 5 juillet, l’archevêque de Mayence proclama, dans l’église de Saint-Barthélemy, Charles d’Autriche empereur d’Allemagne. Le nonce de Sa Sainteté, conformément aux instructions qu’il en avait reçues, voulut, dit Robertson, se faire un mérite auprès du futur empereur, en lui offrant volontairement, au nom de Léon X, une dispense pour réunir la couronne impériale à celle de Naples. Charles reçut cette nouvelle sans manifester la moindre émotion, comme si, dit Pierre Martyr, il eût tenu déjà sous ses pieds le monde entier. On ne comprit pas d’abord, en Allemagne non plus qu’en France, ce qui avait valu à Charles une si haute dignité. A peine âgé de dix-huit ans, et jusqu’alors sous la tutelle de Chièvres, son gouverneur il n’avait révélé aucun de ces talents supérieurs qui présagent un grand prince : mais l’impassibilité qu’il montra quand les envoyés allemands vinrent lui faire hommage de la couronne frappa d’admiration l’Europe, entière. A quelques jours de là il montrait, dans un tournoi, qu’au besoin il saurait se servir de la lance pour défendre ses droits. A Valladolid, il permit à son écuyer de rompre une lance avec lui, et il le désarçonna. A son tour il l’attaqua en champ clos, et brisa trois fois le fer de son adversaire, sans que le mot Nondum, gravé sur son écusson, eût été seulement égratigné. Sickingen n’eût pas mieux fait : Charles avait gagné ses éperons de chevalier. Le pape n’était pas sans crainte sur les dispositions du nouvel empereur à l’égard du saint siège : Charles aurait-il pour l’Église la déférence de Maximilien ? et quel parti prendrait-il envers ce moine augustin qui troublait en ce moment l’Allemagne ? Le jour où Charles serait couronné, Rome saurait si définitivement elle pouvait compter sur le dévouement du prince. Charles ne perdit pas un moment, et partit pour Aix-la-Chapelle, que fa Bulle d’or avait désignée pour le couronnement. Georges Sabinus a décrit en véritable poste les merveilles de la cérémonie. Quand la couronne impériale eut été posée sur le front du jeune monarque, aux acclamations de tous les assistants, l’archevêque de Cologne s’avança en habits pontificaux, et s’adressant à l’empereur : Promettez-vous, lui dit-il à haute voix, de travailler saintement au triomphe de la foi catholique, de défendre et de protéger les Églises d’Allemagne, de soutenir loyalement les intérêts de l’Empire, d’être le père et le tuteur des veuves et des pauvres, de rendre au pontife de Rome l’obéissance qui lui est due ? A chacune de ces questions, Charles se contentait d’incliner la tête ; à la dernière il leva la main, et la posant sur le côté droit de l’autel : Je le veux ainsi, dit-il, et je compte, pour remplir ma promesse, sur l’aide de Dieu et les prières des chrétiens : que Dieu et ses saints me soient en aide ! Alors l’archevêque se tournant vers les électeurs : Voulez-vous, leur dit-il, reconnaître Charles, ici présent, pour maître et pour souverain, l’aider, lui être soumis, lui obéir, suivant le précepte de l’Apôtre : Que toute âme soit soumise aux puissances ? Fiat, fiat, crièrent tous les assistants. Fidèle à son serment, Charles, quelques mois après son couronnement, convoquait une diète à Worms, pour réprimer les doctrines de Luther. Mais les prédictions de Léon X ne devaient pas tarder à s’accomplir : l’Italie, ainsi qu’il l’avait prévu, allait servir de champ clos au duel entre les deux rivaux. Avec son sang allemand, la maison de Bourgogne avait transmis à Charles sa vieille haine contre les Français. L’empereur gardait rancune au jeune prince qui avait voulu monter sur le trône d’Allemagne, retenait un duché appartenant au duc de Bourgogne, et s’était fait un nom glorieux à Marignan. Il lui en fallait un à lui, roi d’Espagne et de Castille, empereur élu des Romains, empereur d’Allemagne, et à qui Fernand Cortez venait de donner le Mexique. François Ie, de son côté, avait ressenti cruellement l’affront que lui avaient fait les Ordres allemands en lui préférant un jeune homme à peine émancipé, de taille médiocre, au teint blafard, aux cheveux rouges, dont la lèvre inférieure pendait sur le menton ; qui traînait péniblement ses mots, et ressemblait à une momie ; digne fils de Jeanne la Folle, et incapable comme sa mère. En apprenant l’élection de Charles, François Il’ avait déclaré qu’en qualité de duc de Milan, il ne souffrirait pas que l’empereur se fît couronner à Rome autrement que Sigismond et Frédéric III, c’est-à-dire sans armes. Or Charles, à Valladolid, avait montré qu’il savait trop bien se servir de sa lance pour la jeter aux pieds de son rival : une lutte était inévitable. Léon X suivait avec soin les mouvements de ces deux princes. L’Italie devait encore avoir quelques mois de repos, car Charles était trop occupé en Allemagne à fonder son autorité, et François Ier en France à surveiller la guerre allumée dans les Ardennes et le duché de Luxembourg, pour qu’ils vidassent de sitôt leur querelle. Ce que la papauté devait faire, dans la prévision d’un conflit plus ou moins éloigné, c’était de se tenir prête à tout événement. Faible et désarmée, elle courait de grands risques ; puissante et sur ses gardes, elle pouvait faire acheter son alliance, rester maîtresse de ses mouvements, et faire pencher la balance partout où elle pèserait de cette double force dont elle seule réunissait les éléments, la force divine et la force humaine. La civilisation avait tout à gagner de la grandeur mondaine de Rome. Si vous Ôtez à Rome l’épée dont se servit si heureusement Jules II, que deviendra-t-elle ? vassale du roi de France, ou tributaire de l’empereur d’Allemagne ; alors le mouvement intellectuel, à la tête duquel s’est noblement placée la papauté, s’arrête tout aussitôt ; le pinceau s’échappe des mains de Raphaël, le ciseau de celles de Michel-Ange ; Marc-Antoine Raymondi jette son burin ; le gymnase romain est fermé, les travaux de Saint-Pierre sont abandonnés, les chants de Vida et de Sannazar interrompus, les histoires de Guichardin et de Paul Jove inachevées, les livres politiques de Machiavel livrés peut-être aux flammes, et la marche de l’esprit humain suspendue. La papauté est, au XVIe siècle, le soleil du monde intellectuel : qu’aucun corps étranger ne vienne s’interposer entre l’astre et les intelligences qu’il éclaire, car autrement il y aurait obscurcissement, et ténèbres peut-être. Dans l’intérêt de son existence temporelle, et bien plus encore dans l’intérêt de la civilisation, la papauté avait raison de se mettre à la tête, pour le diriger, de tout mouvement qui pouvait agiter l’Italie. L’évêque de Pistole, Pucci, partit avec une somme de 19.000 écus d’or pour lever en Suisse un corps de six mille hommes. Le cardinal de Sion, Schinner, l’attendait pour l’aider de toute son influence. Elle vivait toujours en Suisse, cette influence, grande, révérée et accrue, s’il était possible, dans ces derniers temps, par la pieuse résignation avec laquelle le prélat avait obéi aux ordres du souverain pontife, qui lui avait prescrit le silence et la retraite. Mis au ban de la papauté, pour ainsi dire, Schinner avait donné un bel exemple au monde catholique, en se courbant comme un enfant devant la parole de son maître, certain que tôt ou tard il sortirait de ce repos qui enchaînait et ses mains et son intelligence. Milan commençait à se lasser des Français. Tandis, dit un historien qui n’est pas suspect, que Louis XII avoit ménagé le Milanois comme un ancien héritage auquel il étoit affectionné, François Ier n’y avoit vu qu’une riche province qui pouvoit plus payer que toutes les autres. — On estimoit, ajoute messire Martin du Bellay, le nombre de ceux que le sieur de Lautrec avoit bannis de l’État de Milan, aussi grand que celui qui estoit demeuré ; et disoit-on que la plus grande part avoient été bannis pour bien peu d’occasion, oit pour avoir leurs biens ; qui estoit cause à nous donner beaucoup d’ennemis qui depuis ont été moyen de nous chasser de l’État de Milan, afin de rentrer dans leurs biens. Auparavant que le maréchal de Foix fût venu lieutenant du roi au duché de Milan, estoit, comme dit est, le seigneur de Lautrec venu en France ; le seigneur de Téligny, sénéchal de Rouergue, demeura en son lieu, audit duché, lieutenant du roi ; lequel avoit, par sa sagesse et gracieuseté, Baigné les cœurs des Milanois, si que le pays estoit en grande patience ; mais le seigneur de Lescun arrivé, et le sénéchal de retour, les choses changèrent : aussi firent les hommes d’opinion. Les proscriptions durèrent longtemps. Lescun, qu’on nommait alors le maréchal de Foix, confisquait les biens des bannis, lançait ses soldats après les malheureux échappés à ses poursuites, et les faisait pendre quand il pouvait s’en emparer. C’était un véritable proconsul, fastueux, colère, irritable au dernier point, n’écoutant que sa mauvaise tête, méprisant les réprimandes que lui adressa plus d’une fois son maître ; bon capitaine du reste, dit Brantôme, mais pourtant plus hardi et vaillant que sage et de conduite. A la fin, les mécontents devinrent si nombreux, qu’ils se ruinèrent, coururent aux armes, et formèrent de véritables guérillas qui attaquaient sur les grandes routes les gens du roi de France. Ces proscrits, riches citoyens de Milan, semaient partout la défiance et la haine contre les Français. Il était difficile qu’on ne crût pas aux plaintes d’hommes dont les biens avaient été confisqués sans forme de procès, et la tête mise à prix, parce qu’ils s’avisoient de l’iniquité du gouverneur. Leurs plaintes arrivèrent jusqu’à Rome : ce fut Jérôme Morone, chancelier de Milan, exilé lui aussi, mais exilé volontaire, qui se chargea de plaider la cause des bannis. La voix de cet homme d’État, éloquente mais passionnée, ne pouvait manquer de faire une vivre impression sur l’esprit de Sa Sainteté : quand un magistrat se plaint d’un soldat, presque toujours il est écouté. Le pape était personnellement mécontent du gouverneur Lautrec, qui, sans respect pour l’autorité du saint-siège, disposait à son gré de tous les bénéfices, les conférait à des sujets indignes ou incapables, et défendait, sous des peines sévères, les appellations à la cour de Rome. Ces témérités, que François Ier eût été le premier à réprimer, s’il les eût connues plus tôt, blessaient au cœur Léon Y. Le pape s’en était plaint d’abord par ses ambassadeurs à la cour de France, puis à ses cardinaux, quand il vit que les réparations promises se faisaient toujours attendre. Quelques-uns des proscrits milanais qui fuyaient l’oppression s’étaient rassemblés à Busseto, petite place appartenant à Christophe Pallavicini. Lescun, irrité, députe le Crémonais Cardino à Pallavieini, pour se plaindre d’une protection accordée, au mépris du droit des gens, à des sujets révoltés. Pallavicini conçoit des soupçons, fait appliquer à la question l’envoyé, qui confesse, vaincu par les tourments sans doute, des projets d’assassinat. Pallavicini, ne pouvant trouver des juges qui condamnassent sans procédure Cardino, s’érige en dictateur, prononce la sentence et livre le coupable au bourreau. Une semblable énormité ne pouvait rester impunie. Les bannis se hâtent de quitter Busseto, avec eux Pallavicini, et se sauvent à Reggio. C’était une place démantelée et qui n’aurait pu résister à une attaque sérieuse. Le maréchal de Foix croyait qu’à la première sommation le gouverneur allait lui livrer les bannis : il se trompait. Ce gouverneur était Guichardin le Florentin, qui, bien que républicain, avait prêté serment de fidélité au pape, et qui n’était pas disposé à le trahir. Lescun lui demande une entrevue ; le gouverneur l’accorde, en indiquant pour le lieu du rendez-vous la porte de Parme. Le maréchal, qui se défie de Guichardin, fait poster à la porte de Modène un corps de troupes, pour en barrer le chemin aux bannis, s’ils avaient envie de s’échapper. Pendant que le maréchal, qui s’est fait accompagner de quelques gentilshommes, échange des paroles de reproche avec l’historien, la porte de Modène s’ouvre afin de laisser passer une voiture de farine, et les soldats français se précipitent pour pénétrer dans la place ; mais on les repousse. Alors de toutes parts on crie à la trahison, on court aux armes, on attaque la suite du maréchal, qui, sans le sang-froid du gouverneur, allait chèrement expier l’imprudence de ses gens ; trop heureux d’échapper à la vengeance populaire, grâce aux efforts de son généreux ennemi. Cette violation du territoire de l’Église était pour le pape un motif ou un prétexte de rupture avec la France. Le maréchal, pour réparer sa faute, se hâta de dépêcher La Motte-Grouin à Sa Sainteté ; mais le pape refusa d’agréer les excuses du lieutenant de François Ier. Il assembla le consistoire, se plaignit amèrement de la conduite de ce monarque, dénonça comme un attentat au droit des gens la violation du territoire de Reggio, excommunia son ennemi, et déclara que, dès ce moment, l’alliance avec la France était rompue, et qu’il agréait les propositions que don Manuel, ambassadeur de Charles-Quint, faisait au saint-siège. Ces propositions étaient tout à fait dans l’intérêt de la papauté. Charles-Quint, si Sa Sainteté voulait joindre ses troupes à celles de l’empereur afin de chasser les Français de l’Italie et de rétablir François Sforce à Milan, promettait de faire rentrer Parme et Plaisance dans le domaine de l’Église, d’aider le pape dans sa lutte contre ses vassaux rebelles, de donner une pension de mille ducats au cardinal de Médicis sur les revenus de l’archevêché de Tolède, et d’augmenter le cens qu’il payait au saint-siège sur le royaume de Naples. La malheureuse invasion de Reggio détermina la rupture de Rome avec la France. Un historien contemporain dont l’opinion est d’un grand poids, M. Daru, trouve dans l’état de l’Église d’Allemagne, à cette époque, le motif d’un rapprochement naturel entre le pape et l’empereur. La Saxe était pleine du bruit que produisait la parole de Luther ; les doctrines du moine faisaient chaque jour de nouveaux progrès ; quelques princes même étaient séduits : or un seul homme pouvait mettre fin au schisme, c’était l’empereur ; le pape vint à lui. Charles-Quint était à la diète de Worms, quand il reçut en même temps la nouvelle de la signature du traité d’alliance défensive et offensive entre les deux cours, et de l’irruption des Français en Navarre. Il ne put réprimer un vague sentiment de crainte, car il prévoyait que la lutte dont le signal venait d’être donné ferait le malheur de l’empereur ou du roi. Les historiens favorables à Charles-Quint, tels que Maffei, Guichardin, Polydore Virgile, croient que le signal des hostilités fut donné par François Ier ; mais le monarque s’est justifié de cette infraction aux traités dans une lettre qu’il fit parvenir au saint-père : c’est un débat entre deux têtes couronnées difficile à juger. Ce qu’il y a de certain, c’est que l’invasion de la Navarre par François Ier, provoquée ou non, était un coup de maître ; si le monarque en eût fait la conquête, il serait resté paisible possesseur du Milanais, et la guerre aurait eu nécessairement l’Espagne pour théâtre. La noblesse tout entière était hostile à Charles-Quint ; elle avait vu de mauvais œil l’élection de ce prince à l’empire, parce qu’elle craignait l’influence, dans les conseils du souverain, d’hommes étrangers aux mœurs espagnoles. François Ier avait dû compter sur les antipathies des deux peuples. La fortune seconda d’abord les Français, qui traversèrent les Pyrénées et pénétrèrent en Espagne sans difficulté. Pampelune n’arrêta qu’un moment le vainqueur : le commandant s’enfuit à la première sommation. Restait la citadelle, défendue par un jeune homme d’un rare courage. Placé sur la brèche, il animait ses compagnons de la voix et du geste, et de sa longue épée menaçait les assiégeants ; autour de lui se pressaient d’autres combattants du même âge à peu près, et résolus de s’ensevelir sous les ruines de la forteresse plutôt que de traiter avec l’ennemi, quand un éclat de pierre et un boulet de canon vinrent à la fois frapper le noble Espagnol aux deux jambes : il s’appelait Don Inigo. Le lendemain la citadelle capitulait, et Don Inigo était transporté dans le château de son père. Les médecins appelés crurent d’abord que les blessures étaient mortelles, et que le malade expirerait au milieu des souffrances de l’opération. Il les supporta cependant avec un courage héroïque et ne mourut pas. Pour tromper les longues heures de la convalescence, Don Inigo demanda quelques livres ; on lui en apporta : c’étaient des romans de chevalerie qu’il ferma aussitôt, et les Fleurs des Saints, qu’il ouvrit et dévora. La nuit venue, il s’endormit plus doucement que de coutume, et eut des visions. Il crut que la terre s’agitait, que le lit où il reposait dansait sur ses pieds, et, frappé de terreur, il se mit à prier ; alors sa petite chambre s’illumina d’une blanche lumière, et sur des nuages odorants il vit Marie la reine des anges qui lui souriait tendrement. Estant remis en santé, dit le Parisien Favin, sans déclarer à personne le secret de ses conceptions, il fait un pèlerinage à Notre-Dame de Mont-Serrat... et là, ayant quitté son espée, son poignard, son génet et son habit séculier, il prend un meschant roquet de toile, et se déguisant ainsi sans dire d’où il estoit, il s’adonne à la dévotion, à macérer sa chair, ne vivant que d’aumône. Il est malheureux que l’expédition de la Navarre ait été confiée à Lesparre, bon soldat comme tous les capitaines dont se servait François Ier, mais qui n’entendait rien à l’art de la guerre. S’il se fut contenté de jeter des garnisons dans les diverses places fortes de ce pays, et surtout s’il avait eu soin d’annoncer publiquement qu’il avait envahi la Navarre, non pas pour la réunir à la France, mais pour la restituer aux enfants de Jean d’Albret, qui la réclamaient comme leur patrimoine, en vertu du traité de Noyon que Charles d’Autriche avait signé, alors les esprits ne se seraient point émus en Espagne, et il serait resté maître du pays. Mais, enivré par ce facile triomphe, il marche en avant, se jette dans la Castille, et va mettre le siége devant Logrogno, commandée par Don Pèdre Velez de Guevara. Alors tous les Castillans de sang noble ou roturier se réunissent pour arrêter le vainqueur ; partout on court aux armes ; en quelques jours vingt mille hommes sortis des villes, des villages et des montagnes, se présentent pour barrer le passage à Lesparre, qui, au lieu d’attendre de Pampelune 6,000 Navarrais qu’on enrôlait pour lui porter secours, s’en va, avec autant d’imprudence que de courage, se heurter contre des masses compactes, est mis en déroute, et tombe avec ses principaux officiers dans les mains du vainqueur. Il avait employé environ trois semaines à conquérir la Navarre, il la perdit en moins de quinze jours. Cependant tout se préparait en Italie pour de grands événements. Le pape donna le commandement de ses troupes à Frédéric, marquis de Mantoue, qui renvoya aussitôt à François Ier, le cordon de Saint-Michel dont il avait été décoré. Guichardin eut le titre de commissaire général près de l’armée pontificale ; le commandement des forces alliées fut confié à Prosper Colonne, ce vieux soldat qui depuis près de vingt ans n’avait pas quitté les camps ; encore plein de verdeur malgré ses blessures et son âge, très beau sur un champ bataille, plus admirable dans une redoute. Au commencement du mois d’août 1520, toutes ces troupes vinrent prendre position sur la Lanza, à cinq milles de Parme. L’armée alliée était forte de six mille italiens, de deux mille Espagnols, venus des environs de Gênes dont ils n’avaient pu s’emparer, de deux mille autres partis de Naples sous la conduite de François d’Avalos, marquis de Pescaire, de six mille Allemands et de deux mille Suisses environ. Schinner était heureux ; voici le moment venu où, dociles à ses conseils, le pape et l’empereur paraissent avoir compris le danger de laisser plus longtemps les Français en Italie. Il a repris cette croix de légat que Jules II lui avait donnée, et qu’il portait à la bataille de Marignan. Depuis cette journée funeste, que de chagrins il a dévorés ! Ses montagnards l’ont abandonné, Henri VIII n’a pas voulu l’écouter, et il a vu, dans le Valais, son château de Martigny ruiné par Georges Supersax. C’est en philosophe, ou plutôt en chrétien, qu’il a supporté les reproches de Léon X, l’ingratitude de ses paysans, les fureurs de ses ennemis, les triomphes des Français ; il a cherché dans la prière des consolations contre la mauvaise fortune. A Sion, où il vit dans l’exil, il s’est remis, en attendant des jours meilleurs, à feuilleter le livre de Boèce, son vieil ami, qui sait si bien guérir les maladies de l’âme. Il a peu d’espoir de revoir Rome, aussi a-t-il fini par vendre à Léon X la maison qu’il possédait sur l’Esquilin, et qu’il avait prêtée à Sa Sainteté pour y loger les humanistes romains. Ne le croyez pas malheureux dans ses montagnes de la Suisse. Toutes les joies ne lui ont pas été ravies ; un jour il reçoit une lettre d’Erasme ; une autre fois, un voyageur qui passe à Sion lui remet une belle et longue épître de Sadolet ; un soir, c’est un humaniste qui en traversant=les Alpes, comme Longueil (Longolius), est dévalisé, et auquel il donne généreusement sa bourse. Mais le plus grand bonheur qu’il ait éprouvé de sa vie, c’est quand le pape revient à lui, et qu’il peut reprendre sa croix et sa cuirasse. Les montagnes de l’Appenzell, les deux Mythen et le lac de Wallenstadt retentissent du bruit du cor alpestre. C’est un appel, le dernier qu’il fait à ses montagnards, eues Suisses accourent en foulent. Les soldats qu’il improvise traversent le Pont-du-Diable, l’Urnerloch, et arrivent dans le Modénais. Déjà Prosper Colonne en compte dans son armée plus de dix mille. Mais Lautrec en avait à lui seul près de 20.000 qui semblaient devoir lui rester fidèles, car la diète helvétique, en rappelant ses soldats dans leurs foyers, menaçait de châtiment ceux qui violeraient leurs serments en se battant contre les Français. Le cardinal n’a pas peur de la diète, qu’elle arrache du soi valaisan jusqu’à la dernière pierre de ce château épiscopal qu’a renversé Supersax, que lui importe s’il peut chasser les Français de l’Italie, rétablir les Sforce, et rendre à l’Église Parme et Plaisance ? C’est la ruse cette fois qu’il emploie. Il a des émissaires qui se glissent dans l’armée de Lautrec, qui parlent aux Suisses, excitent leurs défiances, leurs jalousies, leurs colères, et parviennent à les séduire. La désertion se met bientôt dans les rangs de ces soldats mercenaires, qui accusent le général de lenteur, d’incapacité, d’orgueil, et surtout de parjure : il leur avait promis une solde arriérée de plusieurs mois, l’argent n’arrivait pas. Mais ce n’était pas la faute du général français, qui pressait inutilement l’envoi des 30.000 ducats qu’il avait demandés, et que la duchesse d’Angoulême, mère de François Ier, avait reçus et dépensés. Alors les Suisses, malgré les protestations de Lautrec, quittent le camp français, et passent avec armes et bagages dans le camp des alliés, où les cardinaux de Sion et de Médicis, légats du saint-siège, les attendaient la crosse en main, insigne de leur dignité. Il n’y avait pour Lautrec, compromis par une semblable défection, qu’un parti à prendre : c’était de se retirer derrière l’Adda, afin de couvrir Milan, que les alliés voudraient enlever. C’est ce qu’il fit résolument. Il est difficile d’expliquer comment il se laissa tromper par Prosper Colonne, qui passa la rivière sans coup férir. Au moins aurait-il dut s’avancer avec toutes ses forces pour harceler et inquiéter l’ennemi, s’il n’avait pu l’empêcher de traverser l’Adda ; tuais il reste l’arme au bras dans son camp, et se contente de détacher Lescun, son frère, qui, avec un misérable corps d’infanterie, quatre cents lances et cinq à six pièces de canon, va tenter d’arrêter les confédérés dans leur marche sur A flan. La partie n’était pas égale, et Lescun, malgré toute sa bravoure, devait succomber. Après d’inutiles prodiges de valeur, il fut forcé d’opérer sa retraite sur Cassano. Lautrec, ayant appris par ses coureurs la défaite de son frère, se hâta de regagner à marches forcées Milan. Pour effrayer les habitants, il livra au bourreau un vieillard, Christophe Pallavicini, dont il s’était emparé quelques mois auparavant, et que Léon X avait vainement réclamé, en promettant en échange un chapeau de cardinal à l’une des créatures de Lautrec : imprudence ou cruauté qu’un historien français de cette époque a justement flétrie. Milan, du reste, était fatigué de la domination française : à la première sommation des alliés, il se rendit, sans même essayer de se défendre. Depuis l’expédition de Charles VIII, l’esprit national italien avait fait de grands progrès ; le joug de l’étranger, qu’on subissait d’abord avec joie, était devenu dur et pesant : Jules II commençait à être compris. II faut bien avouer que cette haine pour l’étranger est due à la papauté, qui, depuis Alexandre VI, travaille à rendre odieux aux Italiens tout ce qui porte le nom de Barbare. Réduite à ses seules forces, il est certain que la papauté n’aurait pas pu opérer la délivrance du sol : aussi s’allie-t-elle à Charles-Quint pour refouler au delà des Alpes les Français ; mais avec une arrière-pensée, qu’on a taxée de ruse et qui n’est que du patriotisme, celle de tourner ses armes, avec la grande confédération italique, contre les Espagnols, dont elle se servait pour instrument ; puisque, comme l’a remarqué si justement M. Libri, l’asservissement de l’Italie devenait inévitable le jour où François Ier et Charles-Quint la choisiraient pour champ de bataille. Léon X était à sa maison de campagne de la Magliana, quand un courrier vint lui apporter la nouvelle de la restitution au domaine de l’Eglise de Parme et de Plaisance, ces deux bras de l’exarchat de Ravenne, selon l’expression de Jules II. Que Dieu accorde encore quelques jours de vie au pontife, et dans toute l’Italie il ne restera pas une lance étrangère ! Il partit le 24 novembre de la Magliana pour Rome, où il avait hâte de remercier le ciel, au pied des autels, du triomphe que venait d’obtenir le saint-siège. Le peuple l’attendait aux portes de la ville, des couronnes d’olivier à la main ; partout sur son passage éclataient des transports d’amour. De grandes réjouissances eurent lieu pendant trois jours. Pâris de Grassi vint demander à Sa Sainteté si elle jugeait convenable de rendre à Dieu de solennelles actions de grâces. Que vous en semble ? dit le pape. Très saint-père, répondit le maître des cérémonies, quand la guerre éclate entre des princes chrétiens, l’Église n’a pas coutume de célébrer la défaite du vaincu, à moins toutefois que l’Eglise n’en retire quelque avantage. Le pape sourit et répondit : J’ai recouvré un beau trésor ! — Alors, répliqua Pâris, nous remercierons Dieu. Le pape convoqua le consistoire pour le mercredi 27, et, se trouvant incommodé, se retira dans sa chambre à coucher. Les médecins furent appelés, mais l’indisposition leur parut sans danger : c’était un catarrhe, que l’humidité de la villa Magliana avait développé, et qui bientôt revêtit un caractère funèbre. Le pape avait de la peine à respirer ; il se mit au lit. La nuit fut mauvaise et agitée ; le dimanche matin, 1er décembre 1521, on le vit lever les yeux au ciel, joindre les mains, murmurer quelques mots d’une prière ardente, puis retomber sur son oreiller et mourir : le catarrhe l’avait suffoqué. II achevait sa quarante-sixième année ; il avait régné huit ans huit mois et dix-neuf jours. Jamais la mort d’un pape n’avait encore excité d’aussi vifs regrets. Le peuple se jeta, dans les premiers transports de son aveugle colère, sur l’échanson de Sa Sainteté, Barnabé Malespina, qu’il accusait d’avoir empoisonné le pape dans une coupe de vin. On le traîna au château Saint-Ange ; mais l’arrivée du cardinal de Médicis rendit la liberté au malheureux échanson. On avait cherché des preuves, et on n’avait trouvé que des rumeurs populaires. Les funérailles du pontife furent simples et modestes : Antoine de Spello prononça l’oraison funèbre du mort ; mais les pleurs du peuple furent plus éloquents que les paroles du camérier. Au bruit de cette mort si soudaine, Érasme écrivit d’Angleterre : La chrétienté vient de perdre un de ses plus beaux ornements. Quatre siècles, parmi les soixante qui se sont écoulés depuis que Dieu créa le monde, ont reçu le nom d’un homme. Cet homme s’appela Périclès, Auguste, Léon X, ou Louis XIV. |