L’HISTOIRE ROMAINE À ROME
DEUXIÈME PARTIE —
VII — GUERRES SAMNITES. - PYRRHUS.
|
Le cinquième siècle est le plus beau siècle de Rome. Les plébéiens ont conquis le consulat et achèvent de conquérir leur admission aux autres magistratures que les patriciens roulaient se réserver ; ils s’affranchissent de la servitude qui, sous le nom de nexus, pesait sur les débiteurs. Ils arrivent à l’égalité politique et à l’indépendance individuelle ; en même temps la vieille aristocratie domine encore dans le sénat et y maintient l’inflexibilité des résolutions et la persistance des desseins. C’est grâce à cette situation intérieure que le peuple romain put soutenir au dehors les plus fortes épreuves dont il ait triomphé, et faire les progrès qui lui ont le plus coûté. On le voit combattre tour à tour, et souvent tout ensemble, les Latins, les Étrusques, les Gaulois, les Samnites, les autres peuples sabelliques de l’Apennin, et il finit toujours par vaincre. Je ne puis, ce n’est pas le but de cet ouvrage, l’accompagner dans cette seconde phase de la conquête, car la conquête perd souvent de vue l’horizon romain qui est l’horizon de mon histoire. Mais, sans quitter Rome, je suivrai d’ici les pas de sa fortune. Je pourrai indiquer les principaux moments du progrès des armes romaines, car leur bruit viendra jusqu’à Rome. Les généraux y seront élus et y seront ramenés par les luttes des partis ou pour le triomphe ; enfin des temples, ou d’autres monuments y seront élevés à l’occasion de tous les grands événements politiques et militaires, dont ces monuments me permettront de faire, dans ce qu’elle a d’essentiel, la double histoire. Les commencements de cette époque brillante furent sombres. Rome fut affligée par une de ces maladies qu’on trouve à toutes les époques dans l’histoire de cette ville malsaine. Telle est l’origine des jeux scéniques[1], importés par les Étrusques et d’où sortit la comédie. Ce fut un moyen dont on s’avisa pour apaiser les dieux ; ainsi la comédie eut à Rome une origine religieuse et triste. Le cinquième siècle est à Rome l’âge des grands dévouements et des grands sacrifices. Deux généraux romains immolèrent leurs fils, vainqueurs sans permission, à l’impitoyable rigueur de la discipline. Le premier Decius se dévoua au salut de l’armée, en se consacrant aux dieux infernaux, en assumant ainsi sur sa tête, par une vaillante mort, les maux dont la patrie était menacée. Cette immolation volontaire fut accomplie par deux autres Decius[2] ; les Decius, grandes âmes plébéiennes, Plebeiæ
Deciorum animæ, plebeia fuerunt Nomina
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . comme dit Juvénal. On vit alors ce qu’étaient ces plébéiens, que la superbe patricienne avait voulu repousser des honneurs et qui en prenaient possession par la gloire et par la mort. A Rome, le dévouement n’était pas un caprice de l’héroïsme individuel, c’était une institution soumise à de certaines règles et à de certaines formes que la religion imposait. On le voit par la mort de celui des Decius qui donna le premier l’exemple de cette noble mort au pied du Vésuve, lieu que Pline devait illustrer par un autre dévouement non moins noble, le dévouement à la science[3]. Decius appela le pontife public du peuple romain et le pria de lui dicter les paroles par lesquelles il devait se dévouer au salut des légions. Le pontife lui ordonna de prendre la robe prétexte, de se voiler la tête, de toucher sous sa toge son menton, et, les pieds sur un javelot couché à terre, de dire : Janus, Jupiter, Mars, Quirinus, Bellone, Lares, dieux Novensiles, dieux Indigètes, dieux au pouvoir desquels nous sommes et sont nos ennemis, vous, dieux Mânes.... je vous demande de donner la force et la victoire au peuple romain des Quirites, et d’envoyer aux ennemis du peuple romain des Quirites l’épouvante et la mort, comme je l’ai. déclaré par mes paroles ; ainsi pour la chose publique des Quirites, pour l’armée, les légions, les auxiliaires du peuple romain des Quirites, je dévoue avec moi aux dieux Mânes et à Tellus, les légions et les auxiliaires de l’ennemi. On voit par cette consécration en forme que le dévouement était un acte religieux solennel, ayant son rite et son formulaire, bel article de foi de la religion du peuple romain[4]. Le dévouement des Decius avait été précédé par le dévouement de Curtius ; sauf la clôture merveilleuse du gouffre, la tradition n’a rien que de vraisemblable. Dans tous les cas, cette fois, elle était restée attachée à un endroit déterminé, connu de tous, et par là mérite de prendre place dans une histoire comme celle-ci, qui rapporte les faits traditionnels aussi bien que les faits historiques en les rattachant aux lieux où on les plaçait. Voici ce que cette tradition racontait : Un gouffre s’était ouvert au milieu du Forum[5], et, quelque quantité de terre qu’on y jetât, n’avait pu être comblé. Les devins avaient déclaré qu’il fallait dédier à ce gouffre[6], c’est-à-dire aux puissances souterraines qui l’habitaient, ce qui était la plus grande force du peuple romain, et qu’ainsi on assurerait la perpétuité de la république. Alors un vaillant jeune homme, nommé Marcus Curtius, avait dit : Comment pourrait-on penser qu’il y ait pour Rome un plus grand bien que les armes et le courage, et tout le monde ayant fait silence, lui, regardant les temples qui dominaient et dominent encore aujourd’hui le Forum, puis le Capitole, tendant les mains tantôt vers le ciel, tantôt vers cette ouverture et les dieux Mânes, il s’était dévoué ; ensuite, monté sur un cheval superbement équipé, il s’était précipité tout armé dans le gouffre. Hommes et femmes avaient jeté sur lui des offrandes et des fruits de la terre, et le gouffre s’était refermé. Ce lieu, déjà célèbre sous le nom de lac Curtius, en mémoire d’un ancien guerrier sabin, le devint plus encore par le dévouement patriotique d’un autre guerrier du même nom. Le gouffre était au centre du Forum ; on y éleva à la mémoire des deux héros, deux autels[7] ; Ovide les vit encore. Les Romains avaient élevé l’autel de M. Curtius qui leur appartenait, bien qu’il fût Sabin d’origine[8], pour l’opposer à l’autel de l’ancien Curtius, le champion sabin qui avait été leur ennemi[9]. Dans le commencement de la période où nous entrons, le
champ de la guerre est encore singulièrement rapproché de Rome. Les Romains
sont aux prises avec les habitants de Tibur, il semble que nous en soyons à Ce pont a été réparé par Narsès, mais quelques parties où le tuf se mêle au travertin, appartiennent aux derniers temps de la république. Le pont qui existait à l’époque de Manlius Torquatus était probablement en bois. Les Romains occupaient la rive gauche de l’Anio ; ni l’une ni l’autre armée n’avait voulu rompre le pont, disait la tradition, pour n’avoir pas l’air de craindre l’ennemi, procédé chevaleresque qui étonnerait bien un commandant du génie ; mais on avait fait des deux côtés plusieurs tentatives inutiles pour s’emparer de ce passage. Alors un Gaulois de grande taille, — les soldats gaulois sont toujours représentés comme très grands, — un Gaulois de grande taille s’avance sur le pont vide, frappe son bouclier de sa lance et, criant le plus fort qu’il peut, de manière à être entendu de toute l’armée romaine, prononce en latin[12] ces paroles, qui, si la discipline le permettait, sortiraient en pareille occasion de la bouche d’un de ses descendants, de ces soldats gaulois qui se promènent aujourd’hui près du ponte Salaro : Voyons, que le plus brave d’entre vous vienne m’attaquer, et que ce qui adviendra de l’un et de l’autre fasse connaître laquelle de nos deux nations se bat le mieux. Et avec cette humeur drolatique que les Gaulois modernes, dont je parlais tout à l’heure, n’ont pas laissé perdre l’usage, celui-ci tira la langue en manière de défi grotesque[13]. Ce que j’ai peine à croire, quoique les anciens l’attestent[14], c’est que chacun dans l’armée romaine garda le silence, épouvanté par le péril. En tout cas, ce lâche exemple ne fut pas suivi par un jeune patricien du nom de Manlius. Ce jeune homme s’était déjà fait connaître par l’énergie de ses résolutions. Comme il passait pour avoir un esprit lourd et grossier, son père l’avait traité avec rigueur et tenu à l’écart dans une de ses fermes. Or il advint que ce père rigoureux fut accusé par un tribun de procédés tyranniques envers les plébéiens, et le tribun allégua aussi contre lui sa cruauté à l’égard de son fils. Celui-ci le sut, accourut à Rome de grand matin, pénétra chez le tribun ; et, en menaçant de le tuer, lui fit jurer qu’il se désisterait de son accusation. Père dur comme il avait été fils dévoué, ce qui est bien romain, ce même Manlius devait un jour faire mourir son fils pour avoir, contre son ordre, attaqué un ennemi en combat singulier, ce que lui-même faisait aujourd’hui, mais après avoir demandé l’autorisation de son général. En effet, il se présenta devant le dictateur, et lui dit : Général, je ne combattrais pas sans ta permission, quand je serais sûr de vaincre ; mais, si tu y consens, je montrerai à cette brute qui se pavane si fièrement en avant des rangs ennemis. que je suis d’une famille où l’on a précipité les Gaulois de la roche Tarpéienne. Je doute, malgré le témoignage de Tite-Live, qu’un Manlius ait osé faire cette allusion à un homme dont sa gens avait répudié le souvenir et ne voulait plus porter le prénom. Le dictateur permet le combat et encourage Manlius ; ses camarades s’empressent de l’armer. Il prend un bouclier léger de fantassin, une épée espagnole commode pour combattre de très près, et s’avance à la rencontre du Barbare. Les deux champions, isolés sur le pont, comme sur un théâtre, se joignent au milieu. Le Barbare portait un vêtement bariolé et une armure ornée de dessins et d’incrustations dorées, conforme au caractère de sa race, aussi vaine que vaillante. Les armes du Romain étaient bonnes, mais sans éclat. Point chez lui, comme chez son adversaire, de chant, de transports, d’armes agitées avec fureur, mais un cœur plein de courage et d’une colère muette qu’il réservait tout entière pour le combat. Le Gaulois, qui dépassait son adversaire de toute la tête, met en avant son bouclier et fait tomber pesamment son glaive sur l’armure de son adversaire. Celui-ci le heurte deux fois de son bouclier, le force à reculer, le trouble, et, se glissant alors entre le bouclier et le corps du Gaulois, de deux coups rapidement portés lui ouvre le ventre. Quand le grand corps est tombé, Manlius lui coupe la tête[15], et, ramassant le collier de son ennemi décapité, jette tout sanglant sur son cou ce collier, le torques, propre aux Gaulois, et qu’on peut voir au Capitole porté par celui qu’on appelle à tort le gladiateur mourant. Un soldat donne, en plaisantant, à Manlius le sobriquet de Torquatus, que sa famille a toujours été fière de porter. Le seul monument de cette guerre que les Romains tirent alors aux Gaulois fut un monceau d’or assez considérable que le dictateur C. Sulpicius consacra dans le temple de Jupiter Capitolin et entoura d’un mur de pierre. Ce monceau devait avoir été formé surtout des colliers et des bracelets si chers à la braverie gauloise. Les Étrusques de Tarquinii, les Falisques et les Cærites[16] avaient immolé à leurs dieux des prisonniers romains ; le Forum vit de terribles représailles de ce crime trois cent cinquante-huit jeunes gens des premières familles de Tarquinii y furent battus de verges et décapités, comme l’avaient été au même endroit les fils de Brutus. Le reste fut égorgé autrement, dit froidement Tite-Live. La guerre avec les Latins ne fut ni très longue ni très difficile. Depuis Spurius Cassius, alliés des Romains, leurs chefs continuaient à se rassembler dans le bois de Ferentina (bois de Marino). Plusieurs villes, qu’on regardait comme faisant partie du Latium, quoique, par leur situation et leur origine, elles appartinssent plutôt au pays et à la race sabelliques, s’étant détachées de l’alliance romaine, l’assemblée de Ferentina, osa déclarer que les Latins aimaient mieux combattre pour leur liberté que pour Rome. Dès ce moment, ils. prétendirent traiter sur le pied de l’égalité avec les Romains ; mais les Romains ne voulaient point d’égaux, et quand, mandés par le sénat, inquiet de leurs menées secrètes dont il avait connaissance, leurs envoyés vinrent à Rome, l’orgueil de la confédération latine et celui de la ville, dont le berceau avait été latin, se trouvèrent en présence au Capitole ; car c’était dans le temple de Jupiter qu’on avait reçu les envoyés latins, sans doute pour les accabler de la majesté de Rome, que ce temple représentait. L’un des envoyés, Annius, n’en fut point troublé ; il osa demander que les Romains et les Latins formassent un seul peuple, eussent un sénat mi-partie des deux nations, et que le consulat fût partagé entre elles. A cette proposition superbe, Manlius, qui, en défendant la majesté incommunicable du Capitole, était sur sort terrain, car ses aïeux avaient habité et l’un d’eux sauvé le Capitole, saisi d’indignation, se tourna vers la statue de Jupiter, et s’écria : Ainsi, ô Jupiter, captif et opprimé, tu verrais des consuls étrangers, un sénat étranger dans ton temple auguré ! Il conclut en déclarant que, si le sénat consentait à une telle honte, lui tuerait de sa main tout sénateur latin qu’il trouverait dans la curie, indignation qui n’était pas très l’ondée, car les traités avaient autrefois établi une parfaite, égalité entre les Romains et les Latins, et le partage du pouvoir que ceux-ci réclamaient avait existé[17] ; mais cette indignation montre combien la nationalité romaine se sentait, dès cette époque, distincte de la nationalité latine. Les Romains n’étaient point, à leurs propres yeux, aussi Latins que le dit Tite-Live, qui appelle la guerre contre les confédérés du Latium une guerre civile. Les noms de Latins et de Sabins, ces deux éléments de la population primitive de Rome, s’étaient perdus dans le nom, déjà superbe, de Romains, le seul que ses citoyens voulussent porter. Je me trompe, ils s’appelaient aussi Quirites, c’est-à-dire Sabins, et ce Titus Manlius, qu’irritait si fort la proposition des envoyés latins, était de race sabine ; son prénom et son nom étaient sabins[18]. Annius aussi fut saisi d’une grande colère,, et on prétendit qu’il avait prononcé des paroles de mépris contre le Jupiter romain. On ne manqua pas de voir une punition divine dans la chute qu’il fit en sortant précipitamment du temple. Il roula jusqu’au bas des degrés, et sa tête heurta le rocher si violemment, qu’il perdit la connaissance, même la vie, disaient quelques-uns[19]. Les Latins furent battus et firent la paix, puis se révoltèrent et essuyèrent deux défaites définitives, l’une près de Pedum, au pied des monts de Tibur ; l’autre sur le bord de la mer, près d’Astura. Nul temple ne fut élevé à l’occasion de la guerre latine ; il n’en resta d’autres monuments, outre les rostres, nouvel ornement de la tribune, et dont je vais parler, que les statues équestres des deux consuls Furius et Mænius, honneur rarement accordé à cette époque, et une plaque de bronze sur laquelle était gravé un décret qui accordait aux chevaliers campaniens le droit de cité. Ce décret fut placé dans le temple de Castor, en souvenir, sans doute, de la victoire sur les Latins au bord du lac de Régille, à l’occasion de laquelle avait été érigé ce temple qui rappelait un souvenir humiliant pour eux. Les Campaniens avaient été dans cette guerre les alliés des Latins ; mais les chevaliers, ce qui veut dire les nobles de Campanie, étaient restés fidèles au peuple romain. L’aristocratie de Rome avait des intelligences avec les autres aristocraties italiotes[20]. Au fond sabine, elle devait chercher à s’appuyer sur ces aristocraties qui, en beaucoup de lieux, avaient la même origine. En Campanie, l’aristocratie était sabellique, car elle était originairement samnite. La guerre avec les Latins fut assez peu de chose et assez promptement terminée. Les Latins étaient les habitants de la plaine, une population agricole plus facile à dompter que les rudes populations sabelliques de la montagne, et ils auraient encore moins résisté aux Romains s’ils n’avaient eu dans leur alliance plusieurs de ces populations[21]. Ce fut pendant cette guerre que l’on prit leurs vaisseaux aux habitants d’Antium ; ils avaient embrassé la cause des Latins, et on leur interdit le commerce maritime. Une partie de ces vaisseaux fut brûlée, une autre conduite à Rome dans l’arsenal ; les becs de bronze (rostra) dont leurs proues, selon l’usage tyrrhénien, étaient armées, servirent à orner la tribune et lui donnèrent le nom qu’elle porta toujours depuis, les Rostres. C’est ainsi que, plus tard, on suspendait, les jours de fête, dans le Forum, les boucliers dorés des Samnites. Pourquoi cet ornement naval fut-il employé à décorer la tribune ? Rome eut de bonne heure des intentions maritimes, comme le prouvent ses traités avec Carthage. Le sénat voulait-il tourner la pensée des citoyens vers la mer, en plaçant des proues de vaisseaux sous les yeux des orateurs et devant les regards du peuple ? Outre la grande guerre contre les Samnites, à laquelle j’arriverai bientôt, les Romains eurent à combattre successivement d’autres populations sabelliques de la montagne moins redoutables, comme les Aurunces. La guerre qu’ils firent aux habitants de Privernum (Piperno) doit être signalée ici, car elle se rattache à une localité du Palatin ; elle fait voir d’ailleurs dans le peuple romain une générosité de sentiments qu’il ne montra pas toujours, et qui caractérise cette époque de sa vraie grandeur. Privernum était située sur une cime qui domine les marais Pontins. Piperno, comme on l’appelle aujourd’hui, est célèbre par ses brigands. Dans un pays désorganisé, les brigands sont souvent la partie la plus énergique et la plus frère de la nation. Les Privernates, aïeux des bandits de Piperno, montrèrent dans leurs rapports avec Rome une grande énergie et une grande fierté. On va voir que l’énergie et la fierté des Privernates ne déplurent point aux Romains. Les habitants de Fondi avaient fait cause commune avec les habitants de Privernum. Leur chef, Vitruvius Vacca, possédait une maison sur le Palatin ; c’était un homme considérable dans son pays et même à Rome[22]. Ils demandèrent et obtinrent grâce. Privernum fut pris, et Vitruvius Vacca, qui s’y était réfugié, conduit à Rome, enfermé dans la prison Mamertine pour y être gardé jusqu’au retour du consul, et alors battu de verges et mis à mort ; sa maison du Palatin fut rasée, et le lieu où elle avait été garda le nom de Prés de Vacca. Ses biens furent consacrés au dieu Sabin Sancus, pour lequel la dévotion du consul Plautius, vainqueur des Privernates, ire surprend point, car la gens Plautia était d’extraction sabine[23]. Tout ce que l’on trouva de monnaie en cuivre chez le condamné fut employé à faire des globes de bronze, et ils furent déposés dans le sanctuaire de Sancus, sur le Quirinal. On délibérait dans la curie sur le sort des Privernates. Quelle peine estimez-vous avoir méritée ? demanda à un de leurs envoyés un sénateur disposé à la sévérité. — La peine que méritent, répondit l’envoyé, ceux qui se jugent dignes de la liberté. — Et si nous vous faisons remise de la peine, quelle sera la paix que nous pouvons attendre de vous ? — Si les conditions en sont bonnes, reprit l’envoyé, cette paix sera fidèlement et à toujours observée ; si elles sont mauvaises, elle ne sera pas de longue durée. Ces réponses ne plurent pas à tout le monde dans le sénat ; mais la majorité s’honora en déclarant que c’était parler en homme et en homme libre, qu’on ne pouvait avoir confiance en ceux qui désirent la servitude. Plusieurs opinèrent que des hommes qui voulaient avant tout la liberté étaient dignes d’être Romains ; et, au lieu de punir les Privernates, on leur accorda le droit de cité : nobles sentiments des deux côtés et nobles paroles ; généreuse conduite de la part des Romains. La générosité est rare en politique. Quand on la rencontre, cela fait du bien à l’âme : elle respire, le changement la repose. Les guerres contre les Samnites furent tout autre chose que les guerres contre les Latins : la montagne lit une tout autre résistance que la plaine ; la race sabellique était autrement trempée que la race latine. Déjà les Æques et les Volsques, placés à l’avant-garde de la montagne, avaient rudement exercé le courage et la patience des Romains, les Æques surtout. Des hauteurs qui dominent Carséoli et Subiaco et s’étendent jusqu’au lac Fucin, ils venaient sans cesse se heurter sur l’Algide contre les armées romaines, qui ne se lassaient point de les repousser. Ils descendaient dans la campagne et menacèrent souvent les murs de Rome. Vaincus une dernière fois par Camille, ils se relevèrent à l’époque des guerres samnites ; mais les Romains leur prirent quarante villes en cinquante jours, et ils furent, presque complètement exterminés. La trace de leur extermination est. dans le peu de traces et le peu de ruines qu’ils ont laissées. Mais les véritables champions de l’indépendance sabellique
furent les Samnites. C’était une population vigoureuse, habitant des bourgs[24] dans la
montagne, pareils aux petites villes dont elle est aujourd’hui semée, et ils
formaient une confédération puissante. Placés à l’est des Æques et des
Volsques, et séparés par eux des Romains, les Samnites avaient dirigé leurs
conquêtes sur Il faut entendre Tite-Live : Je vais dire des guerres plus grandes par les forces de l’ennemi, par la distance des lieux, par la durée des temps. Puis viendra Pyrrhus, puis Annibal. Que de difficultés ! que d’efforts ! Quanta rerum moles ! Les Romains ne voulaient pas laisser les Samnites maîtres
tranquilles de Les commencements de la guerre samnite furent marqués par deux événements, dont l’un vint se terminer aux environs de Rome, l’autre dans Rome même, et qui, par conséquent, doivent entrer dans cette histoire. Ils peignent l’état moral et politique de Rome, que je cherche toujours à saisir de près en me transportant sur les lieux et au cœur des faits dans lesquels il se produit. La garnison de Capoue forma le dessein de s’emparer de cette ville et de s’y établir. Le sol et le climat plaisaient aux soldats, ils les préféraient au sol aride et empesté de la campagne romaine[25]. Puis, craignant que leur conspiration ne fût découverte, ils prirent, le parti d’aller à Rome, sans doute pour y obtenir un adoucissement au sort des débiteurs, en intimidant les patriciens dont ils accusaient la dureté. Une cohorte partit des environs de Terracine, et, s’en vint, pillant le pays, camper au pied du mont Albain. Cette troupe, disciplinée dans son indiscipline même, sentit le besoin d’un chef, elle était composée de Romains. Ils apprirent que, près de Tusculum, vivait dans sa villa un patricien, T. Quinctius, qui s’était distingué dans la guerre, mais qui, devenu boiteux à la suite d’une blessure, avait dei y renoncer. Les mutins résolurent de le mettre de force à leur tête. Ils entrèrent de nuit dans sa villa, s’emparèrent de lui, et, ne lui laissant d’autre alternative que le commandement ou la mort, le contraignirent d’accepter le titre de général et lui demandèrent de les conduire à Rome. Ils arrivèrent ainsi enseignes en tête, au huitième mille de la voie qui s’appela depuis Appia, quand Appius l’eut pavée en lave ; un chemin existait déjà[26]. C’étaient des Coriolans au petit pied, mais ils s’arrêtèrent plus tôt que lui, et l’amour de la patrie, qui avait eu tant de peine à fléchir l’âme du patricien endurci, triompha beaucoup plus vite dans le cour de ces plébéiens égarés. Le dictateur Valérius Corvus, celui qui devait son surnom à ce combat contre un Gaulois, dans lequel un corbeau était venu, disait-on, à son secours, sortit de Rome avec une armée et s’avança à leur rencontre. C’était la première menace d’une guerre civile. Mais, comme dit Tite-Live, on n’avait pas alors tant de courage pour verser le sang de ses concitoyens. Quand les révoltés rirent les armes et les enseignes romaines, ils se sentirent émus. Soldats et généraux se rapprochèrent. Le dictateur n’eut garde de déployer une rigueur excessive : Vous n’êtes pas dans le Samnium, dit-il avec douceur ; vous n’êtes pas chez les Volsques : vous campez sur le sol de Rome. Ces collines, ce sont celles de votre pays natal. Ces soldats, ce sont vos concitoyens, et moi j’ai été votre consul. C’est sous ma conduite et sous mes auspices que, l’année dernière, vous avez battu les légions et forcé le camp des Samnites. Moi, consul à vingt-trois ans, j’étais aussi sévère pour les patriciens que pour les plébéiens ; le dictateur sera pour vous ce qu’a été le consul, ce qu’a été le tribun. Vous tirerez le fer contre moi avant que je ne le tire contre vous. Si nous devons combattre, que la trompette sonne, que le cri de guerre s’élève, que le combat commencé de votre côté. T. Quinctius, tout en larmes, se tournait vers ceux qui l’avaient contraint de marcher à leur tête et leur disait : Soldats, je serai un meilleur chef pour la paix que pour la guerre. Ce n’est pas un Volsque ou un Samnite qui vient de parler c’est un Romain, c’est votre ancien consul, c’est votre général. Ceux dont la victoire serait assurée, veulent la paix ; et nous que voudrions-nous ? Plus de colère, plus de fallacieuses espérances. Remettons notre sort à une foi qui nous est connue. Des cris d’approbation s’élèvent de toutes parts ; Quinctius vient en avant des enseignes et se livre au dictateur, en le suppliant de vouloir bien se charger de la cause de ses infortunés concitoyens, ne demandant rien pour lui-même, mais seulement que nul ne fût recherché pour cette sécession. Le dictateur galope vers Rome, et, sur la proposition du sénat, les centuries, rassemblées dans ce bois Pœtélius qui avait vu la condamnation de Manlius, déclarent que nul ne serait recherché ; et, de plus, V. Corvus pria les citoyens que jamais un reproche ne fût adressé sur ce sujet à personne, même en plaisantant. D’après une autre version non moins touchante[27], les généraux n’avaient pas eu le temps d’intervenir dans la réconciliation, mais aussitôt que les deux armées s’étaient trouvées en présence, elles s’étaient précipitées l’une vers l’autre et s’étaient embrassées avec larmes. Quoi qu’il en soit de la vérité de ces deux récits ; c’est une belle histoire, qui fait voir à quel point le sentiment de la patrie était encore puissant sur le cœur des Romains, à cette époque qu’on peut appeler leur époque héroïque ; et ce souvenir d’une rencontre attendrissante, non loin du lieu où les Horaces et les Curiaces s’embrassèrent avant de combattre, et du lieu où Coriolan embrassa sa mère qui l’avait désarmé, ce souvenir va bien aux deux autres. Le second événement que je veux raconter présente un triomphe de la modération sur la sévérité dictatoriale, mais il ne fut pas aussi facilement remporté. Le dictateur était L. Papirius Cursor. Il avait pour maître de cavalerie Q. Maximus Fabius. Tous deux appartenaient à deux grandes familles patriciennes et originairement sabines[28]. Le dictateur, averti parle gardien des poulets sacrés de l’insuffisance de ses auspices, était revenu à Rome en chercher de nouveaux. En partant il défendit à Fabius d’attaquer l’ennemi durant son absence. Celui-ci lui désobéit, remporta sur les Samnites une victoire brillante, et en adressa la nouvelle, non au dictateur, mais au sénat. Papirius en fut très irrité ; congédiant sur-le-champ le sénat, il s’élança hors de la curie, et fit grande hotte pour aller rejoindre son camp, plein de colère et de menaces. Fabius, au bruit de son approche, rassemble l’armée et lui demande de le protéger contre le dictateur. Des acclamations lui répondent ; les soldats lui promettent de le défendre. Le dictateur arrive, cite Fabius devant son tribunal, lui reproche sa désobéissance, et, ce qui était encore plus grave ; d’avoir combattu sous des auspices douteux, et termine par ces mots : Que le licteur s’avance, qu’il prépare les verges et la hache. Un grand tumulte s’élève ; de toute l’armée sortent des voix qui supplient et menacent. Le jour finit, et, selon la coutume, le jugement est remis au lendemain. Fabius s’échappe pendant la nuit ; il se rend à Rome. Son père, qui avait été dictateur et trois fois consul, convoque le sénat. Il commençait à se plaindre de la violence de Papirius ; tout à coup on entend au bas de la curie le bruit que faisaient les licteurs en écartant la foule, et Papirius paraît. En apprenant l’évasion de Fabius, il était parti sur ses traces. Il ordonne de le saisir ; les sénateurs se récrient et s’efforcent de détourner le dictateur de son dessein. Tout est inutile. Alors le père de Fabius en appelle aux tribuns et au peuple. On sort de la curie. Le dictateur monte à la tribune, et Fabius vient s’y placer à ses côtés ; Papirius le force à en descendre. Son père, qui y avait également pris place, en descend avec lui. La voix et l’indignation du père de Fabius dominent le bruit du Forum : il accuse le dictateur, il défend son fils là où le vieil Horace avait défendu le sien. Des verges, des haches, s’écrie-t-il, pour des généraux victorieux ! Et à quoi de plus cruel eût été exposé mon fils si l’armée avait péri ? Celui par lequel les temples s’ouvrent, les autels fument et sont chargés d’offrandes, sera dépouillé de ses vêtements, déchiré par les verges en présence du peuple romain, en vue du Capitole, de la citadelle et des Dieux que, dans deux combats, il n’a pas vainement invoqués. Le Capitole, qui dominait le Forum et le champ de Mars, s’élevait comme un autel magnifique vers lequel les suppliants tendaient toujours les mains. En disant ces paroles, le vieux père embrassait son fils, comme le vieil Horace, et pleurait. Les sénateurs, les tribus, le peuple, étaient pour lui ; le dictateur ne cédait pas. Inflexible, il proclamait la nécessité de la discipline, la sainteté des auspices, la majesté de l’imperium, qui devait être transmise intacte à perpétuité, comme un pape parlerait de son pouvoir inviolable qu’il ne saurait abdiquer. Il montrait les suites de la désobéissance impunie, il gourmandait les tribuns, il les en rendait responsables pour tous les siècles. Voulez-vous, leur disait-il, offrir vos têtes pour protéger l’insubordination de Fabius. Les tribuns étaient troublés et commençaient à craindre pour eux-mêmes l’omnipotence du dictateur. Alors, par un mouvement unanime, le peuple tout entier passa de la résistance à la prière. Les tribuns prièrent aussi et demandèrent la grâce de Fabius. Fabius lui-même et son père tombèrent aux genoux du dictateur. Il se fit un grand silence, et Papirius dit : C’est bien ! La discipline militaire, la majesté de l’imperium, ont triomphé. Quintus Fabius n’est point absous d’avoir combattu contre l’ordre de l’imperator, mais, condamné pour ce crime, je le donne au peuple romain, je le donne à la puissance tribunitienne, qui a exercé en sa faveur une intervention officieuse, mais non de droit. Ainsi furent sauvés à la fois et la vie d’un noble jeune homme et le principe de la discipline. Papirius, en descendant de la tribune, fut entouré par les sénateurs et par le peuple transportés de joie. La foule accompagna chez eux le dictateur et Fabius. Admirable scène, l’une des plus émouvantes qu’ait vues le Forum romain, et l’une de celles qu’on aime le mieux à évoquer ; car cette fois tout le monde a fait son devoir. Les droits de l’autorité ont été maintenus, et les droits de l’humanité n’ont pas été réclamés en vain. Bientôt après, le Forum fut témoin d’une autre scène plus triste. Une multitude silencieuse et indignée le remplissait. Les boutiques dont il était entouré s’étalent fermées d’elles-mêmes. On venait d’apprendre que l’armée romaine avait passé sous le joug dans la vallée de Caudium. On maudissait cette armée déshonorée, on se promettait de ne pas ouvrir à ceux qui la composaient la porte d’une seule maison ; mais, quand on vit les soldats qui ressemblaient à des captifs, la tête basse, se glisser le soir, dans la ville, pour aller se cacher chacun en sa demeure, et quand, les jours suivants, on n’en aperçut pas un seul dans le Forum, où ils n’osaient se montrer, on eut pitié de ces malheureux. Les consuls qui les avaient ramenés se cachaient aussi. On en créa de nouveaux, et ce jour-là même, le sénat se rassembla dans la curie pour délibérer sur la paix de Caudium. Ce fut une morne et belle séance. Sp. Posthumius, qui, pour sauver l’armée, s’était, résigné à une si grande honte, de l’air qu’il avait sous le joug, parla le premier. Il déclara que le peuplé romain n’était pas engagé, qu’on ne devait aux Samnites rien autre chose que la personne des auteurs du traité. Que les fétiaux ; dit-il, nous livrent nus et enchaînés. Un tribun du peuple intervint et dit qu’on ne pouvait livrer les tribuns, dont la personne était sacrée. Livrez-nous donc, reprit Posthumius, nous dont la personne n’est pas sainte, et celle de ceux-ci quand leur sainteté cessera, le jour où ils sortiront de leurs charges ; mais, si vous m’en croyez, avant de les livrer, faites-les battre de verges, là tout prés, dans le comitium[29], pour qu’ils payent l’intérêt de ce délai de leur peine. Et casuiste héroïque, Posthumius établit que ni lui, ni personne n’avait pu engager le peuple romain ; qu’ils avaient outrepassé leur pouvoir et devaient en être punis. Pourquoi les Samnites n’ont-ils pas envoyé vers les autorités légitimes, le sénat et le peuple ? Mais ils ne l’ont point fait. Ils n’ont rien à réclamer de vous : c’est nous qui nous sommes donnés pour garants de la convention, nous n’avions pas le droit de le faire ; c’est à nous que les Samnites doivent s’en prendre, à nos corps, à nos vies. Portons-leur nos têtes viles pour acquitter notre engagement, et rendons, par notre supplice, au peuple romain la liberté de combattre. Le sénat fut ému de ce généreux abandon et de ce noble mépris de soi-même. Les tribuns suivirent. l’exemple des consuls. Tous abdiquèrent sur-le-champ et furent livrés aux fétiaux pour être conduits à Caudium. Le peuple admirait Posthumius et allait en masse au champ de Mars se faire inscrire sur les rôles militaires, tandis que l’armée vaincue était reconduite à Caudium pour être livrée. Arrivés à la porte Capène, les fétiaux dépouillèrent les soldats de leurs vêtements et leur attachèrent les mains derrière le dos, et, comme le licteur chargé de ce triste office en présence de la majesté consulaire, hésitait à l’accomplir : Licteur, apporte la courroie ! Ce fut le dernier ordre de Posthumius. Arrivés près du chef samnite, Posthumius, soutenant jusqu’au bout la fiction légale qu’il avait mise en avant dans la curie, frappa fortement du genou le fétial qui faisait la dédition de l’armée, et s’écria : Je suis devenu Samnite, et j’ai insulté, contre le droit des gens, un fétial romain, la guerre sera juste. Il y avait de la grandeur dans ces faux-fuyants de mauvaise foi, mais courageux, par lesquels le dévouement de Posthumius voulait dégager, au prix de sa tête, la responsabilité du peuple romain. Mais le Samnite ne s’y laissa pas prendre : Je n’accepte point cette dédition, dit-il, c’est se moquer des dieux. Qu’on délie ces Romains ; qu’ils s’en aillent dès qu’il leur plaira. Il voulait laisser à Rome la honte des engagements violés, et ne consentit point à cette satisfaction dérisoire donnée aux dieux protecteurs des traités. Posthumius et l’armée retournèrent à Rome. Cette défaite, qui avait fait éclater le patriotisme de ceux mêmes qu’elle avait humiliés, n’arrêta point les Romains dans la conquête du Samnium. Marchant toujours devant elle, Rome avait rencontré un jour sur son chemin les Fourches Caudines[30] ; elle ploya la tête en frémissant, mais la releva aussitôt et passa. Ce qui est admirable à cette époque, c’est de voir les Romains occupés de cette formidable lutte contre les Samnites et leurs alliés de la montagne, combattre en même temps les Gaulois, les Ombriens et les Étrusques. La guerre est double, les armées romaines se portent incessamment de l’est à l’ouest, du nord au sud. Ces deux conquêtes leur étaient nécessaires ; il fallait qu’ils eussent, pour ainsi dire, leurs coudées franches des deux côtés avant d’aller au delà. Les Étrusques étaient des ennemis redoutables : cette nation qui, après son asservissement, s’amollit et se corrompit, était alors très belliqueuse. Dés les premiers temps de leur histoire, les Romains et les Étrusques, séparés seulement par le Tibre, sont aux prises ; mais il s’agit alors de la partie de l’Étrurie la plus voisine de Rome, de celle qui est en deçà du mont Ciminus. Le mont Ciminus, dont on voit de Rome le long dos bleuâtre, borne de ce côté le grand bassin de la campagne romaine. Ce rempart de l’Étrurie était couvert d’une forêt aussi
impénétrable, dit Tite-Live[31], que le furent
depuis les bois de, D’autres batailles et d’autres victoires suivirent, et, en quelques années, l’Étrurie fut soumise. Mais Étrusques, Samnites, Ombriens, Gaulois, firent un
dernier effort. Les deux ailes de l’armée de ces peuples qui menaçaient Rome
de deux côtés se réunirent. Rome triompha de tout ; elle confina, d’une part,
à Pendant ces mémorables guerres contre tous leurs ennemis d’Italie, les Romains construirent leur premier aqueduc, pavèrent leur première voie, élevèrent plusieurs monuments. L’aqueduc et la voie furent l’œuvre d’un Claudius, Appius Claudius l’aveugle, le plus illustre de cette forte race sabine et patricienne dont nul ne représenta mieux le caractère. Ces deux grands travaux, l’aqueduc et la voie, furent accomplis pendant la censure d’Appius qu’ils ont immortalisé. Les aqueducs (conduits d’eau) n’ont pas été tout d’abord ces longues suites d’arcades apportant l’eau, comme a dit Chateaubriand, sur des arcs de triomphe, et dont les restes, épars dans la campagne romaine, sont la magnificence de ce désert. Le premier, celui d’Appius[32], commençait à deux lieues environ de Rome sur la voie Prénestine. II n’était pas à ciel ouvert, mais souterrain, à l’exception d’un intervalle de soixante pas. On ne songeait encore qu’à l’utile. Plus tard, la beauté architecturale fut unie à l’utilité. De plus, quand l’ennemi venait encore de temps en temps tout près de Rome, mettre les aqueducs sous terre, c’était les empêcher d’être coupés. La voie Appia commençait à la porte Capène ; un chemin
existait là bien avant Appius ; mais il remplaça ce chemin par une route
pavée ; il lui fit traverser les marais Pontins, ce qui dut nécessiter
d’assez grands travaux pour lesquels l’art étrusque ne fut probablement pas
inutile, travaux repris à toutes les époques, entre autres par César et par
Napoléon. La voie fut prolongée jusqu’à Capoue. La construction de cette
route avait le même but que la guerre samnite, à laquelle Appius prit part
aussi, atteindre Cette route, continuée jusqu’à Brindes, devint la reine des routes romaines[33]. Elle fut bordée de tombeaux magnifiques, comme on peut le voir par ceux que l’on a dégagés, il y a quelques années, sur une étendue de cinq lieues à partir de Rome, ce qui, avec le majestueux encadrement de l’horizon romain, forme une perspective incomparable. Rien n’est plus imposant que cette avenue de sépulcres traversant la solitude pour aboutir à la ville éternelle[34]. Pendant la guerre étrusque, Appius Claudius voua un temple à Bellone[35]. Bellone correspondait à la Nerio[36], sabine, épouse de Mars. Par conséquent, un tel vœu convenait à un Claudius. Ce temple fut, pour les Claudius, comme un sanctuaire de famille où ils plaçaient fièrement les portraits de leurs ancêtres. C’était dans le temple de Bellone que le sénat recevait les ambassadeurs étrangers. Le choix de ce temple leur rappelait que Rome était toujours prête à la guerre. Une autre déesse, celle-ci souterraine et funèbre qu’on invoquait avec les Mânes, dieux sabins, et, par conséquent, sabine elle-même, Tellus (la terre), obtint un temple qui lui fut voué, à l’occasion d’un tremblement de terre dans le Picentin, par Sempronius Sophus, après les guerres Samnites[37]. Plusieurs temples furent élevés pendant ces guerres. où les Romains eurent à combattre les Samnites, les Ombriens, les Gaulois et les Étrusques. Le danger était grand, et l’esprit du peuple encore très religieux. Les vœux faits sur le champ de bataille durent se multiplier, et, avec eux, les monuments sacrés qui en étaient le résultat. Junius Bubulcus s’était trouvé dans un pas difficile, et il avait fait vœu d’élever, s’il s’en tirait, un temple au Salut[38], à la déesse Salus, sabine comme la gens Junia[39]. Attilius Regulus, voyant fuir les troupes qu’il commandait, fit comme Romulus, et promit à Jupiter, s’il arrêtait les fuyards, un temple dédié à Jupiter Stator, Jupiter qui arrête[40]. Ces dédicaces ne manquaient point d’à-propos ; quelquefois elles eurent de la grandeur. Après que le second Decius se fut immolé volontairement, son collègue Fabius, certain de la victoire, que ne pouvait manquer d’obtenir ce dévouement, avant qu’elle fût décidée, dédia un temple à Jupiter vainqueur[41]. Le consul L. Posthumius fit encore mieux. Ce fut le lendemain d’une défaite qu’avec la confiance d’un vrai Romain il dédia un temple à la Victoire[42]. Papirius Cursor, Sabin de nom et d’humeur, — sa dureté était célèbre, — avait voué un temple au dieu national des Sabins, Quirinus ; il n’eut que le temps de jouir de son triomphe, le premier où furent étalées une grande richesse et une grande magnificence[43]. Le temple fut dédié par le fils de Papirius, qui plaça auprès un cadran solaire, objet nouveau encore pour les Romains. Janus Quirinus, dans l’origine, était, nous l’avons vu, une personnification du soleil[44]. Le collègue de Papirius Cursor, Maximus Carvilius, termina la guerre d’Étrurie et choisit singulièrement la divinité à laquelle il consacra un temple : ce fut le Hasard Fortuné[45] (Fors Fortuna). Il avait été dans le Samnium tantôt vainqueur, tantôt vaincu : voulait-il faire une allusion à l’inconstance de la fortune ? Les Herniques étaient ordinairement les alliés de Rome ; mais le mouvement sabellique les avait entraînés. Ils s’étaient rassemblés dans le grand cirque d’Agnani et y avaient résolu de se soulever avec leurs frères de la montagne contre les Romains. Leur vainqueur, Marcius Tremulus, eut les honneurs d’une statue placée dans le Forum, devant le temple de Castor[46], qui rappelait lui-même la grande victoire du lac Régille. C’était une statue équestre et portant la toge. La campagne chez les Herniques, rapidement soumis, ne semble pas avoir mérité la distinction, rare alors, d’une statue équestre ; mais Marcius était un consul plébéien, et la plupart de ceux qui se signalèrent dans les guerres samnites étaient patriciens ; l’ordre auquel il appartenait parvint sans doute à faire honorer d’une manière extraordinaire un consul qui l’honorait. Les patriciens, qui ne se prêtaient pas de bonne grâce au partage du consulat, travaillaient sourdement à revenir sur la loi Licinia ; les plébéiens étaient bien aises, au contraire, de la glorifier dans la personne d’un général qui devait à cette loi d’avoir pu triompher,et qui, d’ailleurs, avait attaché son nom à une mesure populaire[47]. C’est pourquoi, sans doute, malgré la mesure générale qui fut prise au sixième siècle pour faire disparaître du Forum les statues qui l’encombraient, celle-ci y était encore au temps de Cicéron[48]. D’autres statues furent érigées pendant les guerres Samnites : Deux statues au Capitale, l’une d’Hercule[49], l’autre de Jupiter, toutes deux colossales comme ces guerres elles-mêmes. Celle-ci fut placée au Capitole par Carvilius[50] ; elle était faite avec les. armures d’un corps de Samnites astreints à un serment particulier, ce qui en faisait comme un ordre de chevalerie[51]. Cette statue était si grande, qu’on la pouvait voir du mont Albain. Avec les rognures de la lime, Carvilius fit faire sa propre statue, que Pline vit encore, aux pieds du dieu. Le colossal étonne à cette époque de l’histoire romaine ; il sera le cachet de l’empire, et nous sommes heureusement encore bien loin de l’empire. On est étonné aussi de voir dans ce temps guerrier deux temples élevés à Vénus par un Fabius ; mais ce Fabius démentait l’austérité de sa race sabine, car sa gloutonnerie l’avait fait surnommer Gurgès. D’ailleurs, l’un de ces temples était un hommage à la chasteté. Fabius l’avait fait construire pendant son édilité avec les amendes levées sur des matrones dissolues[52]. Cela indique les premiers germes de la corruption qui se produira plus tard, comme l’apparition des empoisonneuses au sixième siècle annonce de loin les Locustes. Le second fut dédié à Vénus favorable (Venus obsequens), à la suite d’une expédition heureuse contre les Samnites[53] dans laquelle Fabius croyait que Vénus l’avait protégé. Avant cette expédition, il en avait fait une autre qui n’avait pas réussi. On voulait le forcer à abdiquer le consulat ; mais son père, qui avait été cinq fois consul, demanda qu’on épargnât son fils en offrant de servir sous lui comme lieutenant. Grâce à cette offre touchante qui fut acceptée, Fabius Gurgès répara sa disgrâce et obtint les honneurs triomphaux. On fut ému en voyant ce père gravir la montée du Capitole dans le char de ce fils qui lui devait son triomphe[54]. Un autre temple de Vénus fut fondé par un motif de pureté, mais cette fondation même montre que la pureté commençait à sortir des mœurs romaines. A la suite de grands désordres qui avaient atteint jusqu’aux Vestales, et la foudre ayant traversé d’une manière étrange le corps d’une jeune fille[55], on résolut d’élever un temple à Vénus Verticordia, afin qu’elle tournât vers l’amour conjugal le cœur des matrones romaines. Sulpicia[56] fut désignée par leur jugement, comme la plus chaste d’entre elles pour dédier l’autel de la déesse. Les matrones romaines montrèrent dans une circonstance assez singulière qu’elles aussi savaient, au prix de quelques sacrifices, maintenir leurs droits[57] ; elles avaient obtenu, après la prise de Véies[58], celui d’aller en voiture par la ville. C’était une grande faveur ; l’usage des voitures particulières ne s’accordait que difficilement, et fut souvent interdit dans l’ancienne Rome, à cause sans doute du peu de largeur des rues. Le sénat ayant retiré aux dames romaines ce privilège, elles se concertèrent et résolurent, jusqu’à ce qu’il leur fût rendu, de s’interdire tout rapport avec leurs maris ; les sénateurs qui étaient époux, durent céder, dans l’intérêt de la population, à ce genre d’opposition qui la menaçait, et de nombreuses naissances ayant suivi la réconciliation, les mères dédièrent près de la porte Carmentale un sanctuaire à Carmenta, dont on avait fait la déesse des accouchements. Ile_Tiberine.jpg Pendant les guerres samnites, Rome fut de nouveau frappée par une de ces maladies auxquelles elle était souvent en proie, celle-ci dura trois années. On eut recours aux livres sibyllins. En cas pareil ils avaient prescrit de consacrer un temple à Apollon ; cette fois, ils prescrivirent d’aller à Épidaure chercher le fils d’Apollon, Esculape, et de l’amener à Rome[59]. Esculape, sous la forme d’un serpent, fut transporté d’Épidaure dans l’île Tibérine, où on lui éleva un temple, et où ont été trouvés des ex-voto, représentant des bras, des jambes, diverses autres parties du corps humain, ex-voto qu’on eût pu croire provenir d’une église de Rome, car le catholicisme romain a adopté cet usage païen sans y rien changer. Pourquoi plaça-t-on le temple d’Esculape en cet endroit ? On a vu que l’île Tibérine avait été très anciennement consacrée au culte d’un dieu des Latins primitifs, Faunus[60] ; or ce dieu rendait ses oracles près des sources thermales ; ils devaient avoir souvent pour objet la guérison des malades qui venaient demander la santé à ces sources. De plus, les malades consultaient Esculape dans des songes[61] par incubation, comme dans Ovide, Numa va consulter Faunus sur l’Aventin[62]. Il n’est donc pas surprenant qu’on ait institué le culte du dieu grec de la santé, là où le dieu latin Faunus rendait ses oracles dans des songes, et où étaient probablement des sources d’eau chaude qui ont disparu comme les lautulæ près du Forum romain. On donna à l’île la forme d’un vaisseau, plus tard un obélisque figura le mât[63] ; en la regardant du ponte Rotto, on reconnaît encore très bien cette forme ; de ce côté, on voit sculpté sur le mur qui figure le vaisseau d’Esculape, une image du dieu avec un serpent entortillé autour de son sceptre. La belle statue d’Esculape, venue des jardins Farnèse, passe pour avoir été celle de l’île Tibérine. Un temple de Jupiter touchait à ce temple d’Esculape[64]. Un jour que je visitais ce lieu, le sacristain de l’église de Saint-Barthélemy me dit : Al tempo d’Esculapio quando Giove regnava, au temps d’Esculape, sous le règne de Jupiter. Phrase singulière et qui montre encore vivante, une sorte de foi au paganisme chez les Romains. L’histoire politique de Rome au cinquième siècle peut se résumer en ces termes : Consommation et affermissement de la conquête de l’égalité. Dans ce siècle le Forum est beaucoup moins tumultueux c’est que les patriciens sont moins superbes, et les plébéiens plus puissants. Le représentant héréditaire de l’esprit patricien est un Claudius, mais ce Claudius qui se montra en plusieurs circonstances l’ennemi des ambitions plébéiennes, fut obligé de s’appuyer sur la partie la plus infime de l’ordre plébéien pour l’opposer à la partie la plus respectable de cet ordre ; il offrit le sénat aux fils d’affranchis, les tribus à ceux que la bassesse de leur condition en avait exclus jusqu’à ce jour[65], et, selon l’expression de Tite-Live, corrompit le champ de Mars et le Forum. Il ne voulait pas que les plébéiens illustres fussent consuls ; mais il voulait bien que les plus humbles d’entre eux fussent électeurs et sénateurs, surtout électeurs. Il espérait avoir bon marché des comices plébéiens quand ils seraient dans les mains de ce que Tite-Live appelle Forensis turba, la tourbe du Forum. Les tyrans démagogues sont vulgaires dans l’histoire ; les aristocrates démagogues sont plus rares ; Appius Claudius fut un de ces aristocrates. Ainsi la cause de l’égalité absolue était servie même par les adversaires de l’égalité dans ce siècle destiné à la voir triompher. Ce triomphe eut ses monuments. Appius Claudius avait préparé à l’ordre patricien un cruel et, il faut le reconnaître, heureux échec. Cette tourbe, à laquelle il avait ouvert les comices, porta à l’édilité curule un fils d’affranchi, nommé Flavius, scribe obscur, mais habile et éloquent. Ce fut un grand scandale parmi les patriciens. Flavius jura de se venger de leur mépris ; il tint parole. Un jour, on vit tout autour du Forum, écrits sur des planches blanchies, les mystères du droit civil, dont jusqu’alors les patriciens s’étaient réservé la connaissance[66]. Jusque-là il dépendait d’eux de déclarer que tel jour était faste ou néfaste ; que l’emploi de telle formule, qu’eux seuls connaissaient, était nécessaire, et d’entraver ainsi, quand ils le jugeaient à propos, la marche des procès et des débats politiques. Mais un scribe divulguait ce qu’ils avaient voulu cacher : le voile de la justice était déchiré. L’omnipotence patricienne avait reçu le dernier coup. Pour constater sa victoire, Flavius, en sa qualité
d’édile, éleva un temple à Un autre temple fut une noble protestation de la fierté plébéienne. Près du temple rond d’Hercule[68], dans le marché aux
bœufs, était une chapelle consacrée à C’était dire : Et nous aussi nous sommes chastes ; c’était élever un monument aux deux principales lois liciniennes, celle qui autorisait lé mariage entre les ordres, et. celle qui permettait qu’un plébéien fût consul. Les patriciens, désarmés successivement de tous leurs privilèges, cherchaient à les ressaisir indirectement. Depuis la loi Valéria, ce que les comices plébéiens avaient décidé était obligatoire pour tous[70] ; mais les curies prétendaient avoir le droit d’autoriser les résolutions ces comices, plébéiens. A la suite d’une dernière sécession sur le mont Janicule, la loi Hortensia établit la souveraine autorité des plébiscites en confirmant la loi Publilia[71], qui avait réduit le droit des curies à une vaine formalité, une approbation préalable, donnée aux plébiscites avant qu’ils fussent votés. La loi Hortensia fut portée dans l’Esculetum[72], un bois de chênes qui était probablement sur le Janicule. Le Comitium était vaincu. Les curies ne s’y assemblèrent plus que pour entendre proclamer les décisions du Forum, pour déclarer les auspices[73], pour investir de l’imperium ceux à qui elles ne pouvaient le refuser. Cependant, à Rome, le respect de la coutume était si grand, que jusqu’au temps des Gracques les orateurs qui occupaient la tribune du Forum et parlaient aux plébéiens, se tournaient toujours vers le Comitium, par respect pour les curies patriciennes, bien qu’elles n’eussent réellement plus d’autorité. Après la grande guerre de conquête qui a soumis aux
Romains le Latium, l’Étrurie, les peuples sabelliques, parmi lesquels le
peuple samnite était surtout difficile à vaincre, l’est et l’ouest, le nord
et le
Pyrrhus fut appelé en Italie par les Grecs de Tarente pour
faire la guerre à leur profit contre les. Romains ; il y vint avec la pensée
de soumettre Rome, l’Italie, La brouille des Tarentins et des Romains est curieuse, parce qu’elle montre la légèreté grecque se heurtant étourdiment à l’énergie romaine. Les Tarentins avaient imaginé de se poser en arbitres entre les Romains et les Samnites. Ils avaient interdit aux premiers de passer un certain promontoire. Les Romains, l’ayant passé, les Tarentins attaquèrent la flotte romaine, coulèrent un des vaisseaux et en capturèrent plusieurs. Puis des envoyés de Rome étant venus se plaindre à Tarente, ils firent reçus dans le théâtre où se tenaient les assemblées politiques, qui, à Rome, se tenaient dans les temples. On se moqua de ces hommes qui n’étaient pas vêtus à la grecque et parlaient mal le grec ; un plaisant s’avisa de souiller de la façon la plus grossière[75] la toge de l’un d’eux, Postumius. Tout le monde se mit à rire. Le Romain se contenta de dire gravement : Riez, riez, il faudra beaucoup de votre sang pour nettoyer mon habit. Le caractère des deux peuples est là tout entier. Ces deux peuples, les premiers du monde, se méprisaient réciproquement. Leur tempérament différait trop pour qu’ils pussent se comprendre et s’apprécier. La même différence, la même antipathie, existent aujourd’hui entre les Romains et les Napolitains. Le voyageur est bien vivement frappé de cette différente
quand il passe du calme sévère de Rome au tumulte étourdissant de Naples. Là,
le silence et la solitude ; ici, le bruit et le mouvement. Rome est sérieuse
et grave ; Naples est pétulante et folle ; et Naples, c’est Les Napolitains, par leur vivacité, leur mollesse, leur légèreté, rappellent les Athéniens ; les Romains actuels, surtout les gens du Transtevere et ceux de là campagne, ont la rudesse et la férocité sauvage de leurs aïeux. Ce peuple a conservé le sentiment, souvent trop stérile, il est vrai, de son ancienne primauté, et l’on a entendu deux petits bourgeois se dire, en fermant le soir leurs boutiques voisines : Après tout, nous sommes Romains, la première nation du monde. La vieille antipathie dure encore. Quand on va de Naples à Rome par la malle-poste, on change de courrier en passant la frontière. Je me rappelle être venu à Terracine avec un courrier napolitain, jeune homme enjoué, railleur, et qui traçait un portrait peu flatté des Romains. A Terracine, je trouvai le courrier des États pontificaux : c’était un personnage à profil de médaille, à tête consulaire, et qui n’épargnait pas les Napolitains. Ces deux hommes me rappelaient les sentiments réciproques des Grecs de l’Italie et des Romains d’autrefois, qui n’eussent pas parlé différemment les uns des autres. Le Napolitain aurait, je crois, volontiers conspué un envoyé de Rome et poussé de même les grossièretés de l’insulte à des excès qu’on ne peut raconter. Les jeunes lazzaroni qui commencèrent la révolte de Mazaniello n’adressaient pas aux préposés espagnols des insultes plus décentes. Mon vieux courrier romain, bafoué par une foule en gaieté et en délire, eût dit aussi : Il faudra beaucoup de votre sang pour nettoyer mon habit. Et le sang eût coulé si jamais un Tarentin se frît trouvé à la portée de son couteau. Pyrrhus commença par battre les Romains ; mais leur défaite lui apprit à les respecter, et son succès le fit réfléchir. « Encore une victoire comme celle-ci, dit-il, et il me faudra retourner en Épire. » La science militaire de ses ennemis le remplit d’admiration et de surprise. Un Grec n’attendait pas cela des Barbares. Il envoya le Thessalien Cinéas à Rome traiter de la paix. Celui-ci vint dans la curie, et fut étonné aussi de ce qu’il vit ; il crut avoir devant les yeux un sénat de rois. En effet, les assemblées, alors orageuses ou muettes, de J’étais fâché de ne pas voir, dit-il ; aujourd’hui, il me fâche d’entendre. Après son discours, que nous n’avons plus, et que Niebuhr a essayé de refaire, le sénat déclara à Pyrrhus que le peuple romain ne traiterait pas avec lui tant qu’il serait en Italie. Cinéas dit aussi à Pyrrhus que Rome lui avait paru un temple[76]. Ceci semble indiquer l’aspect déjà monumental qu’offrait la ville, tandis que le luxe demeurait étranger aux maisons privées. — Une accusation avait été intentée à Camille, parce que la sienne avait des portes de bronze. — Les toits étaient couverts en bois[77]. Mais les édifices sacrés commençaient à se multiplier, car on en avait voué un presque à chaque victoire. Le Forum se peuplait de colonnes, de statues, de trophées. Rome put apparaître à Cinéas solennelle comme un temple. La richesse, que méprisaient encore Fabricius et Curius, allait venir trop tôt pour la vraie grandeur de Rome ; ce fut pendant la guerre contre Pyrrhus qu’on adjoignit une officine monétaire au temple de Junon Moneta[78], et ce fut vers ce temps qu’on frappa la première monnaie d’argent. On ne voit pas que de nouveaux monuments religieux se rapportent aux deux apparitions de Pyrrhus en Italie ; seulement les augures firent rétablir le temple[79] du dieu des foudres nocturnes, le dieu étrusco-sabin Summanus, en expiation sans doute de ce que la tête de la statue de Summanus, placée sur le temple de Jupiter Capitolin, avait été détachée par la foudre, et, après qu’on l’eut cherchée en vain, retrouvée dans le Tibre[80]. Je ne compare pas, mais j’ai vu le long des murs de Rome, entre la porte Cavallegieri et la porte Saint-Pancrace, une petite chapelle élevée au lieu où l’on a retrouvé la tête de Saint-André, apportée solennellement de Constantinople à Rome au quinzième siècle, et qui s’était perdue. Pyrrhus, dès qu’il eut appris la réponse du sénat, marcha contre Rome. Rome ne s’émut point[81], et Pyrrhus dut se contenter de la regarder à l’horizon, des hauteurs de Préneste. Menacé d’être attaqué par plusieurs corps d’armée à la fois, il se retira. Tite-Live s’est demandé ce qui serait advenu si Alexandre fût venu attaquer les Romains. Tite-Live ne doute point qu’Alexandre n’eût été vaincu. Je ne sais, mais ce que je sais bien, c’est qu’en vue de Rome Alexandre n’eût pas tourné le dos. Pyrrhus, qui n’avait fait que vaincre, mais qui voyait bien que ses victoires ne le mèneraient pas à Rome, quitte l’Italie au premier prétexte, et passe en Sicile, où il fonde un royaume qu’il perd bientôt. Il repasse alors en Italie, et cette fois se fait battre par Curius, plébéien, bien que de race sabine[82], qui, poursuivant l’ouvre d’un autre Sabin d’origine, éleva dans Rome le second aqueduc[83] avec les dépouilles de Pyrrhus. Pyrrhus retourna la même année en Grèce, poursuivi par le courroux de Proserpine, dont il avait pillé le temple, et alla mourir dans une rue d’Argos, sous une tuile qu’une vieille femme fit tomber sur sa tête pour défendre son fils. Rome eut le spectacle d’un triomphe plus brillant que tous ceux dont le Capitole avait été jusque-là témoin. On y voyait figurer la pourpre, les tableaux et les statues grecques de Tarente[84]. C’était la première fois que les arts de Des têtes d’éléphants, sculptées sur la cuirasse d’un torse antique, ont fait donner à une statue du musée Capitolin le nom de Pyrrhus[86]. Les éléphants prouvent que ce n’est point un Mars, comme on l’a pensé, que feraient des éléphants sur la cuirasse de Mars ? La trompe d’éléphant était, au contraire, comme un signe héraldique héréditaire dans la famille de Pyrrhus[87] ; mais, comme la tête de la statue du Capitole est rapportée, nous ne pouvons être sûr d’avoir là le portrait de Pyrrhus, et il se peut que. nous n’ayons que le portrait de sa cuirasse. Pyrrhus a été l’avant-coureur et comme l’éclaireur d’Annibal ; Annibal va venir. |
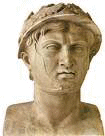 Pyrrhus était petit cousin d’Alexandre
Pyrrhus était petit cousin d’Alexandre