L’HISTOIRE ROMAINE À ROME
PREMIÈRE PARTIE —
II — ÉTAT PRIMITIF DU SOL ROMAIN.
|
Me transportant en esprit à l’époque où le lieu qui depuis a été Rome et l’est encore n’était pas habité, j’aperçois d’abord un fleuve qui, plus tard, s’appellera le Tibre, mais dont le nom primitif, le vrai nom, selon Virgile, fut Albula, ce qui peut dire blanchâtre. .... Amisit verum velus Albula nomen. (Virgile, Æn., VIII, 332.)
Sulfurea Nar albus aqua[4]. (Virgile, Æn., VII, 517.) Le Nar dont l’eau sulfureuse est blanche. Les eaux des petits lacs sulfureux près de Tivoli s’appelaient, comme les autres de même espèce, Albulæ. On doit donc penser que le Tibre a changé de couleur depuis les temps primitifs, qu’il était blanchâtre quand il s’appelait Albula, et voir, dans ce nom qu’il a porté, comme un reflet de la teinte ancienne de ses eaux. Comment rendre raison de ce changement ? Je pense que le Tibre fut dit d’abord blanchâtre (Albula) parce que lui et surtout l’Anio, qui se jette dans son sein, recevaient plus de sources sulfureuses que maintenant, car le nombre en devait être plus considérable à une époque moins éloignée de l’âge des volcans. Les anciens parlent des eaux sulfureuses de l’Anio[5]. Il faut donc se figurer le Tibre roulant vers la mer des eaux blanchâtres : c’est tracer un premier trait de ce tableau de l’état primordial des lieux dont j’écris l’histoire. A cela prés, le Tibre était tel que nous le voyons ; sa courbe suit encore le contour de l’espace où fut le Champ de Mars et où est la partie la plus habitée de la ville actuelle[6]. Le Tibre était dès lors, comme il est aujourd’hui, rapide
et tourbillonnant[7]
; il ronge toujours ses bords, ce qui lui avait fait donner anciennement le
nom de Dévorant[8].
Les livres des augures l’appelaient pour cette raison Les poètes l’ont flatté, il n’a jamais été le Tibre azuré, fleuve entre tous agréable au ciel de Virgile : Cæruleus Thybris cœlo gratissimus amnis. (Virgile, Æn., VIII, 61.) car le ciel n’a jamais pu réfléchir avec complaisance son image dans les eaux troubles et sales du fleuve limoneux. Non, le caractère du Tibre est autre ; son air n’est pas
gracieux, mais sévère, et cet air convenait à sa destinée. Quelle sombre
physionomie devait avoir le Tibre lorsqu’il se précipitait sous de vieilles
forêts, à Ira vers des solitudes ! Les forêts ont été abattues, mais les
solitudes sont restées, ou plutôt elles sont revenues, et l’on a de nos
jours, le spectacle de ce qu’était le Tibre avant Rome, quand, sortant par Seulement le lit du Tibre était alors plus profond. Le lit de tous les fleuves, surtout de ceux qui charrient beaucoup, s’exhausse avec le temps. On l’a constaté pour le Nil ; il en a été de même pour le Tibre. Suivant Pline, qui devait se connaître en navigation puisqu’il était amiral, le Tibre pouvait porter les grands vaisseaux de la Méditerranée[10]. Sa profondeur devait être encore plus grande à l’époque où nulle voile ne se montrait entre ses rives désertes. Le lit du Tibre était aussi plus large quand aucun travail d’art n’emprisonnait le fleuve indompté. Le Tibre baignait le pied du Palatin ; il inondait l’emplacement futur de la rue Étrusque, où devait titre un jour le quartier élégant et corrompu de Rome. On disait, que le dieu Vertumne[11] avait détourné le cours du fleuve. Le Tibre, en dépit de Vertumne, débordait fréquemment, et quelquefois, dans ses crues soudaines, retrouvait la largeur de son ancien lit. Horace nous montre le Tibre refoulé par un coup de libeccio (sud-ouest) de la rive droite[12], et venant ébranler, renverser même, ce qui me semble une exagération du poète, le temple de Vesta et la maison de Numa, à l’angle septentrional du Palatin, non loin de l’endroit où s’élève l’église de Sainte-Marie Libératrice. Plus tard encore, le Tibre, dans une forte crue, atteignit, dit Tacite, des lieux élevés où fort se croyait a l’abri des inondations[13]. Un jour même, le Tibre était entré par une porte de la ville, la porte Flumentana[14], située au bord du fleuve, vers l’endroit où une rue moderne rappelle des inondations analogues par son nom presque semblable de Fiumara. Les annales de Aujourd’hui encore, le Tibre déborde souvent ; il n’est pas très rare de voir des barques dans les rues de Rome et la place du Panthéon transformée en un petit lac au sein duquel se dresse, bizarre spectacle ! le majestueux portique. Imaginez ce que devaient être ces inondations et ces débordements quand rien d’humain ne leur faisait obstacle et quand des forêts, aujourd’hui détruites, augmentaient, comme toujours, l’abondance des eaux. Le long de la vallée du libre devaient se trouver des espèces de savanes[15] ; aussi les prairies qui bordaient les deux côtés du fleuve, et dont l’une fut plus tard le Champ de Mars, étaient-elles des prairies marécageuses où croissaient des presles[16]. Des prairies et des marécages au pied de quelques collines couvertes d’arbres, voilà ce que Rome a remplacé. Dans cet espace fréquemment submergé, s’étendait, entre la place Navone et Sant-Andrea della Valle, un enfoncement dont le nom de cette église garde le souvenir. La place a succédé à un cirque où avaient lieu des courses de char dans l’eau, imitées jusqu’à nos jours par les promenades en voitures du mois d’août autour de la place artificiellement inondée. Au sein de l’enfoncement dont je viens de parler, quelques redressements de terrains formaient durant les inondations comme des îlots ; entre cet enfoncement et le Capitole, la prairie reparaissait : c’est ce qu’on appela les prés Flaminiens. Mais quittons la plaine pour les collines, et commençons par la rive droite du Tibre. La chaîne de collines continues qui, à partir de Ponte Molle, longent cette rive et vont se rapprochant de son lit sinueux, laissent d’abord entre elles et lui un espace qui faisait partie du champ Vatican. Là croissaient anciennement des chéries verts. Pline[17] parle d’une yeuse plus vieille que Borne même, et que de son temps on voyait encore au Vatican. Cet arbre ne devait pas avoir été dans cet endroit seul de son espèce. Plus tard on y planta des vignes qui produisaient un vin détestable ; le vin du Vatican était le Suresnes de l’ancienne Rome. Bois le vin du Vatican, disait Martial, si tu aimes le vinaigre[18] : et ailleurs : Boire le vin du Vatican, c’est boire du poison[19]. A nous ce nom de Vatican dit autre chose, ce vieux nom est celui de la basilique de Saint-Pierre et du palais des papes. Vers la partie moyenne des collines qui longent la rive droite du Tibre, les Romains établirent leur forteresse du Janicule ; mais auparavant il n’y avait de ce côté qu’un rideau de collines boisées et arrosées par des sources. Pour retrouver l’aspect primitif de Rome, il faut mettre partout des sources et des arbres ; ces sources, aujourd’hui en grande partie perdues, permirent de placer une forteresse dans un lieu qui n’eût pas été tenable sans elles. On a retrouvé quelques-unes des sources du Janicule, par exemple, au quatrième siècle de l’ère chrétienne, l’eau de Saint-Damase, qui donne son nom à la cour embellie par les Loges de Raphaël. Passant sur la rive gauche du Tibre et nous avançant en sens inverse de son cours, nous rencontrons d’abord l’Aventin. L’Aventin, dont la forme est assez irrégulière, a deux cimes que sépare un ravin ; l’une, la plus haute, est indiquée par l’église de Sainte-Sabine ; l’autre, qu’on appelle le faux Aventin, par l’église de Sainte-Balbine. Virgile, qui fait autorité en matière de tradition, parle de l’épaisse forêt de l’Aventin, qui, au temps d’Évandre, descendait, jusqu’au fleuve, et d’un bois sacré au pied de la colline[20]. Ovide[21] mentionne également la forêt de l’Aventin. Cette colline était couverte de toutes sortes d’arbres. Denys d’Halicarnasse cite en particulier les lauriers[22] ; cet arbre prophétique croissait volontiers sur le sol romain. De là était venu à une partie de l’Aventin le nom de bois de Lauriers (Lauretum ou Loretum)[23] ; c’est ainsi que deux rues modernes à Rome doivent le leur aux haies vives qu’elles ont remplacées[24] ; il y avait sur l’Aventin le grand Loretum et le petit[25]. Un temple de Vertumne était dit in Loreto Majore, comme il existe de nos jours à Rome une église de San-Salvator in Lauro. Sur l’Aventin se trouvaient aussi de nombreuses sources[26]. Ce mont était remarquablement rocailleux. Il est parlé souvent des rochers de l’Aventin. Un rocher appelé le Rocher-Sacré dominait la moindre des deux cimes de la colline et formait, dit Ovide, une partie considérable de la montagne[27]. De ce sommet de l’Aventin, suivant la tradition, Remus consulta les présages qui lui furent contraires. Mont néfaste, l’Aventin de Remus, voisin et rival du Palatin de Romulus, fut exclu par les patriciens de l’enceinte sacrée de la cité, du Pomœrium romain où il n’entra que sous Claude, bien qu’il fût entouré d’un mur d’enceinte dès le temps des rois. La colline proscrite, et qui depuis Remus fut toujours la colline de l’opposition, servit, à plusieurs reprises, d’asile et de forteresse à la liberté plébéienne. Aujourd’hui l’Aventin semble encore maudit et proscrit ; à peine si quelques moines l’habitent ; ses églises éparses s’élèvent parmi des vignes solitaires et de grands espaces remplis de roseaux. L’Aventin était séparé du Palatin par une vallée étroite et profonde[28] dont les pentes abruptes se couvraient de myrtes[29]. Le fond de cette vallée marécageuse et souvent inondée fut comblé quand on y construisit le grand cirque qui la remplissait tout entière. En regard de la masse irrégulière et des anfractuosités de l’Aventin, le Palatin s’élève très nettement isolé ; sa forme est régulière, c’est un carré long ou plutôt un trapèze dont les quatre côtés correspondent, à peu de chose près, aux quatre points cardinaux. A l’origine, le Palatin abondait en sources[30] que les constructions impériales ont fait disparaître. Au pied du Palatin, vers le Forum, était le bassin de Juturne, où, après le combat du lac Régille, on crut voir Castor et Pollux, qui avaient secouru les Romains pendant L’action, faire boire leurs chevaux divins. Tout près de là est aujourd’hui un de ces grands abreuvoirs romains destinés aux troupeaux ; il est alimenté probablement par un reste de la même source. On voit déjà combien le sol de Rome était riche en sources naturelles. Ce fut pour remplacer ces sources détruites que les Romains imaginèrent le moyen dispendieux et magnifique des aqueducs. A Rome, on trouve presque partout l’eau à quelques pieds de profondeur. Au lieu de là cher de tirer parti de cette eau si voisine du sol, les Romains ont préféré aller à de grandes distances chercher des ondes choisies, les amener sur des arcades majestueuses et les distribuer avec profusion dans la ville ; c’est que ce peuple ne se contentait pas du nécessaire et à l’utile il voulait mêler le grand. Les sources du Palatin y entretenaient des pâturages[31], aussi ce mont fut d’abord un mont pastoral ; la tradition y plaça l’Arcadien Évandre au milieu de ses troupeaux. Comme l’Aventin, le Palatin était très boisé[32]. L’histoire du Palatin est l’histoire de home. Sur cette colline de peu détendue où il avait été précédé par les Sicules et les Pélasges, Romulus le pâtre, qu’on disait né du sang des dieux et des rois, fonda ou agrandit une bourgade qui l’ut le noyau de la cité romaine. A la fin de la république l’ancienne bourgade était devenue la demeure des citoyens opulents ; puis la colline fut graduellement envahie par les accroissements successifs de la demeure impériale. Le nom du mont Palatin était Palatium, comme Capitolium celui du mont Capitolin ; ce mot palatium devint le nom de la maison d’Auguste, plus tard de l’ensemble d’édifices qui composaient le halais et finirent par couvrir la colline tout entière. Ce nom, qui fut d’abord celui d’un lieu où quelques pâtres campèrent, est resté dans presque toutes les langues modernes pour désigner la demeure des rois et des princes : singulière fortune d’un mot ! Aujourd’hui l’intérieur du Palatin est tout pétri de ruines ; il ne reste à sa surface que des débris immenses et confus, en partie noyés dans une végétation vigoureuse, qui a repris le dessus quand les édifices qui l’avaient chassée lui ont fait place à leur tour ; des substructions gigantesques servent de magasins de foin, et sur l’emplacement du palais, d’où pâturages, forêts et fontaines ont disparu, sont des carrés de choux et d’artichauts. Sous l’escarpement du Palatin vers l’ouest, était un antre appelé Lupercal, fameux par l’allaitement de Romulus et de Remus. Cet antre était dominé par de grands arbres, les eaux qui descendaient du Palatin y entretenaient une constante fraîcheur[33]. Entre le Palatin et le Tibre, commençait, à partir du fleuve, le Vélabre, vaste marais, formé à son extrémité par les flaques d’eau stagnante que laissaient les débordements , alimenté par des sources nombreuses et par les eaux pluviales qui se précipitaient des collines. Ovide[34], comparant le passé au présent, dit : Là où des processions solennelles traversent le Vélabre pour se rendre au cirque, il n’y avait que des saules, des roseaux et un marais qu’on ne pouvait affronter que pieds nus. Properce dit qu’on avait autrefois navigué dans ce quartier magnifique Le nautonier faisait voile à travers les eaux dans la ville[35]. Spectacle pareil à celui que Rome donne encore aujourd’hui quand le Tibre est débordé. Nous savons ce qu’on payait pour passer le Vélabre ; c’était un quadrans, environ trois sous, trois fois plus cher que le prix actuel de la barque de Ripetta[36]. Ce lieu s’appela toujours le Vélabre, quoiqu’il n’y eût
plus de Vélabre, comme Le souvenir du Vélabre subsiste dans la dénomination de Saint-George-en-Vélabre, qui est celle d’une église à peu près abandonnée. Le Vélabre se continuait jusqu’au Forum[37], dont ses eaux marécageuses occupaient presque entièrement la place. L’épisode épique de la retraite de Mettus Curtius, pendant le combat des Romains et des Sabins au temps de Romulus, montre qu’elles baignaient le pied du Capitole : le nom de Velia, donné à la colline qui barrait le Forum à son autre extrémité, nom qui veut dire marais, fait voir que le marais s’étendait jusqu’à cette colline ; car une élévation de terrain n’a pu recevoir une telle dénomination que si le marécage y touchait. Tous ces témoignages se rapportent évidemment à un état antérieur au grand système d’égouts créé par les Tarquins pour dessécher le Forum et les lieux environnants. Après cet étonnant ouvrage, l’état primitif des lieux changea, mais il en resta très longtemps le souvenir et quelques traces[38]. Enfin le Vélabre allait au nord jusque vers le pied du Quirinal : C’était ce qu’on appelait le petit Vélabre[39]. Le grand Vélabre séparait le Palatin d’une autre colline, située entre le Palatin et le Tibre. Cette colline, de toutes la moins considérable, devait avoir la destinée la plus grande, car elle devait être le Capitole. Le Capitole, comme l’Aventin, a deux cimes, mais beaucoup plus rapprochées. Sur celle qui a conservé le nom de Roche Tarpéienne était la citadelle ; sur l’autre, le temple de Jupiter, qui a fait place à l’église d’Araceli. Deux bois de chênes, dont on conserva religieusement les restes, descendaient de ces deux cimes, alors plus hautes et plus aiguës[40] vers le fond, aujourd’hui comblé, de l’étroite vallée qui les divisait. Les flancs de. cette colline sauvage étaient hérissés de broussailles[41]. Des deux côtés d’une gorge par où devait passer un jour la voie triomphale, une forêt s’abaissait sur la pente méridionale du Capitole. Des sources filtraient à travers la colline et allaient tomber dans le Vélabre ; leur présence est attestée par des puits très anciens qu’on a retrouvés dans les souterrains du Capitole et par une de ces sources, que la piété des chrétiens a conservée, parce qu’elle servit, dit-on, à saint Pierre pour baptiser ses geôliers dans la prison Mamertine. Le Capitole était à pic du côté du Champ de Mars, là où on le gravit aujourd’hui par une pente doucement inclinée ; du côté du Forum, il était presque aussi abrupt, et Ovide parle encore de la pente escarpée qui conduisait dans le Forum et la vallée[42]. Je crois retrouver ce rude chemin dans une montée très roide qui porte le nom de Salita di Murforio. L’aspect primordial du Capitole, tel que l’a évoqué l’imagination savante de Virgile[43] et de Properce[44], était formidable. Sur ce mont solitaire que visitait seulement la foudre, Jupiter était présent par son tonnerre avant de l’être par son temple. Ces trois montagnes, je devrais dire ces trois collines, mais je parle comme l’orgueil romain[45], l’Aventin, le Palatin et le Capitole., forment un groupe à part, dans le voisinage du Tibre. Plus loin, quatre autres monts s’avancent tous dans le même sens comme se détachant de la plaine supérieure ; leur ensemble dessine un arc dont le Tibre serait la corde. Le premier qu’on rencontre en suivant du sud au nord ce demi-cercle de hauteurs, est le Caelius. Primitivement le Cœlius s’appelait le Mont des Chênes[46] ; ce nom indique la nature de la végétation qui le couvrait. Les sources du Caelius étaient nombreuses ; l’une d’elles porta le nom de source Argentine, une autre s’appelait source de Mercure. Celle-ci a été retrouvée de nos jours et reconnue à la bonté de son eau. A l’angle occidental du Cœlius, une fontaine sortait d’une grotte et se répandait à travers les herbes. Ce fut plus tard la fontaine de la nymphe Egérie, qui coulait sous un bois sacré, celui des Camènes ; la fontaine et le bois sacré subsistaient encore au temps de Juvénal[47]. Les chênes du Caelius descendaient dans la vallée qui le sépare de l’Esquilin et remontaient sur le flanc de cette dernière colline. Car précisément de ce côté se trouvait, sur l’Esquilin, la chapelle consacrée aux nymphes des chênes ; plus loin venait un lieu appelé Bois de Hêtres (fagutal). On suit, à la trace de ces dénominations locales, les vestiges des vieilles forêts de chênes et de hêtres qui couvraient l’Esquilin. A la base de cette colline, dans la région paludéenne, on nous venons de voir que le Vélabre s’étendait, fut anciennement le bois Argiletum, dont le nom demeura au quartier de Rome par lequel il fut remplacé. Tout près était Aussi bien que le quartier étrusque situé à l’extrémité
opposée du Vélabre, Ce nom d’un quartier de Rome plus ancien, nous le verrons, que Rome elle-même a subsisté au moyen âge dans celui d’une église, Sainte-Agathe in Subura ; il est rappelé encore aujourd’hui par la place Subura. En allant vers le nord, on franchit sans s’en apercevoir le dos étroit du Viminal, ainsi nommé des osiers (vimina) qui y croissaient ; c’est aujourd’hui, des monts de Rome, le seul un peu difficile à retrouver. On a d’abord quelque peine à le découvrir. Quand on vient de Sainte-Marie-Majeure, bâtie sur l’Esquilin, une faible montée vous amène sur le Viminal, qui ne paraît point détaché de l’Esquilin et du Quirinal. Mais, si l’on tourne à gauche pour suivre la rue que M. Charles Didier, dans sa Rome souterraine, a si bien nommée la rue champêtre de Saint-Vital, on aperçoit un escarpement peu différent sans doute de ce qu’il était quand le Viminal ne portait que des saules ; du reste, les abords de cette colline ont été anciennement champêtres, car sous le Viminal fut un sanctuaire consacré au dieu des bois, Sylvain[49]. Les saules du Viminal rappellent ceux dont on a trouvé près de là, sur le Pincio, les débris fossiles et rattachent ainsi aux âges géologiques les âges anciens de l’histoire ; les saules, dans plus d’un endroit de la campagne romaine, par exemple au Ponte-Nomentano, penchent encore leur chevelure élégante sur les eaux comme le faisaient jadis ceux du Viminal, car les eaux qu’aiment les saules ne manquaient pas plus à cette colline qu’aux autres collines de Rome. Puis vient un mont plus visible et plus célèbre, le Quirinal ; avec les trois derniers de ceux que j’ai énumérés avant lui, savoir : le Cœlius, l’Esquilin et le Viminal, le mont Quirinal forme un quatrième prolongement de la campagne romaine ; ce sont quatre promontoires qui s’allongent vers le Tibre et comme quatre doigts d’une main dont la plaine élevée de laquelle ils se détachent serait la paume immense. Cette main a saisi le monde. Jusqu’à Trajan, le Quirinal tenait au Capitole par une colline intermédiaire que cet empereur a supprimée pour établir son Forum, et dont la colonne Trajane, qui a cent pieds romains, indique, l’inscription qu’elle porte en fait foi, la plus grande hauteur. four nous représenter la configuration primitive du sol de Rome, il faut donc rétablir cette langue de terre qui unissait le Quirinal au Capitole, le Capitole formant alors l’extrémité d’une presqu’île, tandis qu’il est comme une île depuis Trajan. Pour l’intelligence de plusieurs faits de l’histoire romaine, nous devrons tenir compte de cette colline aujourd’hui disparue. Nous avons peu de renseignements sur l’antique végétation du Quirinal. La maison de Pomponius Atticus, située sur le Quirinal, était remarquable par ce que Cicéron appelle une forêt, sylva. Et rien n’empêche de reconnaître dans le parc de l’opulent Romain un reste de la forêt primitive. Ainsi j’ai vu aux États-Unis, près de la ville de Chicago, dans un jardin, des arbres qui avaient fait partie de la forêt vierge avant le défrichement. Mais Chicago, bien que renfermant quarante mille âmes, ne comptait alors que quinze années d’existence, et au temps de Cicéron Rome était âgée de sept siècles ; il est vrai qu’on était plus conservateur à Rome qu’aux États-Unis, et en particulier pour les arbres ; cependant on ne peut rien affirmer touchant l’antiquité de la forêt d’Atticus sur le Quirinal. Il n’y a pas de raison de supposer que dans une région partout boisée, sur sept collines, une seulement ait été nue. D’ailleurs on trouve quelques indices de la végétation primitive du Quirinal : il est question dans Ovide d’un bois sacré sur la colline de Quirinus[50]. Or les bois sacrés étaient souvent un débris soigneusement conservé des forêts antiques pour lesquelles on avait un superstitieux respect et que le souvenir des vieilles divinités du pays consacrait, car les bois avaient été les premiers temples[51]. Aussi trouve-t-on les bois sacrés de Rome debout à l’époque des régionnaires, c’est-à-dire au quatrième siècle de notre ère. C’est que les Romains, encore plus que les Anglais, avaient le respect des vieux arbres. Pour eux, ce respect était un culte ; il fallait un sacrifice peur expier la chute d’un arbre, même d’un arbre tombé de vétusté : abattre un arbre dans un bois sacré était un crime[52]. Les bois sacrés peuvent donc servir comme autant de jalons pour retrouver la forêt primitive. Or partout sont indiqués dans Rome des bois sacrés au delà du Tibre, le bois de Satriana[53], le bois de Furina, qui vit la mort de Tiberius Gracchus ; sur le Capitole, le bois de l’Asile ; sur la pente septentrionale du Palatin, le bois de Vesta ; sur le Cœlius, le bois des Camènes et les deux bois sacrés entre lesquels s’élevait la maison de l’empereur Tétricus[54] ; sur l’Esquilin, le bois de Méphitis et le bois de Junon-Lucine ; au pied de l’Esquilin, l’Argiletum et le bois de Strenia ; sur le Quirinal, le bois de Quirinus. Lors même qu’il n’est pas fait mention expresse d’un bois sacré, on peut en supposer l’existence partout où il y avait soit un temple, soit même une chapelle. Outre les bois sacrés, des groupes d’arbres ou des arbres isolés, qui provenaient sans doute de la forêt. primitive, achevaient d’en déterminer la physionomie et le caractère ; ainsi le cornouiller ne devait pas être rare, car on le trouve mentionné par la légende ou par l’histoire en plusieurs lieux[55]. Aux grands arbres se mêlait une végétation d’arbustes, parmi lesquels[56] le myrte, dont l’abondance contribua peut-être à rattacher l’origine de Rome à Vénus ; çà et là, un olivier, un figuier, un cyprès, un lotos[57], épargnés parce qu’ils se rapportaient à quelques vieux souvenirs, attestaient la présence de ces arbres, à une époque ancienne, sur le sol romain. Un palmier qui naissait spontanément donnait à cette végétation primitive l’air à demi oriental que les huit ou dix palmiers de Rome[58] donnent à la végétation romaine d’aujourd’hui. Un palmier naquit dans le temple de Jupiter au Capitole, pendant la guerre contre Persée ; un autre poussa entre les pierres de la maison d’Auguste, sur le Palatin, où les deux palmiers du couvent de Saint-Bonaventure font un si bel effet. Le sol de Rome n’a pas seulement changé d’aspect, il a
changé de forme. D’abord il est des collines qui n’ont pas toujours existé :
le Monte-Citorio, composé de ruines ; le Monte-Giordano, qui date du moyen
âge ; le singulier Monte-Testaccio, formé tout entier de vases brisés et qui
ne remonte pas jusqu’aux premiers siècles de notre ère. Pour retrouver l’état
primitif des collines anciennes, il faut faire abstraction des ruines
entassées sur leurs sommets ; l’exhaussement du sol, une des choses qui à
Rome étonne le plus les étrangers, ne s’observe pas seulement dans les lieux
bas, où il s’explique par l’accumulation des terres que diverses causes ont
pu y faire descendre ; on le remarque sur le sommet isolé du Palatin ; en
quelques endroits le sol antique ne paraît que si l’on creuse à une
profondeur de Déjà les anciens avaient été frappés de cet amoncellement et avaient cherché à l’expliquer par les incendies[59]. Quelquefois deux hauteurs séparées dans l’origine ont été
artificiellement réunies[60] ; quelquefois
aussi les pentes sont devenues plus escarpées par suite d’un éboulement de
rochers : c’est ce qui est arrivé pour la roche Tarpéienne au sixième siècle
de Rome[61]
et au seizième de l’ère chrétienne. Ces cas sont rares ; ce qui a eu lieu
beaucoup plus souvent, c’est que les sommets ont été aplanis eu effacés et
même que certaines hauteurs ont disparu, comme le Germale, mentionné avec Chacune des collines fut primitivement hérissée de mamelons, dont, pour la plupart, on ne saurait trouver aujourd’hui la trace. Nous le savons par un précieux témoignage. Varron, parlant des chapelles consacrées au culte antique des Argéens[66], nous apprend que ces chapelles étaient au nombre de vingt-quatre ou vingt-sept, que chacune était placée sur un sommet, et il fait l’énumération de la plupart de ces sommets. C’étaient autant de pointes, de saillies, s’élevant çà et là sur les collines de Rome. Pour retrouver en esprit la configuration primitive du sol romain, l’on doit donc, replantant sur chacun des sept monts l’espèce de bois qui le couvrait, ici les chênes, là les hêtres, là les lauriers, y dresser aussi de nouveau et y tailler à pic une vingtaine, au moins, de petits sommets à dont quelques-uns seulement subsistent et dont aucun n’est aussi marqué qu’il l’était à l’origine. Pour trouver quelque chose qui ressemble à cette physionomie primitive de Rome, il faut aller chercher les monticules épars dans la campagne ; et encore ceux-ci ont souvent perdu leurs saillies par suite de l’établissement à leur sommet d’une ville ou d’une villa. Maintenant, si je ferme les yeux à ce qui m’entoure pour voir ce qui a été ; si j’efface de mon esprit cette longue et mémorable histoire de Rome, je découvre une forêt, entrecoupée de clairières où sont des pâturages, et composée d’essences diverses ; elle couvre quelques collines et domine une plaine verdoyante et marécageuse, envahie par le Tibre. Dans cette forêt, les loups ont leur repaire, les oiseaux de proie font leur nid ; l’homme n’y a pas encore paru ; là où sera Rome est une forêt vierge. .... Incædua sylva virelat[67]. A la place où doit s’élever un jour la ville des rois, des consuls, des empereurs et des papes, il n’y a que des bois, des prés et des marécages. Jetons maintenant un coup d’oeil sur l’état primitif de la campagne romaine. La campagne romaine, aujourd’hui presque entièrement dépouillée d’arbre, présentait aussi l’aspect d’un pays boisé. Le culte antique du dieu Faunus, des faunes et des sylvains, divinités indigènes du Latium, le prouve, ainsi que le rôle mythologique du pic-vert et son nom picus donné à un roi latin, car cet oiseau n’habite qu’au plus profond des bois ; de plus, l’histoire mentionne dans les environs de Rome plusieurs forêts qu’on y chercherait vainement aujourd’hui. A cette heure, il ne reste guère que la grande forêt qui s’étend d’Ostie vers les marais Pontins, et encore était-elle plus étendue au temps de Pline le Jeune que de nos jours. Grégoire XIII en a abattu une partie. Nous connaissons par les auteurs la forêt Nœvia formée de chênes verts. cette forêt, voisine de l’Aventin, noire par l’ombre des yeuses[68]. Lucus Aventino proprior niger ilicis umbra. Vers expressif qui rend bien l’effet de l’ombre ténébreuse que ces arbres répandent sur le sol, et dont on peut vérifier l’exactitude en se promenant sous les beaux chênes verts de la villa Borghèse. Dans cette forêt, qui avait donné son nom à une porte de Rome, habitèrent plus tard des gens sans aveu, des bandits descendants des premiers sujets de Romulus et ancêtres des brigands de nos jours[69]. Ceux-ci, en général, n’exercent pas leur profession aux portes de Rome, où parfois ils paraissent cependant ; leurs repaires ont reculé de quelques lieues avec les forêts. Les brigands de l’antiquité devaient habiter également les environs du bois consacré à Laverna, patronne des voleurs, que la madone, honteuse dérision de ce que la religion a de plus pur, a parfois remplacée. La forêt des Malfaiteurs[70] a dû son nom aux hôtes qui la fréquentaient. Sur la rive droite du Tibre, à cinq milles de Rome, était la forêt Mœsia dont il reste à peine quelques vestiges[71]. Tite-Live parle d’un très grand bois entre le Tibre et la voie Salaria, dans lequel se réfugia une partie de l’armée romaine après le désastre de l’Allia[72]. Le lac d’Albano était entouré d’une forêt. Ovide est sur ce point d’accord avec Tite-Live[73], et la tradition qui donne à plusieurs rois fabuleux d’Albe le nom de Sylvius, homme des bois, semble confirmer par les témoignages les plus anciens la vérité de ce double témoignage. Aujourd’hui, on ne trouve un bout de forêt que plus haut, en gravissant le mont Albain (Monte-Cavi), à l’endroit où, sous les grands chênes, apparaissent tout à coup, parmi les feuilles tombées, les dalles de la voie Triomphale. Ovide dit, en parlant du lac de Nemi : Là est un lac ceint d’une épaisse forêt[74]. ......Sylva
præcinctus opaca Est
lacus. Il y avait donc en cet endroit une forêt. Cette forêt
était assez considérable pour faire donner au sanctuaire de Le petit bois de Cære est décrit dans Virgile avec des expressions qui aujourd’hui seraient exagérées[75]. Il y a, dit-il, un grand bois près du fleuve aux froides eaux de Cære. Ce bois s’étend au loin, consacré par la religion des aïeux. De partout des collines creuses l’enferment[76] et de noirs sapins l’environnent. Les sapins n’y ont guère laissé d’autre souvenir de leur présence que le nom d’une hauteur qui s’appelle la Sapinière[77] (Abetone). Les noms font partie de la physionomie des lieux ; souvent ils la représentent après qu’elle a changé et la conservent, pour ainsi dire, après qu’elle a disparu. Le nom antique d’Alsium (Palo) nous apprend qu’il y eut là autrefois un bois sacré (Alsos), et, si Préneste doit le sien, comme le veut Servius[78], aux chênes verts (prinoi) qui y abondaient encore au temps où il écrivait, cette étymologie nous révèle un trait de l’aspect ancien du pays, que son aspect moderne ne nous présente plus, du moins au même degré. La forêt du mont Algide, qui existait encore au moyen âge, n’existe plus[79]. C’est une loi universelle que les bois, s’ils ne sont entretenus avec soin, vont toujours occupant un moindre espace. Chaque jour en Italie, on voit ceux de l’Apennin achever de périr ; les forêts de la campagne romaine, que la culture croissante et des guerres continuelles pendant les quatre premiers siècles de Rome ont concouru à faire disparaître, ont dû avoir plus tôt le même sort. On peut donc, d’après la nature et les noms des lieux, affirmer de la campagne de Rome ce que de nombreux témoignages nous ont conduit à établir pour la ville elle-même. Elle fut dans l’origine une vaste forêt. Les bouquets d’arbres suspendus sur les hauteurs dont est
semée la campagne romaine, comme le petit bois voisin de ce qu’on appelle à
tort Dans la campagne, de même qu’à Rome, le sol était originairement hérissé de broussailles ; ces broussailles que Virgile replaçait avec raison sur le Capitole contemporain d’Évandre, on les retrouve sur les tertres, d’où elles n’ont pas disparu, comme sur le Capitole, devant les temples aux toits dorés ; nous les trouvons par exemple sur la colline de Fidène, où elles étaient avant que personne fût là pour les voir. Ici, l’ancien aspect s’est conservé ; ailleurs, il a reparu. Quand Cicéron disait d’Astura : lieu agréable[80], il montrait ce lieu tel que la civilisation et l’élégance romaine l’avaient fait. Aujourd’hui, en présence de la tour solitaire d’Astura, si notre regard se promène sur cette plage triste, inhabitée, funeste à Auguste, à Tibère, à Conradin[81], nous n’apercevons que la forêt, les sables et la mer. De nos jours cet endroit sinistre ressemble, mieux qu’au temps de Cicéron, à ce qu’il était avant la naissance du premier Romain. Les eaux, plus mobiles que le sol, ont parfois changé
comme lui d’aspect. Les cascades de Tivoli, après avoir été bouleversées dans
l’antiquité[82],
viennent de l’être sous nos yeux ; une nouvelle chute. a été créée. Les
anciennes cascades elles-mêmes n’étaient pas antiques. La plus grande avait
reçu de la main des hommes une partie de son caractère. Ce que l’on appelle Au. cinquième siècle de la république, Curius Dentatus,
après avoir vaincu les Sabins, voulut vaincre aussi la nature ; il fit
écouler les eaux du Velino dans Ce changement artificiel de l’état des eaux ne fut pas accompli sans provoquer une querelle entre les autorités municipales de Rieti et celles de Terni[83] ; il en a été de même au moyen âge et à la fin du dernier siècle. On risque à imposer des perturbations violentes à la nature aussi bien qu’à la société. Primitivement l’Anio, comme le Tibre, était plus profond, et cela en vertu de la cause générale que j’ai signalée : l’exhaussement constant du lit des fleuves. Pline[84] dit qu’il a été navigable, et tous les efforts des modernes pour le rendre tel ont échoué. Il était plus large ; on le voit, au pont Salaro, trop grand pour le lit actuel du fleuve. Par contre, d’autres petits fleuves se sont amoindris ; le Numicius (Rio Torto) s’est en partie perdu au sein des marais, et, dans le mince et peu profond cours d’eau qui en reste, Énée, avec la meilleure volonté du monde, ne pourrait se noyer aujourd’hui[85]. Le Tibre aussi a changé au-dessus et au-dessous de Rome. Nous lisons dans Tite-Live[86] qu’il a été plus étroit devant Fidène, et l’on sait que des deux bras qu’il forme vers son embouchure, le bras occidental, le seul dont on se sert aujourd’hui, est un canal artificiel. L’île Sacrée, près d’Ostie, est un produit du Tibre ; avant les temps historiques, à l’embouchure, unique alors, du Tibre il n’y avait pas d’île[87]. La côte du Latium tout entière à la même origine ; à l’extrémité de la vallée du Tibre, elle s’accroît de douze pieds au moins par an. Prise dans son ensemble, elle avance plus lentement, mais elle avance toujours, et, quand la belle carte de M. Rosa, ce découvreur de la campagne romaine, sera publiée, on y verra, plus nettement qu’on n’a pu le faire jusqu’ici, ces empiétements du sol sur la mer à partir des collines qui formaient autrefois le rivage de cette mer. Les marais Pontins ont dû mériter mieux qu’aujourd’hui ce nom de marais, que leur état présent ne justifie pas complètement, car une partie de la région que l’on désigne ainsi se compose de pâturages marécageux, on des hommes à cheval, enfoncés jusqu’à la ceinture dans les grandes herbes, poussent de leur lance des boeufs à demi sauvages. Sans doute, au temps de la civilisation romaine, lorsqu’il y avait trente-trois villes dans les marais Pontins[88], qu’on y recueillait du blé en abondance[89], que les armées romaines y campaient[90], que les tribuns, pour gagner la faveur des plébéiens, demandaient que ce territoire fût partagé entre eux[91], les eaux marécageuses devaient occuper moins d’espace ; mais, dans l’origine, avant qu’elles fussent refoulées par l’habitation et la culture, elles devaient être beaucoup plus envahissantes qu’elles ne l’ont été depuis, et même ne le sont redevenues de nos jours ; comme les marais de la vallée de l’Arno étaient, beaucoup plus considérables qu’ils ne le sont à présent lorsque Annibal eut tant de peine à les franchir et perdit un oeil en les traversant[92]. Le resserrement ou la disparition des marais et des lacs est un fait général dans la campagne romaine. Le lac de Lariccia, le lac Régille, n’existent plus depuis l’antiquité. Le lac Juturne a été desséché par Paul V. J’ai encore vu le lac de Gabies ; il a été desséché de mon temps par le prince Borghèse, petit-neveu de Paul V, et à cette heure on travaille à diminuer le lac Fucin. On voit donc que la campagne romaine, elle aussi, a changé d’aspect. En contemplant le tableau que nous avons devant les yeux, et dont nos yeux ne se lassent pas d’admirer la grandeur, nous pouvons en évoquer un autre assez différent : une campagne couverte d’arbres, où il y a plus de lacs, traversée gardes cours d’eau plus profonds et plus larges, s’arrêtant là où commencent les alluvions qui l’ont augmentée du côté de la mer, et, à son extrémité, les marais Pontins, étendant des nappes d’eau immenses. Si la campagne romaine a changé plusieurs fois d’aspect
depuis les temps antiques jusqu’à nos jours, il y a des choses qui n’ont
point changé : c’est l’éclat de la lumière, la beauté et la sérénité du ciel[93]. Les admirables
montagnes qui encadrent le paysage romain offrent à peu près le spectacle
qu’elles présentaient, il y a trente siècles ; elles sont moins boisées, sans
doute, surtout celles de Les spectateurs manquèrent aux premiers actes de ce drame qui se jouait obscurément loin du monde grec, dans un coin reculé du Latium, entre les montagnes et la mer. Mais le jour arriva où ce coin du monde en devint le centre, où le drame, en se continuant, commanda l’attention universelle et força tous les peuples à le regarder et à y prendre part. L’Histoire et la poésie se sont chargées d’en célébrer les acteurs ; les intelligences et les imaginations cultivées de tous les siècles et de tous les pays ont assisté de loin à cet étonnant spectacle dont j’ai voulu donner à mon tour un compte rendu. Pour cela je suis venu m’asseoir, quand la pièce était
finie, sur un de ces gradins abandonnés ; j’ai évoqué les grands morts dont
la poussière était sous mes pieds, et pour moi la pièce a recommencé. Tandis
qu’elle se jouait de nouveau en ma présence, il m’a semblé que je n’étais
plus seul, que je voyais autour de moi d’innombrables générations venir
occuper les places vides, dans ce théâtre magnifique qui semble avoir été
fait à dessein pour la plus grande représentation historique donnée par |
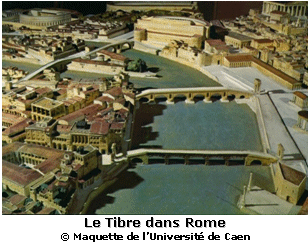 Or les eaux du Tibre ne sont pas blanchâtres, mais
jaunâtres. Sur ce point le témoignage de nos yeux est d’accord avec celui des
poètes de l’empire : Horace
Or les eaux du Tibre ne sont pas blanchâtres, mais
jaunâtres. Sur ce point le témoignage de nos yeux est d’accord avec celui des
poètes de l’empire : Horace